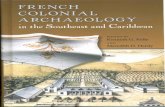L'eau dans la vie quotidienne - Centre pilote la main à la pâte
La Vie quotidienne au Château de Silves (Algarve, Portugal)
Transcript of La Vie quotidienne au Château de Silves (Algarve, Portugal)
AUSONIUS ÉDITIONS Scripta Mediævalia 15
Le château au quotidien
Les travaux et les jours
Actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire en Périgord
les 28, 29 et 30 septembre 2007
Textes réunis parAnne-Marie COCULA
& Michel COMBET
Diffusion DE BOCCARD 11 rue de Médicis F - 75006 PARIS— Bordeaux 2008 —
AUSONIUSMaison de l’ArchéologieUniversité Michel de Montaigne - Bordeaux 3F - 33607 Pessac Cedexhttp://ausonius.u-bordeaux3.fr/EditionsAusonius
DIFFUSION DE BOCCARD11 rue de Médicis75006 Parishttp://www.deboccard.com
Directeur des Publications : Jérôme FRANCE
Secrétaire des Publications : Nathalie TRAN
Graphisme de couverture : Stéphanie VINCENT
© AUSONIUS 2008ISSN : en coursISBN : 978-2-35613-004-4
Achevé d’imprimer sur les pressesde l’imprimerie La Nef-Chastrusse87, quai de Brazza - BP 28F - 33015 Bordeaux cedex
septembre 2008
CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
LA VIE QUOTIDIENNE AU CHÂTEAU DES SILVES (ALGARVE, PORTUGAL) XIIe-XIIIe SIÈCLES
Rosa Varela GOMES
INTRODUCTION
Silves se situe dans la province d’Algarve, sur le bord du fleuve Arade, à l’extrême sud de l’actuel territoire portugais (fig. 1).
Le château de Silves est l’une des fortifications musulmanes les mieux conservées et les plus importantes de la Péninsule Ibérique. Elle a été édifiée au Xe siècle et réaménagée aux XIIe et XIIIe siècles (fig. 2). Elle présente, également, des vestiges de l’occupation chrétienne qui suivit (structures et matériaux archéologiques), comme les témoignages de la résidence du gouverneur ou alcaide reconnue, récemment, près du pan ouest de la muraille (fig. 3).
Les fouilles que nous menons à l’intérieur du château montrent que, depuis au moins le VIIIe siècle, vécut à cet endroit une importante communauté musulmane, probablement, patricienne. Cette constatation est illustrée par un rare ensemble de céramiques et d’autres pièces importées du Moyen-Orient. La couche archéologique correspondante, dont la chronologie, relative comme absolue, indique qu’elle date de la moitié du VIIIe siècle ou du début du siècle suivant, apporte la confirmation d’une occupation musulmane très ancienne 1. Les informations écrites dont on dispose indiquent qu’elle remonterait à 713, quand le prince Abdalaziz a conquis Silves. Au-dessus de cette couche, d’autres se dessinent à travers des restes de structures, de sols et de vestiges divers, mais aussi grâce à quelques constructions bien conservées qui se superposent ou s’adossent à d’autres, constituant ainsi une longue série stratigraphique qui correspond à ce que l’on désigne en Orient sous le nom de tell, soit une colline artificielle.
Les vestiges les mieux conservés du château sont les restes de constructions érigées au cours d’une période comprise entre sa reconquête par les musulmans en 1191, et la conquête définitive de Silves, par les chrétiens, en 1248. De grands travaux furent alors entrepris à l’intérieur de cette enceinte. On procéda notamment à la construction ou au réaménagement d’une grande partie des dispositifs défensifs
1. Gomes 1995, 21-34 ; Gomes 2002, 50 ; Gomes 2003, 467-506.Gomes 1995, 21-34 ; Gomes 2002, 50 ; Gomes 2003, 467-506.
48 ROSA VARELA GOMES
Fig. 1. Carte du sud du Portugal avec la localisation de la ville de Silves.
Fig. 2. Vue du sud du château de Silves.
LA VIE QUOTIENNE AU CHÂTEAU DE SILVES 49
visibles et d’au moins deux palais. On réalisa aussi la monumentale citerne, d’une capacité suffisante pour approvisionner près de 1 200 personnes pendant un an, ainsi que d’énormes silos à céréales – au nombre de six, dans l’état actuel de nos recherches – dans lesquels on pouvait stocker cet aliment essentiel en quantité suffisante pour cette même durée (fig. 4). Cet aspect nous a conduit à considérer cette fortification comme une véritable citadelle-grenier.
Nous avons observé qu’au cours de cette période, d’environ un demi-siècle, avaient également été réaménagés des lieux d’habitations que nous avons repérés à cet endroit, articulés entre eux par des rues ou de petites places. Les fouilles entreprises dans l’un de ces lieux, que nous avons initialement dénommé le “complexe balnéaire”, nous ont permis de découvrir qu’il faisait partie du palais d’un aristocrate, gouverneur du territoire de Silves, comme semble l’indiquer le plus grand espace occupé au centre du château et la cote plus élevée en comparaison avec les autres habitations identifiées.
Ce complexe, fouillé seulement en partie, comprenait un grand patio, avec jardin, et ses accès, salon de réception et annexes, des installations sanitaires et des bains, dûment compartimentés et équipés de baignoires, avec chauffage par hypocauste, un jardin avec un grand parterre, possiblement utilisé à l’origine comme bassin ou comme piscine. Une partie du jardin était couverte. On observe donc que, dans ce cas particulier, au-delà de leurs fonctions hygiéniques et prophylactiques, les bains faisaient partie d’un espace de loisirs qui correspondait au jardin où étaient éventuellement servis des repas dans une atmosphère parfumée par les plantes et les essences que l’on faisait brûler.
Une autre édification, la mieux conservée, se trouve dans la partie sud-ouest du château (fig. 5). Il s’agissait très certainement de la résidence d’un membre important de la hiérarchie politico-militaire ou, plus exactement, de plusieurs membres, étant donné que, selon les informations archéologiques dont nous disposons, cette structure fut édifiée dans le courant du second quart du XIIe siècle et occupée jusqu’à
Fig. 3. Vue du château et de la ville de Silves (photo Jorge, F. 2005, 89).
50 ROSA VARELA GOMES
Fig. 4. Château de Silves - vue de l’intérieur de l’aljibe et coupe de deux des silos qui y ont été identifiés.
Fig. 5. Reconstitution graphique du palais almohade.
LA VIE QUOTIENNE AU CHÂTEAU DE SILVES 51
la moitié du XIIIe, soit durant plus d’un siècle. Elle fut donc habitée par au moins trois générations 2.
Ce palais comptait deux niveaux et deux patios, l’un correspondant à une zone semi-privée et l’autre à une zone privée. Il était équipé d’installations sanitaires et d’un complexe balnéaire chauffé par hypocauste. Parmi les réaménagements effectués après 1191, nous pouvons mentionner la réorganisation du jardin, la rénovation du sol de l’un des patios et, également, outre d’autres travaux, nous pensons que furent réalisées, à cette période, des décorations en stuc qui ornaient les trois arcades de l’un des patios et celle qui donnait accès au salon principal de la maison (fig. 6). Cette dernière arcade reposait sur une colonne avec un beau chapiteau en marbre.
Les interventions archéologiques dans le château, toujours en cours, ont permis d’identifier de nouveaux espaces d’habitations islamiques, dans la zone nord et nord-ouest, peut-être occupés par des militaires ou par le personnel des palais évoqués plus haut. Ils obéissent à un modèle que l’on retrouve dans plusieurs citadelles de grandes dimensions, comme celle de Málaga et même dans l’Alhambra de Grenade. Ce sont des maisons plus modestes qui s’organisent autour des patios, permettant la liaison avec les différents compartiments (fig. 7).
LES TÉMOIGNAGES DE LA VIE QUOTIDIENNE
Au château de Silves, il y avait évidemment des différences entre le quotidien des élites qui habitaient les palais, où les espaces étaient plus grands et l’architecture plus complexe, et celui des habitants des maisons plus modestes. Mais, en dépit de ces disparités, les céramiques culinaires étaient semblables dans les cuisines des palais et des petites maisons.
La cuisine, après le salon, était l’espace couvert le plus important de la maison pour ce qu’elle représentait en termes sociaux et économiques. Cependant, la zone où étaient préparés et cuisinés les aliments n’était pas vraiment délimitée, étant donné l’utilisation fréquente d’un ou plusieurs réchauds, ainsi que d’un foyer adossé au mur ou à l’un des coins de la pièce, aussi bien à même le sol que sur un plan surélevé. Cette constatation peut avoir un lien avec la tradition de nombreux peuples méditerranéens où la cuisine se trouvait à l’extérieur de la maison, ou était mobile selon les saisons de l’année et le temps qu’il faisait. C’est probablement ce qui explique la découverte de nombreux réchauds lors des fouilles archéologiques. La cuisine servait aussi à entreposer des aliments et, en particulier, l’eau, dans des pots et des cruches (fig. 8) ; toutefois, les palais possédaient des espaces spéciaux pour les réserves alimentaires, les garde-manger, en plus des silos où étaient conservées les céréales, mais aussi les fruits secs qui étaient ainsi gardés en bon état pendant plusieurs années.
En plus des réchauds, il y a une autre pièce commune à toutes les cuisines islamiques : la marmite, qui constitue même l’ustensile le plus nombreux, avec une
2. Gomes 2003, 53.
52 ROSA VARELA GOMES
Fig. 6. Fragment de stuc du palais almohade.
Fig. 7. Reconstitution graphique des habitations islamiques du château de Silves (R. et M. V. Gomes).
LA VIE QUOTIENNE AU CHÂTEAU DE SILVES 53
Fig. 8. Château de Silves – des cruches.
Fig. 9. Château de Silves – des marmites.
54 ROSA VARELA GOMES
grande diversité de formes et de tailles (fig. 9). Le grand nombre de marmites que nous avons recueillies est probablement dû au fait que les aliments bouillis et les ragoûts étaient préférés aux aliments grillés et rôtis. Cette préférence s’explique non seulement par les aspects liés au goût et à la tradition culinaire, mais aussi pour des raisons économiques, puisque ce mode de cuisson permettait de profiter au maximum des aliments, surtout de la matière organique animale. En effet, les études faunistiques déjà réalisées pour les fonds du château de Silves ont démontré une grande consommation d’ovins et de caprins, qui étaient découpés en petits morceaux et cuits de manière à mieux profiter de la viande, comme la graisse et la mœlle des os 3. Certaines de ces marmites, en particulier celles qui sont vitrifiées, pouvaient être utilisées pour garder des aliments, surtout des graisses. La batterie de cuisine comprenait aussi les poêles et les casseroles, présentant presque toujours d’importants vestiges d’utilisation sur le feu, mais en petit nombre. Un autre récipient typique de la cuisine islamique, dont nous avons recueilli quelques spécimens est le couscoussier, pour la cuisson à la vapeur. Les bassines étaient utilisées pour préparer les pâtes, en vue de la confection du pain ou d’autres aliments, mais elles pouvaient aussi être utilisées pour laver la vaisselle ou le linge, voire tout simplement pour se laver les mains. Il s’agit donc d’un ustensile polyvalent et très répandu, raison pour laquelle il présente différentes tailles et, bien souvent, son usage n’est pas réservé à la cuisine.
Les cruches et les brocs, compte tenu de leurs tailles, permettaient de transporter facilement et surtout de stocker de petites quantités d’eau. Disposés en rang, sur des plans en pierre ou en bois, normalement dans la cuisine ou à côté, ils pouvaient avoir un couvercle et, posés sur celui-ci, des pichets ou des cruchons.
Les grands pots (talhas), récipients pour stocker de grandes quantités d’aliments, solides ou liquides, se trouvaient dans les cuisines ou les garde-manger. Toutefois, ceux qui contenaient de l’eau, présentant des surfaces émaillées de couleur verte, en totalité ou en partie, et une profusion de décoration estampillée, intercalée avec des éléments incisés, voire plastiques, étaient disposés dans les cours des palais, où nous avons retrouvé des fragments, afin de désaltérer leurs habitants ou d’éventuels visiteurs. L’iconographie représentée à l’extérieur de ces pièces est variée et montre des motifs à caractère anthropomorphique (main de Fatima), zoomorphique, lettriforme, architectural ou géométrique, ce qui permet de les considérer comme des pièces de prestige, liées au statut social et économique de leurs propriétaires.
Dans les maisons plus modestes les repas devaient être pris près du foyer, où ils avaient été préparés, tandis que dans les palais ils étaient servis dans les salons où il y avait, sur l’un des côtés, une alcôve. Les repas étaient servis dans des tripodes mais, surtout, dans de grandes coupes émaillées, quelques-unes à décoration incisée ou estampillée, qui pouvaient avoir des couvercles hermétiques, dans lesquelles étaient servis fruits secs, condiments et sauces, ainsi que les desserts et les fruits qui, en plus des plats principaux, complétaient les repas (fig. 10, 11). Des coupes plus
3. Gomes 2002, 73-76.
LA VIE QUOTIENNE AU CHÂTEAU DE SILVES 55
petites pouvaient être utilisées pour les épices, le sel et, tout comme les petits pots, être utilisées pour boire de petites quantités de liquide. Les boissons étaient servies dans des cruches, mais aussi dans des théières, comme le thé à la menthe. En plus des pièces en céramique, il pouvait y avoir, sur ces tables copieuses, des récipients en verre (pichets) qui contenaient de l’eau ou même du vin.
Les couteaux aident à couper les aliments, mangés à la main et probablement à l’aide de cuillers en bois qui ont disparu. Les lavabos qui contenaient de l’eau permettaient de se laver les mains durant le repas. Parmi les pièces énoncées ci-dessus, il manque certainement les ustensiles produits dans des matériaux périssables et qui ont rarement été conservés, mais dont nous savons qu’ils ont existé sur les tables islamiques, notamment des récipients en différentes fibres végétales tressées, et les cuillers, déjà citées, ou d’autres récipients en bois.
Lorsque l’obscurité tombait, les lampes à huile éclairaient les lieux. La salle était parfumée par les essences brûlées dans les brûleurs, ainsi que par les odeurs
Fig. 10. Château de Silves – des coupes émaillées.
Fig. 11. Château de Silves – des coupes vitrifiées.
56 ROSA VARELA GOMES
des arbres et des plantes des jardins, comme le grenadier, l’abricotier et l’arbousier, entre autres, des espèces identifiées dans les jardins des palais du château de Silves (fig. 12).
Durant la journée, les jardins des maisons plus modestes et des zones privées des palais étaient utilisés par les femmes, certaines parées de boucles d’oreilles et de bagues. Elles se consacraient au filage et au tissage, une occupation dont sont parvenues jusqu’à nous des aiguilles, en os, pour faire tenir les écheveaux de fils sur les quenouilles, ainsi que des fusaïoles, également en os ou en métal, des fuseaux et des manches de quenouilles, en os, plus ou moins décorés (fig. 13). Autour d’elles, les enfants jouaient avec des jouets en céramique et aussi aux dés.
En ce qui concerne les activités ludiques, pour tous les âges, nous avons exhumé de nombreux vestiges de jeux, en céramique ou en os, dans tous les espaces d’habitation du château de Silves, ainsi que des plateaux de jeu en pierre, mais qui pouvaient également être composés de graphites, et de séries de creux représentés sur le sol, ce qui n’excluait pas l’existence d’autres objets, ayant les mêmes fonctions, mais ne figurant pas sur le relevé archéologique car ils étaient construits en matériaux périssables, comme le bois.
Parmi les jouets utilisés, nous avons retrouvé des pièces de dînettes en céramique, produites dans le même type de pâte et avec la même décoration que les pièces grandeur nature 4. Ces dînettes étaient, comme elles le sont encore aujourd’hui, réservées aux fillettes et, en plus de leur fonction ludique, elles avaient aussi une fonction didactique, pour l’apprentissage de la cuisine et l’élaboration d’aliments, en suivant les instructions des mères et/ou des préceptrices.
Les complexes balnéaires, privés, étaient non seulement des espaces de loisirs et de purification, avant les cinq prières de la journée, mais ils permettaient aussi aux habitants des palais de bénéficier de différents soins d’hygiène. Ceux-ci pouvaient être effectués dans les espaces cités et dans les installations sanitaires que nous avons repérés dans tous les lieux d’habitation du château de Silves et aussi au hammam public, situé près des portes de la ville, puisque nous n’avons pas encore retrouvé de complexe balnéaire collectif dans cette forteresse, comme c’est le cas dans le quartier fortifié de l’Alhambra de Grenade ou même dans la forteresse de Málaga.
Dans les bains privés, nous avons retrouvé des récipients en verre utilisés pour contenir des parfums, ainsi que des petits pots et des coupes. Nous avons aussi remarqué la présence de pinces à épiler, peignes, épingles à cheveux, perles de colliers et bracelets, entre autres pièces utilisées pour l’hygiène et aussi comme ornements. Le mobilier et les ustensiles n’abondaient pas dans la maison médiévale musulmane : une économie de moyens touchait presque tout le monde, exceptées les élites qui pouvaient acheter et jouir d’un plus grand nombre de biens, surtout exogènes et somptuaires.
4. Gomes 2004, 103-116.
LA VIE QUOTIENNE AU CHÂTEAU DE SILVES 57
Pendant les fouilles, nous avons recueilli plusieurs objets métalliques, en plus de ceux déjà cités, tels que boucles de ceintures, poignées de portes, anses de chaudrons, clous, grelots, ainsi que huit monnaies musulmanes. Parmi celles-ci, la plus ancienne correspond à un qirat almoravide frappé au nom d’Ali ben Yusuf, sans atelier ni date, mais indiquant le nom de son héritier Sir (1128-1139). Cette pièce fut trouvée sous le couloir d’accès au palais, situé dans le secteur sud-ouest du château, et elle doit dater de l’époque de cette construction. Un dirham carré indique le nom de l’atelier où il a été frappé (Qurtuba), tandis que les autres, même s’ils appartiennent à la période Almohade, sont anonymes et ne portent aucune indication de leurs ateliers d’origine 5.
5. Gomes 2003, 178-180.
Fig. 12. Château de Silves – brûleur d’essences (photo M. V. Gomes).
Fig. 13. Château de Silves – manches de quenouilles (photo M. V. Gomes).
58 ROSA VARELA GOMES
Les grelots que nous avons retrouvés pourraient éventuellement être des instruments de musique, en raison du son qu’ils émettent ; ils pouvaient aussi servir à l’ornement des animaux domestiques, ou encore constituer des pièces de colliers ou de bracelets dont nous connaissons des exemples, aussi bien en Europe qu’en Afrique du Nord 6. L’activité cynégétique des habitants peut être représentée par quelques balles de fronde et armatures de flèches ou d’arbalètes, que nous avons retrouvées, même si nous croyons que la plupart de ces armes datent de la conquête de cette fortification.
L’architecture, la décoration et les vestiges recueillis, en particulier dans les palais, témoignent du goût raffiné des habitants, ainsi que de leur pouvoir économique, attestés par les pièces en verre, un grand nombre de céramiques et d’objets métalliques retrouvés qui étaient importés par différents ateliers d’Al-Andalus ainsi que d’Afrique du Nord.
LA CONQUÊTE CHRÉTIENNE
Ce quotidien a été abruptement interrompu en 1248 avec la conquête chrétienne du château.
Parmi les témoignages de cette conquête figure un ensemble abondant d’armatures de flèches ou de carreaux d’arbalète (pointes de flèches, pointes incendiaires, pointes de carreaux), ainsi que de fragments d’armes blanches en fer. Les pointes de flèches ou de carreaux sont les armes les plus nombreuses, mais il est impossible de savoir si elles ont été utilisées par des chrétiens ou des musulmans. Ces derniers utilisaient souvent l’arc comme arme, sur l’indication du prophète lui-même qui aurait préconisé son utilisation, dans le verset suivant : “Celui qui tire une flèche par amour de Dieu, qu’il touche ou non l’ennemi, aura une place spéciale à côté de son Seigneur” 7.
Les nombreuses balles de fronde, en calcaire ou en grès, que nous avons retrouvées doivent dater de cette époque. Elles constituaient des armes de trait, faciles à se procurer et à utiliser, très répandues à partir du XIIe siècle. Une balle de fronde fut représentée sur une enluminure, en position de tir et dans la main d’un musulman qui participait à la défense de Majorque avant sa conquête par le roi d’Aragon et de Catalogne 8 au XIIIe siècle. Nous avons aussi recueilli des balles de catapulte, en grès rouge, dont la plupart s’étaient cassées au moment de l’impact. Des insignes chrétiens, comme celui représentant saint Thomas Becket, archevêque de Canterbury, canonisé en 1173, monté à cheval et représenté avec la mitre d’archevêque, qu’aura perdu un chevalier participant à la reconquête de cette place, ainsi que des éléments cruciformes considérés comme des insignes d’arbalétriers 9, attestent la présence
6. Homo-Lechner 1996, 130, 131.7. Boudot-Lamotte 1968, 42.8. Nicole 1976, 108, fig. 122.9. Ward-Perkins 1993, 119 ; Egan & Pritchard 1991, 210, 214 ; Gomes 2003, 160, 161, 188, 191,Ward-Perkins 1993, 119 ; Egan & Pritchard 1991, 210, 214 ; Gomes 2003, 160, 161, 188, 191,
LA VIE QUOTIENNE AU CHÂTEAU DE SILVES 59
probable de croisés lors de cette conquête (fig. 14). Un squelette humain non inhumé, tombé à plat ventre suite à une mort violente provoquée par un trait d’arbalète, a été trouvé dans le jardin du complexe balnéaire qui appartenait au gouverneur, sous une couche de gravats et de terre brûlée, témoignant de la lutte féroce qui eut lieu au moment de la conquête définitive du château.
Sur les dalles du palais situées dans la partie sud-ouest du château ont été gravées des représentations de lances et de fleurs de lys, l’une d’elles sur la deuxième marche de l’escalier qui menait à l’étage supérieur de cet espace d’habitation. L’une de ces dernières a une pointe triangulaire large, pourvue d’une nervure centrale et d’un long manche, semblable à l’exemplaire présenté dans le “Códice Rico de las Cantigas”, attribué à l’infanterie chrétienne dans une chronologie située entre 1200 et 1300 10. La fleur de lys représente, par excellence, l’emblème du christianisme. Elle symbolise la pureté céleste, l’innocence et la virginité, mais aussi la régénération, la prospérité et le pouvoir. Elle fut donc très tôt choisie comme symbole héraldique des monarques français. Symbole de la féminité et de l’amour, elle se répandit en Europe, surtout à partir du XIe siècle, associée au culte croissant voué à la Vierge Marie. Les représentations de fleurs de lys et d’armes gravées sur le sol du palais témoignent de l’appropriation de la forteresse, centre du pouvoir politique et administratif de la ville, par les chevaliers chrétiens représentés par ces symboles héraldiques, ainsi que par la force des armes attestée par les lances figurées.
Les recherches menées dans le château de Silves ont permis non seulement de comprendre l’organisation du secteur où les fouilles ont été effectuées mais également de mettre au jour un nombre important de vestiges, notamment des éléments architecturaux. Elles ont, de plus, permis l’étude de ce qui est jusqu’à présent le seul palais musulman du XIIe-XIIIe siècles, connu sur le territoire portugais.
193.10. Soler del Campo 1993, 41, 237, 307.
Fig. 14. Château de Silves – Insigne représentant saint Thomas Becket, archevêque
de Canterbury (photo M. V. Gomes).
60 ROSA VARELA GOMES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Boudot-Lamotte, A. (1968) : Contribution à l’Étude de l’Archerie Musulmane, principalement d’après le Manuscrit d’Oxford Bodléienne Huntington 264, Damas.
Egan, G., Pritchard, F. (1991) : Dress Accessories. Medieval finds from excavations in London. Londres.
Gomes, R. V. (1995) : “Cerâmicas muçulmanas, dos séculos VIIIe-IXe de Silves” Primeiras Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: Métodos e Resultados para o seu estudo, Tondela, 21-34.
— (2002) : “Silves (Xelb) – Uma cidade do Gharb Al-Andalus: território e cultura”, Trabalhos de Arqueologia, 23.
— (2003) : “Silves (Xelb) – Uma cidade do Gharb Al-Andalus: a Alcáçova”, Trabalhos de Arqueologia, 35.
— (2004) : “Brinquedos muçulmanos – Um aspecto do quotidiano no Sul de Portugal (séculos XII-XIII)”, Estudos Medievais, Lisbonne, 103-116.
Homo-Lechner, C. (1996) : Soins et Instruments de Musique au Moyen Âge, Archéologie Musicale dans l’Europe du VIIIe au XIVe siècles, Paris.
Jorge, F. (2005) : O Algarve visto do Céu, Lisbonne.Nicole, D. (1976) : Early Medieval Islamic Arms and Armour, Cáceres.Soler del Campo, A. (1993) : La evolución del armamento medieval en el Reino Castellano-Leonés y
Al-Andalus (siglos XII-XIV), Madrid.Ward-Perkins, J. R. (1993) : London Museum Medieval Catalogue, Londres.