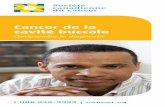Untitled - Convention des Nations Unies sur la Diversité ...
Comprendre la diversité des modes d’organisation quotidienne après 50 ans
-
Upload
sciences-po -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Comprendre la diversité des modes d’organisation quotidienne après 50 ans
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RS&ID_NUMPUBLIE=RS_053&ID_ARTICLE=RS_053_0067
Comprendre la diversité des modes d’organisation quotidienne après 50ans
par Émilie BILAND
| La Documentation française | Retraite et société2008/1 - n° 53ISSN 1167-4687 | pages 67 à 87
Pour citer cet article : — Biland n, Comprendre la diversité des modes d’organisation quotidienne après 50ans, Retraite et société 2008/1, n° 53, p. 67-87.
Distribution électronique Cairn pour La Documentation française.© La Documentation française. Tous droits réservés pour tous pays.La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
En refusant d’adopter une définition a priori du handicap, et ensurreprésentant, au sein d’un échantillon représentatif de la populationfrançaise, les personnes rencontrant quotidiennement des difficultés duesà un ou plusieurs problèmes de santé, l’enquête «Handicaps-Incapacités-Dépendance » (HID)11 regroupe des personnes que l’on qualifiehabituellement de handicapées et des personnes âgées dites dépendantes.
Dépendants et handicapés sont communément distingués par leur âge etle moment d’apparition de leurs premières difficultés (au cours de lavieillesse pour les premiers, avant celle-ci pour les seconds). Au momentde l’enquête et jusqu’à une époque récente (cf. encadré ci-contre), cesdifférences justifiaient que les politiques sociales les considèrent commedeux catégories administratives bien distinctes. La catégorie du handicapest définie par rapport à l’activité professionnelle : face à elle, il s’agit defavoriser l’insertion sur le marché du travail, de donner accès à desemplois protégés ou encore de compenser l’absence de revenus dutravail. La catégorie des «personnes âgées dépendantes », dont lareconnaissance est plus récente, s’est construite en réponse aux besoinsde prise en charge suscités par l’apparition d’un nouvel âge de la vie (le« quatrième âge », le « grand âge») pour lequel le maintien à domicilepeut s’avérer problématique.
Cette construction progressive d’un traitement séparé du handicap adulteet de la dépendance des plus âgés relève d’une «naturalisation desquestions sociales » (Frinault, 2005). Une telle approche « ségrégative»méconnaît en particulier le rapprochement des profils de mortalité despersonnes handicapées par rapport à ceux de la population générale(Azéma, Martinez, 2005) : la société se trouve pour la première foisconfrontée à une génération de handicapés vieillissants, dont la priseen charge pose des problèmes spécifiques. L’analyse proposée ici« départicularise » le problème des «personnes âgées dépendantes »pour raisonner, de manière générale, sur les difficultés de viequotidienne et sur les manières d’y faire face : elle cherche à rendrecompte de la diversité des situations de vie des personnes vieillissantes.Mais rendre compte de cette diversité suppose, au préalable, qu’on cerneprécisément le contenu des catégories administratives qui servent depoint de départ à l’analyse.
68
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
Émilie BILAND, Centre Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS-UCBN)
1 Réalisée au tournant des années 2000 par un groupe de projets réunissant l’Insee,l’Ined, l’Inserm, le RFR Vieillissement, Santé, Société, la Drees, le Credes et leCTNERHI. Pour une présentation de l’enquête, voir Ravaud et al., 2002.
69
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
Amorcée avec la loi du 23 novembre 1957, la politique de réinsertion professionnelle des« inaptes au travail » s’appuie, depuis la loi d’orientation du 30 juin 1975 et jusqu’à la loidu 11 février 2005, sur des institutions départementales, les Cotorep (commissionstechniques d’orientation et de reclassement professionnel) qui statuent sur différentstypes de reconnaissance. Il s’agit principalement de mesures relatives au travail(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, orientation professionnelle,abattement de salaire, emploi dans la fonction publique, prime de reclassement,subvention d’installation) et de l’octroi d’allocations (allocation pour adulte handicapé,allocation compensatrice pour tierce personne, allocation compensatrice pour fraisprofessionnels) (Demoly, 2005).
Nous avons défini comme « reconnue» une personne qui reçoit une allocation ou qui esttitulaire d’une carte d’invalidité ou encore qui a reçu une réponse positive suite à unedemande déposée à la Cotorep2.
La reconnaissance administrative des difficultés liées au grand âge vise, de son côté, lemaintien à domicile. Conçue en 1986 dans un souci de lutte contre le chômage, lapolitique de développement de l’aide à domicile, amorcée par des avantages fiscaux, estcomplétée, à la fin des années quatre-vingt-dix, par des prestations financières. Laprestation spécifique dépendance (PSD), créée en 1997 et remplacée en 2002 parl’allocation personnalisée à l’autonomie (Apa), marque la reconnaissance d’un risquespécifique à la vieillesse, distinct du risque d’inaptitude au travail. Ces prestationsdoivent aider à la professionnalisation des aidants, ou à la rémunération des aidantsfamiliaux, puisque l’Apa est aussi bien versée à ceux qui restent à domicile qu’à ceux quivivent en institution. Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête HID sontcependant peu concernées par ces mesures, il est vrai récentes au moment del’enquête : seuls 37 enquêtés de plus de 60 ans déclarent recevoir la PSD en 1999.Cela ne nous permet pas de construire une variable spécifique de « reconnaissanceadministrative de la dépendance».
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances des handicapésconstitue une première traduction législative de la nécessité de penser ensemble etd’apporter des réponses communes à ces deux formes de difficultés de vie quotidienne.Une unification des différents dispositifs, sans distinction d’âge, est ainsi prévue àl’échéance 2011. En application de cette loi, les Cotorep sont remplacées, depuis 2006,par les commissions des droits et de l’autonomie au sein des Maisons départementalesdes personnes handicapées qui regroupent aussi les services destinés aux personnesdites dépendantes.
Reconnaissances administratives du handicapet de la dépendance
2 Cet indicateur doit cependant être manipulé avec précaution car il est construit àpartir de données déclaratives qui sous-estiment la reconnaissance effective.Mentionnons que les personnes « reconnues» peuvent avoir plus de 60 ans, dansla mesure où certaines prestations délivrées par la Cotorep (en particulier la carted’invalidité) ne connaissent pas de limite d’âge supérieure.
En complétant les indicateurs biomédicaux à partir desquels cescatégories ont été construites (cf. encadré ci-dessous) par un indicateurqui associe les activités qui donnent lieu à prise en charge et lesindividus impliqués dans cette prise en charge, nous nous demanderonss’il existe effectivement deux modes d’organisation de la vie quotidiennecorrespondant, l’un à la catégorie institutionnelle de «handicap», l’autreà celle de « dépendance». En d’autres termes, nous tenterons de mesurerles effets, sur la prise en charge, de la construction récente de lacatégorie de « dépendance», et de les comparer aux conséquences despolitiques du handicap sur les populations plus jeunes. Ce faisant, nousserons amenés à proposer nos propres définitions de ces deux catégories,et à en construire de nouvelles pour rendre compte de l’ensemble de lapopulation étudiée.
70
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
Pour penser les différents registres de difficultés, l’enquête HID reprend les catégoriesde l’ancienne Classification internationale des handicaps3, qui distingue les«déficiences», définies comme des «pertes de substance ou altération d’une structureou fonction psychologique, physiologique ou anatomique», et les « incapacités»,définies comme des « réductions, partielles ou totales, de la capacité d’accomplir uneactivité d’une façon ou dans des limites considérées comme normales pour un êtrehumain».
Déficience et incapacité
Rappelons pour commencer que la pertinence des seuils d’âges retenuspour distinguer handicap et dépendance fait l’objet de nombreux débats.Les prestations «dépendance» sont accessibles dès 60 ans. Or lespremières exploitations de HID ont montré que « le seuil des 60 ans n’estpas un seuil à partir duquel la proportion de personnes dépendantes estparticulièrement forte» (Duée, Rebillard, 2004). L’âge légal de la retraiteapparaît aujourd’hui comme « largement en contradiction avec leprocessus du vieillissement», si bien que certains plaident pour une«abolition de seuil » (Colvez, Villebrun, 2003) et pour une redéfinitiondes étapes habituellement retenues pour l’entrée dans l’âge de lavieillesse. Du fait de l’avancement de l’âge légal de la retraite, mais aussides politiques nationales de traitement du chômage et des pratiques desentreprises, la génération née dans l’entre-deux-guerres s’est retirée dumarché du travail plus tôt que la génération précédente, alors même quel’espérance de vie en bonne santé se prolongeait. Avec l’allongement del’espérance de vie, le calendrier des différents seuils caractéristiques de lavieillesse est beaucoup moins resserré que dans le passé, quand retraite,veuvage, et décès se suivaient souvent en l’espace d’une décennie.
3 La CIH a été construite par l’Organisation mondiale de la santé en 1980. Depuis2001, la classification internationale du fonctionnement (CIF) la remplace. Celle-ciinclut, outre la déficience et l’incapacité, la notion de «désavantage» (conséquencedes précédentes qui limite l’accomplissement d’un rôle social «normal »).
L’enquête HID a interrogé les mêmes personnes en 1999 et 200144, sousréserve qu’elles aient continué à vivre à leur domicile. Les spécificités dece dispositif permettent de procéder à une analyse diachronique destrajectoires actuelles du vieillissement. Nous cherchons en particulier àtester l’hypothèse d’un étalement des différentes étapes de celui-ci :vieillissement biologique ou fonctionnel avec l’apparition desincapacités, vieillissement institutionnel avec le départ à la retraite et lerecours à différentes prestations, vieillissement familial enfin, avec laperte du conjoint. Nous avons construit notre échantillon afin de prendreen compte ces différentes étapes. Dans la mesure où une part nonnégligeable des personnes interrogées se retire du marché du travailavant 60 ans (22% des personnes qui partent en retraite ou préretraiteentre 1999 et 2001 sont quinquagénaires), nous avons inclus lesquinquagénaires dans notre échantillon (cf. encadré ci-dessous), ce quipermettra d’examiner la pertinence du départ à la retraite comme entréedans le processus de vieillissement.
71
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
Font partie de notre échantillon, les personnes qui :– ont 50 ans au moins en 1999 ;– ont répondu aux deux vagues 1999 et 2001 de l’enquête à domicile ;– déclarent avoir au moins une difficulté dans la vie quotidienne5 ;– et qui ont renseigné les questions sur les aidants quand elles déclaraient recevoir
une aide humaine.
L’échantillon ainsi constitué comprend 7610 personnes, ce qui représente 60% despersonnes interrogées, tous âges confondus. La moitié de ces individus ont plus de70 ans. 9 sur 10 sont inactifs et un peu plus de la moitié (56%) sont des femmes.
Définition de l’échantillon
4 Notons que 18,9% des personnes interviewées en 1999 n’ont pu être interrogéesdeux ans plus tard, soit qu’elles fussent décédées (1,8%), soit qu’elles fussententrées en institution (0,4%), soit qu’elles eussent refusé la deuxième interview(7,1%), soit qu’on eût perdu leur trace (9,6%).
5 Le module B de l’enquête interroge les individus sur 28 activités, potentiellementsources de difficultés (depuis la difficulté à se lever jusqu’à la difficulté à suivre uneconversation).
6 Les personnes vivant en institution ont été interrogées en 1998 et en 2000, dansdeux autres volets de l’enquête.
Dans la mesure où nous nous intéressons principalement aux formesfamiliales de prise en charge, nous avons utilisé le volet «Ménages» del’enquête HID, lequel interroge des personnes vivant en ménageordinaire, et non en institution66. Notre étude porte donc sur lesconditions qui rendent possible ce maintien à domicile, en particulier sur
les formes de mobilisation familiale77. Cette question des «aidantsfamiliaux » rejoint l’interrogation sur la pertinence des catégories del’action publique. Nous cherchons à déterminer si les personneshandicapées et les personnes âgées dépendantes ont des recoursdifférents à l’aide familiale, ainsi qu’à estimer la place de l’aide familialedans l’entrée «en dépendance».
Pour tester ces hypothèses, nous mobiliserons successivement trois typesd’outils statistiques. À partir d’analyses des correspondances multiples,nous commencerons par identifier les différents modes d’organisation dela vie quotidienne (reliant indicateurs sociodémographiques, indicateursbiomédicaux et type de prise en charge) construits par la populationétudiée. Des diagrammes de cohortes nous permettront ensuite depréciser le « calendrier » du vieillissement et les enchaînements entre sesdifférentes étapes. Enfin, au moyen de régressions, nous estimerons lesrépercussions des différentes transitions sur l’évolution des modes deprise en charge entre les deux vagues de l’enquête.
■ Identifier les modesd’organisation quotidiennedes personnes vieillissantes
Du fait de la définition très large du vieillissement adoptée, notreéchantillon présente une grande diversité. L’âge constitue le premierfacteur de diversité : les personnes les plus jeunes, quinquagénaires,s’opposent, sur plusieurs plans, aux personnes les plus vieilles del’échantillon. En termes d’indicateurs socioprofessionnels d’abord, laprésence importante d’agriculteurs et de professions indépendantes(artisans, commerçants, chefs d’entreprise) au sein des classes d’âges lesplus âgées, et son déclin chez les plus jeunes, témoigne du mouvementde salarisation qu’a connu la société française dans la deuxièmemoitié du vingtième siècle. Les plus jeunes appartiennent d’ailleursplus fréquemment aux classes populaires, lesquelles sont plussouvent confrontées au handicap au cours de l’âge adulte que les autres
72
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
7 En d’autres termes, les changements de prise en charge observés ici neconcernent qu’une partie de l’échantillon d’origine : celle pour qui la détérioration del’état de santé ou la perte de l’aidant principal n’a pas remis en cause le maintienà domicile parce qu’elle a réussi à mobiliser d’autres aidants. L’enquête«Ménages» ne permet pas d’étudier le départ vers la maison de retraite, le foyer-logement ou l’hôpital, départ qui introduit pourtant une distinction à l’intérieur de laclasse d’âges considérée (Joël, 2003), et qui est statistiquement corrélé à l’intensitédes soutiens familiaux (les personnes en institution ont un réseau familial moinsdense que celles qui restent chez elles : Désesquelles, Brouard, 2003).
PCS (Ravaud, Mormiche, 2000). En outre, notre population estmajoritairement inactive, y compris dans les groupes d’âges les plusjeunes. Toutefois, l’enquête montre que les raisons de l’inactivitévarient avec l’âge. Les quinquagénaires ont plus souvent dû arrêter detravailler du fait de leurs problèmes de santé et ont, de ce fait, plussouvent accès aux dispositifs de reconnaissance du handicap liée àl’inaptitude au travail. Les plus âgés, en revanche, sont souvent restésactifs jusqu’à l’âge de la retraite. Des différences liées à l’âge s’observentégalement au plan de la situation familiale (cf. encadré, p. 74). Alors queles quinquagénaires font face au départ des enfants du foyer, lesoctogénaires sont nombreux à retourner vivre chez ceux-ci ou chezd’autres parents (situation dite de « recohabitation»).
Le sex-ratio, enfin, est sensible à l’âge : les femmes deviennentmajoritaires dès la tranche d’âges 60-69 ans et leur surreprésentations’accentue avec l’âge. Nous raisonnons ici sur une populationparticulière, puisque les 7 610 individus de notre échantillon rencontrentdes difficultés de vie quotidienne. Deux effets se conjuguent donc.Un effet valable sur la population générale : les femmes de 60 ansbénéficiant, en 2002, d’une espérance de vie de cinq ans supérieure àcelle des hommes (Insee, 2004), elles sont plus nombreuses dans lesclasses d’âges avancés. Un effet spécifique à cet échantillon : les femmessont moins concernées par les difficultés à l’âge actif, mais le sontdavantage durant la vieillesse (Cambois, Désesquelles, Ravaud, 2003).
L’âge est aussi un facteur de division du point de vue de l’aide humaine.Les nonagénaires sont ainsi quatre fois plus souvent aidés que lesquinquagénaires (cf. tableau 1). L’aide pour les activités « vitales » (cf.encadré, p. 74) est la forme la plus sensible à l’avancée en âge, ainsi qu’àla sévérité des déficiences. Un tiers des octogénaires bénéficient d’uneaide pour ce type d’activité contre un sixième des quinquagénaires.
73
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
Couple avecenfant(s)ou famille
monoparentale
Couplesans enfant Isolé
Ménagecomplexe
(recohabitation)
50-59 ans 38,3 36,0 18,2 7,5
60-69 ans 14,9 56,5 21,0 7,6
70-79 ans 7,5 54,9 30,6 7,0
80-89 ans 6,3 33,2 50,1 10,4
90-99 ans 10,0 14,8 53,7 21,5
Population étudiée 16,4 47,4 28,2 8,0
Tableau 1. Type de ménage par tranche d’âges en 1999 (en %)
Note : échantillon =7610 personnes.
La part de personnes qui ne bénéficient d’aucune aide humaine diminuefortement avec l’âge. L’écart de prise en charge entre quinquagénaireset nonagénaires est encore plus important quand on considère le typede personnes apportant leur aide. Si l’aide familiale varie peu avecl’avancée en âge, le recours à une aide exclusivement professionnelle yest sensible. Il croît jusqu’à 89 ans, âge à partir duquel l’aideprofessionnelle se cumule de plus en plus souvent avec l’aide familiale(cf. tableau 2).
74
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
L’enquête 1999 interroge les enquêtés sur leur capacité à effectuer seul et/ou sansdifficulté trente-trois activités différentes (de « faire sa toilette» à «se pencher pourramasser un objet»). À partir de ce questionnaire, on distingue les types d’aide suivants(Eideliman, 2003) :– aide pour des activités de sociabilité, marqueurs de l’intégration sociale des individus
(sortir de son logement, communiquer avec son entourage, etc.) que nous appelonsactivités sociales ;
– aide pour des activités que l’on peut éviter de faire par recours au marché (faire ses achats, faire les tâches ménagères, etc.) et que nous appelons substituables ;
– aide pour des activités fondamentales de la vie quotidienne (faire sa toilette,s’habiller, manger, boire, etc.) que nous appelons vitales.
Aide «vitale», aide «substituable», aide «sociale»
Aideexclusivement
familiale
Aide familialeet
professionnelle
Aideexclusivementprofessionnelle
Pas d’aidehumaine
50-59 ans 24,4 4,9 2,6 68,1
60-69 ans 24,5 5,4 5,0 65,1
70-79 ans 18,0 9,4 8,3 64,3
80-89 ans 23,0 24,5 16,6 35,9
90-99 ans 29,5 44,3 10,1 16,1
Total 22,0 9,9 7,2 60,9
Tableau 2. Aide humaine et type d’aidants par tranche d’âges (en %)
Note : échantillon =7610 personnes.
La population enquêtée semble donc bien structurée par une oppositionentre les personnes «handicapées» (plutôt jeunes, de milieu plutôtpopulaire, et dont les difficultés sont apparues dans l’enfance,l’adolescence ou à l’âge actif) et les personnes «dépendantes » (de milieuplus aisé, leurs difficultés sont apparues après 60 ans et suscitent uneprise en charge plus souvent professionnelle). Mais l’enquête permetsurtout de mettre en lumière la différence entre la population la mieuxciblée par les politiques de la dépendance, autour du seuil des 70 ans,
et les plus jeunes, qui sont restés en amont du dispositif : lesquinquagénaires qui rencontrent depuis peu des difficultés dans la viequotidienne bénéficient rarement d’une aide humaine.
Une analyse en correspondances multiples88 (cf. graphique 1) met enrelation les indicateurs sociodémographiques avec les indicateursbiomédicaux et les types de prise en charge (cf. tableau 3). En distinguantquatre modes d’organisation de la vie quotidienne, qui présententchacun des combinaisons différentes du couple «aidants/type d’aideapportée », elle complexifie notablement le schéma binairehandicap/dépendance.
75
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
Graphique 1. Analyse des correspondances multiples
Note : échantillon =7610 personnes.
8 L’analyse en correspondances multiples permet d’étudier et de représenter, enutilisant les fonctions graphiques, les associations deux à deux de plusieursvariables qualitatives. Elle donne donc la possibilité de visualiser l’espace sur lequelse situent ces différentes variables les unes par rapport aux autres. Sur le graphe 1ci-dessus, on remarque par exemple l’éloignement entre le point «50-59 ans» (enhaut) et le point «70-79 ans» (en bas).
Tableau 3. Variables actives utilisées dans l’ACM
Variables qui contribuent à l’axe horizontal Variables qui contribuent à l’axe vertical
Déficience motrice/pas de déficience motrice
Déficience grave/peu de déficience
Aide vitale/pas d’aide, beaucoup dedifficultés/pas d’aide, des difficultés
Pas de nouvelle incapacitédepuis dix ans/nouvelle incapacité
depuis moins de deux ans
Âge décennal
Ménage avec enfant/ménage isolé
Reconnu administrativement/pasde reconnaissance
Inactif pour raison de santé/inactif/actif/travail normal/travail protégé
Aide familiale/aide professionnelle/aide mixte
Cette analyse des correspondances multiples (ACM) permet d’opposer,dans son côté est, le handicap (au nord) et la dépendance (au sud).Handicapés comme dépendants sont aidés pour des activités que nousqualifions de vitales. Ce qui les distingue, ce sont les personnes qui leurapportent cette aide : les personnes handicapées, relativement jeunes,souvent reconnues administrativement, sont aidées uniquement parleur famille, au contraire des personnes âgées dépendantes, quidisposent d’une aide professionnelle souvent complémentaire de l’aidefamiliale. Cependant, ni l’opposition entre les plus jeunes et les plusvieux des enquêtés, ni l’opposition entre handicapés et dépendants, nesuffisent à décrire notre population. En plus de ces deux situationsconnues, la moitié ouest du graphique met en évidence deux autressituations, l’« aménagement » et le « soutien». Certains quinquagénairessouffrent effectivement de difficultés importantes, ne travaillent plus,bénéficient de mesures institutionnelles compensatrices et sont aidés parleur famille (quart nord-est qui correspond au handicap) : ceux-cipeuvent être dits handicapés. Mais d’autres quinquagénaires, dont lesdifficultés sont stabilisées depuis longtemps, ont pu mettre en placedes routines leur permettant de travailler et d’être autonomes (quart nord-ouest). Nous proposons le terme d’«aménagement » pour qualifier cemode d’organisation. De même, il y a effectivement des individus deplus de 70 ans «dépendants » (quart sud-est du graphique), qui souffrentde déficiences à la fois graves et récentes et cumulent aide familiale etaide professionnelle. Mais certaines personnes (projetées dans le quartsud-ouest) sont seulement « soutenues» : atteintes, par exemple, detroubles auditifs, il leur arrive de faire appel à une aide humaine (plutôtprofessionnelle) mais celle-ci porte sur des activités que le recours à desservices payants pourrait remplacer (faire ses achats, accomplir les tâchesménagères) et non sur des activités « vitales ». Finalement, si quatreoctogénaires sur dix dépendent d’autrui pour des activités « vitales », untiers est seulement soutenu pour des activités « substituables » et uncinquième parvient encore à se passer d’aide humaine, en ayant recoursà une aide technique ou en évitant de se livrer à certaines activités.
Les catégories construites par l’analyse statistique sont donc plusnombreuses que celles construites par les pouvoirs publics. Si deuxd’entre elles se correspondent assez largement (handicapés etdépendants), les situations de soutien et d’aménagement restent encorepeu prises en charge par les politiques publiques. Le suivi de cohortesopéré par l’enquête HID va à présent nous permettre de montrer que cescatégories ne sont pas étanches l’une à l’autre : il existe deschevauchements qui rendent plus délicat le ciblage des populations.
76
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
■ Report et étalement des seuilsdu vieillissement
Remarquons avant toute chose la grande variabilité des probabilitésd’occurrence des différents types de changement intervenus entre 1999et 200199. Les changements biomédicaux (Cambois, Lelièvre, 2004) sontles plus fréquents : la moitié de la population connaît de nouvellesdéficiences, un tiers de nouvelles incapacités. Au contraire, un quartdes enquêtés connaissent un changement de prise en charge entre1999 et 2001, soit qu’ils reçoivent désormais de l’aide alors qu’ils sedébrouillaient seuls auparavant (près d’un changement sur deux), soitqu’ils aient au contraire perdu l’aide dont ils bénéficiaient (un cas surtrois), soit enfin qu’ils ne soient plus aidés par le même type depersonnes (un cas sur cinq). Les évolutions des configurations d’aideprésentent donc une relative inertie par rapport à l’évolution de l’état desanté. Mais elles sont plus fréquentes que les changements familiaux etinstitutionnels qui ne concernent qu’une petite minorité d’enquêtés : 3%pour le départ à la retraite et le veuvage, 5% pour le changement dereconnaissance.
En constituant des cohortes de personnes nées la même année, et enprojetant la situation de chacune de ces cohortes à deux ans d’intervalle,on peut déterminer à quel moment ces différents changements ont lieu.Plus précisément, les diagrammes ci-dessous permettent de comparer lasituation des différentes cohortes et de formuler des hypothèses sur lestransformations qu’ont pu générer les changements des modes de priseen charge de la dépendance intervenus au tournant des années 2000.Ces diagrammes indiquent en outre un deuxième type d’effet, dit effetd’âge. Nous sommes en effet en mesure de comparer la situation d’unmême groupe d’âges à deux ans d’intervalle, au moment de la premièreet de la deuxième vague de l’enquête. Cette comparaison permet derépondre à la question de l’effet d’un vieillissement de deux ans pour unmême groupe d’âges.
77
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
9 L’organisation de l’enquête en deux vagues successives auprès des mêmesenquêtés est essentielle pour prendre en compte l’évolution dans le temps desmodes d’organisation de la vie quotidienne. Elle ne permet cependant pas decerner l’ensemble des changements possibles. L’écart de deux ans entre lesenquêtes apparaît à la fois trop long pour cerner les périodes de crise (telle que lamort subite d’un conjoint ou la dégradation brutale, mais pas forcément irréversible,de l’état de santé) et trop bref pour appréhender les changements au long cours ducalendrier du vieillissement et de la prise en charge.
Comme on pouvait s’y attendre, le départ à la retraite est la transition laplus précoce. Ce changement de situation vis-à-vis du marché du travailsemble souvent associé à un changement du point de vue de lareconnaissance du handicap. Le graphique 2 fait apparaître un seuil trèsnet, dès 60 ans : seules les deux cohortes qui franchissent ce cap pendantl’enquête présentent un taux de reconnaissance qui diminue entre 1999et 2001. L’âge officiel de la retraite produit donc des effets observablesdans HID. Plus étonnant est le seuil observé à 70 ans : à cet âgecorrespond une chute brutale du taux de reconnaissance du handicap,sans qu’aucune génération ne connaisse une diminution de sareconnaissance entre les deux vagues de l’enquête. Le remplacementd’une sous-population reconnue (handicapée, au sens où nous l’avonsdéfini plus haut) par une sous-population non reconnue (ditedépendante) se ferait donc autour de soixante-dix ans. Ce constat de lanon-reconnaissance des personnes âgées doit cependant être nuancé,puisque l’on observe une augmentation du taux de reconnaissance avecl’âge au-delà de 80 ans qui pourrait correspondre au développementrécent des politiques d’aide aux personnes dépendantes.
78
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
Graphique 2. Part des personnes bénéficiant d’une reconnaissanceinstitutionnelle (selon l’âge)
Lecture : chaque segment du diagramme représente la situation en 1999 (point de départ) et en2001 (point d’arrivée) des personnes nées la même année. En 1999, 27% des personnes de 70ans sont « reconnues». Deux ans plus tard, en 2001, 30% des individus de cette même cohorte(alors âgés de 72 ans) sont « reconnus».
Le seuil suivant est lié aux incapacités (cf. graphique 3). C’est à partir de66 ans (en 1999) que la part de personnes rencontrant de nouvellesincapacités1100 augmente nettement. Entre 66 et 90 ans, la part d’unecohorte qui rencontre de nouvelles difficultés passe de moins de 20% àplus de 60%. Jusque-là, on a surtout affaire à des personnes dont l’étatde santé est stabilisé, mais peu à peu les personnes dont l’état de santése dégrade prennent plus d’importance. Une nouvelle variablecomplexifie donc les définitions jusqu’ici données du handicap et de ladépendance : aux personnes les plus jeunes, handicapées, les difficultésau long cours, aux personnes âgées dépendantes les difficultésnouvelles, l’état de santé qui se dégrade. Quant aux handicapésvieillissants, ceux qui ont depuis longtemps des incapacités et quiatteignent un âge avancé, ils commencent, comme les personnes de leurclasse d’âges, à souffrir de nouvelles déficiences, sans que nosstatistiques soient assez fines pour cerner si cette dégradation est vécuedifféremment selon que l’on était, ou non, en situation de handicapauparavant.
79
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
Graphique 3. Part des personnes qui connaissent de nouvelles incapacitésdepuis moins de deux ans
Lecture : chaque segment du diagramme représente la situation en 1999 (point de départ) et en2001 (point d’arrivée) des personnes nées la même année. En 1999, 20% des personnes de 70ans font face à des incapacités apparues depuis moins de deux ans. Deux ans plus tard, en2001, 31% des individus de cette même cohorte (alors âgés de 72 ans) font face à desincapacités apparues depuis 1999.
10 Rappelons ici que nous nous basons sur des données déclaratives. Or, il existed’importantes différences dans la perception des incapacités selon l’appartenancesociale. La perte d’autonomie liée au vieillissement est ressentie de manière tout àfait différente selon que l’on avait ou non recours à des services rémunérés (emploide personnel domestique, visites régulières chez le pédicure, etc.) avant que lesincapacités n’apparaissent.
Les seuils relatifs à la prise en charge sont plus difficiles à cerner. Le sensdu changement (perdre l’aide dont on bénéficiait ou en obtenir quand onn’en avait pas deux ans plus tôt) varie selon l’âge. Les générationsd’environ 65 ans en 1999 se débrouillent plus souvent seules en 2001qu’en 1999. Cela peut refléter l’importance, autour de 65 ans, soit desrémissions ou des décès, soit des départs des plus dépendants vers desprises en charge institutionnelles. Au contraire, en vieillissant de deuxans, les individus de plus de 70 ans sont de moins en moins nombreuxà se débrouiller seuls (cf. graphique 4). Parmi ces plus de 70 ans, ce sontles cohortes les plus jeunes qui obtiennent le plus souvent de l’aide entreles deux vagues de l’enquête. C’est ici probablement l’effet des nouvellesmesures de soutien aux personnes dépendantes âgées, lesquelles étaientprincipalement destinées aux septuagénaires au moment de la créationdu dispositif.
80
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
Graphique 4. Part des personnes se débrouillant seules (selon l’âge)
Lecture : chaque segment du diagramme représente la situation en 1999 (point de départ) et en2001 (point d’arrivée) des personnes nées la même année. En 1999, 63% des personnes de 70ans se débrouillent seules. Deux ans plus tard, en 2001, 54% des individus de cette mêmecohorte (alors âgés de 72 ans) se débrouillent seules.
On observe un seuil voisin concernant la prise en charge par desprofessionnels (cf. graphique 5). À partir de 75 ans, face à l’apparitiondes nouvelles incapacités, l’aide professionnelle apparaît comme lavariable d’ajustement, soit qu’elle pallie l’absence d’aide familiale, soitqu’elle s’y adjoigne. Le ciblage des populations âgées par les politiquesde professionnalisation de l’aide à domicile fait clairement sentir seseffets.
Ces diagrammes de cohorte confirment la nécessité de nuancerl’opposition entre handicapés et dépendants. S’ils mettent effectivementen évidence la substitution d’un type de population par un autre, ilsmontrent aussi que cette substitution prend du temps. Selon l’indicateurretenu, le vieillissement est sensible dès 60 ans (retraite, reconnaissanceinstitutionnelle) ou 65 ans (incapacités) ou seulement à partir de 70 ans(veuvage), 75 ans (aide professionnelle) voire 80 ans (recohabitation).Les instruments statistiques utilisés jusqu’ici nous ont malgré tout permisde montrer une différence importante entre les personnes décritescomme handicapées et les personnes dépendantes : celle-ci résideraitdans l’absence ou la présence de professionnels dans la prise en chargedes incapacités. Pour étayer cette hypothèse, nous proposons à présentde raisonner sur l’articulation entre seuils du vieillissement etchangements de prise en charge. Nous cherchons à identifier les facteursqui ont conduit, entre 1999 et 2001, à un changement dans la prise encharge ainsi que dans le type d’aidants mobilisés.
81
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
Graphique 5. Part des personnes aidées par des professionnels(selon l’âge)
Lecture : chaque segment du diagramme représente la situation en 1999 (point de départ) et en2001 (point d’arrivée) des personnes nées la même année. En 1999, 15% des personnes de 70ans sont aidées par un(e) professionnel(le) exclusivement. Deux ans plus tard, en 2001, 18%des individus de cette même cohorte (alors âgés de 72 ans) sont aidés par un(e)professionnel(le) exclusivement.
■ Des transitions biographiquesaux changements de prise en charge
Pour ce faire, l’accent a été mis sur les personnes qui n’étaient pas aidéesen 1999 pour savoir si elles avaient obtenu de l’aide deux ans plus tard.Le cas échéant, étaient-elles désormais aidées par des membres de leurfamille ou par des professionnels ? Toutes choses égales par ailleurs, lefait d’avancer en âge, d’être une femme, de disposer d’unereconnaissance administrative, de souffrir de déficiences récentes ousévères augmente la probabilité d’acquérir de l’aide entre les deuxvagues de l’enquête1111. Pour préciser ces effets généraux, nous avonsréparti notre population en trois classes d’âges : moins de 60 ans, 60-70ans, plus de 70 ans. Nous avons successivement testé trois modèles (unpar classe d’âges) de choix discrets correspondant à trois situations :la probabilité de continuer à se débrouiller seul en 2001 ; la probabilitéd’obtenir une aide professionnelle ou mixte ; la probabilité d’obtenirune aide exclusivement familiale (cf. tableau 4). Ces régressionspolytomiques1122 montrent que certains déterminants sont plus ou moinssignificatifs selon les groupes d’âges.
82
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
11 Notons que les effets de la position et de l’origine sociale sont difficiles àdéterminer. La profession du père de l’enquêté(e) et son propre niveau de diplômene sont pas toujours significatifs dans les modèles de régression logistiqueestimés, et quand ils le sont, ils ne jouent pas de manière linéaire. Par exemple,à sévérité de déficience donnée, être diplômé diminue les chances d’obtenirune aide. Est-ce à dire que les diplômés qui ont besoin d’aide ont été mieux prisen charge plus tôt ?
12 Les modèles de régression autorisent un raisonnement « toutes choses égales parailleurs» : ils mesurent l’effet propre de chacune des variables intégrées au modèle.Le modèle de régression polytomique non ordonné utilisé ici permet de tester, à ladifférence des régressions logistiques habituelles, plus de deux hypothèses. Ici,nous testons trois hypothèses : être toujours autonome ; obtenir une aideexclusivement familiale ; obtenir une aide professionnelle ou mixte.
Tableau 4. Régressions polytomiques sur les personnes autonomesen 1999 - Valeur test : rester autonome
Moins de 60 ans 60-69 ans 70 ans et plus
Nombre d’observations 978 1 164 2 450
Sont toujours autonomes 852 1 031 1 791
Obtiennent une aideprofessionnelle ou mixte
27 43 321
Obtiennent une aideexclusivement familiale
99 90 338
83
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
Obtenir une aideprofessionnelle ou mixte vscontinuer à être autonome
Obtenir une aideexclusivement familiale vscontinuer à être autonome
< 60 ans 60-69ans > 69 ans < 60 ans 60-69
ans > 69 ans
Constante -1,3 -12*** -12,5*** -1,3 -4,5 -12,3
Sévérité des déficiences en 1999A des déficiences importantesN’a pas de déficiences importantes
Réf.0,1
Réf.- 0,09
Réf.- 0,1
Réf.- 0,1
Réf.- 0,2**
Réf.- 0,2 ***
Âge d’apparition des 1res incapacitésAvant 45 ansEntre 45 et 60 ansEntre 60 et 75 ansAprès 75 ansÂge inconnu
Réf.0,4--
-0,6*
Réf.0,3
0,05
-0,8 **
Réf.0,2
-0,030,1
-0,2**
Réf.0,5 ***
--
-0,2***
Réf.- 0,030,3
-0,6***
Réf.0,3 **
0,10,1
-0,6 ***
Évolution des déficiencesStabilitéAméliorationDégradation
Réf.- 0,7
0,8**
Réf.0,3
0,5 **
Réf.- 0,2
0,6***
Réf.- 0,6 *0,8 ***
Réf.- 0,090,5***
Réf.- 0,2
0,6 ***
Nombre d’enfants (variable continue) -0,3 -0,2 * -0,01 0,05 0,1* 0,06
Filles dans la descendance a
A au moins une fille vivanteN’a pas de fille dans sa descendance
Réf.- 0,3
Réf.0,05
Réf.- 0,08
Réf.0,1
Réf.- 0,05
Réf.- 0,08
Statut professionnel en 1999Inactif pour raison de santéInactifN’a jamais travailléA un travail normalA un travail protégé
Réf.- 0,70,5-1*0,3
Réf.-
- 1,2 *-
-0,7
Réf.- 0,10,1
-0,0003-
Réf.- 0,6**
-0,10,20,8
Réf.- 0,8*0,009-0,11,6
Réf.0,7 ***1,2 ***
--
Changement de statut professionnelToujours inactifToujours actifPassage de l’activité à l’inactivité
Réf.0,3
0,08
Réf.-
- 2,2 **
Réf.--
Réf.- 0,30,04
Réf.0,02-0,3
Réf.--
Changement de statut matrimonialEst devenu veufN’est pas devenu veuf
Réf.-
Réf.- 0,1
Réf.- 0,5***
Réf.- 0,05
Réf.-
Réf.- 0,3 **
Reconnaissance administrativeEst reconnu administrativementN’est pas reconnu administrativement
Réf.- 0,4
Réf.- 0,1
Réf.- 0,1
Réf.- 0,4***
Réf.- 0,08
Réf.- 0,06
Âge (variable continue) -0,1 0,1 -0,1*** 0,01 -0,02 -0,06 ***
SexeEst une femmeEst un homme
Réf.- 0,2
Réf.- 0,1
Réf.- 0,1**
Réf.- 0,1
Réf.- 0,01
Réf.- 0,1 *
Lecture : un coefficient de signe positif dans la colonne de gauche statistiquement significatifindique qu’on est en présence d’un facteur qui accroît les chances, pour un individu qui étaitautonome en 1999, d’être aidé par un professionnel (respectivement par un membre de safamille) en 2001.aLe choix de cette variable « filles dans la descendance» était motivé par la volonté de tester(à la suite de Crenner, 1999) l’existence d’une implication inégale des descendants masculinset féminins dans la prise en charge de leurs parents dépendants.*** : significatif au seuil 1%; ** : significatif au seuil 5%; * : significatif au seuil 10%;Ref. : modalité de référence.
Quel que soit l’âge, la dégradation de l’état de santé rend plus probablel’obtention d’une aide humaine. Mais les effets de l’amélioration de l’étatde santé dépendent pour leur part de l’âge. Toutes choses égales parailleurs, un quinquagénaire dont l’état de santé s’est amélioré entre 1999et 2001 a moins de chances d’obtenir de l’aide de la part de sa familleque les individus du même âge. Ce n’est pas le cas après 60 ans.La classe la plus jeune est la seule pour laquelle la prise en chargesemble s’adapter assez rapidement à l’évolution des difficultés. À partirde 60 ans, le retour à l’autonomie se fait plus rare.
La situation vis-à-vis du marché du travail a elle aussi des effets variablesselon l’âge. Un quinquagénaire qui a arrêté de travailler pour raison desanté a plus de chance d’obtenir une aide familiale. En revanche, à partirde 60 ans, c’est le départ à la retraite qui augmente les chances derecourir à ce type d’aide.
L’effet propre de l’âge (ce que l’on peut appeler le vieillissement) n’estsensible qu’à partir de 70 ans. Toutes choses égales par ailleurs, envieillissant de deux ans, un septuagénaire voit augmenter ses chancesd’obtenir une aide au moins partiellement professionnelle, commeobservé précédemment. Une femme septuagénaire a aussi plus dechances qu’un homme du même âge d’obtenir de l’aide1133.
En résumé, les transitions vers l’aide humaine entre 1999 et 2001répondent à des facteurs différents selon que l’on a moins de 60 ans ouplus de 70 ans. Pour les plus jeunes, la trajectoire la plus probable estl’obtention d’une aide familiale. À partir de 70 ans, l’obtention d’uneaide professionnelle est plus fréquente. Les politiques publiquessegmentées selon l’âge ont donc des effets sur la nature de l’aide reçue.Celle-ci est plutôt familiale pour ceux qui, relativement jeunes, sontd’abord soutenus vis-à-vis du marché du travail, ou professionnelle pourceux qui, plus âgés, sont encouragés à embaucher des professionnelspour rester à leur domicile.
84
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
13 Il faut interpréter cet effet de sexe avec précaution : il se peut que l’aide apportéepar le conjoint de son vivant (en 1999) ait été sous-déclarée et queson décès révèle une prise en charge qui existait déjà, bien que non visible dansnos statistiques. Mais nous savons aussi que les femmes doivent plus souventchercher hors du couple une prise en charge, soit que leurs conjoints ne soientplus là – les femmes sont plus souvent veuves que les hommes (Caradec, 2001) –soit qu’ils soient moins enclins à les aider sans déclarer leur soutien à l’enquêteur(Cambois, Désequelles, Ravaud, 2003).
■ Conclusion
Cette exploitation secondaire de l’enquête HID montre que lescatégories des politiques publiques ont des répercussions sur les modesd’organisation de la vie quotidienne : les personnes reconnues commehandicapées bénéficient plus souvent d’une prise en chargeexclusivement familiale ; les personnes âgées, ciblées par les politiquesde la dépendance, ont plus souvent recours à des aidants professionnels.Mais cette étude a aussi permis de repérer des configurations de prise encharge qui échappent à ces catégories institutionnelles. En étudiant lesphénomènes de report et d’allongement du temps marquant l’entréedans l’âge de la « vieillesse », nous avons donc voulu rendre compte dela diversité des expériences sociales des personnes vieillissantes.Finalement, les personnes reconnues handicapées et celles ciblées par laprise en charge de la dépendance, statistiquement minoritaires au seinde l’échantillon, sont à certains égards plus proches entre elles que cellesqui parviennent, grâce à des routines ou à des aides techniques, à sepasser de prise en charge. En filigrane, nous avons touché du doigt cessituations intermédiaires où la prise en charge, sans être « vitale », seraitde nature à faciliter l’insertion sociale.
85
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S
■ Bibliographie
AZÉMA B., MARTINEZ N., 2005, « Les personnes handicapéesvieillissantes : espérances de vie et de santé, qualité de vie. Une revuede la littérature», Revue française des Affaires sociales, n° 2, Paris,p. 297-333.
BILAND É., EIDELIMAN J.-S., GOJARD S., WEBER F., 2004, «Dispositifsinstitutionnels et soutien familial. Pour comprendre les inégalitéssociales dans la prise en charge du handicap», Rapport de recherchepour la MiRe/Drees, Paris, 220 p.
BRESSE S., DUTHEIL N., 2003, «Les bénéficiaires des services d’aide àdomicile », Dossiers Solidarité et santé, 1, p. 17-24.
BREUIL-GENIER P., 1998, «Aides aux personnes âgées dépendantes : lafamille intervient plus que les professionnels », Insee, Économie etStatistique, n° 316-317, Paris, p. 21-39.
CAMBOIS E., DÉSESQUELLES A., RAVAUD J.-F., 2003, «Femmes et hommesne sont pas égaux face au handicap», Ined, Population et Sociétés,n° 386, Paris, 12 p.
CAMBOIS E., LELIÈVRE A., 2004, «Risques de perte d’autonomie etchances de récupération chez les personnes âgées de 55 ans ouplus », Drees, Études et Résultats, n° 349, Paris, 12 p.
CARADEC V., 2001, « Hommes et femmes face aux transitionsbiographiques : le cas de la retraite et du veuvage», in Femmes ethommes dans le champ de la santé. Approches sociologiques,Presses de l’ENSP, Rennes, p. 255-280.
COLVEZ A., VILLEBRUN D., 2003, «La question des catégories d’âge etdes «charnières » entre les différents types de population», Revuefrançaise des Affaires sociales, n° 1-2, Paris, p. 255-266.
CRENNER E., 1999, «Famille, je vous aide», Insee Première, n° 631,Paris, 4 p.
DAVID M.-G., STARZEC C., 1996, «Aisance à 60 ans, dépendance etisolement à 80 ans », Insee, Insee Première, n° 447, Paris, 4 p.
DEMOLY E., 2005, «Augmentation sensible de l’activité des Cotorep en2004», Drees, Études et Résultats, n° 455, Paris, 12 p.
DÉSESQUELLES A., BROUARD N., 2003, «Le réseau familial des personnesâgées de 60 ans ou plus vivant à domicile ou en institution», Ined,Population, vol. 58, n° 2, p. 201-227.
86
R E T R A I T E E T S O C I É T É / NN °° 55 33 J A N V I E R 2 0 0 8
DUÉE M., REBILLARD C., 2004, La dépendance des personnes âgées :une projection à long terme, Insee, Direction des Études et SynthèsesÉconomiques, document de travail, Paris, 51 p.
DUTHEIL N., 2001, «Les aides et les aidants des personnes âgées»,Drees, Études et Résultats, n° 142, Paris, 12 p.
EIDELIMAN J.-S., 2003, « Du handicap à la dépendance ? Étudestatistique de situations de vie handicapantes », mémoire secondairede DEA de sciences sociales, ENS/EHESS.
FRINAULT T., 2005, «La dépendance ou la consécration française d’uneapproche ségrégative du handicap», Politix, vol. 18, n° 72, p. 11-31.
INSEE, 2004, Femmes et hommes : regards sur la parité, Insee, 174 p.
JOËL M.-È., 2003, «Les conditions de vie des personnes âgées vivantà domicile d’après l’enquête HID», Revue française des Affairessociales, n° 1-2, Paris, p. 103-122.
RAVAUD J.-F., MORMICHE P., 2000, «Handicaps et incapacités », inLeclerc A., Fassin D., Grandjean H., Kaminski M., Lang T.,Les inégalités sociales de santé, Inserm, La Découverte, Paris,p. 295-314.
RAVAUD J.-F., LETOURMY A., VILLE I., 2002, « Les méthodes dedélimitation de la population handicapée : l’approche de l’enquêtede l’Insee Vie quotidienne et santé. », Ined, Population, n° 3, Paris,p. 541-566.
WEBER F., 2005, «Les inégalités sociales dans la prise en charge duhandicap », La lettre de la MiRe, n° 4, p. 2-7.
87
C O M P R E N D R E L A D I V E R S I T É D E S M O D E S D ’ O R G A N I S AT I O N Q U O T I D I E N N E A P R È S 50 A N S