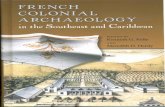« Le Théâtre et ses publics ou la société socialiste en représentation(s) à Oradea (Roumanie)...
-
Upload
sciences-po -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Le Théâtre et ses publics ou la société socialiste en représentation(s) à Oradea (Roumanie)...
1
Paru dans Nadège Ragaru, Antonela Capelle-Pogăcean (dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le
communisme. Consommer à l’Est, Paris, Karthala, coll. Recherches internationales, 2010,
pp.351-392.
Le théâtre et ses publics ou la société socialiste en représentation(s) à Oradea (Roumanie)
Antonela Capelle-Pogǎcean*
Le 23 décembre 1986, la troupe roumaine du Théâtre d’Etat d’Oradea, ville située à l’ouest
de la Roumanie, près de la frontière avec la Hongrie, proposait une production en première nationale.
Home and Beauty, la comédie en deux parties de W. Somerset Maugham était présentée sous le titre
Moda cǎsǎtoriilor [La mode des mariages]. Le cahier de salle rappelait le contexte d’élaboration de la
pièce, telle que remémoré par l’auteur anglais : « J’ai écris cette pièce dans un sanatorium, durant le
dernier hiver de la guerre [1917 n.n.], alors que souffrant de tuberculose, j’étais soigné en Ecosse
/…/. Par les fenêtres ouvertes, la nuit froide envahissait la chambre protégée du vent ; les mains
couvertes de gants de laine pour tenir le stylo sans souffrir du froid, j’avais là une occasion admirable
pour écrire une farce. /…/ Certains critiques l’ont jugée cruelle et sans cœur. Je n’ai pas eu cette
impression. J’étais dans une excellente disposition au moment où je l’écrivais et j’avais l’intention
d’amuser aussi les autres »1.
Si l’on se fie au nombre des représentations, il apparaît que la farce de W.S. Maugham
aurait eu un certain succès, malgré les critiques plus mitigées à l’égard d’une mise en scène trop
« intellectuelle »2. Les spectateurs se rendirent au théâtre à l’italienne du centre-ville, beau encore,
eussent ses dorures et son velours accusé les outrages du temps. La « grotte aux merveilles3
n’échappait pas au délitement du communisme tardif et les rigueurs de la saison hivernale se
prolongeaient au milieu des années 1980 jusque dans la salle mal chauffée. Manteaux sur les épaules,
les amateurs de théâtre pouvaient assister à la satire acide de la société londonienne de la fin de la
Grande guerre, tout en découvrant un « manuel de conversation à l’anglaise »4. La « suspension de
l’incrédulité » réclamée par le théâtre n’était certes pas complète. Mais elle ne l’est de toute façon
jamais5. Veuve frivole d’un militaire disparu, Victoria s’était remariée après le délai convenable à un
officier revenu des tranchées qui se trouvait être le meilleur ami du feu son époux. Or le disparu
réapparaît. Et la complicité ressurgit entre les deux officiers, guère héroïsés ici, animés par le même
désir de s’éloigner de la chère Victoria. Impuissante à choisir entre les deux, celle-ci jette quant à elle
son dévolu sur un troisième homme, un parlementaire. Le charme des officiers est rompu, l’avenir est
aux politiciens, suffisamment influents pour obtenir un accès généreux à des biens rationnés en temps
de guerre. Cette même farce cynique qui explorait les écarts entre normes et pratiques ainsi que les
* L’auteur souhaite remercier Elisabeta Pop, secrétaire littéraire du Théâtre d’Etat d’Oradea entre 1965 et 1995,
pour son soutien amical, généreux et passionné durant cette recherche. 1 W.S. Maugham cité dans le cahier de salle Moda cǎsǎtoriilor [La Mode des mariages], Théâtre d’Etat Oradea,
saison 1986-1987, p.2. 2 Elle fut jouée 41 fois, étant la pièce la plus représentée de la saison par la troupe roumaine. Mais les grands
succès de public dépassaient les 50 représentations. Elisabeta Pop, « Repertoriul Secţiei române a Teatrului de
Stat Oradea între anii 1955-2001 » [Le Répertoire de la section roumaine du Théâtre d’Etat Oradea entre 1955 et
2001], in Elisabeta Pop (dir.), Teatrul românesc la Oradea. Perspectivǎ monograficǎ, Oradea : Biblioteca
Revistei Familia, 2001, p. 333-406, p. 386 ; Mircea Morariu, « Teatrul din Oradea între anii 1985-2001 » [Le
Théâtre de Oradea entre 1985-2001] in Elisabeta Pop (dir.), Teatrul românesc la Oradea …, op.cit., p. 175-210,
p. 180. 3 George Banu, Le rouge et or. Une poétique du théâtre à l'italienne, Paris : Flammarion, 1989, p.49-57.
4 La formule appartient au traducteur roumain de la pièce. Cf. Andrei Bantaş, « Cîteva gînduri despre teatrul lui
W.S.Maugham » [Quelques réflexions sur le théâtre de W.S.Maugham], Moda cǎsǎtoriilor…, op.cit., p.11-12,
p.12. 5 Jack Goody, « Représentations et contradictions cognitives » in id., La Peur des représentations.
L’ambivalence à l’égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques et de la sexualité, Trad. Pierre
Emmanuel Dauzat, Paris : La Découverte, 2003, p. 13-47, p.38.
2
reconfigurations des relations hommes-femmes à la fin de la Grande guerre, était proposée la saison
suivante, peu avant la coupure estivale (le 25 juillet 1988), par la troupe hongroise du théâtre d’Oradea
[Nagyvárad en hongrois], sous le titre « J’adore me marier » [Imádok férjhezmenni]. Home and Beauty
devenait dans cette nouvelle lecture une comédie musicale, genre apprécié par le public hongrois
d’une ville que l’on appelait jadis la « citadelle de l’opérette »6.
L’inclusion au répertoire de ce texte éloigné de l’imaginaire nationaliste et puritain de la
mobilisation révolutionnaire, imaginaire présent en suroffre dans l’espace public roumain de l’époque,
ne servait pas « un programme d’éducation matrimoniale par le théâtre »7 pour reprendre les propos
ironiques d’un critique. Elle participait, au moins en partie, du nouveau régime de production théâtrale
cristallisé après 1984. Les théâtres (à l’instar de l’ensemble des établissements culturels) étaient
désormais confrontés à une réduction substantielle des subventions publiques et invités à l’acrobatie
de l’« auto-financement », alors même que les spectateurs se faisaient plus rares. Dans le cahier de
salle du spectacle hongrois avec Home and Beauty, la remarque d’un journaliste local en dialogue avec
le metteur en scène témoignait des glissements intervenus dans les définitions du théâtre :
« Finalement, la représentation théâtrale elle-même – excusez-moi pour cette formulation un peu
vulgaire – est une marchandise, n’est-ce pas ? »8. Pourtant, le répertoire devait toujours répondre aux
« besoins réels du peuple » et contribuer à la formation de l’homme socialiste.
L’hétérogénéité socialiste au prisme d’un théâtre de province
Le projet de normalisation idéologique des conduites avait été réaffirmé en Roumanie à
plusieurs reprises à partir de 1971. Les « thèses de juillet » présentées par le secrétaire général Nicolae
Ceauşescu au Comité exécutif du Parti communiste roumain (PCR), soit les dix-sept propositions
destinées à améliorer « l'activité idéologique et d'éducation marxiste et léniniste » avaient proclamé, le
6 juillet 1971, la nécessité d’éliminer « les manquements, les déficiences et les insuffisances » qui
entravaient « le progrès de notre société »9. Considérées dans l’historiographie du communisme
roumain comme sonnant le glas d’une « libéralisation bien tempérée »10
(1964-1971), ces propositions
furent placées à l’origine d’une « mini-révolution culturelle », d’une « restalinisation de la vie
culturelle », ou furent interprétées comme une composante du « néo-stalinisme sans terreur » ou du
« (néo)stalinisme national »11
. Par delà les typologies mobilisées et la valeur heuristique de certaines
de ces catégorisations, les différents travaux consacrés aux dernières décennies communistes
s’accordent pour souligner le renforcement du contrôle idéologique12
, les mobilisations permanentes
6 István Kelemen, Várad színészete [Le Théâtre à Oradea], Oradea : Charta, 1997, p. 179.
7 Mircea Morariu, « Teatrul din Oradea … », art.cit., p. 180.
8 « A kérdésekre válaszol Nicoleta Toia » [Nicoleta Toia répond aux questions], cahier de salle Imádok
férjhezmenni [J’adore me marier], Théâtre d’Etat Oradea, saison 1987-1988, sans page. 9 Nicolae Ceauşescu, “Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice, de educare
marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii” [Mesures proposées pour l’amélioration de
l’activité politico-idéologique, d’éducation marxiste-léniniste des membres du Parti, de tous les travailleurs], le 6
juillet 1971, http://ro.wikisource.org/wiki/Tezele_din_iulie [consultée le 3 novembre 2009]. 10
Zoe Petre, « Une libéralisation bien tempérée » in Catherine Durandin, Zoe Petre, La Roumanie post-1989,
Paris : L’Harmattan, 2008, p. 65-69, p. 65. 11
Florin Constantiniu, « O monarhie comunistă : România sub Ceauşescu » [Une monarchie communiste : la
Roumanie sous Ceauşescu], in id. O istorie sinceră a poporului român (ediţia a IVa revăzută şi adăugită),
Bucarest : Univers enciclopedic, 2008, p. 402-510 ; Cristina Petrescu, Dragoş Petrescu, « Restalinizarea vieţii
culturale româneşti. Tezele din iulie 1971 » [La restalinisation de la vie culturelle roumaine. Les Thèses de juillet
1971], Arhiva Cotidianului, 10 (53), octobre 1996, p.1-3 ; Dennis Deletant, « România sub regimul comunist
(decembrie 1947-decembrie 1989) [La Roumanie sous le régime communiste (décembre 1947-décembre 1989)]
in Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Serban Papacostea, Istoria României, Bucarest : Editura
enciclopedică, 1998, p. 539-576 ; Vladimir Tismăneanu, Stalinism for all Seasons. A Political History of
Romanian Communism, Berkeley: University of California Press, 2003. 12
Gail Kligman, The Politics of Duplicity: Controlling Reproduction in Ceausescu's Romania, Berkeley :
University of California Press, 1998.
3
notamment au nom de la nation socialiste13
, l’étendue du culte de la personnalité, développé en
parallèle avec l’aggravation spectaculaire de la crise économique dans les années 198014
.
Cependant cette évolution ne suivit pas partout la même cadence, pas plus qu’elle ne connut
une progression linéaire, montrant des intensités et des formes variables selon les périodes, les lieux et
les milieux envisagés15
. Les vies sociales du théâtre, se déployant sur scène et dans la salle, en amont
comme en aval de la représentation, observées en outre dans une ville de frontière qui connaît au XXe
siècle de multiples césures liées aux redéfinitions des appartenances étatiques (hongroise et roumaine)
et des systèmes politiques, témoignent de cette « hétérogénéité de la société à l’égard de la normativité
de l’Etat »16
, fût-il socialiste et autoritaire. Certes, cette hétérogénéité peut apparaître agrandie aux
marges géographiques, d’autant qu’elle est par ailleurs examinée à partir d’un lieu, le théâtre, qui
n’occupe plus sur la carte des loisirs démocratisés la place centrale qui fut sienne au début du XXe
siècle17
. Loin de saisir le tout, le regard décalé vise, bien plus modestement, à fournir quelques
éléments de compréhension de la gouvernementalité éducationniste de l’Etat socialiste, insérée dans le
jeu des échelles spatiales et temporelles18
.
Lieu étatisé du loisir collectivisé et politisé, le théâtre fut un champ tissé de relations
asymétriques, traversé de pouvoirs plus ou moins « liliputiens », pour reprendre la traduction proposée
par Paul Veyne aux micro-pouvoirs foucaldiens19
, lequel ne se laisse point enfermé dans les catégories
dichotomiques de l’obéissance inculquée ou de la subversion cultivée, de la culture « officielle » et de
la culture « dissidente »20
. Des agents aussi divers que des responsables politiques, des bureaucrates de
la culture, des dramaturges et des critiques de théâtre, des directeurs, des secrétaires littéraires, des
metteurs en scène, des acteurs – artistes d’Etat21
et artistes tout court – des organisateurs de spectacle
et des spectateurs, mobilisant des sources différentes de légitimité, y engagent des conflits
d’interprétation. Qu’est-ce donc le théâtre et que doit-il être ? Même inséré dans un système de
contraintes politiques spécifiques, ce domaine peut relever simultanément de plusieurs registres – art
et art national, éducation, propagande, divertissement, marchandise, etc. – permettant dès lors une
démultiplication des motivations du côté de ceux qui s’y engagent en tant que spectateurs et une
différenciation des formes, plus ou moins cérémonielles, de leur participation.
13
Catherine Durandin, Histoire des Roumains, Paris : Fayard, 1995, surtout p. 431-491 ; Katherine Verdery,
National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania, Berkeley and Los
Angeles: University of California Press, 1991. 14
Pavel Câmpeanu, Ceauşescu, anii numărătorii inverse [Ceauşescu, les années du compte à rebours], Iaşi :
Polirom, 2002 ; Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc [Sur les
épaules de Marx. Une introduction au communisme roumain], Bucarest : Curtea Veche, 2005, surtout p. 392-
492. 15
Liviu Chelcea, Puiu Lăţea, România profundă în comunism [La Roumanie profonde pendant le communisme],
Bucarest : Nemira, 2000 ; Adrian Neculau (dir.), La vie quotidienne en Roumanie sous le communisme, Paris :
L’Harmattan, 2008. 16
Jean-François Bayart, «Préface à la nouvelle édition», in Jean-François Bayart, Achille Mbembe, Comi
Toulabor (dir.), Le politique par le bas en Afrique noire, 2e édition revue et augmentée, Paris : Karthala, 2008,
p.15. 17
Christophe Charle, Théâtres en capitales. Naissance de la société de spectacle à Paris, Berlin, Londres et
Vienne (1860-1914), Paris : Albin Michel, 2008. A titre d’indice, rappelons que le plan du Comité de culture et
d’éducation socialiste du département de Bihor prévoyait pour 1971, à l’échelle du département, 5 200 000
spectateurs de cinéma et 479 000 spectateurs pour le théâtre et les deux orchestres, philharmonique et
folklorique. Source : Archives du Théâtre d’Etat d’Oradea. 18
Jacques Revel (dir.), Jeux d´échelles. La micro-analyse à l´expérience, Paris : Les Editions de l’EHESS, 1996. 19
Paul Veyne, Foucault. Sa pensée, sa personne, Paris : Albin Michel 2008, p. 142. 20
Pour une critique de ces catégories voir Alexei Yurchak, Everything Was Forever,Until It Was No More,
Princeton : Princeton University Press, 2005; Jan Plamper, “Cultural production, Cultural consumption. Post-
Stalin Hybrids”, Kritika : Explorations in Russian and Eurasion History, 6 (4), Fall 2005, p.755-762. Pour des
approches plus nuancées de la relation entre art/littérature et pouvoir, appliquées à la Roumanie, voir Magda
Cârneci, Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989, Paris : L’Harmattan, 2007; Lucia Dragomir, L'Union des
Ecrivains. Une institution littéraire transnationale à l'Est : l'exemple roumain, Paris : Belin, 2007. 21
Miklós Haraszti, Artistes d’Etat. De la censure en pays socialiste, Paris : Fayard, 1985.
4
Dans une ville de province de quelque 200 000 habitants, le théâtre nourrit des sociabilités
ritualisées. Si le spectre social touché est en rétrécissement dans les dernières décennies communistes,
dans la salle baroque se croisent néanmoins des « Hongrois » et des « Roumains », des représentants
des bourgeoises d’antan et des groupes urbains produits par la mobilité socialiste, des bohêmes et des
puritains, des élèves des collèges et des lycées et des jeunes conscrits en uniformes, sortis pour
quelques heures de leurs casernes, dans une co-présence non-dépourvue de hiérarchies implicites ou
explicites, de concurrences à la primauté, voire de tensions surgies d’altérité, que la représentation
peut provisoirement faire taire. Les vies sociales du théâtre s’inscrivent dans des espaces-temps
multiples. Elles invitent à insérer les pratiques socialistes dans une durée plus longue et à examiner
l’enchâssement du temps moyen des constructions stato-nationales rivales et du temps de l’ordre
socialiste.
Les répertoires historiques du théâtre dans une ville de frontière
Si en 1988, un journaliste pouvait, avec la prudence rhétorique nécessaire, qualifier le théâtre
de « marchandise », en 1907, quelques années après l’inauguration le 15 octobre 1900 du nouveau
bâtiment du théâtre, une publication locale adoptait un ton beaucoup plus affirmatif : « aussi triste que
ce soit, il faut convenir que le théâtre est une affaire à Nagyvárad »22
. A l’époque, la ville était
hongroise et se trouvait dans la partie orientale de la composante hongroise de l’Autriche-Hongrie.
Elle comptait quelque 50 000 habitants, locuteurs de hongrois à 90% (contre 44% en 1977) (voir
Tableau 1) et semblait grandir et accomplir sa mue bourgeoise aux rythmes de l’opérette. Prompts à
manier l’opposition de l’art et du commerce, d’aucuns y jugeaient les pratiques du théâtre
excessivement commerciales.
Tableau 1 : La population d’Oradea (Nagyvárad, Grosswardein) selon l’appartenance
linguistique et nationalitaire
Année Total Roumains (%) Hongrois (%) Juifs/Yiddish (%) Allemands (%)
1880 (l) 31 324 6,5 86,9 - 3,7
1900 (l) 50 177 6,6 89,2 - 2,8
1910 (l) 64 169 5,6 91,0 - 2,2
1920 (n) 68 081 12,4 59,8 26,3 0,9
1930 (l) 82 687 25,3 66,6 5,0 1,4
1930 (n) 82 687 27,1 51,6 17,9 1,1
1941 (l) 92 942 5,2 92,0 1,4 0,9
1941 (n) 92 942 5,2 91,9 1,7 0,7
1948 (l) 82 282 32,8 63,9 2,2 0,2
1956 (l) 98 950 34,9 63,5 0 ,4 0,4
1956 (n) 98 950 36,0 59,0 3,6 0,3
1966 (l) 122 534 45,5 53,2 0,1 0,4
1966 (n) 122 534 46,1 51,4 1,2 0,4
1977 (n) 170 531 53,9 44,1 0,5 0,4
1992 (l) 222 741 65,1 33,8 0,0 0,3
1992 (n) 222 741 64,8 33,3 0,1 0,4
* (l)=langue ; (n)=nationalité, soit auto-identification ethno-culturelle
Source :
Árpád E. Varga, « Bihar megye településeinek etnikai (anyanyelvi/nemzetiségi) megoszlása százalék szerint 1869-2002 » [La
composition ethnique (selon le critère de la langue et de la nationalité) des communes du département de Bihor, en
pourcentage, 1869-2002], http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/bhszaz.pdf [consulté le 15 octobre 2009].
Rapprocher les voix de 1907 et de 1988, observer le réinvestissement partiel d’un ancien
registre dans un contexte où « affaire » et « marchandise » raisonnent différemment, ne visent
aucunement à suggérer une quelconque représentation cyclique des vies sociales locales du théâtre. Le
but n’est pas ici de montrer qu’il y aurait eu des pratiques théâtrales placées en situation de
22
Cité dans István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 179.
5
marchandisation au début du siècle – elles ne le furent pas complètement - , « décommodifiées »
ensuite par « en haut » sous le régime communiste23
, avant de connaître un retournement de situation à
la faveur de l’épuisement de l’utopie avant même la fin du régime communiste. Mais les termes
mobilisés dans les premières luttes locales de qualification autour du théâtre, tels que moralité,
affaires, loisir et divertissement, culture et culture nationale, prestige et civilité urbaine, etc.
connaissent des réemplois tout au long du XXe siècle et notamment dans les dernières décennies de la
période communiste.
1900 : la ville libérale sur un air d’opérette
Des spectacles en langue hongroise furent proposés à Nagyvárad d’une manière régulière à
partir des années 186024
. Chaque été, de mai à octobre, une structure en bois, progressivement
modernisée pour améliorer le confort du public, accueillait des compagnies de deux villes
avoisinantes. Les premières mobilisations en faveur de l’édification d’un bâtiment qui puisse héberger
un théâtre de langue hongroise avaient quant à elles vu le jour en 182625
, impulsées par l’aile
réformatrice et nationaliste de la noblesse locale. Grosswardein/ Nagyvárad était alors un bourg
fortifié de l’empire autrichien. L’allemand et le latin y étaient les langues du pouvoir. Le théâtre en
hongrois devint dès lors une priorité nationaliste. Après la transformation de l’empire autrichien en
monarchie austro-hongroise en 1867 et la redéfinition, en 1870, du statut de Nagyvárad, désormais
chef-lieu du comitat de Bihar sous administration hongroise26
, le répertoire local du théâtre s’enrichit
de nouveaux éléments.
La problématique de la langue au service de la fabrique du national y était devenue secondaire,
même si les échos des politiques d’assimilation linguistique mises en place par l’Etat central se
prolongeaient à Nagyvárad. En 1880, moins de la moitié de la population de Hongrie déclarait le
hongrois comme langue maternelle27
. En revanche dans la ville même, les hungarophones étaient
massivement majoritaires. L’arrière-pays rural où le roumain était davantage présent n’y menaçait pas
la suprématie du magyar. Les spectacles assurés en roumain par des étudiants/amateurs mobilisés au
service de l’émancipation nationale demeuraient rares28
. Les citadins de confession israélite – un quart
de la population en 191029
-, dont l’émancipation politique et civile remontait à 1864, s’intégraient à la
société locale et s’identifiaient majoritairement comme Hongrois.
En 1890, au moment où le projet de construction du théâtre fut réactualisé, Nagyvárad entrait
dans une phase de croissance économique et démographique, de consolidation de ses bourgeoisies et
de mobilisations ouvrières inédites30
. Les luttes de qualification autour du théâtre s’enrichirent des
échos de ces évolutions sociales plus larges. L’adoption par la municipalité de la décision de
23
Pour le concept de “commodity situation” voir Arjun Appadurai, « Introduction: commodities and the politics
of value » in Arjun Appadurai (ed.), The social life of things, Cambridge : Cambridge University Press, 1986, p.
3-64. 24
Le premier spectacle en langue hongroise assurée par une compagnie de Kolozsvár/Cluj datait de 1798. Cf.
István Kelemen, Várad színészeté, op.cit., p. 27-28. 25
Id.ibid, p.42-46. 26
Liviu Borcea, Gh.Gorun (dir.), Istoria oraşului Oradea [L’Histoire de la ville d’Oradea], Oradea : Editura
Cogito, 1995, p.218. 27
En 1880, 46,65% des habitants déclaraient le hongrois comme langue maternelle. Trente ans plus tard, malgré
les politiques de magyarisation, ce chiffre ne s’élevait qu’à 54,56%. Cf. Gábor Gyáni, György Kövér,
Magyarország társadalomtörténete. A reformkortól a második világháborúig [L’histoire sociale de la Hongrie.
De l’ère des réformes à la Seconde guerre mondiale], Budapest : Osiris, 1998, p.146. 28
Lucian Drimba, “Inceputuri”, in Elisabeta Pop (dir.), Teatrul românesc la Oradea…, op.cit., p. 7-64, surtout
p.35-36. 29
Liviu Borcea, Gh.Gorun (dir.), Istoria oraşului Oradea, op.cit., p. 224 et p.463-476 ; Tereza Mozes, Evreii din
Oradea [Les juifs d’Oradea], Bucarest : Editura Hasefer, 1997. 30
En 1910, 35,9% des habitants de la ville étaient employés dans l’industrie, 12,7% dans le commerce et le
secteur bancaire, 9,1% dans les transports, 9,9% dans les services et dans le secteur des libres professionnels et
6,1% dans l’agriculture. Un quart de la population vivait en surpeuplement Cf. Liviu Borcea, Gh.Gorun (dir),
Istoria orasului Oradea, op.cit., p.224 et 236.
6
construire l’édifice sur l’une des places centrales fut suivie de moult polémiques. Certains continuaient
à s’opposer à une « institution sans morale ». D’autres mobilisaient le registre du « théâtre national »,
tout en considérant ce projet comme un amplificateur du rayonnement régional de la ville. Le choix,
en 1895, des architectes chargés de l’élaboration du projet ne fut d’ailleurs pas sans éclairer cette
ambition. Le bureau de Vienne de l’Autrichien Ferdinand Fellner et l'Allemand Hermann Helmer
s’était spécialisé dans ce domaine. Quarante-sept théâtres bâtis sur les territoires austro-hongrois et
allemands, mais aussi à Sofia, à Iasi ou à Odessa, y avaient été pensés. Au registre du prestige, les
défenseurs du projet ajoutaient des arguments éducationnels : la fréquentation du théâtre allait
simultanément produire des « urbains » et des « nationaux31
.
Si les projets furent élaborés à Vienne, la mise en œuvre fut confiée à plusieurs entreprises
locales de bâtiment. Le mécénat et un important emprunt contracté par la mairie assurèrent le
financement des travaux. L’édification du théâtre n’était en effet pas un geste isolé d’urbanisme. A
l’orée du XXe siècle, il participait d’un refaçonnage complet du centre-ville et d’une
« monumentalisation de la trame urbaine »32
. D’imposantes maisons bourgeoises dont les façades Art
nouveau rivalisaient d’arabesques allaient commencer à orner les places et la rue centrale33
. A vol
d’oiseau du théâtre, le nouveau siège de la mairie sera bâti entre 1902 et 1903 selon les plans élaborés
par le fils du principal maître d’œuvre du théâtre, l’une des premières fortunes de la ville. Eclectique,
le théâtre fut quant à lui édifié en seize mois, entre le 10 juillet 1899 et le 15 octobre 1900. La façade
néo-classique fut décorée de six colonnes ioniques, le perron fut bordé de deux sculptures réalisées
dans un atelier renommé de Budapest, représentations allégoriques de la Tragédie et de la Comédie. Le
marbre du vestibule et du foyer se reflétait dans les miroirs de Venise, alors que la salle baroque
associait l’or et le pourpre du velours et pouvait accueillir 1036 spectateurs (dont 330 debout). Les
loges, insuffisantes par rapport à la demande, donnèrent lieu à quelques échanges vifs entre notables34
.
Par ses dimensions monumentales et sa centralité sur la carte redessinée de la ville, entouré de
de banques, de restaurants, d’hôtels, de cafés, à proximité du pouvoir politique, le théâtre devint en ce
début du XXe siècle une institution sociale importante. Le spectacle se déroulait tant sur les planches
que dans la salle, en particulier le soir des premières quand les gens de loisir prolongeaient l’entre-soi
par des bals qui duraient jusqu’à l’aube. Mais son air de rayonnement social était plus large. L’offre de
places était en effet importante pour une ville qui comptait un peu plus de 50 000 habitants en 1900,
64 000 dix ans plus tard. Si le théâtre qui fonctionnait en système de concession reconsidéré par une
commission municipale tous les trois ans35
, était protégé par une réglementation municipale favorable
sur un marché des loisirs en diversification36
, les directeurs successifs étaient requis néanmoins de
rentabiliser un investissement initial élevé. En 1908, un espace de plein air fut également inauguré,
doté de 1300 places, libérant la troupe constituée d’une centaine de membres de l’asservissement de la
mobilité estivale nécessaire à la survie économique37
.
31
Ces polémiques sont retracées dans István Kelemen, Várad színészeté, op.cit., p.155-157. 32
Pour des éléments sur la « haussmanisation théâtrale » à Paris voir Christophe Charle, Théâtres en capitales,
op.cit, p. 36-37. 33
Liviu Borcea, Gh.Gorun (dir.), Istoria oraşului Oradea, op.cit., p.220-221.Voir aussi Fredric Bedoire, Robert
Tanner, “The promised city. Nagyvárad, Lodz, New York” in id., The Jewish contribution to modern
architecture, 1830-1930, Hoboken, New Jersey, Ktav Publishing House, 2004, surtout p. 381-401. 34
István Kelemen, Várad színészete, op.cit.., p. 167-171; Alexandru Pop, “Construcţia clădirii” in Elisabeta Pop
(dir.), Teatrul românesc la Oradea…, op.cit., p. 66-68. 35
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 169 36
Árpád Kupán, « Nagyvárad a mozivásznon I. Filmgyártási próbálkozások és sikerek a 20. század első
évtizedeiben » [Oradea à l’écran I. Tentatives de production cinématographique et succès durant les premières
décennies du XX siècle], http://epa.oszk.hu/00100/00181/00023/26.htm [consulté le 25 octobre 2009] ; dans une
perspective conceptuelle et comparative, voir Alain Corbin, L’Avènement des loisirs 1850-1960, Flammarion,
1995. 37
Béla Nagy, Színház születik (1899-1900) [A la naissance d’un théâtre], Nagyvárad [Oradea] : Bihari Napló
Kiadó, 1998, p.91.
7
La réussite de cette entreprise théâtrale fut surtout liée au second directeur, Miklós Erdélyi
(1866-1934), issu lui-même du monde du théâtre puisque acteur au départ. Il resta à la tête de
l’établissement de 1907 à 192138
. M. Erdélyi fit de la ville « la citadelle de l’opérette »39
. Non que le
répertoire eût été exclusivement consacré à ce genre. Eclectique pour répondre aux préférences
esthétiques différenciées des spectateurs, il comprenait de l’opéra, du ballet, des tragédies, des drames,
des vaudevilles, du théâtre moderne, réaliste et social, de G.B.Shaw à H. Ibsen, de Verdi à Offenbach.
Les étrangers, français en particulier40
, étaient plus souvent montés que les dramaturges hongrois. Un
auteur roumain local, Iosif Vulcan (1841-1907) entrepreneur culturel fortuné engagé au service de la
cause roumaine, fut également mis au programme. Une compagnie privée de Roumanie assura quant à
elle deux spectacles en 191341
. L’offre qui illustrait la sensibilité pour le neuf du directeur inséré dans
les réseaux européens du théâtre, comprenait annuellement quelque cinquante productions et entre 350
à 450 représentations. Cependant la plupart des 400 000 entrées annuelles étaient assurées par les
opérettes, en particulier celles signées par des compositeurs hongrois, dont certains avaient acquis leur
célébrité à Vienne42
. Ce genre représentait un cinquième du répertoire à partir de 190543
, au fondement
de la prospérité de l’entreprise qui dés lors multipliait les « événements » autour des vedettes des
scènes budapestoises, plus rarement viennoises, dont la présence à Nagyvárad nourrissait le prestige
de la ville.
L’opérette se trouva ainsi au coeur du « contrat social » entre le théâtre et son public, elle
permit à l’institution de mener « la domestication du corps et de l’esprit »44
exigée par la participation
à la représentation théâtrale. Elle séduisait par sa critique cynique et pleine d’humour des classes
supérieures de la « monarchie duale » en mettant en scène des personnages stéréotypés, l’officier, le
gentry, l’aristocrate, la grande dame et en mobilisant, dans l’univers austro-hongrois où résonnaient
des revendications nationales concurrentes, une ethnicité exotisée45
. Au moins autant que les intrigues,
les qualités formelles de l’opérette entraient faisaient écho au style de vie des groupes urbains de la
ville en expansion. Tout en regrettant l’éloignement du théâtre et de la littérature, un poète hongrois
écrivait à ce sujet : « l’opérette est désirée, elle séduit, elle vit sa renaissance. Pourquoi ? /…/ Parce
que notre époque est celle des impressions rapides et colorées, c’est l’époque du journal et du cinéma ;
or l’opérette offre une histoire qui tourne vite, une musique légère, beaucoup de bizarrerie décoratives
et peu de sérieux »46
. D’une manière encore plus intense que dans les capitales de l’empire, à Vienne
ou à Budapest, l’opérette devint dès lors à Nagyvárad un élément central dans la définition du style de
vie urbain, contribuant à façonner les dispositions esthétiques des spectateurs. Ce genre assura aussi
une intégration partielle des normes des nouvelles bourgeoises et des nouvelles couches moyennes à
l’intérieur d’un théâtre où s’opérait également la validation sociale de la place que l’on occupait dans
la hiérarchie locale.
Ainsi durant les premières décennies du XXe siècle le théâtre fonctionne comme vecteur
d’intégration à la vie locale et nationale, à travers des formes culturelles dont la circulation ne s’arrête
38
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 179. Il reviendra à la direction du théâtre entre 1926 et 1927 et
entre 1930 et 1931. 39
Id.ibid., p. 179-182. 40
Péter Szaffkó, “English and American plays on the repertory of the Theatre of Oradea between 1900 and
1945”, The Round Table. Partium Journal of English Studies, 1(1), Spring 2008,
http://www.theroundtable.ro/pages/cultural_studies/peter_szaffko_english_and_american_plays_on_the_repertor
y_of_the_theatre_of_oradea_between_1900_and_1945.htm [consultée le 5 novembre 2009]. 41
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p.181. 42
Voir notamment András Gerő, Dorottya Hargitai, Tamás Gajdó, A Csárdáskirálynő - Egy monarchikum
története [Princesse Czardas – L’histoire d’un produit de la Double Monarchie], Budapest : Pannonica, 2006. 43
Liviu Borcea, Gh.Gorun (dir.), Istoria oraşului Oradea, op.cit., p. 325. 44
Emmanuel Bourdieu, « Remarques sur l'économie temporelle de la représentation théâtrale », in Eveline Pinto
(dir), Penser l'art et la culture avec les sciences sociales. En l'honneur de Pierre Bourdieu, Paris : Centre de
recherche sur la philosophie des activités artistiques contemporaines, 2002, p.47-62, p. 54. 45
Moritz Csáky, « Az operett az 1900-as évek tájékán. Egy kultúrtörténeti értelmezés kisérlete“ [L’opérette aux
alentours de 1900. Esquisse d’interprétation d’histoire culturelle], Regio, 16(1), 2005, p.53–70. 46
Le poète Gyula Juhász cité dans István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p.181.
8
guère aux bornes de l’Etat hongrois, ni même à celle de l’empire. Ce régime du théâtre se trouve
partiellement bouleversé par le redécoupage des frontières étatiques qui touche Nagyvárad/ Oradea en
1918, en 1940, en 1944. La dynamique de la compétition nationalitaire atteint un domaine fragilisé au
même moment par la concurrence du nouveau loisir, le cinéma.
Effets de frontière : compétitions nationales en représentations et leurs limites
Le redécoupage des frontières à la fin de la Première guerre mondiale inscrit Nagyvárad
devenue Oradea, sur le territoire de la Roumanie agrandie47
. D’une ville située à l’intérieur de l’Etat
hongrois, à quelque 250 kilomètres de sa capitale, elle se retrouve près de la frontière, séparée par plus
de six cents kilomètres du centre du nouvel Etat, Bucarest. Entre 1940 et 1944, Oradea redevient à
nouveau Nagyvárad48
. Le pouvoir politique « roumanisé »49
après 1918 se « remagyarise », avec
d’autant plus d’intensité que les ressentiments sont forts. Ces mouvements des frontières au dessus de
la ville refaçonnent son profil social et renforcent le poids du nationalisme dans la vie publique locale.
La présence du roumain et des Roumains augmente durant les deux décennies qui séparent la Première
de la Seconde guerre mondiale. Le recensement de 1930 qui propose une catégorisation ethno-
nationale et une catégorisation linguistique, y indique la présence de 27,7% de Roumains
« ethniques », contre 51% de Hongrois et 17,9% de juifs. L’introduction d’une ethnicité « juive » vise
notamment à encourager une « dissimilation » et une distanciation de ces derniers de l’univers
hongrois.
Le registre du « théâtre national » esquissé au XIXe siècle se trouve investi avec plus
d’aplomb dans ce contexte. Parmi les premières mesures adoptées par le pouvoir « roumain » figure
ainsi la relabélisation des lieux et des institutions. La coloration locale et/ou nationale hongroise
s’efface au profit de résonances roumaines. Baptisé à son inauguration en 1900 d’après Ede Szigligeti
(1814-1878), l’un des fondateurs de la dramaturgie hongroise au XIXe siècle, un « fils de la ville » par
la naissance, le théâtre acquiert désormais le nom de la reine Marie de Roumanie. C’est également elle
qui donne son nom à la place du théâtre, connue auparavant comme la placé Bémer, d’après László
Bémer, ancien évêque catholique de la ville50
. Le roi Ferdinand Ier de Roumanie est quant à lui honoré
par une statue érigée devant le théâtre. Celle-ci sera démantelée quelques jours à peine après l’entrée
triomphale de Miklós Horthy, régent du Royaume de Hongrie, à Nagyvárad, le 6 septembre 1940.
L’ancienne place Bémer prendra alors pour quelques années son propre nom.
Malgré le déploiement de ces politiques symboliques de contrôle de l’espace, la mairie
« roumaine » continue à accorder à plusieurs reprises dans les années 1920 la concession à des
directeurs « hongrois ». Mais les conditions de location de la salle sont désormais beaucoup moins
47
Par le traité de Trianon (4 juin 1920), la Hongrie perd deux tiers de son territoire et 57% de sa population. 3,2
millions de Hongrois découvrent le statut minoritaire dans les États successeurs, la moitié d’entre eux en
Roumanie. Celle-ci double quant à elle son territoire et sa population. Cf. Irina Livezeanu, Cultural Politics in
Greater Romania. Regionalism, Nation Building and Ethnic Struggle, 1918-1930, Ithaca : Cornell University
Press, 1995, p.8-11; Ignác Romsics, Magyarország Története a XX. Században [L’histoire de la Hongrie au XXe
siècle], Budapest : Osiris, 1999, p.143-145. 48
Le 30 août 1940, le deuxième arbitrage de Vienne décide une division en deux de la province de Transylvanie,
avec le nord rattaché à la Hongrie et le sud intégré à l’Etat roumain. Nagyvárad. Oradea se trouve au nord de la
nouvelle ligne de démarcation. La Transylvanie est réunifiée au sein de la Roumanie à la fin de la Seconde
guerre mondiale, les nouvelles frontières étant confirmées par le Traité de Paris (1947). Pour une présentation
synthétique de la compétition hungaro-roumaine autour de la Transylvanie, voir Rogers Brubaker, Margit
Feischmidt, Jon Fox, Liana Grancea, Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town,
Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 56-88. 49
Fût-ce à un degré moindre que la Hongrie d’avant 1918, la Roumanie est à son tour confrontée à une présence
de populations « non- roumaines », soit 28% en 1930. 50
Zoltán I. Péter, « 115 éves a nagyváradi Bémer tér » [La place Bémer à son 115e anniversaire], Várad
folyóirat, 8, http://www.kik.ro/Varad_archivum/Varad_8_szam/varad_8_szam_17.html [consultée le 5 novembre
2009]
9
avantageuses51
. Privée de ressources publiques – les maigres subventions de l’Etat sont affectées à des
troupes de langue roumaine52
- pénalisée par une législation beaucoup plus libérale qui intensifie la
compétition entre les troupes, subissant en outre les effets des changements démographiques et la
concurrence d’un cinéma dont la séduction s’amplifie, la compagnie permanente de langue hongroise
constituée autour du théâtre d’Oradea se délite. Après 1928, les spectacles de langue magyare sont
principalement assurés, à un rythme ralenti, par la troupe de la ville de Cluj-Kolozsvár53
.
Les temps ne sont pas plus cléments pour les entrepreneurs qui tentent entre 1928 et 1931, à
mettre en place une compagnie permanente de langue roumaine sous le label « le théâtre de l’Ouest ».
Malgré les évolutions démographiques, la population roumaine ne représente au mieux qu’un quart
des habitants à Oradea et son poids dans l’économie urbaine demeure faible. Certes, les spectacles
organisés autour d’artistes renommés venus de l’Ancien Royaume, en particulier de Bucarest ou de
Iaşi, bénéficient d’un accueil enthousiaste de la part des élites politiques, intellectuelles, religieuses
militaires, de langue roumaine. Des banquets prolongent dans la nuit ces événements qui relient la
ville de province à la sa nouvelle capitale et dont le faste rappelle les bals d’autrefois54
. Développé
autour des établissements publics de Bucarest et de Iasi, d’une part, et des nouvelles compagnies
privées créées dans la première décennie du XXe siècle, de l’autre, ce théâtre de professionnels dont
les repères sont Paris et Vienne, qui couvre des courants divers allant du théâtre romantique au théâtre
réaliste et aux avant-gardes, ne fait que souligner le caractère « provincial » de l’entreprise locale55
.
Les journalistes fustigent néanmoins l’attitude des habitants roumains de la ville : « Le public roumain
d’Oradea devrait considérer le théâtre roumain comme une question nationale et le soutenir, y compris
au prix du sacrifice »56
, peut-on lire dans la presse. Mais les appels à la fierté nationale ne suffisent pas
pour consolider une compagnie locale à qui il manque et les spectateurs et les financements publics.
Le retour de l’administration hongroise en 1940 s’accompagne de celui de l’opérette qui
cristallise à nouveau un public hongrois. En effet, pendant les quatre années de la guerre, l’opérette
représente 80% du répertoire du théâtre Szigligeti57
. Mais le genre change de significations. Ce n’est
plus la satire des élites de la « double monarchie » qui lie la société représentée sur scène à celle de la
salle. L’opérette est réinvestie comme genre « hongrois », vecteur d’un « nationalisme banal »58
qui dit
implicitement la victoire magyare, comme le font aussi les vedettes de Budapest acclamées par des
salles combles. Mais en fonction du regard, elle dit aussi une nostalgie du passé, des anciens beaux
jours, et un désir d’ailleurs qui éloignerait tant du passé immédiat que du présent. Des spectateurs que
l’on identifie à présent comme « juifs », qui avaient connu l’antisémitisme roumain à la fin des années
1930, sont désormais les cibles des lois antisémites de l’Etat hongrois. Des acteurs juifs se font siffler
en 1942 sur la scène de Nagyvárad59
. En mai 1944, 30 000 juifs de la ville et des environs sont réunis
dans un ghetto avant d’être envoyés vers les camps de la mort. Quelque 2 000 en reviendront. Des
statistiques établies en 1946 font état de 6 500 juifs à Oradea60
, incluant aux côtés des natifs,
survivants, de la ville, ceux arrivés d’autres régions.
51
Béla Nagy, A Tegnap színháza. A Magyar színház képes olvasókönyve a XX szazadról [Le théâtre d’hier],
Nagyvárad [Oradea] : Bihari Napló Kiadó, 1999, p.24. 52
József Kötö, « A színházi intézményrendszer Erdélyben a két világháború között » [Le système institutionnel
du théâtre en Transylvanie entre les deux guerres mondiales], Korunk, 4, avril 2002,
http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2002&honap=4&cikk=6863 53
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 187-192. 54
Lucian Drimba, “Inceputuri”, in Elisabeta Pop (dir.), Teatrul românesc la Oradea…, op.cit., p. 7-64, surtout
p.50-54 55
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 188. 56
Cité dans Lucian Drimba, “Inceputuri”, in Elisabeta Pop (dir.), Teatrul românesc la Oradea…, op.cit., p. 7-64,
p. 61. 57
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 194. 58
Michael Billig, Banal Nationalism, London: Sage Publications, 1995. 59
Béla Nagy, A Tegnap színháza…, op.cit., p.89. 60
Liviu Borcea, Gh.Gorun (dir.), Istoria oraşului Oradea, op.cit., p. 474-476 ; Tereza Mozes, Evreii din Oradea,
op.cit.; plus largement, à l’échelle de la Hongrie, voir Randolph L Braham (ed.), The Holocaust in Hungary:
Fifty Years Later, New York: Columbia University Press, 1997; Randolph L. Braham, Tibori Szabó, Zoltán
10
Ces multiples césures transforme le profil social d’Oradea. Les chiffres du recensement de
1948 (voir tableau 1) n’en offre qu’un faible aperçu. L’air nouveau du communisme séduit
notamment des ouvriers et une partie de l’intelligentsia hungarophone, urbains sensibilisés aux idéaux
socialistes dans les premières décennies du XXe siècle. Mais à Oradea/ Nagyvárad, qui voit son
appartenance à la Roumanie confirmée en 1947 et se retrouve près d’une frontière quasiment
infranchissable, jusqu’en 1956, avec la Hongrie61
(voir carte), la nouvelle idéologie s’instille
également dans les tensions d’hier qu’elle retravaille. Comme ailleurs en Transylvanie, la séduction
qu’exerce initialement les nouveaux idéaux62
exprime aussi l’attirance pour un projet politique qui
proclame la rupture avec le nationalisme de la Grande Roumanie des années 1920 et 1930. Le théâtre,
« decommodifié », est désormais invité à participer à la construction d’un ordre plus juste. Le registre
du théâtre-éducation au national, se déplace vers des cieux internationalistes. Mais ce glissement se
joue au moins en partie aux rythmes – réactualisés - de l’opérette.
Carte : Oradea [Nagyvárad] sur la carte de la Roumanie communiste
Un théâtre d’Etat pour un nouveau public
Le 28 décembre 194863
la Grande Assemblée nationale, organe législatif de l’Etat
communiste, crée le Théâtre d’Etat hongrois d’Oradea. Peu avant, la loi 265 adoptée en juillet 1947
avait réglementé le régime des spectacles publics et avait placé les institutions théâtrales sous la
(ed.), A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája [Encyclopédie géographique de l’Holocauste en
Hongrie], Budapest : Park, 2007. Pour la destruction des juifs en Roumanie, voir Radu Ioanid, La Roumanie et la
Shoah, Paris : Editions de la MSH, 2002. 61
Stefano Bottoni, « 1956 Romániában – Eseménytörténet és értelmezési keretek » [1956 en Roumanie –
Histoire factuelle et cadres d’interprétation], in Stefano Bottoni (ed.), Az 1956-os forradalom és a romániai
magyarság (1956–1959), Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2006,
http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf1851.pdf, p.20 62
Les Magyars représentent 11% des effectifs du Parti Ouvrier Roumain en 1948. Cf. Stefano Bottoni,
« Recepció és párhuzamosság. A romániai '56 és a magyar forradalom viszonya » [Réception et évolution
parallèle. La relation des événements roumains de 1956 avec la révolution hongroise], Korunk, 2, 2006, p.40-48. 63
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 196.
11
supervision du Ministère des Arts, et notamment de la Direction générale des Théâtres. Celle-ci allait
chapeauter à partir du milieu des années 1950 une quarantaine de théâtres64
. Le décret 83 du 11 juin
1948 avait quant à lui annoncé la nationalisation des compagnies privées. Le théâtre du nouvel ordre
communiste doit cesser d’être un vecteur de l’aliénation bourgeoise, doit perdre sa dimension élitiste
pour propager la culture au sein des masses larges et participer à la reconstruction spirituelle de celles-
ci. La révolution annoncée rend nécessaire la création d’une ligne de partage entre « l’ordre nouveau et
le théâtre ou les cérémonies d’autrefois »65
. Le contrôle centralisé du répertoire encadre – d’une
manière très stricte jusqu’en 1952, un peu moins après66
- l’offre en terme de genres et de thèmes selon
les normes du réalisme socialiste importé de l’Union soviétique. Adossées à une lecture rigide des
méthodes du théoricien du théâtre, Constantin Stanislavski (1863-1938), celles-ci combattent le
« formalisme » et « l’intellectualisme » et recadrent le théâtre autour de sa fonction littéraire67
.
La mise en place de ce système centralisé, avec des établissements financés par le budget
public et le répertoire façonné par des normes idéologiques prescrites par le Parti68
ne constitue pas le
seul vecteur de redéfinition du théâtre. L’Etat se charge également de la formation des agents, acteurs,
metteurs en scène, décorateurs, secrétaires littéraires, etc. Dans son pamphlet au vitriole consacré aux
« artistes d’Etat »69
, Miklós Haraszti voyait dans cette professionnalisation l’une des courroies de
socialisation aux valeurs officielles. Si le jugement peut apparaître quelque peu réducteur, il ne
manque pas de fondement. La formation de type universitaire aux métiers de la scène refaçonne les
imaginaires et les pratiques70
. Des conservatoires d’art dramatique avaient certes déjà existé avant la
période communiste. Cependant ces derniers ne constituaient pas des lieux de passage obligés pour
intégrer une troupe professionnelle. Cela change progressivement dans les années 1950. Ces
formations débouchent sur une égalisation au moins partielle, des conditions sociales des « artistes
d’Etat » du théâtre71
. Le statut et l’image sociale des professionnels s’en trouvent également redéfinis :
les traits anciens de la bohême et l’aura du vedettariat croisent la respectabilité, voire la notabilité des
diplômés de l’éducation supérieure. Dans un régime de production théâtrale qui insiste sur
l’importance du public, cible du travail d’éducation, ce système de formation favorise paradoxalement
le durcissement d’un champ où le jugement des pairs et la critique théâtrale prennent progressivement
de l’importance.
Oradea : une histoire d’Anciens et de Nouveaux
Les pratiques du théâtre à Oradea sont également refaçonnées, à travers toutefois des
combinaisons inédites d’ancien et de nouveau. Observer ce lieu spécifique éloigne le regard d’autres
évolutions tant locales que nationales, qui donnent à voir, surtout à la fin des années 1940 et puis à
64
Marian Popescu, Scenele teatrului românesc : 1945-2004. De la cenzurǎ la libertate [Les scènes du théâtre
roumain : 1945-2004. De la censure à la liberté], Bucarest : Unitext, 2004 ; Liviu Maliţa (dir.), Cenzura în teatru.
Documente 1948 – 1989 [La censure dans le théâtre. Documents 1948-1989], Cluj-Napoca : Efes, 2006. 65
Jack Goody, « Théâtres, rites et représentations de l’autre » in id., La Peur des représentations. L’ambivalence
à l’égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques et de la sexualité, Trad. Pierre Emmanuel Dauzat,
Paris : La Découverte, 2003, p. 112-167, p. 136. 66
Liviu Maliţa (dir.), Cenzura in teatru.op.cit., p.4. 67
Marie-Christine Autant-Mathieu, « Le dressage du théâtre soviétique dans les années 1930 et 1940 », Cahiers
Slaves, 8, p. 19-41. 68
Les modes de régulation du théâtre en tant qu’entreprise socialiste en RDA, qu’il s’agisse de la structure
institutionnelle, de la professionnalisation des agents, assurée par l’Etat, du rôle de la « troupe » comme vecteur
de politiques sociales, etc. ne sont pas sans rappeler la régulation de ce domaine en Roumanie. Cf. Laure de
Verdalle, Le théâtre en transition. De la RDA aux nouveaux Länder, Paris : Editions de la MSH, 2006, surtout
p.115-143. 69
Miklós Haraszti, Artistes d’Etat. De la censure en pays socialiste, Paris : Fayard, 1985. 70
Cette formation est assurée en Roumanie, à partir de 1954, par deux établissements, l’un à Bucarest, consacré
à la formation théâtrale et cinématographique, le second dans la ville transylvaine de Tîrgu-Mureş, dédié à la
préparation des acteurs hongrois et avec intermittences, à celle des metteurs en scène hongrois, avant d’accueillir
également à partir de 1976 des étudiants roumains. 71
Cette égalisation ne toucha pas tous les domaines de la même façon. La télévision et le cinéma avaient des
modes de rétribution beaucoup plus généreux.
12
nouveau entre 1958 et 1962, de la répression et des épurations72
. En 1955, l’établissement de langue
hongroise jusque-là, s’enrichit d’une « section » roumaine et change par conséquent de nom pour
devenir le Théâtre d’Etat d’Oradea. Le directeur de l’établissement est en même temps le responsable
artistique de la troupe roumaine, alors la « section » hongroise dispose de son propre « directeur
artistique ». L’institution finit par réunir autour de 180 salariés dans les années 1960, pour descendre à
157 dans la seconde moitié des années 1980 ; autour de quatre-vingts d’entre eux sont considérés,
selon le label officiel, du « personnel artistique ».
La création de la section roumaine apparaît comme la résultante d’une mobilisation locale et
une dynamique nationale qui voit à partir de 1955 un glissement progressif du discours politique.
Après avoir pratique la répudiation du « national », celui-ci réintègre cette thématique, fût-ce
initialement d’une manière prudente73
. Localement, les revendications d’intellectuels et d’acteurs
amateurs en faveur de la constitution d’une troupe roumaine rencontrent quant à elles le soutien du
responsable du domaine culturel à l’échelle de la région, Andrei Dauer74
. Lui-même directeur du
théâtre entre 1957 et 1960, ce diplômé de philosophie et d’histoire, né à Oradea en 1922 est un rescapé
des détachements de travail forcé et, ensuite du ghetto de Budapest75
.
La pratique théâtrale de la section roumaine apparaît dès le début marquée par la relation avec
Bucarest. La troupe initiale est constituée autour d’un noyau de jeunes diplômés de la promotion 1955
de l’Institut de théâtre de Bucarest séduits par les promesses du directeur de l’établissement, lequel
s’engage non seulement à les faire jouer, mais aussi à leur assurer des logements76
. Aux oreilles de
certains d’entre eux, la ville dont les rues sont remplies de son hongrois ne manque pas d’une certaine
étrangeté77
. L’offre de théâtre roumain ne se cristallise dès lors pas dans un lien fort avec un public
local – si ce n’est, dans les années 1960, l’inclusion au répertoire du drame historique – elle se
constitue davantage en rapport avec les évolution d’un champ théâtral qui s’organise autour de
Bucarest, lieu de validation de la qualité professionnelle. D’ailleurs l’entrée d’Oradea sur la carte du
théâtre roumain s’opère autour d’une création de la saison 1957-1958 avec l’Alouette de Jean Anouilh,
premier spectacle sans rideau en Roumanie, salué par la critique mais lequel désempare, semble-t-il le
public local, de sorte que le spectacle est arrêté après dix représentations78
. Cette projection à l’échelle
nationale s’accomplit à un moment où la scène roumaine entame sa « rethéâtralisation», à la faveur du
relâchement des normes du réalisme socialiste, dans le sillage de la déstalinisation soviétique79
. A
l’instar des écrivains roumains qui réclamaent en 1956 « l’éradication du dogmatisme »80
, en 1957 les
« hommes de théâtre » et surtout de jeunes metteurs en scène, réunis en conférence nationale, exigent
« la professionnalisation artistique de la mise en scène » et se prononce en faveur de « l’authenticité de
72
Voir notamment Dennis Deletant, Communist Terror in Romania: Gheorghiu-Dej and the Police State 1948–
1965, New York: St. Martin's, 1999; pour une synthèse qui se prête à une lecture critique, on peut se reporter à
Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile (dir.), Comisia prezidenţială pentru analiza dictaturii
comuniste din Romania. Raport final [La Commission présidentielle pour l’analyse de la dictature communiste
de Roumanie. Rapport final], Bucarest : Humanitas, 2007. 73
Voir notamment Stefano Bottoni, « Recepció és párhuzamosság. A romániai '56 és a magyar forradalom
viszonya », art.cit. ; Katherine Verdery, National Ideology Under Socialism…, op.cit. 74
Stelian Vasilescu, « Primul deceniu » [La première décennie], in Elisabeta Pop (dir.), Teatrul românesc la
Oradea…, op.cit., p. 85-123, p. 85. Jusqu’à la réforme administrative de 1968, les régions constituent le niveau
sous-étatique de l’administration roumaine. En 1968, elles sont remplacées par des départements. 75
« Directorii Teatrului de Stat. Evocǎri, confesiuni, interviuri, Andrei Dauer » [Les directeurs du Théâtre
d’Etat. Evocations, confessions, entretiens. Andrei Dauer], in Elisabeta Pop (dir.), Teatrul românesc la
Oradea…, op.cit., p. 225-229. 76
Eugen Tugulea, Unele mărturisiri, op.cit., p.47. 77
Voir sur ce thème le témoignage de Eugen Tugulea, Unele mărturisiri, op.cit. p. 47-49. 78
Elisabeta Pop, « Repertoriul Secţiei române a Teatrului de Stat Oradea… », art.cit., p. 338. 79
Miruna Runcan, « Teatru 1957. Schimbarea la faţă. Explorare arheologică la semicentenarul întîlnirii dintre
teatrul şi filmul romanesc (I) » [Théâtre 1957. Le changement. Une exploration archéologique au 50ème
anniversaire de la rencontre du théâtre et du film roumain (I)], Observator cultural, 350, décembre 2006,
http://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-1957-Schimbarea-la-fata*articleID_16660-articles_details.html
[consultée le 1er
novembre 2009] 80
Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile (dir.), Comisia prezidenţială… op.cit., p. 316.
13
l’univers évoqué par le texte ». Un an plus tôt avait vu le jour la revue de critique théâtrale « Teatrul »
[Le Théâtre], autre indice de cette dynamique de « professionnalisation ».
A l’inverse, la pratique théâtrale de la troupe hongroise s’inscrit davantage dans un lien de
proximité avec le public local. L’auteur de la monographie consacrée au théâtre hongrois à Oradea,
qualifiait les années 1950 comme la « période où le théâtre d’Oradea a vraiment été d’Oradea, sans
copier personne ».81
Ce profil fut façonné sous la direction conjointe d’un « homme nouveau » et d’un
Ancien82
. Entre 1949 et 1956, l’homme nouveau fut le directeur, János Molnár, de profession
cordonnier, également auteur de deux pièces réalistes socialistes, dont l’une qui rencontra un véritable
succès de public. Après la chute du communisme, ses qualités d’écoute et de bon organisateur
continuaient à être saluées au théâtre. Dans un entretien accordé en 1972 au quotidien local Fáklya [La
Flamme], J. Molnár rappelait dans ces termes sa rencontre avec le théâtre : « Je suis entré en contact
avec le mouvement ouvrier en 1936. J’ai connu beaucoup d’épreuves et un jour il m’est arrivé quelque
chose de totalement inattendu. J’ai appris qu’on voulait me nommer directeur de théâtre. /…/. J’ai été
obligé d’accepter à contre coeur et lorsque je l’ai fait, j’ai compris que mon principal devoir sera de
faire venir les habitants de la ville au théâtre. /…/; je ne me suis pas impliqué excessivement dans les
problèmes artistiques qui me dépassaient. /…/Lorsque j’ai quitté le théâtre, je suis retourné à mon
fauteuil de cordonnier en dépit du fait que l’on voulait faire de moi un fonctionnaire /…/».83
L’Ancien, également atypique, était incarné par le metteur en scène principal, en charge
pendant une quinzaine d’années de la définition du répertoire de la troupe hongroise, László Gróf
(1891– 1971). Acteur qui avait gagne sa notoriété dans les années 1910 comme interprète d’opérette, il
était aussi le gendre de l’ex-directeur du théâtre de Nagyvárad, l’entrepreneur théâtral de succès,
Miklós Erdélyi. Après avoir obtenu, dans les années 1920, pour de brèves périodes, la direction de la
compagnie de Nagyvárad, L. Gróf avait cédé aux sirènes de Bucarest et s’était éngagé au théâtre
d’opérette Alhambra qui diffusait ce genre auprès du public bucarestois. Revenu en Transylvanie à la
fin des années 1930, il fut marginalisé pendant la guerre en raison de ses origines juives, mais échappa
à la déportation84
.
Ces deux hommes s’engagent ensemble dans la diffusion du nouvel imaginaire égalitariste du
théâtre. La redéfinition s’appuie non seulement sur un répertoire partiellement refaçonné selon les
normes du réalisme socialiste, où les auteurs soviétiques jouxtent les représentants d’une nouvelle
dramaturgie roumaine et des classiques (F.Schiller, C. Goldoni, A.Tchékhov, etc.). Le succès de
l’entreprise est plus encore lié au réinvestissement de formes culturelles antérieures, en particulier de
l’opérette85
. Une saison théâtrale composée en moyenne d’une dizaine de productions comprend une à
deux opérettes, dans les mises en scène soignées de László Gróf. Les significations sociales de ce
genre se redéploient une fois de plus86
, son cercle de séduction étant grâce à la diffusion par la radio,
élargi au-delà des classes moyennes vers les milieux ouvriers. Ses rythmes remplissent tant la salle
baroque du théâtre – où les travaux de rénovation réalisés entre 1958 et 1959 suppriment les places
debout, réduisant la capacité d’accueil à quelque 700 places87
- que le jardin d’été inauguré près du
81
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 196. 82
Dans cette même perspective, voir notamment Catriona Kelly, David Shepherd (ed), Constructing Russian
Culture in the Age of Revolution : 1891-1940, Oxford: Oxford University Press, 1998. 83
« Directorii Teatrului de Stat. Evocǎri, confesiuni, interviuri, János Molnár » [Les directeurs du Théâtre d’Etat.
Evocations, confessions, entretiens. János Molnár], in Elisabeta Pop (dir.), Teatrul românesc la Oradea…,
op.cit., p. 224. 84
Magyar Szinházi Lexikon [Dictionnaire du théâtre hongrois],
http://mek.niif.hu/02100/02139/html/sz08/229.html 85
Pour la circulation de ce genre dans l’espace soviétique et son investissement dans les relations entre l’Union
soviétique et la Hongrie, voir Gyöngyi Heltai, « Operett-diplomácia » [La diplomatie à travers l’opérette], Aetas,
3-4, 2004, p.87-119. 86
Sur les logiques des appropriations particulières des œuvres voir notamment Roger Chartier, « La nouvelle
histoire culturelle existe-t-elle ? », Cahiers du Centre de recherches historiques. Regards sur l’histoire
culturelle, 31, avril 2003, p.13-24, p.20. 87
István Kelemen, Várad színészete, op.cit., p. 175.
14
théâtre en 1953, réservé à la saison estivale. Ces espaces sont investis en partie par un nouveau public.
Le directeur développe en effet un système d’abonnement d’entreprise, grâce auquel les ouvriers
méritants, quelque 300 par représentations, voient leur travail récompensé par des billets de théâtre88
.
Le titre d’un spectacle de cabaret proposé durant la saison 1954-1955 illustre bien cet esprit : « Pour
un travail bien accompli, un loisir de qualité »89
. Pendant la même saison, une photo réalisée avec
l’équipe de la production « Des Derniers » de Maxim Gorki, montre un théâtre d’égaux. Une vingtaine
de personnes se trouvent réunies : au premier rang, l’éclairagiste se trouve près du directeur du théâtre,
suivi de quatre jeunes acteurs; au deuxième rang, le metteur en scène roumain, n’est pas très loin de la
costumière90
.
La mise en conformité idéologique à la sortie des « belles sixties »91
tente de remettre le
théâtre au service d’un imaginaire égalitariste en proposant une définition de la culture en terme
d’activité créative des masses visant à dépasser les frontières entre « haute culture » et « culture
populaire ».
Aux marges d’une « mini-révolution culturelle »
Le rôle de l’éducation socialiste est réaffirmé au début des années 1970 alors que des
transformations sociales refaçonnent le profil de la société socialiste. L’urbanisation se poursuit,
associée à une deuxième vague d’industrialisation réalisée au prix d’un endettement important92
.
Après avoir rendu, en 1962, l’éducation de 8 ans obligatoire, en 1978 une nouvelle loi de l’éducation
et de l’enseignement relève ce seuil à 10 ans. L’accès aux biens de consommation connaît quant à lui
un élargissement progressif dans les années 1960. Des études réalisées par l’Office d’études et de
sondages auprès de la Télévision roumaine font état au début des années 1970 de l’existence de
1 287 360 appareils de télévision dont 74% dans le milieu urbain. Dans la hiérarchie des préférences,
les émissions de divertissement réunissent six fois plus de spectateurs que celle d’information et treize
fois plus que les émissions économiques93
. La mobilisation idéologique vise dès lors à réhabiliter un
imaginaire révolutionnaire, puritain, essoufflé. La crise économique qui s’installe dans les années
1980 est en partie liée aux ambitions du régime roumain de rembourser les dettes extérieures. La
réaffectation des ressources touche tous les secteurs de la consommation interne, comme elle touche le
secteur culturel « non-productif ».
Cette diminution des ressources fragilise le théâtre plus encore que ne l’avaient fait
les « thèses de juillet », dont la douzième directive traitait du répertoire, requis de promouvoir « la
création originale, ayant un caractère militant, révolutionnaire », les « travaux de valeurs de la
création actuelle des pays socialiste » alors que le « répertoire international classique et
contemporain » devait faire l’objet d’une « sélection plus rigoureuse ».94
. Pour mener ces politiques
culturelles, l’ancien Comité d’Etat pour la Culture et l’Art, équivalent du ministère de la Culture,
cédait la place au Conseil de la culture et de l’éducation socialiste (CCES) placé sous la double tutelle
de l’Etat, le président du Conseil ayant rang de ministre, et de la commission idéologique du Comité
88
István Kelemen, Várad színészete.op.cit, p. 196 ; « Directorii Teatrului de Stat. Evocǎri, confesiuni, interviuri,
János Molnár », art.cit, p. 223. 89
Béla Nagy, Ötven év az állam tenyerén [Cinquante ans aux frais de l’Etat], Nagyvárad [Oradea] : Editura
Imprimeriei de Vest, 1998, p. 28. 90
Id.ibid. 91
Catherine Durandin, Histoire des Roumains, op.cit, p.403. 92
Entre 1950 et 1981 la population employée en agriculture passe de 74,1% à 28,9%, alors que celle employée
dans l’industrie passe de 12% à 36,1%.Cf. Dragoş Petrescu, « The alluring face of Ceausescuism : nation-
building and identity politics in Communist Romania, 1965-1989 », New Europe College Yearbook, 11, 2003-
2004, p. 241-275, p.261. Les dettes roumaines passent de 1,2 milliards dollars en 1971 à 9,5 milliard de dollars
en 1981. Cf. Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, op.cit., p.515. 93
Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx, op.cit., p. 447-466. 94
Nicolae Ceauşescu, « Propuneri de măsuri … », art.cit.
15
central du Parti communiste95
. Les catégories de l’esthétique socialiste étaient redéfinies ainsi que les
priorités thématiques, précisées en 1973, lors d’une réunion des professionnels du théâtre avec des
responsables du CCES. Ces derniers dénonçaient notamment la valorisation de critères esthétiques qui
guideraient l’importation des pièces de la « dramaturgie universelle contemporaine » et encourageaient
la critique de la société, tant qu’elle restait sur de positions communiste96
. En 1977, le CCES voyait
ses compétences élargies suite à la suppression du département chargé auparavant de la censure. Cette
réforme déplaçait la responsabilité depuis une structure clairement identifiable vers une multitude de
niveaux de décision, le CCES et ses échelons départementaux, mais aussi toute institution active dans
le domaine de la culture ou de la presse, revue, maison d’édition, théâtre, etc. Si les années 1970
avaient multiplié les innovations institutionnelles introduisant de nouvelles incertitudes dans des
pratiques quelque peu routinisées, le décret n°476 de 1983 sur l’auto-financement, appliqué à partir du
1er janvier 1984, réduisait d’une manière substantielle la part des subventions publiques dans les
budgets des établissements de culture, théâtre compris97
.
Ces redéfinitions des règles de jeu autour de mots d’ordres au contenu suffisamment vague
pour être susceptible d’investissements multiples se traduisent par un accroissement des institutions et
des lieux de négociation. Certains observateurs évoquent le « chaos » : une même pièce pouvait être
présentée dans un département et interdite dans un autre, acceptée dans une mise en scène, refusée
dans une autre98
, acceptée à condition qu’elle ne quitte pas le territoire du département. En situation
segmentation, de compartimentalisation du pouvoir, l’insertion dans des réseaux diversifiés,
« professionnels » et « politiques », la capacité à mobilier des acteurs économiques et politiques
locaux, ainsi que des membres de la nomenklatura culturelle locale et nationale99
constitue le pré-
requis d’un directeur de théâtre qui souhaite durer. De ces atouts, le directeur du théâtre d’Oradea, le
journaliste et dramaturge Mircea Bradu (né en 1937), qui réussit à égaler la performance de Miklos
Erdélyi en restant quinze années à la tête de l’établissement (entre 1977 et 1992), est pourvu avec
générosité. Le Théâtre d’Oradea ne connaît pas la situation d’autres établissements obligés non
seulement à réduire leur personnel et à mettre à la retraite certains des agents, mais aussi à opérer des
coupes dans les salaires pour cause non-réalisation du plan100
. Par la politique de promotion de la pièce
originale quelque fois signée par des auteurs qui occupent aussi de hautes positions dans la
nomenklatura culturelle, par la capacité à garder ou à faire venir dans son établissement des metteurs
en scène talentueux dont les spectacles obtiennent la reconnaissance de la critique et des prix dans les
nombreux festivals de théâtre des années 1970 et 1980, sa démarche consolide la situation du théâtre
d’Oradea.
Le répertoire d’un théâtre politisé : « besoins réels des masses », art et distractions vespérales
A l’instar du reste de la Roumanie, Oradea connaît également les effets de la deuxième vague
d’industrialisation dans les années 1960-1970, qui contribue à une hausse considérable de sa
population (voir tableau 1), à une reconfiguration de sa carte géographique autour de nouveaux pôles
95
Une chronologie de ces réformes est disponible sur le site web « Comunismul în România », du Musée
d’histoire de la Roumanie à l’adresse http://www.comunismulinromania.ro/aspecte-documentare/articole/92-
educaie-tiin-cultur-iii-.html [consulté le 2 novembre 2009]. 96
Anneli Maier, Theatrical Meeting in Bucharest, Radio Free Europe Research, Rumania, 1, 5 janvier 1973,
http://www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/52-1-355.shtml [consultée le 9 novembre 2009]. 97
A Oradea, où trois institutions – le Théâtre d’Etat, le théâtre de marionnettes et la Philarmonique – sont
réunies dans une administration commune, le degrés d’auto-financement s’élève à 85%. Malgré le dépassement
des indications du « plan culturel », les retards de paiement des fournisseurs s’accumulent. « Teatrul de stat
Oradea, administraţia comună, Către Consiliul popular al judeţului Bihor » [Le Théâtre d’Etat, l’administration
commune, Au conseil populaire du département de Bihor], courrier daté du 14 mars 1989. 98
Liviu Maliţa, « Scena întunecată » [La scène assombrie], in Liviu Maliţa (dir.), Viaţa teatrală în şi după
comunism, Cluj-Napoca : Efes, 2006, p. 7 ; Elisabeta Pop, Istorii şi isterii teatrale [Histoires et hystéries
théâtrales], Arad : Nigredo, 2003, p.79. 99
Pour une analyse du fonctionnement de l’informel à partir du terrain roumain, voir notamment l’article de
Steven Sampson, « The informal sector in Eastern Europe », Telos, 66, winter 1985-1986, p. 44-66. 100
Entretien Siviu Bicescu, organisateur de spectacle, le 22 septembre 2006.
16
industriels loin du centre-ville, à la proximité desquels sont créés des quartiers qui alignent des
immeubles de béton communiste, de quatre ou huit étages. En même temps, sur l’une des collines qui
dominent la ville, des maisons que l’on appelle « villas », augmentent en nombre. La croissance
urbaine signifie aussi une « roumanisation » de la ville101
tant en termes démographiques qu’en termes
d’offre culturelle et éducationnelle. Cette évolution n’est pas sans rapport avec le tournant nationaliste
adopté par le communisme roumain. En même temps, les « belles sixties » se prolongent dans les
années 1970, au moins dans certains secteurs de la vie quotidienne. Une moitié de la rue centrale qui
mène de la gare au théâtre, laquelle avait acquis son apparence moderne au moment des travaux
d’urbanisation des années 1900, est rendue aux piétons. Fût l’offre moyennement développé, les
magasins de vêtements, de nourriture, les librairies, se succèdent au rez-de-chaussée des bâtiments Art
Nouveau. Le premier « magasin universel » de quatre étages présente son lourd profil en béton décoré
d’arabesque dans cette même rue en 1978. L’offre de loisir se diversifie quant à elle avec la
construction en 1972 d’une « Maison de culture des syndicats » dont la salle de spectacle dispose de
plus de capacité que celle du théâtre. En 1981, une Maison de la science et de la technique pour la
jeunesse est également inauguré dans un des nouveaux quartiers102
. La dégradation de la situation
économique se fait sentir à Oradea dès la fin des années 1970, mais la crise, notamment alimentaire,
est, quelque peu diminuée grâce notamment à la proximité avec la Hongrie. Celle-ci ne connaît pas la
pénurie. Un marché informel peut dès lors se déployer103
.
Dans ce contexte, le répertoire du théâtre de province est façonné par plusieurs contraintes.
Défini au niveau de la Direction des théâtres du CCES, la grille censée encadrer une saison réunissant,
pour chaque troupe, quelque six productions, comprend quatre entrées : dramaturgie nationale
contemporaine, dramaturge nationale classique, dramaturgie des pays frères et dramaturgie
universelle. Dans les années 1980, des raisons à la fois économiques et idéologiques renforcent
davantage la dimension « roumaine contemporaine ». Les spectacles de cabaret, nombreux au
répertoire de la section hongroise, sont requis de contenir 70% de morceaux musicaux composés par
des auteurs roumains104
. La configuration des ensembles et la question de « normes professionnelles
pour le personnel artistique » qui précisent à partir de 1976, le nombre d’heures à passer sur scène, le
nombre d’heures de répétitions et les autres activités105
influencent également l’offre de spectacles.
Dans ce système de contraintes, les préférences dramaturgiques des metteurs en scène jouent un rôle
central. Intervient enfin, l’horizon d’attente de spectateurs/consommateurs dans une ville de frontière
où l’on capte non seulement la télévision roumaine dont l’offre se réduit durant la seconde moitié des
années 1980 à la chronique enthousiaste des innombrables « visites de travail » du « fils le plus aimé
du peuple », mais aussi la télévision hongroise aux programmes nettement plus variés. A la même
époque, la multiplication des magnétoscopes contribue à façonner le spectateur/consommateur106
L’examen du répertoire de deux troupes entre 1969 et 1989 révèle une relative ouverture en
termes de genres et de thèmes et une différenciation des styles des mises en scène, malgré une
domination relative de l’esthétique réaliste. L’intégration dans le même système institutionnel, mais
aussi dans une société cible de politiques d’homogénéisation, ne reste pas sans effets. Les différences
qui apparaissent reflètent des représentations en partie distinctes de la relation au public, quelques
écarts dans les savoir-faire, malgré la formation uniformisée, des ressources et des contraintes
101
En 1989, les lycées d’Oradea comptaient 17 123 élèves dont 2 764 étudiaient en hongrois, soit un huitième.
Cf. Liviu Borcea, Gh.Gorun (dir.), Istoria oraşului Oradea.op.cit., p. 422-423. 102
Id.ibid., p. 415-421. 103
Sur l’économie informelle développée autour du « petit trafic » de frontière dans la Roumanie des années
1980, voir Liviu Chelcea, Puiu Lăţea, România profundă în comunism, op.cit.. 104
Entretien Béla Nagy, secrétaire littéraire de la section hongroise entre 1982 et 1990, le 25 septembre 2009 105
Eugen Tugulea, Unele mărturisiri, op.cit, p.47; entretien avec Eugen Tugulea, le 18 septembre 2009 ;
entretien avec László Dénes, organisateur de spectacles pour la section hongroise, le 25 septembre 2006. 106
Pour une évolution semblable observée dans l’Union soviétique, voir Stephen Lovell, “Publishing and the
Book Trade in the Post-Stalin Era: A Case–study of the Commodification of Culture”, Europe-Asia Studies, 50
(4), 1998, p. 679-698; Joshua First, “From Spectator to “Differentiated” Consumer. Film Audience Research in
the Era of Developed Socialism (1965-80)”, Kritika : Explorations in Russian and Eurasian History, 9(2),
Spring 2008, p.317-344.
17
partagées partiellement. Le nationalisme officiel qui investit massivement l’espace public à partir des
années 1970 et la « roumanisation » de la ville plus intense dans les dernières années du communisme
sous l’effet des émigrations magyares vers la Hongrie façonnent la société hongroise du spectacle. Si
les deux troupes souffrent par ailleurs d’un désinvestissement plus général à l’égard du théâtre (voir le
tableau 2) que vient renforcer vers la fin des années 1980 la dégradation générale des conditions de
vie, elles cherchent à compenser ce déclin de manière différente. La troupe roumaine peut s’appuyer
sur un public « captif » d’élèves –abordés par les organisateurs de spectacles qui se rendent dans les
écoles, à travers une question piège « qui ne prend pas d’abonnement ? »107
- et de conscrits stationnés
dans les casernes d’Oradea. Sur les six séries d’abonnement proposées par la troupe roumaine, quatre
comprennent en partie des élèves108
. Le réservoir d’élèves hongrois « captifs » est lui en réduction. Les
deux ensembles développent par ailleurs des stratégies de mobilité, lesquelles se déploient dans des
espaces en partie différents.
Tableau 2 : Spectateurs
Année Spectateurs Au siège Troupe
roumaine Au siège Troupe
hongroise Au siège
1969 211 208 108 913 117 843 32 615 93 365 42 992
1970 189 928 91 776 95 212 57000 94 716 34 776
1971 175 888 92 716 96 330 62 128 79 558 30 588
1972 169 911 96 888 97 430 65 242 72 481 31 646
1973 167 225 110 412 95 197 70 412 72 028 40 000
1974 162 321 96 205 97 653 65 388 64 668 30 817
1975 184 477 97 609 110 060 62 823 73 417 34 786
1976 189 159 116 954 115 469 78 228 73 690 38 726
1977 212 432 106 017 130120 73 023 82 312 32 994
1978 194 247 114 004 107 587 74 824 86 660 39 180
1979 192 947 x 112 012 x 80 935 x
1980 207 293 119 142 104 840 66 734 102 453 52 408
1981 189 992 108 067 95 106 58 979 92 932 49 088
1982 211 056 113 885 98 295 56 170 112 761 57 175
1988 330 808 117 565 156 192 62 122 174 616 55 443
Sources : Archives du Théâtre d’Etat d’Oradea
A partir de 1977, l’ensemble roumain assure deux à trois représentations hebdomadaires dans
une station de bains thermaux, Baile Felix, développée surtout dans les années 1970, située à moins de
dix kilomètres de Oradea. Une salle de trois cents places appartenant aux syndicats est mise à sa
disposition pour améliorer une maigre offre de loisirs pour les vacanciers venus du pays entier. Le
second axe de mobilité de la troupe roumaine vise les festivals de théâtre qui se multiplient. Lieux de
sociabilité professionnelle, ce sont des amplificateurs de notoriété. Le prestige validé par des prix
n’appartient pas uniquement au théâtre, mais concerne aussi la ville et le département (et les autorités
politiques qui en ont la charge), renforçant ainsi les marge de manœuvre de négociation du directeur et
de sa troupe. L’ensemble hongrois croise partiellement la trajectoire des Roumains dans les festivals
(où six autres ensembles de langue hongroise se font représenter), mais soigne davantage, outre ses
spectateurs locaux, ceux de villes moyenne de deux départements à majorité hongroise, Harghita et
Covasna, situés au centre de la Roumanie, à plus de 300 kilomètres.
La cadence des spectacles de la troupe hongroise qui continue à réunir jusqu’à la fin des
années 1980 un nombre plus important d’acteurs est également à souligner (voir le tableau 3).
Tableau 3 : Spectacles et représentations
Année Créations Créations en roumain Creations en hongrois Représen-
tations
En
roumain
En
hongrois
107
Entretien Siviu Bicescu, organisateur de spectacle, le 22 septembre 2006 108
id.ibid.
18
1968 12 7 6 407 189 218
1969 15 7 8 492 250 242
1970 18 9 9 514 227 287
1971 14 8 6 473 213 260
1972 12 5 7 436 201 235
1973 13 7 6 453 197 256
1974 13 7 6 422 229 193
1975 14 8 6 467 233 231
1976 13 7 6 411 218 193
1977 17 7 10 460 239 221
1978 16 8 8 426 211 215
1979 16 9 7 461 232 129
1980 19 8 11 481 229 252
1981 16 7 9 460 221 234
1982 15 5 10 532 225 307
1983 16 8 8 525 250 275
1984 16 6 10 676 x x
1985 14 6 8 685 335 350
1986 18 9 9 807 400 407
1987 17 7 10 790 394 396
1988 16 7 9 788 358 430
Sources : Chiffres reconstitués par l’auteur à partir des compte-rendu comptable annuels du théâtre. Archives du
Théâtre d’Etat d’Oradea. Ces données sont néanmoins indicatives, d’autres sources pouvant indiquer des chiffres
légèrement différents, en particulier Elisabeta Pop (ed.), Teatrul românesc la Oradea. Perspectivǎ monograficǎ
[Le Théâtre roumain à Oradea. Une monographie], Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 2001 ; Béla Nagy,
Ötven év az állam tenyerén [Cinquante ans aux frais de l’Etat], Nagyvárad [Oradea] : Editura imprimeriei de
Vest, 1998.
Les spectacles ouvertement dédiés à la gloire du Parti restent très peu représentés dans les
deux cas (sept pour l’ensemble roumain, sur plus de 150 productions pendant presque 20 ans, six pour
ensemble hongrois sur 175 productions sur la même période 1969-1989). La ventilation selon les
catégories de la grille est également assez proche, même si le poids des auteurs roumains
contemporains apparaît légèrement plus important chez les Roumains avec un peu plus de 33%, que
chez les Hongrois (un peu plus de 29%). Dans les deux cas, on peut par ailleurs observer un
recoupement partiel des auteurs joués et des effets de concentration autour de quelques noms
« maison ». Ces derniers sont issus dans le cas roumain essentiellement de la même génération
affirmée dans les années 1960 dont certains représentants occupent des positions institutionnelles
importantes, tout en écrivant des textes dotés d’une dimension critique à l’adresse de l’ordre socialiste.
C’est notamment le cas pour Dumitru Radu Popescu, président de l’Union des écrivains entre 1981 et
1990. Cet effet de concentration autour de quelques noms qui développent des liens serrés avec le
directeur ou tel metteur en scène est provoqué également par la priorité accordée, coté roumain, à la
pièce originale et à la première absolue. Le lien avec Bucarest est central, comme le rappelle
l’ancienne secrétaire littéraire du théâtre : « on pouvait attirer la presse à une première seulement si
l’on proposait un texte nouveau ou si le metteur en scène qui signait la direction du spectacle était
quelqu’un qui intéressait les spécialistes. Pour des pièces « fumées », anciennes, des metteurs en scène
moins connus, ne se précipitait personne, et le théâtre risquait d’enregistrer, dans un anonymat parfait,
première après première. Or rien n’était plus triste pour les acteurs que le soir de la première aucun
chroniqueur de Bucarest ne soit présent, et que rien n’apparaisse dans la presse centrale. Comme s’ils
n’existaient pas »109
.
Les deux ensembles présentent en revanche un taux réduit de pièces issues des dramaturgies
nationales pré-communistes, un peu plus de 9% coté roumain et 8,1%, coté hongrois. Le poids de la
dramaturgie russe et soviétique est semblable : dix productions chez les Roumains, dont deux pré-
soviétiques, avec A.Tchékhov et l’expressionniste Léonid Andreev, treize chez les Hongrois où l’on
retrouve F.Dostoïevski, A.Tchékhov, L.Tolstoï. Le poids des autres « pays frères » est dans les deux
cas réduit avec six productions (B.Brecht et S.Mrozek essentiellement). On peut remarquer néanmoins
109
Elisabeta Pop, Istorii si isterii teatrale, op.cit., p.60.
19
le succès de public dont bénéficie au début des années 1970 deux représentants de la nouvelle
dramaturgie est-allemande, R.Strahl et surtout Ulrich Plenzdorf, dont « Les Nouvelles souffrances du
jeune W. » publié originellement sous forme de roman en 1972 en RDA, transformé ensuite en pièce
de théâtre, évoque le malaise d’un jeune est-allemand autour d’un parallèle avec le Werther de Goethe.
Le spectacle est monté à Oradea durant la saison 1973-1974 dans une production qui associe l’un des
premiers groupes rock hongrois de Transylvanie, le « Métropol », et rencontre un vif succès
notamment auprès des jeunes. Autre caractéristique du répertoire hongrois, la présence des auteurs
hongrois contemporains, avec vingt-sept créations assurées par huit auteurs. Là aussi, un effet de
concentration est visible, en particulier autour du dramaturge István Csurka joué cinq fois. Ses liens
familiaux avec la ville de Nagyvárad où il visitait, enfant, ses grands-parents, joue dans ce lien .Au
nom de cette mémoire familiale, I. Csurka renonce d’ailleurs à ses droits d’auteur, argument séduisant
pour les autorités culturelles et politiques roumaines.
La dramaturgie universelle représente dans les deux cas à peu près un cinquième du répertoire
et l’on observe un recoupement partiel entre les deux ensembles, avec quelques noms qui reviennent,
qu’il s’agisse de classiques (W.Shakespeare, Molière) ou des représentants du vaudeville français de la
seconde moitié du XIXe siècle (Sardou-Moreau, dont Madame sans gêne est joué par les deux
ensembles) ou encore du « boulevard » ou de Broadway des années 1960 (Robert Thomas, Barillet-
Grédy, etc.) lesquels arrivent sur la scène d’Oradea à l’initiative d’une direction à la recherche de
pièces qui pourraient attirer le public. Le théâtre plus moderne ou l’avant-garde sont moins présents,
même si l’on retrouve un F. Wedekind, un E.Bond, un H.Pinter. Mais aussi reconnus par la critique
que ces spectacles fussent, la rencontre avec le public n’est pas toujours heureuse. On remarquera
toutefois qu’en 1979, alors que Madame sans Gêne réunit 16 689 spectateurs, Ce soir on improvise de
Pirandello, l’un des spectacles les plus primés de la section roumaine, attire 5 798 spectateurs.110
Les publics « d’une belle salle comme la nôtre »: les contradictions du théâtre socialiste
Si l’on s’intéresse aux entrées, et surtout aux séries de représentations avec la même pièce, des
rapprochements sont visibles dans les préférences des spectateurs des deux troupes, par delà un goût
plus marqué des Hongrois pour des spectacles musicaux (qui prolonge d’une certaine façon la
socialisation à l’opéra) et l’enthousiasme des Roumains pour des vedettes du théâtre de Bucarest qui
gagnent leur notoriété dans les années 1970 notamment grâce à la télévision111
. Outre les comédies,
quelques-uns des succès publics les plus importants se réalisent autour d’auteurs contemporains. Pour
l’ensemble hongrois, les productions avec les pièces de István Csurka qui se suivent annuellement
entre 1978 et 1983 attirent les spectateurs. Malgré ses racines locales, mises en avant dans le cahier de
salle de la première production, en 1978, avec Az idö vasfoga [Les dents de fers du temps], I. Csurka
est un explorateur de l’univers urbain et de la nouvelle intelligentsia socialiste. Le metteur en scène de
la première production construite autour d’un personnage central qui est « directeur de l’Institut
national de réparation de la gueule de boit » invite dans le cahier de salle le spectateur « à écouter
avec attention chaque mot. Car Csurka est un dramaturge si dangereux qui sait qu’au théâtre, la vérité
ne se trouve jamais dans les paroles prononcées, mais se cache toujours derrière ce qui est dit ; ne
croyez même pas au metteur en scène de Csurka lorsqu’il vous dit que Les dents de fers du temps est
une comédie drôle et gaie au service du combat contre l’alcoolisme, et ne le croyait même pas
lorsqu’il vous dit qu’il s’agit d’une comédie triste et amère, qui dénonce la bureaucratie »112
. Une autre
de ses pièces, Nagytakaritas [Le Grande ménage] éclaire la compétition notabiliaire : « Le temps de
sortir de l’oeuf, ils avaient déjà occupé toutes les bonnes places. Mais un jour ils seront mis dehors
».113
110
Compte rendu comptavle sur l’activité du Théâtre d’Etat d’Oradea pour l’année 1979, Arvices d’Etat
d’Oradea. 111
Elisabeta Istorii si isterii teatrale, op.cit., p.60. 112
Cahier de salle Az idö vasfoga [Les dents de fer du temps], Théâtre d’Etat Oradea, saison 1978-1979, sans
page. 113
Cahier de salle, Nagytakaritas [Le grand ménage], Théâtre d’Etat Oradea, saison 1979-1980, sans page.
20
Les satires de Csurka rappellent jusqu’à un certain point quelques pièces appartenant à des
dramaturges roumains contemporains qui rencontrent à la fin des années 1970 et au début des années
1980 un fort succès de public, avant que ce dernier commence à se détourner de ce genre. Dans des
paraboles sur le pouvoir, des satires sociales ou des pièces de moraliste, on retrouve des
questionnements semblables, avec un accent plus posé sur les effets d’une mobilité sociale rapide et
les changements des ordres du prestige social, lesquels peuvent arriver à mobiliser des ressources
anciennes pour légitimer le nouveau. Comme chez Csurka, la posture n’est pas en théorie,
d’opposition par rapport à un discours officiel, même si les auteurs ou les metteurs en scène peuvent
rencontrer des difficultés politiques. Le spectacles avec la pièce de Teodor Mazilu, Mobilǎ şi durere
[Meuble et douleur] en fait partie, en mettant sur scène deux chefs de coopératives qui « rivalisent
dans l’organisation de leur intérieurs luxueux avec des tapis chers et des tableaux de valeur et obligent
leur partenaire de vie à tenir des salons artistiques /…/, à porter des toilette extravagantes, à se
promener avec des chiens si petits qu’on peut les mettre dans un sac à main, voire à prendre des
amants officiels »114
.
Le rapprochement des répertoires des deux ensembles ne suppriment pas toutes les différences
dans la définition du théâtre et du professionalisme. Ce dernier reste dans le cas de l’ensemble roumain
à valider par le centre, la relation à Bucarest ; chez les Hongrois, le « professionalisme » inclut aussi
une relation de proximité avec le public qui avec le renforcement du nationalisme roumain acquiert
une dimension identitaire plus marquée (d’où aussi l’importance de la relation à la Hongrie]. Le
répertoire se construit davantage autour de performances d’acteurs et de genres, que des mises en
scène soignées, comme dans le cas roumain. La présence du public captif d’élèves – certains
contractant des abonnements à un coût réduit, mais ne se déplaçant pas pour les spectacles, constituant
dès lors ces « âmes mortes » 115
qui apparaissent dans les statistiques mais sont absentes de la salle –
facilite cette pratique théâtrale. En entretien, un organisateur de spectacle s’en expliquait : « C’était la
pensée de l’époque ; il fallait amener les enfants tout petits encore au théâtre, en espérant que certains
y restent ; les autres auraient au moins vu la salle »116
. Une enseignante interrogée dans un cahier de
salle, mettait en avant « la civilisation des corps » dont le théâtre devait constituer un vecteur : « Il faut
habituer les élèves avec la tenue, les savoir-faire, les bonnes manières : applaudir à la fin, offrir des
fleurs, demander des autographes, discuter durant les pauses au fumoir et servir quelque chose au bar
et non pas faire du bruit avec des emballages en plastic durant le spectacle ». Dans le même entretien,
elle ajoutait : « il est vrai que parfois le théâtre contribue également à l’éloignement du public./…/.
Vous savez quoi ? Il me manque le Somptueux, de beaux spectacles (et non pas un décor réalisé à
partir d’une corde et deux cubes), des spectacles auxquels l’on assisterait habillés élégamment » 117
..
Si fréquenter le théâtre n’est plus un pratique de masse dans la ville des dernières décennies
communistes, elle s’organise autour d’un lieu qui garde en effet sa charge symbolique. Au point
d’ailleurs que des réunions importantes de l’appareil du Parti ou de la Securitate s’y déroule118
. Autour
de cette salle, l’on observe une diversification des motivations individuelles et des significations
sociales de la pratique théâtrale. Certains y vont pour entendre ce qui ne peut se dire ailleurs et investir
les limites du permis et de l’interdit. D’autres, ou les mêmes, pour rêver d’un Occident, projection
inversée du paradis socialistes, à travers des comédies sentimentales ou des pièces de boulevard.
D’aucuns (ou les mêmes encore) s’inscrivent dans une tradition familiale : « mes grands parents
occupaient déjà les mêmes places », peut-on entendre. D’autres y ont accès en tant que ressource dans
une entreprise de distinction119
. Les motivations hédonistes ne manquent pas, associées ou non aux
114
Valentin Silvestru, Ora 19.30 [19h30], Bucarest : Editura Meridiane, 1983, p. 109. 115
Entretien M.D., enseignante, 19 septembre 2009 116
Entretien avec Siviu Bicescu, le 22 septembre 2006. 117
Entretien avec le professeur Maria Liber, directrice du Lycée de Philologie et Histoire et présidente de la
Commission municipale des femmes, dans le cahier de salle de « Interviu » [Inteview] de Ecaterina Oproiu,
saison 1980-1981. 118
Entretien Elisabeta Pop, 17 septembre 2006. Pour un questionnement sur les voies de la « distinction » au sein
des nouvelles élites communistes, voir aussi Nicolas Bauquet, François Bocholier (dir.), Le communisme et les
élites en Europe centrale, Paris : Presses Universitaires de France, ENS Editions, 2006. 119
Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris : Editions de Minuit, 1979.
21
autres justifications, ni l’amitié pour des acteurs, voisins dans le même immeuble. Mais la même salle
baroque peut être invoquée également dans le registre de l’exclusion : « ma place n’est pas là », c’est
par cette formule qu’une voisine de l’ancienne secrétaire littéraire, hébergée dans le même immeuble
communiste de huit étages, pouvait expliquer ses réticences.
Le théâtre socialiste participe ainsi à la fois à l’égalisation des conditions sociales et à la mise
en visibilité de nouvelles inégalités. Le « public », collectif qui tient simultanément de l’éphémère et
de la répétition, révèle des changements dans les codes du prestige. Les normes de la consommation
culturelle légitime élaborées autour d’un socle de culture littéraire apparaissent fragilisées. La science
et la technique acquièrent une nouvelle importance dans une société au sein de laquelle les diplômés
de l’enseignement supérieur viennent désormais surtout des universités techniques. Les
recompositions de la culture légitime traduisent également les effets de la massification et d’une
certaine diversification des loisirs. Le cinéma, la télévision, constituent quelques vecteurs de cette
évolution. Dans ce contexte, la fréquentation du théâtre d’Etat, pratique sociale dotée d’épaisseur
historique, permet la distinction sans qu’elle s’y réduise, rendant visibles d’anciennes (recomposées) et
de nouvelles différences sociales, dans une société qui se dit égalitaire.