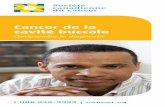Comprendre les motivations derrière l'engagement des internautes sur les sites de...
Transcript of Comprendre les motivations derrière l'engagement des internautes sur les sites de...
UNIVERSITE DE PARIS IV - SORBONNE
CELSA
Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la communication
MASTER 2ème année
Mention : Information et Communication Spécialité : Médias et Communication
Parcours : Médias informatisés et stratégies de communication
« Comprendre les motivations derrière l'engagement des internautes
sur les sites de question-réponse : le cas Quora. »
Préparé sous la direction du Professeur Véronique RICHARD
Nom, Prénom : EL HAJJAMI, Anouar Promotion : 2013-2014 Option : Médias et Communication Soutenu le : Note du mémoire : Mention :
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé, directement ou
indirectement, à la réalisation de ce mémoire :
Les utilisateurs du site Quora, qui ont généreusement accepté de répondre à mes
questions et à renseigner leurs motivations.
Madame Mathilde Faidherbe et Messieurs Pierre Lévy et Damien Philippon qui
ont accepté de m’accorder des entretiens de qualité.
Madame Pergia Gkouskou, qui a accompagné et enrichi de son expertise ce
travail de recherche du début jusqu’à la fin.
Monsieur Franck Perrier, qui a accepté de prendre en charge, avec Mme
Gkouskou, le suivi de ce mémoire.
Tous les internautes qui ont répondu au questionnaire sur les usages des espaces
collaboratifs et surtout, mes collègues, amis, famille et accointances, qui m’ont
aidé à diffuser massivement le questionnaire en question.
A toutes ces personnes, je présente mes sincères remerciements et assure que
leurs contributions ont été grandement appréciées.
Table des matières MASTER 2ème année ........................................................................................................................ 1
Introduction ............................................................................................................................................ 5
Cadre théorique et choix interdisciplinaires ....................................................................................... 6
Pertinence dans les SIC et questions de recherches ........................................................................... 7
Problématisation et hypothèses .......................................................................................................... 10
Méthodologie de travail ....................................................................................................................... 11
Exposé des méthodes de recherche et d’analyse retenues .............................................................. 12
Echantillonnage ................................................................................................................................. 13
Analyse sémiologique ........................................................................................................................ 14
Quelques mots sur l’expérience-utilisateur du site .......................................................................... 15
Profilage et typologie d’utilisateurs .................................................................................................. 18
Répartition des utilisateurs ............................................................................................................... 19
Typologie 1: Relationnel ................................................................................................................ 19
Typologie 2 : Fonctionnel .............................................................................................................. 20
Typologie 3 : Fréquence ................................................................................................................ 20
Typologie 4 : Engagement ............................................................................................................. 21
I. La contribution comme marqueur d’un engagement politique ................................................. 24
1. Sur les pratiques actuelles des internautes ............................................................................. 24
a. L’engagement à l’ère numérique : du « like » à la production de contenu médiatique ....... 27
b. Les plateformes d’échanges numériques : des sources inépuisables d’informations ? ....... 30
c. Sur l’économie du don .......................................................................................................... 35
2. Vers une nouvelle forme de médiatisation ? ........................................................................... 40
a. Le producteur-consommateur de l’information : un individu relationnel ............................ 40
b. L’intelligence collective en tant que projet d’émergence ..................................................... 42
c. Le fantasme des cerveaux connectés .................................................................................... 45
Conclusion de l’hypothèse I .............................................................................................................. 47
II. La contribution comme caractéristique d’un contexte économique .......................................... 49
1. La production de contenu numérique et la constitution d’un projet professionnel ............... 49
a. E-réputation et les communautés en ligne : les développeurs open source comme modèle
50
b. Le cas des « résolveurs » de Quora ...................................................................................... 52
2. Les enjeux professionnels sur les sites de questions-réponses ................................................ 56
a. Des pro-ams et des experts ...................................................................................................... 56
b. Quora serait-il un réseau professionnel de niche ? .............................................................. 59
Conclusion de l’hypothèse II ............................................................................................................. 61
III. La contribution comme rétroaction individuelle à un discours promotionnel dominant ..... 62
1. La promesse comme facteur de motivation............................................................................. 63
a. Sur la société de l’information ................................................................................................... 63
b. Sur le projet d’intelligence collective médiée par ordinateur ................................................... 69
c. De l’émergence d’un nouveau paradigme ............................................................................ 71
2. Médiatisation de soi et valorisation de la contribution en ligne ............................................ 74
a. Le triomphe des idéaux de la communauté IT .......................................................................... 74
b. Publicité de soi et rôles médiatiques : entre demandeurs, résolveurs et commentateurs ....... 77
Conclusion de l’hypothèse III ............................................................................................................ 79
Conclusion ............................................................................................................................................. 80
Bibliographie ......................................................................................................................................... 83
Introduction
Internet connait depuis quelques années, une évolution caractéristique des
technologies en forte expansion. Tandis que des concepts comme le « Web 2.0 » et le « Web
sémantique » occupent les débats autour des sciences et du marché de la communication,
d’autres notions resurgissent après une période d’hésitations et de doutes. Des appellations
comme l’« intelligence collective » ou l’« économie du don » ont depuis lors foisonné dans les
travaux de recherche ainsi que dans les milieux professionnels, laissant supposer l’émergence
d’un nouveau paradigme socio-économique induit par l’utilisation massive des médias
informatisés. Bien que ces terminologies soient abondamment utilisées pour décrire les
phénomènes de contribution sur le web (notamment les wikis) et dans le monde de
l’entreprise quand il s’agit de la gestion des connaissances internes (knowledge management),
les discours d’accompagnement qui entouraient les technologies numériques au tout début de
l’internet -et qui ont momentanément resurgi dans les années 1990- se sont vus
considérablement revisités au début des années 2000, notamment après l’implosion de la bulle
internet, mettant de côté les projets utopiques annonçant l’émergence d’un nouveau système
de représentations et de rapports économico-sociaux.
Cependant, depuis l’émergence et la généralisation de ce que nous appelons
communément aujourd’hui le « web social », qui permet aux internautes de coproduire du
contenu en temps réel sur des plateformes de plus en plus personnalisables, ces travaux
théoriques connaissent un regain d’intérêt de la part des professionnels du digital aussi bien
que des entrepreneurs pris dans le tumulte des innovations numériques sans cesse changeante.
Ces concepts théorisés dans les années 1990, se sont développés indépendamment du cadre
premier dans lequel leurs théoriciens les avaient placés, et nous assistons aujourd’hui à
différentes récupérations, voire à des recyclages intéressants à étudier aussi bien d’un point de
vue socio-économique que sémiotique.
L’objectif de cette recherche est moins de donner une définition contemporaine des notions et
pseudo-notions en rapport avec l’action de contribution1, que d’étudier sur le terrain, la
pertinence des discours portés sur cette action ainsi que son degré d’autoréalisation dans le
web d’aujourd’hui. Les théories conceptualisant la contribution, ayant d’abord été formulées
1 Cela va de l’indexation de contenu (évaluation, partage de contenus existants) à la production de contenu
qualitatif.
sous forme de projet social -voire civilisationel2- puis adaptées aux besoins de l’entreprise
pour la production et la gestion des données, il convient de questionner la motivation des
usagers -en tant qu’agents de cette production- à faire part de ce « projet » ou de cette forme
d’organisation des connaissances. En d’autres termes : qu’est-ce qui pousse les internautes à
produire du contenu sur le réseau quand cette production ne leur rapporte, a priori, ni
compensation financière ni aucun autre intérêt matériel immédiat ? Cette question relative aux
pratiques des internautes sur le web en général, sera reformulée pour les besoins de notre
recherche, qui cibleront particulièrement les plateformes de Questions/Réponses3.
Cadre théorique et choix interdisciplinaires
La démarche suivie dans la rédaction de ce mémoire est à la fois économique et
sociologique. Economique car les discours médiatiques relatifs aux TIC et aux innovations
technologiques en général, ont un impact considérable sur les choix politiques et marchands
entrepris par les pouvoirs publics et les leaders économiques. Sociologique car l’évolution des
rapports socioculturels sont souvent liés aux pratiques des individus en interaction avec des
innovations technologiques et politiques impactant directement ou indirectement le lien
social4.
Le cadre théorique dans lequel s’inscrit ce travail de recherche a une particularité
avantageuse : les notions qui y seront étudiées ont connu une évolution intéressante durant les
vingt dernières années et disposent d’une base théorique foisonnante. La transformation
progressive que connait internet depuis le début des années 1990, a donné lieu à un
déchainement de théories prospectivistes et de spéculations sur l’évolution de la société et de
l’économie mondiale. L’enthousiasme qui a accompagné la démocratisation des technologies
numériques ainsi que les déceptions qui ont suivi l’éclatement de la bulle internet, ont
également stimulé la production de travaux de recherche, qui vont de la critique des théories
existantes à des démarches empiriques moins dogmatiques, renforcés par deux décennies
d’expériences « in vivo » dans les réseaux numériques. Aussi, au vu des objectifs de ce
mémoire, qui consistent en une analyse des usages déjà établis depuis une vingtaine d’années,
2 Toujours selon Pierre Lévy in L’Intelligence Collective, pour une anthropologie du cyberspace, 1994, La
Découverte 3 Nous incluons dans cette catégorie à la fois les forums d’aide où les internautes posent des
questions/problèmes à la communauté, les réseaux sociaux spécialisés dans la gestion des connaissances de type Quora, ainsi que les pages de questions/réponses de type Yahoo answers. Les Wikis et autres pages encyclopédiques et de répertorisation des données, ne seront traitées que de manière périphérique. 4 C’est du moins la théorie défendue par la sociologie de l’innovation.
il sera davantage question de mettre en relation les théories fondamentales qui ont grandement
influencé notre vision du web, les critiques qui ont été faites de ces théories durant les vingt
dernières années, et les usages et pratiques des internautes en 2013. Toutefois, il ne sera pas
question ici de confronter de manière schématique des doctrines aux opinions contradictoires
(thuriféraires VS détracteurs de la société de l’information) mais plutôt de pondérer les
discours de part et d’autre, profitant du recul rendu possible par les multiples
expérimentations conduites par les chercheurs et les communautés d’internautes ces deux
dernières décennies.
Pour mener à bien ce projet, notre corpus théorique sera constitué de travaux de
recherches traitant de différents concepts, que nous pouvons classifier dans deux catégories:
1. Théories fondamentales : corpus constitué des principaux textes fondateurs de concepts
globaux comme l’intelligence collective ou l’économie de la connaissance.
Datant pour les plus anciens des années 1990 -mais fréquemment repris et enrichis depuis-,
ces textes constituent la base théorique qui a inspiré les consultants et les professionnels du
digital derrière la vulgarisation massive de ces concepts.
2. Etudes des phénomènes de contribution : catégorie regroupant les études empiriques
menées autour des comportements des internautes sur le web, questionnant notamment les
facteurs implicites et explicites qui motivent certaines pratiques, comme la production et
l’indexation individuelle des contenus.
Pertinence dans les SIC et questions de recherches
La pluridisciplinarité des sciences de l’information et de la communication nous place
devant une multitude de champs scientifiques que la présente recherche ne pourra pas
explorer dans sa totalité. Ne seront traités que de façon périphérique la dimension technique et
les sciences de l’ingénieur (télécommunications, informatique…), l’objet de ce travail de
recherche étant précisément la motivation des usagers et leurs interactions avec des
dispositifs massivement utilisés. L’action de contribution étant une donnée sociologique a
priori antérieure à l’invention des interfaces numériques - même s’il est tout autant intéressant
d’analyser une éventuelle accélération de ces phénomènes avec l’arrivée des nouveaux
dispositifs numériques - le rapport humain-machine sera moins abordé sous un angle
ergonomique que socioculturel.
La pertinence de ce travail de recherche dans la discipline des SIC peut alors se
résumer en trois points :
Tout d’abord, le cadre théorique et les concepts fondamentaux de ce mémoire ont été
formulés par des théoriciens de la communication dont les travaux ont été repris quasi
immédiatement par les professionnels de l’info-com. Ensuite, le sujet de cette recherche est un
fait sociologique qui a émergé -ou s’est du moins amplifié- avec l’arrivée des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, et demeure inhérent à ces technologies.
Et enfin, les diverses prophéties et spéculations qui occupent les cercles de consultants et
d’enthousiastes de la communication digitale, nous engagent à étudier ces discours
médiatiques d’un point de vue de chercheur en sciences de l’information et de la
communication, afin de retirer le flou qui entourent ces concepts massivement médiatisés et
mettre en évidence leurs composants laissés dans l’ombre, et souvent présentés comme des
innovations révolutionnaires.
Afin de rendre plus évidente la place considérable que prennent les SIC dans ce projet
de recherche, nous allons dans un premier temps procéder à la formulation d’une série de
questions qui serviront ensuite à l’élaboration de notre problématique.
Du général au particulier, la question initiale qui oriente la problématique de ce mémoire est
la suivante : Pourquoi les internautes consentent-ils à créer du contenu sur le web ? Cette
question globale peut se décliner en plusieurs sous-questions dont nous ne retiendrons que
celles qui traitent de notre objet d’analyse, à savoir les plateformes de questions-réponses.
Qu’est ce qui amène les usagers de ce type de plateformes à répondre aux questions
d’autres internautes, alors qu’ils ne perçoivent aucune rémunération en retour ? Avant
d’entamer l’analyse des quelques éléments de réponses proposés par divers sociologues des
usages du web5, il convient d’énumérer toutes les interrogations relatives à notre
problématique :
L’action de contribution (dans le sens partage des connaissances) est-elle inhérente aux
nouvelles techniques de communication ou s’agit-il de l’amplification d’un phénomène
antérieur au numérique ?
5 Cf. Dominique Cardon, par exemple.
La participation en ligne peut-elle être considérée comme un élément intrinsèque à la «
culture numérique » dominée par un idéal méritocratique de production qui remonte aux
débuts de l’internet ? Lorsqu’il s’agit d’une participation se limitant à un engagement ‘faible’
(sondages, like/dislike etc.) peut-on parler d’une généralisation de masse de cet idéal ou plutôt
de son travestissement?
Au vu de l’évolution rapide du taux de pénétration de l’internet6
dans les foyers ces dix
dernières années, nous avons vécu l’émergence d’un « web social » mettant en valeur la
contribution des internautes. Mais cette participation plus ou moins massive est-elle pérenne
sur le long terme ou serait-elle le résultat de l’arrivée massive d’usagers encore au stade de
l’engouement et de l’expérimentation d’une technologie récemment acquise? De ce fait,
l’enthousiasme des acteurs du web vis-à-vis de concepts comme le crowdsourcing serait-il
une surinterprétation de l’évolution des pratiques des internautes ? Quelle forme prendra la
contribution des internautes à fur et à mesure que le nombre des usagers se stabilise ?
Comment les internautes perçoivent-ils leurs propres pratiques de contribution sur le web ?
Et quelle définition/justification attribuent-ils à ces pratiques qui ne donnent lieu à aucune
gratification en retour ? Existe-t-il au sein de la communauté des internautes un discours
médiatique partagé par l’ensemble des utilisateurs, et qui expliquerait cet «engagement de la
réponse» ?
6 Source : http://goo.gl/BMrm9
Problématisation et hypothèses
Dans la continuité des questions de recherche qui ont été formulées jusqu’ici, notre
problématique se présente de la manière suivante :
Dans le web actuel, marqué par l’utilisation d’outils collaboratifs et des réseaux
sociaux, la participation des internautes dans les sites de questions-réponses
(production/qualification de contenu) signifie-t-elle l’émergence d’une nouvelle perception
des liens socio-économiques chez l’individu connecté ? Quels sont les facteurs de
motivation derrière l’engagement des internautes dans les dispositifs numériques de
partage d’informations tels que les forums de discussions et les sites de questions-
réponses ?
Hypothèse 1 : Les technologies numériques, par leur capacité de mise en réseaux à grande
échelle, permettent aux internautes d’interagir socialement et économiquement en dehors des
règles du marché (rapports marchands, valeur monétaire…)
Sous-hypothèse A : Les facteurs de motivations derrière l’engagement des internautes dans les
plateformes de partage de type Question/Réponse, sont d’ordre politique ou proto-politique
(intérêt pour la gestion des affaires publiques) et se manifestent de plus en plus grâce aux
innovations des technologies numériques.
Sous-hypothèse B : Les internautes trouvent dans les plateformes collaboratives des avantages
en matière d’accès à l’information, qui ne se retrouvent pas dans d’autres types de médias
(rapidité, personnalisation, conversation etc.) ce qui implique de nouvelles exigences de la
part du consommateur de l’information.
Hypothèse 2 : Le contexte socio-économique qui a vu l’émergence des médias informatisés
est marqué par les conjonctures et les crises économique. L’engagement des internautes dans
ces médias correspond à l’arrivée massive d’une population ayant de plus en plus de
difficultés à mettre en valeur ses qualifications sur le marché de l’emploi.
Sous-hypothèse A : Une part importante des contributeurs sur les sites de questions-réponses,
s’engagent dans la production de contenu par précarité économique. Le non-emploi ou
certains types de professions libérales (freelance) les poussent à multiplier les investissements
bénévoles en préparation ou en attente d’un avenir professionnel meilleur (capitalisation des
expériences)
Sous-hypothèse B : L’évolution du marché du travail (mondialisation, valorisation des
compétences ‘annexes’, péremption rapide de l’information…) oblige les acteurs sociaux à
continuellement se mettre en valeur via le média qui leur est le plus accessible et à
réactualiser leurs connaissances en s’engageant dans des communautés d’échanges
d’informations.
Hypothèse 3 : Le discours médiatique sur les technologies numériques et la société de
l’information amènent les individus à s’impliquer davantage dans l’utilisation des médias
informatisés créant ainsi un effet d’auto réalisation et d’amplification des pratiques.
Sous-hypothèse A : Les populations les plus actives sur les plateformes d’échanges de type
Q/R sont les plus exposées aux discours promoteurs des technologies numériques. Leur
implication traduit donc une attente sous-jacente d’un ‘changement’ socio-culturel induit par
ces médias informatisés.
Sous-hypothèse B : La participation des internautes dans les plateformes d’échanges de type
Q/R est une forme de médiatisation de soi sur des canaux communicationnels de plus en plus
mis en valeur par les acteurs économiques et médiatiques. Il s’agirait de l’investissement, par
les individus, d’un média qui gagne en légitimité.
Méthodologie de travail
Pour apporter des éléments de réponse à notre problématique de recherche, nous avons
retenu quatre méthodes que nous emploierons pour répondre à chacune de nos hypothèses.
Dans un premier temps, nous aurons recours à la méthode du questionnaire, auprès d’une
population de 100 personnes, toutes connectées à internet. L’objectif de cette enquête
exploratoire est de dresser un état des lieux des pratiques des internautes sur les plateformes
de questions-réponses, mais aussi de prendre un instantané des imaginaires et des perceptions
qu’ont les internautes du phénomène de contribution sur internet. Les données recueillies par
ce questionnaire seront croisées, analysées, et mises en perspective avec les théories
fondamentales et les études menées par divers chercheurs sur les comportements des
individus sur le web (cf. corpus théorique). Il s’agira de vérifier sur le terrain si les concepts
véhiculés dans les discours médiatiques propres aux technologies numériques, ont une
résonnance chez les usagers du web.
Une deuxième méthode consistera à écouter les conversations sur le web et à en faire
l’analyse sémantique la plus développée possible. En effet, tandis que le questionnaire se base
sur du déclaratif, il existe sur le web (et notamment dans notre objet d’analyse, à savoir un site
de questions-réponses) des discussions abordant les éléments qui motivent les internautes à
contribuer sur les dispositifs étudiés. Bien que ces échanges soient publics, des éléments
inédits -et qui n’apparaissent pas dans les réponses aux questionnaires- pourront émerger de
l’analyse de ces discussions. Cette analyse sémantique sera accompagnée d’une analyse
sémiotique des supports investis par les internautes, afin de mettre au clair les éventuels
rapports sociotechniques derrière l’action de contribution et d’engagement de l’utilisateur
(ergonomie, incitation au clic/partage de contenu etc.)
La troisième méthode de travail constitue le pilier de la recherche puisqu’il s’agit de
suivre l’évolution d’un échantillon de vingt personnes utilisatrices s’un site de questions-
réponses (Quora), d’un point de vue médiatique (présentation de soi) et socio-économique
(motivations derrière l’usage). Cette observation qui s’étend sur deux mois, nous permettra de
cerner les enjeux implicites et explicites, de la participation des internautes dans les sites
collaboratifs. Les résultats de cette analyse serviront à conforter ou infirmer chacune de nos
hypothèses. Dans un deuxième temps, nous procéderons à des entretiens semi-directifs avec
quelques membres de l’échantillon afin de mieux qualifier les résultats émergeant de notre
observation.
Enfin, des entretiens qualitatifs seront conduits auprès de chercheurs et de
professionnels s’intéressant de près au concept de l’intelligence collective et de la co-
production de contenu en réseau. Cet échange direct avec des experts du domaine nous
permettra de confronter les résultats obtenus sur le terrain avec les théories fondamentales et
les discours médiatiques portés sur les TIC durant les deux dernières décennies.
Exposé des méthodes de recherche et d’analyse retenues
La méthode d’observation s’articulera de deux manières :
- D'une part, une observation asynchrone des débats autour de la contribution. Il s’agit
d’une analyse des discussions achevées, ayant directement comme objet les
motivations des utilisateurs à produire du contenu sur le web en général, et sur les sites
de questions-réponses en particulier.
- D'autre part, une observation participante où il sera question de faire émerger des
éléments inédits sur les motivations des utilisateurs, en posant ou en répondant à des
questions n’abordant pas directement la question de la motivation (analyse sémantique
des éventuels métadiscours et des considérations implicites qui accompagnent les
énoncés des participants dans des discussions généralistes). Il sera également demandé
à quelques utilisateurs figurant dans l’échantillon, de donner leurs motivations en
répondant à la question « Pourquoi utilisez-vous Quora ? » discussion ouverte sur le
site depuis quelques mois et qui fait partie des éléments de notre observation
asynchrone.
L’observation participante s’étendra sur 4 phases :
Phase 1 : Description de l’environnement d’observation et justification des profils
sélectionnés.
Phase 2 : Observation des interactions des utilisateurs sans participation ni démarche
d’inflexion des discussions en cours.
Phase 3 : Tentative d’engager la conversation directement et indirectement avec une
préparation du terrain en amont.
Phase 4 : Analyse comparative de l’évolution des profils observés selon des critères
prédéfinis (engagement dans la conversation, impact du capital relationnel sur l’engagement,
rapport du statut professionnel et des thématiques abordées etc.) suivi d’un recueil de
témoignages avec un échantillon réduit de l’échantillon étudié.
Echantillonnage
Les profils qui feront l’objet de cette observation ont été sélectionnés sur deux critères qui
nous ont semblé le plus pertinents : d’une part, le degré d’engagement dans un laps de temps
donné (profil actif dans les 6 derniers mois). Et d’autre part, la diversité des catégories socio-
professionnelles.
Bien qu’il ne soit pas évident de trouver des profils représentatifs de toutes les catégories
socio-professionnelles dans un site comme Quora7, nous avons tenté de sélectionner des
profils qui ne se ressemblent pas au niveau des professions et des intérêts. Le premier
échantillon « brut » a été défini de manière complètement aléatoire : 50 profils ont été ainsi
« tirés au sort » en parcourant tout simplement les discussions en cours sur le site (le profil
utilisé durant cette observation étant crée intentionnellement à cet effet, aucun historique n’a
pu être enregistré et donc influer sur les résultats des recherches).
Dans un second temps, trois différentes catégorisations ont été envisagées pour
faciliter l’analyse des résultats de l’observation durant la phase 4 : une catégorisation par
CSP, une catégorisation par groupes d’intérêts (participation à des sujets à thématique
définie), et une catégorisation par degré d’engagement (récurrence des participations) allant
d’un « faible » à un « très fort » taux d’engagement.
Analyse sémiologique
En amont de l’observation des contenus produits par les profils échantillonnés sur le
site choisi comme objet d’étude, une brève analyse sémiotique sera menée afin de décrire
l’environnement ergonomique dans lequel évolue notre échantillon d’utilisateurs. Tout
d’abord une description des étapes d’inscription sur le site en question, puis de l’interface
principale tel que l’utilisateur régulier la voit.
Dans un second temps, nous procéderons à la description, de l’interface profil, de son
flux d’activités, de l’espace « présentation de soi » sur l’entête du profil ainsi que l’espace
« connexions » regroupant les chiffres de participation et de socialisation sur le réseau :
nombre de « suiveurs » de « contacts suivis », de sujets consultés et de questions/réponses
produites.
Notre échantillon comporte 20 profils d’utilisateurs qui, pour des raisons de taux
d’adoption du site par pays, sont à 60% de nationalité américaine, résidants aux Etats-Unis ou
dans d’autres pays (seulement 3 membres sur 20 sont Français, 3/20 Indiens, 1/20 Espagnol et
1/20 Allemand).
7 Une plateforme réputée comme élitiste, de par son public largement constitué de chercheurs universitaires et
de jeunes entrepreneurs américains.
Parallèlement à la quantification des interactions de chaque utilisateur et de la
réalisation d’une typologie d’utilisateurs selon les résultats obtenus, nous mènerons une
analyse sémiologique sur les discours médiatiques des sujets observés (entre 3 et 5 messages
de type question ou réponse pour chaque membre) qui mettront au clair les éléments
dénotatifs et les éléments connotatifs susceptibles de signifier les motivations de leurs auteurs.
Nous veillerons également à croiser des données telles que le nombre de retours pour chaque
participation (votes, partages, réponses et commentaires) afin de déterminer l’impact des
interactions sur les motivations.
Quelques mots sur l’expérience-utilisateur du site
L’utilisateur, une fois inscrit sur le site, doit renseigner ses centres d’intérêts afin d’alimenter
son flux de questions-réponses (figure 1 et 2). Les sujets susceptibles de susciter son intérêt
lui seront alors présentés de manière visible pour le pousser à la participation.
Figure 1: Première interface de Quora après l'inscription. En cliquant sur les boutons "follow" (encadré) l'utilisateur s'abonne à un flux d'informations donné.
Figure 2: Seconde interface: en cochant la thématique choisie (encadré), l'utilisateur recevra sur son flux d'informations des questions/réponses à ce sujet
La dimension sociale est également mise en valeur sur le site Quora. Après avoir choisi ses
centres d’intérêts et les sujets que l’utilisateur voudrait suivre8, une dernière étape (figure 3)
consiste à retrouver des connaissances sur le site en les important d’autres réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn), ou en les cherchant via la barre de recherche :
Figure 3: La troisième page invite l'utilisateur à inviter ses connexions
Une fois ces étapes passées, l’utilisateur peut accéder à son flux d’informations (figure 4) et
commencer à consulter les questions-réponses et à produire du contenu.
8 Suivre un sujet ou un utilisateur signifie recevoir sur son flux personnel, des informations concernant le sujet
ou le topic en question : nouveaux messages postées, évaluations des réponses par l’utilisateur, nouvelles questions postées etc.
Figure 4: Interface principale d'utilisation. Rouge: flux d'informations, Violet: barre de recherche, Jaune: Profil utilisateur, Vert: Interactions utilisateur, Bleu: Sujets tendances
La page-profil (figure 5) sur laquelle figure toutes les informations que l’utilisateur a
renseigné sur lui-même, les chiffres sur ses interactions ainsi que son capital relationnel
(nombre de connexions) est accessible publiquement (en cliquant sur le nom de l’utilisateur)
et nous permet de recueillir des données sur la participation de chaque utilisateur et son degré
d’engagement.
Figure 5: Profil utilisateur. Rouge: présentation de soi, Bleu: relationnel, Vert: traces d'usage
Profilage et typologie d’utilisateurs
Nous avons défini une typologie d’usage pour les 20 utilisateurs de notre échantillon
en nous basant sur les chiffres de participation et de connexions affichés sur la page profil de
chaque utilisateur (nombres de questions posées depuis l’inscription sur le site, nombre de
réponses postées, d’ « abonnés » et d’ « abonnements »9). Nous avons également fait le calcul
des productions de contenu (questions, réponses, commentaires) durant la période
d’observation, du 15 juin au 15 juillet 2013. Toutes ces données ont été utilisées pour répartir
les utilisateurs dans des catégories de pratiques que nous utiliserons tout au long de l’analyse
empirique.
Les principaux chiffres retenus pour chaque utilisateur sont donc les suivants :
Abonnés (Followers): nombre de personnes abonnées aux flux de l’utilisateur (reçoivent ses
interactions).
Abonnements (Following): nombre de personnes dont les interactions sont suivies par
l’utilisateur.
Questions : nombre de questions postées par l’utilisateur depuis son inscription.
Réponses : nombre de réponses postées par l’utilisateur depuis son inscription.
Questions 30 jours : nombre de questions postées par l’utilisateur durant la période
d’observation.
Réponses 30 jours : nombre de réponses postées par l’utilisateur durant la période
d’observation.
Votes & Veille (Upvotes / Follows) : nombre d’interactions de type qualification (évaluer
positivement par un vote) ou veille (suivre une discussion afin de recevoir des notifications à
son sujet) produites par l’utilisateur durant la période d’observation.
D’autres indicateurs secondaires ont été mis en place pour des besoins statistiques, notamment
le nombre de posts (publications de l’utilisateur dans les blogs du site dédiés à une
9 Le site Quora étant uniquement en langue anglaise, nous avons repris les traductions adoptées par Twitter
qui utilise les mêmes terminologies que Quora pour la partie relationnelle. Les followers étant les abonnés (personnes qui reçoivent des notifications sur leur flux d’informations (ou « mur ») quand l’utilisateur interagit sur le site (questions, réponses, commentaires) et les following étant les abonnements de l’utilisateur (personnes dont les interactions sont publiées sur le flux d’informations de l’utilisateur)
thématique) le nombre de topics (thématiques suivies par l’utilisateur) le nombre de blogs
suivis par l’utilisateur, ainsi que le nombre d’edits (édition de commentaires ou de posts par
l’utilisateur)
Répartition des utilisateurs
La répartition des utilisateurs échantillonnés se fait conformément aux indicateurs principaux,
à savoir les Abonnés/abonnements, les Questions/Réponses, les Questions 30 jours/Réponses
30 jours et les Votes & Veille. Par conséquent, 4 typologies ont été élaborées se basant sur
l’un des quatre indicateurs, chacun étant noté sur une échelle de 1 à 310
.
Typologie 1: Relationnel
En se basant sur le nombre d’abonnés et d’abonnements, nous avons réparti les utilisateurs en
sept catégories :
- Veilleur : catégorie regroupant les utilisateurs de l’échantillon ayant un score
d’abonnés (followers) égal à 1 et un score d’abonnements (following) égal à 2.
- Leader : catégorie regroupant les utilisateurs de l’échantillon ayant un score d’abonnés
(followers) égal à 2 et un score d’abonnements (following) égal à 1.
- Super leader : catégorie regroupant les utilisateurs de l’échantillon ayant un score
d’abonnés (followers) égal à 3 et un score d’abonnements (following) égal ou inférieur
à 2.
- Super veilleur : catégorie regroupant les utilisateurs de l’échantillon ayant un score
d’abonnés (followers) inférieur ou égal à 2 et un score d’abonnements (following) égal
ou inférieur à 3.
- Veilleur-leader : catégorie regroupant les utilisateurs ayant un score égal à 2 pour les
deux indicateurs (abonnements et abonnés).
- Super veilleur-leader : catégorie regroupant les utilisateurs ayant un score égal à 3
pour les deux indicateurs (abonnements et abonnés).
- Semi-régulier : catégorie regroupant les utilisateurs ayant un score égal à 1 pour les
deux indicateurs (abonnements et abonnés).
10
Voir tableur des taux en annexe.
Typologie 2 : Fonctionnel
La deuxième typologie intitulée Fonctionnel, aborde l’utilisation des fonctionnalités
principales du site, à savoir les questions et les réponses. La répartition se base sur le nombre
de questions et de réponses postées par l’utilisateur. Un utilisateur qui pose plus de questions
que de réponses tend vers la catégorie de « Demandeurs » tandis que les utilisateurs qui
répondent plus aux questions qu’ils n’en posent sont plus dans la catégorie de « Résolveurs ».
- Résolveur : catégorie regroupant les utilisateurs de l’échantillon ayant un score de
questions égal à 1 et un score de réponses égal à 2.
- Demandeur : catégorie regroupant les utilisateurs de l’échantillon ayant un score de
questions égal à 2 et un score de réponses égal à 1.
- Super résolveur : catégorie regroupant les utilisateurs de l’échantillon ayant un score
de questions égal à 3 et un score de réponses égal ou inférieur à 2.
- Super demandeur : catégorie regroupant les utilisateurs de l’échantillon ayant un score
de questions inférieur ou égal à 2 et un score de réponses égal ou inférieur à 3.
- Versatile : catégorie regroupant les utilisateurs ayant un score égal à 2 pour les deux
indicateurs (questions et réponses).
- Super versatile : catégorie regroupant les utilisateurs ayant un score égal à 3 pour les
deux indicateurs (questions et réponses).
- Participant occasionnel : catégorie regroupant les utilisateurs ayant un score égal à 1
pour les deux indicateurs (questions et réponses)
Typologie 3 : Fréquence
La troisième typologie aborde la fréquence d’utilisation ponctuelle du site. Les données
utilisées pour la répartition des utilisateurs sont le nombre de questions postées durant la
période d’observation ainsi que le nombre de réponses postées durant cette même période (30
jours). Cette catégorisation est complémentaire à la typologie 2 : un Résolveur qui a autant ou
plus répondu aux questions durant la période d’observation sera catégorisé Résolveur actif.
- Résolveur actif ou ponctuel : est considéré comme actif tout utilisateur résolveur ayant
un score de réponses, durant la période d’observation, égal au score de participation
habituel (depuis l’inscription). Le résolveur ponctuel a un score de réponses, durant la
période d’observation, supérieur au score habituel.
- Demandeur actif ou ponctuel : est considéré comme actif tout utilisateur demandeur
ayant un score de questions, durant la période d’observation, égal au score de
participation habituel (depuis l’inscription). Le demandeur ponctuel a un score de
questions, durant la période d’observation, supérieur au score habituel.
- Super résolveur actif ou ponctuel : est considéré comme actif tout super résolveur
ayant un score de réponses, durant la période d’observation, égal au score de
participation habituel (depuis l’inscription). Le super résolveur ponctuel a un score de
réponses, durant la période d’observation, supérieur au score habituel.
- Versatile actif ou ponctuel : le versatile actif a un score de participation durant la
période d’observation égal au score de participation habituel, tandis que le versatile
ponctuel a un score de participation supérieur au score habituel.
- Super versatile actif ou ponctuel : le super versatile actif a un score de participation
durant la période d’observation égal au score de participation habituel, tandis que le
versatile ponctuel a un score de participation supérieur au score habituel.
- Participant occasionnel ou ponctuellement actif : le participant occasionnel a un score
de participation régulièrement faible (égal à 1) avant et pendant la période
d’observation tandis qu’un participant ponctuellement actif a un score légèrement plus
élevé pendant la période d’observation.
Typologie 4 : Engagement
Cette quatrième typologie sert à quantifier l’engagement des utilisateurs en calculant le
nombre de votes et de partages de contenu durant la période d’observation.
- Indexeur occasionnel : sont un utilisateur ayant un score de votes/partages égal à 1.
- Indexeur régulier : est un utilisateur ayant un score de votes/partages égal à 2.
- Super indexeur : est un utilisateur ayant un score de votes/partages égal à 3.
Ces 4 typologies serviront d’éléments de repères lors du croisement des discours médiatiques
des utilisateurs (étude qualitative) et de leurs interactions sur le site (étude quantitative).
Plan
Considérant notre problématique et les hypothèses retenues, le développement de ce
travail de recherche suivra le plan suivant :
I. La contribution comme marqueur d’un engagement politique
1. Sur les pratiques actuelles des internautes
a) L’engagement à l’ère numérique : du « like » à la production de
contenu médiatique
b) Les plateformes d’échanges numériques : des sources
inépuisables d’informations ?
c) Sur l’économie du don
2. Vers une nouvelle forme de médiatisation ?
a) Le producteur-consommateur de l’information : un individu
relationnel
b) L’intelligence collective en tant que projet d’émergence
c) Le fantasme des cerveaux connectés
II. La contribution comme caractéristique d’un contexte économique
1. La production de contenu numérique et la constitution d’un projet
professionnel
a) Sur l’e-réputation et les communautés en ligne : les
développeurs open source comme modèle
b) Le cas des « résolveurs » de Quora
c) Le capital relationnel entre démonstration d’expertise et
investissement périphérique
2. Les enjeux professionnels dans les sites de questions-réponses
a) Des pro-ams et des experts
b) Quora serait-il un réseau professionnel de niche ?
III. La contribution comme rétroaction individuelle à un discours promotionnel
dominant
1. La promesse comme facteur de motivation
a) Sur la société de l’information
b) Sur le projet d’intelligence collective médiée par ordinateur
c) De l’émergence d’un nouveau paradigme
2. Médiatisation de soi et valorisation de la contribution en ligne
a) Le triomphe des idéaux de la communauté IT
b) Publicité de soi et rôles médiatiques : entre demandeurs,
résolveurs et commentateurs
I. La contribution comme marqueur d’un engagement politique
Nous allons nous pencher, dans cette première partie, sur l’hypothèse que nous pouvons
qualifier de sociologique. Nous supputons, en effet, que la contribution des internautes sur des
plateformes collaboratives11
tels que les sites de questions-réponses, serait un indice d’un
engagement politique. Les TIC seraient, alors, un élément amplificateur d’une évolution
sociale.
Avant d’entamer le développement de cette hypothèse, nous portons à l’attention du lecteur
que nous ne n’utiliserons pas, dans cette première partie, de terminologies propres à l’analyse
médiatique bien que l’acte de médiatisation soit omniprésent tout au long de la réflexion. En
effet, nous avons fait en sorte que l’analyse des dispositifs en tant que « média » ne soit pas
centrale dans cette partie de la recherche. Ceci se justifie par la nature de cette première
hypothèse, essentiellement orientée vers l’étude des dynamiques sociales. Toutefois, l’objectif
de cette enquête n’est pas de reprendre le chemin discursif qui consiste à ranger toute étude
des pratiques des internautes dans la formule de « sociotechnique » expliquant tous les
phénomènes ayant lieu dans un environnement numérique par un déterminisme hybride, mi-
social mi-technique. L’ambition de ce premier développement est beaucoup plus simple : il
s’agira d’étudier quelques travaux de recherche qui traitent de la contribution d’un point de
vue socio-économique, tout en comparant ces éléments théoriques avec les résultats obtenus
lors de notre enquête sur le terrain, et qui questionnent à la fois les perceptions des internautes
(déclaratif et analyse de discours) et leurs degré d’engagement réel (étude quantitative des
interactions).
1. Sur les pratiques actuelles des internautes
Nous commençons notre étude par un exposé des résultats obtenus lors de la première
partie de notre enquête d’observation. Il convient tout d’abord de rappeler que notre
questionnaire a été diffusé auprès de 100 personnes, toutes usagères du web, via des canaux
exclusivement numériques (réseaux sociaux, emails, forums de discussions etc.) Nous nous
sommes efforcés au possible, de diversifier les cibles de l’enquête (notamment en matière
d’âge) afin de rendre l’échantillon le plus représentatif possible.
11
Notons, par ailleurs, l’utilisation de la terminologie « plateformes collaboratives » pour désigner le type de dispositifs que nous avons pris comme objet d’analyse, à savoir les sites de questions-réponses.
Le questionnaire12
a été élaboré en trois parties : la première (questions 1 à 4) cherche
à dresser un bilan sur les pratiques des internautes en les interrogeant sur la manière dont ils
utilisent le web en général et les plateformes collaboratives en particulier. A cet égard, les
premières questions portent sur l’utilisation des réseaux sociaux et d’autres plateformes
d’échanges (forums, blogs).
La seconde partie (questions 5 à 9) a comme objectif de sonder les motivations
derrière l’engagement des internautes dans les plateformes collaboratives de type questions-
réponses et de mesurer leur degré d’engagement dans ces environnements. La troisième partie
(questions 10 à 13) sert à prospecter l’opinion des internautes sondés vis-à-vis des discours
promotionnels des TIC dans l’objectif de croiser les données quantitatives avec le degré
d’exposition aux discours de promotion, en cherchant un éventuel impact. Quant à la dernière
partie (questions 14 à 18), elle sert principalement au profilage des personnes interrogées,
dans l’objectif de faire un bilan critique de la méthodologie utilisée.
Avant d’engager le questionnement de notre première hypothèse, nous allons nous
arrêter sur les résultats de la première partie du questionnaire de prospection au vu de l’intérêt
de ces données pour la suite de notre réflexion.
Tout d’abord, les résultats concernant l’utilisation des réseaux sociaux sont unanimes
: seulement 1% des participants ne sont inscrits sur aucun réseau social tandis que 90% ont un
compte Facebook et 87% un compte LinkedIn (figure 6). Ces chiffres sont intéressants pour la
suite de notre enquête puisque ces deux réseaux disposent de la fonctionnalité « groupes » qui
sert de plateforme d’échanges de type questions-réponses (notre objet d’étude).
Figure 6: Métriques sur l'utilisation des réseaux sociaux
Concernant la consultation des forums de discussions en ligne (figure 7), 25% de
l’échantillon sondé déclare s’y rendre régulièrement ( 14% plus d’une fois par jour) 38% une
12
Voir Annexes.
fois par semaine, et seulement 1% déclare ne jamais s’y rendre. Nous pouvons donc
dorénavant considérer notre terrain comme disposant d’une base de consommateurs de
l’information qu’il convient d’étudier de plus près. Ces chiffres ne nous renseignent pas,
cependant, sur les motifs de consultation pour chaque visiteur. La valeur de cette prospection
confirme donc uniquement le présupposé essentiel selon lequel les internautes se rendent
effectivement sur des plateformes collaboratives pour chercher l’information.
Figure 7: Métriques sur la fréquence des consultations des forums
En revanche, la production de contenu sur les forums de discussions (qu’il s’agisse de
nouveaux messages ou de réponses à des sujets existants) demeure restreinte à une catégorie
limitée d’internautes. En effet, seulement 5% de la population sondée déclare poster des
messages de manière régulière tandis que 41% déclarent ne jamais le faire. Nous porterons
donc une attention particulière aux motivations des personnes productrices de contenu
puisqu’il s’agit de comportements isolés. Les travaux de recherches constituant notre corpus
théorique (analysés plus loin dans le développement) et qui présentent le même constat
concernant la participation en ligne sont, de notre point de vue, accrédités.
Figure 8: Métriques sur la production de contenu sur les forums
Tandis que le taux de consultation régulière des forums de discussion est de 25%
(figure 7) celui des plateformes d’échanges affiliées à des réseaux sociaux ou à des pages de
type Wiki13
atteint les 42% dont 21% visiteurs plus d’une fois par jour (figure 9). Nous
pouvons de ce fait, considérer que la plupart des actions de contribution sont produites dans
les réseaux sociaux et les pages d’édition de contenu plutôt que dans les forums de
discussions. Cette donnée est intéressante compte tenu de la symbolique des uns et des autres
dispositifs, les forums de discussions étant des plateformes qui ont accompagné les débuts de
l’internet (ou ce que l’on appelle dans le jargon marketing le « Web 1.0 ») tandis que les wikis
et les réseaux sociaux représentent les outils du « web 2.0 » par excellence.
Figure 9: Métriques sur la consultation d'espaces collaboratifs multiples
a. L’engagement à l’ère numérique : du « like » à la production de contenu
médiatique
Ces premiers résultats nous confirment donc l’existence d’une population usagère des
plateformes collaboratives, que l’on pourrait diviser dorénavant en deux catégories : celle des
« producteurs » de contenu et celle des « consommateurs » de contenu14
. Nous allons à
présent analyser les caractéristiques de ces usages en nous appuyant sur des travaux de
recherche antérieurs. Dans un article intitulé Prosumer15
, Valérie Beaudoin distingue
deux modalités « d’expression de la réception »16
dans les environnements numériques : d’un
13
Pages éditables par tous les utilisateurs avec un système d’historique et d’évaluation/modération par les utilisateurs. L’exemple le plus connu est Wikipédia. 14
Dans un développement ultérieur se conformant davantage aux terminologies de la sociologie médiatique, nous parlerons plus spécifiquement d’ « émetteurs » et de « récepteurs » 15
Beaudouin V. (2011). "Prosumer : quand le consommateur devient producteur (de soi)", Communications, 89, p. 131- 139. Notons au passage que le terme prosumer (de producer-consumer ou « proactive consumer ») a été utilisé pour la première fois, par les prospectivistes américains Alvin et Heidi Toffler dans leur ouvrage The Third Wave (1980) : « We invented the word prosumer for those of us who create goods, services or experiences for our own use or satisfaction, rather than for sale or exchange. When, as individuals or groups, we both produce and consume our own output, we are “presuming” » in The Revolutionary Wealth (2006) 16
Par « expression de la réception » l’auteur signifie la rétroaction produite par l’utilisateur pour signifier sa réception d’une expression médiatique (présentation de soi, cristallisée par l’investissement d’un profil par exemple) ou la production de contenu sous différents types.
côté l’évaluation quantitative, dont on peut à présent mesurer la teneur grâce à des compteurs
d’audience (référencement dans les moteurs de recherche, nombre d’ « amis » ou
d’ « abonnés » sur les réseaux sociaux, nombre de votes de type « j’aime » etc.). De l’autre,
l’évaluation qualitative qui consiste à recenser les interactions des internautes (commentaires,
échanges, partage de contenu). Selon l’auteur, « dans un même environnement, la réception
devient production de signes de qualité. Le changement de posture de lecteur à producteur se
fait en un clic ». Nous nous situons donc face à des acteurs sociaux majoritairement
« consommateurs », mais potentiellement « producteurs » de contenu puisqu’ils en ont la
possibilité technique à tout moment. Paradoxalement, différentes évaluations de métriques
produites par les interactions des internautes sur les réseaux sociaux, ont démontré que les
producteurs actifs de contenu sont une part très minoritaire17
de l’ensemble des visiteurs d’un
site collaboratif.
Pour V. Beaudoin, cette différence de formes d’engagement entre les individus constituent
une sorte d’indicateurs utilisés comme repère de gouvernance organisant à la fois la hiérarchie
sociale (les producteurs les plus actifs acquièrent une reconnaissance au sein de la
communauté) et la hiérarchie des productions médiatiques : « De fait, les indicateurs
quantitatifs et le système des commentaires et annotations contribuent à la hiérarchisation et
à la concentration de l’attention sur les biens les plus populaires »18
.
Mais quel mécanisme détermine la décision de l’internaute, de passer d’une posture de
lecteur-indexeur (s’engageant uniquement par des évaluations de type « j’aime ») à celle d’un
producteur actif de contenu ? En psychologie sociale, différentes théories sur les leviers de
motivation chez l’individu, ont été formulées à la fin du XXème siècle. Nous pouvons citer à
titre d’exemple, la théorie du Concept de soi (Self concept theory) qui regroupe un nombre
d’études sur la perception et la présentation de soi dans un environnement social19
. La
motivation derrière les phénomènes de contribution serait alors le résultat (ou la recherche du
résultat) d’une interaction heureuse confirmant une image de soi auprès des autres20
. Il
convient d’ailleurs de mentionner l’apport important d’Albert Bandura dans le domaine,
17
Il s’agit d’une donnée tellement récurrente dans différents outils collaboratifs que des professionnels du digital en ont fait une règle fondamentale des réseaux sociaux : « Loi des médias participatifs ou loi des 1/10/89 % qui est une constatation sur les médias participatifs et outils du web 2.0 voudrait qu’ 1% des internautes produisent du contenu, 10% le commentent ou le modifient et 89% le consultent. Ainsi fonctionnent les réseaux sociaux comme Twitter ou encore Facebook. » 18
ibid 19
La référence reste indéniablement l’ouvrage de Goffman : GOFFMAN Erving, La mise en scène de la vie quotidienne, tome 1 : la présentation de soi, 1973 20
Bong, M., & Clark, R. E. (1999). Comparison between self-concept and self-efficacy in academic motivation research. Educational Psychologist, 34(3), 139-153.
notamment sa théorie d’Auto-Efficacité (Self Efficacy theory) définissant ce concept comme
« un système de croyances qui forme le sentiment d’efficacité personnelle est le fondement de
la motivation et de l’action, et partant, des réalisations et du bien-être humains. Comme il
l’indique régulièrement, avec une clarté et une force de conviction rares, « si les gens ne
croient pas qu’ils peuvent obtenir les résultats qu’ils désirent grâce à leurs actes, ils ont bien
peu de raisons d’agir ou de persévérer face aux difficultés »21
. Les travaux de Bandura sur
l’efficacité personnelle nous donne une piste de recherche intéressante à explorer, notamment
lorsqu’il s’agira de sonder les motivations des internautes actifs dans les sites de questions-
réponses. En effet, ces recherches assertent que le sentiment d’efficacité induit par la
contribution régulière et la production de contenu de qualité sur des plateformes
collaboratives, peut accroitre l’image de soi du contributeur dans un sens communément jugé
comme positif, à savoir une personne efficace au sein de sa communauté.
Les théories du Self s’inscrivent dans une tradition de recherche que l’on pourrait
remonter à Carl Rogers et Abraham Maslow. Le premier a théorisé le concept du « Soi idéal »
(Ideal Self), une image construite de soi vers laquelle l’individu voudrait évoluer. Plus la
représentation qu’a l’individu de lui-même ressemble à cette image, plus son bien-être serait
grand. D’autre part, Maslow a théorisé la hiérarchie des besoins (connue également sous
l’appellation Pyramide de Maslow) dans laquelle il organise les ‘besoins’ de l’individu dans
des catégories hiérarchisées : les besoins physiologiques étant les plus primaires et les besoins
d’Actualisation de soi (Self-Actualization) étant la dernière catégorie de besoins à achever. Il
est intéressant de noter que Maslow considère le ‘besoin de résolution des problèmes’ comme
faisant partie de l’Actualisation de soi.
Ces théories, quand elles sont appliquées au domaine des médias informatisés, ont
toutefois le désavantage de réduire considérablement l’existence des interfaces utilisées par
les individus jusqu’à les faire disparaitre. Comme le souligne Yves Jeanneret dans un article
publié dans Communications et langages (2007)22
, l’approche qui consiste à expliquer l’usage
par le besoin « fait disparaître le média comme un objet en lui-même négligeable. Les médias
apparaissent alors comme un moyen de satisfaire des besoins sociaux, ressource
explicitement interchangeable avec d'autres produits. »
21
Philippe Carré, De l’apprentissage social au sentiment d’efficacité personnelle : autour de l’œuvre d’Albert Bandura, coll. « Savoirs », 2004 22
Jeanneret Yves. Usages de l'usage, figures de la médiatisation. In: Communication et langages. N°151, 2007. pp. 3-19.
La critique ainsi formulée, met au clair l’instrumentalisation qui est faite de la notion
d’usage par la notion de besoin. Y. Jeanneret explicite la généalogie proposée par les auteurs
qui définissent le besoin comme élément central de la recherche: « (1) la vie sociale engendre
des besoins («needs») qui (2) peuvent recevoir une satisfaction («gratification ») par divers
moyens, dont (3) l'usage (« use») des médias constitue une variété. »23
Ce procédé, reproché
notamment aux théories dites Uses and Gratifications24
, peut également être tenu contre toute
tentative d’explications des pratiques numériques par des besoins psychologiques. Nous
précisons, par conséquent, que l’introspection des motivations et des perceptions des usagers
réalisée dans la présente enquête, sera davantage orientée vers l’analyse des discours plutôt
qu’une approche psychologisante.
b. Les plateformes d’échanges numériques : des sources inépuisables d’informations
?
Nous allons à présent, davantage nous pencher sur notre problématique en abordant le
lien entre la contribution en environnement numérique et les engagements politiques
individuels. Nous partons du présupposé que les médias informatisés, et particulièrement les
espaces collaboratifs, constituent des sources d’informations d’une multitude telle que l’on
pourrait parler d’abondance informationnelle. Bien des auteurs ont écrit sur la multitude des
flux d’informations à l’ère numérique et la littérature qui spécule sur l’avènement d’une
nouvelle économie foisonnent depuis au moins une décennie25
. L’un des arguments récurrents
dans la littérature traitant des technologies de l’information d’un point de vue économique, est
l’immatérialité26
des biens de connaissance. La valeur des biens dits d’expérience (pour
reprendre la terminologie de J. Rifkin) est déterminée par la valeur symbolique de l’échange
que lui confèrent les acteurs sociaux. Plus une information est recherchée et consultée par les
lecteurs-consommateurs, plus elle est accréditée. La valeur de ces biens est ainsi « construite
socialement et prend son utilité dans l’échange social, que ce soit comme signe ostentatoire
23
Ibid, p. 10 24
« L’approche des Usages et Gratifications, les U&G, a marqué durablement la sociologie de la communication, intellectuellement et empiriquement. Elle a été formalisée dans les années 70 par la recherche anglo-saxonne dans deux textes fondateurs : Sur l’usage des mass médias dans les choses importantes , compte rendu d’une enquête dirigée par Katzsur les usages et les gratifications que les Israéliens nouent avec leurs médias (Katz 1973) ; puis Les usages des communications de masse, dirigé par Katz et Blumler. Cet ouvrage réunitles figures centrales du courant des U&G : McLeod et Becker, Denis McQuail, MichaelGurevitch, Karl Erik Rosengren, William McGuire. Il est aussi la première tentative de théorisation de ce modèle. (Katz 1974) » in CAPITANT Sylvie, Médias et Pratiques démocratiques en Afrique de l’Ouest Usages des Radios au Burkina Faso (Thèse), 2008 25
Voir à titre d’exemple : RIFKIN Jérémy, L’Age de l’accès, 2005. 26
Nous préférons utiliser, dans la suite de notre développement, le terme « bien numérique » plutôt que bien immatériel.
de richesse, pour marquer l’appartenance à une classe ou comme ressource
conversationnelle »27
. D’autre part, la compétence des contributeurs est un facteur essentiel
pour la fonction de contribution puisque le partage de l’information se fait dans un objectif
précis de confirmation de valeur. Or, comme l’indiquent Philippe Beraud et Franck
Coremerais dans leur article sur l’économie de la contribution28
: « La compétence est elle-
même influencée par l’articulation avec d’autres facteurs qui renvoient aux combinaisons
variables entre les trajectoires individuelles et les déterminations sociales : éducation,
formation, expérience, disponibilité, mobilisation, altruisme, leadership, etc. (Gregory, Share,
2003) ». Le point de vue exprimé ici est que l’espace collaboratif numérique en tant
qu’innovation technique, ne peut pas être considéré comme une corne d’abondance où les
utilisateurs viendraient se servir librement. Les auteurs insistent sur l’indépendance des
phénomènes de contribution des dispositifs numériques et de l’appropriation consciente de ces
innovations dans des objectifs déterminés : « La contribution peut s’épanouir dans la mesure
où des participants s’emparent de ce support technique pour y créer une activité distribuée,
caractéristique à la fois d’un niveau déterminé d’appropriation et de production de
connaissances, d’une prise de conscience des possibilités offertes par la constitution de
l’échange d’expertise ou de contre-expertise, d’une intention de peser sur les conditions
d’exercice de la gouvernementalité à différents niveaux, des gouvernements locaux à la
gouvernance internationale, en investissant le politique et les dossiers de la chose publique. »
Sous cet angle, la contribution se présente comme un acte conscient de la part des acteurs
sociaux, et qui peut être considéré comme acte politique.
Dans la continuité de l’analyse de notre questionnaire d’exploration, la seconde partie
des questions, concernant l’utilisation des plateformes de questions-réponses et les
motivations derrière les usages a révélé que 90% des internautes sondés consultent des sites
dédiés aux questions-réponses (figure 10), mais de manière très occasionnelle (seulement
11% à fréquence régulière).
27
BEAUDOIN V. op. cit. 28
BERAUD Philippe et CORMERAIS Franck, Économie de la contribution et innovation sociétale in Innovations 2011/1 (n°34) P. 163-183.
Figure 10: Métriques sur la consultation des sites dédiés aux questions-réponses
Les chiffres s’inversent lorsqu’il s’agit de s’engager par une évaluation ou une
indexation de contenu sur les plateformes en question. En effet, seulement 5% de l’échantillon
sondé déclare évaluer du contenu posté, contre 43% qui ne le font jamais. Le constat est le
même concernant la production de contenu en rétroaction (réponses aux sujets, commentaires
etc.) puisque 16% de l’échantillon déclare apporter des réponses occasionnellement (au moins
une fois par semaine) tandis que 51% déclare ne jamais le faire (Figure 11 et 12).
Figure 11: Métriques sur l'indexation/évaluation des contenus sur les sites de questions-réponses
Figure 12: Métriques sur la production de réponses sur les sites de questions-réponses
Sur les déclarations des internautes concernant les motivations derrière leur
engagement dans ces plateformes, le facteur le plus mentionné dans le cas de la lecture des
informations, est incontestablement la rapidité du processus de recherche de l’information
(64% de votes), vient ensuite le facteur de sérendipité29
ou la découverte de nouvelles
informations au hasard des navigations (49% de votes). Le troisième facteur de motivation le
plus mentionné est la gratuité avec 47% des internautes qui sont d’accord avec l’assertion
« c’est un moyen de consultation d’informations pas cher (gratuit) », vient ensuite le facteur
de consultation des opinions dans l’objectif de prendre des décisions (« le croisement des
opinions vous aide à prendre des décisions » recueillant 42% de votes, et enfin 32%
d’internautes ont également mentionné la valeur des avis exprimés sur les espaces
collaboratifs, qu’ils considèrent comme complémentaires à l’expertise des professionnels.
Ajoutons à cela quelques témoignages par les internautes concernant les motifs de leurs
usages, et dont la plupart évoquent l’efficacité et la rapidité, mais également une volonté de
s’extraire des circuits médiatiques classiques, jugés trop investis par des professionnels du
marketing (« bonne volonté, générosité de certaines personnes qui diffusent leur avis en
dehors des circuits commerciaux ou de marketing ») D’autres témoignages donnent des
raisons plus pratiques, notamment l’accès simplifié de ces espaces d’échanges, par le
référencement sur les moteurs de recherche (« 1ers résultats de recherche dans les moteurs »)
ou la profession de l’internaute qui implique une veille sur les plateformes en question (« Je
suis rédacteur de contenu »30
.
Concernant la production de contenu sur les sites de questions-réponses, notons tout
d’abord que les faibles taux de participation recueillis au début de l’enquête en ce qui
concerne les forums de discussions, se confirment également pour les sites de questions-
réponses. En effet, 44% des internautes ont déclaré « ne jamais posté de messages sur ce type
de plateformes ». Le facteur de motivation le plus nommé par les internautes est celui de la
réciprocité avec 24 votes pour l’assertion « Vous aurez peut-être besoin, à votre tour, de
l’aide des autres sur les réseaux », vient ensuite la volonté de rectifier des informations
jugées incorrectes (« des informations erronées circulent sur le web et il convient de les
rectifier ») ainsi que le facteur de curiosité et de volonté d’apprentissage (« vous apprenez de
nouvelles choses en interagissant avec les autres ») Certains internautes ont également ajouté
29
« Issu de serendipity, il signifie « don de faire des trouvailles ». Le terme, forgé par le collectionneur Horace Walpole en 1754, faisait partie du jargon des bibliomanes anglais. Il a migré petit à petit comme concept vers les sciences et la technique, le droit et la politique mais aussi l’art et, tel monsieur Jourdain qui « sérendipite » sans le savoir, la vie quotidienne.» in http://www.scienceshumaines.com/serendipite-mot-de-l-annee_fr_24741.html 30
Nous reviendrons plus en détail sur le rapport entre le métier et l’investissement des internautes dans la seconde partie du mémoire.
des commentaires sur le non-usage des plateformes en question (« [je ne réponds pas] Parce
que les réponses que j'auraient tenté de formuler s'y trouvaient déjà. »)
Nous pouvons résumer ces résultats comme suit : une majorité écrasante de la
population connectée consultent les sites de questions-réponses, mais seulement une minorité
restreinte produit du contenu. Les internautes consultent ces espaces collaboratifs parce qu’ils
estiment que c’est un moyen rapide et efficace pour trouver l’information, parce qu’ils
apprennent de nouvelles choses en naviguant de manière sociale, et car le croisement des avis
leur permet de compléter les conseils des experts à moindre coût (gratuité). Nous pouvons
donc dire que la majorité des utilisateurs de ces espaces sont des consommateurs
pragmatiques que l’on pourrait rapprocher de la notion d’usagers-braconniers de Michel de
Certeau. Bien qu’ils ne fassent pas une confiance aveugle aux informations circulant sur le
web (« Rapide et efficace mais les sources ne sont jamais sûr. » témoigne un internaute) les
utilisateurs trouvent dans les espaces collaboratifs un moyen de sonder les opinions et
d’acquérir des informations d’individu à individu, économisant ainsi partiellement du temps
et de l’argent. Ces consultations semblent être une étape préliminaire et ne constitue pas une
méthode certaine d’acquisition d’informations correctes, comme les témoignages de certains
internautes le démontrent. Les producteurs de contenu donnent comme motif d’engagement,
l’attente d’une réciprocité dans le partage de l’information, l’apprentissage dans l’interaction
avec les autres et la rectification des informations jugées incorrectes. De ces trois facteurs
nommés en priorité par l’échantillon sondé, le dernier représente celui qui s’approche le plus
d’un acte militant. Nous pouvons considérer, en effet, que le mécanisme derrière l’acte de
produire du contenu dans l’intention de faire une critique à une information existante, est
d’ordre politique31
.
Dans notre observation participante, nous avons essayé de relever les éléments
dénotatifs et les éléments connotatifs pouvant signifier formellement les motivations des
utilisateurs du site de questions-réponses Quora. L’une des premières remarques que l’on
pourrait faire concernant les discours des producteurs actifs de contenu sur ce site, est la
31
Dans le sens d’un idéal citoyen de partage des savoirs. Notons au passage le terme « proto-politique » utilisé par Peter Dahlgren dans Media and Political Engagement. Citizen, Communication and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pour modérer les espérances autour des TIC comme technologies d’amélioration de l’espace démocratique : « Il n'est guère surprenant que des espoirs se soient rapidement formés quant à la capacité du net d'étendre l'espace public. Cependant, l'histoire du net étant très récente, nous devrions modérer notre optimisme. Les usages actuels du net sont bien loin de l'idéal démocratique d'universalisme, et cette situation devrait probablement durer. De plus, la commercialisation du net est un fait : le réseau lui-même est devenu à la fois un instrument et une arène du marché global »
dimension politique que prennent certains sujets à forte popularité. Nous n’avons cependant
pas voulu traiter dans notre analyse, de sujets typiquement politiques car cela biaiserait les
résultats de l’analyse. En effet, les utilisateurs de l’échantillon qui répondent à des sujets
politiques le font occasionnellement et sont autant actifs sur d’autres thématiques. Affirmer le
caractère politique des contributions en se basant uniquement sur une partie des sujet auxquels
les utilisateurs participent manquerait de pertinence. A ce niveau d’analyse, il est difficile de
confirmer l’hypothèse selon laquelle l’outil numérique serait « au service d’un engagement
des acteurs de la société civile dans l’espace public, qui fait de la contribution un des
fondements de la création collective. »32
c. Sur l’économie du don
Il existe différents travaux de recherche qui ont tenté d’expliquer les phénomènes de
contribution d’un point de vue économique. Nous pouvons citer à titre d’exemple la théorie de
l’économie du don (the gift economy theory) développée notamment par Peter Kollock dans
des travaux datant des années 2000. Dans son article intitulé The Economies of Online
Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace33
, dans lequel l’auteur reprends la
définition du don comme étant (1) un transfert obligatoire (obligatory transfer), (2) d’objets
ou de services inaliénables (of inalienable objects or services), (3) entre deux cocontractants
reliés et mutuellement obligés (between related and mutually obligated transactors) , Kollock
stipule que les communautés en ligne disposent d’un modèle économique différent de celui
qui régit les biens publics malgré les similarités que ceux-ci peuvent avoir avec les biens
numériques. L’environnement d’abord, selon Kollock, est (1) un réseau (2) d’informations (3)
numérisées. Ces trois éléments changent considérablement la manière dont le don est perçu
par les individus. En reprenant la définition de Carrier (1991) : « Dans les sociétés du don, les
liens du don sont orientés vers la mobilisation et le contrôle du travail, tandis que dans les
sociétés capitalistes, les liens marchands ont été généralement orientés vers la mobilisation et
le contrôle des objets » Kollock rajoute que dans les communautés connectées en
environnement numérique, les liens sont orientés vers la mobilisation et le contrôle de
l’information.
La définition du don stipule donc qu’un bien transmis (dans les environnements
numériques : l’information) implique une attente tacite d’un don ultérieur en retour. Une
différence constatable dans les espaces d’échanges numériques est l’abstraction faite des
32
BERAUD et CORMERAIS, op. cit. 33
SMITH Marc and KOLLOCK Peter (editors), 1999. Communities in Cyberspace. London, Routledge
cocontractants de la transaction : l’utilisateur ayant bénéficié d’un don-information X n’est
pas forcément celui qui donnera un don-information Y au premier donateur X. Il s’agit donc
d’une attente diffuse dans la communauté où les utilisateurs ayant répondu à un certain
nombre de questions s’attendent généralement à ce que l’on réponde à leurs propres questions
peu importe la provenance individuelle de cette réponse.
Dans notre objet d’analyse, le site Quora, il existe un système permettant de gérer ces
transactions de sorte que chaque utilisateur puisse exiger de la communauté des réponses en
utilisant un crédit accumulé en répondant aux questions des autres (Quora credits). Nous
pouvons donc considérer l’élément de la réciprocité anticipée, comme un facteur de
motivation derrière la contribution des usagers, surtout quand celui-ci est géré par un système
de notation comme c’est le cas dans Quora. Kollock appelle ce genre de système de gestion
des participations, un système d’annotations en réseau (network-wide accounting system)34
Nous avons demandé à notre échantillon d’utilisateurs observés durant l’étude, de
répondre à un questionnaire sur les motivations derrière leur utilisation du site, nous leur
avons présenté les mêmes facteurs utilisés dans le questionnaire de prospection et nous avons
introduit un facteur nouveau : « Je participe pour gagner des crédits Quora ». Huit sur les
vingt utilisateurs contactés ont répondu favorablement à l’appel et les résultats sont
intéressants en comparaison avec ceux de la population sondée initialement. En effet, aucun
utilisateur de Quora n’a voté pour le facteur de gain de points (Quora credits) que ce soit d’un
point de vue de « demandeur » (utilisateurs posant des questions) ou d’un point de vue de
« résolveur » (utilisateur répondant aux questions des autres). En revanche, le facteur qui a
recueilli le plus de votes est celui du désir d’apprentissage, avec 7 votes sur 8 pour les
demandeurs35
et 6 votes sur 8 pour les résolveurs36
(figure 13 et 14). Il s’agit du même facteur
revendiqué par les répondants à notre enquête préliminaires. Le second facteur le plus
plébiscité est celui du divertissement (« because it’s entertaining ») qui a recueilli 6 réponses
sur 8 pour la partie consultation et 5 réponses sur 8 pour la partie production de contenu. Nous
reviendrons plus en détail sur ce facteur de motivation.
34
« One possibility is that a person is motivated to contribute valuable information to the group in the expectation that one will receive useful help and information in return; that is, the motivation is an anticipated reciprocity. As I discussed above, it is sometimes the case that reciprocity will occur within the group as a whole in a system of generalized exchange. This kind of network-wide accounting system creates a kind of credit, in that one can draw upon the contributions of others without needing to immediately reciprocate. Such a system, in which accounts do not need to be kept continually and exact in balance, has numerous potential benefits (Kollock 1993).” 35
L’intitulé exact était : « You learn new things while surfing on the website” 36
L’intitulé exact étant : « You learn new things while interacting with people”
Figure 13: Métriques sur les facteurs des motivation derrière la consultation des sujets sur Quora
Figure 14: Métriques sur les facteurs de motivation derrière la production de contenu sur Quora
Enfin, nous notons également que les votes concernant l’attente d’une réciprocité
tacite chez les résolveurs de Quora est plutôt important (50% de l’échantillon) ce qui nous
amène à déduire que cette attente se manifeste autrement que par le système d’annotations
proposés par les administrateurs du site. Les utilisateurs seraient donc amenés à répondre aux
questions des autres en espérant avoir à leur tour des réponses quand ils poseront de question,
mais ne cherchent pas particulièrement à avoir des points leur permettant de promouvoir une
question afin d’avoir des réponses. Cette assertion reste toutefois à modérer pour deux
raisons : la première est le caractère déclaratif de l’enquête (méthode du questionnaire) qui ne
couvre pas une partie des perceptions des internautes et de certains non-dits concernant les
usages37
, la seconde raison est la typologie des usagers qui ont répondu aux questionnaires : il
s’agit en effet majoritairement se Super résolveurs (utilisateurs répondant à beaucoup de
question) et de Super versatiles (utilisateurs posant et répondant à beaucoup de questions),
tandis que les 3 participants occasionnels de l’échantillon sont également de grands indexeurs
de contenu (un Super indexeur et deux indexeurs réguliers), sachant qu’indexer du contenu
(votes, partages, commentaires) tout autant que de répondre à des questions, donnent
automatiquement des crédits à l’utilisateur. Ceci signifie que les utilisateurs en question
disposent de grandes quantités de crédits et n’ont pas besoin de faire plus d’effort pour en
avoir, ce qui explique leur détachement par rapport au gain de points.
Dans la continuité de cette argumentation, nous avons relevé des indices démontrant
ce désintérêt pour le gain de crédits à fur à mesure que les utilisateurs deviennent des
contributeurs actifs. Un phénomène très intéressant a été observé dans les publications d’un
utilisateur de l’échantillon observé et qui est catégorisé Super veilleur (abonné à un très grand
nombre de personnes) / Super indexeur (votant énormément pour les publications des autres)
et participant occasionnel (ne produisant pas beaucoup de contenu) : l’usager en question
reçoit souvent des dons de crédits de la part d’utilisateurs plus actifs qu’il suit, et poste en
conséquent des messages de remerciements (figure 15). Les messages en question sont
majoritairement des courts et particulièrement expressifs. Les motivations potentielles
derrière ces publications sont la réception des crédits ainsi qu’une volonté de socialisation
avec les donateurs. Les éléments dénotant ces motivations sont l’utilisation intensive de
smilies de joie, de points d’exclamation ainsi que des majuscules (expression
d’enthousiasme), le ton est très positif et la posture « reconnaissante ». Ces messages ne
reçoivent généralement de retour que de la part du cercle d’abonnés très proches (entre 4 et 10
votes par messages) ce qui confirme le caractère privé et la visée socialisante de ces
interactions.
37
La réciprocité anticipée serait en quelque sorte un facteur de motivation tacite mais non valorisant, et donc tabou.
Figure 15: Tableau d'analyse concernant l'utilisateur n° 15 de notre échantillon
Toujours concernant le système de crédits de Quora, nous avons, durant notre
observation participante, utilisé des crédits pour promouvoir la question suivante : « Quora :
Why do you use Quora ? » (Figure 16). Cette fonctionnalité permet de cibler un nombre
d’utilisateurs défini selon le nombre de points déployés. Les internautes en question verront
la question promue en visibilité sur leur flux de sujets et seront plus amenés à y répondre.
Cette fonctionnalité nous a permis d’avoir 5 réponses supplémentaires à la question dont 2
provenant d’utilisateurs faisant partie de l’échantillon observé. L’utilité de la fonction est
donc avérée et par conséquent, le désintérêt pour le gain de points observés chez les
utilisateurs les plus actifs ne peut être dû à une éventuelle futilité du système d’annotation mis
en place.
Figure 16: Dans l'encadré à droite, nous pouvons promouvoir la question en utilisant les crédits existants
Les réponses des utilisateurs de Quora à notre questionnaire ainsi que les phénomènes
de donations de crédits nous poussent à remettre partiellement en cause la piste de la
réciprocité anticipée comme facteur de motivation derrière l’engagement des utilisateurs. La
réponse « Vous aurez peut-être besoin, à votre tour, de l’aide des autres sur les réseaux », a
été évoquée en premier chez une population majoritairement lectrice de contenu
(questionnaire préliminaire) mais n’arrive qu’en 5ème
position chez la population usagère du
site Quora (utilisateurs majoritairement de catégorie « Super résolveurs actifs »). Les usagers
les plus actifs produisent donc du contenu sans attendre nécessairement un retour
d’informations, ce qui tend à privilégier la théorie des liens faibles (weak ties theory) avancée
par Mark Granovetter38
et reprise dans des travaux menées sur les espaces numériques : les
employées de multinationales géographiquement dispersés, fournissent des informations de
qualité à d’autres employés qu’ils n’ont jamais rencontrés en dehors de l’environnement
numérique (Constant et al., 1996). Les membres de communautés en ligne communiquent de
manière anonyme avec des inconnus qui leur donne conseils et informations sans que ceux-ci
n’aient aucun lien de proximité (Wellman & Gulia, 1999). La conclusion que nous pourrons
faire de ces analyses est que « les motifs de l’échange sont, dans la plupart des cas, à
rechercher hors du champ de l’intérêt économique, pour des contributeurs œuvrant dans une
‘économie de la reproductibilité à coûts quasi nuls’ (Stiegler, 2008a, p. 126).
2. Vers une nouvelle forme de médiatisation ?
La suite du développement tenu sur l’économie du don nous amène sur d’autres
questionnements relatifs aux caractéristiques du producteur-consommateur de l’information
en environnement numérique, notamment les rapports économiques et sociaux qu’il entretient
avec ses pairs.
a. Le producteur-consommateur de l’information : un individu relationnel
L’échantillon d’utilisateurs observés dans notre terrain affiche des comportements et des
usages très similaires à des observations antécédentes39
. Dans Economie de la contribution
et innovation sociétale, P. Beraud et F. Cormerais réintroduisent dans leur travail la notion
38
GRANOVETTER M, The Strength of Weak Ties, American journal of Sociology, Volume 78, Issue 6 (May 1973) 1360-1380. 39
Voir partie empirique de notre bibliographie.
d’économie relationnelle en insistant sur le caractère uniquement complémentaire
(amplificateur au mieux) des techniques numériques : « l’outil technique de l’ère numérique
n’a pas constitué en lui-même le déterminant de la contribution. Il n’en a pas dicté non plus
les finalités. C’est l’importance des interactions entre les collaborateurs du logiciel libre ou
du web 2.0, marquées par des comportements désintéressés, qui a permis l’émergence d’une
économie relationnelle fondée sur des engagements réciproques. » Bien que les
« comportements désintéressés » restent encore une assertion à étudier, le qualificatif de
relationnel se confirme par l’étude de notre terrain où nombreux ont été les témoignages
impliquant les relations dans les facteurs de motivations :
“I use Quora because:
- it's fun
- I like being useful
- I enjoy hanging out online with so many really smart, clever people
- I learn something great every single day
- when I need an answer to a specific question I can usually get it fairly quickly
- did I mention that it was fun?
- yeah, it's fun”
Cette contribution de la part d’un utilisateur, en réponse à la question « Why do you
use Quora ? », s’ajoute à d’autres témoignages recueillis dans la partie libre du
questionnaire40
, qui confirment le caractère relationnel des fonctionnalités du site (centré
autour de l’utilisateur) et des motivations derrière l’engagement des internautes. L’autre
élément frappant est la récurrence du qualificatif « fun », qui correspond d’ailleurs aux
résultats du questionnaire diffusé au sein de la population de Quora. En effet, la réponse
« Je participe parce que c’est divertissant » vient en seconde place des votes sur les
facteurs de motivation, qu’il s’agisse de la consultation ou de la production de contenu sur
le site. L’action de contribution arrive dans un contexte relationnel où la satisfaction de
l’utilisateur atteint un certain degré, prédéterminé par la confiance qu’il fait aux
utilisateurs qui l’entourent et l’intérêt ludique du contexte dans lequel a lieu cette action.
« La contribution apporte un nouvel éclairage sur les logiques de l’action, de la
40
A titre d’exemple: “Quora is full of smart, clever people asking and answering questions about the things they know. It is irresistible.” Des termes positifs sont utilisés pour décrire les utilisateurs du site ainsi que le qualificatif « irrésistible » pour justifier son engagement. Le relationnel est donc déterminant dans le choix de participer ou non dans un espace d’échanges numérique.
valorisation et de la localisation de l’activité, ainsi que de la participation à la décision
dans l’espace public » conclut Beraud et Cormerais sur la nature de la contribution en
environnement numérique. Les internautes s’engagent donc dans des actions de
contribution parce que (1) cette action intervient dans un contexte de communication
possible41
, (2) par une abondance de relations favorables42
(3) stimulée par une forme
ludique de consommation de l’information.
b. L’intelligence collective en tant que projet d’émergence
Divers auteurs ont vu dans cette forme de médiatisation de contenu, rendue possible par
les technologies numériques, l’émergence d’une volonté collective de rendre abondantes et
accessibles au plus grand nombre, les informations produites via ces supports. Dans un
article intitulé « Vers une nouvelle forme d’intelligence collective »43
Jérôme Laniau,
journaliste scientifique, fait une synthèse assez complète des différentes théories avancées par
des chercheurs en sciences de l’information, ces deux dernières décennies. La problématique
de son travail de recherche suit un questionnement déjà élaboré par Pierre Lévy, l’un des
premiers théoriciens à avoir écrit sur le concept de l’intelligence collective : « Nous avons
choisi de considérer ici Internet en tant qu’outil permettant le développement d’une nouvelle
forme d’intelligence collective, dont nous dégagerons deux définitions. « Des groupes
humains peuvent-ils être collectivement plus intelligents, plus sages, plus imaginatifs que les
personnes qui les composent44
? »
L’intelligence collective est une appellation communément utilisée aujourd’hui pour
désigner des méthodes de travail, notamment en entreprise, nécessitant la collaboration de
plusieurs individus en même temps45
. Il s’agit aussi de la représentation chez certaines
41
« […] en tant qu'espace d'échange et en tant qu'ensemble de ressources offertes à la symbolisation, le dispositif global de l'ordinateur en réseau intervient dans une communication possible. L'ensemble des perspectives dessinées à partir de là par Josiane Jouet, qu'on peut résumer par une série de tensions (entre contraintes et initiatives, entre individualisations et normalisations, entre normes et affranchissements, etc.) est entièrement éclairé par cet espace des conditions de possibilité de l'échange. » in JEANNERET Yves, Usages de l’usage, figures de la médiatisation, 2007. 42
« Cette interaction d’un grand nombre sur l’Internet s’appelle l’effet bibliothèque. Plus grand est le nombre en réseau de personnes qualifiées sur un sujet, plus forte est la probabilité que vous trouviez la bonne réponse à une question que vous posez et plus forte aussi l’économie de temps réalisée. » in MOULIER-BOUTANG Yann, Le Capitalisme Cognitif : La Nouvelle Grande Transformation, 2007. 43
LANIAU Jérôme, Dossier Réseaux internet et lien social, Vers une nouvelle forme d’intelligence collective, in Empan, 2009/4 (n° 76), 176 pages 44
Pierre Lévy, Pour une anthropologie du cyberspace, 1994 45
« L’intelligence collective désigne les capacités cognitives d’une communauté. Cette capacité est générée par les interactions entre les membres du collectif. » Définition donnée lors du colloque : L’Intelligence Collective, Actes de la première Université d’été, Université d’été de la FFC Pro, 12 & 13 septembre 2008, PARIS
catégories socio-professionnelles46
, d’une synergie de travail de groupe dont l’image la plus
1proche est celle d’un « brainstorming continu »47
. Dans son ouvrage intitulé L’Intelligence
collective : pour une anthropologie du cyberspace48
, Pierre Lévy définit le concept de
l’intelligence collective comme étant une « une intelligence partout distribuée, sans cesse
valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences
[…] dont le but et le fondement essentiel est l’enrichissement mutuels des personnes ». Il
s’agit bien ici d’une définition relevant davantage d’un idéal convertible en projet que de la
description de phénomènes existants, raison pour laquelle nous ne succomberons pas à des
analogies rapides entre les phénomènes de contribution étudiés sur le terrain, et les notions
développées par les auteurs ici analysés. Toutefois, dans la partie du questionnaire destinée à
sonder les perceptions des internautes concernant des concept-projets comme l’intelligence
collective, nous avons eu des résultats pouvant signifier une adhésion théorique à un tel projet
– théorique puisqu’il ne s’agit pas d’un engagement de la part des internautes, mais plutôt une
opinion exprimée vis-à-vis d’un sujet qui est de plus en plus évoqué dans les médias-. En
effet, confrontés à l’assertion suivante : « Internet et les technologies numériques pourraient
faire émerger de nouvelles formes de résolution de problèmes à grande échelle » 71% des
internautes sondés ont déclaré être d’accord dont 34% « Tout à fait d’accord ». Concernant la
valorisation et la mobilisation des compétences, les internautes sondés ont également une
opinion qui va plutôt dans le sens du projet de l’intelligence collective tel que défini par P.
Lévy. Plus de la moitié de l’échantillon sondé déclare être d’accord avec l’affirmation : « Les
contributions sur les plateformes d'échanges numériques, quand elles sont régulées et évaluées
par les internautes, pourraient équivaloir à certaines formes d'expertise », dont 17% « Tout à
fait d’accord » (contre 19% pas d’accord et 28% ni d’accord ni pas d’accord). L’exigence
formulée par P. Lévy quant à la conception d’un « cyberspace coopératif conçu comme un
véritable service public » nous parait aujourd’hui un vœu resté au stade de la théorie puisque
tous les indicateurs confirment la marchandisation massive du réseau internet49
.
L’émergence d’une intelligence collective dont le moteur serait la contribution des
individus connectés, a suscité des questions quant aux conséquences socio-économiques et
46
Nous traiterons plus en détail de la représentation dans le milieu professionnel, de la contribution en général, et de l’intelligence collective en particulier, dans notre troisième hypothèse. 47
Définition donnée par Damien Philippon, associé chez Magellan Consulting, durant un entretien qualitatif autour du concept d’intelligence collective (qui se trouve par ailleurs, être l’une des valeurs phare de l’entreprise). 48
LEVY Pierre, L’Intelligence collective : pour une anthropologie du cyberspace, 1994, Paris. 49
« La commercialisation du net est un fait : le réseau lui-même est devenu à la fois un instrument et une arène du marché global » Peter Dahlgren, op. cit.
anthropologiques d’une telle coopération. La question qui divise chercheurs et enthousiastes
est l’analogie faite avec la théorie de l’émergence quand il s’agit de penser les médias
informatisés comme des outils de propulsion d’une « intelligence collective techniquement
augmentée » (LEVY, 1997)50
. En d’autres termes : l’utilisation des médias informatisés par
un nombre croissant d’internautes, dans une perspective que l’on pourrait rapprocher du projet
d’intelligence collective, provoquera-t-elle l’émergence51
de nouvelles capacités humaines ou
permettra-t-elle juste de résoudre les problèmes courants de manière plus rapide ? La seconde
supposition semble se confirmer avec l’utilisation des espaces collaboratifs de types forums
de discussions, wikis, et sites de questions-réponses comme l’indiquent les résultats de notre
observation ainsi que des travaux antérieurs : « Si acheter ou vendre des appareils et des
compétences, ou encore s’informer sur ces appareils et ces compétences, sont des problèmes
que l’on résout de plus en plus souvent sur Internet, ce n’est pas seulement parce que c’est
moins fatigant, mais c’est surtout parce que c’est plus rapide. » (LANIAU, 2009). Reste la
première supposition concernant l’émergence de capacités cognitives nouvelles : nous ne
traiterons pas particulièrement cette question qui s’éloigne du questionnement de recherche
initial de ce travail, mais il convient d’indiquer quelques éléments à l’origine de cette
assertion : l’idée qu’une intelligence supérieure puisse « émerger » par la somme des
intelligences individuelles connectées a été popularisée par différents best-sellers dont on peut
citer de Steven Johnson52
, où il explique comment le principe d’émergence pourrait
s’appliquer –entre autres- aux communautés d’individus connectés par des réseaux
d’ordinateurs. Cette même hypothèse a été défendue par James Surowiecki dans son
ouvrage53
publié en 2004, et dans lequel il reprend l’idée de foules intelligentes développé
par Howard Rheingold54
. Ce point de vue semble se généraliser considérablement dans la
population connectée comme le démontre les réactions à l’assertion 11 de notre
questionnaire : « Les contributions sur les plateformes d'échanges numériques, quand elles
sont régulées et évaluées par les internautes, pourraient équivaloir à certaines formes
d'expertise » ayant eu 53% de confirmation (dont 17% « Tout à fait d’accord »). Cette opinion
50
Nous préférons d’ailleurs à cette appellation celle, plus technique, d’ « intelligence médiée par ordinateur » 51
« Emergence, La propriété d’émergence est une application du principe « le tout est supérieur à la somme des parties ». En biologie, elle désigne l’apparition de propriétés nouvelles qui surviennent du fait de l’agrégation d’éléments au sein d’un ensemble. Ainsi la capacité du cerveau à produire des concepts formels n’est pas une capacité individuelle des neurones. C’est une propriété émergente qui résulte de l’interact ion entre des milliards de cellules. » in L’intelligence collective, dossier Sciences humaines, n° 169, Mars 2006 52
JOHNSON Steven, Emergence : The connected lives of ants, brains, cities and software, Scribner, 2001 53
SUROWIECKI James, The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations Little, Brown, 2004 54
RHEINGOLD Howard, Les Communautés virtuelles, Addison-Wesley France, 1995.
est toutefois modérée par les réponses à la question 13 sur les entraves les plus vraisemblables
qui pourraient limiter la réussite de ces dispositifs à laquelle notre échantillon a répondu
prioritairement : « Risques de désinformation -propagande, falsifications, trolling etc » (32%),
« Risque d'influence par les chiffres et "effet moutonnier" : plus une information est créditée
en premier lieu plus elle est sur-créditée par la suite » (26%) et « Non-représentativité des
participant : réponses trop clivées, manque de diversité dans les savoirs et les expériences »
(16%) en plus de facteurs supplémentaires proposés par les participants, notamment « La
censure et l’interventionnisme politique » ou encore « Le manque de construction du débat
limitant la portée des réponses apportées et des responsabilités in fine ». Les limites d’une
supposée intelligence collective médiée par ordinateur sont par conséquent, connues du
public et si l’opinion collective se montre parfois plus pertinente que les avis des experts, il
existe une multitude de procédés de déformation et de manipulation des opinions55
.
c. Le fantasme des cerveaux connectés
Nous l’avons remarqué dans l’analyse précédente, les discours des différents acteurs
(chercheurs, professionnels, internautes…) comportent des éléments se référant à un idéal à
atteindre : pouvoir connecter les intelligences individuelles à très grande échelle. L’existence
de collectifs intelligents (LEVY, 1994) sont conditionnées par (1) une connectivité (2) de
type stigmergique56
(3) permettant un holoptisme57
élargi. Un site de questions-réponses par
exemple, serait un média via lequel, les acteurs peuvent atteindre des messages
informationnels à une portée inatteignable par d’autres moyens58
. Cette définition implique
que tout média a un but tacite de communication des savoirs d’un point A (cerveau d’un
individu X) à un point B (cerveau d’un individu Y)59
. C’est à la suite de ce raisonnement que
55
La troisième hypothèse de cette recherche traitera de l’influence des discours médiatiques et des biais de la décision collective. 56
De Stigmergie : « un type de communication indirecte comme c’est le cas chez l’ours qui se frotte contre un arbre. Il envoie un signal aux autres individus via l’environnement. C’est une communication qui est nécessairement locale, ou en tout cas limitée spatialement. » (LANIAU, 2009) 57
Holoptisme : « conditions dans lesquelles chaque individu d’un groupe peut percevoir toutes les informations sensorielles émises par les agents ». (ibid) 58
Marshall Mcluhan considère toute technique permettant d’ « augmenter » les capacités humaines -par exemple les lunettes- comme étant média : “In a cool medium, the audience is an active constituent of the viewing or listening experience. A girl wearing open-mesh silk stockings or glasses is inherently cool and sensual because the eye acts as a surrogate hand in filling in the low-definition image thus engendered.” 59
Il s’agit, bien entendu, d’une formule métaphorique. Les neurosciences n’étant pas encore tout à fait en mesure de donner avec certitude un emplacement totalisant toutes les opérations cognitives de l’homme, même pour le cas du cerveau.
Pierre Lévy a théorisé le concept de l’hypercortex60
et que Howard Rheigold a pris le contre-
pied des discours qui veulent que les foules soient toujours manipulées et irrationnelles. « En
quelques minutes, de bouche à oreille – ou plutôt d’un écran à l’autre-, un message peut
circuler rapidement vers des milliers d’individus. »61
Plusieurs réactions à la question promue, dans le cadre de l’observation participante
sur le site Quora (« pourquoi utilisez-vous Quora ? ») ont fait montre d’enthousiasme vis-à-
vis d’idée de connectivité des cerveaux, ce qui nous amène, au vu de l’ancienneté des discours
médiatiques analysés plus haut, à considérer davantage la thèse de l’influence par les discours
promotionnels.
“I use Quora to connect with other minds. It's not a Social Network, it's a Mental Network.”
Témoignage d’utilisateur.
Cette représentation de l’intelligence collective médiée par ordinateur, est également
présente dans le discours des professionnels :
« [Concernant l’intelligence collective] nous pourrions même envisager une
collaboration où l’information circule de cerveau à cerveau »62
D’un point de vue ontologique, la passation des idées d’un être pensant à un autre, a été
un sujet de réflexion chez bon nombre d’auteurs, cela avant même que les technologies
numériques ne prennent la place qu’ils ont aujourd’hui dans les sciences de l’information et
de la communication. Yves Jeanneret trace l’historique des disciplines étudiant la circulation
des informations chez l’être humain63
en citant notamment « l’épidémiologie des
représentations » à vocation d’expliquer « la contagion des idées » (1996). Cette discipline
évoque, précise Y. Jeanneret, des travaux antérieurs menés par Gabriel Tarde qui voit la
société comme « autant plus avancée […] que la mode agit le plus rapidement possible avec
comme vitesse maximum et en même temps idéale celle du cerveau individuel. L’humanité
aura touché le bord extrême de son histoire quand elle pensera aussi rapidement qu’un
60
« L’informatique communicante se présenterait alors comme l’infrastructure technique du cerveau collectif ou de l’hypercortex […] La finalité dernière [l’intelligence collective] est de mettre autant que faire se peut le gouvernement de la grande machine ontologique et noétique entre les mains de l’espèce humaine constituée en « hypercortex » » op.cit. 61
DORTIER Jean-François, Des fourmis à Internet. Le mythe de l’intelligence collective, in Sciences Humaines, n° 169 / Mars 2006. 62
Interview Damien Philippon. 63
JEANNERET Yves, Penser la trivialité, volume 1, 2009.
cerveau individuel »64
Yves Jeanneret continue : « Les médiations (matérielles, sociales,
symboliques) sont en effet pour Tarde des facteurs de viscosité qui font obstacle à la
propagation des idées d’individu à individu, processus auquel il réduit l’activité ». Nous
pouvons donc considérer la volonté actuelle de connexion directe de cerveau à cerveau
comme une exacerbation de la pensée Tardienne culminée, avec une espérance considérable
portée sur les TIC, dont il est attendu un perfectionnement technique tel qu’elles pourraient
s’effacer en tant que média pour ne laisser que le lien communicationnel « pur » entre les
individus65
.
Conclusion de l’hypothèse I
Nous avons commencé notre développement par l’analyse des résultats de notre
questionnaire de prospection ainsi que de notre observation participante menée sur le site de
questions-réponses Quora. Ces résultats ont démontré l’existence de deux catégories
d’usagers, l’une largement majoritaire : les « lecteurs » et l’autre très minoritaire : les
« producteurs ». Les motivations derrière l’engagement des utilisateurs varient selon leur
appartenance à l’une ou à l’autre catégorie en plus d’autres critères comme le relationnel
(nombre de connexions) et l’image de soi (efficacité personnelle et concept du soi). Les
théories tentant d’expliquer la contribution par le besoin sont sujettes à des critiques
sérieuses, à cause du caractère instrumentalisant et naturalisant (transformation en
« besoin ») de phénomènes sociaux qui demeurent sujet à débat. Cette critique est
particulièrement virulente envers la théorie dite des Uses & Gratifications.
Les déclarations des internautes sondés donnent comme principales motivations derrière
leur utilisation des sites de questions-réponses, la rapidité et la gratuité d’accès à
l’information recherchée ainsi que les découvertes hasardeuses faites au cours des
navigations (sérendipité). Cependant, les internautes ne considèrent pas les plateformes
d’échanges numériques comme une source d’informations incontestablement fiables
puisqu’ils déclarent utiliser les informations qui y sont recueillies en complément aux avis
des experts. La réciprocité anticipée constitue le motif de participation principal chez la
population des producteurs de contenu suivi de la volonté d’apprentissage en interaction avec
les autres et enfin la rectification des informations jugées erronées.
64
Dominique Reynié (1989, p.15) 65
C’est ainsi que Jeanneret évoque une « réduction du réel assimilant l’échange communicationnel à la seule idée de connexion. »
Nous n’avons pas pu déceler, dans notre observation participante, d’indices sur le
militantisme des participants au vu du nombre insignifiant de sujets à portée politique,
investis par les utilisateurs –même les plus actifs- en comparaison avec le nombre de sujets
global. Il nous est donc impossible de confirmer l’hypothèse de l’engagement militant
derrière la contribution des internautes sur les sites de questions-réponses. D’autre part, bien
que nous ayons noté un désintérêt manifeste pour le gain de crédits chez la population
étudiée durant l’observation participante, différents éléments pouvant signifier l’émergence
d’une économie basée sur le don, sont perceptibles dans les usages des internautes, à savoir :
des donations régulières de points crédits à des personnes qui en ont besoin, des apports à
très forte valeur ajoutée à destination de « demandeurs » n’ayant aucun lien d’amitié ou
d’affinité avec les « résolveurs » et surtout, la récurrence de sujets postés par des utilisateurs
anonymes et bénéficiant également des réponses d’autres utilisateurs. Notre utilisation
personnelle du système de crédits nous a bien démontré l’utilité de cette fonction puisque
nous avons reçu davantage de réponses aux questions posées, par ce moyen.
Dans ce type d’échange que nous pourrons qualifier de système émergent, le
relationnel joue un rôle prépondérant. Le degré de contribution des producteur-
consommateurs de l’information dépend effectivement de la perception –positive- qu’ils
peuvent avoir des contacts avec qui ils interagissent via le média utilisé. La médiatisation de
soi par l’individu relationnel, en créant de nouveaux territoires à étudier (quantité
considérable de contenu produit), a suscité un certain enthousiasme autour de concepts tel
que l’intelligence collective médiée par ordinateur. Cette intelligence collective se présente
sous forme de projet anthropologique dont le but principal est de mettre en valeur l’individu
relationnel et d’optimiser ses compétences. Bien que cet imaginaire soit largement popularisé
et partagé par l’opinion publique, il s’inscrit dans une vision où le média est considéré
comme invisible (ou en cours de disparition) pour ne laisser de l’acte communicationnel que
la connexion. De cette vision est produit un discours promotionnel vis-à-vis des technologies
de l’information, mettant en valeur un imaginaire de la réticularité où les cerveaux seraient –
deviendraient- connectés entre eux à la manière du réseau des réseaux. Par conséquent, ces
éléments nous poussent à considérer davantage l’hypothèse supposant les discours
promotionnels comme facteur de motivation derrière la contribution en ligne. Mais avant
d’entamer le développement de cette troisième partie, nous allons nous attarder sur la
dimension économique en traitant notre seconde hypothèse questionnant les usages
numériques à visée professionnelle.
II. La contribution comme caractéristique d’un contexte
économique
Comme nous l’avons mentionné plus haut, différents travaux de recherche ont tenté
d’expliquer les motivations derrière l’engagement des internautes dans les espaces
collaboratifs, d’un point de vue sociotechnique. Nous pouvons citer, en ce qui concerne le
cas précis des sites de questions-réponses, l’approche de Rosenbaum et Schachaf66
qui se
basent sur la théorie de structuration (Giddens, 1979, 1984; Orlikowski, 1992, 2000) pour
étudier les interactions dans les communautés en ligne, comme étant des phénomènes
constituant d’une dynamique sociale67
. L’hypothèse traitée dans cette seconde partie,
s’approche plus des développements basés sur des arguments économiques comme c’est le
cas pour les travaux de Rafaeli, Raban et Ravid68
concernant les facteurs de motivation des
utilisateurs de la plateforme Google Answers. Les résultats de cette étude ont mis en
évidence le caractère économique de la contribution69
ainsi que les efforts employés, de
manière sous-jacente, par les grandes entreprises de l’informatique pour maintenir un certain
degré d’engagement chez la population connectée. Notre présupposé diffère toutefois en ce
qui concerne la nature de la récompense économique recherchée par l’utilisateur des sites de
questions-réponses. Ici, il sera davantage question de capitalisation des expériences et des
compétences, dans l’objectif d’acquérir des opportunités de travail, plutôt que la recherche
de rémunération immédiate.
1. La production de contenu numérique et la constitution
d’un projet professionnel
La question principale développée dans cette partie est le lien éventuel entre la
production de contenu sur les sites de questions-réponses et le développement d’un projet
professionnel. Pour aborder cette question, le travail mené par Michaël Vicente70
sur la
communauté des développeurs du logiciel libre, nous permet d’avoir un premier aperçu sur la
66
ROSENBAUM, H., & SHACHAF, P. (2010). A structuration approach to online communities of practice: The case of Q&A communities. Journal of the American Society of Information Science and Technology, 61 (9), 1933 ‐ 1944. 67
“In this article, we arguethat an approach based on structuration theory (Giddens, 1979, 1984) emphasizing the duality of technology (Orlikowski, 1992, 2000) and Wenger’s (1998) concept of communities of practice can be used as a framework to guide investigation into the dynamics of online Q&A communities.” 68
RAFAELI, S., RABAN, D.R. and RAVID, G. (2007) 'How social motivation enhances economic activity and incentives in the Google Answers knowledge sharing market', International Journal of Knowledge and Learning ( IJKL ), Vol. 3, No. 69
“The participation of experts in GA is associated with a hybrid of material (economic) and social motivators.” 70
VICENTE, Michaël, Logiciels libres et réseaux sociaux de compétences [thèse], 2008, Université Technique de Compiègne.
nature de ce lien. Comme le précise l’auteur, « la plupart des produits singuliers (les grands
vins, les conseils d’un avocat ou la psychanalyse) comportent une grande incertitude quant à
leur signification, leur qualité et leur dimension Il en est de même lorsque l’on fait appel à un
développeur ». Le contenu publié sur les sites de questions-réponses est de même essence : il
s’agit de conseils-informations données par des utilisateurs à d’autres utilisateurs dans des
domaines d’expertise variés et dont la signification et la qualité échappent à leur
consommateur. Par conséquent, les résultats de cette recherche menée par M. Vicente sont
intéressants à mettre en perspective, parallèlement à notre propre enquête sur le terrain.
a. E-réputation et les communautés en ligne : les développeurs open source comme
modèle
Le terme « E-réputation » (ou « réputation numérique ») est communément utilisé
pour désigner l’ensemble des traces laissées par l’internaute durant sa navigation sur le web
(interactions sur les réseaux sociaux, photos et messages postés, forums visités etc.) et plus
particulièrement, les actions consciemment menés par l’individu afin de maitriser son
« identité » sur le web71
. Les motifs de cette volonté de contrôle des contenus portant sur
l’identité d’un individu, sont principalement professionnels. En effet, la généralisation
d’internet dans les entreprises d’un côté, et l’utilisation massive des réseaux sociaux et
d’autres outils dits « web 2.0 » de l’autre, ont vu naître de nouvelles pratiques de recrutement
chez les responsables RH72
. Une communauté d’internautes a été particulièrement avant-
gardiste dans son utilisation de la réputation numérique dans un objectif carriériste : il s’agit
de la communauté des développeurs.
Divers économistes ont formulé des hypothèses selon lesquelles les motivations
derrière l’engagement des développeurs dans la création de logiciels libres, seraient d’ordre
carriériste (career concerns)73
. Leurs productions font alors preuve de compétence (signaling
skills), dans une perspective de recrutement par les entreprises. Le logiciel libre se situerait
alors à la frontière de deux mondes qui s’auto-ajustent : le monde de la gratuité et du travail
71
Les offres commerciales qui promettent un contrôle de son identité numérique foisonnent depuis une demi-dizaine d’années : http://caddereputation.over-blog.com/article-petit-historique-de-l-e-reputation-117114034.html 72
Faisons mention, notamment, de la pratique qui consiste à taper systématiquement le nom d’un candidat sur les moteurs de recherche en plus de la consultation de son CV. 73
LERNER Josh & TIROLE Jean, The Economics of Technology Sharing: Open Source and Beyond, Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 2—Spring 2005—Pages 99 –120
bénévole d’un côté, et celui du salariat et de l’entreprise de l’autre74
. Cet ajustement se
manifesterait du côté des développeurs, par la réalisation d’une « trajectoire de
professionnalisation » (VICENTE, 2008) depuis une activité bénévole vers une activité
rémunérée. Ce glissement s’effectue par un engagement bénévole de la part du développeur
dans des communautés en ligne œuvrant pour la création de logiciels libres. Du côté des
entreprises, cet engagement résout un problème spécifique à la main d’œuvre dite cognitive -
professions mettant à disposition un effort intellectuel de création contre rémunération- à
savoir les indéterminations qui entourent la délivrance de la prestation demandée ainsi que la
vérification de sa validité. En effet, le développeur peut « promettre à une entreprise de
résoudre certains problèmes techniques particuliers sans que le client soit a priori certain de
l’identité et des compétences du développeur qui les résoudra et donc, par là même, s’ils
seront réellement solutionnés ou non. ». Afin de lever ces indéterminations, des ‘dispositifs de
confiance’ et ‘des dispositifs de jugement’ (Karpik, 2007) ont été mis en place par
l’élaboration d’espaces collaboratifs de plus en plus performants, à l’adresse de producteurs
de contenu qualifié (dans ce cas précis, les développeurs). L’objectif de ces dispositifs est de
réduire les incertitudes liées au « marché des singularités »75
en apportant à l’utilisateur de ces
dispositifs, les informations et les matériaux qui lui manquent et aux entreprises les éléments
de confiance lui permettant de faire de bons choix en matière d’utilisation du contenu produit
et de recrutement de la main d’œuvre qualifiée.
C’est dans cet environnement que les développeurs, en participant activement à
l’élaboration de produits Open source, construisent un ‘capital réputation’ qui détermine leur
employabilité sur le marché. Dans l’enquête menée par M.Vicente, cette approche est
manifestement dominante au sein des géants du web, dont la politique de recrutement se base
quasi-entièrement sur la réputation :
« Ici, chez Google, on a un système d’entretiens particulier, tu as d’abord un entretien
classique avec les RH, mais après, il y a encore un entretien sur ce que tu as réellement fait,
qui est plus technique, basé sur le code, et là on voit la réputation, c’est très clair.’ ENT47 »
Il existe cependant, selon les conclusions de cette étude, une résistance à
l’instrumentalisation d’un tel dispositif de recrutement. Vicente conclut que même si le
74
DEMAZIRES Didier, HORN François, ZUNE Marc, Les développeurs de logiciels libres: militants, bénévoles ou professionnels? In Demaziere, D. Et Gadea, C., Sociologie Des Groupes Professionnels, Paris, La Découverte, 2009 75
KARPIK Lucien, «L’économie des singularités», é2007, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, Paris
logiciel libre a crée un marché de ressources intellectuelles hautement qualifié, dont les
compétences sont particulièrement appréciées par les entreprises, il ne peut s’agir, de manière
formelle, d’un vivier de compétences où les recruteurs peuvent se servir de façon régulière et
pérenne. L’auteur désigne alors un ‘dispositif d’appariement’ plutôt qu’un marché des
compétences. Dans un tel environnement, il est encore possible d’observer des utilisations qui
vont « dans le sens d’une méritocratie, valeur défendue par les communautés du libre. »
Cette résistance peut se ressentir, par ailleurs, dans les chiffres concernant la
participation des internautes dans les espaces collaboratifs. Notre enquête préliminaire auprès
d’utilisateurs du web nous démontre un faible intérêt –du moins déclaré- pour le gain d’un
capital-réputation. En effet, à la question « Pourquoi participez-vous aux sujets postés sur les
espaces d’échanges numériques ? » seulement 16% de l’échantillon a répondu « parce ce que
c’est formateur en matière d’application de votre expertise et de vos compétences ». Il s’agit
ici d’une appréciation globale exprimée par une population plutôt réticente à la production de
contenu dans l’ensemble. En revanche, la donne change radicalement lorsque l’on pose la
même question aux « résolveurs » de Quora : 5 utilisateurs sur 8 déclarent répondre aux
questions des internautes car cela leur permet de mettre en valeur leurs compétences et leur
expertise. Et cette opinion se manifeste de manière plutôt concrète dans le choix des
thématiques et des sujets abordés, comme nous le démontrent l’analyse sémiotique des
discours recueillis durant notre observation participante.
b. Le cas des « résolveurs » de Quora
Nous avons relevé plusieurs cas d’usage où l’utilisateur fait directement mention de
son activité professionnelle voire justifie sa réponse par cette dernière. Mettre en évidence le
lien entre la profession et la participation de l’utilisateur n’a pas été très difficile dans la
mesure où la majorité de notre échantillon met le titre de sa profession (ou du moins, son
domaine d’expertise) en visibilité sur son profil. Nous avons également noté que l’expertise
de l’utilisateur joue considérablement sur le nombre de réactions –positives- que celui-ci peut
avoir quand il participe à un sujet qui relève de son domaine de compétences. Cette donne est
particulièrement intéressante car la recherche de rétroactions figure parmi les facteurs de
motivations les plus mentionnés par les utilisateurs, comme l’ont démontré des travaux
antérieurs (Rafaeli, Raban & Ravid, 2007)76
tout autant que notre enquête qualitative auprès
de la population de Quora. En effet, l’une des réponses recueillies auprès de l’échantillon
76
Op.cit. Pour la communauté de Google Answers, il s’agit du facteur de motivation avec l a rémunération (both economical and social incentives)
observé, concernant les motivations derrière la participation, fait mention des rétroactions
comme facteur principal d’engagement :
“The positive response you get (e.g. upvotes, positive comments) are a great incentive to
consistently contribute more content.” Utilisateur 7
A partir de ces données, nous considérons que plus l’utilisateur a une expertise
développée dans un domaine, plus il reçoit de récompense sociale de la part des autres
utilisations (votes positifs, commentaires etc.) ce qui l’incite à participer encore davantage.
Cela donne une disposition des usagers similaire à celle que l’on retrouve dans d’autres
espaces collaboratifs, notamment les forums de discussions (Cardon, 2007) avec à la tête de la
pyramide un noyau restreint de contributeurs très actifs que certains auteurs appellent
‘innovateurs’77
, porté par une ‘nébuleuse des contributeurs’ qui constitue la base de la
population usagère et qui indexe massivement le contenu, engageant encore davantage les
innovateurs. S’ajoute à ces deux types d’utilisateurs un ‘cercle des réformateurs’ qui vont
apporter de nouveaux usages qui n’étaient pas prévus auparavant.
Les utilisateurs spécialisés dans un domaine d’expertise ont donc des profils très
similaires en termes de relationnel, d’utilisation des fonctions du site, de fréquence de
participation et d’engagement en matière d’indexation du contenu. Nous avons noté que 50%
de ces utilisateurs sont de type Leader : ils ont davantage d’abonnés qu’ils ne sont eux-
mêmes abonnés aux flux des autres. 35% sont des semi-réguliers (utilisateurs avec peu de
connexions dans les deux sens) et 15% seulement sont de type Veilleur (abonnés à un nombre
considérables de profils). Nous faisons de ces chiffres, deux déductions : la première est que
les utilisateurs dits ‘spécialistes’ ont une audience plus large que les utilisateurs classiques. La
seconde déduction concerne la motivation de ces utilisateurs : en ne suivant qu’un nombre
restreint de personnes, ces profils démontrent un souci de ciblage de l’information. Il ne s’agit
pas de suivre un maximum d’utilisateurs pour recevoir toutes les données mais bien d’être
notifié des informations à valeur ajoutée uniquement.
Dans les messages postés par ces utilisateurs, différentes dénotations nous permettent
d’envisager l’hypothèse de la démonstration des compétences :
77
L’intelligence collective, dossier Sciences humaines, n° 169, Mars 2006
“Here are a few grab-bag suggestions:
Practice as much English as you can in chunks, rather than word by word. Try to
forget words exist.
Practice reading quickly. Take a magazine or a newspaper or other printed
material, but focus on accuracy at first and then speed it up. If you focus on speed right away,
it'll probably just slow you down. Make it like a little game.
Practice dialogues, casual and technical, fast and slow, by yourself and with a
partner, in order and out of order (that is, in response to random cues).
In other words: practice, practice, practice.” Utilisateur 178
La thématique dans laquelle cette discussion a eu lieu est celle de la linguistique, le ton
de la réponse est pédagogique et la posture didactique. Des éléments connotatifs comme
l’usage de l’impératif suggèrent une certaine autorité. Les motivations potentielles de cette
contribution pourraient a priori s’apparenter à une forme d’altruisme et de partage
d’expérience. Il convient toutefois d’ajouter que l’utilisateur en question, mentionne à
plusieurs occasions sa profession, à savoir professeur d’anglais, en plus de la description du
profil-utilisateur, se présentant comme un « freelance nerd ». Nous pouvons donc déduire à
partir de ces deux informations qu’il s’agit de (1) un enseignant d’anglais (2) dans le secteur
privé (indépendant) (3) donnant des conseils sur son domaine d’expertise (langue anglaise)
(4) dans un espace collaboratif public. Ces éléments réunis renforcent considérablement la
thèse de la publicité indirecte des compétences bien que la réponse en question n’ait pas
suscité une indexation importante (seulement 3 votes positifs), ce qui réduit la portée
publicitaire de cette démonstration de compétences sur le site.
Un exemple plus parlant est celui de l’utilisateur 17, un résolveur et indexeur
régulier, dont la présentation de soi sur le site met en évidence une volonté manifeste de
visibilité professionnelle. En effet, l’utilisateur en question se présente par sa profession
(médecin-chirurgien retraité79
) et le nom de l’entreprise de cosmétique qu’il gère : « MD,
Nom Entreprise by Dr. User - see www.Nom-Entreprise.com »80
. Son engagement sur le site
est très intéressant à étudier car il s’agit d’une participation particulièrement méthodique et
stable. Les réponses aux questions posées suivent un rythme régulier (messages postés à des
heures plus ou moins fixes, récurrence quasi statique) et l’utilisateur ne pose quasiment jamais
78
En réponse à la question : « Quel est le moyen le plus rapide d’apprendre à parler anglais ? » 79
“ATA - Sorry, I am retired. But as a board certified Ob/Gyn, I did all the surgeries involved. I specialized in laparoscopic surgery. I also did cosmetic procedures on a limited basis.” Réponse de l’intéressé à une question d’ordre médical. 80
Le nom de l’utilisateur ainsi que sa structure ont été changés»
de questions (3 questions posées depuis son inscription, contre 485 réponses et 1080 éditions
de commentaires). Les sujets abordés sont uniquement liés au domaine médical ce qui tends à
démontrer une stratégie de ciblage de potentiels consommateurs. Bien qu’il ne soit pas
directement fait mention dans les réponses de l’utilisateur, des services proposés par son
entreprise, les réponses données aux questionnements des internautes sont suffisamment
indexés (entre 10 et 25 votes positives et 1 à 3 commentaires en moyenne) pour permettre une
certaine visibilité du profil (et par conséquent du site commercial qui y est présenté) aux
potentiels demandeurs de prestation médicale.
La mention de la profession dans un objectif publicitaire n’apparait pas uniquement
dans les profils de Leaders. Nous avons effectivement noté deux exceptions dans notre
échantillon. La première concerne l’utilisateur 16, un Super veiller et super indexeur, ne
participant que rarement (participant occasionnel) mais suivant un nombre très important de
personnes et votant/partageant quotidiennement le contenu des autres. L’utilisateur en
question a mis dans la présentation de son profil, la description suivante :
“Currently open to opportunities in Music, especially Singing for Weddings and
Funerals and other occasions too.”
De par le statut de sa profession (intermittent du spectacle), l’utilisateur a choisi une
tactique carriériste différente de celle observée chez les utilisateurs de professions
intellectuelles supérieures. En effet, comme il s’agit dans ce cas de compétences qui ne
peuvent être démontrées dans le ‘dispositif de jugement’, l’usager s’est lancé dans une course
d’acquisition de contacts dans l’objectif de constituer un réseau (2874 abonnés et 7389
abonnements) potentiellement activable pour la recherche de nouvelles opportunités
professionnelles. D’autres utilisateurs ont choisi de faire de la plateforme un canal de
diffusion des publications marketing relatives à leur entreprise. C’est précisément le cas de
l’utilisateur 3 de notre échantillon, un semi-régulier (peu de connexions) participant et
indexeur occasionnel (très peu d’interactions), ayant comme description de profil :
« Nom-de-l’entreprise.com co-founder »
Il s’agit donc, au même titre que l’utilisateur 17 précédemment étudié, d’une publicité
directe des compétences, encore plus renforcée par la publication semi-régulière de contenu
marketing relatif à l’entreprise publicisée :
« Le Guide Ultime de Pinterest pour votre Site Ecommerce »81
Chacun des messages publiés est suivi d’un récapitulatif et d’un lien vers l’article
complet. Il s’agit cependant de publications isolées ne bénéficiant quasiment d’aucune
visibilité (1 vote positif en moyenne). Ces cas d’usage nous démontrent cependant, l’existence
de facteurs exclusivement économiques derrière l’utilisation des sites de questions-réponses.
2. Les enjeux professionnels sur les sites de questions-réponses
Mais ce constat reste à modérer au vu de l’autre partie de l’échantillon étudié (60% des
utilisateurs) qui n’affiche pas une stratégie publicitaire aussi directe. Nous allons dans cette
partie aborder le cas des professionnels-amateurs, qui partagent opinions et expertises sur le
réseau, parfois en défiance aux discours des experts.
a. Des pro-ams et des experts
La figure du professionnel-amateur (souvent réduit en pro-am) a été largement
popularisée dans les années 2000, notamment grâce aux travaux de recherche portant sur les
pratiques amateurs exprimées sur le web82
. Ce concept socioéconomique désigne les
individus passionnés par un sujet/hobby/pratique et qui, par un travail de recherche important,
arrive à produire des informations à forte valeur-ajoutée pouvant, dans certains cas, rivaliser
avec l’expertise des professionnels.
L’une des caractéristiques avancées par divers auteurs (BERAUD & CORMERAIS, 2011,
FLICHY 2010) est le présupposé désintéressement de l’amateur par rapport au professionnel :
« L’amateur désintéressé et le tiers secteur de l’économie de la contribution s’inscrivent dans
une démarche favorisant le principe d’un développement durable. » Cette définition nous
place donc devant un autre type de motivations, à distinguer de la stratégie carriériste étudiée
antérieurement. Cela ne signifie pas cependant que la démarche des professionnels-amateurs
est dénuée de tout intérêt économique.
Pour que l’amateur-professionnel soit un agent déterminant dans la subsistance d’une
économie de la contribution –usant à cet effet des technologies relationnelles- il faut que les
facteurs de motivation qui l’animent, soient d’une solidité et d’une pérennité au moins aussi
sérieuses que celles qui ont jusqu’ici poussé le professionnel à agir en tant qu’acteur de
l’économie industrielle. Sur ce rapport entre les motivations des individus et le maintien des
81
Titre de la publication postée dans la rubrique E-commerce. 82
FLICHY Patrice, Le sacre de l’amateur : Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique, Seuil, 2010.
systèmes économiques, Yann Moulier-Boutang élabore un concept intéressant qui réutilise
certains éléments de la psychologie ainsi que de l’épistémologie, avec des emprunts
linguistiques remontant aux travaux de Saint Augustin d’Hippone.
Moulier-Boutang développe effectivement le concept de libido sciendi (désir de savoir) dans
son questionnement sur la contribution des individus à titre amateur83
. Selon l’économiste, le
capitalisme industriel a pu se développer en exploitant deux passions humaines : la libido
sentiendi (désir de jouissances matérielles) et la libido dominandi (désir d’exercer un pouvoir
sur autrui)84
, nous assisterions aujourd’hui à l’utilisation d’une troisième passion comme
facteur d’incitation à la production d’informations à valeur-ajoutée. Le désir ‘prométhéen’ de
comprendre et de contrôler le complexe, serait donc derrière l’engagement des individus dans
cette entreprise de production de contenu spécialisé. Le professionnel-amateur est considéré,
de ce point de vue, comme le producteur d’externalités positives très recherchées par
l’entreprise, à savoir un « travail gratuit incorporable dans des nouveaux dispositifs de
captation et de mise en forme. ». Comme nous l’avons déjà mentionné, les déclarations des
internautes allant dans le sens du désir d’apprentissage sont majoritaires que ce soit chez les
lecteurs ou les producteurs de contenu. Au niveau des pratiques, plusieurs profils ont retenu
notre attention par la revendication manifeste d’un statut de professionnel-amateur sur la
description des profils :
“Atheist, Medievalist, Sceptic and amateur Historian”
Phrase de présentation de l’utilisateur 19
“Shakespearean director, computer programmer, teacher, writer, likes dinosaurs”
Phrase de présentation de l’utilisateur 6
Ces utilisateurs font montre d’une grande précision dans la rédaction de leur contenu
et respectent une méthodologie scientifique traduisant un niveau d’éducation élevé. Nous
83
« Si l’activité productive devient essentiellement « la coopération des cerveaux reliés en réseau par des ordinateurs et l’internet », qu’est ce qui motive les cerveaux humains interagissant entre eux ? Certes, l’intérêt économique et la passion dominatrice continuent à guider l’action humaine aussi bien dans la société et dans l’entreprise, mais ces motifs sont tout à fait insuffisants pour expliquer comment les chercheurs travaillent à des découvertes, pourquoi des artistes travaillent dans le spectacle vivant, pourquoi des développeurs de logiciels libres travaillent des heures durant sur des ordinateurs, à n’importe quel moment du jour et de la nuit. » 84
« Si l’on classe les incitations directes et indirectes auxquelles le capitalisme industriel a eu recours de façon dominante dans son histoire, on peut dire qu’elles relèvent de deux types de satisfaction des passions humaines : la libido sentiendi (entendu au sens restreint du désir de jouir au maximum de biens matériels en tant que consommateur ou homo oeconomicus maximisant son utilisé) et la libido dominandi (ou désir de dominer autrui, d’exercer un pouvoir sur autrui). Le paternalisme relève très évidemment de cette dernière passion. Il motive en effet l’encadrement tout autant que l’incitation matérielle. Il renforce dans le salariat, l’autorité du patron auprès de ses subordonnées qui accepteront qu’une règle extra-économique, un pouvoir analogue à celui du pater familias, ou du père de la patrie, puisse prévaloir sur des considérations matérielles. »
avons notamment pu analyser une réponse intéressante de la part d’un utilisateur, concernant
la rédaction de contenu et l’implication des réponses sur Quora :
“Writing answers is difficult. Upvoting answers? That's relatively easy. It's like a multiple choice quiz.
You just try to choose the answer that is the least wrong.
But writing answers? I've always had trouble with that. The problem doesn't come from knowing the
answer. […]. The problem comes from trying to figure out how to present that answer. […]
My usual approach is to try to keep technical jargon, buzzwords, and pointless dates and decimals out
of my writing. Maybe it’s all a fool’s errand, in the end, but my point is that if my answers sound
casual and unsophisticated, that’s deliberate. I’d always assumed that stripping off the razzle dazzle
would be a good thing.
The reason I’m writing this is that I’ve recently noticed that the few times I’ve screwed up and left the
technical jargon in through the editing process, it seems like my answers were consequently upvoted
more highly. A recent example of this is my answer [last answer] I’m really surprised my answer has
gotten as popular as it has when, in my opinion, I’ve written many better answers on the question of
English usage and grammar.”
L’utilisateur insiste sur l’effort employé pour produire un contenu qui sera lu et compris par le
plus grand nombre. Ceci nous renseigne, de deux manières, sur les motivations derrière la
participation: 1) Le contributeur confirme explicitement la visée de sa participation qui est
d’avoir un retour positif et quantitativement important (nombre de votes), 2) il s’agit d’un
souci de vulgarisation scientifique qui relève d’une méthode académique (approche top-down)
et non pas d’une contribution de ‘bas-en-haut’ ou de contre-expertise (FLICHY, 2010)
comme cela a été décrit dans la littérature.
Dans certains cas courants sur le site, les réponses données aux questions sont d’un degré de
complexité qui implique un grand intérêt et une connaissance approfondi du sujet que ce soit
de la part du « demandeur » qui souhaite avoir des avis sur une question précise, ou du
« résolveur » qui doit faire preuve d’argumentation solide afin que sa réponse soit créditée par
la communauté :
“The idea that "history is written by the winners" is a clichéd truism that isn't actually very true.
History is actually written by academics trained in a careful scholarly method and working within a
system of peer review, both of which serve to discard unlikely or obviously biased interpretations. It
works toward an argument to the best explanation - ie one that explains as much of the evidence as
possible and which is agreed is the most likely version of what happened in the past[…].”85
Cette réponse (ici extrait seulement) comporte des éléments d’explication sur la méthode
historique (heuristique, criticisme, synthèse et exposition) qui relève d’un académisme
manifeste. Comme l’indexation de ce contenu est exceptionnellement élevé (105 votes
positifs) par rapport à la moyenne des votes reçues par l’utilisateur sur l’ensemble de ces
85
Réponse à la question « Comment sait-on que l’histoire est réelle ? »
participations, nous déduisons que la légitimité des professionnels-amateurs est
intrinsèquement liée à la scientificité de leur méthode. Les réponses dont l’argumentaire est
jugé léger descendent vite au fond des messages non-consultés, par un système de votes
négatifs (downvotes) tandis que les réponses les mieux argumentées bénéficient d’une
visibilité importante grâce à une indexation massive.
Comme nous l’avons vu, les utilisateurs recevant le plus de rétroactions sont par effet de
récompense, les plus actifs dans la communauté. Ici en l’occurrence, il s’agit de profils
hautement qualifiés qui correspondent par ailleurs, au modèle mis en avant par les
fondateurs de Quora86
. Cela nous amène à considérer la thèse du dispositif d’appariement en
ce qui concerne les professions intellectuelles supérieures.
b. Quora serait-il un réseau professionnel de niche ?
Au vu des pratiques de démonstration des compétences, de publicité directe de son
commerce via les hyperliens et des différentes qualifications des expertises –assimilable à de
la recommandation- nous sommes en mesure de se demander si Quora ne constitue pas un
réseau professionnel destiné à un certain type de profils (intermittents du spectacle,
professions artistiques, activités libérales et professions intellectuelles supérieures). Bien que
le site ne soit pas présenté, par ces fondateurs, comme un outil de mise en relation entre
internautes (encore moins entre contacts professionnels) l’étude des pratiques courantes sur la
plateforme nous mène à penser que nous sommes devant un usage-double : d’un côté le
partage des connaissances, qui constitue le slogan porté par les fondateurs, et de l’autre, la
médiatisation de soi par les utilisateurs, souvent dans un but d’ordre économique.
Les réseaux sociaux dits de niche, sont des plateformes permettant de mettre en contact,
sous forme de réseau social numérique (SNS), des utilisateurs qui ont en commun, un centre
d’intérêt ou un sujet de prédilection précis. Ces réseaux se distinguent des médias sociaux
classiques de deux manières :
- La population définit l’usage : dans les réseaux sociaux de niche, ce n’est pas le besoin
qui définit l’utilisation du site (exemple : l’image définit l’utilisation du réseau
Pinterest où l’on partage et l’on qualifie des images) mais plutôt les affinités des
86
“In fact, there is no viral coefficient or easily reproducible answer here. The key is simply the DNA of the site. Unlike Yahoo Answers which emphasized quantity or Diggers that incentivized individual ego, Quora has always focused everything about its community, product, and business around finding the best possible answer for a question.” http://pandodaily.com/2012/04/23/quora-co-founders-share-numbers-the-secret-of-surviving-the-hype-cycle/
utilisateurs réunis dans le réseau. Ce sont donc les utilisateurs qui donnent au réseau
son identité : systèmes de valeurs/affects/passions/types d’usages.
- Les motivations sont plus précises : contrairement aux réseaux sociaux généralistes,
les motivations déclarées par les utilisateurs des réseaux sociaux de niches sont plus
précises : il s’agit d’échanger autour d’un sujet donné. Souvent, les slogans de ces
réseaux annoncent la couleur en dissipant toute ambiguïté87
Les fonctionnalités de ces réseaux spécialisés sont souvent réalisées dans un souci de
pertinence du contenu et en cela, ils ressemblent beaucoup aux forums de discussion. En effet,
nous pouvons considérer les médias sociaux de niche comme étant une hybridation entre
réseaux sociaux et les forums de discussion spécialisés. Cette définition nous ramène à notre
objet d’analyse : si Quora est effectivement un réseau dont l’identité est très marqué par les
utilisateurs (forte dimension communautaire) et la forme des participations dans les sujets,
ressemblent beaucoup aux forums de discussions spécialisés, il reste que le site embrasse une
multitude de sujets et de centre d’intérêts généralistes, qui ne peuvent pas rentrer dans une
seule catégorie de spécialisation. Quora s’apparenterait donc plus à un réseau social
numérique avec une particularité que l’on pourrait qualifier de forum-centrique. En effet,
comme il s’agit d’un système permettant de connecter directement les utilisateurs (suivi de
flux, messages privés, accès aux connexions des autres etc.) et dans lequel l’utilisation de son
nom civil est obligatoire88
, nous ne pouvons considérer Quora comme un forum de
discussions globaliste (couvrant différents domaines). D’autre part, la multitude des sujets
traités, l’accès aux discussions ouvert sans obligation de connexion avec les producteurs de
contenu89
ainsi que la dimension forum-centric (l’ensemble des interactions se passent dans le
cadre d’une discussion de type question-réponse similaire, dans la forme, aux topics des
forums de discussions) sont autant d’éléments qui singularisent le site Quora et le rends
difficilement classable dans la catégorie des médias sociaux de niche.
87
Cf. Digikaa, réseau dédié aux professionnels du digital, dont le slogan : « le réseau des talents du web et du mobile » est clairement mis en avant sur la page d’accueil. 88
Contrairement aux forums de discussion où l’utilisateur se contente d’un pseudonyme. http://www.quora.com/Real-Names-Policy-on-Quora 89
Comme c’est le cas sur Facebook par exemple, où on doit avoir un utilisateur en « ami » pour pouvoir consulter son contenu.
Conclusion de l’hypothèse II
Nous avons traité dans cette seconde partie, le rapport entre l’engagement des
internautes dans les sites de questions-réponses et la constitution d’un projet professionnel.
L’analyse des travaux précédents, portés essentiellement sur la communauté des développeurs
du logiciel libre, nous ont démontré l’existence de motivations de type carriériste (career
concern) ainsi que l’émergence de nouveaux dispositifs dits de « confiance » que les grandes
entreprises utilisent comme des dispositifs d’appariement pour recruter des profils hautement
qualifiés. Ce processus de passage d’un modèle de contribution (production gratuite de
contenu qualitatif) à un modèle salarial (production contre rémunération) a été décrit comme
étant une « trajectoire de professionnalisation » intrinsèque aux métiers dits « cognitifs »
nécessitant la validation des acquis et une forme de capitalisation des expériences.
Le cas des résolveurs de Quora nous a démontré l’existence de différentes formes de
valorisation de soi dans un objectif professionnel, allant de la stratégie commerciale (voir
personal branding) aux tactiques d’activation de réseau. La première étant l’apanage des
profils les plus qualifiés (médecin, avocats et autres professions intellectuelles supérieures)
tandis que la seconde forme de médiatisation est plus utilisée par des profils d’artistes et
d’intermittents du spectacle. La publicité des compétences ainsi que la publication de contenu
purement marketing sont des pratiques courantes mais ne bénéficient d’aucune visibilité au vu
des systèmes d’évaluation qui font remonter en priorité les contenus qualitatifs. Cela fait de
Quora un site difficilement exploitable dans une optique essentiellement basé sur le ROI, mais
constitue un excellent vivier pour les métiers nécessitant des compétences en vulgarisation
scientifique, en expertise spécialisée (santé, juridique, arts etc.) ainsi que
l’appréciation/évaluation de produits (particulièrement les produits culturels : cinéma,
musique, mode etc.). Les usagers de sites comme Quora, sont de ce fait, des amateurs-
professionnels très investis dans ce qu’ils produisent comme contenu comme nous l’avons
noté lors de notre analyse des réponses produites en réponse à des questions nécessitant des
connaissances approfondies et à un niveau de raisonnement complexe. Certaines publications
respectent d’ailleurs une méthode de développement très académique ce qui, d’une part,
confirme l’implication de sujets hautement qualifiés dans la production de contenu à titre
bénévole et infirme, d’autre part, les différentes théories spéculant sur la fin de l’expertise au
profit d’une forme moins de production de contenu, moins scientifique. Enfin, nous avons vu
en quoi Quora est une plateforme hybride, offrant à la fois la possibilité de constituer un
réseau de contacts comme c’est le cas sur les médias sociaux, mais également une liberté
d’accès aux contenus, similaires à celle que l’on trouve sur les forums de discussions. Ce
système dit ‘forum-centric’ combiné avec les fonctionnalités classiques des réseaux sociaux
(suivi d’utilisateurs, indexation du contenu) ne nous permettent pas cependant, de qualifier
Quora de média social de niche. En effet, la diversité des sujets traités ainsi que la prévalence
des questions-réponses sur les rapports inter-utilisateurs nous font plutôt penser à une
combinaison de deux types de médias : l’espace collaboratif et le réseau social.
Tous ces éléments nous permettent d’affirmer qu’il existe un facteur carriériste manifeste
derrière la contribution des internautes sur les sites de questions-réponses, bien que celui-ci ne
soit pas entièrement déterminant dans le choix de s’engager ou pas dans une communauté en
ligne. Si les internautes les plus actifs sont aussi ceux qui ont une certaine méthode, et par
conséquent, ceux qui gagnent le plus d’évaluations positives de la part de leurs pairs (grâce à
la pertinence de leurs participations), il en demeure pas moins que l’exigence d’une rigueur
académique dans les développements de ces producteurs de contenu, reflète un certain souci
d’exactitude scientifique qui n’est pas forcément lié –voire complètement antinomique- à la
recherche d’opportunités professionnelles ou d’un capital d’expérience à mettre en avant
auprès de futurs recruteurs.
III. La contribution comme rétroaction individuelle à un discours
promotionnel dominant
Dans cette dernière partie, nous allons nous pencher sur l’hypothèse qui explique les
phénomènes de contribution comme étant une réaction aux discours médiatiques dominants,
qui présentent les technologies numériques comme une innovation révolutionnaire susceptible
de nous faire changer de paradigme civilisationnel. L’engagement des internautes sur
différents types de plateformes, dont les sites de questions-réponses, serait donc une réponse à
cette promesse de la salvation par la technique : plus les individus sont exposés aux discours
promotionnels des TIC plus ils s’engagent dans ces dispositifs médiatiques, créant ainsi de
nouvelles arrivées sur la toile qui serviront d’argument –par les chiffres- pour renforcer ces
discours. Nous pouvons appeler ce système à rétroactions positives (amplification par le
discours) une prophétie auto-réalisatrice.
Aussi appelé « effet Pygmalion », « effet Rosenthal & Jacobson » ou encore
« prédiction créatrice », le concept de prophétie auto-réalisatrice a été théorisé pour la
première fois par Robert K .Merton dans Social Theory et Social Structure en 194990
. Il
définit dans son chapitre ce qu’il baptise « théorème de Thomas91
» à savoir une description «
au début fausse de la situation qui provoque un comportement qui fait que cette définition
initialement fausse devient vraie ». Ce théorème a été par ailleurs, vérifié sur le terrain,
notamment par Jane Elliot ainsi que Rosenthal & Jacobson92
.
1. La promesse comme facteur de motivation
Nous commençons cette troisième analyse par faire un état des lieux des discours
promotionnels qui seraient derrière l’engagement des individus dans les plateformes médias «
2.0 ». Pour ce, nous partons des discours les plus globaux –et qui bénéficient de la publicité
la plus importante- pour ensuite essayer de mesurer l’impact de ces ‘énonciations
engageantes’ sur le comportement des acteurs sociaux, comme cela pourrait transparaitre dans
leurs usages et leurs productions éditoriales.
a. Sur la société de l’information
Défini comme la conséquence d’une révolution technologique considérable
(l’invention du microprocesseur) par les uns93
, et comme un « lieu vide » par les autres94
, le
concept de « société de l’information » a été massivement médiatisé depuis les années 1990
comme une tentative descriptive de la société de l’après-guerre. Des « autoroutes de
l’information »95
à la « ville numérique », les différentes réplications plus ou moins
tautologiques de cette figure ont occupé l’espace médiatique de manière quasi-continue
depuis une quarantaine d’années, avec des périodes de résurgence, notamment avec l’arrivée
des réseaux sociaux et des outils collaboratifs que l’on désigne sous la dénomination « web
2.0 ».
L’objectif de cette analyse est de déterminer si l’emprunt de cette terminologie dans
les discours médiatiques, a un impact direct ou indirect sur l’investissement des médias
sociaux - et notamment les sites de questions-réponses - par les acteurs sociaux. A cet égard,
90
MERTON Robert K. Social Theory and Social Structure, Macmillan USA, 1968. 91
En hommage au sociologue américain William Isaac Thomas, pour sa formule célèbre : « If men define situations as real, they are real in their consequences » (Si les hommes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences) (1928). 92
ROSENTHAL R. et JACOBSON L. Pygmalion in the classroom, The Urban Review, Volume 3, Issue 1 , pp 16-20, Kluwer Academic Publishers, 1968. 93
CASTELLS Manuel, La Société en réseaux, Fayard, 2001. 94
JEANNERET Yves, La « société de l’information » comme figure imposée. Sur un usage particulier des mots en politique, in La « Société de l’Information » Entre mythes et réalités, sous la dir de Michel Mathien, 2010. 95
Slogan de campagne du candidat démocrate Al Gore durant l’élection présidentielle américaine de 2000.
il convient d’expliciter les potentiels enjeux politiques et socio-économiques derrière la
récurrence d’un tel emprunt. Pour nous aider dans cet exercice, nous allons nous appuyer sur
un ensemble de travaux de recherche ayant pour objet d’étude le concept de « société
d’information ».
Dans son article intitulé La société de l’information comme figure imposée96
, Yves Jeanneret
décortique le concept de Société de l’information, en commençant par analyser la construction
sémantique et la portée significative d’une telle construction. En ayant recours à la notion
d’information, une notion elle-même « ambiguë par excellence » énonce Jeanneret, le terme
entretient une double-confusion : la première concerne le « lien entre signes, objets et
pratiques », puisqu’il est impossible de déterminer par une simple lecture s’il s’agit d’une
société des objets-informations (une société où l’information est un élément plus abondant ?),
de signes informationnels (une société où les signes seraient plus nombreux/plus complexes
que dans d’autres sociétés ?) ou de pratique de l’information (existe-t-il des sociétés qui ne
pratiquent pas l’information ?). La seconde confusion vient du lien entre société d’un côté et
information de l’autre. Selon Jeanneret, « ce ‘de’ si ambigu (société de l’information) masque
la question des intérêts, des logiques, des valeurs en jeu » L’utilisation du terme
‘information’ serait selon l’auteur une manœuvre pour dissimuler la position d’hégémonie que
prenne l’industrie informatique dans le cadre d’une abstraction du pouvoir détenu par cette
industrie97
. Jeanneret décrit cette manœuvre comme une forme d’ « obscurantisme
officialisé » ayant pour objectif l’autoréalisation d’un concept-projet. L’annonce publicitaire
de la société de l’information serait donc un élément déclencheur suffisant, pour engager les
individus exposés à cette publicité, à s’investir massivement dans la consommation des
produits et services proposés par l’industrie bénéficiaire de la publicité en question :
« L’annonce de « la société de l’information », loin de décrire seulement une réalité existante,
participe matériellement de la réalisation même de ce qu’elle prétend désigner ; ainsi passe-t-
on d’un effet de discours, dans le dire, à l’autoréalisation d’une idéologie, dans le faire. » A
partir de cette assertion, il est intéressant de sonder sur le terrain, le degré d’intériorisation
d’un tel discours publicitaire, par les individus investis dans les médias informatisés.
Rappelons au passage, les réponses particulièrement approbatrices des discours promotionnels
96
Op. Cit. 97
« Une industrie qui n’est jamais nommée, puisqu’elle est désignée par l’intermédiaire de son avatar culturel, la « société de l’information ». L’informatique est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part, ce caractère insaisissable soustrayant à certains égards l’informatique à l’obligation de la justification » précise Jeanneret, citant Pascal ROBERT, « Penser l’informatique : un effort indispensable pour les SIC », Actes du 12
e congrès de la SFSIC, Paris, 2001.
vis-à-vis des technologies informatiques (qu’il s’agisse des discours sur la fortification –
empowerment98
- de l’individu dans une perspective libérale-libertarienne, ou ceux appelant à
l’investissement étatique en produits informatiques dans l’objectif de réduire une supposée
‘fracture numérique’) de la part des personnes interrogées par questionnaire sur la place que
prennent les technologies numériques dans la société d’aujourd’hui (figure 17 et 18)
Figure 17: Métriques sur la perception des utilisateurs de l’avènement des médias informatisés
Figure 18: Métriques sur la perception des utilisateurs de l'avenir des médias informatisés
La perception de la population sondée, tends donc vers l’autoréalisation d’une conception,
pour reprendre les termes de Jeanneret. Le processus par lequel cette autoréalisation est
rendue possible a été étudié par Sarah Labelle99
qui utilise le terme « réquisition » pour
désigner cet « appel à agir » qui serait derrière l’investissement des acteurs sociaux dans les
médias informatisés100
. D’autres auteurs ont également pointé du doigt, l’aspect flou et
ambivalent du concept de société de l’information sans pour autant remettre en question
l’objectif implicite des discours en question. Ainsi, Pierre Lévy décrit la société de
98
http://www.celsa-misc.fr/a-la-une/2013/02/23/smctalks-notion-empowerment/ 99
Sarah LABELLE, « La société de l’information. A décrypter », Communication et langages, n° 128, 2001, pp. 65-79 100
« […] la réitération de l’appel à agir, à devoir faire quelque chose, à peu près n’importe quoi, pour confirmer que « la société de l’information », être intellectuellement indéfini, existe bel et bien dans les faits » in JEANNERET Y. Op.cit. p 147.
l’information comme étant un leurre101
, tout en définissant les médias informatisés sous la
métaphore de l’espace, une construction imagée qui sert de facilitateur cognitif, à l’expansion
de l’idée selon laquelle les espaces numériques seraient non seulement des territoires à
explorer, mais surtout les derniers territoires à investir, une espèce de couche supplémentaire
qui surplomberait l’espace géographique102
. C’est de cette métaphore technique du réseau,
assimilable à un espace superposé, que l’idée de l’accès a été rendue diffuse. En admettant les
médias informatisés comme une expansion de l’espace public (DAHLGREN 2000,
CARDON, 2007103
) ce discours donne aux industries informatiques un rôle de bâtisseur et de
fournisseur d’accès à un service sublimé en espace indispensable aux formes d’organisations
sociétales actuelles, à savoir un régime démocratique basé sur l’accessibilité d’un espace
public. Nous comprenons donc mieux l’investissement massif qui peut être observé dans ces
médias, par une population dont les attentes en matière de démocratie, vacillent entre
résiliation et défiance. Les discours promotionnels ‘naturalisant’ des concepts comme la
société de l’information sont, de ce point de vue, porteurs d’une désignation d’ordre
idéologique vis-à-vis des rapports socio-économiques existants. Comme le précise Y.
Jeanneret : « Cette prise à la lettre de la métaphore spatiale, qui fait du réseau un espace
public superlatif (multiple, étendu) est bien porteuse d’une qualification politique nouvelle de
la relation culturelle : plus exactement, elle fonde un imaginaire du politique sur un
imaginaire de la trivialité des êtres culturels. »
En l’occurrence, l’imaginaire en question est particulièrement fort de sa capacité à gommer à
la fois l’aspect idéologique (message) et l’aspect publicitaire (forme) de son énoncé, raison
pour laquelle, il est quasiment impossible de rencontrer dans les discours des individus
sondés, une quelconque forme de méfiance ou de remise en question de conceptions telle que 101
« La société de l’information est un leurre. On a laissé entendre qu’après avoir été centrée sur l’agriculture, puis sur l’industrie (les transformations de la matière), l’économie était maintenant pilotée par le traitement de l’information. Mais comme de nombreux employés et cadres le découvrent à leurs dépens, rien ne s’automatise aussi bien et aussi vite que le traitement ou la transmission de l’information. » 102
« L’espace du nouveau nomadisme n’est pas le territoire géographique ni celui des institutions ou des Etats, mais un espace invisible des connaissances, des savoirs, des puissances de pensée au sein duquel éclosent et mutent des qualités d’être, des manières de faire société. Non les organigrammes du pouvoir, ni les frontières des disciplines, ni les statistiques des marchands, mais l’espace qualitatif, dynamique, vivant, de l’humanité en train de s’inventer en produisant son monde. Où lire les cartes mobiles de cet espace fluctuant ? Terra incognita. Même si vous parveniez pour votre compte à l’immobilité, le paysage ne cesserait de couler, de tourbillonner autour de vous, de vous infiltrer, de vous transformer de l’intérieur. » 103
« Les mises en scène de soi, de ses qualités, de ses compétences accompagnent une volonté d’élargir l’espace de visibilité dans lequel chacun manifeste aux autres sa singularité pour la faire reconnaître. Cette ouverture de l’espace public aux individus a des conséquences de première importance. Elle introduit dans le monde de l’information et de la politique des manières d’être ensemble, d’interagir et de coopérer qui restaient jusqu’alors encloses dans l’espace des sociabilités privées. Internet rend ainsi visible un ensemble d’attentes qu’il est crucial de décrypter. » in La démocratie Internet, Promesses et limites, Seuil, 2007
la société de l’information ou l’intelligence collective104
, qui de ce fait, se posent comme des
évidences établies105
. Au mieux, assiste-t-on, dans certains témoignages, à une forme de
consensus fait de la question des déterminismes (social d’un côté, technique de l’ordre),
renvoyant à la figure récurrente du paradigme « sociotechnique » :
« Il y a toujours, me semble-t-il, un effet de déclenchement entre les technologies et les
réflexions quelque part, sociétales. Donc les technologies boostent des réflexions et l’inverse
est vrai aussi, un besoin crée la technologie - enfin fait naître des technologies qui répondent
à ce besoin. […]Je pense qu’il y a des deux. Je pense que l’un et l’autre se parlent, c’est-à-
dire que la technologie permet des choses mais du coup, ça fait naître d’autres besoins, donc
on crée d’autres technologies qui y répondent etc. C’est un effet d’amplification. Mais par
contre, je pense que tous ces réseaux et ses outils ne peuvent marcher que s’ils sont très
fortement animés, sans animation il ne se passe rien. »
Extrait de l’entretien qualitatif mené auprès de Mathilde Faidherbe106
.
Le rôle des technologies de l’information et de la communication peut c’est le cas dans ce
témoignage, se réduire à une infrastructure sans que la nature médiatique (et donc
déformatrice) de ces supports ne soit évoquée. Il convient de noter, cependant, les doutes émis
quant à l’efficacité de ces outils, ainsi que la distinction faite entre les communications
interindividuelles et les communications médiatisées :
« […] enfin la technologie peut aider, mais je ne crois pas à la technologie seule […] un truc
virtuel en entreprise, ne marchera pas à moins que les gens se rencontrent au moins une fois
par an, mangent ensemble, créent le contact, créent une chaleur que la technologie ne produit
pas forcément »
104
Aucun des témoignages recueillis dans notre questionnaire de prospection ou dans l’observation participante, n’a mis en évidence l’existence de discours influents allant dans le sens de l’utilisation massive des médias informatisés en général, ou des espaces collaboratifs en particulier. 105
« Il faut s’interroger sur le fait, au moment où l’on donne tant d’importance à la communication, que des conceptions aussi confuses puissent être non seulement acceptées mais imposées à tous les acteurs comme condition d’accès au débat. […]L’ « évidence » de « la société de l’information », se charge, en fonction du dispositif discursif dans lequel elle s’inscrit, d’un semblant de précision. « Chaque fois que l’on présente comme élément d’un système bien structuré une notion traditionnellement confuse, le lecteur peut avoir l’impression que l’on vient d’exprimer ce qu’il a toujours pensé, s’il ne possédait pas lui-même de contexte précis qui aurait fourni à cette notion certaines de ses déterminations » Jeanneret citant Chaïm PERELMAN et Lucie OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l’argumentation : la nouvelle rhétorique, Editions de l’ULB, 1992, p. 155. 106
Mathilde Faidherbe est psychologue du travail et coach professionnelle, elle a été contactée dans le cadre d’une interview en sa qualité d’Associée chez Agissens, cabinet spécialisé en développement du capital humain.
Nous noterons l’usage de la métaphore thermique (chaleur) dans la distinction qui est faite
entre les deux types de communications. Cette image d’une médiation ‘chaleureuse’ a été
traitée par Marshall Mcluhan dans son ouvrage Pour comprendre les médias : les
prolongements technologiques de l'homme107
qui fait la distinction entre médias chauds (hot
media) et médias frais (cool media)108
. La communication interindividuelle dans sa dimension
‘chaleureuse’ a été classée par l’auteur dans les médias frais (de l’anglais ‘cool’, dans le sens
mélioratif : agréable, sympathique) ce qui corresponds par ailleurs à la qualification de notre
témoignage, par lequel on comprend une valorisation de la médiation humaine à celle ayant
recours aux médias informatisés.
D’autre part, nous avons également recueilli un témoignage qui, sans pouvoir nommer
explicitement une origine discursive ni la nature idéologique de l’idée circulée, définit un
point de départ historique à l’expansion de la conception en question:
« Ce que j’ai remarqué en lisant et observant, c’est qu’on ne parle d’intelligence collective
que depuis peu de temps. L’émergence de cette idée est née de quelque chose qui a changé
dans le monde industriel.
Les entreprises, dans les années 70, étaient à 95% sur un mode d’organisation hiérarchique :
1 employé/ 1 chef. C’est le développement des notions d’entreprises matricielles, en réseau,
qui sont à l’origine de cette notion d’intelligence collective.»
Entretien Michel Moral109
, Consultant psychothérapeute
Ce témoignage est doublement intéressant car il stipule que (1) l’émergence de l’idée en
question est née de quelque chose et est donc moins une contingence ou une évidence
intemporelle qu’une conséquence d’un fait historique110
, et (2) l’origine de cette idée est à
chercher dans le domaine du management, lui-même affecté par les innovations
technologiques, notamment le développement des réseaux informatiques. Par conséquent, la
107
MCLUHAN Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, MIT Press, New Edition 1994 (initial edition: 1964). 108
Ces qualificatifs thermiques correspondent au degré de complexité et de définition de la donnée, de l’audience exposée au message ainsi que du sentiment engendrée par la forme du média (incluant/excluant). En l’occurrence, les médias dits ‘frais’ est incluant, tribalisant, organique, de définition basse (peu de données à décrypter) et réducteurs de l’espace-mire (collapses space). McLuhan donne comme exemple de médias frais : le téléphone, les discussions, les dessins, les bande-dessinée, entre autres. 109
L’Intelligence Collective, Actes de la première Université d’été, Université d’été de la FFC Pro, 12 & 13 septembre 2008, PARIS. 110
Roland Barthes définit le mythe comme un transformateur de l’histoire en nature : « La sémiologie nous a appris que le mythe a pour charge de fonder une intention historique en nature, une contingence en éternité […] Le mythe ne nie pas les choses, sa fonction est au contraire d’en parler ; simplement, il les purifie, les innocente, les fonde en nature et en éternité, il leur donne une clarté qui n’est pas celle de l’explication, mais celle du constat »
fonction publicitaire ‘naturalisante’111
des mythes fondateurs de ces pseudo-concepts,
n’aboutit pas dans tous les cas, comme nous le démontre ce témoignage112
.
Nous avons donc vu comment des pseudo-concepts comme la société de l’information
peuvent se dresser comme une évidence et une condition d’entrée dans les débats socio-
politiques actuels. Ces discours promotionnels peuvent être derrière l’investissement des
internautes dans les médias informatisés, dont l’image métaphorique la plus répandue est celle
de l’espace (espace de discussion numérique, espace collaboratif 2.0 etc.). Nous allons à
présent nous attarder sur l’origine de cet emprunt métaphorique et l’impact que celui-ci peut
avoir sur la perception des individus, et en conséquence, sur leur investissement des médias
en question.
b. Sur le projet d’intelligence collective médiée par ordinateur
Le second pseudo-concept bénéficiant d’une publicité conséquente et qui peut être
considéré comme un objet auto-réalisateur est l’idée selon laquelle les TIC seraient un
élément catalyseur d’une forme supérieure d’intelligence humaine, rendue possible par la
connexion de plusieurs intelligences113
. Cette conception est encore plus engageante et plus
valorisatrice des médias numériques que ne l’est le concept de société de l’information. En
effet, la première stipule un état de fait qui implique une participation nécessaire des individus
au risque de ‘passer à côté de quelque chose’, il s’agit d’un appel à agir par contrainte, par
besoin socio-économique impérieux, tandis que dans le cas de l’intelligence collective, il
s’agit davantage d’un appel à contribuer, dans le cadre d’un projet à grande dimension
humaine. C’est ainsi que les théoriciens de l’intelligence collective décrivent cette notion
comme « un attribut de l’humain aussi essential du langage, mais à une échelle supérieure »
(LEVY, 1994). A cette « voie de l’intelligence collective » l’auteur oppose la communication
par les médias, signifiant que la notion d’intelligence collective se pense en dehors des
théories médiatiques : « Ou bien nous dépassons un nouveau seuil, une nouvelle étape de
111
Certains auteurs parlent aussi d’ « industrie du baptistère » où « on prête vie aux objets quand on leur prête un nom, on leur prête nom pour leur donner vie […] La fonction publicitaire primordiale, tant dans la chronologie de ses efforts que dans la pérennité de ses résultats, vise à l’imposition d’un nom. La publicité, c’est avant toute chose un grand baptistère, où les productions les plus disparates, issues de géniteurs innombrables, espèrent obtenir le sceau d’une identité » in Georges PENINOU, « Le oui, le non et le caractère », Communications, n° 17, 1971, pp. 67-81 112
Notons au passage qu’un bref entretien par email a été réalisé avec Pierre Lévy, philosophe et chercheur à l’université d’Ottawa. A la question : Les TIC et les phénomènes de contribution : un rapport de causalité ou d’amplification ? P. Lévy a répondu qu’il s’agit d’un rapport d’amplification, assertant ainsi que l’engagement des individus dans les dispositifs médiatiques informatisés serait un ‘besoin’ préexistant plutôt qu’une rétroaction positive au discours publicitaire appelant à agir en ce sens. 113
Voir notre précédent chapitre : le fantasme des cerveaux connectés.
l’hominisation en inventant quelque attribut de l’humain aussi essentiel que le langage, mais
à une échelle supérieure. Ou bien nous continuons à « communiquer » par les médias et à
penser dans des institutions séparées les unes des autres, qui organisent de surcroît
l’étouffement et la division des intelligences » Nous voyons bien dans cette assertion, le
contraste fait entre « les médias », terme englobant des éléments laissés flous et non-définis,
et un « attribut » (terminologie tout aussi floue) qualifié de nouveau et ne faisant pas partie de
ces médias. Ce nouvel attribut serait donc doté de grandes vertus, notamment le pouvoir-
communiquer, tandis qu’il est reproché aux médias de ne pas ‘réellement’ remplir cette
fonction de communication (usage des guillemets), bien au contraire puisque celles-ci est à
l’origine de la division des intelligences. La métaphore des cerveaux connectées est ici
particulièrement manifeste : la conception de l’attribut en question serait la concrétisation
d’un idéal de la transparence où le média disparait pour ne laisser place qu’à une ‘connexion’
entre les intelligences.
La forme que prendrait cet attribut nouveau est définie en ayant recours à l’image spatiale du
territoire ou du continent : « Peut-être la crise actuelle des repères et des modes sociaux
d’identification signale-t-elle l’émergence encore mal aperçue, incomplète, d’un nouvel
espace anthropologique, celui du savoir et de l’intelligence collective, dont l’avènement
définitif n’est d’ailleurs nullement garanti par de quelconques « lois de l’histoire ». Comme
les précédents espaces anthropologiques, l’Espace du savoir aurait vocation à commander
les espaces antérieurs et non les faire disparaître. » Cet ‘espace des savoirs’ est donc
considéré comme un lieu et non comme un média et l’appel à agir qui découle du projet de
l’intelligence collectif est à appel à peupler ce nouvel espace114
. Nous retrouvons également
dans cette définition des éléments relevant du ‘mythe naturalisant’ puisqu’il s’agit de
l’émergence d’un espace anthropologique en dehors des « lois de l’histoire ». Ce discours à
visée essentiellement prédictive tient cependant compte de l’existence du réseau des réseaux
en tant qu’invention technologique historiquement déterminée sur un point fixe (un contexte
historique et socio-économique donnés). Bien qu’il ne soit pas mentionné directement que
l’espace des connaissances en question prend forme grâce aux technologies informatiques,
l’auteur désigne ultérieurement cet attribut comme une « intelligence collective techniquement
augmentée ». Nous assistons donc à l’élaboration (1) d’une conception d’ordre mythique
(avènement d’un nouvel élément), (2) ayant recours à des emprunts métaphoriques flous (un
114
La métaphore de la conquête d’un nouveau territoire a été forgée par Al Gore en 1994, en référence à la conquête du grand Ouest aux États-Unis de la fin du XIXème siècle.
espace anthropologique mal aperçu), (3) se présentant comme une émergence en dehors de
l’histoire (naturalisation en contingence) et (4) rendu possible par les technologies
numériques. La fonction publicitaire de cet énoncé est manifestement produite à l’avantage de
l’industrie informatique puisqu’il s’agit d’un appel, adressé aux acteurs sociaux, à s’investir
dans un service décrit comme nouveau, présentant des vertus incontestées et assurant une
communication ‘purifiée’ a contrario des médias dont il ne fait d’ailleurs pas partie.
Cette apologie de la technique est d’autant plus accrue que nous serions en train de faire un
constat inédit : « Pour la première fois, il [l’individu] est élevé en société avec un cerveau
outillé et prolongé par des ordinateurs en réseaux » (MOULIER-BOUTANG, 2007). Il s’agit
donc bien d’une émergence aux origines connues, à savoir l’industrie informatique, même si
celle-ci n’est pas nommément citée dans la définition qui est faite de l’intelligence collective.
La promotion implicite que contient la notion d’intelligence collective est à cet égard, bien
plus effective puisqu’elle élève l’objet promu à une position de déclencheur d’une
(r)évolution anthropologique.
c. De l’émergence d’un nouveau paradigme
L’idée d’un changement conduit par les technologies numériques est, nous l’avons vu, la
composante essentielle d’un discours promotionnel à forte portée médiatique. Cette
conception, quand elle est poussée à son paroxysme, peut donner des annonces prédictives de
l’avènement d’un nouveau paradigme socio-économique. Dans cette partie, nous allons traiter
des éléments qui permettent d’élaborer ces discours sans toutefois être exhaustif dans le
développement des différentes théories socio-économiques allant dans ce sens.
Le principal présupposé avancé ici est le suivant : nous serions en train de changer de système
de représentations, de modèle de gouvernance et de rapports économiques notamment suite à
l’utilisation massives des technologies dites cognitives. Pour Yann Moulier-Boutang, il s’agit
moins d’un changement de système économique que de l’évolution du système capitaliste
actuel : « Ce capitalisme mutant qui doit faire avec la nouvelle composition du travail
dépendant (majoritairement salarié), nous l’appelons cognitif parce qu’il fait face à la force
cognitive collective, au travail vivant et non plus du muscle consommé dans les machines
marchant à la dissipation de l’énergie « carbo-fossile »115
. Il ne s’agit donc pas, selon
Moulier-Boutang d’une rupture dans le sens de renversement des structures normatives
actuelles pour les remplacer par d’autres, mais plutôt d’un réagencement des modèles de
115
Op.cit p. 65
production du système capitaliste dit ‘industriel’ : « Pas plus que le capitalisme industriel
n’avait rompu avec la substance du capitalisme marchand esclavagiste, le capitalisme
« cognitif » qui s’annonce et qui produit et domestique le vivant à une échelle jamais vue
n’évacue pas le monde de la production industrielle matérielle : il le ré-agence, le réorganise,
en modifie les centres nerveux.». Dans un tel environnement de transition où les technologies
numériques sont présentées comme les outils de médiation et de restructuration d’un
paradigme économique ‘nouveau’, nous pouvons considérer la thèse de la contribution
comme réponse à un appel à agir, dans un mouvement tourbillonnant de rénovations et
d’expérimentations de nouveaux modèles. A cet égard, l’auteur du Capitalisme cognitif fait
un constat intéressant concernant les rapports économiques qui peuvent exister entre les
grandes entreprises et les usagers des technologies numériques. Un rapport de dépendance qui
pousserait l’industrie informatique au devant de la scène économique puisqu’il s’agit du
secteur bénéficiant de la proximité la plus importante quand il s’agit des innovations des
internautes : « le numérique et son appropriation par le plus grand nombre possible est une
condition indispensable pour récupérer le travail de pollinisation non directement marchand.
Si on ne laisse pas le réseau numérique se développer sans entrave, la productivité magique
de l’exploitation de niveau 2 s’évanouit rapidement. » Nous assistons donc bien à une
promotion des médias informatisés, dans le dire ainsi que dans l’agir. D’une part, les discours
militants sur l’ouverture de l’internet116
, la valorisation de la contribution et des différentes
formes d’implication individuelle dans des formes diverses de production non-marchande
(do-it-yourself, fab labs, personal branding etc.) et d’autre part, les initiatives des grands
mastodontes de l’IT mettant à disposition des internautes des ressources et des outils dont ils
ont besoin pour produire du contenu à valeur-ajoutée, sont autant d’éléments manifeste d’une
stratégie de promotion derrière l’engagement des individus dans les médias informatisés.
L’objectif de cet effort promotionnel est de déclencher, au sein de la communauté des
internautes, des innovations dans les usages, que les entreprises reprennent à leur compte avec
comme avantage des coûts largement plus bas que ce qui aurait été mobilisé dans un pôle
R&D. Moulier-Boutang utilise l’image de la pollinisation pour expliquer cette stratégie : « Il
devient donc indispensable pour le capitalisme cognitif de laisser la coopération spontanée se
créer elle-même. Sans la richesse des multitudes qui « pollinisent » la société avec les ailes du
numérique, la récolte de miel (celle du capitalisme traditionnel) faiblit. ». Nous saisissons
116
« Les nouveaux explorateurs, capitaines, conquistadors puis gouverneurs du capitalisme cognitif l’ont compris. Ils ne défendent pas la liberté de l’Internet seulement au nom des principes moraux et esthétiques, mais par intérêt bien ordonné. » Op.cit p. 167
alors la dimension économique de certains discours militants sur la gratuité de l’internet et la
mise en valeur de l’implication individuelle dans les processus de création médiatisés par
ordinateur. Il ne s’agira probablement à aucune phase du capitalisme cognitif, d’exproprier les
internautes directement, comme ce fut le cas pour la main d’œuvre ouvrière dans l’histoire du
capitalisme dit industriel, « Il a trop besoin de leur travail de pollinisation à partir de la
société des réseaux. Il veut parvenir à retransformer le produit de cette activité en
marchandise commercialisable sur le marché. » Conclut l’auteur.
Cette forme d’organisation des processus de création en dehors de l’entreprise (Outsourcing
ou externalisation117
) s’est vu accroitre depuis les années 1980 avec l’expansion du néo-
libéralisme et les procédures de dérégulation. Avec l’importance grandissante, accordée à
l’innovation, conçue comme ressource stratégique, la communication des acteurs et la logique
des réseaux sont devenus des schémas dominants dans l’organisation en entreprise. C’est dans
ce contexte de favorisation explicite, soutenue par des décisions politiques, que le
management dit de l’intelligence collective a vu le jour :
« Le développement de l’intelligence collective suppose que les individus entrent dans ce
projet. Or cela suppose certains types de relations entre les individus du collectif. Un soutien
personnalisé est parfois nécessaire ou au moins utile pour qu’un individu acquière les
comportements adaptés à un contexte de management de l’intelligence collective. »
Citation : Michel Moral
Nous voyons donc comment l’incitation à contribuer va au-delà des discours promotionnels
pour toucher à des actions concrètes au sein de l’entreprise, en passant par les instances de
décisions dites de « gouvernance ». Ces orientations top-down, donnent lieu à des ‘conduites
de changement’, à savoir un suivi par des coachs dont la fonction est de faire adopter
l’innovation à l’ensemble des salariés.
Les leviers de la motivation derrière l’utilisation des technologies informatiques sont donc
double : d’une part, des énoncés publicitaires valorisant les produits et les services
numériques en les élevant au rang de services publics (extension de l’espace public,
démocratie électronique etc.) accompagnés de gestes commerciaux implicites de la part des
grandes entreprises du secteur (services et outils gratuits, aide à l’innovation individuelle,
117
http://fr.wikipedia.org/wiki/Externalisation
sponsoring d’évènements de type barcamps118
etc.). D’autre part, nous assistons à une
‘évangélisation’ au sein de l’entreprise sur une présupposée nécessité urgente de passer à des
modèles de collaboration basée sur le partage de l’information sans frontières ni limites
rigides119
. La contribution des internautes dans les médias dits 2.0, par ailleurs produite par les
discours d’évangélisation que nous venons de mentionner, sont utilisés comme argument au
sein de l’entreprise pour suivre le cheminement de la digitalisation et de la socialisation120
des
processus de travail. Les nouvelles recrues ainsi que les chercheurs d’emploi sont donc
amenés à constater cette mouvance et répondent par une implication massive dans les médias
sociaux. C’est ainsi que la boucle est bouclée et nous assistons, en conséquent, à une
énonciation auto réalisatrice qui trouve tout son sens.
L’activité de « production de soi » sur internet serait alors une conséquence de ce nouveau
paradigme en autoréalisation par le discours publicitaire et l’appel à agir : « Maintenir son
employabilité suppose d’être entrepreneur de soi, entrepreneur de sa réputation121
. La forme
contemporaine du capitalisme informationnel, la dissolution des collectifs traditionnels, la
flexibilité croissante des emplois rendent essentiel ce travail de mise en visibilité de l’acteur
individuel. » (BEAUDOIN, 2011). C’est ainsi qu’une espèce d’individualité publicisé a pris
forme sur internet et est en cours de devenir le modèle dominant dans toutes les formes de
production médiatique.
2. Médiatisation de soi et valorisation de la contribution en ligne
Comme nous venons de le voir dans la première partie de note analyse, nous assistons
depuis quelques années à une valorisation accrue de la contribution en ligne et à des appels
réitérés à agir, qui se traduisent par une publicisation renforcée de soi via les médias
informatisés. Dans la suite de notre analyse des discours d’incitation à la contribution en
ligne, il convient de rappeler leurs origines historiques d’un point de vue idéologique.
a. Le triomphe des idéaux de la communauté IT
Bien que des auteurs parlent de« fracture sur deux lignes » de l’utopie défendue par les
pionniers du réseau des réseaux (Cardon, 2010), nous défendrons ici la thèse selon laquelle les
idéaux libertaires des fondateurs et premiers investisseurs de l’internet, a manifestement
118
http://fr.wikipedia.org/wiki/BarCamp 119
http://www.surferlavie.com/2012/10/jeudi-11-octobre-%C3%A0-18h30-d%C3%A9bat-en-direct-jo%C3%ABl-de-rosnay-et-philippe-dessertine-sur-agoravox.html 120
De « web social ». 121
A. Gorz, L’Immatériel. Connaissance, valeur et capital, Paris, Galilée, 2003.
conquis un territoire très large avec l’expansion du web ainsi que les politiques de
dérégulation mené dans les années 1980. Ce triomphe des idéaux défendus par la
communauté informatique se perçoit de deux manières : la première est d’ordre socio-
économique et concerne la perception qu’ont les individus des rapports marchands vis-à-vis
des produits informatisés (propriété intellectuelle et exploitation des services), la seconde est
d’ordre politique et concerne le rapport de l’individu avec les instituions et l’Etat (autonomie
individuelle et contestation anti-institutionnelle).
Comme l’évoque Dominique Cardon dans son ouvrage La démocratie Internet, Promesses et
limites (2010) les mouvements contestataires de l’aile libertaire, dans les années 1970 « n’ont
guère eu de problèmes à s’acclimater aux injonctions libérales ainsi qu’aux politiques de
dérégulation […]Certains des gourous des communautés libertaires ont activement soutenu
la libération des marchés, fidèles à leur détestation des pouvoirs et des contraintes
réglementaires. » L’auteur décrit cet environnement idéologique, dans lequel la naissance de
l’internet civil a eu lieu, d’ « idéologie californienne122
». Le parcours professionnel de
certains de ces gourous nous renseigne sur les étapes de massification de ces idéaux. En effet,
des pionniers comme Steward Brand, Esther Dyson, et Kevin Kelly sont également les
fondateurs du Global Business Network, « une entreprise de consulting qui s’efforce de
sensibiliser les cadres dirigeants des grandes entreprises à la thématique de la flexibilité du
travail et de la responsabilité individuelle » note Cardon. Le même constat peut être fait pour
Louis Rosseto, le fondateur du magazine Wired qui est devenu la référence incontournable
des entrepreneurs du digital à travers le monde.
Il s’agit donc bien d’une mobilisation à grande échelle, dont les discours de valorisation de
l’engagement individuel sur le réseau et l’appel à la contribution est l’un des moteurs les plus
efficients. Les forums de discussions et toute forme de dispositifs d’échange d’information en
ligne, se basent sur cette volonté de coopération pour pouvoir subsister. Il est donc intéressant
d’essayer de quantifier le degré de circulation de ces idéaux dans la population usagère de ces
plateformes.
Nous avons noté différents éléments concernant la perception idéologique des utilisateurs de
Quora durant la période d’observation. Cela peut transparaitre dans certaines discussions
d’ordre politique, où la question de l’autonomisation de l’individu est très récurrente autant et
122
Expression empruntée à Richard Barbrook et Andy Cameron, « The Californian Ideology », in Peter Ludlow (dir.), Crypto Anarchy, Cyberstates and Pirate Utopias, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2001, p. 363-387.
pouvant aller jusqu’à une vive expressivité dans les discussions concernant les politiques
relatives à l’Etat-providence :
“Look: there's a line. There's a point of taxation beyond which – even if you can get "the rich"
to pay it – becomes usury. France has long since crossed that line. It's this tired old trope,
"But we only need a little bit more!"
Bullshit. The French and Euro-Socialists have been spouting that horse-shit for decades and
look where it's gotten them. Anemic economies, massive subsidies for inefficient industries
and a complete failure to deliver services to those who actually need them while having the
benefit of driving away investment. Quick: name the last great startup, invention, discovery
or industry-disruptor to come out of France! […] It’s the endless push in France to keep a
bloated bureaucracy, byzantine labor law, short work-weeks, massive social spending and a
very contra-business attitude.” Utilisateur 13123
Bien que ce type de réactions particulièrement politisé, soit anecdotique par rapport à
l’ensemble des contributions des usagers de Quora, nous avons noté dans les réponses des
utilisateurs suivis dans le cadre de notre échantillon, une tendance idéologique valorisant
l’individualité et dénigrant toute forme d’interventionnisme d’état. Il est d’ailleurs intéressant
de noter que les réactions des utilisateurs-indexeurs à ce genre d’assertions vont dans le sens
de l’approbation (80 votes positifs pour l’exemple que nous venons d’exposer). Cette
tendance idéologique peut s’expliquer par le type de population usagère du site. En effet, on
note une certaine homogénéité dans les profils des utilisateurs, majoritairement des cadres
travaillant dans le secteur des technologies informatiques et généralement des indépendants
(freelance). Vient ensuite le facteur géographique : bien que nous n’ayons pas de chiffres
officiels communiqués par Quora, nous avons noté une forte concentration des utilisateurs du
site dans la côte-ouest américaine. Nous pouvons donc considérer que la première
communauté ayant investi la plateforme, étant particulièrement exposé aux idées
libérales/libertariennes, a été derrière la circulation d’un discours qui, par effet de « biais de
confirmation124
» faisant en sorte que seuls les utilisateurs qui retrouvent leur propre opinion
123
En réponse à la question: « Gérard Depardieu quitte la France : Est-il juste de dire que M. Depardieu aime l’argent plus qu’il n’aime la France ? 124
Les psychologues appellent « biais de confirmation » le fait que les gens, la plupart du temps, ne s’intéressent qu’aux informations qui confirment leur opinion. Que ce soit en raison de leur composition ou par conformisme, cet effet a été également constaté dans des groupes, dont les discussions deviennent alors restreintes à l’examen sérieux d’une seule solution parmi plusieurs possibles.
dans une communauté donnée, s’investissent de manière régulière, encouragés par les
récompenses symboliques (citations, votes positifs, abonnements etc.). Nous retrouvons
d’ailleurs divers participations, n’ayant aucun autre but que la favorisation d’une cohésion
sociale entre les membres :
“Friendship: Which Quora user would you most like to be friends with in real life?”125
Nous assistons donc à une communauté d’usagers partageant globalement des idéaux
similaires et pouvant se constituer en groupes avec des niveaux élevés de cohésion, ce qui
peut expliquer les motifs d’usages des individus en question, à savoir la recherche d’une
récompense symbolique (approbation et reconnaissance des pairs) et un confort
psychologique dû à une faible disparité idéologique entre les participants. Ajoutons à cela un
potentiel effet d’amplification des tendances existantes suite aux délibérations ayant lieu à
travers ce média ; les psychologues sociaux appellent ce phénomène « effet de
polarisation126
».
b. Publicité de soi et rôles médiatiques : entre demandeurs, résolveurs et
commentateurs
La contribution dans les dispositifs d’échange d’information est comme nous l’avons vu, une
réponse des individus à ‘l’appel à agir’ que brandit le discours promotionnel de l’industrie
numérique et qui puise ses origines idéologiques dans la pensée libertarienne, mettant
l’individu au centre de l’attention. Dans leur ouvrage de publicité individuelle, les utilisateurs
de Quora se fondent dans des rôles médiatiques selon leur degré d’engagement et l’image
sociale qu’ils souhaitent laisser transparaitre dans leur contribution. Il s’agira dans cette
partie, de vérifier comment les internautes exposent dans leur présentation de soi, des
éléments pouvant être interprétés comme des réponses aux discours promotionnels.
Dans une communauté d’internautes où la reconnaissance par les pairs se fait sur des critères
méritocratiques (votes, reprises, citations), l’effort fourni par les utilisateurs pour la
125
Question à laquelle l’Utilisateur 8 de notre échantillon a répondu en complimentant l’Utilisateur 13. Cette réponse a suscité 30 votes positifs, la plupart issus de connexions communes aux deux internautes. 126
« Des études de psychologie sociale ont en effet montré que la discussion a souvent pour effet de renforcer la tendance préexistante des opinions au sein d’un groupe délibérant. Ainsi, un groupe dans lequel l’opinion médiane se trouve, avant la discussion, modérément favorable à une politique quelconque (l’usage de la peine de mort, par exemple) aura une opinion médiane fortement favorable à cette mesure après avoir discuté. Inversement, si la tendance au sein du groupe était, au départ, modérément défavorable à la mesure considérée, elle y sera, après discussion, fortement opposée. Ce phénomène est en général nommé l’effet de polarisation. On le décrit peut-être mieux en parlant d’une radicalisation de l’opinion dans le sens initialement dominant. » Bernard Manin, op.cit. p 44.
construction de soi, peut s’avérer particulièrement conséquent et chronophage. Nous avons
notamment relevé une fréquence de contribution très élevé chez les profils de résolveurs qui
peut aller jusqu’à 2 réponses/heure, et beaucoup plus en ce qui concerne les indexeurs
(jusqu’à 5 votes par minute). Les descriptions des utilisateurs sont particulièrement
intéressantes et peuvent s’assimiler aux « signatures » dans les forums de discussions. Nous
retrouvons dans cet espace une présentation de soi typique au média puisqu’il ne s’agit ni
d’une donnée de l’identité civile ni d’une appartenance géographique (adresse, origine
ethnique etc.) Nous trouvons à titre d’exemple, chez les profils de demandeurs des
descriptions des motivations :
“Seeking wisdom” Utilisateur 7
“I have only come here seeking knowledge. Things they would not teach me of in college.”
Utilisateur 8
Quant aux profils des résolveurs, leur énonciation exprime davantage une familiarité avec la
communauté et l’utilisation d’un humour à caractère privé :
‘I am user number 1,846,186 . . . which is sort of the coolest number ever.’
Utilisateur 13
‘Meta-Hipster. Lover of bacon.’
Utilisateur 10
Cette différence dans le ton utilisé dans la présentation de soi traduit une disparité de
perception chez les deux types de profils : les résolveurs étant les plus actifs en terme de
production de contenu, plus intégrés dans la communauté (notamment par leur ancienneté) et
bénéficiant d’une popularité accrue, sont plus dans une approche ludique et familière
(importante cohésion sociale) tandis que les utilisateurs les moins impliqués (et donc
bénéficiant d’une popularité moindre) affichent une posture plus ‘sérieuse’ et plus
justificative. Le discours de ces derniers sur l’apprentissage et l’acquisition de nouveaux
savoirs correspond d’ailleurs plus aux idées véhiculées par les promoteurs des plateformes
d’échanges informatisés, ce qui induit une exposition à ces discours de l’extérieur, avant
même que la communauté ne soit investie par l’utilisateur. Cet élément confirme la thèse de la
diffusion de l’appel à agir par d’autres médias (presse papier, audiovisuel, conférences, etc.)
Certains auteurs soutiennent que les moyens d’incitation à la contribution peuvent dépasser le
stade de l’appel à agir et élaborer des stratégie marketing allant de la fabrication d’imaginaires
publicitaires (storytelling, invitation à la projection de soi) à la récompense matérielles dans
certains cas : « Les internautes sont largement incités, notamment par l’intéressement
financier des plus actifs et par la médiatisation de success stories, à multiplier les
publications qui attireront une audience satisfaisant à la fois leur intérêt personnel [ego] et
les intérêts économiques de l’exploitant. » (Quonam & Lucien127
, 2009)
Considérant cet ensemble d’actions comme une stratégie de la part de l’exploitant, en
reprenant la métaphore de la guerre appliquée à la consommation (Jeanneret, 2011), le
consommateur (ici l’usager de la plateforme) réplique par des ‘tactiques de braconnage’ lui
permettant de s’investir un minimum tout en gardant une marge d’indépendance (engagement
par l’indexation au lieu de la production, construction d’un soi multiple, etc.)
Conclusion de l’hypothèse III
Nous avons vu comment des pseudo-concepts comme la société de l’information ou
l’intelligence collective prennent une place considérable dans les débats politiques et socio-
économiques. Ces discours promotionnels constituent un levier de motivations pour les
individus qui répondent par un investissement plus ou moins important sur les médias
informatisés. Cette fabrique de l’imaginaire de l’internet constitue une étape primordiale dans
l’autoréalisation de l’hégémonie de l’industrie informatique comme le démontrent les
déclarations des internautes sur leur perception de l’avenir des services informatiques. En
effet, pour une majorité de personnes sondées, internet et les médias numériques sont en train
de devenir une condition de l’élargissement de l’espace public. Des auteurs ont mis en
évidence le caractère volontairement flou et imprécis de ces concepts, dont la fonction
principale est de se poser comme une évidence dans toute réflexion politique et socio-
économique. Nous avons déterminé trois types de discours qui vont dans ce sens : un discours
promotionnel ‘naturalisant’ posant comme évidence, et par anticipation, les conséquences de
décisions politiques –jamais nommées-, comme étant une réalité à laquelle il faut s’adapter.
Les seconds sont davantage des appels réitérés à agir dans le cadre d’un projet à dimension
humaine, auquel il serait dommageable de ne pas participer. Et enfin, le dernier est un
discours annonciateur d’un changement de paradigme socio-économique auquel il fait agir
127
QUONAM Luc, LUCIEN Arnaud, L’intelligence économique 2.0 ? in Les Cahiers du numérique 2009/4 (Vol. 5), 196 pages.
(par l’adhésion ou par l’opposition, mais en tout cas agir) en utilisant les moyens propres à ce
système naissant, et donc s’engager dans l’utilisation de ces moyens. Ces messages
massivement diffusés dans tous sorte de médias, ont pour conséquence la mobilisation
individuelle et la publicisation de soi via les médias informatisés, en ayant comme modèle
d’action les early adopters, à savoir la communauté des pionniers de l’internet, baignée dans
les idéaux libertaires et la valorisation de l’individu. C’est ainsi que nous retrouvons, dans les
communautés en ligne, des exemples de valorisation de la contribution (popularité des
producteurs actifs ou les « résolveurs » dans le cas de Quora) et des tactiques de médiatisation
de soi qui différent selon les attentes et le degré d’engagement de chaque utilisateur. Au vu de
tous ces éléments, nous pouvons considérer la promesse (de l’émergence d’une nouvelle
société en réseau, d’un glissement de paradigme, ou du déplacement des centres socio-
économiques) comme un levier de motivation derrière l’usage des plateformes collaboratives
sur internet.
Conclusion
Dans le cadre de ce travail de recherche appliqué, nous avons essayé de répondre à la
problématique suivante : Quels sont les facteurs de motivation derrière l’engagement des
internautes sur des sites de partage de l’information tels que les forums de discussions et les
plateformes de questions-réponses ? Pour ce, nous nous sommes basés dans notre
développement, sur un corpus alliant des théories fondamentales et des recherches empiriques
similaires à l’observation participante que nous avons menés sur le site Quora. Des entretiens
qualitatifs ont été réalisés auprès de professionnels du secteur de l’information (plus
particulièrement le management des SI) autour de la question de la contribution au sein de
l’entreprise, et un questionnaire prospectif diffusé sur le web (principalement par emails) a
recueillis 100 participations. L’échantillon observé sur notre objet d’analyse (Quora) a réuni
20 utilisateurs que nous avons répartis, selon leur degré d’engagement et leurs usages de la
plateforme, dans des typologies servant à faciliter le travail de croisement et de comparaison
des données. Un questionnaire individuel a été adressé à chacun de ces utilisateurs en plus des
interactions que nous avons pu avoir avec eux en utilisant les fonctionnalités du site
(invitation à répondre aux questions, votes, abonnements etc.) Cette méthode nous a permis
de répondre à nos hypothèses et de conclure comme suit :
Les internautes utilisent les sites de questions-réponses principalement parce que l’accès
à l’information y est gratuit et rapide. L’apprentissage et les découvertes ‘hasardeuses’
durant la consultation des messages sont considérés comme un avantage inhérent aux médias
informatisés. La réciprocité anticipée est le premier levier de motivation cité chez les
producteurs de contenu les plus actifs en plus d’un souci de rectification des informations
jugées inexactes ou imprécises. Pour l’ensemble des internautes, les informations qui
circulent sur le web ne sont pas considérées comme entièrement fiables, raison pour laquelle
ils continuent d’avoir recours à l’expertise professionnelle.
Les résultats de l’observation conduite sur le site Quora ainsi que l’analyse des discours
qui y sont émis, ne permettent pas de valider le facteur militant derrière l’engagement des
internautes puisqu’à aucun moment, il n’a été question d’une remise en question organisée,
ciblant un système de représentations ou une idéologie dominante. Les sujets à portée
politique sont d’ailleurs minoritaires par rapport au nombre total des discussions. Toutefois,
des donations régulières de ‘crédits’ ont été observées sur le site, confirmant partiellement la
thèse de la théorie du don, mais nous avons été incapables, au vu de la durée limitée de cette
observation, de juger de la pérennité ou de l’universalité de tels comportements (le contexte
étant particulièrement réduit). Nous infirmons donc, au vu de l’analyse de ces résultats,
l’hypothèse de l’engagement militant comme levier de motivation derrière l’investissement
des sites de partage d’informations.
L’analyse de la littérature existante nous a permis de mettre en évidence des motivations
d’ordre carriériste chez différentes populations usagères du web, dont nous avons retenu la
communauté des développeurs du logiciel libre. La recherche en question a en effet
démontré un processus de passage d’un modèle de contribution à un modèle salarial que
l’auteur désigne comme une « trajectoire de professionnalisation ». Dans le cas des
utilisateurs de Quora, il s’agit d’une valorisation des compétences dans un but d’acquisition
de nouvelles opportunités (potentiels prospects). Ont notamment été observées, des stratégies
commerciales ainsi que des tactiques d’activation de réseau, chacune de ces procédures étant
plus adaptée à un groupe de métier (professions libérales, professions intellectuelles
supérieures, carrières artistiques). Les procédés plus ‘marketing’ (publication d’articles,
publicité directe de son business etc.) sont toutefois vite discriminés par un système
d’évaluation permettant de faire remonter les contributions jugées plus qualitatives, poussant
ainsi l’internaute à une démarche plus sophistiquée de publicisation de ses compétences.
Le souci d’exactitude et de méthode scientifique chez une partie importante de
producteurs de contenu, nous amène à penser que la figure de l’amateur-professionnel
s’inscrit dans une démarche ‘d’exportation’ de culture académique plutôt que de rupture avec
les méthodes d’expertise. Comme notre raisonnement se base sur l’observation d’un site web
précis, nous avons pris le temps de démontrer en quoi Quora n’était pas un réseau social de
niche, écartant de ce fait les biais pouvant nous empêcher de généraliser les résultats à
d’autres dispositifs d’échange d’informations (notamment les forums). Ces éléments nous
permettent de confirmer la thèse stipulant un rapport entre l’engagement des individus dans
les médias informatisés et la constitution d’un projet professionnel. Cela n’explique
cependant qu’à moitié le degré d’engagement des acteurs sociaux, notamment quand nous
notons une participation particulièrement accrue chez des individus hautement qualifiés et
n’ayant un besoin immédiat de constituer un capital expérientiel à des fins de recrutement.
La dernière hypothèse développée dans notre recherche semble répondre à ce questionnement.
En parcourant la littérature traitant des technologies de l’information et de la communication
à l’ère numérique, nous avons noté la présence d’un discours de promotion à très forte portée
médiatique, spéculant sur l’advenir des médias informatisés et allant jusqu’à leur attribuer des
vertus démocratiques voir anthropo-salvatrices. Portant sur des pseudo-concepts comme la
‘société de l’information’ ou l’intelligence collective, ces énoncés publicitaires atteignent
d’abord des communautés restreintes de pionniers pour ensuite se répandre via les dispositifs
numériques qui portent en leur usage, l’idéologie défendue par leurs fabricants. Des auteurs
ont mis en évidence les origines idéologiques des valeurs défendues par ces cyber-
enthousiastes et nous avons noté suite à notre étude, la construction d’un imaginaire de
l’internet, très vraisemblablement responsable de l’autoréalisation de ces énoncés, dans un
effet de boucle fermée : 1) appel à agir en brandissant le message d’une supposée réalité où
les médias informatisés seraient hégémoniques, 2) réponse des premières communautés
exposés au message par un investissement et une évangélisation accrues 3) massification des
usages en rétroaction à l’appel des pionniers 4) Utilisation des chiffres enregistrés comme
argument statistique pour amplifier l’appel à agir 5) retour à l’étape 1). C’est ainsi que nous
considérons les discours promotionnels dominants comme un levier de motivation tangible,
qui explique en grande partie les phénomènes de contribution sur les plateformes d’échanges
numérisées.
De ces conclusions, nous supposons que l’évolution de ces plateformes, et plus
particulièrement des sites de questions-réponses, va aller dans le sens d’une hyper-
valorisation de l’individu (après les architectures de type user-centric et les actuels débats sur
la notion d’empowerment, nous allons probablement assister à une accélération des
fonctionnalités sociales et de publicisation de soi) tandis que les dispositifs d’appariement
pourraient devenir de moins en moins implicites pour laisser à l’utilisateur, la possibilité de
faire directement publicité de ces compétences professionnelles. La permissivité des
administrateurs du site Quora par rapport aux formes les plus directes de publicité (visibilité
de son site marchand, cooptation de ses collègues etc.) va déjà dans ce sens et nous donne un
aperçu de ce que seront les plateformes collaboratives de demain.
Bibliographie
- BEAUDOIN Valérie, (2011). "Prosumer : quand le consommateur devient producteur (de soi)",
Communications, 89, p. 131- 139.
- BERAUD Philippe et CORMERAIS Franck, Économie de la contribution et innovation sociétale
in Innovations 2011/1 (n°34) P. 163-183.
- BONG, M., & CARK, R. E. (1999). Comparison between self-concept and self-efficacy in
academic motivation research. Educational Psychologist, 34(3), 139-153.
- CAREE Philippe, De l’apprentissage social au sentiment d’efficacité personnelle : autour de
l’œuvre d’Albert Bandura, coll. « Savoirs », 2004
- CASTELLS Manuel, La Société en réseaux, Fayard, 2001.
- DAHLGREN Peter, Media and Political Engagement. Citizen, Communication and Democracy,
Cambridge, Cambridge University Press, 2009,
- DEMAZIRES Didier, HORN François, ZUNE Marc, Les développeurs de logiciels libres: militants,
bénévoles ou professionnels? In Demaziere, D. Et Gadea, C., Sociologie Des Groupes
Professionnels, Paris, La Découverte, 2009
- FLICHY Patrice, Le sacre de l’amateur : Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique,
Seuil, 2010.
- GRANOVETTER M, The Strength of Weak Ties, American journal of Sociology, Volume 78,
Issue 6 (May 1973) 1360-1380.
- JEANNERET Yves, La « société de l’information » comme figure imposée. Sur un usage
particulier des mots en politique, in La « Société de l’Information » Entre mythes et réalités,
sous la dir de Michel Mathien, 2010.
- JEANNERET Yves, Penser la trivialité, volume 1, 2009.
- JEANNERET Yves. Usages de l'usage, figures de la médiatisation. In: Communication et
langages. N° 151, 2007. pp. 3-19.
- JOHNSON Steven, Emergence : The connected lives of ants, brains, cities and software,
Scribner, 2001
- KARPIK Lucien, «L’économie des singularités», é2007, Gallimard, Bibliothèque des sciences
humaines, Paris
- L’Intelligence Collective, Actes de la première Université d’été, Université d’été de la FFC Pro,
12 & 13 septembre 2008, PARIS
- L’intelligence collective, dossier Sciences humaines, n° 169, Mars 2006
- LABELLE Sarah, « La société de l’information. A décrypter », Communication et langages, n°
128, 2001, pp. 65-79
- LANIAU Jérôme, Dossier Réseaux internet et lien social, Vers une nouvelle forme
d’intelligence collective, in Empan, 2009/4 (n° 76), 176 pages
- LERNER Josh & TIROLE Jean, The Economics of Technology Sharing: Open Source and Beyond,
Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 2—Spring 2005—Pages 99 –120
- LEVY Pierre, L’Intelligence Collective, pour une anthropologie du cyberspace, 1994, La
Découverte
- MCLUHAN Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, MIT Press, New Edition
1994 (initial edition: 1964).
- MERTON Robert K. Social Theory and Social Structure, Macmillan USA, 1968.
- QUONAM Luc, LUCIEN Arnaud, L’intelligence économique 2.0 ? in Les Cahiers du numérique
2009/4 (Vol. 5), 196 pages.
- RAFAELI, S., RABAN, D.R. and RAVID, G. (2007) 'How social motivation enhances economic
activity and incentives in the Google Answers knowledge sharing market', International
Journal of Knowledge and Learning (IJKL), Vol. 3, No.
- RHEINGOLD Howard, Les Communautés virtuelles, Addison-Wesley France, 1995.
- ROSENBAUM, H., & SHACHAF, P. (2010). A structuration approach to online communities of
practice: The case of Q&A communities. Journal of the American Society of Information
Science and Technology, 61 (9), 1933 ‐ 1944.
- ROSENTHAL R. et JACOBSON L. Pygmalion in the classroom, The Urban Review, Volume 3,
Issue 1 , pp 16-20, Kluwer Academic Publishers, 1968.
- SMITH Marc and KOLLOCK Peter (editors), 1999. Communities in Cyberspace. London,
Routledge
- SUROWIECKI James, The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and
How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations Little, Brown,
2004