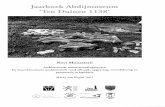Marcas Negadas por Ofenderem a Moral e os Bons Costumes: um estudo de caso
"Vie et mort d'une résistance. Le dernier siècle de l'hérésie des bons hommes en Albigeois...
Transcript of "Vie et mort d'une résistance. Le dernier siècle de l'hérésie des bons hommes en Albigeois...
illdl-PyrénéesPatrimoine
En Albigeois, terre emblématique de la dissidence,celle-ci entra en déclin dès les années 124O, tout
comme dans le reste du languedoc.La dure répression menée par l'évêque dfAlbi Bernard
de Castanet et par l'lnquisition de Carcassonne suscitaune importante vague de contestation au début du
DDieu »
Notel. La meilleure synthèse sur la
dissidence des bonshommes dits à tort« cathares » est celle de
Jean-Louis Biget, Hérésie,politique et société enLanguedoc (vers 1 1 2O-vers1 320) dans Le pays cathare:les religions médiévales etleurs expressionsméridionales, JacquesBerlioz i dir.L hris, PointSeuil.1000. p.17-79.
Dossier
Le dernier siècle de I'hérésiedes bons hommes en Albigeors (122e-v. rrso)
Vie et mortd'une résistonce
XlV" siècle. Mais l'hérésie des bons hommes sréteignitensuite très rapidement.
ans l'histoire des bons hommes « amis deet de leurs croyantsl, une nouvelle ère
commença avec l'institution, au concile deToulouse en 1229, de mesures d'exception pourfavoriser la chasse aux hérétiques languedociens,mesures renforcées un peu plus tard, entre 123iet1233 avec la mise sur pied des tribunaux d'in-quisition par le pape Crégoire lX. S'ouvrait lesiècle ultime de la dissidence, temps de recul,où elle se réduisit bien vite, dès les années 1240sans doute, à une résistance vouée à la clan-destinité et à la persécution, résistance bientôtrésiduelle, malgré quelques fugaces regains dedernière heure à la fin du Xllle et au début duXlV" siècle. Temps de déclin et bientôt d'étiole-ment, jusqu'à la disparition finale.Albi et l'Albigeois-qui étaient des lieux relle-ment emblématiques de l'hérésie des bonshommes que ce mouvement dissident fut d'abrordnommé dans son ensemble, pour tout le Langue-doc, o hérésie albigeoise » -, connurent para-doxalement une répression inquisitoriale moinsintense que bien d'autres régions méridionalesavant le milieu des années 1280, avant que nese développe l'action énergique d'un évêqueenvoyé sur place par la papauté à des fins demise au pas, l'intransigeant Bernard de Casta-net-
La ville d'Albi avait pourtant fait preuve écla-tante d'insoumission dès la première incursionforquisitoriale à l'intérieur de ses murs, en 1234.
Par,lulien lhéy
Maître de conférences à i'Université Montpellier lll et chercheuraq Centre historique de recherches et d'études médiévales sur IaMéditerranée occidentale (CHREMMO), Julien Théry a soutenuen 2003 une thèse de doctorat intitulée : Fama, enormia. l'en-quête sur les crimes de l'évêque d,Albi Bernard de Castanet(1 307-1 308). Cauvehement et contestation au ternps de lathéocratie pontificale et de l'hérésie des bons hommes.
Cette année-là, le frère Arnaud Cathala était venuenquêter dans Ia cité des bords du Tarn, en appli-cation des pouvoirs très étendus que lui confé-rait l'« lnquisition de la dépravation hérétique,(pour reprendre Ie nom officiel de cette juridic-tion toute-puissante, qui dépendait directementdu pape et de lui seul). ll avait prononcé unesentence d'exhumation des restes d'une bour-geoise convaincue d'avoir reçu le sacrement desbons hommes hérétiques au moment de sa mort.Les notables de la ville furent indignés par labrutalité et l'efficacité des méthodes de l'inqui-siteur, jusqu'alors inconnues dans un Langue-doc où les bons hommes et leurs amis avaientvécu sans être sérieusement inquiétés (sinondans des circonstances exceptionnelles au coursde la croisade albigeoise).Arnaud Cathala ne tarda pas à être chassé d'Albi,comme l'avait été de Narbonne un de sescollègues l'année précédente et comme le futdeToulouse un autre l'année suivante. Dans sonrécit de l'émeute et de la tentative de lynchagequi contraignit l'inquisiteur à la fuite, le chro-niqueur Cuillaume Pelhissou cite, parmi Iesnoms des meneurs de la sédition, ceux denombreuses familles appartenant à I'oligarchieconsulaire- les Fenasse, Foyssens, Amat,Guignou, Delport, Broze, Fumet-dont onretrouve des membres condamnés pour hérésieplus d'un demi-siècle après. Preuve qu'à Albicomme ailleurs, l'adhésion à l'hérésie des bons
t4
liéiÉiiri ues r: +ijrâi-ar ûarr's
/e büc,he,'.s,rir-ç fe reg,tcd.: Ph![ippe Augt;ste
iCra::rk:s r:hrcn!ques de5aii'rt-lleni:, Xl\,'c siè:rie.Tr:ulou=e, 3i'n!icthèque
muriicipale, m:,512).
Uie etd'une
bûcher ou à I'emprisonnementperpétuel.À partir de la fin des années
124O, la dissidence ne futcombattue que très mollementdans la région. D'abord en raison
des difficultés générales de l'ln-quisition en Languedoc, paralr'sée pendant plusieurs années par
les tensions entre dominicains.papauté et juridictions éPisco-
(1243) contre le roi de France, la réconciliation pales. Mais ce long répit accordé aux bons
du comte avec le pape et l'assassinat de deux hommes et à leur amis fut principalement lié à
inquisiteurs àAvignonet, en Lauragais,le2g mai un facteur spécifique à Ia ville d'Albi, à sar'oir
1242, expliquent l'intensification générale de l'alliance entre les évêques Durand de Beau-
l'action inquisitoriale pendant cette période. caire (1 228-1254), puis Bernard de Combret
MaisAlbietl'Albigeoisfurentrelativementépar- (1254-1271), et les dirigeants de l'oligarchie
gnés. On y garde trace au total, pour cette municipale, contre les tentatives des orticiers
époque, d'une trentaine de condamnations au royaux pour étendre leur juridiction dans Ia
hommes relevait de choix fami- On y garde traCeliaux.La période d'activité de frère au total, pour cetteFerrier, de 1237 au milieu des époque, d'uneannées 1240, fur celle de la üentaine derépression la plus forte en Albi- ,geois avant les procès présidés par condamnations aul'évêque Bernard de Castanet en bûChef OU à1286-1287 . léchec des révoltes l,emarisOnnementdu vicomte Trencavel (l 240) et du 'comte deToulouse Raymond Vll
Midi-Pyrénées làtrlmoire,@
Midi-PyrénéesPatrimoine
N§ §8
.Érurirrs ;rnolgirfiïr rc fnrrr;t
-.ffft ^.-'t.o..+.'aur§.r1.
rï."o,ro',,rrnr. slrarâ,ro,,rsrr.n, rEfl f",'"" "1"'u
wr.'plt[' Épmri 1'r,â m-e,i.,u yù 6 t'7Ë',
Si?.r!. i,,'in .;rrtrn.r rfr alLâ.rc.U'l..* rli; t"" tir ";ÂL'" b''rllrne .,lLr È,,ùl it'.' i,"ifirrc ltmc [,,mnoi,rsrro1ior"1,,frsfltp,,mm.lnnPpry 6'.'ïit.*, .*,rJi" r'.l".--r /.,'t{*"*- lt,f ÊiFrtu aûrt ùmr.J, r r,rl,rc ù",,s r,,rux,8,,rr. ,i*fi^.i,-æ- ,lf,,,,1-i ffirr.l,ro rnT oSro a,,u* ,,P 1*,,* .r,[pJ,t,à. r'n-,j'lü o"'r r,r *'^,"hÊ D; 1oo\i ftr 6r,h.,{ trrallr rh',!an,,,orllnii w"rrt>",ii,[".". t,o,c 1"rnî l,roo fuiio .1,æ ,fr c. uàornrolrrrc ùè-æ narar 'Én.6 tfif.dlfnr4:' .1'.'11ut.*. trôr'ot hîr tüftr .,-üatE; F§ar; Ê fq,nr. ,rcÊÈ §e.e. ,.fnr
"i ümî f »,r l*ii < Jpl Fnfl 'J'ilo,. I o- üi:.1'.n. na.,, nrc,n !ù
f ri ÊJ*,, rp.rî fu on' r\au.',,, d-o :o p"r, p- p" :l-- .'rac'r- lpnrii tù fr r&,ù à*rçraf a$uâ fsà l,oo td;r i[ rr'a*I',r;.p-.r. rain. pll.>llc a-,rf . 3lLr.{ funru ta,,r rlr b,',,îrfi"-c. * n3rr,r,y--r.c. ià ioa r,,o q' .À;pw'"r«a ü;."1,i .,narr, . 1.aÈq,,c ü,. '@ltitfa È r',,,',,r ,È <.oi rn',' nÈF,{!ssâ F*o §Ê'o.iii. FoÈ1n. :rî § l6"a Ç[à,cr""§n. ll],p--a.
"-11i xna 1!É'rtmrF rF'iia,ïd§û,r'r .æ ,7 6.nir ô *,,,o. -
+'*Ér,î &,;;i pffr l,rrrir l,fr', 1fl'.,Iv'd*-"à ]§rî' . cî. 'ii.e .
rolf f.oiu ràorr,rrr p mlii l*re: - l,u,'".s .1:r r [---r'e.,.i.!)c Érsr ft,-- l'oliio-., -( 116 6g,,nrrrr r âro i:..) m- ru- fr r tdle îfu .È.rl[àî 5à*" .i,i; tn ifirm r i.rÉî eli;È t:,' É.1 É'i-,,b i ni,ur'.p,-. ni5iâ'.'-î.l É'; 7§lf. p iî . È .,r',a/i,, r 1m' §ï §,ii df ru r
rx'l'.rFti ü,os §'Ès. ".È
*|io,, i1"*,r aÊ atÊà . p'r"i * 6a-x,{b dJ;-f' û,,,Ë,.-1 F&ü- §â )'n.,,I.if, s raf i@,,;i.âî b -
i.,p.n,,.,u. *q,*'61.i- rl.l'rfir.u o,r','n .6 pr'.rfi oL1îr [rÀ:yî .6n, l{faî1 É*a i"r,irÉ-fr 1r8,rfr -ê. .rr,rr, Fntttt i.S lI" -
iî:a- c"i oiî r ü,Â: $ d"srr. -ïei §'î cfi î o','mæ r}rp
_ra.
dm$ l,§rf .tpû,101û ;àxtf.-..1 i
.t'I,r.r{,, il à rrtli..â,,"i \',È..t!È 'J';fl"""i'-J''i1:' .-1,îu'rF..{,,r, ",rrt, r,'ÊpP;fi-rr'tÊ.'[,;c .. b"r' lrd .uîli'"'rn'r l
i\i*iii: if ol"'r i''a''æ url8*'rrmm =î 'Fr' u'r'lf': r;,"a' r'i'rullrr,,,ÉÈ .,, i rà T,'ù,,o :i-'i Lùc -u. r,.,t,:- §p.ræ 6 . p.'' 6r', lt.
l'..".,1. i. ;..l.,d, . Jrie.n r.p- asrru-r Fù §1it,;' Ë '!"*.'. Ë-plf.-, .Ë.trfioli.{.-i ;p'',',.r ^].'È
.tr: ]ft'i- r.rc.urs., *,iro.-1. É- Ên.I 1,îjF-,; {,,nl'r : f F'rd tlrtil'tLin rrl',,,r r.- fs- n,i t.à,-e..r lÀn' lF- f ...ç - "iæ "'
o ""
rÈi i1,',', r,-^i t,J,ou"l fr,,r- * sro'b .r,;$,L Ê;' rî î'f c,iF T:tLlr ur !ir=.r.rf'41 pc rls 3o,ilÊnàru,id 6 æri :ô lftr "ore.r,a,f':,,,r- § fc"a-. ,fr+ r*io J,l.7tri.,,oùn_ .: Ês l'.ïnaô,rt 1C r',Jrrlr îS' 'î''Êr.{'nlôdE-îr\éaFdfldô
'rxtuû Êü;- ùb-,ilgr'?.É.ue{*n.,.q.;i.rli' ! &r !p"ç rs'*r-u.-".n,,. rÊ<. a&,m,,,r i§b=-o l-"io f{-or,,[, §o"lb lîSà-
Ê ,,pàn Eo!çu. EÂ1,,,1i/A'"!',; rr"'-"- :a pn 66 'i'fi'e '§âq, ,a .*. rp"o rii "nr6h:,1,,"- . É..1'"1r/ i1îr-sfi'Ée.,à"i.I':a r rpri,n[-.4 .§'l 'a 5 . > ùt 'rt 'ol.r .l lurn §'r: 1'firrrtr irro c,t.1i-1.0" ap1i,r rrrro r f,,. yaî tr.à oà S'âcF r f .irlms ËSùirr,'mf ." r-. "Èl;.1"'Èt,dd
1 E0; rul'F t " 1t'1 pf-"6S16 aæo i,,i,,i .,fli; -',,4- f fi p.r.'4r.,Ll'-'h +"'-''$,4 . ;. Ê rutfo". iiifq ",ii rltio-ii - 1.ttô, 1* !È -I"tt: rÿt tiÇ*t..l';- i psa .a . ;";. É. - r""*ll',, r nr',ù' [.j'" nX:^S: S'ôg r,rq'4o u . lil'ntor 6rou Smu "l [tss. aflcruti.,[6,ir. *",Ê"h; S 1o§, 6]à,,6 'æ'i aÊ s.{F.m.J.'oü' }t,,.,ro L-ra æ's .""*a §}ws-ê'.-'*' o.-" i- i': 1l rfi
':n& ,ùê,,rd mi 1n'efio:'f, r;# pî.f6d, liftâf Êfr F'y"ê.,,6 rtf ,râ *,a a. ".' Ê;ïe $,slid pî r æ f.i'-oG r' li À+5i:, r-6i. rr s'iï .F iɧii- t ..,,,nê t s'-s.J[iâ '-p .'l its,'5'- rcn.' ^iLiE aT,,Ê ïG+"'"t... S uiil-ao lÉg nii 'Fr rF-t"ifa. ,i pi,F'"§ r ,æ1'","0 '.-
Confession de Bernard Audiguier dit Apostole, de Lescure (Tarn),devant l'!nquisition à Albi (2 et 30 mars 1300)
Les deux pages manuscrites reproduites ici sont les folios 31 verso
et 32 recto d'un registre, aujourd'hui conservé à Ia BnF (ms lat.
11847), contenant les procès-verbaux d'interrogatoires menés àAlbi par l'évêque Bernard de Castanet et un tribunal de l'lnqui-sition, de décembre 1299 à mars 'l 300, au cours d'une série deprocès pour crime d'hérésie. 35 accusés, habitants du diocèsed'Albi, furent alors jugés - et pour la plupart condamnés à laprison perpétuelle.Sur ces deux folios sont enregistrées les confessions faites par unhabitant du village de Lescure, Bernard Audiguier, dit aussi Apos-tole, lors de deux interrogatoires successifs. Au cours du premier,
daté du 2 mars I300, l'accusé reconnaît seulement avoir aidédes bons hommes hérétiques à circuler clandestinement et avoiraccepté, à leur demande, de les « adorer » -selon le terme très
péjoratif employé par les inquisiteurs-, c'est-à-dire de leur faireune révérence rituelle considérée par l'Église comme un acted'hérésie.Les inquisiteurs ne furent pas satisfaits par cette première confes-sion/ sans doute parce qu'ils disposaient de leur côté, grâce à
des dénonciations enregistrées, de pfus d'informations sur les
fautes de l'accusé. Selon leur technique de pression habituelle,ils laissèrent Bernard Audiguier passer quatre longues semainesen prison, probablement dans des conditions très pénitrles, avantde procéder à un second interrogatoire (peut-être précédé d'uneséance de torture), le 30 mars suivant. Bernard Audiguier complètaalors ses aveux, en confessant avoir assisté à l'« hérétication»
d'un juriste par les bons hommes Raymond del Boc et RaymondDidier et en dénonçant sept habitants d'Albi qui assistèrent à lacérémonie. On remarquera le mot hereticatioécrit en marge, en haut du lolio 32 recto, faceau texte correspondant. Ce type d'annotationfacilitait l'usage de leurs archives par les inqui- tsiteurs, qui effectuaient des recoupements lsystématiques entre les confessions et dénon- |cialions pour mieux confondre les accusés etles forcer aux aveux.Voici une traduction du début du texte du second interrogatoire(il s'agit du début du paragraphe commençant au bas du premierfolio) :
Après quoi, l'an du Seigneur 1300, Ie trois des calendes d'avril,ledit Bernard, constitué en jugement devant ledit seigneur évêque
et les vénérables et religieux hommes frères Nicolas d'Abbevilleet Bertrand de Clermont, inquisiteurs cle la dépravation hérétiquedans le royaume de France députés par l'autorité apostolique,revenant à son ccrur, se souvenant plus complètement/ ajoutaaux chases sudites en disant qu'il peut y avoir six ans ou envi-ron, à ce qu'il lui semble de l'époque-il ne se souvient pas plusprécisément en ce qui concerne la date-, alors que maîtreGuillaume Adémar, juriste, était malade, à Albi, chez lui, de lamaladie dont il est mort, pendant cette maladie, comme ledittérnoin était venu de Lescure et était entré dans la chambre danslaquelle ledit malade était alité, iltrouva là réunis...
1tu'',2' +,r3n((t(!.
Notes2. Selon Ie comptage de
J.-1. BiBet, L'extinction ducatharisme urbain: Ies
points chauds de larépression, dans« Effacement du catharisme(Xlll+XlVes) ? », Cahiers deFanjeaux, 20, 1985, p. 305-340, p. 31 1.
3. Voir notamment J.-1. Biget,La restitution des dîmes par
Ies laïcs dans le diocèsed'Albi au Xlll" siècle, dans« Les évêques, les clercs etle roi (1 250-1 300) ,, Cahiersde Fanjeaux, T, 1972, p.21-t -283.
cité-tentatives de plus en plus pressantes après
la soumission à Louis IX du dernier opposant aupouvoir capétien en Languedoc, le comte deToulouse Raymond Yll, en 1243.llhérésie des bons hommes n'était le fait qued'un milieu social assez étroit, qui correspon-dait largement à l'oligarchie consulaire. S'ils s'en
étaient pris à cette dernière en s/attaquant à ladissidence, les évêques auraient à coup sûr favo-risé, au détriment de leurs droits seigneuriaux,une intervention des officiers de Louis lX. Aussi
les deux prélats firent-ils preuve d'un évidentmanque de sévérité en matière d'hérésie.Durand de Beaucaire accepta par exemple d'en-quêter sur l'exhumation des restes des bourgeois
Jean et Arsinde Fenasse, à Ia requête de leursfils, en vue d'une réhabilitation. ll renonça auxconfiscations prononcées contre deux amis des
bons hommes dénommés Cuillaume de Foys-
sens et Cuillaume Roger, qui avaient fait péni-tence et payé des amendes. ll se garda égale-ment d'attirer I'attention inquisitoriale sur laville-sa propre pafticipation au siège du château
de Montségur, en 1 242, visait d'ailleurs à luiéviter les soupçons de laxisme. Sous son épis-
copat, les inquisiteurs en charge dans la villeétaient non des dominicains (directement soumis
au pape) mais des clercs séculiers, dont l'actionfut très modérée. Bernard de Combret, son
successeur/ eut le même comportement conci-liant.Hors d'Albi en revanche, pour l'ensemble dudiocèse, les documents attestent une reprise des
activités inquisitoriales en Albigeois dans les
décennies 1260 et 127O. On est assez bien
Vied'une
renseigné, en pafticulier, sur une campagne d/en-quêtes commencée en 1274 dans les campagnes
albigeoises par les inquisiteurs Ranulphe de PIas-
sac et Pons de Parnac. Les bons hommes étaientalors nombreux à sillonner le pays, notammentles Albigeois Raymond del Boc et RaymondDidier (cf. encadré), dont Ia condamnation parcontumace fut publiquement prononcée en mai1276 par l'lnquisition de Carcassonne.ll ne fait pas de doute que Ia dissidence connutégalement une certaine prospérité à l'intérieurde la cité épiscopale à la même époque. Les
confessions obtenues lors des procès d'lnquisi-tion de 1286-1287 par l'évêque Bernard deCastanet permettent de recenser, pour unepériode qui s'étend entre 1258 et ces dernièresdates, soixante dix-neuf repas clandestins des
bons hommes avec leurs amis et quarante quatreconsolaments administrés par ces derniers2. Onpeut cependant se demander si la dissidencen'a pas été quelque peu stimulée/ voire renfor-cée, après 1276, par le gouvernement à poignedu nouvel évêque Bernard de Castanet.Celui-ci était un étranger à la ville et au diocèse,qui n'était donc pas lié aux intérêts locaux.C'était un fidèle serviteur de la théocratie ponti-ficale, qui avait lutté en son nom contre les gibe-lins et les hérétiques en ltalie du Nord, avantd'aller réprimer des rébellions à l'autorité dupape et de l'Église romaine en Rhénanie. Inno-centV le premier pape dominicain, le nommaévêque d'Albi en vue d'une reprise en main decette ville-symbole de l'hérésie.
La nouvelle cathédrale Sainte-Cécile
lJépiscopat fut un long combat, bien connu grâce
aux études de l'historien Jean-Louis Biget, pourl'appl ication d' u n projet pastoral théocratiq ue3.
La meilleure expression de ce projet fut donnéepar Ia construction d'une nouvelle cathédrale,décidée par Bernard de Castanet le lendemainmême de son arrivée dans la ville. Encore bienvisibles aujourd'hui, Ies premiers murs, formi-dables, de cette nouvelle église Sainte-Cécile,de même que les fortifications massives du palais
épiscopal de Ia Berbie, construites égalementpar l'évêque, imposaient clairement à Ia ville Ie
programme politico-religieux du prélat.llavènement de Bernard de Castanet avait coïn-cidé avec I'installation d'un couvent dominicainà Albi. Dès les premiers temps de l'épiscopat,
a
{
E
.a
E
U
Àlbi ; ie Pcni-\,Iieur el lacathédvale. coûstruite à
t'ir:itiative de ['évêqueBernard de Caslanet" quien posa !a prenrière hriqueen1)t-7, pour répondre audéfi de ia dlssrdence ders
bons h*mmes,
Midi-Pyrénées Patrimoine T rl[]
Bibliographie sommaire
. Biget flean-Louis), Hérésie,
politique et société enLanguedoc (vers 1 120-vers1 320), dans Le pays cathare :
les religions médiévales et leursexpressions médiona les,jacques Berlioz (dir.), Paris,
Point Seuil, 20OO, p. 17-79.
. ld., Réflexions sur l'« hérésie »
dans Ie Midi de la France auMoyen Âge, Heresis, 36-37,2OO2, p.29-74.
. ld., Les bons hommes sont-ilsles fils des bogomiles ? Examencritique d'une idée reçue, dans« Bogomiles, Patarins etCathares », Slavica Occitania,16,2003, p. l 33-1 88.
. Brunn (Uwe) Cathari,
catharistae et cataphrigii,ancêtres des cathares du Xllesiècle ?, Heresis, 36-37 , 2OO2,p. I 83-200.
. Théry (Julien), llhérésie des
bons hommes. Commentnommer la dissidencereligieuse non vaudoise nibéguine en Languedoc ?,
Heresis, 36-37, 2002, p. 7 5-117.
. ld., Cléricalisme et hérésie des
bons hommes: I'exempled'Albi et de l'Albigeois (1276-1 329), dans « l-'Anticléricalismeen France méridionale (milieuXllqdébut XlV" siècle) » ,
Cahiers de Fanjeaux,38, 2003,p.471-5O8.
. Zerner (Monique), êd., lnventerI'hérésie ? Discours polémiqueset pouvoits avant l'lnquisition,Nice, 1998 ; L'histoire ducatharisme en discussion : lea concile » de Saint-Félix1167), llice, 2OO1 .
i;i
Ia mise en place sur la porte de Ronel, près ducouvent, des portraits ou statues de saint Domi-nique et de saint Pierre de Vérone, patron desinquisiteurs maftyrisé par un hérétique en 1252,affichèrent les symboles du retour à l'ordre. En
septembre 1285, Bernard de Castanet accueillità Albi l'inquisiteur de Carcassonne Jean Caland,menacé dans sa ville par un complot, et jugeales coupables à ses côtés, avec le titre de vice-gérant de l'lnquisition. ll obtint probablement à
cette occasion des renseignements sur l'hérésiedans son diocèse. Au mois de janvier suivant,I'évêque ouvrit un long procès d'lnquisition quilui permit de recueillir, auprès d'une dizained'accusés, plus de quatre cent dénonciations.La moitié des personnes compromises étaientdes habitants d'Albi dont Ia quasi-totalité appar-tenaient aux couches dirigeantes de la sociétéurbaine. Or l'alliance entre les grandes famillesde la ville et le pouvoir épiscopal avait pris fin.Le gouvernement très autoritaire de Bernard deCastanet, qui s'opposa durement à tout déve-loppement de l'autonomie municipale, avaitrapidement abouti au conflit avec les bourgeois.Au terme des procès d'lnquisition de 1286-1287,déviance religieuse et opposition politiquepouvaient donc être identifiées par lrévêquecomme les deux visages du même ennemi.
Un fichier de dénonciations
Contre une oligarchie déterminée à lutter contreson pouvoir temporel, Bernard de Castanet dispo-sait désormais d'un atout redoutable avec le véri-table fichier de dénonciations constitué lors deces procès. ll en usa pleinement au moment oùles Albigeois le menacèrent d'un coup fatal. Àpartir de 1297 et pendant plus de deux ans,
Ifie et lnor.td'une régistoncc
l'évêque fut confronté à un procès mené par les
bourgeois devant les tribunaux royaux pourneutraliser sa juridiction seigneuriale. La réac-tion fut brutale: de décembre 1299 à mars 1 300,l'lnquisition frappait Ia tête de l'oppositionurbaine. Au terme de procédures exceptionnel-lement rapides, vingt-cinq Albigeois, issus des
familles les plus influentes et comptant parmiles opposants les plus actifs, furent condamnésà Ia prison perpétuelle pour crime d'hérésie.Non que l'évêque ait faussement accusé dedéviance dans la foi ces adversaires politiques.Tout prouve au contraire que les condamnésétaient bien des amis des bons hommesa.
liépopée et le complotdu franciscain Bernard Délicieux
Le conflit entre Ia ville et son seigneur évêqueprit alors une intensité nouvelle. Alliés aux repré-
sentants d'autres villes languedociennes entréesen Iutte contre l'lnquisition, les opposants à
Bernard de Castanet s'engagèrent de 1 301 à
1305 dans une étonnante épopée politique, quis'acheva par une déroute et une dérive. Emme-
nés par Ie franciscain Bernard Délicieux, meneurintrépide et charismatique, capable d'unifier le
mouvement anti-inquisitorial et d'en être le porte-
parole inspiré, ils obtinrent d'abord de grands
succès. Pétitionnant, voyageant à travers Ie
Languedoc, envoyant des délégations auprès des
représentants royaux et même auprès de Philippele Bel lui-même et de la reine Jeanne, ils parvin-rent à mettre à profit la politique religieuse duroi, dont l'objectif majeur était alors d'obtenirla soumission de l'Église gallicane contre les
prétentions théocratiques du pape BonifaceVIll.Dans une confrontation avec les inquisiteurs
o
*
,!
Ee
.a
U
Aibi : le palais épiscopalde la Berbie, forriTié par
ilernard de Castanet, et le.
cathédrale, af{irment lapuissance de l'Égtise.
I
I
Midi-Pyrénees Patrimoine : 4!t
Note4. Sur tout ceci/ voir J.-1. Biget,
Un procès d'lnquisition à
Albi en 1 300, dans Le
credo, la morale etI'lnquisition, Cahiers deFanjeaux, 6, 1971, p. 273-341 .
jea:r-Pau! La,r rrr:.,i'agilati-ur dr,' ! a n gu.e c o c
,li'\ si..'(LjUil'.\ir, \-i.l.a. t,, c \l:-il : i-'
Lr XlX.' sièci* rcrrant:t-ea m*ltiirlre ks re p;-éientaric;r'siraules en coule ul de grandc:s.èr:cs de i'[i:itoir= c,"r ,\lo,ve r
Âgr'. lcr ".'t,ld,,l l-).i'it rrtir{i4va r':1 se5 jLia€s
,
:s
É
Vie et moild'une résistonce
devant le roi lui-même, à Senlis, à l'automne tôt déserter sa ville. Albi demeura en état de1 301, trois représentants des Albigeois défen- semi-insurrection pendant plusieurs années, les
dirent l'argumentaire du mouvement, développé dominicains de la ville étant soumis aux vexa-avec passion par Bernard Délicieux. Selon eux, tions populaires. llapogée du mouvement contes-l'hérésie n'existait plus en Languedoc. Les accu- tataire fut sans doute atteint en août.l 303, lors-sés récemment condamnés n'étaient pas qu'un soulèvement populaire, auquel prirentcoupables, mais victimes des abus systématiques part de nombreux habitants d'Albi, obtint lade Bernard de Castanet et de l'lnquisition domi- sortie des prisonniers de l'lnquisition (parminicaine. Tortionnaires, corrompus et de lesquels des condamnés albigeois) et leur trans-mauvaises mceurs, les inquisiteurs n/avaient fert vers les prisons royales/ ce qui put paraîtred'autres buts que de s'enrichir et dominer le pays comme un préalable à leur librération.au détriment de la juridiction royale. Rien de tel n'advint pourtant. Au contraire, c'estLe mouvement anti-inquisitorial un coup d'arrêt définitif queconnut alors deux années très Le ffanCiSCain connurent les protestataires aufavorables. Philippe le Bel exigea Bernafd DéliCieUX, cours des mois suivants. Philippele renvoi de l'inquisiteur de -.-:-L_t_:)^ le Bel était satisfait du contrôlemeneur tntreotoeCarcassonne Foulques de Saint- instauré sur l'lnquisition et neCeorges (qui avait aussi juridic- et charismatique, voulait pas paraître défendre des
tion surAlLri)et inrposa la tutelle Capable d'Unifier hérétiques; il fut indisposé, en
de ses officiers sur l'lnquisition. ,^ *- outre, par la pression auquelll contraigrrit Bernarcl cie Ca-rta- le mouvement tentèrent de le soumettre lesnet à se soumettre à une enquête anti'inqUisitorial et opposants aux inquisiteurs lorsroyale et lui infligea une énorme d'en êtfe le OOfte- de son voyage à Toulouse à laamende. Malmené au cours ,^ ,^^'^r-, Noël 1303. Déséspérés, Bernardd'uneémeute, l'évêquedûtbien- parorc lnsplre' oàti.i"r^ et les consuls de
J,. i
+1p;.1x*q1
:,ii'ii
l
: ,. .. .-:,.- aa:. ^ . 5f
o
§U
Carcassonne se lancèrent alors dans un complotcontre le roi pour offrir le pouvoir en Langue-
doc au fils du roi de Majorque. Les bourgeoisd'Albi refusèrent de les suivre dans cette entre-prise subversive hautement risquée. Bien les en
prit, puisque la trahison fut découverte et les
coupables carcassonnais pendus en 1 305. En'l 308, le nouveau pape ClémentV choisitd'ailleurs de favoriser I'apaisement à Albi en
déplaçant Bernard de Castanet vers Ie siège épis-
copal du Puys.
Dès les premières années du XlV" siècle, l'hé-résie des bons hommes était en cours d'extinc-tion en Albigeois comme ailleurs6- le feu depaille du mouvement anti-inquisitorial ne chan-gea rien à ce processus de fond. La persécution
inquisitoriale joua ceftes un rôle important dans
la disparition rapide de la dissidence. Mais l'ex-plication tient surtout à Ia combinaison d'unesérie de facteurs qui déterminèrent un ralliementprogressif des élites contestataires, aussi bienbourgeoises que nobiliaires, à I'orthodoxie reli-gieuse.
llaffermissement de la mainmise royale fran-
çaise sur Ie Languedoc contribua fortement àimposer, peu à peu, des compromis plus effi-caces entre la puissance temporelle de l'Église
issue de la réforme grégorienne et les résistances
que cette dern ière suscitait. Ces résistances
U3e st no"td'une aÊsistanse
avaient été d'autant plus fortes, depuis le Xlle
siècle, que les nouvelles prétentions théocra-tiques de l'Église n'avaient pas été contreba-Iancées, sur place, par un pouvoir séculier fort.Le développement de pratiques religieuses alter-native, extra-ecclésiales, hérétiques, c' est-à-d i re
de formes radicalisées de contestation de l'Église
institutionnelle, n'avait été possible qu'à la faveur
d'une certaine vacance de l'autorité civile en
Languedoc-vacance qui prenait fin avec l'in-tégration, bientôt complète, dans l'orbite capé-tienne.Dans le même temps, l'assouplissement des
prohibitions opposées par I'Église aux pratiques
commerciales et bancaires des marchands,jusque là condamnées en bloc, facilita la soumis-
sion des milieux dirigeants urbains. Ces derniersfurent très sensibles à la pastorale des frèresmendiants, tout particulièrement à celle des fran-
ciscains. L'humble mode de vie des frèresMineurs était propre à convaincre ceux dont laparticipation à l'hérésie était motivée par uneforme d'anticléricalisme contestant les pouvoirs
et la richesse de l'Église. Car les bons hommesdissidents avait dû leur succès à la meilleurevoie de salut spirituel qu'ils offraient aux bour-geois en les lavant sans condition de tout péché,
y compris de celuid'usure, par le consolament.
Ultime vague de répression
Une ultime vague de répression eut lieu entre1 325 et le début des années 1 330. lllnquisitioncondamna encore une vingtaine d'Albigeois,mais pour des faits qui remontaient très loin en
arrière, sur la base de dénonciations recueilliespar Bernard de Castanet lors de ses procès d'ln-quisition de 1299-1300. Après l'avènement en
1 316 du pape Jean XXII, ami de l'ancien évêque
d'AIbi (lequel fut d'ailleurs immédiatementnommé cardinal !), des représailles à retarde-ment furent en effet menées contre la ville. En.l
319, celle-ci dut ainsi demander pardon à l'in-quisiteur Jean de Beaune, au cours d'une céré-monie humiliante, pour son opposition à Bernard
de Castanet et aux inquisiteurs. Mais lorsqueBernard Cui-qui avait été prieur du couventdes dominicains d'Albi avant d'être fait inquisi-teur de Toulouse- rédigea son Manuel d'lnqui-sition dans les années 132O,|'hérésie des bonshommes « amis de Dieu » n'existait déjà plus en
Albigeois et à Albi.
Jacqucs Fauché,Ra'y,mant! de Péreille
au cachr:t"
5. Sur ce qul précède, voir lelivre d'Alan Friedlander, IheHammer of the lnquisitors :Brother Bernard Del icieuxand the Struggle Against theI nquisi tion i n Fourteenth-Century France, Leyde-Boston, Brill (Cultures,
beliefs and traditions, 9),
2000, etJ.Théry, Unepolitique de la terreur.L'évêque d'Albi Bernard de
Castanet (v. 1240-1 317) etl'lnquisition, dans lesinquisiteurs. Portraits de
défenseurs de la foi en
Languedoc (Xllle-XlVe s.),
Laurent Albaret (dir.),
Toulouse, Privat, 2001,p.71-87.
6. Voir J.-1. Biget, Yextinctiondu catharisme urbain: les
points chauds de larépression, op. cit.
Midi-Pyrénées Patrimoine !f,1:









![KAVUR, Boris. Heads apart : the invisible history of the Servite monastery in Koper. Hortus artium medievalium, ISSN 1330-7274. [Print ed.], 2013, vol. 19, str. 417-423.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63254866545c645c7f099ec1/kavur-boris-heads-apart-the-invisible-history-of-the-servite-monastery-in-koper.jpg)








![BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/bereiziat-gerald-et-al-buard-jean-francois-ed-la-grotte-de-labbaye-i.jpg)