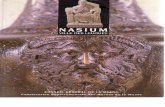Sale guerre et bons sentiments (à propos du film Joyeux Noël de C. Carion, 2005)
-
Upload
univ-bpclermont -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Sale guerre et bons sentiments (à propos du film Joyeux Noël de C. Carion, 2005)
IMAGES ET SONS Nicolas Beaupré et al. Presses de Sciences Po | Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2006/2 - no 90pages 201 à 211
ISSN 0294-1759
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-2-page-201.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beaupré Nicolas et al., « Images et sons »,
Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2006/2 no 90, p. 201-211. DOI : 10.3917/ving.090.0201
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.
© Presses de Sciences Po. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
201
Images et sons
Sale guerre et bons sentiments
Lors de la sortie de son Capitaine Conan, BertrandTavernier soulignait les difficultés à produire desfilms historiques. Le générique du film de ChristianCarion, Joyeux Noël, laisse aussi entrevoir ces diffi-cultés. Le projet résolument international a ainsiobtenu des aides financières françaises, allemandes,belges et européennes. Le respect pour une telleentreprise, sans aucun doute ardue, ne doit cepen-dant pas abolir l’esprit critique qui peut porter à lafois sur le film lui-même et sur le phénomènemédiatique qui l’a entouré. Dans cet ordre d’idée, ilappartient déjà de corriger un lieu commun tropsouvent entendu sur les ondes les plus diverses :non, les trêves de la Noël 14 n’étaient pas oubliées nioccultées. Le faire croire a sans doute pour but defaire vendre mais est inexact. L’attention qui estportée aujourd’hui sur les fraternisations de Noëlest en revanche intéressant. Outre le film de Chris-tian Carion, un ouvrage dirigé par Marc Ferro1 et undocumentaire de Michaël Gaumnitz2 leur sont con-sacré. En Allemagne, en 2003, le phénomène avaitfait l’objet d’un livre à succès publié par MichaelJürgs3, rédacteur en chef de l’important hebdoma-daire Stern. Un an plus tard, la deuxième chaîne alle-mande diffusait sous le titre Friedliche Front undocumentaire sur le même sujet4. La même annéeparaissait en Belgique un cd-rom de chants de Noëlintitulé Christmas Truce 19145. Déjà en 2001, l’histo-
rien Stanley Weintraub6 avait publié un ouvrage àsuccès en anglais consacré à ces trêves. Le livre del’historien militaire britannique Tony Ashworthqui évoquait ces Christmas Truces datait lui de 19807.
Comme le soulignait justement Jean-JacquesBecker dans un article du Monde paru le11novembre 2005, le regain d’intérêt actuel pources trêves en dit plus long sur notre époque que surla guerre elle-même. Il représente sans doutel’expression d’un désir de paix et d’Europe, alorsmême que l’Europe et les Européens peinent jus-tement à se construire une image d’eux-mêmes.L’image de soldats écossais, français et allemandfaisant fi de la guerre est à cet égard rassurante.Les soldats sont représentés dans le film de Chris-tian Carion comme de braves gens qui refusentl’Europe en guerre de leurs dirigeants et géné-raux. Il peut être alors tentant de tracer un paral-lèle avec certaines interprétations du vote desFrançais ou des Néerlandais au dernier référen-dum sur la Constitution européenne. Le filmcapte en tout cas un certain « air du temps ».
C’est pour cela sans doute, plus que pour soncontenu, que le film peut intéresser pour l’histo-rien. S’il présente bien la dimension religieusechrétienne de la trêve de Noël, tradition quiremonte au Moyen Âge, il sombre rapidementdans le pathos, le kitsch et l’exagération, notam-ment lorsque les soldats non seulement fraterni-sent, mais se prêtent même mutuellement assis-tance et protection sous les bombardements deleur camp respectif. La version historiographiquedes faits qu’il propose est donc, malgré la préten-due nouveauté du phénomène présenté, éculée,manichéenne et parsemée de clichés pacifistes.
(1) Marc Ferro et alii (dir.), Frères de tranchées 1914-1918,Paris, Perrin, 2005.
(2) Michaël Gaumnitz, Premier Noël dans les tranchées, Paris,Éd. Montparnasse, 2005.
(3) Michaël Jürgs, Der kleine Frieden im Großen Krieg,Munich, Bertelsmann, 2003.
(4) Voir le lien : http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/26/0,1872,2087770,00.html
(5) Coope Boyes & Simpson et Wak Maar Proper, TheChristmas Truce 1914 : Kerstbestand, No Masters NMCD14 .
(6) Stanley Weintraub, Silent Night. The Story of the WorldWar 1 Christmas Truces, New York, The Free Press, 2001.
(7) Tony Ashworth, Trench Warfare 1914-1918 : The Live andLet Live System, Teaneck, New Jersey, Holmes & Meier, 1980.
M EP_Revue90.fm Page 201 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
202
Les soldats fraternisent quasi naturellement etceux qui semblaient réticents, de par leurs fonc-tions comme les officiers ou de par leur volontéd’en découdre, se convertissent presque unanime-ment et très rapidement aux bons sentiments.Ainsi le lieutenant allemand est présenté commeayant deux bonnes raisons de ne pas sombrer aupathos de Noël : son origine juive est soulignée, demême que sa raideur d’officier prussien peuamène avec certains de ses soldats. Il sait pourtantse souvenir de son voyage de noces à Paris et de samaîtrise du français au moment voulu et se dit luiaussi gagné par l’émotion religieuse de Noël. Lesreligions fraternisent donc aussi ! Étrangement,l’idéologie de l’Union Sacrée fait ainsi bonménage avec celle de l’amitié entre les peuples.
Le soldat des territoires occupés est présentépour sa part comme un chtimi nostalgique qui n’abien sûr pas un mot pour des atrocités allemandesalors très présentes dans les mentalités. Lui aussi fait« copain-copain » le plus naturellement du mondeavec les « Boches » jusqu’à revêtir leur uniformepour aller boire un café avec sa mère de l’autre côtédes tranchées. Le film n’évite pas non plus les sté-réotypes nationaux. Pour n’en évoquer qu’une,l’image de l’Allemagne correspond ainsi à la classi-que représentation des « deux Allemagnes » : celledu Kronprinz et des officiers d’état-major, veules,cruels et désintéressés du sort des hommes et celledes artistes et des musiciens, incarné par l’un despersonnages centraux du film, le ténor qui chanteentre les lignes.
Finalement, ce film ne s’éloigne jamais de la vul-gate lénifiante d’une représentation victimisantedes soldats qui avait déjà assuré le succès, par exem-ple, de la publication Paroles de Poilus1. C’est dom-mage car il est bien entendu essentiel de s’intéresseraux phénomènes marginaux du conflit en ce qu’ilséclairent aussi, mais par contraste et en creux, ceque fut le centre du maelström de la guerre.
Rapportées à l’ensemble de la période 1914-1918, les trêves de Noël, malgré leur étendue le
long du front Ouest en 1914, furent une manifesta-tion marginale, un épiphénomène sans effet de cecôté du front sur le déroulement de la guerre. Et làencore, évoquer la contrainte et la « reprise enmain » ne suffit pas à expliquer la fin de ce phéno-mène. L’armée où la contrainte était la plus forte,la discipline la plus dure est aussi celle qui a connule plus de « fraternisations » et où celles-ci ont eul’effet le plus direct sur le résultat du conflit, àsavoir l’armée russe sur le front Est. Il faut cepen-dant souligner que ces dernières ont lieu le plussouvent après que les soldats russes se sont renduset sont donc dissymétriques, avec un vainqueur etun vaincu. Les Allemands fraternisent seulementparce que les Russes veulent bien se rendre. Ce quiest très différent de Noël 1914 et ajoute encore à lamarginalité du type occidental des fraternisations,aussi bien moins massif qu’à l’Est.
Dans les armées occidentales, les « reprises enmain » et les répressions des états-majors – parfois(mais rarement) brutales, très souvent ponctuel-les, et jamais systématiques et aveugles –, contreles fraternisations et les refus de monter en ligneen 1914 et 1915 traduisent avant tout une imprépa-ration face à une guerre qui s’installe dans la duréeet qui offre un visage nouveau. Les fraternisationsde Noël 1914, qui ne se reproduisent pas ensuite,sont juste le signe que la totalisation, si elle est enmarche, n’est encore pas à son apogée au cours dupremier hiver de la guerre et qu’il subsiste encoredes vestiges des anciennes manières de faire laguerre amenés à disparaître.
Le film ne montre pas cet aspect, laissantaccroire à l’entente universelle et intemporelle deshommes qui, seulement, ne sont plus maîtres deleur destin et ne peuvent imposer leur point devue. Ce faisant, le film manque même son but ini-tial et généreux d’éveiller des sentiments d’amitiéet de concorde entre les peuples : cette imageimplique que ces sentiments sont de toute façoninutiles et inefficaces à long terme face aux puis-sants et à l’inexorable machinerie des sociétés enguerre. Cessant d’être des acteurs de l’histoire, lessoldats ne sont ici plus que de fraternels pantins.
Nicolas Beaupré(1) Jean-Pierre Guéno et Yves Laplume (dir.), Paroles de
poilus : lettres de la Grande Guerre, Paris Historia/Tallandier,1998, 160 p.
M EP_Revue90.fm Page 202 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
IMAGES ET SONS
203
J’ai vu tuer Ben Barka
Le film de Serge Le Peron est sorti à l’occasion duquarantième anniversaire de la disparition du chefde la gauche socialiste marocaine, Mehdi BenBarka, enlevé à Paris le 29 octobre 1965 devant laBrasserie Lipp boulevard Saint-Germain1. Soncorps n’a jamais été retrouvé. Deux procès ont eulieu en France en 1966 et 1967. Mais jamais nefurent dévoilées l’identité des commanditaires, niles modalités de ce crime d’États (Maroc, servicesfrançais, CIA…). En 2006, l’affaire est toujours àl’instruction en France.
Après L’Attentat d’Yves Boisset (1972), J’ai vutuer Ben Barka est le second film sur l’affaire BenBarka. Son premier mérite est d’appartenir à latrop rare catégorie des films politico-historiquesfrançais. En outre, il attire l’attention des jeunesgénérations sur une affaire qui a durablementmarqué la Cinquième République, et plus encoreaffaibli le courant socialiste et réformiste des paysdécolonisés. Aussi l’actualité de cette affaire ne sedément pas. Au Maroc, elle reste brûlante, tandisque la CIA interdit l’accès à ses deux mille fichessur le sujet, et que la France a ouvert des archivesépurées de longue date.
Ce film complexe ne saurait dispenser le specta-teur d’une connaissance préalable, même som-maire, de l’histoire postcoloniale et de la figure deMehdi Ben Barka2. J’ai vu tuer Ben Barka n’est pasun film sur le militant ni sur les circonstances histo-riques qui ont conduit des tueurs sur sa piste. Il sefocalise sur les conditions, aussi rigoureusementexactes que possibles, qui ont présidé à son enlève-ment et, le soir même, à son assassinat présumé enbanlieue parisienne, en présence du ministre maro-cain de l’Intérieur. C’est un film militant qui place
la fiction au service d’une vérité historique partiel-lement connue. Cela n’enlève rien à la rigueur qui aprésidé à cette reconstitution.
Elle souffre certes d’inattentions, comme cemagasin Fnac inconnu en 1965, ou ces gros planssur le Casablanca actuel censés représenter LeCaire de 1965 ! Mais cela reste mineur au regarddes efforts méticuleux consacrés à la reconstitutiondes faits liés à cette affaire : les protagonistes mul-tiples, les lieux de l’intrigue (la vraie villa où a étééliminé Ben Barka), le déroulé chronologique, leshypothèses les plus vraisemblables… Tout cela estfidèle aux témoignages des comptes rendusd’audience des procès. Le réalisateur a pris soin derestaurer les ambiances feutrées dans lesquellesévoluait un Ben Barka devenu « commis voyageurinternational de la révolution ». Condamné à mortpar contumace au Maroc, il vit avec sa famille auCaire, dans une Égypte nassérienne, entrevue àtravers le kitsch anglo-oriental désuet de sonappartement. Ben Barka, constamment en transitentre l’Europe, Le Caire et les grandes capitales dutiers-monde, est de ces hommes politiques qui ontinauguré la diplomatie directe grâce aux jets.
Cette reconstitution achoppe néanmoins sur lareprésentation/idéalisation de Ben Barka. À lapersonnalité méditerranéenne chaleureuse etvirevoltante du vrai Ben Barka (surnommé « ladynamo »), l’auteur a préféré la raideur orientaled’un Simon Abkarian. Au petit mathématicienvolubile né dans la médina de Rabat, il a préférél’image distante d’un bourgeois lettré de Fès(voire levantin) de haute stature. Ce choix para-doxal, invisible pour qui ne connaît pas la person-nalité de Ben Barka, est un parti pris narratif. Nonqu’il faille tailler la statue du Commandeur devantl’histoire, mais parce que l’essentiel est ailleurs.Ben Barka, sur lequel le film nous informe peu,n’est pas au centre du film.
Le film s’attache au déroulé du drame : sa prépa-ration, ses acteurs et sa réalisation. Le personnageprincipal est Georges Figon, l’homme qui, grâce àses réseaux parisiens, a monté le piège qui devaitêtre fatal au très méfiant Ben Barka. Le film s’ouvresur le cadavre de Figon, faisant du reste de l’intrigueun vaste retour en arrière qui conduit à son assassi-
(1) Film franco-marocain de Serge Le Péron (réalisateur) etSaïd Smihi (conseiller historique), avec Charles Berling (dansle rôle du personnage principal de Georges Figon), SimonAbkarian (alias Mehdi Ben Barka), Josiane Balasko (alias Mar-guerite Duras). Sorti en France le 2 novembre 2005.
(2) Zakya Daoud et Maâti Monjib, Ben Barka, Paris, Micha-lon, 1996. René Gallissot et Jacques Kergoat, Mehdi Ben Barka.De l’indépendance marocaine à la Tricontinentale, Paris, Karthala/Institut Maghreb-Europe, 1997.
M EP_Revue90.fm Page 203 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
204
nat en janvier 1966. Le film se termine par la fuitedésespérée de cet homme traqué par des services etdes tueurs décidés à le faire taire. Cette construc-tion audacieuse composée de trois tableaux succes-sifs est une réussite narrative et dramatique. C’est lepoint fort du film, qui accentue la dramatisation,mais n’enlève rien à sa complexité relative, pour quin’est pas informé sur cette période.
Dans la Cinquième République naissante se croi-sent une galerie de personnages et de milieux quidonnent le tournis. Les officiers et services du Marocindépendant, formés par les Français avant 1956,sont à Paris comme chez eux. Ils travaillent avec leursamis de la police française. Ils sont en contact avecleurs homologues algériens ou égyptiens formés aumême moule, et de surcroît unis par les nécessitésdes luttes anticoloniales. Ils sont en contact avec lesréseaux interlopes de la République, cette pègre quibrasse depuis vingt-cinq ans les réseaux de collabora-teurs repentis, d’affairistes coloniaux, de résistantsayant combattu outre-mer, de malfrats aux ramifica-tions maffieuses ou policières… Si le réalisateur vou-lait souligner l’abîme qui existe entre la hauteur devue de Ben Barka, la force de ses convictions politi-ques, et la bande de « tontons-flingueurs » qui ontcontribué à son élimination, l’objectif est atteint. Lastature orientale du Ben Barka porté à l’écran accen-tue encore le contraste.
Le montage du film, sur fond du milieu intel-lectuel de Saint-Germain-des-Prés, contribue aucaractère surréaliste de cette mauvaise histoired’espionnage. Franju devait être le personnageprincipal du film avant que le choix ne se porte surFigon. Ce scénariste des années 1950 fut approchépar Figon pour écrire un film sur la décolonisa-tion, avec Mehdi Ben Barka comme conseiller his-torique. Franju et Marguerite Duras se trouventembarqués à leur corps défendant dans le piègequi devait conduire Ben Barka à la mort. Témoinaux procès de 1966 et 1967, Franju est resté hantéjusqu’à sa mort par cette histoire, laquelle a étéracontée a posteriori aux réalisateurs du film.
Du point de vue du Maroc, un certain réalismedénonce en creux le cynisme patient et brutal desservices marocains chargés de l’assassinat. Mais lescommanditaires de l’enlèvement restent dans
l’ombre. Le ministre de l’Intérieur MohammedOufkir est mis en cause, sa présence dans la villa lesoir de l’enlèvement étant établie. Mais cette miseen cause évacue pudiquement la responsabilité deHassan II, dont le nom n’est pas prononcé. Cetteprécaution d’usage dans un film franco-marocainn’empêcha ni les multiples obstacles rencontrés auMaroc lors du tournage ni les entraves à la diffu-sion d’un film manifestement redouté pour soncaractère subversif.
Une autre carence reflète les lacunes de la con-naissance relatives à cette affaire. Invité par lapolice française à monter dans une voiture banali-sée pour se rendre à une entrevue, Ben Barkacroit-il aller à un rendez-vous avec de Gaulle ouavec un émissaire de Hassan II (comme AhmedBalafrej), qui voulaient effectivement le rencon-trer ? La question est sans réponse. Le film sug-gère la collaboration à l’affaire, aux côtés deFigon, de personnalités gaullistes, mais rien n’estdit sur de Gaulle – ni sur sa violente colère quand ilapprend l’affaire –, hormis le fait qu’il déclare laparticipation française à cette affaire « vulgaire etsubalterne ». Qui désirait en France faire taireBen Barka, et pourquoi ? Quant à la CIA, le filmdit son intérêt à la disparition de Ben Barka, che-ville ouvrière internationale de la Tricontinentalequi devait se réunir à La Havane en janvier 1966…Mais la CIA s’est-elle contentée d’observer lesassassins, ou les a-t-elle aidés ? Le film restemodeste et s’en tient à la connaissance des faits.
Un louable souci du respect de la réalité histori-que caractérise ce film. Réussi et captivant, ildemeure quelque peu ardu, mais fidèle à cette« affaire » jamais close, dont l’assassinat de Figon(parmi tant d’autres) a réussi à occulter la vérité.
Pierre Vermeren
Des poings et des roses
Coïncidence de l’histoire, la période de turbulen-ces que traverse aujourd’hui le parti socialiste (PS)coïncide avec le centenaire de sa fondation : le23avril 1905, salle du Globe à Paris dans le
M EP_Revue90.fm Page 204 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
IMAGES ET SONS
205
10e arrondissement, fut fondée la Section françaisede l’Internationale ouvrière (SFIO), au terme d’unquart de siècle de divisions socialistes. L’ouvrageDes poings et des roses. Le Siècle des socialistes, publiésous la direction d’Alain Bergounioux1, a offert l’anpassé une synthèse de cette histoire séculaire sur labase d’un découpage en sept grandes périodeschronologiques : « Vers l’unité de 1905 » ; « 1905-1920 : socialistes et République » ; « 1920-1938 : laSFIO sur tous les fronts » ; « 1938-1944 : la résis-tance des socialistes » ; « 1944-1958 : reconstruirela République », les difficultés de l’exercice dupouvoir ; « 1958-1981: la mutation socialiste » ;« 1981-2002 : les socialistes en alternance ». Maisl’originalité de cet ouvrage qui nous intéresse iciréside dans son apport très important sur le planiconographique : en ce domaine, ce livre est d’uneextrême richesse. En effet, il a bénéficié d’abon-dantes recherches faites à partir de très nombreu-ses sources, et pas seulement celles émanant dessocialistes. Parmi ces sources, ont été largementutilisées la presse socialiste nationale et régionale –cette dernière fort diverse comme le montre la pré-sentation des journaux régionaux existant en 1911 –et des publications anciennes, telles que L’Encyclo-pédie socialiste, syndicale et coopérative parue en 1912ou le Grand dictionnaire socialiste publié en 1924 parCompère-Morel. De façon plus générale, ont éga-lement été mises à contribution les bibliothèqueset archives publiques françaises (Office universi-taire de recherches socialistes, BDIC, Centred’histoire sociale du 20e siècle, Musée social, etcertains centres de province comme l’ancienneMaison du peuple de Saint-Claude où sont conser-vées de très riches archives) et étrangères, tel l’Ins-titut international d’histoire sociale d’Amsterdam.De nombreux documents iconographiques pro-viennent également des archives de militants,d’anciens militants, de nombreuses fédérations.
Cette recherche approfondie a permis d’exhu-mer et de faire revivre une multitude de photogra-phies, de dessins, de caricatures, d’affiches, bienoubliés de nos jours. On ne peut tous les citer icimais comment se priver du plaisir d’en évoquercertains ? Qui connaît aujourd’hui cette photo-graphie (présentée p. 38), prise en 1899, surlaquelle figurent Jean Jaurès, Jean Psichari secré-taire de la Ligue des droits de l’homme alors enformation, Francis de Pressensé futur présidentde cette organisation, Siméon Flaissières maire deMarseille, Alfred Gérault-Richard, directeur deLa Petite République, Alexandre Zevaes qui romprabientôt avec la SFIO ? Tout aussi peu connu est,dans le domaine de la « formation socialiste », ledessin de Grados présentant le classique PetitPierre sera socialiste ou le catalogue de la bibliothè-que de la 11e section socialiste de la Seine en 1960(p. 79). Est sans doute inédite cette photographie(p. 140) du drapeau du Populaire, hissé le 25 août1944 sur le toit du journal collaborateur Le Matin,à Paris, faubourg Poissonnière, dont les locauxviennent d’être attribués au journal socialiste. Cene sont là que quelques exemples.
Outre leur intérêt intrinsèque, ces documentsillustrent également la volonté de propagande etde formation qui a toujours animé le partisocialiste : dans deux pages (p. 120-121) consacréesà « la propagande et à la communication » figureégalement la reproduction de deux disques, « Lavoix des nôtres », édités en 1938-1939 par Jean-Lorris où étaient diffusées « les discours de laSFIO et de la CGT et des chants révolu-tionnaires ». Sur ces aspects iconographiques etpropagandistes qui montrent la représentationque se fait la SFIO d’elle même et qu’elle veutdonner à l’extérieur, cet ouvrage, par la richesse dela documentation qu’il offre au lecteur, innovevéritablement et ouvre des pistes de recherchesencore peu explorées : qu’il s’agisse des cartesd’adhérents (un mémoire de maîtrise avait étésoutenu il y a quelques années au Centre d’histoiresociale du 20e siècle sur l’image du parti socialisteitalien à travers ses cartes d’adhérents durant unsiècle ; un tel sujet pourrait être repris pour le partisocialiste) des badges, des affiches ou des dra-
(1) Alain Bergounioux (dir.), Des poings et des roses. Le siècle dessocialistes, textes préparés par Frédéric Cépède, avec la collabo-ration d’Aline Fiere, Thierry Merel, Denis Lefebvre et Mar-tine Pottrain, préface de François Hollande, Paris, LaMartinière, 2005, 35 €.
M EP_Revue90.fm Page 205 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
206
peaux1, on doit souhaiter que de telles recherchesse poursuivent. Enfin, cet ouvrage comporte descompléments et des annexes qui en font un vérita-ble outil de travail. Chaque chapitre est suivi d’uneprésentation chronologique détaillée. Desannexes (le discours de Saint-Mandé prononcépar Alexandre Millerand en 1905, celui, bienconnu, de Léon Blum au congrès de Tours en1920, « Garder la vielle maison »), les déclarationsde principe de la SFIO en 1946 et du nouveau partisocialiste en 1969, une liste de tous les secrétairesgénéraux du Parti depuis 1905, un index des nomset un glossaire s’avèrent fort utiles.
Une telle synthèse iconographique était diffi-cile à réaliser d’abord en raison de son ampleur : ilne va pas de soi de retracer en images les grandeslignes de ce siècle d’histoire du socialisme français,dans son contexte national et international. Uneautre difficulté était inhérente à la nature même dece livre et aux conditions de sa réalisation : sansmême tenir compte des vifs débats qui agitentaujourd’hui le parti socialiste, le fait que ce livre aitbénéficié d’une préface de son premier secrétaireen fait, de façon inévitable, une publication com-mémorative destinée d’abord aux adhérents et auxsympathisants socialistes. Dès lors, on pouvaitcraindre que les exigences politiques ne l’empor-tent sur les critères historiques. Fort heureuse-ment, il n’en est rien et cet ouvrage ne tombejamais dans l’exercice convenu et moins encoredans une histoire théologique destinée à glorifierle parti socialiste. À de nombreuses reprises, sesauteurs n’hésitent pas à pointer les tensions, lesconflits, parfois les scissions qui émanent de l’his-toire de la SFIO et du PS : ils évoquent parfaite-ment la division entre pacifistes et antifascistes queconnaît la SFIO à partir de 1938, date à laquelle elleentre dans la « période la plus sombre de sonhistoire » (p. 126) qui la mène au désastre dejuillet 1940. Les auteurs ne craignent pas davan-
tage de traiter (p. 178) des « fractures socialistes »provoquées par la guerre d’Algérie et la politiquesuivie alors par Guy Mollet : cette orientation quisuscite des départs (parti socialiste autonome,Union de la gauche socialiste) contribue à affaiblirtrès gravement la SFIO pour plus d’une décennie.Il faut attendre la création du nouveau parti socia-liste en 1971 pour que la tendance s’inverse et ques’ouvre une nouvelle page de l’histoire du socia-lisme français.
Il s’agit donc bien d’une histoire du parti socia-liste scandée en images et nullement d’une« histoire sainte », destinée à démontrer le bien-fondé, en tous lieux et toutes circonstances, deschoix de sa direction. À cela rien d’étonnant, car lesmaîtres d’œuvre de ce livre, comme ceux qui les ontaidés, connaissent parfaitement les recherches lesplus récentes sur l’histoire du parti socialiste,recherches auxquelles ils participent d’ailleurs ouqu’ils impulsent sous une forme ou sous une autredepuis de nombreuses années. Aussi, leur connais-sance, mieux leur érudition, n’est jamais prise endéfaut comme le montre la place importante qu’ilsaccordent aux questions historiographiques débat-tues aujourd’hui : réseaux et implantation socia-liste, rôle des femmes, même si elles ont eu et ontencore bien du mal parfois à trouver leur place ausein du Parti, etc. Pour ne prendre qu’un exemple, lelivre débute par deux pages consacrées à l’image duParti où est rappelé, de façon fort utile, le fait que larose n’a pas toujours été l’emblème des socialistes :elle a été devancée par le drapeau rouge, puis, à par-tir de 1931-1933, dans un contexte de progression dufascisme, par les trois flèches. Ces dernières symbo-liseront la SFIO jusqu’à sa disparition en 1969 avantque deux ans plus tard le nouveau parti socialisten’adopte l’emblème du poing et de la rose.
Ce livre ne voulait ni ne pouvait, à lui seul,apporter de réponses aux questions sur lesquellesles recherches historiques les plus récentes restenttrop discrètes. Il ne traite ainsi guère des rapportsdu parti socialiste avec les autres composantes dumouvement social. Il n’évoque que fort peu la ques-tion syndicale, les liens de la SFIO avec la CGTconfédérée puis Force ouvrière, au moins dans sapremière décennie, ou les liens du parti socialiste
(1) Il n’existe pas en France, à notre connaissance, d’ouvrageanalogue à celui publié par le Centro studio Piero Gobetti etl’Istituto storico della Resistenza in Piemonte, Un altra Italianelle bandiere dei lavoratori. Simboli e cultura dall’unita d’Italiaall’avvento del fascismo, Turin, 1982.
M EP_Revue90.fm Page 206 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
IMAGES ET SONS
207
avec la CFDT à partir de la fin des années 1970. Ilreste également muet sur les relations, fort impor-tantes, qui ont existé entre la SFIO et le mouve-ment coopérateur, de 1905 aux lendemains de laseconde guerre mondiale : en ce domaine, prati-quement toute la recherche reste faire. Mais cen’était pas le but cet ouvrage qui a le mérite de lierérudition et vulgarisation, au meilleur sens duterme ; ces deux notions ne vont pas, toutefois, for-cément de pair. Soyons donc reconnaissant aux ani-mateurs de cette entreprise de nous avoir guidéavec une grande érudition dans ce qui est biendavantage – et ce serait déjà beaucoup – qu’une sim-ple histoire de la SFIO et du parti socialiste.
Michel Dreyfus
Héritage BrésilQuelques notes pour l’histoire du Brésil en France
Mêlant les voix de Leny Eversong et de TaniaMaria, l’accordéon de Sivuca, les guitares deBaden Powell et de Luiz Bonfa, la série HéritageBrésil produite par Universal Jazz est intéressanteà plus d’un titre pour l’historien du culturel1. Elles’inscrit tout d’abord dans la lignée d’une année duBrésil à dominante musicale2, dont l’apogée futsans doute le concert de Gilberto Gil sur la placede la Bastille, en l’honneur de la fête nationalefrançaise. Elle souligne également l’ancienneté
des échanges musicaux entre le Brésil et la France,ainsi que la fascination du public français envers lamusique populaire métisse de la Terra Brasilis :samba, baião, bossa nova, tropicalisme et, plusrécemment, choro3, maracatu, forro et autres ryth-mes du Nordeste ont acquis une place significativesur la scène musicale française. Du succès de lamaxixe dans les salons parisiens de la Belle Époqueaux bals forro du nouveau millénaire, le 20e sièclefut ponctué de moments musicaux brésiliens dontle plus significatif en termes d’audience et de créa-tion artistique fut celui de la bossa nova dans lesannées 1960 et 1970. La réédition par UniversalJazz de huit disques brésiliens enregistrés à Parisentre 1958 et 1978 permet de revenir sur cemoment décisif dans l’histoire des transferts cul-turels entre le Brésil et la France.
Genre musical né à Rio de Janeiro à la fin desannées 1950 de la rencontre entre le rythme de lasamba et les recherches harmoniques du cool jazznord-américain, la bossa nova connut un succèsd’envergure aux États-Unis et en Europe au coursdes années 1960. Les disques édités par Barclay etFontana en sont un premier témoignage : àl’exception de celui de Leny Eversong, ancré dansl’univers de la samba-canção, tous comportent desstandards bossa nova, écrits par Tom Jobim, Vini-cius de Moraes ou João Gilberto, et furent com-mercialisés sous ce label. Luiz Bonfa devint ainsi leRoi de la bossa nova, Sivuca l’interprète de la Nou-velle Vague et, à partir de 1962, le terme bossa novaorna les pochettes des albums brésiliens édités enFrance. L’édition de partition et la presse musi-cale le confirment : l’année 1962 fut le point dedépart de la mode de la bossa nova en France. Faitcurieux si l’on songe au succès obtenu en 1959 parla musique du film Orfeu negro, composée parTom Jobim et Vinicius de Moraes, deux figurestutélaires du mouvement musical. Le décalagetemporel est ici significatif : si les Français décou-vrirent les premières bossas en 1959, il fallut atten-dre la mode du Brazilian Jazz aux États-Unis pour
(1) Produite par Universal Jazz, la collection Héritage Brésilcomporte à ce jour huit disques : Leny Eversong, Barclay Ses-sions (983247-7) ; Luiz Bonfa, Le Roi de la bossa nova (983247-5) ;Sivuca, Samba nouvelle vague (983307-7) ; Baden Powell, LeMonde musical de Baden Powell (983280-2) et Baden Powell cantaVinicius de Moraes e Cesar Paulo Pinheiro (983280-0) ; TaniaMaria, Via Brasil 1 (983309-9), Via Brasil 2 (983266-4) et Brazilwith my soul (983307-2).
(2) Produite par Universal Jazz, la collection Héritage Brésilcomporte à ce jour huit disques : Leny Eversong, Barclay Sessions(983247-7) ; Luiz Bonfa, Le Roi de la bossa nova (983247-5) ;Sivuca, Samba nouvelle vague (983307-7) ; Baden Powell, LeMonde musical de Baden Powell (983280-2) et Baden Powell cantaVinicius de Moraes e Cesar Paulo Pinheiro (983280-0) ; TaniaMaria, Via Brasil 1 (983309-9), Via Brasil 2 (983266-4) et Brazilwith my soul (983307-2).
(3) La sortie en salles de Brasileirinho, un documentairemusical de Mika Kaurismäki consacré au choro, en septembre2005, est à cet égard significative.
M EP_Revue90.fm Page 207 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
208
que le terme bossa nova soit utilisé par le milieumusical français. En novembre 1962, le concertbossa nova1, organisé au Carnegie Hall par la mai-son de production américaine Audio Fidelity et leministère des Affaires étrangères brésilien, lançale nouveau genre musical sur la scèneinternationale : il éveilla l’intérêt des jazzmennord-américains pour les mélodies brésiliennes,et, partant, du milieu du jazz français. Jazz Hot,revue de référence s’il en est, consacra alors denombreux articles au nouveau genre musicalinterprété par des musiciens aussi divers que StanGetz, Charlie Byrd, Kenny Dorham, Ella Fitze-rald, Dizzy Gillespie, Miles Davis, CannonballAdderley, Ahmad Jamal, Sarah Vaughan etQuincy Jones. La présence de ces jazzmen enFrance2, au moment même où les États-Unis con-naissaient une mode bossa nova, contribua à légi-timer le genre auprès des musiciens français, maiségalement à le définir – en lui attribuant un nom –auprès du grand public. Rien d’étonnant dès lors àce que la réédition du catalogue brésilien d’EddyBarclay soit confiée au département UniversalJazz, et non aux responsables des musiques dumonde de la société. Le rôle joué par le jazz dans ladiffusion internationale de la bossa nova apparaîttrès nettement dans les albums de la collectionHéritage Brésil où les jazzmen côtoient des musi-ciens brésiliens. Les participations du batteurAldo Romano, des bassistes Guy Pedersen etLuigi Trussardi et du tromboniste Bill Tamperdonnèrent ainsi le ton des albums de BadenPowell, Tania Maria et Sivuca. Qu’elle qu’en soitl’origine exacte (amitiés, rencontres musicales,stratégies commerciales ou suggestion d’un direc-teur artistique avisé3 ), la présence de ces artistes
permet d’analyser les échanges musicaux entre leBrésil et la France en termes de transferts culturelstriangulaires4, les États-Unis jouant le rôle de pas-seur entre deux univers musicaux distincts.
La mode de la bossa nova en France ne sauraitpour autant se réduire au prestige du jazz dans lemilieu musical parisien : l’exil politique, lecinéma, les voyages de musiciens et les festivals5
contribuèrent également à la bonne réception dugenre par le public. Le cinéma notamment fut unvecteur de diffusion de premier ordre. Alors qu’en1959 Orfeu negro signa la première incursion de labossa nova dans l’univers sonore des Français, Unhomme et une femme, réalisé par Claude Lelouch en1965, consacra ce genre musical. La bande origi-nale, composée par Pierre Barouh et Francis Lai,reprenait le thème de Samba da benção, une bossa deBaden Powell et Vinicius de Moraes, connue enfrançais sous le titre Saravah qui contribua au suc-cès du film dont elle bénéficia en retour. Dans lemême temps, les réalisateurs brésiliens du cinemanovo effectuèrent une entrée remarquée sur lemarché français, tandis que des cinéastes françaispoursuivaient l’expérience du film musical tournéau Brésil. En 1963, Robert Mazoyer réalisa ainsiSanto Módico, une comédie dans laquelle jouaLeny Eversong et dont trois titres figurent sur ledisque de Luis Bonfa6.
Aux côtés des cinéastes et des jazzmen, les exiléspolitiques brésiliens jouèrent un rôle original dansla diffusion de la bossa nova en France. Le coupd’État militaire de 1964 et le tournant répressif de
(1) Les principaux représentants de la bossa nova participè-rent à ce concert : João Gilberto, Tom Jobim, Carlos Lyra,Roberto Menescal, Agostinho dos Santos, Luís Bonfa, OscarCastro Neves et Sérgio Mendes. Cf Bossa nova at Carnegie Hall©2000, Ubatuqui (SGAE DLB 26545).
(2) Ludovic Tournès, New Orleans sur Seine : histoire du jazzen France, Paris, Fayard, 1999.
(3) Jacques Lubin, directeur artistique de Barclay, joua unrôle décisif dans l’établissement du catalogue brésilien de lacompagnie. Il dirigea entre autres les enregistrements deBaden Powell, Tania Maria et Sivuca.
(4) La notion a été définie par Michel Espagne à propos deséchanges culturels entre la France, la Russie et l’Allemagne.Michel Espagne, Les Transferts culturels franco-allemands, Paris,PUF, 1999, p. 153-178.
(5) Dans les années 1960, le développement des communi-cations et des moyens de transports permit la création des pre-miers festivals internationaux de jazz et de variété. Le FIC(Festival Internacional da Canção) au Brésil et le MIDEM(Marché international du disque et de l’édition musicale) enFrance constituèrent alors les premiers lieux de rencontres desprofessionnels de la musique français et brésiliens.
(6) Le guitariste ayant été sacré roi de la bossa nova en raisonde « ses nombreux succès et en particulier des airs célèbresd’Orfeu Negro », la référence cinématographique permettait dedécliner les étapes de la carrière d’un « musicien intégral »(Luiz Bonfa, Le Roi de la bossa nova, liner notes).
M EP_Revue90.fm Page 208 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
IMAGES ET SONS
209
19681 décidèrent de nombreux musiciens brési-liens à s’installer en France à l’égal de RicardoVilas, Teca Calazans, Edu Lobo, Egberto Gis-monti et Nara Leão. Regroupés à Paris, ils contri-buèrent à faire connaître la bossa nova aux musi-ciens venus du jazz mais également de la chansonfrançaise tels Claude Nougaro, Françoise Hardyet Georges Moustaki. Partie du Brésil à la suite depersécutions policières2, Tania Maria fut la seulede ces artistes à construire une carrière en France3.Fait notoire, la situation politique brésiliennen’est évoquée explicitement dans aucun des troisalbums qu’elle enregistra chez Barclay entre 1974et 1978 : paradoxe de l’exil, la dénonciation sedevait d’être discrète4. Le premier disque deTania Maria s’ouvre ainsi sur Samba de Orly, unechanson de Chico Buarque de Hollanda dont lesparoles évoquent la souffrance d’un homme con-traint à vivre loin de son pays, condamnation enfiligrane de l’exil, destinée aux seuls lusophones, lacadence et l’aspect festif de la musique empêchanttoute compréhension extralittéraire du discours.
Héritage Brésil plonge également l’auditeur aucœur des logiques de l’industrie culturelle fran-çaise. Les pochettes de disques indiquent à quelpoint l’engagement de professionnels de la musi-que tels Eddy Barclay et Bruno Coquatrix futdécisif pour lancer la mode de la chanson brési-lienne en France. Certes, l’action conjuguée deces deux hommes eut plus ou moins de succès : en1958, Leny Eversong enregistra chez Barclay letemps d’une escale parisienne et d’un concert à
l’Olympia sans laisser de traces dans les mémoires.Elle contribua cependant à ancrer la bossa novadans le paysage musical français comme en témoi-gne le grand concert de Baden Powell et ClaudeNougaro à l’Olympia en septembre 1974 et le dis-que d’or attribué au Monde musical de Baden Powell,enregistré par Barclay une décennie auparavant.
Anaïs Fléchet
L’art russe en quête d’identité
Le musée d’Orsay innove en ouvrant ses sallesd’expositions temporaires à une rétrospectiveétrangère5. Il faut féliciter les conservateursd’avoir retenu, pour cette occasion, la Russie.L’art russe de la seconde moitié du 19e siècle estparticulièrement méconnu en Europe occiden-tale. Or, l’étude de cette période est fort utile à quiveut comprendre les enjeux artistiques du 20e siè-cle russe et soviétique. L’exposition réunit uneexceptionnelle collection de peintures emprun-tées notamment au musée russe de Saint-Péters-bourg et à la galerie Tretiakov de Moscou qui avaitfermé ses portes pendant près de dix ans à partir de1985. Il y avait donc une certaine émotion à voir ouà revoir certaines toiles si longtemps difficilementaccessibles.
Le fil rouge de l’exposition est le retour auxsources russes qui détermine les choix artistiquesd’une période bornée par le Congrès panslavistede 1864 et la célébration du tricentenaire desRomanov en 1913. Les premiers temps sont ceuxd’une double rupture : rupture avec l’enseigne-ment des académies et rupture avec les modèlesoccidentaux. Toutes les formes d’art sont partieprenantes : le dessin, la peinture, la sculpture, lacéramique mais aussi l’architecture, la musique et,bien entendu, la littérature. Dès lors, la reconsti-tution d’un roman national apparaît sous nos yeux.Les arts populaires sont mis à l’honneur. L’artisa-
(1) En 1968, l’Acte institutionnel n° 5 (AI5) suspenditl’habeas corpus, imposa une censure préalable à l’ensemble desmoyens de communications et inaugura la phase la plus dure dela dictature – les années 1968-1974 dites anos de chumbo ouannées de plomb.
(2) Entretien avec Tania Maria, Paris, 1er décembre 2005. (3) Nous ne considérons pas ici les trajectoires de Caetano
Veloso et Gilberti Gil, exilés à Londres, ni celle de Chico Buar-que, réfugié un temps en Italie.
(4) La contradiction entre activité de dénonciation politiqueet nécessaire discrétion caractérise l’exil brésilien dont les orga-nisations furent confrontées aux forces de l’ordre françaises àplusieurs reprises au cours des années 1970. Cf. Maud Chirio,Les Trajectoires intellectuelles et politiques des exilés brésiliens pen-dant le régime militaire (1964-1979), mémoire de DEA, univer-sité Paris-I – Panthéon-Sorbonne, 2004.
(5) Musée d’Orsay, Paris, du 15 septembre 2005 au 8 janvier2006.
M EP_Revue90.fm Page 209 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
210
nat, l’illustration des contes populaires (Ivan Bili-bine) mais aussi le paysage, la terre et le peuplerusse (ou des périphéries de l’Empire) sont pro-mus à l’unisson d’un art russe original et fertile.Cette recherche d’une singularité puisée, à tort ouà raison, dans le grenier des arts et traditionspopulaires se double d’une préoccupation socialetoujours plus intense. L’abolition du servage et latransformation de « l’immuable » paysannerierusse, l’apparition d’un prolétariat et la révélationd’une condition ouvrière faite de misères, sont desthèmes sur lesquels s’appuie la nouvelle généra-tion d’artistes pour mettre en évidence des« types » nationaux et sociaux.
Dès 1863 le groupe des Ambulants cherche àexprimer les réalités sociales et politiques de laRussie impériale en puisant aux sources nationaleset crée un style « néo-russe ». Dans les villégiatu-res rupestres d’Abramtsevo près de Moscou et deTalachikino dans les environs de Smolensk, grâceau mécénat, deux groupes d’artistes se distinguentpar la vitalité de leur production. Des grands nomsde la peinture russe y travaillent, Polenov, Neste-rov et surtout Illya Repin. Mikhaïl Vrubel y exer-cera son talent. Enfant caché de l’art russe sous lapériode communiste, ses toiles présentées à Orsaysont un mince échantillon de son art mais sont trèsreprésentatives. Le visiteur occidental est surprispar les monumentales réalisations de ViktorVasnetsov, dans lesquelles le réalisme du traits’applique aux contes et légendes de la Russie.Nous sommes à la croisée des chemins en cette finde siècle où l’inspiration nationale est à son apo-gée. L’architecture prend le relais. À l’expositionuniverselle de Paris, en 1900, le pavillon russed’Ivan Bondarenko et Konstantin Korovine faitsensation. À Moscou, la maison Igoumnov,actuelle résidence de l’ambassadeur de France, enest certainement l’une des figures les plus origina-les (sa photographie est curieusement absente del’exposition1 ). Certaines gares de la ville sontbâties dans ce style surprenant, souvent chargé,
qui est à la recherche de la tradition. La capitalepréférée de Nicolas II, puis des bolcheviks, doitêtre considérée comme une véritable cité témoindu renouveau néo-russe, avant d’être le champ desexpériences architecturales de l’Art nouveau et duconstructivisme ensuite.
Les formes hardies et les couleurs vives, quel’on retrouve dans l’art religieux du moment, sontnéanmoins à l’étroit dans ce réalisme de circons-tance. Par ailleurs, la volonté de manifester un artnational exclusif résiste mal à l’ouverture surl’Europe. À la fin du siècle, on assiste à de vérita-bles échanges. Sans doute l’influence française etdes autres pays voisins comme l’Allemagne a con-tribué à faire évoluer l’art russe. Le paysage et leportrait empruntent certainement à l’impression-nisme français (Isaac Levitan, Valentin Serov).Les voyages des artistes russes avant 1914 donnentun nouvel élan à la création. Mais l’influence estréciproque. Au début du 20e siècle, la Russie sortde son isolement. En 1898, une revue, Le Monde del’art, est lancée à Saint-Petersbourg autour deSerge Diaguilev et du peintre Alexandre Benoitpour faire connaître au monde le renouveau del’art russe. Cette publication est suivie, quelquesannées plus tard, de la Toison d’or, revue d’art bilin-gue, en français et en russe, éditée à Moscou.Cette ouverture au monde s’accompagne d’unbouleversement des formes que l’expositionesquisse dans une dernière partie malheureuse-ment peu étoffée.
En introduisant le 20e siècle, les commissairesde l’exposition du musée d’Orsay nous laissent surnotre faim, mais suggèrent des continuités et deshéritages qui furent plus ou moins assumés par lerégime soviétique. De ce demi-siècle de produc-tion artistique, qui pousse bien au-delà de 1900,on voit naître l’innovation qui révolutionne lemonde de l’art dans les années 1910-1920 commedans l’œuvre de Petrov-Vodkine. Mais égale-ment, on y distingue déjà le travail des futuresgloires du réalisme socialiste jusqu’au très officielet nationaliste ombrageux Iliya Glazounov.
Cette question de l’« identité », qui va bien au-delà de la période, est posée par l’insertion, dansl’exposition, d’une importante collection d’objets
(1) On peut se reporter au magnifique ouvrage : Olga Morel(dir.), La Maison Igoumnov. La résidence de l’Ambassadeur deFrance, Paris, Flammarion, « Avant-garde », 1993.
M EP_Revue90.fm Page 210 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o
IMAGES ET SONS
211
d’art tirés du folklore et de l’artisanat traditionnel.Elle permet de remonter aux sources volontairesde l’art russe à la charnière du 19e et du 20e siècle.Si les artistes d’Abramtsevo formaient davantageune colonie, les ateliers d’artisanat de la princesseMaria Tenicheva à Talachkino ont constitué unfoyer artistique de premier plan. Le mobilier et lesobjets de décoration réalisés sur place ont enrichitrès vite les grandes collections particulières et lesprincipaux musées de l’Empire. Créés à partird’esquisses des peintres et créateurs du « Siècled’argent », ces objets utilitaires devaient préserverun art populaire, rural, menacé de disparition parla révolution de l’industrie et la croissance des vil-les. Pour les artistes et leurs mécènes, ce souci eth-nographique de préservation a, sans doute, été au-
delà de leurs espérances. Comme pour les motifsde la peinture de genre, il est surprenant de voir lapérennité des formes, des couleurs vives dans l’artsoviétique qui, surtout après la guerre de 1941-1945, redonne vigueur à l’art folklorique dans uncontexte patriotique inédit.
Pour conclure l’exposition, trois salles présen-tent une collection de photographies représentantla grande variété du paysage russe et de la popula-tion de l’Empire. Ces documents splendides sug-gèrent la permanence des traditions et des modesde vie, en particulier à la campagne, au-delà de1917. Nul doute qu’il s’agisse là encore du témoi-gnage d’un souci de préserver une civilisationmenacée, sentiment qu’ont partagé de nombreuxartistes de l’époque1.
Pascal Cauchy
(1) Signalons que l’exposition est illustrée par un très beaucatalogue qui comporte de nombreuses notices et de somptueu-ses illustrations : L’Art russe dans la seconde moitié du XIXe siècle : enquête d’identité, Paris, RMN/Musée d’Orsay, 2005.
M EP_Revue90.fm Page 211 Vendredi, 14. avril 2006 7:53 07
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 95
.91.
209.
38 -
18/
07/2
014
13h1
8. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 95.91.209.38 - 18/07/2014 13h18. © P
resses de Sciences P
o























![BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/bereiziat-gerald-et-al-buard-jean-francois-ed-la-grotte-de-labbaye-i.jpg)