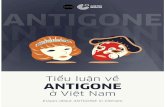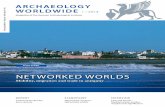kommentiertes vorlesungsverzeichnis - Institut für Südasien ...
BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons :...
-
Upload
univ-tours -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons :...
Report
Reference
La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse
2010-2012
BEREIZIAT, Gérald, et al.
BUARD, Jean-François (Ed.)
Abstract
La grotte de l'Abbaye I est connue depuis le début du 20ème siècle. De 1993 à 2003 des
campagnes de fouilles ont été menées par J.F. Buard avec deux campagnes de sondages
préliminaires (1993 et 1994, Buard et al. 1994 et 1995), puis de fouilles programmées de
1995 à 2003. La séquence stratigraphique du site couvre la fin du paléolithique supérieur, le
néolithique, l'âge du Bronze et le début de l'âge du fer et la période romaine.
BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I
Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève :
Institut Forel, 2012, 176 p., 95 fig., 37 tab.
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:45603
Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.
[ Downloaded 01/09/2015 at 14:52:50 ]
1 / 1
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 3 -
La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons
Rapport de synthèse 2010-2012
Jean-François Buard
Avec les contributions de
Gérald Bereiziat, Jean-Christophe Castel, Patricia Chiquet
Jocelyne Desideri, Sylvain Ozainne, Julia Patouret, Pierre-Jérôme Rey
et avec la collaboration de
Isabelle André, Etienne Jaffrot, Maelle Lhemon,
Mathieu Luret, Loic Jammet-Reynal, Lucie Martin, Pierre-Yves Nicod
et Sébastien Perret
Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie Institut Forel
Université de genève
Les Acacias
décembre 2012
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 5 -
CHAPITRE I
Introduction
Jean-François Buard
1 - Présentation
La grotte de l'Abbaye I est connue depuis le début du 20ème
siècle. Une première mention est faite en
1903 par l'abbé Tournier et Charles Guillon qui, dans leur "Suite aux hommes préhistoriques", font
état de leurs découvertes dans la grotte de l'Abbaye, qu'ils appellent "deuxième grotte du Pelat
(Tournier 1903). Dans les années 1960, Monsieur Jean Reymond conduira de nouvelles investigations
archéologiques dans la grotte, qu'il nomme alors grotte de l'Abbaye (Combier 1962 et 1977). De 1993
à 2003 des campagnes de fouilles ont été menées par J.F. Buard avec deux campagnes de sondages
préliminaires (1993 et 1994, Buard et al. 1994 et 1995), puis de fouilles programmées de 1995 à 2003
(clôture du chantier en 2003). Suit alors une reprise complète et serrée de la documentation chantier
lors des campagnes d'élaboration 2004-2006. Le cadrage stratigraphique détaillé et la présentation
synthétique de la séquence de la grotte de l’Abbaye ont été achevés en 2007 corolairement à la
rédaction du rapport de synthèse des fouilles 1993-2003 (Buard et al. 2007 et 2008).
En 2008 débute la préparation de la publication des fouilles 1993-2003. Le cadrage chrono-
stratigraphique des données de fouille ayant été finalisé, les études spécifiques peuvent commencer.
Ces études s'articulent autour du schéma stratigraphique général de la grotte de l'Abbaye, soit une
découpe en trois séquences : une séquence supérieure (préhistoire récente et périodes de historiques),
une séquence intermédiaire (stérile, Atlantique ancien) et une séquence inférieure (Mésolithique et fin
du Paléolithique supérieur). L’effort principal s’est tourné en 2008 vers l’étude des silex, étude
réalisée pour la séquence supérieure par Julia Patouret et pour la séquence inférieure par Gérald
Bereiziat. L’année 2009 a été plus particulièrement consacrée à la faune de la séquence inférieure,
étude effectuée au Muséeum d’histoire naturelle par Jean-Christophe Castel et Mathieu Luret et à
l’industrie osseuse de la séquence supérieure, étude menée par Sylvain Ozainne. Après une pause en
2010, l'accent a été mis en 2011-2012 sur les niveaux du néolithique moyen avec un ré-étalage des
céramiques des ensembles 4 à 7. La quasi-totalité des profils a été redessinée (P. Nicod, I. André et P.-
J. Rey p. 60-63). L'analyse des remontages a conduit à une réinterprétation de l'ensemble 6, soit
l'abandon de l'hypothèse d'une interdépendance entre les ensembles 5 et 6 au profit de celle des
ensembles 6 et 7. L’étude de la faune de la séquence supérieure a été réalisée en 2012 par Patricia
Chiquet. Une quarantaine d'ossements humains ont été découverts dans la séquence supérieure.
Hormis une description succincte, ils n'avaient pas encore fait l'objet d'une étude anthropologique.
C'est maintenant chose faite grâce à la contribution de Jocelyne Desideri.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 6 -
2 - Les études réalisées depuis 2008
- l'étude technologique des céramiques de l'âge du Bronze et du Néolithique moyen, étude menée
respectivement par Jean-François Buard (p.43) et Pierre-Jérôme Rey (p.55)
- l'étude silex, études réalisées pour la séquence supérieure par Julia Patouret (p.65) et pour la
séquence inférieure par Gérald Bereiziat (p.137).
- l'analyse archéozoologique, étude réalisées pour la séquence supérieure par Patriciat Chiquet (p.105)
et pour la séquence inférieure par Jean-Christophe Castel et Mathieu Luret (p.155).
- l’analyse technologique de l’industrie osseuse de la séquence supérieure, étude menée par Sylvain
Ozainne (p.99).
- l'étude des restes humains épars, analyse préliminaire, étude menée par Jocelyne Desideri (p.127).
3 - Travaux divers
Parallèlement aux études spécifiques, de nombreux travaux de préparation à la publication, à la
reddition de la documentation et au conditionnement du matériel archéologique ont été réalisés. Ces
travaux sont les suivants :
- vérification des attributions chrono-stratigraphiques et conditionnement des restes faunistiques
(collectif).
- vérification des attributions chrono-stratigraphiques et conditionnement des restes lithiques (Jean-
François Buard).
- vérification des attributions chrono-stratigraphiques et conditionnement de la petite industrie
osseuses de la séquence supérieure (Jean-François Buard).
- amélioration du catalogage des aménagements anthropiques (typologie des foyers et des
empierrements), vérification des descriptions et homogénéisation des champs descriptifs dans la base
de données (Jean-François Buard, p.166 et suiv.).
- purges des données de nivellement redondantes. Les données de nivellements (41'580
enregistrements) concernent la position tridimensionnelle des éléments constituants les aménagements
(pierres, rubéfactions, résidus de combustion), du relief et de la nature du sédiment des horizons
stratigraphiques et du matériel (céramique, faunes, silex etc. Jean-François Buard, p.174).
- mise au net des stratigraphies de références de la séquence inférieure (encrage A03.S12 et A03.S13,
Isabelle André, vectorisation des stratigraphies A97.S6, A03.S8, A03.S9 et A03.S13; Jean-François
Buard).
- vérification des attributions chrono-stratigraphiques et des descriptions des prélèvements
sédimentaires des séquences inférieur et supérieur. Sélection et tamisage par flottage des échantillons
sédimentaires de l'ensemble 7 (79 prélèvements, Jean-François Buard et Lucie Martin). Les
échantillons ont été sélectionnés, flottés et tamisés à une maille 0.5 en 2008. L’observation à la loupe
binoculaire des refus de tamis par Lucie Martin n’a pas révélé la présence de macro-restes à
l’exception des charbons.
- vectorisation des empierrements anthropiques et des foyers (Jean-François Buard et Maëlle Lhemon)
: ens.2.1 : E10, ens.3.1 : E13, ens.5 : E14, E15, E16, F19, F24; ens.6 : F3-F34, ens.7 : F27, F29-St50,
F35, F37-F38, E3-E18-E20-E31).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 7 -
4 - Collaborateurs
Isabelle André
- Participation à l'analyse chrono-stratigraphique et à l'interprétation planimétrique de la séquence
supérieure. La grotte de l’Abbaye à l’époque romaine : article rendu.
Université de Lausanne
Institut d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité
BFSH2
CH-1015 Lausanne
Gerald Bereiziat
- Les silex de la séquence supérieure : article rendu.
Université Bordeaux 1
UMR 5199 IPGQ
Avenue des facultés
33 405 Talence
Jean-Christophe Castel, Mathieu Luret col.
- Archéozoologie de la séquence inférieure : étude terminée, article rendu.
Département d’archéozoologie
Muséum d'histoire naturelle de Genève
Route de Malagnou, 1
CP 6434
CH - 1211 Genève 6
Patricia Chiquet
- Détermination ostéologique de d'industrie osseuse de la séquence supérieure : terminé.
- Archéozoologie de la séquence supérieure, article rendu.
Département d’archéozoologie
Muséum d'histoire naturelle de Genève
Route de Malagnou, 1
CP 6434
CH - 1211 Genève 6
Jocelyne Desideri
- Etude des restes humains épars de la séquence supérieure : article partiellement rendu.
Université de Genève
Institut Forel
Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie
Rue Gustave-Revilliod 18
CH-1211 Genève 4
Jehanne Féblot-Augustins
- Matières premières des silex de la séquence inférieure – ens.9 et 10 : terminé.
UMR 7055,
Préhistoire et Technologie,
Nanterre
Etienne Jaffrot
- Participation à l'analyse chrono-stratigraphique et à l'interprétation planimétrique de la séquence
supérieure.
Université de Tours
Laboratoire Archéologie et Territoires
UMR 6173 – CNRS
33 allée Ferdinand de Lesseps
37204 Tours cedex 03
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 8 -
Maëlle Lhemon
- Participation à l'analyse chrono-stratigraphique et à l'interprétation planimétrique de la séquence
supérieure. Vectorisation des empierrements anthropiques : terminé.
Université de Fribourg - Département de Géosciences
Minéralogie et Pétrographie
Ch. du Musée 6
1700 Fribourg - Suisse
Pierre-Yves Nicod
- La céramique des niveaux du Néolithique moyen (Ens. 5 à 7), analyse chrono-culturelle : étude en
cours.
Université de Genève
Institut Forel
Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie
Rue Gustave-Revilliod 18
CH-1211 Genève 4
Sylvain Ozainne
- industrie osseuse de la séquence supérieure : article rendu.
Université de Genève
Unité d'anthropologie
Rue Gustave-Revilliod 12
CH-1211 Genève 4
Julia Patouret
- Participation à l'analyse chrono-stratigraphique et à l'interprétation planimétrique de la séquence
supérieure. Les silex de la séquence supérieure de la grotte de l’Abbaye : étude terminée, article
partiellement rendu.
Inrap – Auvergne
Clermont-Ferrand
Sébastien Perret
- Participation à l'analyse chrono-stratigraphique et à l'interprétation planimétrique de la séquence
inférieure. Université de Fribourg - Département de Géosciences
Minéralogie et Pétrographie
Ch. du Musée 6
1700 Fribourg - Suisse
Pierre-Jérôme Rey
- étude technologique des céramiques du Néolithique moyen : article rendu.
Umr 5204 Edytem
Université de Savoie-CNRS,
Pôle Montagne – Campus scientifique
F 73376 Le Bourget du Lac
Loic Jammet-Reynal
- La céramique des niveaux du Néolithique moyen Bourguignon (ens.4 ) analyse chrono-culturelle :
étude en cours.
Université de Genève
Institut Forel
Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie
Rue Gustave-Revilliod 18
CH-1211 Genève 4
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 9 -
5 - État d'avancement du manuscrit
Projet de titre : "Des Magdaléniens aux Romains dans la grotte de l’Abbaye I à Chazey-Bons dans l’Ain."
Introduction et remerciements (J.-F. Buard : en attente)
Présentation générale (J.-F. Buard : terminé sauf "Contexte archéologique")
Contexte géographique et géomorphologique (J.-F. Buard : terminé)
Contexte archéologique (J.-F. Buard avec la collaboration de J.-M. Treffort : en cours)
Historique et présentation du site (J.-F. Buard: terminé)
Stratigraphie et datation des différentes phases d’occupation (J.-F. Buard: terminé)
La séquence supérieure (col. : en cours, avancé)
Présentations générale
La grotte de l’Abbaye à l’époque romaine (I. André : terminé)
- présentation générale (I. André: terminé)
- étude du matériel (I. André: terminé)
- plans de répartition du matériel, des aménagements anthropiques et planche de matériel (J.-F. Buard,
I. André : terminé)*
La grotte de l’Abbaye à l’âge du Fer et à l’âge du Bronze (J.-F. Buard : terminé)
- présentation générale (J.-F. Buard : terminé)
- plans de répartition du matériel, des aménagements anthropiques et planche de matériel (J.-F. Buard :
terminé)*
La grotte de l’Abbaye au Néolithique (J.-F. Buard : terminé)
- présentation générale (J.-F. Buard : terminé)
- étude du matériel (L. Jammet-Reynal, P.-Y. Nicod, S. Ozainne, J. Patouret, P.-J. Rey : études du
matériel terminée sauf céramiques des ensembles 5 et 6 (en cours), rédaction en cours ou avancée)
- plans de répartition du matériel, des aménagements anthropiques (J.-F. Buard : terminé)*.
Etudes particulières
Le matériel de l’âge du Fer et de l’âge du Bronze (J.-F. Buard : étude et planche de matériel terminées,
rédaction avancée)
La céramique de l'ensemble 4 et la question de la fin du Néolithique moyen dans le Jura méridional (L.
Jammet-Reynal : étude terminée, rédaction en cours)
Etude des inclusions de la céramique des ensembles 5 à 7 (P.-J. Rey : terminé)
La céramique des ensembles 6 et 7, Saint-Uze (P.-Y. Nicod : étude ensemble 7 terminée, ensemble 6
en cours)
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 10 -
L'industrie osseuse de la séquence supérieure (S. Ozainne : quasi terminé, quelques nouvelles pièces à
intégrer dans l'étude)
L’industrie lithique de la séquence supérieure (J. Patouret : étude terminée, rédaction : partie :
technologique terminée, partie matières en cours de rédaction)
La faune de la séquence supérieure (P. Chiquet : étude et rédaction terminées)
Les structures de combustion et les empierrements anthropiques (J.-F. Buard, avec la collaboration de
M. Lhémon : étude terminée, rédaction et illustrations en cours)
Anthropologie des restes humains épars (Jocelyne Desideri, étude en cours, avancé)
La séquence inférieure (terminé)
Présentations générale
- présentation générale (J.-F. Buard : terminé)
- plans de répartition du matériel, des aménagements anthropiques et plans de synthèse (J.-F. Buard :
terminé)*
Etudes particulières
L’industrie lithique (G. Bereiziat : terminé)
La faune (J.-C. Chastel : terminé)
Synthèse et conclusions (collectif : en attente)
Annexes : catalogues et inventaires (J.-F. Buard : terminé)*
* sous réserve de modification pour conformité au format d'édition
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 11 -
6 - Bliographie
BUARD (J.-F.), 1992. Projet de fouilles à la grotte de l'Abbaye I (Commune de Chazey-Bons, Ain). (Inédit, Service
Régional de l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Rhône-Alpes).
BUARD, (J.-F.) ed. et BATIGNE (C.), BASSET (S.), DE CEUNINCK (G.) et SORDOILLET (D.) collab. 1994.
Projet de fouilles à la grotte de l'Abbaye I (Commune de Chazey-Bons, Ain). (Inédit, Service Régional de
l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 49 p, 13 fig., 4 pl.
BUARD (J.-F.) et col. 1995. La grotte de l'Abbaye I, commune de Chazey-Bons, Ain. Rapport 1994. (Inédit, Service
Régional de l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 63 p., 26 fig., 6 tab.
BUARD (J.-F.). 1995. Abbaye I, Chazey-Bons, Ain : campagne 1995 : rapport intermédiaire. Genève : Dép.
d'anthrop. et d'écologie de l'Univ. (Rapport de fouilles, non publ.).
BUARD (J.-F.) et FÉBLOT-AUGUSTIN (J.) collab. 1996. La grotte de l'Abbaye I, commune de Chazey-Bons, Ain.
Campagne 1996 - Rapport intermédiaire (Inédit, Service Régional de l'Archéologie, Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 20 p.
BUARD (J.-F.), ed. & CHENAL-VELARDE (I.), FEBLOTT-AUGUSTIN (J.), MULLER (C.), WITTIG (M.),
collab. 1997. Abbaye I, Chazey-Bons, Ain : rapport de fouilles 1995-1997. (Inédit, Service Régional de
l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 101 p., 27 fig.
BUARD (J.-F.), ed., ANDRE (I.), FEBLOTT-AUGUSTIN (J.), LHEMON (M.), DIAZ (L.). 1999. Abbaye I,
Chazey-Bons, Ain : rapport de fouilles 1998. (Inédit, Service Régional de l'Archéologie, Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 67 p.
BUARD (J.-F.), ed. & ANDRE (I.), CUCCHI (T.), LHEMON (M.), MULLER (C.), PERRET (S.), PERSICO (S.),
collab. 1999. Abbaye I, Chazey-Bons, Ain : rapport de fouilles 1999. (Inédit, Service Régional de l'Archéologie,
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 22 p.
BUARD (J.-F.). 2000. Abbaye I, Chazey-Bons, Ain : rapport intermédiaire 2000. Genève : Dép. d'anthrop. et
d'écologie de l'Univ. (Rapport de fouilles, non publ.), 28 p.
BUARD (J.-F.). 2001. Abbaye I, Chazey-Bons, Ain : rapport intermédiaire 2001. Genève : Dép. d'anthrop. et
d'écologie de l'Univ. (Rapport de fouilles, non publ.), 43 p.
BUARD (J.-F.), ed. & CHENAL-VELARDE (I.), MULLER (C.), FEBLOTT-AUGUSTIN (J.) collab. 2002. Abbaye
I, Chazey-Bons, Ain : rapport de synthèse 2002. Genève : Dép. d'anthrop. et d'écologie de l'Univ. (Rapport de
fouilles, non publ.), 93 p., 52 fig.
BUARD (J.-F.), ed, & ANDRE (I.), HERITIER (L.), JAFFROT (E.), LHEMON (M.), MULLER-PELLETIER (C.),
PERRET (S.), ROCCA (R.), SARRESTE (F.), PATOURET (J.) collab. 2007. Grotte de l’Abbaye I, Chazey-
Bons, Ain : rapport de synthèse 2007. (Inédit, Service Régional de l'Archéologie, Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 178 p., 130 fig., 25 tab.
BUARD (J.-F.), BEREZIAT (G.), CASTEL (J.-C.), PATOURET (J.) & ANDRE (I.), CHIQUET (P.), JAFFROT
(E.), MARTIN (L.), MULLER-PELLETIER (C.), OZAINNE (S.) collab. 2008. Grotte de l’Abbaye I, Chazey-
Bons, Ain : rapport 2008. (Inédit, Service Régional de l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Rhône-Alpes), 119 p., 33 fig., 33 tab.
BUARD (J.-F.), BEREZIAT (G.), CASTEL (J.-C.), OZAINNE (S.), PATOURET (J.) & ANDRE (I.), CHIQUET
(P.), JAFFROT (E.), LURET (M.), MARTIN (L.), LHEMON (M.), MULLER-PELLETIER (C.), PERRET (S.),
collab. 2009. Grotte de l’Abbaye I, Chazey-Bons, Ain : rapport 2008-2009. (Inédit, Service Régional de
l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 149 p., 57 fig., 35 tab.
COMBIER (J.). 1962. Informations Archéologiques, circonscription de Lyon. Gallia Préhistoire, t. 5, pp. 262-264.
COMBIER (J.). 1977. Informations Archéologiques, circonscription Rhône-Alpes, Gallia Préhistoire, t. 20, fasc. 2,
pp. 561-562.
TOURNIER (A.) ET GUILLON (CH.). 1903. Les abris de Sous-Sac à l'époque Néolithique. Suite aux hommes
préhistoriques. Bourg. Imprimerie du Courrier de l'Ain. pp. 53-54.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 13 -
CHAPITRE II
Présentation générale
Jean-François Buard
1 - Contexte géographique et géomorphologique
La grotte de l'Abbaye I est creusée dans une petite falaise calcaire qui domine le flanc nord de la vallée
de la Chouette. Le site se trouve au pied des monts du Bugey, au nord du bassin de Belley. Les monts
du Bugey constituent l'extrémité sud des faisceaux du Jura externe. Ils se déclinent en monts du haut et
du bas Bugey, de part et d'autre de la cluse des Hôpitaux. Prolongement méridional des faisceaux du
Jura externe, les monts du Bugey sont délimités à l'est par la dépression miocène du Rhône dans
laquelle s'effilochent en grands anticlinaux la haute chaîne jurassienne, au sud par les plateaux
miocènes du Bas Dauphiné, et à l'ouest par le plateau jurassique de l'île de Crémieux (Figure 2).
Le bassin de Belley est pris en tenaille par les monts du Bugey et par la haute chaîne jurassienne, dont
les prolongements dans le piémont miocène relient la chaîne du jura à la chaîne subalpine. La vallée
du Rhône à l'est et la cluse des Hôpitaux au nord en sont les principales voies d'accès. Le paysage est
principalement déterminé par les monts du Bugey. La montagne de Virieu et le molard de Don bornent
le secteur au nord et à l'ouest. L'espace est plus ouvert à l'est où les monts de Marigieu séparent le
couloir de Chazey-Bons des marais de Lavours. Au sud-est, les vallées du Furans et de l'Ousson en
contournent la colline molassique de Belley pour se connecter à la vallée du Rhône. Situé dans la zone
intra-würmienne, le secteur a subi une forte érosion glaciaire. Le relief des zones basses est modelé par
les dépôts de la fin Würm récent. Le secteur est dégagé des glaces würmiennes à la fin du pléistocène.
Le Furans, qui prend sa source dans la cluse des Hôpitaux, débouche dans le bassin de Belley par le
couloir de Chazey-Bons, contournant par l'est un massif calcaire de faible importance (Figure 3). Ce
massif est entaillé d'est en ouest par l'étroite vallée de la Chouette. La partie inférieure de la vallée, la
plus importante, est creusée dans des marnes hauteriviennes à intercalations calcaires. De petites
falaises de calcaire barrémo-aptien à faciès urgonien (crétacé), de 5 à 10 mètres de hauteur, reposent
sur ce substrat marneux. La grotte de l'Abbaye I s'ouvre à 270 m d'altitude sur le flanc nord, au milieu
de la vallée (Figure 4). Elle fait face à la grotte du Pelat, également nommée grotte de la Chouette, qui
se trouve sur le flanc sud. Dans son dos émerge le mont Follieu, point culminant du massif (319 m).
Le massif, comme tous les affleurements calcaires environnants, est recouvert d'une chênaie à buis.
Les moraines livrent d'abondants galets alpins que l'on trouve en concentration sur le bord des
chemins. Au lieu-dit la Praille de Sin, au nord du massif, un marais occupe une petite reculée glaciaire.
Le massif s'appuie à l'ouest contre le plateau de Contrevoz. Ce plateau, sis en contrebas du molard
Dedon, est recouvert de moraine et offre un terrain fertile à l'agriculture et à la vigne. Le massif est
délimité à l'est et au nord par le couloir de Chazey-Bons, zone basse comprise entre 230 et 240 m.
Actuellement drainé, le couloir se trouve en zone inondable. La nappe phréatique affleure au niveau
du Furans, qui déborde facilement de son lit. Dans le couloir de Chazey-Bons ont dû alterner des
phases marécageuses à alluvionnaires durant la préhistoire.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 14 -
Figure 1 : situation géographique générale de la grotte de l'Abbaye I (cartographie J.-F. Buard).
Figure 2 : situation géologique générale de la grotte de l'Abbaye I (cartographie J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 15 -
Figure 3 : carte géologique simplifiée de la région de Chazey-Bons au 1:100 000 (d'après la carte géologique
du BRGM au 1:50 000, feuille de Belley, édition 1990. Relief d'après les données SRTM à 90m. Cartographie J.-
F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 16 -
Figure 4 : le couloir de Chazey-Bons, contexte géologique détaillé au 1:20 000 (d'après la carte géologique du
BRGM au 1:50 000, feuille de Belley, édition 1990 et la carte IGN au 1:25 000 3231 E, série bleue édition 1992,
cartographie J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 17 -
2 - Historique des fouilles
Les fouilles anciennes
L'intérêt archéologique de la grotte est relevé une première fois en 1903 par l'abbé Tournier et Charles
Guillon qui, dans leur "Suite aux hommes préhistoriques", font état de leurs découvertes dans la grotte,
qu'ils appellent "deuxième grotte du Pelat". Cette activité archéologique se traduit par le réseau de
tranchées que nous avons repéré entre 1993 et 1995 dans la partie avant du porche.
Dans les années 1960, Monsieur Jean Reymond conduira de nouvelles investigations archéologiques
dans la grotte, qu'il nomme alors grotte de l'Abbaye. Les résultats les plus importants des fouilles de
Jean Reymond ont été publiés dans les "Informations Archéologiques" de Gallia Préhistoire par Jean
Combier, alors Directeur de la circonscription Rhône-Alpes (Combier 1962 et 1977). Les fouilles
anciennes ont fortement touché la partie avant du porche. Dans cette zone, les niveaux supérieurs
resteront très faiblement documentés. Ces niveaux ont été partiellement touchés dans les secteurs IK-
16/17, JK-15, NM-14 et OP-12/13. Ils ont été complètement enlevés dans les secteurs IL-10/12, NM-
12/13 et J-13/14 et dans la zone JL-13/14 (Figure 5 et Figure 8). Cette situation est dommageable pour
l'interprétation des niveaux archéologiques de la séquence supérieure, objectif prioritaire des fouilles
1993-2003.
Les fouilles récentes 1993-2003
Dans le cadre du programme "Les premiers paysans haut-rhodaniens" du Fonds national pour la
recherche scientifique (FNRS), un sondage préliminaire a été effectué en juin 1993 suivit en 1994
d’une campagne de sondage complémentaire (Figure 5.b). Ces deux campagnes de sondages ont
permis d'établir le cadre chrono-stratigraphique général du gisement avec, une subdivision de la
stratigraphie en trois en trois séquences sédimentaires. On observe, au sommet, une séquence holocène
limono-argileuse sombre fortement anthropique, puis un niveau carbonaté jaunâtre datable de
l'Atlantique ancien et enfin, une séquence tardiglaciaire de sables limoneux à cailloutis cryoclastiques
lessivés, concrétionnés et parfois bréchifiés.
Dès 1995 et jusqu’en 2003 se poursuit l’exploitation du gisement en fouille programmée. La fouille est
alors dirigée en fonction de deux objectifs : fouille extensive de la séquence supérieure et sondages
prospectifs dans la séquence inférieure. Nous procédons en conséquence à l'extension des secteurs de
fouille. Le sondage prospectif de la séquence inférieure réalisé en M-12/13 est étendu en 1995 à la
bande N constituant le secteur NM-12/13. La fouille extensive de la séquence supérieure s'étend dans
un double mouvement, centripète par l'ouverture de secteurs au fond et à l'ouest de la grotte et
centrifuge par l'ouverture de secteurs contigus au centre du porche (Figure 5, c et d).
Bien que progressive, l'extension de la fouille peut se schématiser en deux phases. La première phase
se déroule de 1995 à 1997, avec l'exploitation de secteurs situés au centre du porche (secteur LN-15,
OP-14/15 et OP-12/13, Figure 5.c). La seconde phase entamée courant 1997 dans le secteur PQ-23/24,
se développe en 1998 et 1999. Elle voit s'ouvrir de nouveaux secteurs en périphérie du porche (PQ-
23/24, ST-12/13, ST-14/17, LO-20/21, Figure 5.d). Cette seconde phase s'accompagne de la fouille de
petits secteurs de contrôle, situés au fond ou contre les flancs de la grotte (ST-18/19, R20, P-20/21), et
de la réouverture pour complément du secteur NM-14.
La fouille de la grotte de l'Abbaye se termine en 2003 avec le relevé des dernières stratigraphies et la
clôture du chantier ensuite.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 18 -
a : emplacement des fouilles anciennes et, en gris clair,
secteurs concernés par les fouilles 1993-2003.
b : sondages préliminaires 1993-1994, en noir
emplacement des sondages de 1993, en gris sombre
extension de la fouille en 1994.
c : première phase de fouille programmée 1995-1997.
d : seconde phase de fouille programmée 1998-2003.
Figure 5 : position des fouilles anciennes (a) et évolution des fouilles récentes (b à d, plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 19 -
3 - Orientation stratigraphique
Depuis 1993, nous utilisons le terme d'ensemble stratigraphique. Un ensemble correspond à un dépôt
sédimentaire bien visible en stratigraphie, un dépôt brun caillouteux par exemple. La numérotation des
ensembles stratigraphiques repose sur l’interprétation des stratigraphies S1, S2, S6 et S13 (Figure 9).
Les premières, A93.S1 et A93.S2, ont été relevées à la fin de la première année de sondage lors de la
campagne 1993. La troisième, A97.S6, a été relevée à la fin de la première période de fouille
programmée et constitue la stratigraphie de référence depuis pour la séquence supérieure (Figure 26).
La dernière, A03. S13, a été relevée en fin d’opération, lors de la campagne 2003 et sert de référence
pour les séquences intermédiaire et inférieure (Figure 31).
La stratigraphie de la grotte de l'Abbaye repose sur le schéma proposé dans le rapport de 1998, fourni
en appui de la dernière demande de fouille programmée (Buard et col., 1998). Elle se découpe en trois
séquences : la séquence supérieure (ensembles 1 à 7), la séquence intermédiaire (ensemble 8) et la
séquence inférieure (ensembles 9 à 13). La séquence supérieure est relative aux périodes récentes de la
préhistoire et de l'histoire : Néolithique, Âge du Bronze, Âge du Fer et époque romaine. La séquence
inférieure est relative aux périodes plus anciennes : Mésolithique et fin du Paléolithique supérieur. La
séquence intermédiaire les sépare. Elle n'a pas livré d'indices anthropiques.
Pour bien comprendre la structure du remplissage de la grotte, il convient de garder à l'esprit que le
gisement est très régulièrement soumis à un intense ruissellement de l'eau de percolation. Celui-ci
arrive en période de pluie après quelques jours. S'échappant des diaclases, l'eau tombe en très grande
quantité de la voûte, donnant, à son paroxysme, l'impression qu'il pleut dans la grotte. Ce phénomène a
pour résultat immédiat la constitution d'imposantes concrétions stalagmitiques, comme celles qui
bouchent le fond de la grotte ou que l'on rencontre dans la séquence intermédiaire ou dans la séquence
inférieure. Sur la voute, à l'embouchure des diaclases se forment des stalactites bulbeuses, ou plus
classiques, en trompettes inversées. Ces stalactites se retrouvent en grande quantité dans le
remplissage de la séquence supérieure. S'ajoute le concrétionnement qui cimente les sédiments, parfois
assez profondément et enrobe le matériel. Ces brèches ont été observées en de nombreux endroits dans
toutes les séquences. Le ruissellement est également responsable de la création de perturbations de
surface. Il vidange le sédiment, créant des "structures" en entonnoir et en profondeur des courants de
circulation d'eau marqués par la création d'agrégats carbonatés. Le ruissellement engendre une
migration des éléments fins (limons, argiles, cendres), pouvant aboutir à un certain mélange à
l'interface entre deux sédiments, et rend les subdivisions stratigraphiques parfois imprécises.
La séquence supérieure
Les limons argileux de la séquence supérieure indiquent dans l'ensemble une phase tempérée. L'action
des hommes (cendres, litières, coprolithes) y est un facteur de remplissage important, voir
prépondérant. S'ajoute le délitage de la roche encaissante comme en témoigne l'abondance des
modules calcaires de toutes tailles (gravillons, graviers, pierres…). La base de cette séquence
(ensembles 5 à 7) en est particulièrement bien fournie. Cette remarquable concentration de pierres de
taille moyenne (10 à 30 cm.) peut, par endroits, représenter le 80% du remplissage. La séquence
supérieure est également enrichie en matière organique par les mousses et les plantes qui ne manquent
pas de coloniser ce biotope humide.
Sous les déblais des fouilles ancienne et sous un mince dépôt historique (ensemble 0), on distingue
une phase sommitale récente (ensemble 1.1, époque romaine), une phase de limons argileux gris
brunâtre (ensembles 1.2 premier Âge du Fer et 1.3, Bronze final IIb-IIIa), une phase de limons
argileux bruns-gris à bruns (ensemble 2.1, Bronze moyen) dont la base est riche en poches de
gravillons (ensemble 2.2, Bronze ancien). Suit un épais dépôt stratifié grisâtre cendreux à fumier de
bergerie, riche en foyers et pauvre en matériel (ensembles 3.1, 3.2 et 3.3, Néolithique final).
Le sommet des niveaux du Néolithique moyen consiste en une phase hétérogène, brun sombre au
centre à brun jaunâtre vers l'est. Ce dépôt est relativement riche en matériel (ensemble 4, NMB). Suit
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 20 -
une phase gris-brun assez caillouteuse (ensemble 5, Chasséen moyen indifférenciés). Les niveaux du
Néolithique moyen se terminent avec un niveau bien structuré, riche en empierrements (Ensemble 6,
7.1 et 7.2, Chasséen ancien à céramique de style Saint-Uze).
La séquence intermédiaire et son influence sur la configuration de la séquence supérieure
La séquence intermédiaire (ensemble 8) témoigne d'une phase chaude et humide par sa constitution
essentiellement carbonatée. Elle provient de la précipitation du calcaire circulant avec l'eau de
percolation, sous l'action possible de micro-organismes. Ce type de sédiment est typique des dépôts
karstiques Atlantique ancien. Cette phase est marquée par un intense ruissellement, responsable, en
tout ou en partie, de la vidange de sédiment détectée dans le cailloutis de la séquence inférieure et des
imposantes concrétions qui y prennent racine. La séquence intermédiaire constitue un excellent repère
stratigraphique. Elle se retrouve sur toute la surface de la grotte, et s'intercale entre les dépôts
cryoclastiques antérieures au Néolithique (ensembles 9 à 13) et les sédiments limoneux argileux
sombres, contemporains et postérieurs au Néolithique (ensembles 1 à 7).
Le sommet de la séquence intermédiaire se présente sous la forme d'une vaste cuvette dont le point bas
se situe en LMN-13/14, accusant un dénivelé d'environ 1,2 m (Figure 6). De cette disposition dérive la
configuration des dépôts de la séquence supérieure, des niveaux néolithiques plus particulièrement
(ensembles 3 à 7). Ces derniers remplissent le fond de la cuvette et se biseautent contre ses flancs.
L'amplitude sédimentaire des niveaux néolithiques varie donc fortement en fonction de son substrat.
Elle accuse une forte réduction sur les flancs de la cuvette, situés en périphérie ouest et nord de la
grotte. Inversement, elle s'amplifie en direction de son épicentre situé au centre est de la grotte.
L'amplitude sédimentaire des niveaux néolithiques est donc bien plus grande dans les secteurs du
centre (40 à 70 cm.) que dans les secteurs périphériques (10 à 40 cm.). Les niveaux de l’Âge du
Bronze et de l’époque romaine sont moins marqués par la forme en cuvette de l’ensemble 8.
On distinguera alors pour la séquence supérieure donc les secteurs centraux, situés en zone basse, où
l'amplitude sédimentaire de la séquence supérieure est satisfaisante, des secteurs périphériques situés
en zone haute, à amplitude sédimentaire réduite (Figure 7). En conséquence, les subdivisions
stratigraphiques de la séquence supérieure sont définies au niveau des secteurs du centre du porche,
soit des secteurs LN-15, OP-14/15 et LP-16/17. Le raccord des secteurs périphériques aux secteurs du
centre se fait, lorsque les variations latérales de faciès sédimentaires sont trop importantes, sur la base
du matériel archéologique et des datations radiocarbones.
La séquence inférieure
La fouille de la séquence inférieure se limite à deux secteurs contigus situés au centre du porche (IL-
10/12 et MN-12/13) et à un secteur à l'ouest (ST-18/19, Figure 8). Dans le secteur IL-10/12, seul le
sommet de la séquence inférieure a été décapé, la fouille ayant été stoppée lors de l'arrivée sur une
énorme concrétion. Le secteur MN-12/13 a été décapé sur l'ensemble de la séquence. Ce secteur sert
donc de référence dans l'établissement des ensembles stratigraphiques de la séquence inférieure. Le
secteur ST-18/19 est coincé entre la paroi ouest et les grandes concrétions qui bouchent le fond de la
grotte. Il a livré un lot de silex infiltrés entre les diaclases de la paroi.
La séquence inférieure témoigne d'une phase relativement froide. Elle est essentiellement constituée
d'un cailloutis cryoclastique fortement lessivé et souvent concrétionné, dans lequel s'encadre des
phases caillouteuses. Un intense ruissellement a passablement perturbé le sommet de la séquence
inférieure (ens.9 et sommet ensemble 10). Le déplacement des éléments fins (sables, limons, argiles,
cendres) adjoints à l'implantation d'imposantes concrétions en rendent la lecture de terrain difficile et
les informations lacunaires. Même s'il présente d'évidentes marques de ruissellement, le corps de la
séquence est mieux conservé (base ens.10, ens.11 et 12). Séparé des ensembles précédents par une
coulée sableuse (ensemble 12), l'ensemble 13 est nettement mieux conservé.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 21 -
carroyage métrique
alt. sous le zéro
de chantier :
prof [m.]
0.78 à 1
1 à 1.2
1.2 à 1.4
1.4 à 1.6
1.6 à 1.8
1.8 à 1.9
1.9 à 2.05
Figure 6 : reconstitution tridimensionnelle de la cuvette au sommet de la séquence intermédiaire (ens.8), facteur
d'exagération verticale, 1.5. Nord de chantier orienté coin supérieur gauche (plan J.-F. Buard).
carroyage métrique
alt. sous le zéro
de chantier.
prof [m.]
0.78 à 1
1 à 1.2
1.2 à 1.4
1.4 à 1.6
1.6 à 1.8
1.8 à 1.9
1.9 à 2.05
Figure 7 : projection des zones de fouille sur le sommet de la séquence intermédiaire. En bleu secteurs
périphériques, zone haute, en vert secteurs centraux, zone basse, en rouge secteurs dédiés à la séquence
inférieure. Nord de chantier orienté coin supérieur gauche (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 22 -
Figure 8 : nom et position des secteurs de fouille. En vert secteurs situés au centre du porche, en bleu secteurs
périphériques, en rose secteurs dédiés à la fouille de la séquence inférieure (plan J.-F. Buard).
secteurs A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A00 A01 A02
IL-10/12
NM-12/13
ST-18/19
NM-14
LN-15
OP14/15
OP-12/13
J-13/14
LP-16/17
JK-15
IK-16/17
PQ-23/24
ST-12/13
LO-20/21
ST-14/17
P-20/21
R-20
Tableau 1 : répartition des secteurs par campagne de fouille.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 23 -
secteurs surface Développement des séquences
en m2 inférieure int. supérieure
NM-12/13 4 Oui, développée. oui Non, détruit par les tranchées Tournier-Guillon.
IL-10/12 7,5 Partielle, base tranchées, un peu de mésolithique.
oui Non, détruit par les tranchées Tournier-Guillon.
ST-18/19 1,5 Partielle, traces d'Azilien. oui Non, très faible amplitude sédimentaire.
LN-15 3 Non, arrêt sur seq. int. oui Oui, développée, séquence complète.
OP14/15 4 Non, arrêt sur seq. int.. oui Oui, développée, séquence complète.
LP-16/17 10 Non, arrêt sur seq. int. oui Oui, assez développée, séquence complète, amplitude sédimentaire moins forte en OP-16/17.
NM-14 2 Oui, sur 30 cm. en M14, extension lors de la rectification de s12 et s13.
oui Partielle, Néolithique uniquement, romain et Âges des métaux sous l'emprise des fouilles Reymond.
OP-12/13 4 Non, arrêt sur seq. int. oui Faible, sous l'emprise des tranchées Tournier-Guillon. Fort biseautage en direction du sud, lessivages importants.
J-13/14 2 Non, arrêt sur seq. int. oui Non, sous l'emprise des tranchées Tournier-Guillon.
JK-15 2 Non, arrêt sur seq. int. oui Faible, développée sur 1/4 de la surface, sous l'emprise des tranchées Tournier-Guillon.
IK-16/17 5 Non, arrêt sur seq. int. oui Oui, assez développée bande 16, partielle bande 17, front de tranchée flanc sud.
PQ-23/24 4 Non, arrêt sur seq. int. oui Très faible, Bronze final IIb-IIIa uniquement.
ST-12/13 4 Non, arrêt sur seq. int. oui Non, très faible amplitude sédimentaire, lessivages importants.
LO-20/21 5 Non, arrêt sur seq. int. oui Partielle, développée pour l'Âge du Bronze, forts biseautages ensuite contre le flanc nord.
ST-14/17 8 Non, arrêt sur seq. int. oui Oui, romain bien conservé, amplitude sédimentaire correcte pour les Âges des métaux, réduite pour le Néolithique, érosion importante au Néolithique final. Biseautages des niveaux néolithiques contre les flancs sud, nord et est.
P-20/21 2 Non, arrêt sur seq. int. oui Non, forte altération, terrier, lessivage important, très faible amplitude sédimentaire.
R-20 1 Non, arrêt sur seq. int. oui Non, pas de sédimentation, lessivage important.
Tableau 2 : présentation des secteurs de fouille, tableau de synthèse. En rose, secteurs dédiés à la séquence
inférieure. En vert, centre du porche, zone basse; en bleu, périphérie du porche, zone haute. En vert prononcé,
secteurs déterminant dans l'établissement de la stratigraphie de la séquence supérieure.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 24 -
Figure 9 : position des stratigraphies. En gras les stratigraphies de référence A97.S6 (séquence supérieure) et
A03.S13 (séquence inférieure, plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 25 -
4 - Présentation synthétique des ensembles stratigraphiques de la séquence supérieure
Ens. 0 : sommet de la séquence supérieure, dépôts récents, limons argileux hétérogènes humiques
gris-brun sombre à brun jaunâtre, riches en graviers et gravillons, ainsi que les déblais des tranchées
Tournier et des fouilles Reymond.
Figure 10 : ensemble 1.1
Ens. 1.1 : niveau d'occupation romaine (IIIe siècle) dont les vestiges se concentrent dans le secteur ST-
14/17, à l'ouest du porche, autour d'une légère cuvette pierreuse à matrice limono-charbonneuse
noirâtre (St31). Deux foyers lui sont associés : F43 et F47. Ce niveau, bien identifiable à l'ouest du
porche, fugace ailleurs, est composé de limons argileux gris à gris-brun foncé, noirâtres au contact de
St31.
Ens. 1.2 : traces de fréquentation du premier l'Âge du Fer composé de limons gris-brun foncé à fins
placages compacts légèrement jaunâtres. Cet ensemble est limité au centre du porche. Il est bien
visible en OP-16/17 et mal identifié ailleurs. Il s'articule autour de deux foyers à plat (F17 et F41). A
la base de l'ensemble 1.2, le matériel se mélange avec celui du de l'ensemble 1.3.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 26 -
.
Ensemble 1.1, époque romaine
Ensemble 1.2, HaC
Ensemble 1.3, Bronze final.
Figure 11 : ensembles 1.1, 1.2 et 1.3 éléments typologiques (dessin I. André).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 27 -
Ens. 1.3 : niveau d'occupation du Bronze final IIb-IIIa, composé de limons argileux gris-brun foncé à
graviers et gravillons jaunâtres au centre du porche et de limons brunâtres à l'ouest. Deux cuvettes
pierreuses à remplissage limoneux-argileux gris foncé noirâtre (St27, St33) et un petit empierrement
anthropique (E27) lui sont associés, tous situées dans le secteur LP-16/17, au centre du porche. Ce
niveau hétérogène et peu structuré est daté par un échantillon situé à la base du dépôt (E27 - Dt9) :
GrA-20648 (Ly-1843) : 2800 ±50 BP, 1020-860 av. J.-C. Le secteur PQ-23/24, qui se situe au nord du
porche et dont l'amplitude sédimentaire se limite à l'ensemble 1.3, a livré une pièce attribuable au
Bronze final IIb.
Ens. 2.1 : niveau d'occupation du Bronze moyen. Ce niveau est composé dans l'ensemble de limons
brun-marron. Au centre du porche, en NP-15/17, il est brun-gris moyennement caillouteux au sommet,
brun-marron moins caillouteux à la base. Le niveau est peu structuré. Le matériel est "brassé".
L'ensemble 2.1 a toutefois livré un gros empierrement anthropique (zone de rejet) situé contre la paroi
est du porche (E10, secteur IK-16/17).
A l'ouest du porche, dans le secteur ST-14/17, la distinction entre les ensembles 1.3 et 2.1, tous deux
composés de limons brunâtres, se fait sur la base du matériel archéologique. On y distingue pour
l'ensemble 2.1 deux phases sédimentaires, avec, au sommet, des limons bruns indifférenciés (ens. 2.1)
et à la base l'horizon défini par le foyer F11 (ens. 2.11). Le foyer F11 a fourni une date (Dt39) : Ly-
2768 : 3005±30 BP, 1370-1130 av. J.-C., date trop récente compte tenu de la position stratigraphique
de F11 (base ens. 2.11) et du matériel.
Figure 12 : ensemble 2.1, Bronze moyen.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 28 -
Figure 13 : ensemble 1.3
Figure 14 : ensemble 2.1
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 29 -
Ens. 2.2 : niveau d'occupation de la fin du Bronze ancien, composé au centre du porche de limons
argileux brun-marron très riches en gravillons et peu caillouteux (ens. 2.21). Ce niveau est associé à
deux foyers (F15 et F30). Indigent en matériel typologique, l'ensemble 2.21 est attribué à la fin du
Bronze ancien sur la base de datages radiocarbones (Dt2) : OXA-5266: 3500 +- 60 BP, 2020-1770, et
(Dt15) : GrA-21024 (Ly-1845) : 3540±35 BP, 1940-1770. Un troisième datage provenant du foyer
F15 fourni une date beaucoup trop récente (Dt23) : GrA-21027 (Ly-1847) : 3150±40 BP, 1495-1395
av. J.-C. A l'ouest du porche, sur la base d'une datation C14, on rattache à l'ensemble 2.21 les horizons
définis dans le secteur ST-14/17 par les foyers F13 et F40 (ens. 2.22). Les horizons F13-F40 sont sous-
jacents à l'horizon F11 (ens. 2.11) et sont datés de la fin du Bronze ancien par un échantillon provenant
du foyer F13 (Dt38) : Ly-2767 : 3450±30 BP, 1880-1690 av. J.-C.
Figure 15 : ensemble 2.2
Ens. 3.1 : niveau d'occupation de la seconde partie du Néolithique final (après 3000 av. J.C.). Ce
niveau, riche en foyers, est composé de limons gris clair à invaginations brun jaunâtre épars,
interprétés comme des fumiers brûlés de bergerie. Une analyse micromorphologique du sédiment a
révélé une composition apparentée à celle des fumiers de caprinés, marquée par des sphérolithes, des
coprolithes brûlés, des microcharbons et des phytolithes en paquets (échantillons A93.M2 et A93.M3;
Sordoillet 1994). Limité aux secteurs centraux et nord, l'ensemble 3.1 est localement stratifié en deux
horizons, l'horizon F12sup-F31 (ens.3.11) et l'horizon F12inf-F18-F23 (ens.3.12). Indigent en matériel
typologique, l'ensemble 3.1 est attribué au Néolithique final sur la base d'un datage radiocarbone du
foyer F12sup (Dt17) : Ly-2240 (OXA) : 4130 ± 40, 2870-2620 av. J.-C. L'ensemble 3.1 s'étend
légèrement dans le secteur LO-20-21 où il se biseaute dans le sens nord-sud (ens.3.13).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 30 -
Figure 16 : ensemble 3.1
Figure 17 : ensemble 3.2-3.3
Ens. 3.2 : niveau d'occupation de la première partie du Néolithique final (avant 3000 av. J.C.) limité à
la partie ouest du porche (secteur ST-14/17). Ce niveau, assez hétérogène, est sous-jacent à l'ensemble
2.22. Il se raccorde grosso modo à l'ensemble 3.3 (voir ci-dessous) sur la base du matériel et d'une
datation C14 concordante (Dt25) GrA-20647 (Ly-1848) : 4530±60 BP, 3360-3100 av. J.-C. La frange
ouest du secteur ST-14/17 a été érodée par des phénomènes de lessivage (érosion très nets en T16-17).
On a toute fois pu y mettre en évidence, en association avec le foyer F21, une zone de travail du silex.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 31 -
Ens. 3.3 : niveau d'occupation de la première partie du Néolithique final (avant 3000 av. J.C.). Ce
niveau, riche en foyers, a la même extension l'ensemble 3.1. L'ensemble 3.3 est toutefois plus sombre,
et plus caillouteux que l'ensemble 3.1. A l'est du porche, on observe une zone plus claire à
invaginations jaunâtres particulièrement nettes. Ce sédiment est également interprété comme des
fumiers brûlés de bergerie (F25, secteur IK-16/17 et portion est du secteur LP-16/17). Indigent en
matériel typologique, ce niveau est attribué au début du Néolithique final sur la base d'une datation
radiocarbone provenant de F25 (F25 -Dt26) Ly-2766 : 4670±35 BP, 3520-3370 av. J.-C. Dans le
secteur OP-12/13, une fosse foyère (St10), dont le niveau d'ouverture a été arasé par les fouilles
Reymond, est datée de la même période (St10 - Dt42) Ly-2770 : 4625±35 BP, 3500-3360 av. J.-C.
Ens. 4 : niveau d'occupation du Néolithique Moyen Bourguignon. Peu structuré, il est composé de
limons argileux brun-gris à pierres de petites et moyennes tailles (5-15 cm.), localement brun jaunâtre.
Il se suit bien sur l'ensemble du site. Le matériel est cohérent mais très dispersé. Le niveau est daté
avec un échantillon provenant du sommet de l'ensemble 4 (Dt20) GrA-20618 (Ly-1846) : 4950±60
BP, 3790 - 3650 av. J.-C.
Figure 18 : ensemble 4, NMB, éléments typologiques (dessin P.-J. Rey).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 32 -
Ens. 5 : niveau d'occupation du Chasséen. Au centre du porche, ce niveau est défini par un niveau
pierreux assez dense (E16, ens.5) à matrice limono-argileuse gris-brun. Dans les secteurs
périphériques, l'ensemble 5 se biseaute très fortement contre les flancs ouest et nord du porche.
L'ensemble 5 a livré plusieurs foyers bien conservés (F19, F24, St9. L'ensemble 5 a livré très peu de
matériel. L'ensemble 5 est attribué au chasséen sur la base de la datation du foyer F24 (Dt40) Ly-2769
: 5110±35 BP, 3970-3810 av. J.-C.
Ens. 6 : anciennement rattaché à l'ensemble 5, l'ensemble 6 est actuellement interprété comme la
phase terminale de l'occupation du Chasséen ancien à céramique de style Saint-Uze. L'ensemble 6 est
bien défini au centre du porche par un épandage noirâtre charbonneux (F3) lié à une activité de
combustion (F34). Il se perd dans les secteurs périphériques. Ce niveau est en cours de ré-évaluation.
Plusieurs remontages céramiques le lie à l'ensemble 7 sous-jacent.
Ens. 7 : niveau d'occupation complexe du Chasséen ancien à céramique de style Saint-Uze.
L'ensemble 7 est très structuré et bien conservé. Il est composé de plusieurs empierrements. Ces
empierrements sont imposants et nombreux au centre du porche (E3, E18, E20, E23, E31), moins
présents en périphérie ouest du porche (E28, E33). Ce niveau est subdivisé en deux (ens. 7.1 et 7.2),
avec les horizons E3-E18-E20-F38 puis E23-E31-F48 au centre du porche, et les horizons F29-St50
puis E28-F35 dans le secteur St-14/17.
L'ensemble 7.1 est défini par trois gros empierrements jointifs (E3, E18, E20) à matrice de limons
argileux gris à gris-brun sombre. Ces empierrements reposent soit sur des éléments de l'ensemble 7.2,
soit directement sur l'ensemble 8. Dans l'ensemble 7.2 les empierrements sont moins étendus et le
matériel moins dense que dans l'ensemble 7.1. L'ensemble 7.2 repose sur les sables grossiers jaunâtres
à agrégats carbonatés de l'ensemble 8. Il est caractérisé par un fin niveau de limons sableux brun-gris
jaunâtre à empierrements localisés (E23, E28, E31). A la base de l'ensemble 7.2 s'ouvrent une série de
structures en creux et de ravines creusées dans le sommet de l'ensemble 8 (St22, St25, St34, St43,
St44, St45, St48, St49). Ces structures sont remplies de pierres, de limons sableux brun-gris jaunâtre et
d'un peu de matériel infiltré.
La séparation entre les ensembles 7.1 et 7.2 n'est évidente que dans la zones à empierrements denses
au centre du porche et dans la portion du secteur ST-14/17concernée par les complexes F29-St50 /
E28-F35. Ils se confondent en périphérie des gros empierrements, dans les zones faiblement
structurées et contre les flancs du porche où les biseautages sont importants. La subdivision entre les
ensembles 7.1 et 7.2 correspond davantage à une dynamique d'occupation qu'à deux niveaux
sédimentaires. Cette impression est corroborée par l'absence de sédimentation entre les complexes
F29-St50 / E28-F35 dans le secteur ST-14/17, entre E3 et E31 dans le secteur LN-15 ou encore entre
E20 et E23 dans le secteur LP-16/17.
L'ensemble 7 a livré deux datations cohérentes avec le matériel. La première provient de
l'empierrement E3 (Dt1) OXA-5265 : 5395±70 BP, 4340-4070 av. J.-C., la seconde du foyer F38
(Dt43) Ly-2771 : 5265±35 BP, 4230-3990 av. J.-C. Une troisième datation issue de la structure St50
fourni un résultat aberrant et doit être rejetée (Dt44 - Ly-2759 : 4320±30 BP, 3010-2890 av. J.-C).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 33 -
Figure 19 : ensemble 5
Figure 20 : ensemble 6
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 34 -
Figure 21 : ensemble 7.1
Figure 22 : ensemble 7.2
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 35 -
Figure 23 : ensemble 7, Saint-Uze, éléments typologiques (dessin P.-Y. Nicod et I. André).
Figure 24 : plan de répartition des principaux remontages céramiques de l'ensemble 7 (interface 7.1/7.2).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 36 -
Figure 25 : datation des ensembles stratigraphiques de la séquence supérieure, calibration suivant la courbe
atmosphérique intcal04.14c (Reimer et al 2004). Seules les datations jugées fiables sont représentées.
Dates rejetées : Ens. 2.1 (Bronze moyen) - Dt39 / Ly-2768 : 3005±30 BP, 1370-1130 av. J.-C. Ens. 2.21 (Bronze
ancien) - Dt23 / GrA-21027 (Ly-1847) : 3150±40 BP, 1495-1395 av. J.-C. Ens.7 (Chasséen ancien) - Dt44 / Ly-
2759 : 4320±30 BP, 3010-2890 av. J.-C. (Illustration J.-F. Buard d'après le programme OxCal 4,
http://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCalPlot.html).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 37 -
Phases d’occupation Eléments clefs
Séquence supérieure : Fouille extensive du porche, niveaux du Néolithique à l'époque romaine.
Ens. 1.1 : époque romaine Niveau structuré de faible importance, quelques foyers (F43, F47),
concentration de restes au contact de St31 (secteur ST-14/17). Matériel
cohérent et varié (verre, fer, sigillée du IIIème
siècle). Non daté.
Ens. 1.2 : 1er
Âge du Fer Traces de fréquentation du Hallstatt D, peu de matériel, quelques foyers (F17,
F41). Non daté.
Ens. 1.3 : Bronze final IIb-IIIa Niveau peu structuré, Séries de fréquentations réparties sur l'ensemble des
phases IIb et IIIa du Bronze final, pas de stratification interne ni d'organisation
spatiale évidente. Restes humains épars, céramique relativement abondante,
fragments de tôle et bouton en bronze. Daté 1000- 850 av. J.-C. (E27 - Dt9).
Ens. 2.1 : Bronze moyen Niveau peu structuré, avec zone foyère à l'ouest du porche (F11) et un gros
empierrement anthropique à l'est (E10, zone de rejet). Céramique relativement
abondante, poignard et anneaux en bronze. Daté 1500-1300 av. J.C. (Dt39,
date trop récente, nouvelle datation en cours).
Ens. 2.2 : Bronze ancien Foyers nombreux (F13, F15, F30, F40, F44 et F45), très peu de matériel. Daté
2000-1700 av. J.C. (Dt2, Dt15, Dt38).
Ens. 3.1 Néolithique final sup. Niveau à fumiers de bergerie au centre du porche, structure de combustion
complexe (F12-F31-F42). Peu de matériel. Daté 2850-3100 av. J.C. (Dt17).
Ens. 3.2-3.3 : Néolithique final inf. Zone à fumiers de bergerie localisés à l'est du porche (F25), zone foyère (F14,
F16, F32) et fosses foyères (St10, St47). Peu de matériel, zone de travail du
silex à l'ouest du porche (ens.3.2). ens. 3.2 daté 3350-3100 (Dt25), ens. 3.3
daté 3500-3350 av. J.C. (Dt26, Dt42).
Ens. 4 : Néolithique Moyen Bourguignon
Niveau peu structuré, matériel relativement abondant, galets assez nombreux.
Daté 3800-3650 av. J.C. (Dt20).
Ens. 5 : Chasséen moyen indifférencié
Niveau pierreux à foyers (E16, F19, F24), pauvre en matériel (fragmentation
importante), galets assez nombreux. Daté 4000-3800 av. J.C. (Dt40).
Ens. 6 et 7: Chasséen ancien / Saint-Uze
Niveau complexe et stratifié. Ens.6 : phase terminale de l'occupation à
céramiques de style Saint-Uze. En cours de ré-évaluation. Foyers et nappe
charbonneuse (F3-F34). Matériel en connexion avec l'ensemble 7. Ens.7 :
Empierrements denses à foyers au centre du porche (E3, E18, E20, E23, E31,
F27, St6), concentration de matériel base E3. Zones foyères périphériques,
F29-St50 / F35 à l'ouest et F37-F38 à l'est avec zone de piétinement. Matériel
fragmenté, quelques remontages de céramiques de style Saint-Uze, riche en
galets, pauvre en silex. Daté 4300-4000 av. J.C. (Ens.7, Dt1, Dt43).
Ens. 8 : Atlantique ancien Substrat séquence supérieure, dépôt carbonaté jaunâtre stérile. Sommet en
cuvette. Fortement raviné (St22, St25, St34, St43, St44, St45, St48, St49). Non
daté.
Dt : datation C14, E : empierrement, F : foyer, St : structure
Tableau 3 : éléments clef des séquences supérieure et intermédiaire (ens.8).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 38 -
Fig
ure 2
6 : la
stratig
raphie d
e référence A
97.S
6, in
terpréta
tion 2
006 (L
P-1
5/ L
P-1
6, d
essin J.-F
. Buard
).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 39 -
5 - Présentation synthétique des ensembles stratigraphiques de la séquence inférieure
Ens.9 : niveaux d'occupation du mésolithique. Ces niveaux sont composés de cailloutis et graviers
cryoclastiques lessivés, souvent concrétionnés dans lesquels on distingue deux ensembles. Le plus
récent se limite au secteur IL-10/12 (ens.9.1). Mal conservée et très pauvre en matériel, il a livré
quelques lambeaux de foyers (F1, F2 et F39). Le suivant se limite au secteur NM-12/13 (ens.9.2). Cet
ensemble est défini par un horizon de matériel situé à la base du cailloutis lessivé et par une masse de
limons sableux gris cendreux limitée à la frange sud du secteur. Une datation a été effectuée sur un os
provenant de la masse grise cendreuse, (Dt4) : GrA-20642 (Ly-1841) : 10010±70 BP), 9750-9370 av.
J.-C. Cette datation nous permet d'attribuer la base de l'ensemble 9 au Préboréal (probablement
Mésolithique ancien).
Figure 27 : ensemble 9
Ens.10 à 12 : niveaux stratifiés d'occupation du magdalénien supérieur dans lesquels on distingue trois
ensembles. Au sommet, l'ensemble 10 est défini par d'importantes accumulations de résidus de
combustions noirâtres (ens.10.1-St14 et ens.10.2-St23).
Ces éléments reposent soit sur un cailloutage dense (E34-35, ens.11.1), soit sur des limons sableux
brun jaunâtre à taches grisâtres, riches en cailloutis et graviers (ens.11.2). On observe dans l'ensemble
11 de nombreuses infiltrations des sédiments noirâtres charbonneux de l'ensemble 10. La base des
ensembles 10-12 est formée par un niveau de sable grossier jaunâtre (ens.12).
Les datations effectuées aux sommets et à la base des ensembles 10-12 sont homogènes. Elles
permettent de situer cette phase d'occupation au Bölling, vers 12650-12150 av. J.-C. (ens.10 : Dt5 et
Dt10, ens.12 : Dt27. Dt5 : GrA-20650 : 12350±70 BP, 12540-12160 av. J.-C. Dt10 : GrA-21023 :
12340±60 BP, 12490-12150 av. J.-C. Dt27 : GrA-21028 : 12390±60 BP, 12640 -12230 av. J.-C.).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 40 -
Figure 28 : ensembles 10-12
Figure 29 : la structure de combustion St46 (Ens.13, dessin R. Rocca, plan J.-F. Buard).
Ens.13 : niveau d'occupation du Magdalénien supérieure. Le sommet de l'ensemble 13 est légèrement
érodé (ens.13.0). Le corps de ce niveau est très bien conservé, organisé et riche en matériel. Il est
défini par un structure de combustion (St46, ens.13.2) contenant des milliers de fragments d'os
concassés et brûlés associée à une zone de débitage du silex et par un cailloutage périphérique pris
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 41 -
dans une matrice limono-sableuse jaunâtre (ens.13.1). Les études menées sur la technologie du
matériel lithique (G. Bereiziat) et sur la faune (J.-C. Castel) témoignent toutes deux en faveur d’une
grande homogénéité entre les ensembles 10-12 et 13.
Phases d’occupation Eléments clefs
Séquence inférieure : Fouille limitée à l'avant du porche, sondage prospectif NM-12/13 (4.m2).
Ens. 9 : Mésolithique moyen / ancien
Niveaux très altérés de faible importance, quelques lambeaux de foyers (F1,
F2, F39). Matériel très rare. Daté 9750-9350 av. J.-C.. (Dt4).
Ens. 10 à 12 : Magdalénien supérieur
Niveaux complexes et stratifiés, altéré au sommet (horizon St14) mieux
conservé ensuite (horizon St23) bien que partiellement concrétionné. Daté
12650-12150 av. J.-C. (Ens.10 : Dt5, Dt10, Ens.12 : Dt27).
Ens. 13 : Magdalénien supérieur
Surface d'érosion au sommet, si non niveau très bien conservé et en place.
Occupation riche en matériel (faune et silex), organisée autour de la structure
de combustion St46 avec taille du silex. Dans St46 des dizaines milliers de
fragments d'os concassés et brûlés. Datation en cours.
différences sédimentaires mais homogénéité des restes anthropiques entre les ensembles 10 à 13
Dt : datation C14, E : empierrement, F : foyer, St : structure
Tableau 4 : séquence inférieure, éléments clef; niveaux mésolithiques, épipaléolithiques et paléolithiques
supérieurs.
Figure 30 : datation des ensembles de la séquence inférieure. Calibration suivant la courbe atmosphérique
intcal04.14c, Reimer et al 2004 (illustration J.-F. Buard d'après le programme OxCal 4,
http://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCalPlot.html).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 42 -
Figure 31 : la stratigraphie de référence pour la séquence inférieure A03.S13
(Dessin I. Andre).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 43 -
CHAPITRE III
Etude technologique des céramiques de l'âge du Bronze
Jean-François Buard
1 - Bronze final IIb-IIIa (ensemble 1.3)
Le niveau Bronze final IIb-IIIa correspond au limon gris-brun à brun de l'ensemble 1.3. Il est préservé
sur l'ensemble de la fouille. Ce niveau est peu structuré. Il a cependant livré deux structures, St27 et
St33, situées dans le secteur LP-16/17. Il s'agit dans les deux cas de cuvettes pierreuses à remplissage
noirâtre charbonneux à pierres et cailloutis rubéfiés épars, larges d'environ un mètre et profondes d'une
petite vingtaine de centimètres. Au contact de St33, on observe une concentration de boulettes d'argile
rubéfié. Toujours dans le secteur LP-16/17, on notera la présence à la base de l'ensemble 1.3 d'un petit
empierrement anthropique (E27). Cet empierrement a fourni une datation (E27 - Dt9) : GrA-20648
(Ly-1843) : 2800 ±50 BP, 1020-860 av. J.-C. Le matériel associé à ces structures est datable dans
l'ensemble du Bronze final IIb-IIIa. Cependant, dans le secteur LP-16/17, une partie de la jarre c016,
datable du HaC (ens.1.2) interfère avec le matériel du Bronze final. La présence d'éléments du 1er Âge
du Fer dans l'ensemble 1.3 témoigne d'une faible stratification, voire d'un remaniement des dépôts à la
transition 1.2/1.3. La majorité du matériel de l'ensemble 1.3 est cependant attribuable au Bronze final
IIb-IIIa. L'absence dans l'ensemble 1.3 de stratification, d'horizon typologique clair et d'organisation
dans la répartition du matériel indiquent un brassage des vestiges. On se trouve en présence d'une série
de fréquentations, d'occupations de faible importance mais abrasives, réparties sur l'ensemble des
phases IIb et IIIa du Bronze final.
Sur les 884 tessons de l'ensemble 1.3, 558 ont pu faire l'objet d'une analyse technique macroscopique.
Cette analyse prend en compte le mode de cuisson, le traitement de surface et le dégraissant. Les
modes de cuisson observés sont les suivants: phase réductrice en montée et en descente de température
(RR), phase réductrice en montée et oxydante en descente (RO), et enfin ce dernier mode de cuisson
avec une phase réductrice terminale (ROR). Les traitements de surface retenus sont: soigné ou
grossier. Les dégraissants se subdivisent en quatre types: fin (quasiment invisible), assez fin (rare, plus
petit que 1 mm), assez grossier (abondant, de 1 à 2 mm), grossier (abondant, éléments plus gros que 2
mm). Le croisement de ces observations présente une structure cohérente (Figure 32), une nette
opposition entre la céramique fine (surface soignée, dégraissant fin ou assez fin, tous modes de
cuisson) et la céramique grossière (surface grossière, dégraissant assez grossier ou grossier, cuisson
RO quasi exclusive). Un lot de tessons à dégraissant moyen (assez grossier à assez fin) à surface
soignée et cuisson RO signale des céramiques intermédiaires.
Dans la masse de la céramique de l'ensemble 1.3, 44 récipients ont été identifiés: bords divers 11,
fragments cannelés 2, fragments carénés 2, coupes fines 11, coupes grossières 2, pots 6, collages et
appariements sans forme ni décor 6. La céramique fine, de teinte sombre (noir ou brun-noir) est
dominante. Elle consiste en formes basses simples, hémisphériques ou tronconiques, à lèvre arrondie
ou biseautée (Figure 33), et de coupes à cannelures internes à lèvre facettée (Figure 34). On notera,
dans secteur PQ-23/24, la présence d'une coupe à pied (c040). Ce type de pièce attribuable au Bronze
final IIb. La céramique grossière, brun à brun-orangé (mode de cuisson RO) se rapporte à des formes
hautes à profil sinueux dont la jonction panse-col est décorée à l'ongle ou à l'outil, et à de grands pots à
profil indéterminé (Figure 35). On remarquera dans nos remontages l'absence de grand récipient de
stockage et de forme haute segmentée.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 44 -
Figure 32 : analyse technique de la céramique de l'ensemble 1.3, croisement du traitement de surface et du
mode de cuisson avec la taille du dégraissant. A gauche, représentations des fréquences marginales, la taille des
rectangles est proportionnelle aux fréquences en ligne (base du rectangle) et en colonne (hauteur du rectangle);
à droite tableau des effectifs (nombre de tessons). Nette opposition entre la céramique grossière (surface
grossière, dégraissant assez grossier ou grossier, cuisson RO) et la céramique fine (surface soignée, dégraissant
fin ou assez fin, cuisson variable, illustration J.-F. Buard).
Ensemble .31 : description des céramiques
Figure 33
c023 : coupe à lèvre biseautée. Surface altérée, pâte assez grossière, contenant des grains de dégraissant assez
dense, de taille variable (entre 1 et 3 mm), couleur de surface interne gris sombre noirâtre, et rouge brique à
l'extérieur (surface altérée). Mode de cuisson RO (dessin I. André).
c031 : coupe à lèvre plate. Surface soignée, pâte fine, contenant épars, quelques grains millimétriques, couleur de
surface flammée brun clair à noirâtre, mode de cuisson RO (dessin I. André).
c034 : coupe à lèvre arrondie. Surface soignée, pâte assez fine, couleur de surface brun à gris sombre. Mode de
cuisson RR (dessin I. André).
c038 : coupe à lèvre plate. Surface soignée, pâte assez fine, couleur de surface grises sombre. Mode de cuisson
RR. Diamètre estimé à 14 cm (dessin I. André).
c041 : coupe à lèvre légèrement biseautée. Surface soignée, pâte assez grossière, contenant des grains de
dégraissant épars, millimétriques et très fins (quartz, micas…), couleur de surface externe brun-orangé; interne
brun à gris (dégradé). Mode de cuisson RO. Diamètre estimé à 15 cm (dessin I. André).
c046 : coupe à lèvre biseautée. Surface altérée, pâte très fine, un peu sableuse-savonneuse, friable, contenant en
surface des fines paillettes de mica. Diamètre d'environ 20 cm (dessin I. André).
c049 : coupe à lèvre plate. Surface soignée, pâte fine à grains fins, couleur de surface gris sombre. Mode de
cuisson ROR (dessin I. André).
c050 : coupe à lèvre biseautée. Surface soignée, pâte assez fine, couleur de surface gris sombre. Cuisson RR.
Diamètre de 15 cm (dessin I. André).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 45 -
c123 : coupe à lèvre débordant int. Assez épaisse (0,7 cm). Surface soignée, pâte assez fine, couleur noir, cuisson
RR (dessin C. Von Tobel).
c155 : bord à lèvre plate. Pâte fine, surface soignée, couleur noir, mode de cuisson ROR (dessin I. André).
Figure 34
c015 : coupe à cannelures internes. Surface soignée, pâte assez fine. Surface de couleur noir. Cannelures fines
horizontales en bandes répétées face interne. Mode de cuisson ROR. Typique BF IIIa (dessin I. André).
c018 : coupe à cannelures internes. Décor de cannelures larges sur la face interne. Surface soignée (lustrée), pâte
fine, couleur noirâtre, cuisson ROR. (dessin I. André).
c040 : pied de coupe. Assez rare, BF IIb. Surface soignée, pâte fine, couleur de surface noirâtre, cuisson ROR
(dessin I. André).
c044 : plat ou grande coupe à lèvre facettée, BF IIb-IIIa. Cannelures larges internes sous le bord. Surface soignée
(lustrée), pâte assez fine, couleur de surface noirâtre, cuisson ROR, Diamètre 34 cm. (dessin I. André).
c045 : plat ou grande coupe à lèvre facettée. Surface soignée, pâte fine, couleur de surface noirâtre. Cuisson en
mode ROR (dessin I. André).
c058 : plat ou grande coupe à lèvre légèrement facettée. Surface soignée, pâte fine, couleur de surface noirâtre,
mode de cuisson ROR (dessin I. André).
Figure 35
c024 : pot grossier. Surface altérée, pâte assez fine. Bord légèrement oblique, couleur de surface orangé, cuisson
RO (dessin I. André).
c026 : pot à impressions fines. Surface soignée, pâte assez fine contenant des grains de dégraissant épars, avec
quelques éléments plus grossiers atteignant 2-3 mm. Couleur de surface brun-noir, mode de cuisson RR (recuit?,
dessin I. André).
c029 : pot décoré d'excisions. Surface soignée, pâte assez grossière, couleur de surface brun-orangé, cuisson RO
(dessin I. André).
c032 : pot à lèvre plate munie d'un bourrelet interne et externe. Surface grossière, pâte grossière, couleur de
surface brun clair orangé, taches grisâtres sur la surface interne, cuisson RO (dessin I. André).
c047 : pot décoré de poinçonnages tangentiels disposés en ligne horizontale. Surface grossière, pâte assez fine,
contient des grains épars de dégraissant millimétriques et fins, couleur de surface brun-orangé. mode de cuisson
RO. Hors contexte. (dessin I. André).
c048 : bord (jarre ?). Surface grossière, pâte grossière contenant pas mal de grains millimétriques à 2-3 mm,
couleur de surface brun clair à brun-gris (sur face interne), cuisson RO. (dessin I. André).
c104 : bord de céramique à lèvre plate. Surface grossière, pâte grossière, couleur brun-orange, cuisson RO
(dessin I. André).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 46 -
Figure 33 : céramiques fines, coupes non décorées de l'ensemble 1.3.
Figure 34 : céramiques fines, coupes à cannelures internes et à lèvre facettée et coupe à pied de l'ensemble 1.3.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 47 -
Figure 35 : céramiques grossières de l'ensemble 1.3.
2 - Bronze moyen (ensemble 2.1)
L'occupation Bronze moyen correspond au limon brun de l'ensemble 2.1 que l'on suit sur l'ensemble
du site. L'ensemble 2.1 est peu structuré. Dans le secteur ST-14/17, à l'ouest du porche, se trouve un
petit foyer à plat assez bien conservé (F11, Figure 37). Le foyer F11 a fourni une date (Dt39) : Ly-
2768 : 3005±30 BP, 1370-1130 av. J.-C., date trop récente compte tenu de la position stratigraphique
de F11 (base ens.2.1) et du matériel associé. A l'opposé, contre la paroi nord et est du secteur IK-
16/17, un grand empierrement anthropique couvre les deux tiers du secteur (E10, Figure 37). Cet
empierrement est constitué de pierres de moyen et gros module (7-25 cm). Il contient de nombreuses
pierres rubéfiées et un peu de matériel. Ce matériel consiste en quelques céramiques, dont plusieurs
fragments de jarre à panse couverte de traînées de barbotine (c131), en reste osseux, une trentaine d'os
et en galets. E10 est interprété comme une zone de rejet. On notera enfin, dans le secteur LO-20/21, la
présence d'un empierrement lâche d'environ 1 m de diamètre, à pierres de moyen module (5-15 cm),
parfois rubéfiées (E29). E29 constitue une petite zone de rejet.
Sur les 1091 tessons de l'ensemble 2.1, 743 ont pu faire l'objet d'une analyse technique macroscopique.
L'analyse prend en compte les mêmes critères que celle de la céramique de l'ensemble 1.3 (voir p. 43,
mode de cuisson, traitement de surface et dégraissant). Le croisement de ces observations présente la
même structure que dans le cas de l'ensemble 1.3, avec une nette opposition entre la céramique fine
(surface soignée, dégraissant fin ou assez fin, tous modes de cuisson) et la céramique grossière
(surface grossière, dégraissant assez grossier ou grossier, cuisson RO quasi exclusive, Figure 36). Ici
également, un lot de tessons à dégraissant moyen (assez grossier à assez fin) à surface soignée et
cuisson RO signale des céramiques intermédiaires.
Dans la masse de la céramique de l'ensemble 2.1, 64 récipients ou groupes de tessons similaires ont été
identifiés : bords divers 3, fonds 3, fragment d'anse 1, céramiques cannelées 6, céramiques incisées 13,
dont 6 groupes de tessons pouvant appartenir à de nombreux récipients, coupes 7, tasses 2, jarres et
pots grossiers 7, collages et groupes de tessons sans forme ni décors 22.
La céramique fine non décorée consiste en formes basses simples non décorées de couleur variable, et
de nombreux fragments de céramiques fines noires lustrées dont un bol à paroi verticale (c087, Figure
43). La céramique décorée est très largement dominée par des céramiques de taille intermédiaire
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 48 -
ornées d'incisions couvrantes (Figure 44, c089 a et b, c108, c115, c116 et c118). S'y ajoutent un bol à
incisions horizontales larges et profondes (c078) organisées en bandes horizontales, un récipient de
petite taille à cannelures fines horizontales (c080) et un fragment à cannelures larges de mauvaise
facture (c121).
La céramique grossière comprend de nombreux fragments de jarres à panse couverte de traînées
verticales de barbotine, un lot de céramique de couleur brun-orange à surface grossière dont une coupe
à lèvre biseautée (c091), une jarre à languette médiane et cordon (c093), un pot grossier à profil en S
marqué (c169). On signalera enfin la présence d'un fragment de jarre à cordon digité et pincé de
couleur noir (c119) et d'une petite jarre à cordon décoré d'impressions circulaires dont la panse porte
des traces de vannerie (c074, Figure 45).
Les éléments dominants de la céramique de l'ensemble 2.1 sont la céramique fine noire lustrée, la
céramique intermédiaire décorée d'incisions couvrantes, la céramique grossière à traînées de barbotine
et la céramique grossière de couleur brun-orange. La répartition en plan de la densité de ces éléments
fait apparaître des concentrations spatiales différentielles suivant le type de céramique (Figure 38 à
Figure 42). On observe une répartition assez aléatoire de la céramique intermédiaire à incisions
couvrantes. La céramique grossière à traînées de barbotine présente une forte concentration dans la
zone NP-14/15. La céramique grossière orange se répartit entre la zone NP-14/15 et la zone ST-15/16.
La céramique fine noire admet également une large répartition avec toutefois une densité plus faible
dans la zone riche en céramique grossière à traînées de barbotine.
Figure 36 : analyse technique de la céramique de l'ensemble 2.1, croisement du traitement de surface et du
mode de cuisson avec la taille du dégraissant. A gauche, représentation des fréquences marginales, la taille des
rectangles est proportionnelle aux fréquences en ligne (base des rectangles) et en colonne (hauteur des
rectangles); à droite tableau des effectifs (nombre de tessons). Nette opposition entre la céramique grossière
(surface grossière, dégraissant assez grossier ou grossier, cuisson RO) et la céramique fine (surface soignée,
dégraissant fin ou assez fin, cuisson variable, illustration J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 49 -
Figure 37 : position des structures anthropiques de l'ensemble 2.1 (plan J.-F. Buard).
Figure 38 : éléments dominants de la céramique de l'ensemble 2.1, répartition en points de densité par m2. En
bleu foncé, céramique fine de couleur noir (106 tessons), en vert clair, incisions couvrantes (56 tessons), en
orange, céramique grossière de couleur brun-orange (61 tessons), et en rouge céramique grossière à traînées de
barbotine (79 tessons, plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 50 -
Figure 39 : répartition par m2 de la céramique fine noire (106 tessons, plan J.-F. Buard).
Figure 40 : répartition par m2 des incisions couvrantes (56 tessons, plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 51 -
Figure 41 : répartition par m2 de la céramique à traînées de barbotine (79 tessons, plan J.-F. Buard).
Figure 42 : répartition par m2 de la céramique grossière brun-orange (61 tessons, plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 52 -
Ensemble 2.1 : description des céramiques
Figure 43
c073 : coupe à lèvre biseautée. Surface soignée, pâte assez fine, couleur beige-orange, cuisson RO (dessin I.
André).
c076 : coupe à lèvre biseautée. Surface soignée, pâte fine et peu épaisse (moy. 0,4cm), couleur orange, cuisson
RO. Partiellement recuit (éclatement de chaleur, dessin nc).
c087 : bol ou tasse à paroi verticale. Surface soignée, pâte fine, paroi très mince (0,3cm), couleur noir, cuisson
RR (dessin I. André).
c120 : coupe grossière à lèvre plate. Surface grossière, pâte assez grossière, couleur noir, cuisson ROR (dessin C.
Von Tobel).
c122 : coupe à lèvre segmentée. Surface soignée, pâte assez fine, couleur noir, cuisson RR. (dessin C. Von
Tobel).
c125 : coupe à lèvre plate, paroi assez épaisse (moy 0,8cm, diam ~42cm). Surface soigné, pâte grossière.
Couleur orange, cuisson RO (dessin C. Von Tobel).
c126 : coupe à lèvre biseautée. Surface soignée, pâte assez grossière. Couleur brun-noir, cuisson ROR (dessin C.
Von Tobel).
c130 : tasse. Surface soignée, pâte assez fine, couleur brun-noir à traces orangées, cuisson RO (dessin J.-F.
Buard).
Figure 44
c078 : céramique à cannelures fines/incisions larges horizontales en bandes. Surface soignée, pâte fine, couleur
orange, cuisson ROR. L'un des tessons est recuit (dessin J.-F. Buard).
c080 : cannelures fines horizontales en bandes. Surface soignée, pâte assez fine, couleur noir, cuisson ROR
(dessin E. Jaffrot).
c089.a : incisions couvrantes. Surface altérée, pâte fine, couleur brun, cuisson RO. (dessin E. Jaffrot).
c089.b : divers fragments d'incisions couvrantes (25 tessons). Surface soignée, pâte assez fine, couleur brun à
brun-gris, cuisson RO (dessin nc).
c108 : incisions couvrantes. Surface grossière, pâte assez grossière, couleur brun-brun clair, cuisson RO (dessin
E. Jaffrot).
c109 : incisions horizontales en bandes. Surface soignée, pâte assez fine, couleur brun-orange, cuisson RO
(dessin E. Jaffrot).
c115 : incisions couvrantes horizontales. Surface soignée, pâte assez grossière, couleur brun-orange, cuisson RO.
Hors contexte (dessin E. Jaffrot).
c116 : incisions couvrantes. Surface grossière, pâte assez grossière, couleur brun, cuisson RO (dessin E. Jaffrot).
c118 : incisions couvrantes. Surface grossière, pâte assez grossière, couleur brun-orange, cuisson RO (dessin nc).
c121 : cannelures larges. Surface grossière, pâte assez fine, couleur brun-orange, cuisson RO. (dessin C. Von
Tobel).
Figure 45
c074.a et b : céramique à cordon décoré de petites impressions circulaires (gros poinçonnages). Traces d'un
moule en vannerie sur la face externe (c074b). Surface grossière, pâte assez fine, couleur brun-noir, cuisson RO
(dessin E. Jaffrot).
c084 : incisions couvrantes surmontées d'un cordon travaillé à l'outil. Surface soignée, pâte assez grossière,
couleur orange, cuisson RO (dessin E. Jaffrot).
c091 : coupe grossière à lèvre biseautée. Surface grossière, pâte grossière, couleur orange sale, cuisson RO
(dessin J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 53 -
c093 : jarre à languette médiane. Surface grossière, pâte grossière, couleur orange sale, cuisson RO. Un fond et
un bord parmi l'ensemble (dessin J.-F. Buard).
c117 : bord incisé. Surface grossière, pâte assez grossière, couleur brun clair, cuisson RO (dessin C. Von Tobel).
c119 : jarre à cordon digité et pincé. Surface grossière, pâte assez grossière, couleur noir, cuisson ROR (dessin E.
Jaffrot).
c169 : Pot grossier à profil fortement sinueux. Surface grossière, pâte assez grossière, couleur orange, cuisson
RO (dessin J.-F. Buard).
Figure 43 : céramiques fines non décorées de l'ensemble 2.1.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 54 -
Figure 44 : céramiques cannelées et incisées de l'ensemble 2.1.
Figure 45 : céramiques grossières de l'ensemble 2.1.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 55 -
CHAPITRE IV
Etude technologique des céramiques du Néolithique moyen
Pierre-Jérôme Rey
Le corpus considéré comprend 33 unités de collage qui se répartissent inégalement dans la
stratigraphie. 16 sont attribuées à l’ensemble 4 ; 4 à l’ensemble 5, 4 à l’ensemble 6 et 9 unités de
collage se rattachent à l’ensemble 7.
La fragmentation ne permet pas une analyse poussée des techniques de façonnage. Dans l’ensemble 4
le montage aux colombins semble dominer pour les encolures. Les colombins présentent des plans de
joint obliques. Ils sont disposés sur la face interne du précédent (C006, C011, C177, C196, C197), sur
la face externe du précédent (C009, C163, C164), ou de manière alternée en S (C008). Le montage de
la panse et du fond n'est observable que sur C8. Les colombins sont disposés en S de la même manière
que pour le col de ce récipient. Le fond paraît modelé. Les modes de façonnage des ensembles 5 à 7
n’ont pas été examinés.
Seuls les inclusions et les contrastes colorés ont été décrits visuellement dans les 4 ensembles du
Néolithique moyen. Dans le contexte de cuissons en aire ouverte, les contrastes colorés entre le cœur,
les marges internes et externes et les surfaces des tessons peuvent en effet être utilisés pour décrire la
manière dont les potiers gèrent la durée de cuisson (Martineau et Pétrequin 2000). Ces stigmates ont
été décrits à l'aide de la grille de C. Hénocq (1984, Figure 46).
1 - Ensemble 4
Les inclusions principales constituées de silicates dominent très largement (13 cas). Leur densité est
généralement forte. Leur taille moyenne est comprise entre 0,5 et 1,5 mm, quelques cas vont jusqu’à 2
voire 2,5 mm. Il s’agit généralement de fragments anguleux d'une roche micacée (granitique ?) dans 7
cas. Cinq autres individus sont constitués d'éléments silicatés sans micas apparents, fréquemment
émoussés. Un individu (C010) s’éloigne de la norme : il est constitué de sable roulé inférieur à 0,5
mm. Dans 4 cas on note la présence secondaire de fragments parfois très gros (jusqu’à 10 mm) d’une
même variété de calcaire gréseux, parfois accompagnés d’empreintes de tiges organiques et de nodules
ferrugineux. Dans 4 autres cas on observe des inclusions secondaires de fragments de calcaire ou de
carbonates indéterminés.
Trois unités de collage présentent des inclusions principales carbonatées : fragments de calcaires
(C011) entre 0,5 et 1 mm et carbonates indéterminés inférieurs à 0,5 mm (C163 et C175).Les cuissons
ont généralement été menées jusqu’à l’oxydation partielle des récipients (Ib, Ic, Id, 13 cas). On note un
seul cas de réduction complète (Ia, C011) associé à la présence d’inclusions principales de calcaire.
Dans ce cas les inclusions ont subi une fusion partielle qui laisse de petites vacuoles jusqu’au cœur des
tessons. 5 individus montrent un liseré superficiel sombre sur marges internes et externes plus claires
que le cœur (Id). Cette configuration pourrait résulter d’un enfumage internet et externe ou d’un autre
type de traitement de surface.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 56 -
Deux individus à inclusions principales silicatées, associées à des éléments secondaires carbonatés,
sont oxydés à cœur. Dans un cas l’oxydation a été suivie d’un enfumage important (C160 ~). L'autre
individu est totalement oxydé (C010) mais il pourrait s’agir d’un effet de recuit.
C011 présente une altération préférentielle des surfaces internes caractérisée par une dissolution
complète des inclusions et une desquamation de la paroi. Ces stigmates sont vraisemblablement à
mettre au compte de l'utilisation culinaire d'un récipient fragilisé au préalable par une cuisson poussée
ayant entraîne la fusion partielle des inclusions carbonatées.
Enfin C164 et C176 présentent des caractères techniques et typologiques très proches qui permettent
de penser qu'il pourrait s'agir d'un seul récipient dont la jonction entre l'encolure et la panse est
souligné d'un coup d'outil irrégulièrement appuyé.
2 - Ensemble 5
On note 2 cas d’inclusions principales silicatées dont l’un est constitué de sable très fin (inférieur à 0,5
mm) et de rares fragments anguleux plus gros (C179) et l'autre de fragments silicatés anguleux entre
0,5 et 1,5 mm (C14). Les deux autres individus présentent des inclusions principales de calcaire
anguleux entre 0,5 et 1,5 mm (C166 et anses C198~). Leur densité est variable mais souvent plus
faible que dans l'ensemble 4. La taille des grains varie entre 0,5 et 1,5 mm parfois jusqu'à 2 mm.
On observe une réduction complète sur un individu à inclusions principales silicatées (C014) et trois
cas d’oxydation partielle dont l’une est associée un enfumage ou autre traitement de surface (C179).
3 - Ensembles 6 et 7
Les inclusions principales silicatées sont très majoritaires (11 cas). Leur densité est plus faible que
dans l'ensemble 4. Leur taille moyenne est généralement inférieure à 0,5 mm, dans quelque cas elle
peut atteindre 0,5 à 1 mm. Dans 6 cas on observe l’emploi de sable roulé présentant souvent un poli
brillant, parfois accompagné d'une proportion plus réduite d’éléments anguleux silicatés (3 cas) ou
carbonatés (3 cas). Deux individus présentent des inclusions principales carbonatées : de la calcite
pillée entre 0,5 et 1 mm (C170) et des fragments de carbonates indéterminés entre 0,5 et 2,5 mm
associés à de rares éléments silicatés (C004). Dans les 5 cas d'inclusions silicatées anguleuses, la
petitesse des grains ne permet pas de reconnaitre le type de roche. La présence de mica dans la pâte
n'est pas systématique avec ces fragments silicatés anguleux. Ces micas sont également souvent
présents avec les sables silicatés.
Les cuissons partiellement oxydantes sont très majoritaires (10 cas). Une seule réduction complète
concerne un récipient à inclusions principales silicatées. Un seul individu également à inclusions
principales silicatées est oxydé à cœur (C195). La persistance d’une réduction interne pourrait indiquer
que ce récipient a été cuit à l’envers ou bouché.
4 - Synthèse
La présence d’inclusions secondaires d’un même calcaire gréseux pour 3 individus des ensembles 6 et
7 et pour 5 individus de l’ensemble 4 pourrait indiquer l’utilisation d’une ressource argileuse locale.
Ces calcaires gréseux apparaissent souvent associés à des inclusions principales le plus souvent
silicatées mais également parfois carbonatées.
Les inclusions principales sont très majoritairement constituées de silicates dans tous les ensembles.
Leur origine semble cependant évoluer. Dans les ensembles 6 et 7 il s’agit pour moitié de sable roulé
et pour moitié d’inclusions anguleuses. Dans l’ensemble 4 il ne s’agit que d’inclusions silicatées
anguleuses ou plus rarement émoussées. Les inclusions anguleuses semblent provenir d'une roche
micacée de type granitique.
Dans ce contexte les individus à inclusions principales carbonatées pourraient constituer des
importations. Certains présentent d’autre caractères qui s’éloignent de la norme (taille plus importante
que la moyenne des ensembles 6-7 pour C004 et C170 ; réduction totale et typologie chasséenne pour
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 57 -
C011). Le cas de C163 est plus ambigu : il est façonné dans une argile à particules de calcaire gréseux
qui pourrait évoquer une origine locale, mais la taille moyenne de ses inclusions principales s’éloigne
nettement de la norme de l’ensemble 4.
La taille moyenne des inclusions semble en effet nettement augmenter entre les ensembles 6 et 7
(majoritairement inférieure à 0,5 mm) et les ensembles 4 et 5 (majoritairement entre 0,5 et 1,5 mm).
La densité des inclusions semble s'accroitre dans l'ensemble 4 par rapport aux trois ensembles sous-
jacents.
La cuisson est le plus souvent menée jusqu’à l’oxydation partielle des récipients. Il n’y a guère de
différence entre les ensembles. Les changements de teinte externe que l'on peut percevoir entre les ensemblesdoivent vraisemblablement être reliés à des différences dans l’argile utilisée, dans le
traitement des surfaces ou dans la typologie des structures de cuisson, plus que dans la manière de
mener la fin de cuisson qui varie assez peu.
Enfin les observations techniques s'accordent avec la typologie Saint-Uze de C010. Elles semblent
indiquer que cet élément n’est pas à sa place dans l’ensemble 4 et qu'il se rattache vraisemblablement
aux ensembles 6 et 7.
5 - Comparaison
Au niveau des inclusions principales l’Abbaye s’éloigne nettement des séries du Gardon dominées par
la calcite pillée dans les niveaux Saint-Uze (Coutard 2004), la calcite et les silicates dans c47-46 dont
l'occupation se place vraisemblablement entre 4200 et 4000 av JC, puis par le mélange calcaire et
calcite dans les niveaux NMB 44-40 datés entre 3900 et 3650 av JC (Rey à paraitre). L'emploi
majoritaire d'inclusions d'arènes granitiques concassées se rencontre par contre dans les niveaux
Chasséens et NMB de Chassey (Colas 2005). L'usage d'inclusions silicatées souvent sous forme
sableuse est également une pratique extrêmement majoritaire sur le plateau suisse (Burri 2007).
Cependant le travail à large échelle de Clément Moreau (2010) a montré, pour le NMB entre Yonne et
Saône, que les inclusions reflètent d'abord les disponibilités locales même si quelques particularités et
choix préférentiels locaux sont parfois discernables. A l'Abbaye la disponibilité des différents
matériaux ne constitue pas une contrainte dans un secteur où se rencontrent à la fois des affleurements
calcaires et des moraines wurmiennes. Le choix des silicates pourrait donc constituer soit un trait
culturel, soit l'indication que les céramiques ne sont pas produites sur place mais dans un vallon à
remplissage morainique. Seule la multiplication de ce type d'observation permettra d'en dégager la
signification à l'échelle locale et régionale. L'origine des matériaux et en particulier des sables roulés
brillants mériterait d'être recherchée à l'aide de lames minces et d'échantillonnages sur le terrain.
L'accroissement de la taille et de la densité des inclusions correspond à une tendance suprarégionale au
cours du IVe millénaire (Burri 2007 et Moreau 2010). Entre le Ve et le IVe millénaire les choses sont
plus complexes. Au Gardon les couches 52-48 attribuées au Saint-Uze présentent des inclusions assez
grossières, fréquemment comprises entre 1 et 4 mm (Coutard 2004). L'ensemble 47-46 à la transition
avec le IVe millénaire présente une grande variété de tailles (Rey à paraitre). A Chassey les inclusions
sont assez grossières dans le niveau 10, elles se répartissent pour moitié entre 0,1 et 0,5 mm comme à
l'Abbaye et pour moitié entre 0,1 et 2 mm (Colas 2005) dans les niveaux 9 et 8. Ensuite leur taille
moyenne semble augmenter dans les niveaux 7 et 6.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 58 -
6 - Bibliographie
BURRI (E.), 2007. La céramique du Néolithique moyen ; analyse spatiale et histoire des peuplements. La station
lacustre de Concise, 2. Cahiers d'Archéologie Romande, 109. Lausanne. 310 p.
COUTARD (C.), 2004. Etude expérimentale de la céramique néolithique de style Saint-Uze de la grotte du Gardon
(Ain). Mémoire de Maîtrise sous la direction de F. Giligny. Université de Paris I, Panthéon Sorbonne.
HENOCQ (C.), 1984. Etude de la céramique du groupe de Noyen à travers une production homogène : la céramique
des fosses Fd de Noyen-sur-Seine. Mémoire de Maîtrise de l'Université de Paris I. 123 p. 21 pl.
MARTINEAU (R.), PETREQUIN (P.), 2000. La cuisson des poteries néolithiques de Chalain (Jura), approche
expérimentale et analyse archéologique. In : Pétrequin (P.), Fluzin (P.), Thiriot (J.), Benoit (P.) dir., Arts du feu
et productions artisanales, Actes des XXe Rencontres Internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes. Juan-
les-Pins : Ed. A.P.D.C.A. p. 337-358.
MOREAU (C.), 2010. La céramique du Néolithique moyen II de l'Yonne à la Saône entre 4300 et 3400 avant notre
ère. Thèse de l’Université de Bourgogne, direction Mordant C. et Martineau R.
REY (P.-J.), à paraitre. La céramique néolithique des couches 47 à 38 de la grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey
(Ain) ; analyse typologique et technologique. In Voruz J.-L. et Perrin T. dir. La grotte du Gardon, volume II.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 59 -
UC
en
sty
pe
de
s inclu
sion
sta
ille d
es in
clu
sion
sd
en
sité in
clu
sion
sp
âte
mic
acé
eva
cu
ola
irecu
isson
Re
ma
rqu
eT
yp
olo
gie
C008
4silic
ate
s s
ans m
ica é
moussés
0,5
-1,5
forte
oui
oui
Ibgro
s p
ot N
MB
C177
4silic
ate
s s
ans m
ica e
t rare
s c
arb
onate
s0,5
-2fo
rteoui
Ibgro
s b
ord
sur s
egm
enta
tion
C150 ~
4silic
ate
s s
ans m
ica e
t rare
s c
alc
aire
s g
réseux
0,5
-1,5
forte
oui
oui
Ic
C006
4silic
ate
s s
ans m
ica é
moussés e
t rare
s c
arb
onate
s m
illimétriq
ues
0,5
-2fo
rteoui
oui
Ibassie
tte N
MB
C011
4calc
aire
s0,5
-1fo
rteIa
fusio
n in
tern
e d
es in
clu
sio
ns
marm
ite à
pris
e b
i ou m
ultifo
rée
C162
4silic
ate
s s
ans m
ica é
moussé e
t calc
aire
3-1
0 m
m0,5
-1fo
rteIb
fond p
lat
C160 ~
4silic
ate
s à
mic
a0,5
-2,5
forte
oui
IIc
C163
4carb
onate
s e
t rare
s g
ros fg
t de c
alc
aire
s g
réseux
< 0
,5fo
rteId
bord
de c
oupe p
etit fg
t
C161 ~
4silic
ate
s à
mic
a0,5
-1fo
rteoui
Ib
C009
4silic
ate
s à
mic
a e
t rare
s c
alc
aire
s g
réseux d
e 1
à 1
0 m
m0,5
-1,5
forte
oui
Ibfo
rme s
egm
enté
e
C175
4carb
onate
s (c
alc
ite ?
) fgt d
e tig
es o
rganiq
ues
< 0
,5fo
rteId
carè
ne à
bourre
let
C176
4silic
ate
s à
mic
a0,3
-1,5
moyenne
oui
Idpro
che d
e C
164
épaule
à s
illon e
xte
rne
C164
4silic
ate
s à
mic
a0,3
-1,5
moyenne
oui
Idpro
che d
e C
176
épaule
à s
illon e
xte
rne
C197
4silic
ate
s à
mic
a à
calc
aire
gré
seux d
e 1
à 5
mm
, qq n
od fe
rrugin
eux e
t fgt d
e tig
es o
rganiq
ues
0,5
-1fo
rteoui
Id
C196
4silic
ate
s à
mic
a à
calc
aire
gré
seux d
e 1
à 5
mm
, qq n
od fe
rrugin
eux e
t fgt d
e tig
es o
rganiq
ues
0,5
-1fo
rteoui
Id
C010
4sable
silic
até
et q
uelq
ues g
rain
s c
arb
onaté
s<
0,5
forte
IIasain
t-uze
C179
5sable
silic
até
et q
uelq
ues g
rain
s s
ilicaté
s a
ngule
ux <
2 m
m<
2 m
mfo
rteoui
Id
C014
5silic
ate
s a
ngule
ux à
mic
a0,5
-1,5
moyenne
oui
Ia
C166
5calc
ite b
lanche
0,5
-2 m
mfa
ible
Ib
C198~
5calc
ite b
lanche
0,5
-1,5
moyenne
Ib/Ic
anses e
n ru
ban
C178
6sable
silic
até
brilla
nt
< 0
,5fo
rteId
anse e
n ru
ban e
t mam
elo
n s
urle
bord
C165
6sable
silic
até
et s
ilicate
s a
ngule
ux a
vec q
uelq
ues c
alc
aire
s g
réseux <
2 m
m<
0,7
forte
oui
Ib
C195
6silic
ate
s<
0,5
moyenne
oui
IIb in
vers
e
C013
6sable
silic
até
brilla
nt e
t rare
s c
alc
aire
s g
réseux <
2 m
m<
0,5
forte
oui
Ibpro
che d
e C
167
marm
ite à
bouto
n
C001
7silic
ate
s<
0,3
faib
leoui
Ibva
se s
inueux à
mam
elo
n s
ur le
bord
C002
7silic
ate
s<
0,5
moyenne
oui
Ibpot s
inueux à
pris
e tu
nellifo
rme
C003
7sable
silic
até
et s
ilicate
s a
ngule
ux
< 1
faib
leIb
pot s
inueux à
pris
e tu
nellifo
rme
C005
7silic
ate
s à
mic
a<
0,5
faib
leoui
Idcoupe c
aré
née
C170
7calc
ite<
1,5
forte
Ic
C174
7sable
silic
até
et s
ilicate
s a
ngule
ux
< 0
,5m
oyenne
oui
Ia
C004
7carb
onate
s e
t rare
s s
ilicate
s0,5
-2,5
forte
Ibva
se o
void
e à
mam
elo
n s
ur le
bord
C167
7sable
silic
até
brilla
nt e
t rare
s c
alc
aire
s g
réseux <
2 m
m<
0,5
moyenne
oui
Ibpro
che d
e C
13
C173
7silic
ate
s a
ngule
ux a
vec q
uelq
ues c
alc
aire
s g
réseux <
2 m
m<
0,5
moyenne
Ib
Ta
blea
u 5
: les céram
iqu
es du
Néo
lithiq
ue m
oyen
– d
on
nées tech
niq
ues
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 60 -
Figure 46 : grille de C. Hénocq (Hénocq 1984)
Figure 47 : céramique de l'ensemble 4 (Néolithique moyen bourguignon. Dessin P.J Rey).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 61 -
Figure 48 : céramiques de l'ensemble 4 (Néolithique moyen bourguignon. Dessin P.J Rey).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 62 -
Figure 49 : céramiques de l'ensemble 5 (dessins col.).
Figure 50 : céramiques de l'ensemble 6 (Saint-Uze, dessins col.).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 63 -
Figure 51 : céramiques de l'ensemble 7 (Saint-Uze, dessins P.-Y. Nicod, I. André).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 65 -
CHAPITRE V
Les silex de la séquence supérieure de la grotte de l’Abbaye
Julia Patouret
Les pièces étudiées ici le sont au titre d’industrie, à savoir l’«ensemble des techniques et des activités
par lesquelles un groupe humain transforme la matière première pour en tirer des objets fabriqués.
Par métonymie, collection des objets résultant de ces activités. Dans cet emploi, le terme exclut
généralement les objets d’art ; dans la pratique, il désigne les outils, les armes, et leurs déchets de
fabrication. […]»1.
Chaque objet renseigne sur les gestes effectués pour l’obtenir (chaîne opératoire), et lorsque les
informations sont suffisamment étoffées (technique, matières, etc.) on peut inférer un schéma
opératoire qui traduit les choix et intentions du ou des tailleur(s) concerné(s). Ainsi, «bien que difficile
à atteindre, ce stade de l’analyse permet de toucher à une information réellement anthropologique de
l’individu ou du groupe étudié, puisque l’on reconstruit l’ensemble de la séquence tant mentale que
motrice, liée à une activité de taille»2.
Tous les éléments de l'assemblage portent donc a priori une valeur informative devant être prise en
compte à chaque étape de l'étude. Les silex recueillis lors de la fouille de la séquence supérieure de la
grotte (ensembles 1 à 7) sont au nombre de 812, dont 693 ont été examinés. L'étude concerne les
aspects typologiques et technologiques de la série. L'approche technologique est présentée de manière
succincte, sans remontages entre les pièces ni descriptif détaillé (types de bulbes, aspects des talons,
etc.). Ces informations ont été enregistrées lors de l'étude et pourront faire l'objet d'un développement
ultérieur. Il est fait mention de caractères macroscopiques concernant les stigmates fonctionnels
présents sur les pièces lorsque ceux-ci sont significatifs. L'objectif de l'article est de donner un aperçu
global et relativement complet de la série.
1 - État de la série
La surface des pièces nous renseigne sur les conditions de conservation, considérant différents facteurs
physiques et anthropiques : état lors de l'abandon, altérations post-dépositionnelles (patines,
mouvements des objets dans le sédiment, brassages anthropiques, etc.) et traitement du mobilier lors
de la fouille puis des phases ultérieures de manipulation. Ces différents filtres induisent des
modifications plus ou moins dommageables aux diverses études réalisées ultérieurement sur les
mobiliers concernés, selon des critères propres à chaque recherche.
Le traitement des silex lors et après la fouille a ici permis de minimiser les endommagements, puisque
chaque pièce a été lavée puis conditionnée définitivement de manière isolée, sans qu'il y ait eu de
chocs majeurs entre différents silex lors par exemple d'un stockage multiple en sac unique, comme
cela est souvent le cas. Les bris résultants de ce type de conditionnement « en vrac » altèrent les pièces
de manière significative, tant pour les études typologiques que tracéologiques.
Il est à remarquer que de nombreux silex présentent une patine blanche post-dépositionnelle sur au
moins une partie de leur surface (arêtes et bords le plus souvent), phénomène qui pourrait être gênant
1 Leroi-Gourhan dir. 1988, p. 512. 2 Perrin 2001, p. 24.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 66 -
quant à une éventuelle analyse tracéologique car il brouille la lecture des traces d’utilisation3. Les
mécanismes de formation des patines sur les surfaces siliceuses sont encore méconnus, mais il
semblerait qu’un milieu humide et acide facilite leur apparition ; ceci serait donc lié entre autres
facteurs à l’«intense ruissellement de l’eau de percolation»4 en milieu calcaire auquel la grotte a été
régulièrement soumise.
Les silex brûlés représentent ici 28 % du total de la série. Le taux d'endommagement des silex par
l'action du feu peut être représentatif des activités relatives aux occupations humaines (mode de
traitement et entretien de l'outillage principalement) lorsque le contexte stratigraphique est
suffisamment bien connu et ce type d'observation systématisé. La proportion des pièces ayant subi une
dégradation thermique est précisée dans la suite de l'étude par unité stratigraphique.
Dans une optique semblable, le taux de fragmentation du mobilier siliceux est noté pour chaque
ensemble. La moyenne générale pour la série est de 46% de silex fragmentés, ce qui semble être un
pourcentage élevé au vu du nombre d'occupations marquées distinguées lors de la fouille, qui est de
sept (ensembles 2.2 à 7). Trois de ces ensembles stratigraphiques sont rattachables à des activités bien
déterminées comme aires de travail et/ou de circulations intenses (ensembles du Bronze ancien au
Néolithique final inférieur), qui auraient pu avoir un impact direct sur l'état des pièces et leur mauvaise
conservation. Ce point sera développé plus loin au cours de l'étude.
2 - Méthodologie
Les silex ont été répertoriés de manière à permettre pour chaque pièce deux niveaux d’analyse :
l'appartenance à une famille au sens technique (type de produit) et la morphologie du fragment (type
de support). Cette classification vise en effet à obtenir une homogénéisation de l’enregistrement sur
l’ensemble de la série, pour pouvoir ensuite comparer les proportions de ces différents types entre les
ensembles stratigraphiques.
Le tri des matières premières a été effectué de manière succincte, en discriminant des catégories
principalement par couleur de silex et texture, les zones corticales donnant des indications
supplémentaires sur la provenance des matières (position primaire ou secondaire des rognons, etc.).
Les variétés de silex régional (environ 40 km autour du site) et local (environ 5 km autour du site)
étant connues5, nous avons pu reconnaître un certain nombre d’entre elles de manière sûre et isoler les
types exogènes.
3 - Définitions
Les catégories de produits
Les catégories de produits permettent de replacer chaque silex dans une chaîne opératoire globale,
sans tenir compte des caractéristiques différentielles des industries selon leur contexte chronologique.
Ces catégories répartissent les objets en fonction de leur place dans la chaîne opératoire au sens large :
les silex issus des étapes techniques et/ou de débitage (qui sont la plupart du temps abandonnés)
diffèrent des produits simples et des objets typologiques (considérés comme un aboutissement des
processus de fabrication). Les restes qui ne sont pas déterminables sont enregistrés comme tels.
Technique (Tech) : pièces caractéristiques de la manière de façonner ou de débiter (chutes de burin,
éclats d'épannelage, etc.) pouvant être replacés dans une chaîne opératoire.
Typologique (Typo) : pièces mises en forme volontairement (retouche) ou ayant des stigmates d'usure
intentionnelle (ébréchures) : armatures, grattoirs, racloirs, etc. La dénomination des outils (grattoir,
3 Patouret 2006, p. 39-40.
4 Buard ed. 2007, p. 34. 5 Feblot-Augustins 2005 et Patouret 2006.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 67 -
etc.) renvoie à des formes déjà connues (par exemple Inizan et al. 1995) qui présument d'une
utilisation à partir de leur morphologie.
Production (Prod) : supports simples (éclats, lames, etc.) produits à l'aide d'une technique avec
prédétermination ou non, et dont la place dans la chaîne opératoire est restée incertaine (objets destinés
à être transformés ultérieurement en outils ou pas).
Débitage (Deb) : déchets de débitage ou de façonnage (esquilles, etc.) traduisant les gestes techniques
correspondants.
Indéterminés (Ind) : restes non identifiables.
Les catégories de supports
Les catégories de supports différencient les objets selon leur forme, qui découle des techniques et du
façonnage employés pour les produire. On distingue donc les éclats des supports laminaires (lames,
lamelles, etc.), puisque ces objets impliquent des gestes et investissements techniques différents pour
les obtenir. L’enregistrement est subdivisé selon les dimensions des supports (micro lamelles et lames,
etc.), puisque de la même manière un micro éclat peut être représentatif d’une action différente de
celle qui a produit un éclat de plus grande dimension. Les fragments inidentifiables ou produits
involontairement (esquilles, etc.) sont répertoriés dans la catégorie autres.
Éclat : fragment de silex obtenu par débitage ou façonnage, qui peut traduire une étape de la chaîne
technique (préparation du nucléus), une volonté de production (pour une utilisation ultérieure ou non)
ou un façonnage d'objet (retouche). Un micro éclat est un éclat de largeur inférieure à 1 cm.
Produit laminaire : fragment de silex à bords sensiblement réguliers et parallèles, fruit d’un débitage
prédéterminé, dont la longueur est en général égale à au moins deux fois sa largeur. Une lame est
produite en vue d’une utilisation telle quelle ou bien sous forme d’outil retouché ou composite. Une
lamelle est une lame de moins d’1 cm de large. Une micro lamelle est une lamelle de moins d’1 cm de
long. Un éclat laminaire est un éclat présentant les mêmes modalités de débitage qu’une lame, sauf la
régularité et le parallélisme des bords, qui sont en général moins stricts. Un fragment laminaire est un
fragment de lame ou d'éclat laminaire trop détérioré pour être nettement différencié.
Nucléus : bloc de dimensions variables débité pour obtenir des éclats et/ou des supports laminaires.
Les méthodes de débitage sont variables (à partir d’un plan de frappe ou de plusieurs, avec
prédétermination ou pas, etc.), tout comme les types de percussion (directe ou non, percuteur minéral
ou organique, etc.). On peut déduire ces différentes informations des stigmates restant sur le nucléus
abandonné.
Chute de burin : déchet de retouche caractérisant « le coup du burin », qui vise à détacher un petit
fragment lamellaire latéral, perpendiculairement ou parallèlement au tranchant d’un support. Le plan
ainsi créé forme un burin, qui est plus robuste qu’un tranchant brut et permet donc de travailler
finement et en profondeur des matières résistantes (bois de cerf, minéraux, etc.).
Autre : fragment non déterminable (forme ou place dans la chaîne opératoire), ou qui n'est pas produit
volontairement (esquille, arrachement thermique, etc.).
4 - Analyse des données
Nous présenterons ici les décomptes des pièces vues, les répartitions spatiales et les matières
premières présentes pour chaque ensemble stratigraphique.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 68 -
Ens. 1.1 (Gallo-romain)
Cet ensemble n’a fourni qu’un seul silex, à savoir un racloir latéral sur éclat en silex brun orangé à
grain fin (S177). La variété du silex employé est très certainement régionale, voire locale. Cette forme
d’outil étant peu explicite typologiquement, il est difficile de déterminer si cette pièce appartient bien à
l’horizon concerné ou s’il s’agit d’un brassage inter couches. Il ne faut toutefois pas exclure la
possibilité d'une utilisation expédiente à la métallurgie d'outillage en silex, un racloir tel que celui
décrit ici ne demandant que très peu de connaissances techniques pour être réalisé.
Ens. 1.2 (1er
Age du Fer)
Cet ensemble a livré très peu de matériel, dont un silex. Il s’agit d’un éclat laminaire en matière grise
opaque qui témoigne d’une production anecdotique et ne nous renseigne pas sur les influences
culturelles de cette occupation. Semblablement à la pièce retrouvée dans l'ensemble 1.1, il peut s'agir
d'une utilisation ponctuelle et pragmatique des ressources siliceuses, quoique la matière première
utilisée ici ne soit pas clairement déterminable comme étant de provenance locale.
Ens. 1.3 (Bronze final IIb-IIIa)
Les silex de cet ensemble sont au nombre de 35, peu abondants par rapport aux autres restes retrouvés
dans cette couche (1215 faunes, 41 galets, 884 céramiques). Le faible effectif de ce groupe ne permet
pas une analyse poussée de sa composition technologique. La conservation est médiocre, les fragments
concernant 60% du total et les silex brûlés 40%.
Répartition spatiale
La majorité du matériel est répartie sur une diagonale allant des mètres carrés O14-15 jusque contre la
paroi de la grotte en I16-17 (Figure 52). Compte tenu du faible effectif des silex, on ne peut déduire de
division de l’espace par rapport aux types de produits et de supports représentés, car il n’y a pas de
concentration d’un type précis en un endroit délimité. Ceci concorde avec l’ensemble stratigraphique,
qui est caractérisé par « l'absence […] de stratification, d'horizon typologique clair et d'organisation
dans la répartition du matériel [qui] indiquent un brassage des vestiges. On se trouve en présence
d'une série de fréquentations, d'occupations de faible importance mais abrasives […] »6. Par contre,
on peut voir que la diagonale réduite où sont regroupés les silex correspond aussi à l’espace de plus
grande densité des restes fauniques et céramiques (voir Buard ed. 2007, p. 85).
Catégories de supports Nombre % du total
Eclat 9 25.7
Produit laminaire 19 54.4
Chute de burin 1 2.8
Nucléus 2 5.7
Autre 4 11.4
Tableau 6 : catégories de support de l’ens.1.3.
Composition de l’industrie
La majorité des supports est composée par les produits laminaires qui constituent environ 54% du total
(Tableau 6). Le reste des supports est constitué d’éclats (25%) et de fragments indéterminés (11%) ;
deux nucléus (5,7%) et un fragment de chute de burin (2,8%) complètent cet ensemble. La préférence
pour les produits allongés montre une pérennité des techniques de taille laminaires jusqu’au Bronze
final, avec une certaine maîtrise des modalités de débitage : les deux nucléus présents (S022 et S173)
6 Buard ed. 2007, p. 84
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 69 -
montrent une extraction bipolaire de lames et lamelles très probablement au percuteur tendre.
L'utilisation du coup du burin s'inscrit ici aussi dans une continuité en lien avec les utilisations
antérieures de cette technique.
On peut donc constater que la tendance de ce petit lot est orientée vers la production de produits
laminaires (19 silex sur 35), ce qui indique un savoir-faire notable (Tableau 6). Cette idée est appuyée
par le fait que 10 pièces témoignent de gestes techniques, et 5 d’un débitage sur place. Les objets
d’ordre typologique ne sont qu’au nombre de deux : des racloirs sur éclats laminaires en silex brun
régional (S025 et S034). Ces pièces ont une morphologie qui se rapporte aux outils protohistoriques
du fait de la simplicité du support utilisé (obtenu par une technique rapide, dont l'un par percussion
directe au percuteur dur) ainsi que du façonnage des bords inexistant (le statut de pièce utilisée étant
déduit des ébréchures visibles sur les tranchants). Ce type d'outillage peu investi techniquement se
retrouve communément dans les occupations de l'Âge du Bronze jusqu'au milieu de l'Âge du Fer.
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 18 51.4
Typo 2 5.7
Tech 10 28.6
Deb 5 14.3
Tableau 7 : catégories de produit de l’ens.1.3.
Il apparaît que les silex de l'ensemble 1.3, toutes proportions gardées vu leur nombre réduit, traduisent
des gestes orientés vers la production dans la grotte même de produits laminaires utilisables en outils
retouchés ou bruts. Cette hypothèse est appuyée par la présence de deux nucléus, l’un à lamelles
(S022) et l’autre (S173) à enlèvements laminaires, qui semblent tous deux avoir été abandonnés après
exhaustion. Le manque de pièces bien marquées typo chronologiquement (armatures, etc.) ne nous
permet pas d’établir de lien avec quelque groupe culturel que ce soit, hormis le fait que les outils
recensés pour cet ensemble correspondent bien aux formes protohistoriques.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 70 -
Figure 52 : ens.1.3, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 71 -
Ens. 2.1 (Bronze moyen)
L’ensemble Bronze moyen a livré 99 silex passablement conservés : environ 54% sont fragmentés, et
24% sont brûlés. Leur nombre est ici aussi beaucoup plus limité que les autres types de restes (2002
faunes, 46 galets, 1091 céramiques), tendance qui se retrouve pour tous les niveaux supérieurs dans la
grotte.
Répartition spatiale
Les silex se répartissent principalement sur le centre de la surface fouillée, avec une concentration plus
marquée à l’ouest du remplissage, dans le secteur ST 14-17 (Figure 53). Les trois zones de fouille
présentent des densités de silex différentes : au fond de la grotte, le secteur LO 20-21 montre une
concentration anecdotique, tandis que la majorité des artefacts sont regroupés dans les secteurs situés
vers l’entrée du porche. Le secteur ST 14-17 a fourni 44 silex répartis sur 8 mètres carrés, soit une
moyenne de 5,5 pièces par mètre carré. Le secteur IP 14-17 a quant à lui livré 51 pièces, sur environ
22 mètres carrés, ceci équivalant à environ 2,3 silex par carré. On remarque donc que la densité de
silex est environ deux fois plus élevée dans le secteur à l’ouest de la cavité, ce qui laisserait deviner
une zone d’activités et/ou de rejet privilégiée. En comparant les densités des autres types d'artefacts
dans ce secteur7, on constate que les restes fauniques et céramiques délimitent eux aussi une petite aire
de rejet autour du foyer F11 (situé dans les mètres carrés S15 et S16). Le secteur IP 14-17 dénote
d’une densité de silex moindre et plus diffuse, qui serait à rattacher par exemple à une zone de
circulation, car on n’y retrouve aucune concentration de silex révélatrice d'une activité en lien avec
l'empierrement E10 (présent dans les mètres carrés JKL 16-17).
Les densités des types de supports confirment le fait que la zone ST 14-17 ait été pour cet ensemble le
lieu de rejets et d'activités privilégiés. En effet, les produits laminaires, les éclats ainsi que la catégorie
« autres » sont toutes au minimum deux fois plus abondantes dans la zone fouillée à l'ouest qu'en IP
14-17. Il est par contre à noter que les quatre nucléus présents ont été rejetés dans la zone à l'est du
porche : ceci pourrait concorder avec une fonction d'espace de rejet (entre autres des nucléus après
utilisation) et/ou de circulation du secteur IP 14-17. Les densités de silex examinées sous l'angle des
catégories de produits permettent d'éclairer encore davantage ces tendances :
- les restes de « production » montrent une densité trois fois plus élevée dans le secteur ouest qu'à l'est
(3,625 contre 1,2);
- les témoins du « débitage » sont deux fois plus nombreux en ST 14-17 qu'en IP 14-17
(respectivement 0,27 et 0,5) ;
- les déchets « techniques » sont légèrement plus abondants en zone ouest mais en proportions
quasiment égales dans les deux ensembles (0,68 en IP 14-17 et 0,875 en ST 14-17) ;
- les catégories très peu nombreuses telles que « typologique » et « indéterminés » renseignent
simplement sur le fait que ce dernier type d'objets n'est présent que dans le secteur à l'est du porche, et
que les outils (« typo ») ont une densité six fois plus élevée en ST 14-17 qu'en IP 14-17
(respectivement 0,25 et 0,04).
Ces éléments témoignent donc de la différentiation des deux principales zones d'occupation à l'ouest et
à l'est de la grotte par le biais des rejets de silex que ces ensembles contenaient. Il apparaît que les
densité et composition de ces rejets permettent d'inférer deux fonctions distinctes aux zones ST 14-17
et IP 14-17 : la première serait un espace de travail du silex lié à la production et à l'entretien des
supports et outils, probablement en lien avec le foyer F11, la seconde correspondant plus
probablement à une aire de rejet et/ou de circulation.
7 Buard ed. 2007, p. 93.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 72 -
Composition de l’industrie
Les types de supports (Tableau 8) sont dominés par les produits laminaires (46,5% du total), suivis par
les éclats en quantité non négligeable (35,4%), les objets indéterminés représentant environ 14% de
l’ensemble. Les catégories de produits (Tableau 9) montrent que le débitage était indubitablement
orienté vers l’obtention de supports simples (environ 60% du total), avec la présence de taille sur
place : les pièces techniques (23,3%) et les déchets de débitage (11,1%) l’attestent. Quatre nucléus
proviennent de ces niveaux (S014, S020, S035, S176). Deux d’entre eux ont servi à débiter des
produits laminaires (dont un des lamelles, S176), un autre a produit des éclats (S014), et le dernier est
une plaquette testée en deux endroits (S035).
Catégories de supports Nombre % du total
Produits laminaires 46 46,5
Eclats 35 35,4
Nucléus 4 4
Autre 14 14,1
Tableau 8 : catégories de supports de l’ens.2.1.
Dans les types de produits (Tableau 9) l’outillage est anecdotique (3%) et les fragments indéterminés
sont minimes (2%). Les objets typologiques sont au nombre de trois et traduisent la variété de
l’ensemble : il s’agit de deux racloirs sur éclats (l’un est retouché s166, l’autre non s175), et d’un éclat
laminaire dont l’un des tranchants brut a servi à découper une matière peu résistante (s167). Les
racloirs montrent que la production d'éclats a en partie servi pour la fabrication d'outils retouchés ayant
été utilisés, alors que l'unique outil sur éclat laminaire montrerait plutôt des stigmates (ébréchures
typiques) liés à une utilisation du bord brut. Avec un effectif aussi réduit il devient hasardeux
d'élaborer des hypothèses, mais ces différences de traitement selon les supports sont à noter. Les
morphologies de ces outils s'accordent avec les caractères généraux des industries en silex
protohistoriques : elles sont peu investies techniquement en ce qui concerne l'outillage de fond
commun.
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 60 60,6
Typo 3 3
Tech 23 23,3
Deb 11 11,1
Ind 2 2
Tableau 9 : catégories de produit de l’ens.2.1.
L’analyse de l'ensemble siliceux du Bronze moyen a permis d'étoffer l'interprétation de cette
occupation du fait de la répartition spatiale différentielle qui a été détectée dans le remplissage, ainsi
que des caractéristiques techniques et typologiques qui montrent une certaine diversité. Il est en effet
manifeste que les techniques de débitage laminaire étaient connues à cette période, et les très rares
outils qui ont été récoltés attestent d'une utilisation davantage tournée vers les supports courts et épais.
Malheureusement les faibles effectifs d'outils ne nous permettent pas une réflexion plus poussée.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 73 -
Figure 53 : ens.2.1, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 74 -
Ens. 2.2 (Bronze ancien)
Les niveaux du Bronze ancien ont livré 68 silex, qui sont très fragmentés (57,3%) et assez peu brûlés
(22%). L’ensemble des restes anthropiques de ces occupations sont peu abondants et ont subi une
fragmentation assez conséquente.
Répartition spatiale
Les silex sont clairement concentrés de manière préférentielle dans le secteur ST 14-17, à l’ouest de la
grotte (Figure 54). Quatre foyers ont été fouillés dans cette zone8 (F13, F40, F44 et F45), qui sont
situés dans les mètres carrés S15 et S16. Les autres restes (fauniques, céramiques) montrent eux aussi
une concentration marquée à cet endroit, en particulier dans la périphérie proche de la zone foyère. On
constate aussi que les types de produits majoritaires sont des pièces liées au débitage et aux gestes
techniques de la taille (éclats et autres). Ces silex sont principalement regroupés dans les mètres carrés
S15 et T15, et très peu d’entre eux montrent une altération thermique de leur surface. On peut donc
supposer que ces fragments aient été rejetés en bordure de foyer pendant le travail (en ce cas, il
s’agirait d’une activité liée à F44 ou F45), ou bien qu’ils aient été abandonnés lors d’une activité au-
dessus de structures de combustion non allumées. Dans tous les cas, on distingue très clairement un
lien entre la zone de combustion préférentielle qui voit plusieurs foyers se superposer, et le débitage de
silex autour de cette aire, qui peut alors se définir comme aire d’activités.
Le secteur IP 14-17 a par contre livré peu d’objets en silex, qui ne montrent pas de spatialité
privilégiée pour le côté est de la grotte. Deux foyers témoignent d’occupations humaines pour cette
unité stratigraphique dans ce secteur, mais seul F15, situé dans le mètre carré K16, pourrait
éventuellement être rattachable à la dispersion des silex dans les mètres carrés alentour, de la même
manière que l’aire d’activités située en ST 14-17. Il est toutefois impossible de statuer clairement sur
cette zone, la densité de silex et la conservation des niveaux paraissant trop aléatoire.
Composition de l’industrie
L’industrie liée à l'ensemble 2.2 (Tableau 10) est nettement dominée par les éclats (environ 44% du
total), ainsi que par les restes détritiques (esquilles, etc., soit 32,4%), en dernier venant les produits
laminaires (23,5%). Cette inversion des tendances précédemment observées est intéressante dans le
sens où la majorité des supports fait partie des restes de débitage, ne concernant pas la production
stricto sensu. On constate que les produits laminaires ne sont pas absents de l’assemblage, mais que
les lames et lamelles véritables sont en nombre très limité (2 sur l’ensemble). Ceci pourrait être
rattachable à la mauvaise conservation liée à ces horizons Bronze ancien, la fragmentation concernant
d’autant plus les supports longs et fins tels que les lames. Aucun nucléus n’a été retrouvé dans cet
ensemble.
Catégories de supports Nombre % du total
Produits laminaires 16 23,5
Eclats 30 44,1
Autres 22 32,4
Tableau 10 : catégories de supports de l’ens.2.2.
Les produits (Tableau 11) témoignent d’une volonté d’obtention de supports simples (36,8%), une
bonne partie ayant été effectuée sur les lieux, puisque les restes liés au débitage représentent environ
30% du total, les pièces techniques étant elles aussi bien représentées (23,6%). Les outils sont rares : il
s'agit d’un fragment de lamelle non retouché en silex blond à grain fin (S015), et d’un grattoir
circulaire sur éclat laminaire en matière locale (S032). Ce dernier montre des retouches distales (ainsi
8 Buard ed. 2007, p. 100.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 75 -
que des ébréchures latérales qui suggèrent un emmanchement), le front retouché portant des écaillures
attestant d'une utilisation probable.
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 25 36,8
Typo 2 2,9
Tech 16 23,6
Deb 21 30,9
Ind 4 5,8
Tableau 11 : catégories de produits de l’ens.2.2.
Les occupations du Bronze ancien sont donc caractérisées par une aire d’activités en ST 14-17 qui est
clairement délimitée par l’accumulation de restes siliceux liés au débitage sur place (éclats et déchets)
ainsi que la production de supports laminaires.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 76 -
Figure 54 : ens.2.2, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 77 -
Ens. 3.1 (Néolithique final supérieur)
Les niveaux supérieurs du Néolithique final ont fourni 36 silex, dont la conservation est assez
mauvaise, environ 33% des pièces étant brûlées et presque 39% fragmentées. L’ensemble du matériel
est peu abondant et médiocrement conservé, à l'image des structures relatives à cette phase
d’occupation (empierrement et foyers).
Répartition spatiale
Le plan de répartition des silex montre que les pièces sont dispersées préférentiellement à l’est de la
grotte, de manière peu concentrée (Figure 55). La plupart des autres restes (céramiques et fauniques)
sont eux aussi regroupés dans cette zone contre la paroi (mètres carrés JK 16-17), qui correspond à
l’empierrement E13. Cette accumulation coïncide probablement avec un espace de rejet9. Les silex
restants paraissent dispersés peu densément vers le centre de la grotte, traduisant un piétinement
vraisemblablement marqué et une mauvaise conservation de l’ensemble des témoins archéologiques, à
l’instar des six foyers présents. Ces niveaux sont interprétés comme des occupations de type bergerie
par le biais d’analyses micromorphologiques10
.
Le secteur fouillé à l’ouest (ST 14-17) ne présente que de très rares témoins anthropiques pour le
Néolithique final supérieur, ce qui suggèrerait que les occupations aient eu lieu de manière privilégiée
dans le secteur IP 14-17, à l’est du porche.
Composition de l’industrie
Les différents types de supports retrouvés pour cet ensemble d’occupations (Tableau 12) attestent
d’une dominance des éclats (44,5%), suivis de près par les produits laminaires (38,9%). Cette majorité
d’éclats concerne la catégorie des pièces techniques, la production de supports en elle-même étant
dominée par les objets laminaires. Les chutes de burins, les fragments indéterminés et un nucléus sont
présents de manière peu abondante, mais traduisent certains gestes techniques tels le débitage sur
place et le réaffûtage d’outils. L’unique nucléus retrouvé est en silex régional (S007), et il porte les
négatifs d’un débitage bipolaire d’éclats et de supports laminaires, ce qui conforte l’idée d’un débitage
de supports dans la grotte ou à proximité.
Catégories de supports Nombre % du total
Eclats 16 44,5
Chutes de burins 3 8,4
Produits laminaires 14 38,9
Nucléus 1 2,7
Autre 2 5,5
Tableau 12 : catégories de supports de l’ens.3.1.
Les types de produits (Tableau 13) s 'accordent avec ce schéma du fait de la prédominance de la
catégorie production (38,9%), suivie par les restes techniques (36,2%). La tendance générale pour cet
ensemble est donc à l'obtention de supports simple laminaires, qui traduit une orientation préférentielle
de la production. Les déchets de débitage (environ 11%) et les objets typologiques (environ 11%
aussi) complètent ce petit panel siliceux. Quatre silex sont répertoriés dans la catégorie typologique :
un racloir sur éclat (S008), deux lamelles (S013 et S170) et un racloir sur éclat laminaire (S082). Une
des deux lamelles porte une troncature latérale et des ébréchures d’utilisation (S170), la seconde ayant
des bords bruts (S013) ; les deux objets sont fragmentés. Le racloir sur éclat est façonné par retouches
latérales et distales, et montre lui aussi des ébréchures traduisant son utilisation. Le même outil sur
éclat laminaire présente des stigmates d’usure (ébréchures et émoussé), mais sans mise en forme
9 Buard ed. 2007, p. 101 et 104.
10 Buard ed. 2007, p. 101.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 78 -
préalable par des retouches. Ce petit lot d’outils nous renseigne sur des activités et des savoir-faire
divers, certains nécessitant un façonnage des tranchants, d’autres l’utilisation de bords bruts.
Figure 55 : ens.3.1, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 79 -
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 14 38,9
Typo 4 11,1
Tech 13 36,2
Deb 4 11,1
Ind 1 2,7
Tableau 13 : catégories de produits de l’ens.3.1.
Nous sommes donc en présence d'un ensemble cohérent, où l'obtention de supports allongés par le
biais d'un débitage produisant un nombre important d'éclats résiduels est clairement attesté. L’outillage
dénote de caractéristiques variables, avec une utilisation majoritaire de supports laminaires à bords
bruts.
Ens. 3.2 - 3.3 (Néolithique final inférieur)
Cette unité stratigraphique est formée par le regroupement de deux ensembles concomitants dans la
grotte qui présentent de fortes correspondances. Ce groupe a fourni 124 silex dont la conservation est
assez bonne, 18,5% étant brûlés et environ 40% sont sous forme de fragments.
Répartition spatiale
Aux ensembles stratigraphiques 3.2 et 3.3 correspondent deux types de répartition des silex très
différents (Figure 56).
Le secteur ST 14-17 (ensemble 3.2), dont la densité moyenne est d’environ 9 pièces par mètre carré,
présente un regroupement assez net des silex dans les mètres carrés ST 15-16, en corrélation avec la
présence du foyer F21 en S16. Cette aire montre une concentration de pièces techniques (chutes de
burin, nucléus, etc.) ainsi que de déchets de débitage et de supports. Ceci traduit probablement une
zone de travail, avec des activités telles que la taille d'éclats et de produites laminaires, le façonnage et
le réaffûtage d’outils ainsi que le rejet de produits obsolètes. Seule une petite quantité des pièces qui
sont situés dans ou bordent la surface du foyer F21 sont brûlées.
La zone IP 12-17 (ensemble 3.3) présente une densité d’environ 1,5 silex par mètre carré, et montre
une dispersion très lâche des éléments siliceux. La quasi-totalité des pièces se situe dans la partie est
de ce secteur, qui correspondrait selon les analyses sédimentologiques à une zone de bergerie. Les
types de produits retrouvés dans cette zone ne montrent pas de concentration particulière, ce qui
apparenterait ce secteur à un espace de rejet ou à une aire de circulation, l'un n'excluant pas l'autre. Les
aménagements anthropiques sont plus nombreux pour l’ensemble 3.3 que pour l'ensemble 3.2, mais on
ne peut mettre en relation aucune de ces dernières avec la disposition des restes siliceux.
Composition de l’industrie
Les supports retrouvés dans cet ensemble (Tableau 14) sont majoritairement des éclats (42,7%), puis
des produits laminaires (25,8%), ainsi qu’une petite quantité de nucléus (environ 2%) et de chutes de
burins (1,6%), avec une part importante de déchets et pièces informes (27,5%). Ce fort taux d’objets
résiduels est attribuable aux activités de débitage et probablement aux circulations importantes ayant
eu lieu pendant ces occupations. La prédominance des éclats est rattachable aux activités de taille et de
façonnage liées à l’aire de travail de la zone 3.2, puisque ces objets sont majoritairement témoins de
gestes techniques. La production pure et simple de supports concerne en premier lieu les produits
laminaires. Les nucléus présents (S009, S081 et S072) montrent des modalités de débitage bi- et
multipolaires d’éclats ou de supports non déterminables au vu leur piètre conservation.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 80 -
Catégories de supports Nombre % du total
Produits laminaires 32 25,8
Eclats 53 42,7
Nucléus 3 2,4
Chutes de burins 2 1,6
Autres 34 27,5
Tableau 14 : catégories de supports des ens.3.2-3.3.
Les catégories de produits (Tableau 15) dénotent en premier lieu de gestes techniques (37,9%) ayant
eu lieu dans la grotte pendant ces occupations, suivis de la production de supports simples (29,8%),
puis des restes de débitage (19,4%), sous forme de déchets. Les pièces typologiques restent rares (4%),
comme la proportion d’indéterminés (un peu moins de 9%). On constate donc que la majorité des
pièces traduit des activités de taille et d’entretien ayant eu lieu probablement dans le secteur ST-14/17
(catégories :Tech et Deb), pour produire des lames dont une petite partie nous est parvenue (Prod) par
le biais d'un débitage d'éclats.
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 37 29,8
Typo 5 4
Tech 47 37,9
Deb 24 19,4
Ind 11 8,9
Tableau 15 : catégories de produits des ens.3.2-3.3.
Les types d'outils rejetés évoquent un panel d’actions plus étendu que pour les périodes plus récentes,
puisque l’on trouve deux armatures, un grattoir et deux lames portant des stigmates d’utilisation. Il est
à noter que les deux pointes de flèches ont été retrouvées dans l’ensemble 3.2, au voisinage du foyer
F21. Ces deux objets présentent des morphologies distinctes : l’une est de forme foliacée (S066),
façonnée par retouches inverses sur un silex zoné caramel rougeâtre opaque, la seconde (S001) étant
de type pédonculé à ailerons en silex caramel translucide exogène, mise en forme par retouches
couvrantes. L’unique grattoir de la série est façonné sur éclat laminaire (S127), avec un front rectiligne
à retouches abruptes et ébréchures latérales qui suggèrent un emmanchement. Un fragment de lamelle
en silex blond exogène porte des retouches latérales et de nombreuses ébréchures bilatérales (S010),
reliant cet objet à un éventuel usage comme outil composite (faucille ?). Le second fragment de lame
porte uniquement des ébréchures latérales peu profondes (S017), qui rattachent cet objet à un usage en
percussion posée sur une matière peu résistante (par exemple de la découpe).
L’assemblage siliceux du Néolithique final inférieur a donc plusieurs caractéristiques notables : la
présence d’une aire de travail nettement conservée (ensemble 3.2), la production d'objets laminaires
par le biais d'un débitage d'éclats, ainsi que le rejet d’outils en proportions et variétés plus grandes que
pour les ensembles décrits précédemment. Ces objets présentent des morphologies typiques de la
première partie du Néolithique final (avant 3000 av. J.C.)11
, en particulier le grattoir sur support
allongé et les deux armatures de flèches, celle à morphologie foliacée pouvant se rapporter à des
influences nordiques, telle que la fin de la période du groupe du Michelsberg (4100-3300 av. J.C.)12.
La pointe à ailerons est d’un type répandu pour cette période, probablement d’origine méridionale. Les
affinités avec le sud de la France sont aussi représentées par le biais des lames en silex blond exogène,
caractéristiques du bagage technique Chasséen. On se trouve donc ici au point de contact entre deux
sphères d’influences, nordique et méridionale, comme il est fréquent pour la région jurassienne au
cours du Néolithique.
11 Buard ed. 2007, p. 101-102. 12 Cauwe et al. 2007.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 81 -
Figure 56 : ens. 3.2-3.3, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 82 -
Ens. 4 (Néolithique moyen bourguignon)
Cet ensemble a livré 101 silex, qui sont peu nombreux comparativement aux autres types de mobilier
(945 faunes, 1048 céramiques), et présentent une assez mauvaise conservation : 40,6% d’entre eux
sont brûlés, et 49,5% fragmentés. Ceci s’accorde avec la médiocre conservation des aménagements
anthropiques et la dispersion générale des assemblages13
.
Répartition spatiale
Les occupations de cette période semblent principalement concentrées au centre du porche de manière
assez diffuse dans les deux secteurs fouillés (Figure 57). Aucune structure n’étant clairement
délimitée, il est impossible d’y relier une concentration d'objets de manière significative. La zone
centrale montre une densité de silex légèrement plus marquée. Il n’y a pas d’accumulation nette de tel
ou tel type de produits, tous étant dispersés aléatoirement sur la surface, mis à part les déchets de
débitage qui semblent groupés au milieu de l’accumulation. Ceci indiquerait éventuellement une zone
préférentielle de taille ou de rejet des restes au centre du porche.
Composition de l’industrie
Les types de supports (Tableau 16) sont dominés par les produits laminaires (34,7%), suivis de peu par
les éclats (32,7%) et la catégorie autres (28,8%), les nucléus et chutes de burins étant présents en très
petites quantités (2,9 et 0,9%). La quasi égalité des proportions d’éclats et de produits laminaires est
attribuable au mode de débitage, dont les éclats majoritairement résiduels sont ici comptabilisés.
L'objectif de production premier fut donc les supports laminaires. Trois nucléus sont conservés: deux
d’entre eux ont fourni des produits laminaires (lames et lamelles, S178 et S018), l’un étant en silex
caramel à grain fin à débitage unipolaire (S178). Le seul nucléus à éclats (S164) traduit un débitage
multipolaire sur silex brun. Ces différentes modalités trahissent une volonté d’obtenir des supports de
bonne qualité en utilisant des types diversifiés de matières premières. Le taux important de déchets
résiduels et/ou informes (catégorie : autres) est attribuable à la mauvaise conservation générale des
niveaux, et aux activités de taille ayant apparemment eu lieu au cours de ces occupations.
Catégories de supports Nombre % du total
Produits laminaires 35 34,7
Eclats 33 32,7
Nucléus 3 2,9
Chutes de burins 1 0,9
Autres 29 28,8
Tableau 16 : catégories de supports de l’ens.4
Les catégories de produits (Tableau 17) renvoient clairement à l’idée d’une production de supports
simples (46,6%) in situ, la proportion de restes techniques et de déchets de débitage étant assez
importante (respectivement 26,8 et 17,8%). Un seul objet typologique a été ici conservé, il s’agit d’un
fragment de lamelle à retouche latérale (S011); cet unique indice ne permet pas d’affiner plus
précisément l’attribution culturelle de cette industrie. La part importante de supports laminaires, une
partie étant en silex blond ou caramel à grain fin, est directement rattachable aux assemblages
typiquement chasséens, avec ici une adaptation aux matières premières et besoins locaux.
13
Buard ed. 2007, p. 109.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 83 -
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 47 46,6
Typo 1 0,9
Tech 27 26,8
Deb 18 17,8
Ind 8 7,9
Tableau 17 : catégories de produits de l’ens.4.
L’assemblage siliceux de l’ensemble 4 présente donc des caractéristiques rattachables à une industrie
d'obédience méridionale (production de supports laminaires par un débitage d'éclats, présence de
lamelle) avec une part d’adaptation locale du fait de l'utilisation de matières premières en priorité
régionales.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 84 -
Figure 57 : ens.4, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 85 -
Ens. 5 (Chasséen moyen)
L'ensemble 5 a fourni 72 silex assez mal conservés, 36,1% d’entre eux étant brûlés et 50% fragmentés.
Répartition spatiale
Dans la partie centrale de la grotte la dispersion des pièces ne présente pas de particularité marquée.
Dans la partie est du secteur on distingue deux petits agglomérats, en K15-16 et I16. On peut donc
observer deux types de répartitions : à trame lâche, au centre et à l’ouest du porche (zones LP 14-17 et
ST 14-17), et en petites accumulations distinctes à l’est du porche secteur (zones IK.15-17, Figure 58).
Cependant, ces niveaux ne présentent pas d’aire de travail telles que celles définies pour les ensembles
2.2 ou 3.2-3.3, mais un espace de rejet diffus. Ces indices renforcent l’interprétation de cette unité
stratigraphique comme « une succession de fréquentations ponctuelles de la grotte vers 4000 - 3800
av. J.C. Chacune de ces fréquentations étant responsable de la destruction de l'organisation
antérieure, destructions indiquées par la rareté des remontages et la forte fragmentation des
vestiges14
».
Composition de l’industrie
Le tableau de décompte des catégories de support (Tableau 18) nous indique que les produits
laminaires (43,28%) priment sur les éclats (32,28%), les chutes de burin (1,49%) et les types autres
(22,39%). La relative abondance de ces derniers restes est explicable par la forte fracturation générale
des silex, ainsi qu'éventuellement par un travail sur les supports dans la grotte même. Les éclats, qui
sont en proportion minoritaire, sont attribuables pour les deux tiers à des déchets de débitage, un petit
nombre d'entre eux restant produits en tant que supports simples. L’absence de nucléus ne nous permet
malheureusement pas d'examiner les modalités de débitage des supports.
Catégories de supports Nombre % du total
Eclats 22 32.28
Produits laminaires 29 43.28
Chutes de burins 1 1.49
Autres 15 22.39
Tableau 18 : catégories de supports de l'ens.5.
Le tableau de décompte des catégories de produits (Tableau 19) atteste d'une dominance nette de la
production de supports simples (59,7% du total), suivie des restes techniques (19,4%) et des résidus de
débitage (13,43%), les fragments indéterminés représentant environ 7,4% de l’ensemble. On constate
que la finalité du débitage ayant eu lieu à cette période fut l’obtention de supports simples
principalement laminaires, une partie ayant eu lieu sur place. L’affûtage et le façonnage d’outils est
attesté par une partie des restes techniques, mais aucun objet typologique ne permet de préciser la
finalité de ces mises en forme.
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 40 59.7
Tech 13 19.4
Deb 9 13.43
Ind 5 7.46
Tableau 19 : catégories de produits de l' ens.5.
14 Buard ed. 2007, p. 117.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 86 -
Figure 58 : ens.5, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
Cet ensemble 5 chasséen moyen est caractérisé par une forte dégradation des objets et un débitage
clairement orienté vers l’obtention de supports laminaires. Le schéma technique de cette production ne
peut malencontreusement pas être détaillé, du fait de l’absence de nucléus et d’outils. La préférence
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 87 -
pour les produits allongés est rattachable à la culture chasséenne méridionale, qui se distingue par une
production classique de lames et lamelles aux modules prédéfinis, ce trait se retrouvant tout au long de
la progression de ces influences dans les autres régions. Cette constatation est ici renforcée par la
présence de nombreuses pièces de silex blond à brun caramel, représentatives de certains traits de
cette culture dans l’industrie siliceuse.
Ens. 6 (Chasséen ancien/Saint-Uze)
Le second ensemble stratigraphique daté du Chasséen ancien/Saint-Uze a fourni 46 silex globalement
mal conservés, dont 32,6% sont brûlés et 54,3% sont fragmentés.
Répartition spatiale
La dispersion horizontale des pièces (Figure 59) ne montre pas de particularités notables, mis à part un
léger effet d'accumulation dans les mètres carrés JK 16, où la densité s'apparente à deux petits amas.
Ces derniers ne concernent pas des types de supports ou de produits particuliers. Les silex sont
globalement situés dans la zone est de fouille, avec une trame de présence très lâche. Ceci est en
corrélation, comme pour l'ensemble 5, avec des occupations successives déstructurant les vestiges
antérieurs et entraînant une mauvaise conservation du mobilier15
.
Composition de l’industrie
Les supports (Tableau 20) sont représentés pour la plus grande part (43,18%) par les fragments
informes résultants du débitage (« autres »), qui montrent à quel point les occupations concernées par
cet ensemble furent productifs en résidus lithiques. L'assemblage est ensuite dominé par la catégorie
des supports laminaires (31,82%), suivis des éclats (22,73%) qui sont en majorité des déchets
techniques. Une chute de burin vient compléter cet ensemble. La catégorie des objets laminaires est la
part la plus significative des silex retrouvés, signifiant donc un choix marqué vers le débitage de
produits allongés ; la morphologie fine et régulière de ces supports a ainsi joué en leur défaveur lors de
leur rejet, expliquant en partie l'abondante fragmentation généralisée. Aucun nucléus n'a été retrouvé
dans cet ensemble.
Catégories de supports Nombre % du total
Éclats 10 22.73
Produits laminaires 14 31.82
Chutes de burins 1 2.27
Autres 19 43.18
Tableau 20 : catégories de supports de l'ens.6.
Les types de produits (Tableau 21) permettent d'affiner la compréhension de cet ensemble, qui
apparaît comme étant orienté vers la production de supports (47,73%), avec un taux notable de restes
de débitage (27,27%) et techniques (13,64%). Les fragments non déterminés sont assez peu abondants
(11,36%), ce qui renvoie au fait que les objets de type esquilles et fragments dus à la taille (catégorie
« autres » dans les supports) sont sur-représentés dans cet assemblage. Il ne s'agit pas de fragments
informes et indéterminables produits par -entre autres- un piétinement intensif, mais de vestiges des
actions de taille ayant eu lieu in situ. Aucun outil ou objet typologique n'a été recueilli pour cet
ensemble.
L'industrie lithique recueillie pour l'ensemble 6 possède donc des caractéristiques qui attestent d'une
production préférentielle de supports laminaires, très fragmentés mais reconnaissables, par des
modalités de débitage qui ont généré un grand nombre de résidus. L'absence de pièces typologiques et
de nucléi ne nous permet pas d'approfondir la réflexion technologique sur cet assemblage. La
15 Buard ed. 2007, p.117.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 88 -
dispersion et l'état des pièces tendent à laisser penser que les occupants de cette période ont effectué
des opérations de débitage sur place et que les vestiges abandonnés ont été intensivement malmenés.
La composante fortement laminaire des supports recherchés ainsi que la forte présence de matières
premières blond à brun caramel s'accorde avec la tradition chasséenne méridionale qui privilégie
habituellement ce type de débitage.
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 21 47.73
Tech 6 13.64
Deb 12 27.27
Ind 5 11.36
Tableau 21 : catégories de produits de l'ens.6.
Ens. 7 (Chasséen ancien / Saint-Uze)
Le Chasséen ancien à céramiques du style de Saint-Uze est composé de deux ensembles (7.1 et 7.2) à
empierrements complexes et stratifiés. Ce groupe a fourni 66 silex dont la conservation est médiocre
(environ 27% sont brûlés, et un tiers est fragmenté), cet effectif étant numériquement peu significatif.
Répartition spatiale
La dispersion des pièces est plutôt diffuse et ne montre pas de concentration marquée associable à une
quelconque fonction de l'espace. On peut simplement remarquer qu’aux deux extrémités de la surface
fouillée (secteurs ST 14-17 et IK 16-17) les densités de silex semblent légèrement plus élevées et
correspondent à des zones périphériques aux empierrements et aux foyers (Figure 60).
Composition de l’industrie
L’examen du décompte des supports de cet ensemble (Tableau 22) montre une prédominance nette des
produits laminaires (43,9% du total), suivis par les éclats (environ 35%) puis par les supports produits
involontairement (autres, 21,2%). La majorité de supports allongés (en particulier des lames et éclats
laminaires) permet de rattacher cet ensemble à la sphère chasséenne, la quantité non négligeable
d’éclats attestant uniquement d'actions de débitage. Le nombre assez important de déchets est
attribuable à un travail technique in situ. L’absence de nucléus et de déchets techniques
caractéristiques comme les chutes de burins est à noter.
Catégories de supports Nombre % du total
Eclats 23 34,9
Produits laminaires 29 43,9
Autres 14 21,2
Tableau 22 : catégories de supports de l’ens.7.
L’analyse des catégories de produits (Tableau 23) permet de confirmer la prédominance du débitage
de supports simples (presque 35% du total), dont une part au moins a été effectuée dans la grotte, les
restes de débitage et techniques en attestant (respectivement 25,8 et 28,8%). Les fragments
indéterminés sont peu nombreux (6%), et les pièces typologiques restent rares (4,5%).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 89 -
Figure 59 : ens.6, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 90 -
Catégories de produits Nombre % du total
Prod 23 34,9
Typo 3 4,5
Tech 19 28,8
Deb 17 25,8
Ind 4 6
Tableau 23 : catégories de produit de l’ens.7.
Les outils sont représentés par une lame (S158), une bitroncature sur éclat (S159) et une armature sur
lame (S151). La double troncature sur éclat est façonnée dans un silex caramel à grain fin par
retouches abruptes latérales et distales. La pointe de flèche a été façonnée à partir d'un fragment de
lame retouché de manière abrupte latéralement et distalement, en silex gris-blond. Les deux outils
décrits ici sont des armatures faisant partie d’outils composites tels que des flèches. L’une d’entre elle
(S151) porte une ébréchure d’utilisation témoignant d’une contrainte latérale peut-être rattachable à un
emmanchement.
Leurs morphologies s’accordent avec les phases anciennes du Chasséen d’influence rhodanienne, mais
avec des formes qui ne correspondent pas parfaitement aux caractères habituels et relèveraient plus
d’un certain régionalisme16
.
Cet ensemble du Chasséen ancien présente malheureusement une petite série de silex, qui ne permet
pas d’étendre plus largement la réflexion. Les rares éléments typologiques cadrent bien avec le
contexte chrono-culturel déjà connu pour le Bugey, et la composition de l’ensemble confirme les
influences méridionales dans l’industrie de ces périodes, avec des particularités régionales (matières
premières, présence notable d’éclats, morphologies non classiques). L’absence d’éléments
technologiques plus abondants limite la compréhension du schéma technique des occupants de la
grotte à cette époque.
16
Perrin 2001, p. 88-91.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 91 -
Figure 60 : ens.7, répartition des silex par catégorie de support et de produit (plan J.-F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 92 -
5 - Commentaire général
L’étude des silex retrouvés dans les divers ensembles stratigraphiques de la grotte a permis de détailler
les caractéristiques de chaque groupe. La conservation est globalement médiocre, à cause de la
stagnation du matériel dans un espace semi-clos, les piétinements et ruissellements divers fragmentant
les pièces. Les ensembles stratigraphiques les plus sujets aux cassures des silex sont les ensembles 1.3
(Bronze final), 2.1 (Bronze moyen) et 5-6 (Chasséen moyen), où les taux sont supérieurs à 50%
d’effectifs brisés. Ces occupations sont toutes interprétées comme des niveaux de fréquentation
ponctuels de la grotte, avec des espaces peu ou non structurés, ce qui a pu favoriser l'endommagement
des objets rejetés par une circulation aléatoire et dense en toutes zones de la grotte, en sus des
contraintes climatiques inhérentes à un tel abri (humidités, ruissellements, etc.).
On a pu constater globalement la pauvreté des ensembles en éléments typologiques (une vingtaine en
tout), probablement du fait d’occupations assez brèves de la grotte. En effet, la plupart des
établissements humains laissent supposer qu’ils n’étaient ni très denses, ni pérennes ; l’abandon
d’outils (volontaire ou non) fut peut-être réduit à cause de la rareté de ceux-ci et du soin apporté à leur
entretien.
L'examen des nucléus permet d'effectuer un récapitulatif des modes de débitage utilisés au cours des
différentes périodes chronologiques représentées dans la stratigraphie (Figure 61). Comme on a pu le
constater lors de l'analyse des différents ensembles, le débitage de produits laminaires en vue de
l'obtention de supports est plus fréquent à toutes époques que la fabrication d'éclats, sans que ceux-ci
soient pour autant absents. Les modes de débitage bipolaire et multipolaire sont prédominants,
traduisant une volonté de rentabilisation du volume du nucléus. La fragmentation multipolaire trahit en
général une adaptation à des matières premières difficiles à exploiter plus régulièrement (diaclases,
inclusions, etc.). On ne distingue pas de répartition préférentielle de types de débitage pour une époque
donnée ; il est toutefois à noter que les populations du Bronze final (ensemble 1.3) aient débité des
lamelles et produits laminaires par percussion bipolaire, car ces gestes exigent une maîtrise technique
certaine. On serait donc en présence de perduration d’un savoir-faire élaboré dans un ensemble
culturel n'investissant pas habituellement l’industrie siliceuse par des schémas techniques complexes.
Les ensembles les plus anciens (5 à 7) n'ayant pas livré de nucléus, il est impossible de commenter les
schémas de débitage concernés.
Figure 61 : classement des types de nucléus par ensemble stratigraphique (graphique J. Patouret).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 93 -
Comparaisons diachroniques
L’examen du décompte des catégories de produits par ensemble stratigraphique s’effectuera par
tendances et non par effectifs, étant donné la variabilité de ceux-ci d’un ensemble à l’autre (Figure 62
et Figure 63).
La première remarque concerne la catégorie des supports simples (« prod ») : elle domine l'effectif très
largement et ceci pour la plupart des périodes. La présence de supports en quantité importante est
explicable par au moins deux facteurs : la volonté d’obtenir des objets qui serviront tels quels ou après
retouche, et la nécessité dans certaines étapes du débitage d’éliminer différentes pièces qui ne
conviendraient pas aux objectifs de taille. On ne peut davantage écarter l’hypothèse d’un débitage
d'essai, malgré l'aspect technologiquement abouti de la plupart des supports. Les pics les plus élevés
dans les proportions de supports produits (Tableau 25) concernent le Bronze final (ensemble 1.3), le
NMB (ensemble 4) et le Chasséen moyen (ensemble 5), qui se rapportent à des occupations diffuses et
assez denses, sans répartitions spatiales du matériel bien définies. Les quantités de déchets techniques
et de débitage pour ces ensembles étant peu abondants, on peut supposer qu’une partie des supports a
pu être apportée avec les populations, voire que l'espace fut principalement investi dans une optique de
rejet. Le Bronze moyen (ensemble 2.1) représente un cas particulier. Faisant aussi partie de la
catégorie des occupations ayant produit un taux élevé de supports, l'occupation de l'espace à cette
période apparaît comme bien structurée, avec une aire d'activités attestée à l'ouest du porche. Il
semblerait donc que cet ensemble matériel se traduise, du point de vue corrélatif entre la spatialité et la
qualité des restes lithiques, comme l'occupation la plus cohérente et caractéristique de la stratigraphie.
A contrario, les occupations du Bronze ancien (ensemble 2.2), du Néolithique final (sup. :ensemble
3.1 et inf. : 3.2-3.3), du Chasséen ancien/Saint-Uze (ensembles 6 et 7) ont fourni des proportions de
déchets techniques quasiment égales voire supérieures aux supports (Tableau 25). Les groupes
matériels du Bronze ancien et du Néolithique final inférieur ont livré des aménagements de l'espace
(attestés par l'industrie lithique) tels que des aires d'activités en lien avec des structures de combustion.
Le croisement des données spatiales et mobilières permettent d'interpréter ces vestiges comme
attestant d'activités structurées de débitage et traitement du matériel en silex in situ, avec emport des
produits en résultant (inversement au cas du Bronze moyen). Les ensembles du Néolithique final
supérieur et du Chasséen ancien/Saint-Uze concernent pour leur part des dispersions diffuses et peu
denses de mobilier, sans lien avec des aménagements, que l'on peut donc interpréter comme des rejets
de restes de débitage (fonction "détritique" de l'espace) avec ou sans fabrication locale.
Les restes techniques (« tech », nucléus, chutes de burins, etc.) sont généralement moins fréquents que
les produits, sauf pour les ensembles du Néolithique final inférieur et supérieur, où leur proportion est
presque égale (ensemble 3.1) voire supérieure (ensembles 3.2-3.3) à celle des supports. Cette
abondance ponctuelle des éléments témoignant de gestes techniques sur le site peut être interprétée
comme rattachant ces vestiges à des schémas d'entretien de l'outillage plus fréquents que lors des
autres occupations. On peut aussi rattacher à cette hypothèse le fait que la fréquence la plus importante
de rejet d'outils "typologiques" (deux fragments de lamelles et deux racloirs) ait eu lieu dans
l'ensemble daté du Néolithique final supérieur (ensemble 3.1).
Les déchets de débitage (« deb », esquilles, cassons, etc.) sont présents en quantité moindre, excepté
lors de trois périodes d'occupation. Au Bronze ancien (ensemble 2.2), la fréquence de ces restes est
largement supérieure à la catégorie technique, et presque équivalente à celle des produits. L'ensemble
6 voit se répéter un schéma similaire dans la prédominance des déchets de débitage sur les éléments
techniques, alors que l'ensemble 7 possède un taux de restes de débitage presque équivalent à celui des
objets techniques. Les cas des ensembles 2.2 et 6 nous semblent attester clairement d'activités de taille
du silex sur place, au moins en ce qui concerne le Bronze ancien, et peut-être de simple rejet des
déchets pour les périodes chasséennes.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 94 -
Figure 62 : catégories de produits par ensemble stratigraphique (graphique J.-F. Buard).
Ens Catégories de produits
Prod Typo Tech Deb Ind Totaux
1.3 18 2 10 5 0 35
2.1 60 3 23 11 2 99
2.2 25 2 16 21 4 68
3.1 14 4 13 4 1 36
3.2-3.3 37 5 47 24 11 124
4 47 1 27 18 8 101
5 40 0 13 9 5 67
6 21 0 6 12 5 44
7 23 3 19 17 4 66
Totaux 285 20 174 121 40 640
Tableau 24 : effectifs des catégories de produits par ensemble stratigraphique.
Ens Catégories de produits
Prod Typo Tech Deb Ind Totaux %
1.3 51.43 5.71 28.57 14.29 0 100 %
2.1 60.61 3.03 23.23 11.11 2.02 100 %
2.2 36.76 2.94 23.53 30.88 5.88 100 %
3.1 38.89 11.11 36.11 11.11 2.78 100 %
3.2-3.3 29.84 4.03 37.9 19.35 8.87 100 %
4 46.53 0.99 26.73 17.82 7.92 100 %
5 59.70 0.00 19.40 13.43 7.46 100 %
6 47.73 0.00 13.64 27.27 11.36 100 %
7 34.85 4.55 28.79 25.76 6.06 100 %
Tableau 25 : fréquences en ligne des catégories de produits par ensemble stratigraphique.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 95 -
Figure 63 : relations entre le nombre de déchets de taille (deb) et le nombre de supports produits (prod et typo)
par ensemble stratigraphique (graphique J.-F. Buard).
Synthèse
En combinant l’observation de ces différentes catégories, on peut en tirer certaines conclusions sur les
différentes phases d’occupation :
Le Bronze final (1.3) se rapporte à une occupation assez limitée de la grotte, avec une petite activité
de débitage et façonnage sur place. On note une bonne connaissance technique de l’usage du silex.
Le Bronze moyen (2.1) est étonnant du fait du grand nombre de supports retrouvés et des
connaissances techniques des populations, qui ont là aussi effectué une partie du travail sur place.
L’utilisation du silex à cette époque est en général limitée et peu élaborée, l’ensemble examiné ici
démentant cette règle. Il s’agit peut-être d’un particularisme régional, mais la rareté des études pour
les périodes protohistoriques ne permettent pas de comparaisons. On peut considérer les occupations
de l’ensemble 2.1 comme importantes, tant du point de vue de l’intensité d’investissement de l’espace
que du bagage technique des populations.
Le Bronze ancien (2.2) traduit la présence de restes assez nombreux, avec une activité bien délimitée
dans la cavité (zone de travail) et une industrie siliceuse plutôt abondante et investie techniquement.
Les niveaux supérieurs du Néolithique final (3.1) ont livrés des restes peu abondants, et peu
caractéristiques, mais qui attestent d’une exploitation technique des ressources siliceuses.
Les niveaux inférieurs du Néolithique final (3.2 et 3.3) ont livré les vestiges d’occupations
importantes, tant du point de vue de la densité que de la caractérisation. On a pu distinguer une zone
de travail bien délimitée (témoins nombreux et attestant d’un savoir-faire technique), ainsi que
plusieurs outils caractéristiques du début du Néolithique final, avec des influences méridionales et du
nord de la France.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 96 -
Le NMB (4) a livré des silex abondants, déterminant une occupation assez dense de l’abri avec des
schémas techniques et de production d’obédience méridionale, nuancés par des adaptations aux
contraintes régionales.
Le Chasséen moyen (5) a fourni des restes importants, tournés vers la production de supports
laminaires, dont une partie traduit les influences du sud avec la présence de silex blond translucide,
l’ensemble traduisant une occupation assez dense.
Le Chasséen ancien à céramiques du style de Saint-Uze (6 et 7) est peu riche en éléments techniques,
qui attestent toutefois d’un débitage sur place, la production de produits laminaires étant ici aussi
prédominante, avec une part non négligeable d’éclats. Les éléments typologiques confirment
l’appartenance des populations à la sphère chasséenne, avec des variantes peut être attribuables aux
caractères régionaux.
6 - Conclusion
La grotte de l’Abbaye a livré une série assez peu abondante d’industries en silex, qui permet de
compléter la documentation régionale, en général fragmentaire à quelques exceptions près. Les
différents ensembles attestent de fréquentations régulières de l’abri, la plupart du temps par des
groupes humains de taille réduite, mais dont les vestiges techniques révèlent une connaissance des
savoir-faire liés à l’exploitation du silex, aussi bien dans l’utilisation des matières premières locales
(étude en cours) que dans la production d’outils. Le manque d’études régionales approfondies limite
les interprétations pour les périodes protohistoriques, mais le Néolithique moyen et final (ensembles 7
à 3.1) fournit ici des données confirmant certaines idées développées dans d’autres travaux17
, à savoir
une dichotomie d’influences existant dans la culture matérielle des populations du Bugey à ces
époques. Il apparaît en effet que la plupart des tendances morphologiques caractérisant les industries
siliceuses sont originaires du sud et tributaires des schémas chasséens, mais sont pondérées par des
influences venues du nord-est de la France à partir du Néolithique moyen et au début du Néolithique
final (Michelsberg), avec des particularismes dus probablement à l’adaptation des populations aux
possibilités régionales.
7 - Bibliographie
BUARD (J.-F.) ed. ANDRE (I.), HERITIER (L.), JAFFROT (E.), LHEMON (M.), MÜLLER (C.), PATOURET
(J.), PERRET (S.), ROCCA (R.), SARRESTE (F.) collab., 2007. Grotte de l’Abbaye I, Chazey-Bons, Ain.
Rapport de synthèse 2007. Inédit, Service Régional de l’Archéologie, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Rhône-Alpes. 178 p., 130 fig., 25 tableaux.
CAUWE (N.), DOLUKHANOV (P.), KOZLOWSKI (J.), VAN BERG (P.-L.), 2007. Le Néolithique en Europe.
Armand Colin, Paris. 381 p.
FEBLOT-AUGUSTINS (J.), 2005, Flints from the Bugey, http://www.flintsource.net/flint/infF_bugey.html.
INIZAN (M.-L.), REDURON (M.), ROCHE (H.), TIXIER (J.), 1995. Technologie de la pierre taillée. Préhistoire
de la pierre taillée, tome 4. Meudon, C.R.E.P. 199 p., 79 ill.
LEROI-GOURHAN (A.) dir., 1988. Dictionnaire de la Préhistoire. Presses Universitaires de France, Paris. 1288 p.,
16 pl. h.t.
PATOURET (J.), 2006. Essai d’interprétation fonctionnelle pour l’industrie lithique de la couche 58 de la grotte du
Gardon (Ain). Inédit, mémoire de Master 2, Aix-en-Provence, Université de Provence Aix-Marseille I, 89 p., 10
fig., 14 pl.
PERRIN (T.), 2001. Evolution du silex taillé dans le Néolithique haut rhodanien autour de la stratigraphie du
Gardon (Ambérieu en Bugey, Ain). Inédit, thèse de nouveau doctorat, Paris, Université de Paris I Panthéon
Sorbonne, 3 vol., 665 p., 218 pl., 175 fiches.
17
Perrin 2001.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 97 -
Figure 64 : les silex de la séquence supérieure, éléments choisis (dessins J. Patouret).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 99 -
CHAPITRE VI
L'industrie osseuse de la grotte de l'Abbaye
Sylvain Ozainne
La séquence supérieure de la grotte de l'Abbaye a livré une petite série de sept outils en os, dont trois
ont été découverts par J. Reymond lors de ses fouilles réalisées dans les années 1960. Les pièces sont
décrites dans les paragraphes suivants par phase d'occupation, de la plus ancienne à la plus récente.
1 - NMB (Ensemble 4)
Trois outils en os ont été attribués au NMB (Ot1, Ot2 et Ot7). Deux d'entre eux (Ot2 et Ot7) sont des
pointes sur épiphyse en poulie (PEP). Le support d'Ot2 est un métapode de gros capriné, et Ot7 a pu
être attribué plus précisément à un métacarpien de capriné domestique18
. Les deux pièces ont été
obtenues selon une chaîne opératoire identique, avec un débitage par rainurage longitudinal, puis un
façonnage par polissage. Ot7 montre également des traces d'abrasion plus grossière sur la face interne,
relevant également d'opérations de façonnage, ainsi que des traces de polissage sur son extrémité
distale, indiquant un réaffutage de la pointe. La pointe Ot2 a été fracturée près de son extrémité
proximale, probablement lors de son usage, tandis que Ot7 n'est cassée qu'à son extrémité distale. Une
pièce hors contexte (Ot6) issue des fouilles Reymond et attribuée à un "Néolithique moyen probable"
peut être rapprochée des deux outils attribués au NMB. Il s'agit d'une autre PEP aménagée sur un
métacarpien de capriné domestique, également débitée par rainurage longitudinal et façonnée par
polissage. Elle montre en outre des traces de raclage correspondant à un réaffutage de la pointe,
l'extrémité de cette dernière étant par ailleurs esquillée. La pièce Ot6 peut raisonnablement être
considérée comme issue d'un horizon chasséen.
Les PEP sur métapodes de capriné évoquent en effet clairement le Chasséen méridional, dont elles
constituent le type d'outil le plus représentatif dans le sud-est de la France et dans le massif central
(Sénépart 1992, Bazzanella 1995). Les PEP sur métapodes de petits ruminants sont également très
bien représentées dans le Cortaillod de Suisse occidentale, jusqu'en Valais à Saint-Léonard, où elles
témoignent de l'importance des influences chasséennes jusque dans la Haute-Vallée du Rhône
(Winiger 2009). Dans un contexte géographique plus immédiat, on connaît également plusieurs PEP
sur métapode de capriné dans les niveaux du NMB récent de la grotte du Gardon (3800-3600 av. J.-C),
où elles sont considérées comme représentatives d'un substrat chasséen lié à la proximité du couloir
d'influences sud-nord entre chasséen méridional et septentrional (Ozainne à paraître). Les PEP sont
toutefois généralement assez discrètes dans le NMB jurassien, et ne sont représentées que par quelques
exemplaires à Clairvaux (Motte-aux-Magnins niveau V, Voruz 1989).
L'industrie osseuse du NMB de l'Abbaye se distingue en outre par la présence d'une pointe sur
épiphyse (PED) légèrement déjetée, aménagée sur l'extrémité distale d'une fibula de suidé,
vraisemblablement du porc. Elle présente un aspect lustré et est presque intégralement façonnée par
polissage, lequel a peut-être été précédé par une opération de raclage ; aucune trace de débitage ne
subsiste. La pointe a été cassée très près de son extrémité distale. L'attribution culturelle de cet outil
très particulier demeure problématique. On connaît un objet quasiment identique dans la couche 43 de
la grotte du Gardon, elle-même attribuée à un NMB moyen-récent compris entre 3900 et 3700 av. J.-
18
Les déterminations ont été effectuées par Patricia Chiquet au Département d'anthropologie de l'Université de Genève.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 100 -
C., (Ozainne à paraître, Rey 2008). Cet outil a également été réalisé sur un distum de fibula de jeune
suidé, probablement du porc19
, et presque entièrement façonné par polissage ; sa pointe a été réaffutée
par raclage et cassée très près de son extrémité distale. De par leur morphologie et leur façonnage, les
deux pointes de l'Abbaye et du Gardon évoquent les PEF (E)20
définies par I. Sénépart (1992) dans le
Sud-Est de la France, plus particulièrement dans le Var, à la Fontbrégoua et à la Grotte de l'Eglise
supérieure. En revanche, les supports sur suidé sont totalement absents du corpus chasséen du Sud-Est
de la France (Sénépart 1992). Dans un contexte nettement plus septentrional, on connaît par contre des
pointes sur fibula de porc dans le bassin parisien dès le Villeneuve-Saint-Germain à Jablines, puis dans
le Post-Rössen de Berry-au-Bac "Croix Maigret" (Aisne) et le Chasséen de Catenoy (Oise) (Sidéra
2000). Sur le plateau suisse, il faut aussi signaler quelques outils assez proches mais beaucoup plus
courts que ceux de l'Abbaye et du Gardon, notamment une pointe sur fibula de suidé dans le Cortaillod
classique d'Auvernier-Port (Murray 1982), et un type comparable de pointe sur proximum de fibula
dans le Cortaillod classique de Montilier/Fischergässli (Ramseyer et al. 2000). Toujours en Suisse
occidentale, les pointes sur distum de fibula de suidé semblent d'ailleurs persister dans le Horgen et le
Lüscherz, comme l'attestent plusieurs pièces à Yvonand 4 (Voruz 1984).
2 - Néolithique final supérieur (Ensemble 3.11)
Un outil a été attribué au Néolithique final supérieur. Il s'agit d'une PEP aménagée sur métatarsien de
petit ruminant (Ot3). Elle a été débitée par rainurage longitudinal et fracturation, puis façonnée par
polissage. Elle présente des cassure à ses deux extrémités, et sa "poulie" est donc absente. Il est
difficile de proposer une attribution culturelle précise pour cet unique outil. Les PEP perdurent en effet
d'une manière générale dans le Néolithique récent et final. Dans le sud-est de la France, elles sont en
baisse mais toujours présentes dans le Fontbouisse, tandis qu'elles disparaissent dans le Couronnien
(Sénépart 1992). Les PEP sur métapode de petit ruminant débitées par rainurage longitudinal
persistent également dans le Jura, notamment à Chalain 3 et 4 (Voruz 1997 ; Maigrot 2003). Leur
présence à Chalain 3 est d'ailleurs considérée comme une affinité avec le Cortaillod et le NMB (Voruz
1997 : 474). Sur le plateau suisse, les PEP sur métapodes de petits ruminants régressent à partir de la
fin du Cortaillod, et sont nettement moins représentées dans le Horgen, le Lüscherz et l'Auvernier
(Voruz 1984 ; Ozainne 2003). On observe alors au contraire le développement de pointes plus longues
et plus larges aménagées sur des épiphyses de grands ruminants.
3 - Pièces hors contexte
Trois pièces associées au travaux de J. Reymond n'ont pas d'attribution chrono-stratigraphique précise.
Parmi elles, une PEP (Ot6) dont il a déjà été question plus haut peut être rattachée au NMB. Une
pointe sur épiphyse diverse (PED) aménagée sur l'extrémité proximale d'un métatarsien de petit
ruminant, débitée par abrasion puis rainurage et façonnée par polissage, peut aussi être rapprochée
d'une contexte chasséen régional (Ot4). En effet, cette pièce correspond vraisemblablement à la
récupération d'une chute de débitage de PEP par abrasion puis rainurage. Si l'usage de l'abrasion est
quasiment absent dans le chasséen du sud-est de la France et du massif central, où le rainurage
longitudinal est le plus souvent utilisé seul, l'association de ces deux techniques est nettement plus
importante dans le Cortaillod du plateau suisse, comme à Auvernier ou Montilier (Murray 1982 ;
Ramseyer et al. 2000). La même association se retrouve mais de façon plus discrète dans le Valais, à
Saint-Léonard (Winiger 2009). Ces quelques indices restent insuffisants pour attribuer
catégoriquement l'objet Ot4, qui relève toutefois vraisemblablement d'un contexte chasséen local. Le
troisième outil non attribué (Ot5) se démarque assez nettement du reste de la série. Il s'agit d'une PED
sur radius de bœuf, débitée par fracturation puis façonnée par polissage et peut-être raclage. Les PED
sur radius sont de manière générale un objet rare, à considérer plutôt comme "outil d'économie",
fabriqué de façon opportuniste en fonction des restes de faune exploitables. Dans le Néolithique final
du sud-est de la France, on constate toutefois une augmentation de l'utilisation du bœuf dans l'industrie
osseuse, et en même temps une diversification des supports tirés de cet animal, auparavant surtout
exploité pour ses esquilles (Sénépart 1992). On connaît ainsi l'existence d'outils sur radius de bœuf
19
Les déterminations de l'industrie du Gardon ont aussi été effectuées par Patricia Chiquet. 20
Pointe Entièrement Façonnée (Etroite).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 101 -
dans le Fontbouisse (Sénépart 1992 : 256). L'utilisation de radius, toutes espèces confondues, semble
en revanche beaucoup plus anecdotique voire inexistante dans le Néolithique final de Suisse
occidentale et du Jura (Voruz 1984, 1997 ; Ozainne 2003). Le débitage par fracturation constitue un
autre point commun avec le Néolithique final du sud-est de la France, au cours duquel les techniques
de débitage se simplifient et la percussion atteint un rôle prépondérant en étant souvent associée au
polissage (Sénépart 1992). La fracturation est aussi bien représentée dans l'ouest de la Suisse dès le
Cortaillod (Murray 1982). Ces quelques éléments demeurent donc insuffisants pour proposer une
attribution plus précise pour la pièce Ot5.
4 - Synthèse
Malgré la modestie de son corpus, l'industrie osseuse de la séquence supérieure de la grotte de
l'Abbaye reflète majoritairement la sphère chasséenne, puisqu'elle est essentiellement représentée par
de petites pointe sur épiphyse en poulie de petits ruminants domestiques. En revanche, elle semble se
trouver à l'écart du contexte NMB jurassien observable à la grotte du Gardon, qui, bien qu'intégrant
aussi d'indiscutables éléments issus du Chasséen méridional, se caractérise essentiellement par
l'aménagement d'outils longs sur des métapodes de cerf débités par rainurage longitudinal, un type de
support totalement absent à l'Abbaye. Paradoxalement, la PED sur fibula de suidé constitue un lien
indiscutable entre les industries du Gardon et de l'Abbaye. Ce type d'outil pourrait correspondre à une
particularité régionale (extrémité sud du Jura et Plateau suisse), possédant d'éventuelles origines
septentrionales et se retrouvant dans la région approximativement à partir de 3800 av. J.-C. (Ozainne à
paraître). La PEP de l'ensemble 3.11, seul outil véritablement attribué au Néolithique final supérieur,
est en revanche plus difficile à intégrer dans un contexte plus large. Elle représente en effet un
probable héritage du Chasséen, qui a généralement tendance à disparaître au Néolithique final. La
PED sur radius de bœuf issue des fouilles Reymond, bien que pouvant par certains aspects être
rapprochée du Néolithique final du sud-est de la France, ne peut quant à elle que difficilement être
intégrée à la discussion. En dehors de son statut hors contexte, elle pourrait en effet relever d'une
fabrication occasionnelle et constitue un type d'outil très rare tout au long du Néolithique du Jura et de
Suisse occidentale.
Pour conclure, l'industrie osseuse de la grotte de l'Abbaye présente plus d'affinités avec le Chasséen
que le NMB au début du 4ème
millénaire av. J.-C. Le rapport indéniable que l'on peut tisser dans une
fourchette chronologique très proche avec la grotte du Gardon, quant à elle pourtant beaucoup plus
proche du NMB, révèle que l'on assiste peut-être à cette période au développement de particularités
régionales.
5 - Bibliographie
Bazzanella (M.). 1995. L'industrie osseuse de Cormail dans le Massif Central (Haute-Loire, France). Genève :
Département d'anthropologie et d'écologie de l'Université (Mémoire de certificat de spécialisation en archéologie
préhistorique).
Maigrot (Y.). 2003. Etude technologique et fonctionnelle de l'outillage en matières dures animales : la station 4 de
Chalain (Néolithique final, Jura, France). Besançon : Université de Franche-Comté. (Thèse de doctorat).
Murray (C.). 1982. L'industrie osseuse d'Auvernier-Port : étude techno- morphologique d'un outillage néolithique et
reconstitutions expérimentales des techniques de travail. Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales
(Travail de diplôme : EHESS).
Ozainne (S.). 2003. L'industrie osseuse du Néolithique final de Delley-Portalban II (Fribourg). In : Besse (M.), Stahl
Gretsch (L.-I.), Curdy (P.), eds. ConstellaSion : hommage à Alain Gallay. Lausanne : Cahiers d'archéologie
romande, 95, 193-205.
Ozainne (S.). A paraître. L'industrie en matières dures animales des couches 46 à 38. In : Perrin (T.) & Voruz (J.-L.)
eds. Archéologie de la grotte du Gardon (Ambérieu-en-Bugey, Ain). Volume 2. Du Néolithique moyen II au
Bronze ancien (couches 46 à 33). Ed. Archives d'Ecologie Préhistorique, Toulouse.
Ramseyer (D.), ed., &, Affolter (J.), Augereau (A.), Billaud (Y.), Hurni (J.-P.), Morel (P.), Orcel (C.), Reinhard (J.),
Richard (H.), Sidéra (I.), Tercier (J.), collab. 2000. Muntelier / Fischergässli : un habitat néolithique au bord du
lac de Morat (3895 à 3820 avant J.-C.). Fribourg : Editions universitaires. Archéologie fribourgeoise, 15.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 102 -
Sénépart (I.). 1992. Les industries en matière dure animales de l'Epipaléolithique au Néolithique dans le Sud-Est de
la France. 3 vol. Paris : Université de Paris X. (Thèse de doctorat de 3e cycle).
Sidéra (I.). 2000. Animaux domestiques, bêtes sauvages et objets en matières animales du Rubané au Michelsberg :
de l'économie aux symboles, des techniques à la culture. Gallia préhistoire, 42, 107-194.
Voruz (J.-L.). 1984. Outillages osseux et dynamisme industriel dans le Néolithique jurassien. Lausanne :
Bibliothèque historique vaudoise. Cahiers d'archéologie romande, 29.
Voruz (J.-L.). 1989. L'outillage en os et en bois de cerf. In : Pétrequin (P.), ed. Les sites littoraux néolithiques de
Clairvaux-les-Lacs (Jura), 2 : le Néolithique moyen. Paris : Editions de la Maison des sciences de l'homme.
Archéologie et culture matérielle, 313-348.
Voruz (J.-L.). 1997. L'outillage en os et en bois de cerf de Chalain 3. In : Pétrequin (P.), ed. Les sites littoraux
néolithiques de Clairvaux-les-Lacs et de Chalain (Jura), 3 : Chalain station 3 (3200-2900 av. J.-C.), vol. 2. Paris :
Editions de la Maison des sciences de l'homme. Archéologie et culture matérielle, 467-510.
Winiger (A.). 2009. Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse) : fouilles
Sauter 1956-1962. Lausanne : Cahiers d'archéologie romande, 113.
N° US Phase Contexte Type Support anatomique Espèce Débitage Façonnage
Ot01 4 NMB Ens.4: horizon E12 P ED Fibula (extr.dist. non épiphysée)
Suidé (porc?) Ind (Racl?)+pol
Ot02 4 NMB Ens.4: horizon E12 P EP Métapode (plutôt métatarsien)
Capriné (capra sp.) Rain long Pol
Ot03 3.1 Néolithique final sup
Ens. 3.1: horizon F12-F31-F42-E13 P EP
Métatarsien (extr.dist. épiphysée)
Petit ruminant (plutôt capriné)
Rain long+frac Pol
Ot04 0.32 Remblais Reymond P ED
Métatarsien droit (extr. prox)
Petit ruminant
Abr+Rain long+frac Pol
Ot05 0.31 Fouilles Reymond P ED L
Radius gauche (extr.prox.) Bœuf Frac (Abr?) Pol (+racl?)
Ot06 0.31 Fouilles Reymond
Néolithique moyen probable P EP
Métacarpien (extr. dist.épiphysée)
Capriné domestique Rain long Pol+racl
Ot07 4 NMB Ens.4: horizon E12 P EP Métacarpien (extr. dist.épiphysée)
Capriné domestique Rain long Pol+abr
Tableau 26 : contexte et caractéristiques typo-techniques de l'industrie osseuse de l'Abbaye. Types : PED =
pointe sur épiphyse diverse ; PED L= Pointe sur épiphyse diverse large ; PEP= pointe sur épiphyse en poulie.
Débitage : Rain long= rainurage longitudinal ; Frac= fracturation ; Abr= abrasion. Façonnage : Racl=
raclage ; Pol= polissage ; Abr= Abrasion.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 103 -
Figure 65 : outils attribués aux niveaux du NMB (Ot1, Ot2 et Ot7) et du Néolithique final supérieur (Ot3). Ot1 :
PED sur distum de fibula de suidé (probablement du porc). Ot2 : PEP sur métapode de gros capriné. Ot7 : PEP
sur métacarpien de capriné domestique. Dessins Sébastien Perret.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 104 -
Figure 66 : outils hors contexte issus des fouilles Reymond. Ot4 : PED sur extrémité proximale de métatarsien
de petit ruminant. Ot5 : PED sur radius de bœuf. Ot6 : PEP sur métacarpien de capriné domestique. Dessins
Sébastien Perret.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 105 -
CHAPITRE VII
La faune de la séquence supérieure de la Grotte de l’Abbaye à Chazey-Bons
(Ain, France)
par Patricia Chiquet
1 - Introduction
Le présent document prend en compte l’ensemble des restes fauniques issus de la séquence supérieure
de la grotte de l’Abbaye, soit près de 8000 restes de vertébrés, dont plus de 1000 ont été identifiés. Ces
vestiges se trouvent associés à une dizaine d’ensembles stratigraphiques, qui représentent presque 5
millénaires d’occupations s’échelonnant entre le Néolithique moyen et l’époque romaine. L’analyse
d’un tel matériel peut sembler de prime abord de portée limitée, compte tenu du fait que chaque niveau
d’occupation dispose d’effectifs relativement modestes. Ce corpus offre pourtant l’occasion de saisir
sur le long terme, certains modes d’exploitation du monde animal mis en œuvre au cœur d’une vallée
de faible altitude.
2 - Observations générales
Nous n’avons pas cherché à exploiter les analyses préliminaires et ponctuelles entreprises entre 1994
et 1997 par I. Chenal-Velarde (voir Buard 1997, Buard et al. 1994, 1995), dans la mesure où celles-ci
ne tenaient pas compte des dernières corrélations stratigraphiques, mises au point définitivement en
1998. Nous avons dû concevoir une analyse globale mais relativement succincte, afin de pouvoir
répondre d’une part à la volonté de connaître la liste des espèces présentes à la grotte de l’Abbaye au
cours de chacune des occupations successives, d’autre part à des impératifs de temps. Pour ce faire,
nous nous sommes limitée à une identification anatomique et spécifique des restes, en faisant souvent
l’impasse, sur bon nombre d’aspects comme l’estimation de l’âge et du nombre minimum d’individus
représentés sur le site, l’approche ostéométrique ou encore l’analyse fine de la distribution spatiale des
ossements. Malgré cela, nous avons cherché dans la mesure du possible à restituer l’économie animale
mise en place sur le site dans une perspective diachronique.
La détermination des ossements s’est déroulée au Muséum d’histoire naturelle de Genève, à l’aide de
la collection de comparaison du Département d’archéozoologie. L’enregistrement des pièces s’est
effectué par m2 et décapage, pour chaque ensemble chronologique. A propos des décomptes de restes,
la totalité des restes osseux a été inventoriée, excepté pour l’occupation romaine (ens.1.1) et celles du
Bronze moyen (ens.2.1) et ancien (ens.2.2). Pour ces dernières, les restes identifiables ont été isolés et
enregistrés, tandis que le nombre d’esquilles indéterminées a simplement été estimé sur la base de
décomptes produits à la fouille (doc. J.-F. Buard). Ces pièces apparaissent dans les tableaux sous le
terme « indéterminés estimés ». Après quelques tests, cette manière de faire, induite par des impératifs
de temps, nous a parue satisfaisante.
L’analyse archéozoologique concerne 7772 vestiges osseux représentant près de 9 kg de matériel. La
majeure partie des pièces sont en fait des esquilles de taille millimétrique recueillies lors du tamisage
systématique des sédiments. L’identification des vestiges s’est avérée relativement ardue, du fait d’une
part de cette fragmentation intense des vestiges, dont rend bien compte un poids moyen des restes d’à
peine 1.1 g (Figure 67), d’autre part de la présence d’un voile de calcaire grisâtre qui se développe
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 106 -
plus ou moins intensément autour d’un grand nombre d’ossements. Ces concrétions ainsi que certaines
altérations affectant parfois la surface des os entravent l’observation de la morphologie des os et
empêche dans bien des cas la lecture des éventuelles traces, notamment anthropiques.
Moins d’une cinquantaine de traces de découpe ont du reste été répertoriées et touchent presque
exclusivement les espèces domestiques. Les marques de dents s’apparentant à des carnivores et dans
certains cas à des rongeurs sont rares elles aussi puisqu’elles concernent moins d’un pourcent des
vestiges. On peut par contre estimer que les traces de feu affectent près d’un dixième des restes,
presque exclusivement des esquilles minuscules (poids moyen 0.3 g).
Le matériel, recueilli sur une surface d’un peu moins de 50 m2, se distribue de façon très inégale entre
les ensembles, avec notamment deux ensembles nettement plus riches que les autres (Figure 68 et
Figure 69). Malgré le nombre important de restes et la relativement bonne conservation de la matière
osseuse, peu de restes ont finalement été identifiés. Le taux de restes déterminés au niveau de l’espèce
ou du genre s’élève à 13% seulement du nombre total de restes, avec des valeurs qui oscillent entre
7% et 19% selon les ensembles. Cela correspond toutefois à 59% du poids total des restes avec des
extrêmes de 32% et 82%.
Malgré un taux d’identification au niveau de l’espèce ou du genre (y compris les caprinés) qui dépasse
rarement 15% et qui accompagne un poids moyen des vestiges compris entre 0.7 et 1.4g, le spectre
apparaît fort varié puisque l’on compte pas moins de 16 mammifères identifiés, sans compter plusieurs
micromammifères (écureuil, taupe, loir, mulot, chauve-souris etc.), diverses espèces d’oiseaux dont le
coq domestique, une tortue d’eau douce, un poisson et des amphibiens.
Les remontages n’ont pas été recherchés de façon systématique, mais presque toujours observés de
façon aléatoire, au moment de l’ouverture des sachets de conditionnement ou de l’identification. C’est
pourquoi ces liaisons s’établissent presque toujours à courte distance et au sein d’un même ensemble.
Elles sont présentes tout au long de la séquence, principalement dans les secteurs centraux. Nous en
avons observé une cinquantaine auxquels participent 159 restes osseux. La moitié de ces vestiges sont
impliqués dans 30 unités de collages, l’autre moitié dans 18 unités de remontages de type connexion
ou appariement.
Notons encore que l’industrie osseuse- il s’agit d’une quinzaine de pièces- n’est pas présentée ici
puisqu’elle fait l’objet d’une étude à part entière (Ozainne étude en cours). Les pièces figurent
néanmoins entre parenthèse dans les tableaux de décompte, de façon à pouvoir évaluer par exemple si
les ressources disponibles sur le site sont une variable déterminante dans le choix des supports
d’industrie.
Une trentaine d’ossements humains ont également été mis au jour parmi la faune du Néolithique final,
du Bronze moyen et du Bronze final. Ces pièces viennent enrichir de façon notable le corpus des
données anthropologiques (Desideri, ce volume).
S’agissant de la première publication des données, nous avons pris le parti dans un premier temps de
ne pas regrouper les ensembles mais de les présenter individuellement, en respectant le sens
chronologique. Une brève synthèse des résultats est proposée. Elle se focalise sur l’exploitation des
animaux à la grotte de l’Abbaye et tente d’en saisir les éléments les plus marquants de la séquence.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 107 -
3 - Description des ensembles
Chasséen ancien/Saint-Uze (ensemble 7.1 et 7.2, 4300-4000 av. J.-C.)
L’ensemble 7, considéré comme le niveau le mieux conservé et le plus structuré de la séquence, a livré
près de 700 restes dont une petite centaine a été identifiée au niveau de l’espèce, de la catégorie
d’espèces (caprinés) ou du genre. Les restes déterminés représentent 14 % du nombre total de restes et
82 % du poids correspondant (Figure 68 et Figure 69). Ces taux traduisent entre autres la présence
d’un grand nombre d’esquilles millimétriques indéterminables. Le poids moyen des restes est en sens
également très parlant, puisqu’il s’élève à 8 g pour les restes déterminés et atteint à peine 0.3 g en ce
qui concerne les indéterminés (figure 1).
Les ruminants domestiques, petits et grands, dominent le spectre (Tableau 27), tandis que la faune
sauvage témoigne d’une diversité qui ne sera plus égalée par la suite. Parmi les caprinés domestiques,
seul le mouton est attesté. Un tibia complet et totalement épiphysé a été attribué à un sujet adulte âgé
de plus de 3.5 ans. La taille au garrot de l’animal est estimée à 59.8 cm (Teichert 1975). Le mouton est
également à l’origine de deux fragments d’os frontaux, dont un appartient à un animal âgé de quelques
mois. La tête chez les caprinés est essentiellement figurée par des dents de chute, c’est-à-dire des dents
de lait tombées au moment du changement dentaire. Ce genre de découverte se rapporte exclusivement
aux caprinés dans cet ensemble, exception faite d’une dent de chute de cerf qui sera évoquée un peu
plus loin. Il témoigne de la présence d’animaux vivants au sein de l’abri. Nous reviendrons sur cette
question un peu plus loin. Les autres ossements de caprinés sont majoritairement des vertèbres
cervicales et quelques thoraciques appartenant à deux individus au moins et dont certaines étaient
peut-être en connexion.
Le bœuf est presque exclusivement représenté par des restes dentaires et crâniens, qui proviennent des
mètres MNOP/13-15 et paraissent appartenir au même crâne. Il s’agit d’un sujet adulte, âgé entre 4 et
6.5 ans. Un fragment d’os hyoïde découvert à proximité porte des traces de découpe très nettes, signe
que la langue a été détachée et donc que la tête a certainement été préparée (pl. 1, n°1).
Les ossements de suidés sont dispersés dans le même secteur. Un occipital complet se rapporte à un
sujet mort peu après la naissance. La plupart des autres vestiges correspondent à un second individu
âgé entre 6 et 12 mois. Une incision a été enregistrée sur un fragment de crâne (basi-occipital), en
relation à notre avis avec le détachement de la tête. (pl. 1, n°2). L’absence d’ossement dont la
croissance est achevée nous interdit d’attribuer les restes de suidés à une forme plutôt qu’à l’autre
(domestique/sauvage).
Reconnu également au Bronze moyen (ens. 2.1), le chevreuil (Capreolus capreolus) fait une timide
apparition à travers un fragment de métatarsien. Le cerf (Cervus elaphus) est lui aussi fort discret,
puisqu’il se manifeste exclusivement sous la forme d’une troisième molaire lactéale. Fait tout à fait
intéressant, il apparaît en fait sous la forme d’une dent de lait de chute, ce qui laisse entendre que
l’animal a su profiter de l’abri à un moment donné, très certainement à l’insu de l’homme. Sa présence
y est en tout cas assurée au cours de la belle saison, soit au moment du changement dentaire qui
s’effectue à l’âge d’environ deux ans (Habermehl 1985). Un minuscule fragment de bois de cervidé
brûlé a également été mis au jour dans cet ensemble.
Les restes de blaireau (Meles meles) se rapportent à deux sujets adultes. Quatre des cinq ossements
sont issus des mètres M/14-15 et pourraient appartenir au même sujet, un animal âgé d’après l’usure
importante observée sur une paire de mandibules. La martre (Martes martes) est attestée à une reprise.
La présence du lièvre brun (Lepus europaeus) est assurée. La morphologie d’une extrémité proximale
de radius s’apparente en effet très clairement à celle du lièvre (Callou 1997). L’écureuil (Sciurus
vulgaris) et le hérisson (Erinaceus europaeus) sont chacun représentés par un fragment d’os long et
issus tous deux du même m2 (L15).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 108 -
L’ensemble 7 est le seul à livrer une vertèbre incomplète de poisson (non identifiable) ainsi que les
restes d’une tortue (MNP15-16). Il s’agit ici d’une tortue d’eau douce, la cistude d’Europe (Emys
orbicularis). Ce reptile possède une carapace formée de plusieurs plaques osseuses recouvertes
d’écailles. La carapace est divisée en deux parties, la dossière (dorsal) et le plastron (ventral). Nous
disposons ici d’une scapula et de cinq fragments de plastron dont quatre remontent et forment un
fragment du xiphiplastron, tandis qu’un autre fragment est issu de l’hypoplastron (pl. 1, n°3). Cet
animal, dont la présence est en relation avec un milieu aquatique à régime lent, de type étang ou
rivière à fond vaseux, mais parfois aussi dans des torrents, est attesté dans d’autres gisements du
Néolithique, sous la forme d’éléments de carapace uniquement (Deschler-Erb et Marti-Grädel 2004,
Becker et Johansson 1981). C’est notamment le cas à la grotte du Gardon dans des niveaux du
Néolithique ancien (c.58) et moyen (c.48) (Chiquet et Chaix 2009). L’usage fait de la carapace est
inconnu mais on peut facilement comprendre l’attrait d’un tel objet, qu’il s’agisse des écailles ou de
l’ensemble de la carapace. La présence d’une scapula à la grotte de l’Abbaye pourrait indiquer qu’une
partie au moins du corps de l’animal a également été apporté, peut-être en vue d’être consommé. Un
tel usage est du reste attesté durant l’Holocène (Royer 2008).
Le canard colvert (Anas plathyrrhyncos), autre animal étroitement lié à un milieu aquatique, semble à
l’origine de trois fragments osseux (mandibule, furcula et ulna). Ces restes proviennent du secteur
IJK/16-17, où sont également visibles plusieurs ossements de rongeurs, de batracien et de lièvre. Dans
ce secteur, les autres restes sont essentiellement des esquilles millimétriques ou des ossements de
petits ruminants morts précocement. Il n’est pas exclu que ces divers vestiges soient le fait d’un autre
prédateur que l’homme. En P16, quelques traces de dents attestent en tout cas de la visite de la cavité
par des rongeurs.
Notons encore l’existence de trois atteintes pathologiques, toutes trois reconnues exclusivement chez
le bœuf. La première est un élargissement observé au niveau d’une des éminences articulaires d’un
métapode de bœuf (pl. 1, n°4). Ce genre d’anomalie a tendance à apparaître chez des individus âgés. Il
peut également être le signe d’une importante sollicitation de la musculature de l’animal, par exemple
pour la traction.
Trois molaires de bœuf appartenant au même individu présentent une anomalie au niveau leur surface
masticatoire, cette dernière présentant une usure en dent de scie (pl. 1, n°5). Sont concernées ici la
première et deuxième molaires supérieures gauches et la deuxième molaire inférieure gauche. Le
défaut qui affecte ces dents est probablement occasionné par une gêne qui intervient soit au niveau des
séries dentaires (défaut dans la chute ou l’éruption d’une dent par exemple) soit au niveau des tissus de
soutien de la dent ou de l’os (traumatisme, infection…). Nous avons pu observer un cas comparable
dans la collection de comparaison. Chez le sujet de la collection, l’anomalie est associée à des
inflammations qui intéressent des dents adjacentes et qui sont perceptibles à travers une régression du
bord de leur alvéole. Une autre atteinte concerne les deux deuxièmes molaires de ce sujet. Ces dents
présentent des striations sur la racine qui pourraient être révélatrices d’un stress (maladie, carence
alimentaire…) survenu lors de la formation des dents (pl. 1, n°6). Il n’est pas impossible non plus que
les deux atteintes décrites soient liées.
Des brûlures ont essentiellement été repérées au niveau des bandes 16-17, là où ont été aménagés trois
foyers (Buard 2007, fig. 103, F27, F37 et F38). Les stigmates les plus intenses sont visibles dans le
secteur IK/16-17, dans lequel ont été reconnus deux des structures (F37 et F38).
La zone ouest (ST/14-17) est fort pauvre en vestiges. Cet espace livre exclusivement des esquilles
osseuses, quelques dents de chute (caprinés et cerf), un bourgeon dentaire, deux ossements de taupe et
un fragment de bois de cervidé brûlé.
Les éléments les moins fragmentés sont localisés au niveau des empierrements E3 et E31 (Buard 2007,
fig. 102, 104 et 110), certainement protégés du piétinement du bétail fréquentant l’abri. Les divers
éléments reconnus dans cet ensemble indiquent une présence humaine relativement discrète ainsi
qu’une utilisation de l’abri par des caprinés domestiques, les deux présences étant sans doute liées. Les
empierrements visibles dans l’abri matérialisent peut-être des murets en relation avec le parcage de ces
animaux. En ce qui concerne les espèces sauvages, elles illustrent avant tout une fréquentation du site
par la faune environnante.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 109 -
Chasséen ancien/Saint-Uze (ensemble 6)
Cet ensemble dont l’insertion chronologique demeure en discussion fournit un corpus tout à fait réduit,
avec une vingtaine d’ossements identifiés, principalement des restes de caprinés (Tableau 27). Des
vestiges brûlés sont présents aux alentours du foyer F28 (Buard 2007, fig. 95), tandis que cinq dents de
chute de caprinés ont été observées dans les bandes 16-17.
Parmi les cinq unités de collage identifiées, deux liaisons s’effectuent avec l’ensemble 5, une autre
avec l’ensemble 7. Toutes trois sont recensées dans les mètres NO/14-15, suggérant dans ce secteur
quelques interférences stratigraphiques entre des décapages directement superposés, certainement liées
à la présence d’empierrements.
Chasséen moyen (ensemble 5, 4000-3800 av. J.-C.)
Le matériel consiste comme précédemment en de nombreuses esquilles osseuses indéterminées, d’où
un poids moyen global d’à peine 1g et un taux d’identification au niveau de l’espèce, du genre ou de la
catégorie d’espèces (caprinés) qui ne dépasse pas 10% du nombre total des restes. Le contenu de cet
ensemble se distingue de celui du Chasséen ancien/Saint-Uze (ens. 7), par une contribution bien
moindre des caprinés qui se fait au profit du bœuf et des suidés (Tableau 27). Cette différence est
délicate à interpréter, compte tenu de la faiblesse des effectifs. Il faut néanmoins souligner la présence,
dans un même m2 (N15), de plusieurs éléments d’un même maxillaire appartenant à un boeuf âgé
entre 2 et 3 ans. La dislocation du maxillaire a sans aucun doute eu tendance à accentuer le rôle de cet
animal, en termes d’effectif en tout cas. Dans cet ensemble, les restes de boeuf se répartissent en fait
en deux zones, avec la découverte également de divers ossements de veau en JK/15-17. Pour la
première fois, une dent de lait de chute a été attribuée au bœuf. En ce qui concerne les caprinés, ils
fournissent la presque totalité des dents de chute, à l’instar de ce qui s’observe dans les ensembles 7 et
6. La chèvre est pour la première fois attestée aux côtés du mouton. Les suidés sont essentiellement
représentés par des dents et des fragments de mâchoires. D’après l’état d’éruption et d’usure dentaire
(Habermehl 1975), ces vestiges se rapportent à trois sujets au minimum, soit un jeune âgé entre 1 et 2
mois, un autre âgé d’environ 6 mois et un troisième ayant un an environ.
Quant à la faune sauvage, elle est discrète mais témoigne ici aussi d’une certaine diversité
taxinomique. Le blaireau, la martre et le lièvre sont à nouveau présents, tandis que l’ours fait sa
première apparition. Un fragment de crâne paraît se rapporter à un canard du genre Anas, à l’instar de
ce qui a été observé dans l’ensemble 7.
Pour la seconde et dernière fois au sein de la séquence supérieure, un fragment de bois de cervidé
pesant moins d’un gramme a été identifié. Le fait qu’il soit issu du même mètre que celui de
l’ensemble 7 (S16), du décapage directement sus-jacent et qu’il soit lui aussi calciné, indique à notre
avis la possibilité d’un déplacement vertical pour l’une des deux pièces.
Les restes brûlés ont été reconnus principalement en LP/16-17, soit aux environs des foyers F19 et F24
(Buard 2007, fig. 94). Un tiers des stigmates a néanmoins été observé dans les bandes ST, alors
qu’aucune structure de combustion n’y a été relevée. Plusieurs vestiges, dont l’un d’eux mesure 3 cm
de long, portent les marques de leur passage dans un tube digestif, signe de la fréquentation du site par
un grand carnivore (pl. 1, n°7). De tels stigmates ont été pressentis dans d’autres niveaux mais jamais
de façon aussi claire.
A propos des quelques remontages observés dans ce niveau, deux méritent notre attention. Le premier
mobilise deux fragments de canine d’ours trouvés dans deux mètres contigus (O16 et P16), l’un issu
de l’ensemble 5, l’autre de l’ensemble sus-jacent (ens. 4). La seconde liaison s’établit entre les
ensembles 5 et 6 et concerne les deux moitiés d’un radius de blaireau (O14 et 15). Cet animal
enregistre également en M15 un appariement entre deux mandibules appartenant à un vieil individu, et
une connexion possible entre un fragment d’humérus et le radius évoqué ci-dessus. La présence
d’empierrements explique à notre avis à nouveau ces interférences. La séparation entre les ensembles
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 110 -
5 et 6 n’a du reste pas toujours été évidente à la fouille. En 2007, J.-F. Buard proposait du reste de les
considérer comme deux moments d’une même occupation.
Certains éléments rapprochent cet ensemble des deux précédents (7 et 6), mais aussi du suivant (4).
Les caprinés témoignent une fois encore de leur présence sur pied dans l’abri.
NMB (ensemble 4, 3800-3650 av. J.-C.)
Cet ensemble a livré 670 restes, en majorité des esquilles indéterminées (Figure 68 et Figure 69). La
tendance observée précédemment tend à perdurer, à savoir une présence du bœuf toujours plus forte
(Figure 70). A propos des suidés, c’est la première fois que nous attribuons un élément à une forme
précise, dans le cas présent au sanglier (Sus scrofa). Il s’agit de l’extrémité distale d’un radius non
épiphysé dont le diamètre transverse distal (DTD) est supérieur à 40 mm. Cette valeur entre en fait
parfaitement dans les marges de variation enregistrées pour le sanglier dans les couches du
Néolithique ancien et moyen de la grotte du Gardon (Chiquet et Chaix 2007, Chiquet à paraître), du
NMB de Clairvaux la-Motte-aux-Magnins V (Chaix 1989). Elle dépasse largement celles dont on
dispose pour le porc à la même époque dans la région des Trois-Lacs (Chiquet 2012), voire un peu
plus tard à Chalain (Arbogast 1997).
La faune sauvage dont la contribution peut paraître négligeable, se montre à nouveau diversifiée, avec
la présence de plusieurs carnivores (martre, blaireau, ours, renard), du castor et du lièvre. Parmi ces
taxons, seule la martre porte les traces indubitables de son exploitation par l’homme. Ce mustélidé est
représenté par une mandibule sur laquelle sont clairement visibles des stries faites au silex lors de
l’écorchage de l’animal (pl. 1, n°8).
Des stries de décarnisation ont également été répertoriées sur la branche montante d’une mandibule de
capriné et un fragment de côte.
Un peu moins d’une centaine d’esquilles brûlées ont été repérées. La plupart des atteintes sont
superficielles. Une cinquantaine de restes se distribuent en ST/15-17, avec un maximum en S/16. Les
autres sont localisés dans les secteurs centraux LP/16-17, soit également vers le fond. Ces divers
éléments sont peut-être en liaison avec des foyers aujourd’hui disparus comme semble le suggérer la
présence de galets chauffés et d’un lambeau de foyer (Buard 2007, fig. 86, F22). Ces brûlures
superficielles peuvent également découler de la mise à feu de fumiers. Le parcage de bétail semble en
tout cas attesté par quelques dents de chute appartenant principalement au bœuf (Figure 72) et
reconnues surtout dans les mètres LMN/15-16. La découverte de la majeure partie de l’outillage
osseux dans ce niveau (Ozainne ce volume) est sans aucun doute en relation avec une occupation
humaine de l’abri qui s’accompagne de certaines activités, comme en témoigne du reste la trace
d’écorchage observée sur une mandibule de martre. Aucun aménagement autre qu’un lambeau de
foyer n’est par contre associé à ce niveau.
Néolithique final, phase inférieure (ensembles 3.2 et 3.3, 3500-3150 av. J.-C.)
Parmi les presque 700 restes osseux attribués à cet horizon, une petite cinquantaine a été identifiée.
Malgré les très faibles effectifs, il semble que les suidés s’imposent cette fois en nombre de restes et
cela se produit au détriment du bœuf (Tableau 27 et 5).
Les restes de suidés sont très fragmentaires - le plus gros pèse à peine 7 g - et issus essentiellement
d’animaux en cours de croissance, voire même de sujets mort-nés. La présence de ces derniers et de
deux dents de chute est à notre avis à mettre en relation avec le maintien de sujets domestiques au sein
de la cavité. Des stries de décarnisation visibles sur un fragment de scapula et une vertèbre thoracique
témoignent de la consommation de ces animaux. Une phalange proximale de bœuf totalement
épiphysée porte également la trace évidente d’un coup, certainement en vue d’en exploiter la moelle.
Cette espèce a également livré plusieurs restes pouvant appartenir à un individu âgé d’environ un an,
c’est-à-dire mort durant les beaux jours. Les restes de caprinés sont presque uniquement des dents ou
fragments de dents isolées ou alors des dents de chute (Figure 70).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 111 -
Les mammifères sauvages ayant pu faire l’objet d’une exploitation par l’homme demeurent discrets.
Ils sont représentés par trois vestiges : un fragment distal de métacarpien de cerf, une première molaire
supérieure de martre ainsi qu’une ulna de hérisson.
Des brûlures sont visibles sur une centaine de pièces (17%), dont plus de la moitié provient des abords
du foyer F21. Cette zone concentre les restes calcinés. Des brûlures superficielles ont par contre été
observées à une trentaine de reprises au niveau des fumiers brûlés et de la zone foyère (Buard 2007,
fig. 81). Dans les deux cas, les brûlures sont accidentelles.
Quelques restes de mulot (Apodemus sp.) suggèrent la présence d’un terrier en O13.
Finalement, l’hypothèse d’une utilisation d’une partie de l’abri comme lieu de parcage est une fois
encore à envisager ici, d’autant que des fumiers brûlés de bergerie ont été identifiés à l’est de la cavité
(Buard 2009, p. 20). D’après la localisation des dents de chute et des restes de sujets périnataux,
l’ouest de l’abri pourrait également avoir été fréquenté par des suidés.
Néolithique final, phase supérieure (ensemble 3.1, 3100-2850 av. J.-C.)
Les restes osseux correspondant à cet ensemble du Néolithique final sont au nombre de 576 (Tableau
27). Les rares ossements identifiés témoignent d’un spectre presque exclusivement constitué
d’animaux domestiques, où les caprinés prennent de l’importance aux côtés des suidés (Figure 70).
L’élevage du bœuf semble en perte de vitesse et cette tendance se poursuit jusqu’à l’Âge du fer. En
termes de poids (Figure 71), le bœuf demeure néanmoins majoritaire tandis que les suidés se montrent
en fait fort discrets, malgré leur prépondérance numérique. Cela tient surtout au fait que les suidés sont
essentiellement représentés par des dents et des restes de sujets immatures, tandis que les caprinés ont
surtout livré des éléments appartenant à des animaux adultes.
Le cerf est une fois encore le seul mammifère sauvage attesté. Il apparaît sous la forme d’une dent de
chute, situation que nous avons déjà rencontré dans l’ensemble le plus ancien de la séquence (ens. 7)
et qui indique qu’un sujet se trouvait dans l’abri au moment où s’est effectué le changement de dent.
La présence de plusieurs ossements de loir en bordure de paroi (L/15-16) peut certainement être mise
en relation elle aussi avec une fréquentation de la grotte par la faune environnante, lorsque les hommes
n’y séjournent pas.
Les restes de caprinés montrent une distribution digne d’être relevée puisqu’ils se concentrent
principalement contre la paroi est (en I16) et que plusieurs paraissent appartenir à un pied postérieur
de jeune chèvre. Dans un mètre adjacent (J17), un maxillaire et une mandibule droites proviennent
d’un même sujet adulte âgé de 3-4 ans. Ces observations indiquent que la concentration de vestiges
observée contre la paroi a gardé une certaine cohésion.
Une quarantaine de vestiges portant des brûlures superficielles a été repérée au même emplacement
(IJK/16-17), qui correspond en fait à celui de l’empierrement E13, interprété comme une zone de
rejets, et à celui de deux foyers (Buard 2007, fig. 79, F18 et F23). Les rares stries de découpe
reconnues dans cet horizon sur quelques esquilles proviennent également de cette zone.
L’ensemble de ces éléments peut se rapporter à des déchets de préparation et de consommation
évacués à un moment donné en direction de la paroi. Il faut toutefois s’interroger sur la raison de la
présence, au même endroit de plusieurs fragments crâniens humains.
Quelques dents de chute de bœuf et de caprinés () dispersées dans la zone de plus forte concentration
de vestiges indiquent pour leur part la présence d’animaux vivants durant la belle saison. L’idée d’un
parcage d’animaux au sein de l’abri est appuyée ici par l’identification de fumiers de bergerie (Buard
2007, Sordoillet 1994).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 112 -
Bronze ancien (ensemble 2.2, 2000-1700 av. J.-C.)
Le matériel de cet ensemble est peu parlant (Tableau 28), avec un taux d’identification d’à peine 8%.
Les ongulés de taille moyenne (suidés et caprinés) apparaissent à nouveau majoritaires en nombre de
restes et la présence du porc est dès à présent assurée. Les suidés sont les seuls à avoir livré quelques
ossements d’un jeune sujet, dans le cas présent un périnatal. Le bœuf est exclusivement représenté par
des restes issus de la tête, dont trois dents de chute et un fragment de maxillaire appartenant à un
animal adulte âgé entre 4 et 6.5 ans. Les caprinés ont surtout livré des dents isolées, des tarsiens et des
fragments de tibia appartenant à des sujets adultes. En ce qui concerne l’exploitation bouchère des
animaux, les stries de désarticulation visibles sur un talus de capriné en constituent l’unique
témoignage.
Le cerf est l’unique représentant de la faune sauvage. Il est attesté ici par une moitié distale de radius
dont l’épiphyse n’est pas soudée, signe que l’os appartient à un sujet en cours de croissance, âgé de
moins de 4 ans (Habermehl 1985).
Un carpométacarpe de coq domestique a été identifié à l’ouest de l’abri (S15). Il s’agit d’un élément
intrusif, puisque la présence de cet oiseau sur le territoire français n’est véritablement assurée qu’à
partir de l’âge du Fer. Cet élément provient à notre avis du niveau d’occupation romaine qui a livré
sept ossements de coq domestique dans le mètre T15 directement adjacent. L’aménagement de la
structure st31 et des foyers alentours durant l’époque romaine est sans doute à l’origine du
déplacement.
Dans ce secteur ont également été mis en évidence des foyers datant du Bronze ancien. Une trentaine
d’esquilles osseuses calcinées y a également été observée.
Bronze moyen (ensemble 2.1, 1500-1300 av. J.-C.)
Il s’agit de l’ensemble le plus riche de la séquence supérieure, avec près de 2000 restes, soit plus de 2
kg de matériel osseux (Figure 68 et Figure 69). Le taux d’identification (Figure 73) ainsi que le poids
moyen des restes (figure 1) sont assez comparables à ceux disponibles pour les occupations
antérieures, avec une baisse toutefois du poids moyen des restes déterminés. Cette tendance, qui va
s’accentuer jusqu’à l’Âge du fer, est probablement lié entre autres à une contribution de plus en plus
réduite du bœuf (Figure 70 et 7).
Les restes déterminés appartiennent dans 98% des cas à des mammifères domestiques (Tableau 28).
Le fait le plus marquant ici réside dans la progression des caprinés, qui a lieu au détriment des suidés
(Figure 70 et 7). D’un point de vue anatomique, l’ensemble du squelette est représenté chez les
principales espèces, avec une prédominance de la tête et des pieds. Les os longs de bœuf sont quasi
inexistants mais cela pourrait très bien être lié à l’intense fragmentation des os qui empêche leur
identification. Les vestiges de caprinés sont dans la moitié des cas des dents isolées. Le mouton et la
chèvre sont attestés. Un fragment de frontal témoigne de la présence d’un mouton acère. En ce qui
concerne les suidés, peu de pièces ont pu être attribuées directement à la forme domestique, du fait de
la fragmentation mais aussi de la forte proportion de jeunes voire de très jeunes sujets. Le chien fait
une timide apparition pour la première fois de la séquence. La mesure prise sur l’extrémité distale d’un
fémur (DTD : 25.5) est comparable à celles dont nous disposons pour les chiens néolithiques du Jura
et du Plateau suisse (par ex. Arbogast 1997, Becker et Johansson 1981, Chiquet 2012) qui sont de
taille moyenne et de constitution gracile (Arbogast et al. 2005).
Pas moins de 33 dents de chute ont été enregistrées, dont une quinzaine appartient à des caprinés,
tandis qu’une dizaine de pièces se rapporte clairement au bœuf (Figure 70, pl. 1, n°9). Quelques pièces
sont issues de suidés. Ces vestiges indiquent que l’abri a accueilli suffisamment longtemps ou
fréquemment des animaux vivants pour qu’au minimum deux suidés, trois bœufs et trois caprinés
procèdent à des changements dentaires. D’après les âges d’éruption des prémolaires définitives
retenues par Habermehl (1975) pour le bœuf, le mouton et le porc, on peut estimer un changement au
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 113 -
printemps voire en été. Pour la chèvre, la chute des molaires de lait s’effectuerait plutôt à l’automne.
On peut donc en conclure que les animaux étaient présents dans la grotte au moins entre le printemps
et l’été, voire jusqu’en automne. La présence de restes de suidés périnataux et même de fœtus est à
notre avis un autre témoignage de l’existence de porcs vivants au sein de l’abri au moment des
naissances, c’est-à-dire plutôt au printemps.
Les espèces sauvages demeurent une fois encore fort discrètes. Le cerf est représenté par un bourgeon
de molaire lactéale, tandis que le chevreuil apparaît sous la forme d’un fragment distal de radius. Le
renard et le chat sauvage livrent eux aussi des restes isolés. Aucune trace d’origine anthropique n’est
visible sur ces os.
Quelques os d’oiseaux appartiennent à un corvidé de la taille de la pie. Un coracoïde d’hirondelle est
également présent. Ces vestiges, localisés tout contre la paroi est, en L20 trahissent à notre avis la
fréquentation du site par un animal prédateur.
Quant aux ossements de batraciens et de micromammifères, localisés exclusivement en S15-17 et
MNO16-17, ils mettent également en garde contre de potentielles perturbations dans ces zones.
Quelques marques de dents notamment de rongeurs ont été observées sur plusieurs os, dont quelques
uns appartiennent aux suidés (pl. 1, n°10). Ces vestiges proviennent du mètre I17 localisé contre la
paroi, au niveau de l’empierrement E10 et illustrent l’intervention d’animaux profitant des déchets.
Moins d’une dizaine de traces de découpe ont été repérées. Certaines stries traduisent une opération de
désarticulation du talon visible au niveau d’un os malléolaire chez un bœuf, d’un naviculaire chez un
petit ruminant. Les incisions profondes et parallèles entre elles observées sur un fragment de coxal de
bœuf au niveau de l’épine sciatique relèvent à notre avis du détachement de l’importante masse
musculaire qui prend assise à cet endroit. Un prélèvement de la langue chez cette espèce est également
attesté sur un élément de l’appareil hyoïdien. La décarnisation a également été enregistrée sur la face
interne de deux côtes (pl. 1, n°11) ainsi que sur les processus transverses de deux vertèbres lombaires
de petits ruminants, une des vertèbres présentant également la trace d’un coup visant une segmentation
de la colonne vertébrale (pl. 1, n°12).
Quelques dizaines d’esquilles millimétriques brûlées plus ou moins intensément ont été observées en
S16, soit précisément à l’emplacement du petit foyer F11. Des restes brûlés sont également présents
vers le fond de l’abri ainsi qu’en MNOP 15-17.
Contre la paroi est ont été identifiés divers vestiges se rapportant aux pieds d’une jeune chèvre, à
l’instar de ce que nous avons observé dans l’ensemble 3.1.
Au terme de ce descriptif, il faut admettre que la grotte a abrité divers animaux domestiques. Il ne
s’agit pas seulement d’une bergerie puisque les bœufs et les suidés y ont également été maintenus sur
pied un certain laps de temps. La présence d’un foyer et de traces de boucherie en relation avec la
consommation de bœuf et de caprinés indique que les hommes ont également séjournés dans l’abri,
peut-être au même moment. Notons encore qu’une dizaine de restes humains se trouvent dispersés
parmi la faune, essentiellement au centre de l’abri et en direction du nord.
Bronze final IIb-IIIa (ensemble 1.3, 1000-850 av. J.-C.)
Cet ensemble a livré 1187 restes osseux (1611.03 g). Il s’agit là du deuxième ensemble le plus riche de
la séquence (Figure 68 et Figure 69). Les espèces domestiques sont une fois encore représentées de
façon massive (Tableau 28). Elles entretiennent des rapports assez semblables à ceux décrits pour
l’ensemble du Bronze moyen, avec une majorité de restes issus des espèces de taille moyenne (Figure
70). Les caprinés (chèvre et mouton) se retrouvent en tête, suivis de près par le porc , tandis que le rôle
du bœuf s’amoindrit nettement, avec un recul qui s’enregistre également au niveau du poids. Le boeuf
détient toutefois encore un rôle comparable aux deux autres taxons, du point de vue du poids des restes
(Figure 71). A propos du sexe des individus, on notera la présence d’une truie adulte et d’une chèvre
ou brebis.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 114 -
Le chien apparaît à différentes reprises. Deux individus ont été identifiés, l’un de taille moyenne,
l’autre nettement plus grand. L’Âge du bronze voit en effet le développement d’individus nettement
plus grands et plus robustes aux côtés du chien de taille moyenne qui est la norme au Néolithique
(Arbogaste et al. 2005). Un radius d’oiseau (O/17) ainsi qu’un fémur (S/17) ont été attribués sans
équivoque au coq domestique (Gallus gallus), à l’aide de la clé d’identification proposée récemment
par Tomek et Bochenski 2009. Trois autres restes (des fragments de bassin, de sternum et d’humérus)
semblent également se rapporter à ce gallinacé, sans certitude toutefois. Les ossements de coq sont ici
encore intrusifs. En effet, certains éléments proviennent des deux seuls secteurs ayant livré des restes
de coq dans les décapages rattachés à l’époque romaine. Une interférence avec le niveau de l’âge du
Fer a du reste également été observée pour la céramique dans le secteur LP/16-17 et mise au compte
d’une faible stratification ou d’un remaniement (Buard 2007, p. 83). Le fait que les ossements de
rongeurs proviennent essentiellement de ces zones pourrait être un indice supplémentaire des
bouleversements ayant pu avoir lieu.
Aucun reste d’ongulé sauvage n’a été déterminé, à l’exception d’une molaire de lait à peine usée
appartenant à un faon. Nous avons par contre reconnu, parmi les restes de carnivores, une phalange de
renard ainsi que deux métatarsiens et un fragment de scapula de chat sauvage. Outre le coq, d’autres
oiseaux ont été identifiés, principalement des passereaux. Certains restes s’apparentent à des corvidés
(Corvidae) de la taille de la pie bavarde, d’autres nettement plus petits à des fringilles (Fringillidae) de
la taille du pinson des arbres ainsi qu’à des grives (Turdidae) de la dimension du merle noir. Un
fragment de tarsométatarse pourrait appartenir à une chouette hulotte (Strix aluco), tandis que la
moitié proximale d’un humérus se rapporte très clairement à une marouette ponctuée (Porzana
porzana). Cet oiseau, dont l’existence est intimement liée à la présence de zones humides, a déjà été
reconnu non loin de là, à la grotte du Gardon, dans des niveaux du Néolithique moyen (Chiquet 1997).
Enfin, un fragment d’os long correspond à un oiseau de la taille d’un cygne.
Les os de corvidés, il s’agit d’une dizaine de pièces, sont issus du mètre L/20 situé contre la paroi est,
à l’instar de ceux que nous avons reconnu dans l’ensemble 2.1. Les deux lots d’ossements paraissent
anatomiquement complémentaires et pourraient être issus d’un seul et même individu. Il faut
également signaler dans le même secteur la découverte d’une mandibule de loir (Glis glis), d’un radius
de chauve-souris du genre Myotis (grand murin (Myotis myotis) ou petit murin (Myotis bliti) et d’un
coxal de rongeur de la famille des muridés, dont la taille s’apparente ici à celle d’un rat. Ces diverses
observations tendent à indiquer que ces éléments matérialisent une accumulation tardive liée à
l’activité d’un prédateur comme le blaireau, la martre, le renard ou le chat sauvage, dont la présence a
été mise en évidence à l’Abbaye.
L’état de surface (concrétion, dissolution) et la fracturation des restes empêchent dans bien des cas
l’examen des traces. A peine une dizaine de marques de dents a pu être observée, presque
exclusivement à l’avant de l’abri et essentiellement sur des restes d’animaux de taille moyenne.
Les traces de boucherie sont elles aussi rares mais localisées pour leur part sur des vestiges issus du
fond de l’abri et à l’est des secteurs centraux, soit dans les zones les moins piétinées. Tandis que
quelques coups ont été observés sur des vertèbres lombaires de bœuf et peut-être celle d’un porc, le
prélèvement de la viande est attesté à trois reprises, sur une ulna et une vertèbre lombaire de bœuf
ainsi que sur une côte appartenant à un mammifère de taille moyenne. Des restes brûlés (NR :73) et
parfois même calcinés forment quant à eux de faibles concentrations dans et aux abords des mètres
MN/20 et NO/16-17. Seule la seconde correspond à l’emplacement de structures identifiées (st27 et
st33).
D’un point de vue spatial, plusieurs zones se dessinent au sein de l’abri :
- à l’ouest, les vestiges sont relativement peu nombreux, et consistent essentiellement en des dents de
porc et de caprinés. Cette zone a également livré une dent et un fragment de crâne humains (T/15-16).
- les secteurs nord sont les seuls à avoir livré des restes de carnivores sauvages (renard et de chat
sauvage). Les os de félidé proviennent d’un unique m2 (P/24) et appartiennent sûrement au même
animal. Dans cette partie de la grotte, les ossements sont presque exclusivement issus de la chèvre et
du mouton. Les seuls ossements de bœuf identifiés sont des vertèbres lombaires et coccygiennes qui
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 115 -
représentent très certainement un même tronçon squelettique. Des traces de coup sont visibles sur une
des vertèbres lombaires. C’est également tout au fond de l’abri qu’une quinzaine de restes humains ont
été mis au jour. Ces restes, mêlés aux ossements de faune, sont issus exclusivement des pieds et des
mains (OPQ/22-24) d’au moins un sujet de taille adulte.
Des restes d’oiseaux et de micromammifères, découverts en L/20, tout contre la paroi, traduisent une
accumulation due à un autre prédateur que l’homme. Quelques dents et phalanges de suidés et de
caprinés se distribuent aux alentours. Rappelons qu’une légère concentration de restes brûlés a été
reconnue à proximité, en MN/20.
- enfin, le centre de l’abri rassemble la majeure partie de la faune et la presque totalité des dents de
chute. En ce qui concerne les caprinés et le porc, l’ensemble du squelette est représenté, avec
cependant une forte proportion de dents. Les os relatifs à l’extrémité des membres sont également
assez fréquents. Le bœuf a livré quelques dents et des fragments d’os longs appartenant à un animal
âgé, dont la découpe est assurée à deux reprises. Ces vestiges se concentrent en NOP/14-15. Quant aux
restes de chien, ils proviennent exclusivement des secteurs centraux.
La découverte d’une quinzaine de dents de lait de chute appartenant à des caprinés est à nouveau le
témoignage probant de leur présence sur pied au sein de l’abri, essentiellement au niveau des secteurs
centraux. D’autres animaux ont sans aucun doute eux aussi fréquenté la grotte de leur vivant, puisque
nous avons repéré une molaire et plusieurs incisives lactéales de suidés dont les racines sont
totalement résorbées (Figure 70). Un cas comparable est suspecté pour le bœuf et le chien. L’absence
de stratification et d’organisation relevée pour cette occupation dans le cadre de l’étude céramique
peut aisément s’expliquer par le piétinement, qui a dû particulièrement affecter le centre de l’abri,
d’après la distribution des dents de chute. Sans avoir recherché de raccords, quelques collages et
connexions indiquent qu’une certaine cohésion entre les vestiges persiste toutefois, ne serait-ce qu’au
fond de l’abri.
Âge du Fer (ensemble 1.2, non daté, traces de Hallstatt C)
Cet horizon a livré une centaine de restes, dont seule une dizaine à peine a été identifiée (Tableau 29).
Il s’agit presque exclusivement de dents isolées appartenant principalement à des caprinés et au porc.
La présence du chien est attestée à travers une dent, tandis qu’un fragment de temporal trahit celle du
bœuf. Une dent jugale appartenant à un rongeur de la famille des Arvicolidae a également été
identifiée en J/17.
Signalons encore la reconnaissance, dans les mètres P/14-15, d’une dizaine d’esquilles présentant une
coloration pouvant varier du brun au blanc, qui témoigne de leur contact avec une source de chaleur.
Un foyer (F17) est localisé à proximité (Buard 2009, p. 17).
Epoque romaine (ensemble 1.1, Antiquité tardive)
L’ensemble 1.1 correspond à un niveau d’occupation pouvant être rattaché à l’Antiquité tardive sur la
base de l’étude céramique (André 2007). Plus de 300 vestiges osseux sont associés à ce niveau (Figure
68 et Figure 69), dont une grande partie provient des mètres ST/15-16, à l’instar de ce qui a pu être
observé pour le reste du mobilier (André 2007, fig. 53), soit aux abords immédiats des aménagements
St31 et F47 (André 2007). Les restes déterminés représentent 17% du nombre total de restes et 47% du
poids correspondant. Ces taux traduisent une fragmentation assez importante des ossements. La moitié
des vestiges font moins de 2 cm dans leur plus grande longueur.
A l’exception d’un fragment de diaphyse de métatarsien attribué au cerf (K/17), tous les restes
identifiés appartiennent à des animaux domestiques (Tableau 29). Nous avons reconnu le bœuf, le
mouton, le porc et la poule. La présence de la chèvre n’est pas assurée. En nombre de restes, les quatre
taxons contribuent de façon relativement équilibrée au spectre, avec une dominance tout de même des
petits ruminants. En termes de poids, le bœuf est à nouveau majoritaire.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 116 -
Les ossements de poule sont attribuables à deux ou trois sujets. Ils proviennent d’une part du secteur
occidental (T/15-16), d’autre part des mètres LMNO/16-17. Les restes de porc représentent au moins
trois sujets, dont un mâle et un sujet mort plus ou moins à la naissance (J/16). Le bœuf n’a livré que
des vestiges relatifs à la tête et aux pieds, exception faite de deux fragments distaux d’humérus
appartenant à des individus distincts de taille adulte. Les restes de petits ruminants, issus des
différentes parties du corps, excepté les doigts, appartiennent à deux sujets adultes au minimum.
La plupart des restes présentent un voile de concrétion grise, alors qu’une dissolution plus ou moins
superficielle de la matière osseuse est particulièrement forte dans les secteurs ST/15-16. Différents
témoignages d’une exploitation de ces animaux par l’homme nous sont malgré tout parvenus. Ainsi,
de fines incisions en rapport avec la décarnisation ont été repérées sur deux fragments de côtes
appartenant probablement à des caprinés. Plusieurs impacts reconnus sur la partie distale de la
diaphyse d’un humérus de capriné illustrent la désarticulation du coude (pl. 1, n°13). Un geste de
même nature semble affecter un humérus de bœuf. La fracture d’une première phalange de bœuf
pourrait quant à elle signifier l’ouverture intentionnelle de l’os en vue de tirer profit de la moelle.
Enfin, l’extrémité proximale d’une ulna de poule montre un enlèvement bordé de stries qui nous paraît
intentionnel et pourrait se rapporter à une désarticulation de l’aile.
Quelques restes calcinés ont été observés en S/16-17 et P/14, soit à proximité des foyers F47 et F43,
tandis qu’une vingtaine de restes légèrement brûlés (coloration brun-noir) et pouvant ne former qu’un
seul fragment de mâchoire de bœuf sont issus des mètres T/15-16, c’est-à-dire de l’épanchement
limono-charbonneux noirâtre St31 fonctionnant peut-être avec le foyer F47 (André 2007).
En ce qui concerne l’interprétation de ces restes, il ne semble faire aucun doute que certains animaux
ou parties d’animaux ont été consommés sur place, ne serait-ce que d’après les traces de boucherie
encore visibles sur quelques os. Les animaux de taille moyenne (caprinés, porc) ont dû être exploités
intégralement sur le site, puisque l’ensemble du squelette paraît représenté. Cela ne semble pas le cas
du bœuf, puisque celui-ci a essentiellement livré des restes relatifs à la tête et aux extrémités des
pattes. Notons néanmoins que la plupart des restes issus de la tête sont en fait les vestiges légèrement
brûlés localisés en T/15-16 et décrits plus haut, qui pourraient se rapporter à un seul individu.
Compte tenu de la simplicité des aménagements anthropiques et de la taille plutôt modeste du corpus,
il semble s’agir d’une occupation plutôt occasionnelle du lieu, au cours de laquelle des animaux
domestiques ont été consommés. Fréquentée tardivement, dans une période d’insécurité (André 2007),
la cavité a pu faire office de refuge temporaire, à l’instar d’autres grottes. Le fait qu’aucune dent de
chute de caprinés ne soit associée à cet ensemble, alors qu’elles sont présentes dans tous les autres
niveaux de la séquence supérieure, invalide à notre avis l’hypothèse qu’il s’agisse d’une bergerie. La
découverte d’une scapula appartenant à un suidé plus ou moins mort-né laisse toutefois imaginer que
des animaux ont pu être gardés sur pied un certain laps de temps au sein de la grotte ou aux alentours.
4 - Synthèse et perspectives
Comme nous avons pu nous en rendre compte, la diversité dont témoigne la faune de la séquence
supérieure de la grotte de l’Abbaye tient surtout à la présence d’une multitude d’espèces sauvages au
demeurant fort discrètes tout au long de la séquence. Témoins fugaces de la diversité des biotopes
environnants (forêt, lisière, prairie, plans d’eau…), leur rôle s’amoindrit au fur et à mesure du temps
qui passe, avec probablement un recul un peu plus net au cours du Néolithique final, voire déjà à la fin
du Néolithique moyen. Cette évolution peut bien sûr traduire des changements dans l’utilisation et la
fréquentation de la cavité, mais elle peut également se faire l’écho des transformations qui s’opèrent
de façon plus générale à la fin du Néolithique dans le paysage et qui découlent d’une emprise de plus
en plus forte de l’homme sur le milieu. Un lien entre ces deux propositions n’est du reste pas exclu.
L’hypothèse d’une halte de chasse peut à notre avis être totalement écartée quelle que soit la période
considérée, puisque les restes de faune sauvage, même relatifs à une première étape de préparation des
animaux, font presque totalement défaut. Parmi les espèces carnivores, seule la martre témoigne d’une
exploitation anthropique. Le chevreuil et le sanglier sont mentionnés à une ou deux reprises au cours
de la séquence. Parmi les ongulés sauvages, le cerf est en fait le représentant le plus constant et
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 117 -
pourtant il n’est à l’origine que de sept restes, parmi lesquelles deux dents de lait de chute. Ces
dernières ne se rapportent certainement pas à des animaux chassés. Il semble plus probable que la
cavité ait servi de refuge temporaire à de jeunes cerfs au moment où s’effectuait un changement
dentaire. La présence dans l’abri de micromammifères, de passereaux et de certains carnivores
sauvages, semblent elle aussi indépendante d’une volonté humaine. Elle trahit une fréquentation du
site par la faune environnante soit à l’insu des hommes, soit à une période où ces derniers sont absents.
En ce qui concerne la faune domestique, elle apparaît très largement dominante tout au long de la
séquence. En termes de poids des vestiges, le bœuf domine généralement. Les caprinés ont toutefois
tendance à s’imposer de plus en plus durant l’Âge du Bronze, jusqu’à rivaliser avec le bœuf au Bronze
final. Du point de vue du nombre de restes, plusieurs inflexions dans les contributions respectives sont
perceptibles (Figure 70) mais demeurent difficiles à interpréter, du fait d’effectifs plutôt faibles.
Prédominant au Chasséen ancien (et début du Chasséen moyen ?), l’élevage des caprinés enregistre
ensuite un net recul avant de progresser à nouveau à la fin du Néolithique final. Il demeure
prépondérant dès le Bronze moyen. Parallèlement, le bœuf enregistre une très nette progression durant
le Chasséen moyen et récent puis va graduellement diminuer jusqu’à la période romaine.
Le rôle du porc est plus difficile à circonscrire. En effet, l’intense fragmentation qui se traduit pour les
suidés par un poids moyen de 2.4 g, ainsi que la présence presque systématique d’ossements
d’individus en cours de croissance empêchent bien souvent leur attribution à la forme domestique
plutôt que sauvage. Bien que la présence du porc ne soit clairement assurée qu’à partir du Bronze
ancien, nous supposons que la majeure partie des restes de suidés de la séquence supérieure appartient
également à la forme domestique. Une telle hypothèse repose entre autres sur l’absence quasi-totale
d’ossements dont la taille pourrait s’apparenter à celle d’un animal sauvage, mais aussi sur le fait que
la grotte recèle un certain nombre de dents de chute mais aussi des os de nouveaux-nés et de fœtus
dans les différents ensembles, qui sont à notre avis des témoignages de la présence de quelques porcs
vivants au sein de la cavité, à l’instar de ce qui a été observé à propos des ruminants domestiques.
Nous avons donc pris le parti de considérer l’évolution des suidés parallèlement à celle des ruminants
domestiques. La contribution pondérale des suidés reste toujours inférieure à celle des caprinés et des
bovins, exception faite durant le quatrième millénaire avant notre ère (ens. 5 à 3.2) où les caprinés sont
particulièrement discrets. Du point de vue du nombre de restes, le rôle des suidés s’amplifie à partir du
Néolithique final au détriment du bœuf et demeure dès lors relativement constant.
Il faut encore évoquer la présence du chien, qui n’est visible qu’à partir du Bronze moyen ainsi que
celle du coq qui est assurée durant l’Antiquité tardive en tout cas.
De ces diverses observations, on retiendra en particulier le changement qui semble s’opérer dès la fin
du Néolithique final, à savoir un recours accru aux ongulés de de taille moyenne (caprinés et suidés),
ces derniers allant jusqu’à supplanter le boeuf au Bronze final en termes de poids, soit finalement en
termes de ressources carnées.
A propos des dents de lait de chute trouvées en abondance sur le site (NR : 99), elles indiquent que des
caprinés, mais aussi des bœuf et des suidés, ont séjourné dans la grotte. La perte des dents de lait
semblant plutôt intervenir au moment de la mastication (broutage et rumination en ce qui concerne les
ruminants), leur découverte à l’Abbaye pourraient témoigner du parcage ou du nourrissage dans la
grotte au moins durant la journée en ce qui concerne les caprinés (Helmer et al. 2005), et ce plutôt
entre le printemps et l’automne, d’après les données disponibles quant aux âges de changements
dentaires. Cela n’empêche nullement une fréquentation nocturne du site par les bêtes, mais cela
n’implique pas forcément une présence quotidienne et continue des bêtes au sein de la grotte.
Les restes d’animaux domestiques retrouvés sur le site suggèrent finalement une exploitation limitée
des denrées animales, soit des occupations humaines de faible impact, ce qui fait écho à la discrétion
des aménagements. L’importance de la fragmentation associée à la présence de dents de chute laisse
par contre supposer l’utilisation d’une partie au moins de la cavité comme abri pour le bétail.
L’intense fragmentation des vestiges est très certainement issue du piétinement par les bêtes.
A ce propos, une recherche plus systématique des remontages permettrait d’évaluer plus précisément
l’amplitude des déplacements verticaux et horizontaux des vestiges, c’est-à-dire l’ampleur des
interférences stratigraphiques dues à l’intense fréquentation du site, par le bétail notamment, mais
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 118 -
aussi la dispersion des vestiges au sein de chaque occupation, dans l’espoir d’y repérer par exemple
des axes de circulations privilégiés.
La distribution des restes portant des brûlures reproduit globalement l’emplacement des foyers. Ces
aménagements, de même que les empierrements mais également les différentes catégories d’objets
matérialisent une présence humaine plutôt discrète qui a pu accompagner le bétail. Compte tenu des
restes humains découverts dans certains niveaux, il est également possible que la cavité ait eu comme
vocation, à un moment ou à un autre, celle de sépulture.
Au terme de ce descriptif, il semble que la grotte de l’Abbaye ait répondu à diverses attentes et ce,
alors que sa fréquentation présente une allure plutôt sporadique, limitée, certainement en raison de ses
modestes dimensions. L’importance des pratiques d’élevage observée dès le Néolithique moyen à
l’Abbaye contraste avec ce qui a été notamment observé à la grotte du Gardon, à quelques dizaines de
kilomètres de là, où la chasse contribue de façon notable à l’économie de la communauté durant le
Néolithique moyen I et II. La différence de configuration des deux abris a pu conduire à une utilisation
distincte des deux lieux, qu’il s’agisse de la fonction (habitat, bergerie …), du rythme d’occupation
(saisonnière, pérenne …) ou encore des utilisateurs (une communauté, une frange de cette dernière…).
Comme nous pouvons finalement nous en rendre compte, cette étude encore préliminaire offre de
belles perspectives de réflexions et contribue déjà à une meilleure évaluation des modes d’occupation
du site. Une description plus approfondie des animaux (âge, sexe…) et une confrontation serrée des
résultats des diverses études seront très certainement en mesure de nous fournir à l’avenir quelques
informations substantielles quant à la fonction du site et aux modalités de son utilisation au cours des
divers occupations. Il s’agira alors de déterminer la place assignée à la grotte de l’Abbaye au sein d’un
territoire donné. Ancrée dans un paysage riche en biotopes, il faudra effectivement s’interroger sur la
façon dont s’articule cette cavité vouée essentiellement au bétail par rapport à d’autres sites, et pour se
faire confronter nos données à celles d’autres gisements localisés à proximité, notamment des sites
d’habitat.
5 - Remerciements
Je tiens à remercier Jean-François Buard, qui m’a confié cette étude. L’élaboration de ce travail a pu
bénéficier des infrastructures de l’Université de Genève et du Muséum d’histoire naturelle de Genève,
grâce à la bonne volonté de Marie Besse et Jacqueline Studer.
6 - Bibliographie
André (I.). 2007. La grotte de l’Abbaye à l’époque romaine. In : Buard (J.-F.). Grotte de l’Abbaye I, Chazey-Bons,
Ain. Rapport de synthèse 2007. (Inédit, Service Régional de l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Rhône-Alpes), 65-82.
Arbogast (R.-M.). 1997. La grande faune de Chalain 3. In : Pétrequin (P.), ed. Les sites littoraux néolithiques de
Clairvaux-les-Lacs et de Chalain (Jura), 3 : Chalain station 3 (3200 - 2900 av. J.-C.), vol. 2. Paris : Eds de la
Maison des sci. de l'homme. (Archéologie et culture matérielle), 641-691.
Arbogast (R.-M.), Deschler-Erb (S.), Marti-Grädel (E.), Plüss (P.), Hüster Plogmann (H.), Schibler (J.). 2005. Du
loup au "chien des tourbières" : les restes de canidés sur les sites lacustres entre Alpes et Jura. In : Desse (J.),
Desse-Berset (N.), Méniel (P.), Studer (J.), ed. Hommage à Louis Chaix. Revue de paléobiologie (Genève), 10,
vol. spéc, 171-183.Becker (B.), Johansson (F.). 1981. Tierknochenfunde. Berne : Staatlicher Lehrmittelverlag.
(Die neolithischen Ufersiedlungen von Twann ; 11).
Buard (J.-F.), Féblot-Augustins (J.), Perrin (T.), Sordoillet (D.), Velarde (I.). 1994. La grotte de l'Abbaye I à
Chazey-Bons : rapport 1994. Genève : Dép. d'anthrop. et d'écologie de l'Univ. (Rapport de fouille non publié).
Buard (J.-F.), Féblot-Augustins (J.), Perrin (T.), Sordoillet (D.), Velarde (I.). 1995. La grotte de l'Abbaye I à
Chazey-Bons : rapport 1994. Genève : Dép. d'anthrop. et d'écologie de l'Univ., Besançon : UMR-CNRS, Lab. de
chrono-écologie de l'Univ. (Rapport de fouille non publié).
Buard (J.-F.), ed., &, Chenal-Velarde (I.), Féblot-Augustins (J.), Muller (C.), Wittig (M.), collab. 1997. Abbaye I,
Chazey-Bons, Ain : rapport de fouilles 1995-1997. Genève : Dép. d'anthrop. et d'écologie de l'Univ. (Rapport de
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 119 -
fouille non publié). (Inédit, Service Régional de l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Rhône-Alpes), 101 p., 27 fig.
Buard (J.-F.). Grotte de l’Abbaye I, Chazey-Bons, Ain. Rapport de synthèse 2007. (Inédit, Service Régional de
l'Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Rhône-Alpes), 178 p.
Callou (C.). 1997. Diagnose différentielle des principaux éléments squelettiques du lapin (genre Oryctolagus) et du
lièvre (genre Lepus) en Europe occidentale. Valbonne-Sophia Antipolis : APDCA. (Fiches d'ostéologie animale
pour l'archéologie ; Série B : Mammifères, 8).
Chaix (L.). 1989. La faune des vertébrés des niveaux V et IVb. In : Pétrequin (P.), ed. Les sites littoraux
néolithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura), 2 : le Néolithique moyen. Paris : Eds de la Maison des sci. de
l'homme. (Archéologie et culture matérielle), 369-404.
Chiquet (P.). 1997. La faune du Néolithique moyen II de la grotte du Gardon (Ain). Vol. 1 : texte, vol. 2 : figures et
planches. Genève : Dép. d'anthrop. et d'écologie de l'Univ. (Travail de diplôme : archéologie préhistorique).
Chiquet (P.). 2012. La faune du Néolithique moyen de Concise (Vaud, Suisse) : analyse des modes d’exploitation
des ressources animales et contribution à l’interprétation de l’espace villageois. Lausanne : Cahiers d'archéologie
romande. (Cahiers d'archéologie romande n°131; La station lacustre de Concise ; 4) [http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:22759].
Chiquet (P.), Chaix (L.). 2009. La faune du Néolithique ancien. Annexe : biométrie (en millimètres) des restes
osseux du Néolithique ancien (couches 64 à 53) et moyen I (couches 52-48). In : Voruz (J.-L.), ed. La grotte du
Gardon (Ain). Volume 1 : le site et la séquence néolithique des couches 60 à 47. Toulouse : Ecole des Hautes
Etudes en Sci. Soc. (EHESS). (Archives d'écologie préhistorique), 397-450, [http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:5176].
Deschler-Erb (S.), Marti-Grädel (E.). 2004. Viehhaltung und Jagd : Ergebnisse der Untersuchung der
handaufgelesenen Tierknochen. In : Jacomet (S.), Leuzinger (U.), Schibler (J.), ed. Die jungsteinzeitliche
Seeufersiedlung Arbon/Bleiche 3 : Umwelt und Wirtschaft. Frauenfeld : Dep. für Erziehung und Kultur des
Kantons Thurgau. (Archäologie im Thurgau ; 12), 158-252.
Habermehl (K.-H.). 1975. Die Alterbestimmung bei Haus- und Labortieren. Berlin, Hamburg : P. Parey.
Habermehl (K.-H.). 1985. Altersbestimmung bei Wild- und Pelztieren : Möglichkeiten und Methoden : ein
praktischer Leitfaden für Jäger, Biologen und Tierärzte. Berlin, Hamburg : P. Parey.
Helmer ( D.), Gourichon (L.), Sidi Maamar (H.) & Vigne (J.-D.). 2005. L’élevage des caprinés néolithiques dans le
sud-est de la France : saisonnalité des abattages, relations entre grottes-bergeries et sites de plein air.
Anthropozoologica, 40 (1), 167-189.
Tomek (T.), Bochenski (Z. M.). 2009. A key for the identification of domestic bird bones in Europe : Galliformes
and Columbiformes. Krakow : Institute of Systematics and Evolution of Animals of the Polish Academy of
Sciences.
Royer (A.). 2008. La tortue Cistude (Emys orbicularis) du site Castelnovien de l’Abri du Mourre de Sève
(Vaucluse): étude taphonomique et archéologique. Bordeaux : Université Bordeaux I (Mémoire de Master 2, non
publié).
Teichert (M.). 1975. Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei Schafen. In : Clason
(A. T.), ed. Archaeozoological studies. Amsterdam : Elsevier, 51-59.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 120 -
Es
pè
ce
sN
RP
RN
RP
RN
RP
RN
RP
RN
RP
RN
RP
R
Bœ
uf (B
os
tau
rus
)1
32
22
14
30
1.1
39
36
32
33
77
.74
25
.32
35
24
.5
Ca
prin
és
do
m. (M
ou
ton
/Ch
èvre
)1
98
3.2
94
.71
7(3
)4
3.0
11
62
0.2
11
29
.13
61
29
.8
Mo
uto
n (O
vis a
ries
)(1
)(0
.5)
(1)
(0.9
)(3
)(5
1.1
)
Ch
èvre
(Ca
pra
hirc
us
)(1
)(1
.7)
(1)
(6.3
)
To
tal m
am
mifè
res
do
me
stiq
ue
s
32
30
5.2
23
30
5.8
56
40
6.0
13
93
97
.91
55
4.4
59
65
4.3
Ce
rf (Ce
rvus
ela
ph
us
)1
1.3
11
8.9
(1)
(0.7
)1
(1)
1.9
(1.1
)
Ch
evre
uil (C
ap
reo
lus
ca
pre
olu
s)
13
.8
Sa
ng
lier (S
us
scro
fa)
11
0.3
Re
na
rd (V
ulp
es
vulp
es
)1
3.1
Bla
irea
u (M
ele
s m
ele
s)
12
0.3
29
.43
1.8
15
.85
43
.1
Ma
rtre (M
arte
s m
arte
s)
10
.11
1.3
10
.11
0.8
Ou
rs b
run
(Urs
us
arc
tos
)2
3.9
11
.4
Liè
vre b
run
(Le
pu
s e
uro
pa
eu
s)
12
.81
0.3
11
.2
Ca
sto
r (Ca
sto
r fibe
r)1
0.7
Ecu
reu
il (Sciu
rus
vulg
aris
)1
0.3
Hé
riss
on
(Erin
ace
us
eu
rop
ae
us
)
10
.21
0.2
To
tal m
am
mifè
res
sa
uva
ge
s2
21
.63
19
.29
31
.56
3.6
15
.81
04
9.4
Mic
rom
am
mifè
res
50
.14
50
.05
10
.01
20
.02
50
.1
Ois
ea
ux
40
.22
20
.33
1.8
51
.0
Ba
tracie
ns
40
.32
20
.02
10
.22
0.0
Po
iss
on
s1
0.0
Re
ptile
(tortu
e)
61
0.2
Gra
nd
s ru
min
an
ts5
12
.25
28
.57
49
.35
25
.51
29
.12
8.5
Pe
tits ru
min
an
ts5
(1)
6.3
36
.31
42
6.8
11
34
3.3
15
9.4
13
14
.5
Su
idé
s in
dé
term
iné
s2
63
6.5
12
03
1.5
12
9(1
)8
1.4
12
24
5.1
51
1.4
18
54
.8
Ca
rnivo
res
ind
éte
rmin
és
10
.01
10
.01
13
.8
La
go
mo
rph
es
ind
éte
rmin
és
30
.12
21
.8
Mic
rofa
un
e2
0.0
12
0.0
22
0.0
21
0.0
16
0.2
Ind
éte
rmin
és
Ta
ille P
etit
61
.12
50
.82
70
.73
20
.11
50
.81
30
.9
Ind
éte
rmin
és
Ta
ille M
oye
n3
74
5.2
25
33
.93
3(1
)3
7.4
36
26
.81
81
3.5
22
15
.7
Ind
éte
rmin
és
Ta
ille G
ran
d6
27
.84
14
.42
0(1
)6
4.6
21
(1)
42
.51
1.8
19
56
.5
Ind
éte
rmin
és
44
61
54
.56
59
51
34
.39
48
61
12
.08
54
11
02
.32
24
24
2.4
15
03
73
.3
To
tal
57
66
10
.82
68
85
74
.87
67
08
10
.38
69
26
88
.22
88
17
4.2
26
87
94
3.1
Né
o. F
ina
l su
p.
Né
o. F
ina
l inf.
NM
BC
ha
ss
ée
n m
oye
nC
ha
ss
ée
n a
nc
ien
/St-U
ze
Ch
as
sé
en
an
cie
n/S
t-Uze
en
se
mb
le 3
.1e
ns
em
ble
3.2
et 3
.3e
ns
em
ble
4e
ns
em
ble
5e
ns
em
ble
6e
ns
em
ble
7
Ta
blea
u 2
7 : S
pectre d
e fau
ne o
bten
u p
ou
r les différen
ts ensem
bles d
u N
éolith
iqu
e. Les va
leurs d
on
nées en
tre pa
renth
èses corresp
on
den
t à d
es pièces d
e
l’ind
ustrie o
sseuse o
u à
du b
ois d
e cerf. NR
: no
mb
re de restes ; P
R : p
oid
s des restes.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 121 -
Espèces NR PR NR PR NR PR
Bœuf (Bos taurus) 22 262.6 48 667.3 7 142.1
Caprinés dom. (Mouton/Chèvre) 100 257.2 144 368.02 13 49
Mouton (Ovis aries) (8) (85.8) (9) (40.6) - -
Chèvre (Capra hircus) (8) (11.7) (9) (43.7) - -
Porc (Sus domesticus) 17 96.6 11 63.8 3 18.5
Chien (Canis familiaris) 6 22.5 3 9.5 - -
Total mammifères domestiques 145 638.9 206 1'109 23 209.6
Cerf (Cervus elaphus) 1 1.7 1 1.3 1 57
Chevreuil (Capreolus capreolus) - - 1 10.5 - -
Renard (Vulpes vulpes) 1 0.1 2 4.6 - -
Chat sauvage (Felis silvestris) 3 3.2 1 3.3 - -
Total mammifères sauvages 5 5 5 20 1 56.5
Micromammifères 9 0.83 2 0 2 0
oiseaux 22 9.7 4 1 - -
Coq (Gallus gallus) 1 1.5 - - 1 0.1
Microfaune - - 1 0 - -
Batraciens - - 4 1 - -
Grands ruminants 6 48.5 14 51.7 1 18.5
Petits ruminants 20 24.2 36 82 5 16.2
Suidés indéterminés 72 125.61 94 191.9 19 21.23
Carnivores indéterminés 1 1 - - - -
Indéterminés Taille Petit 7 253 3 0.12 - -
Indéterminés Taille Moyen 173 153.87 141 192.8 34 43.4
Indéterminés Taille Grand 34 106.3 32(2) 153 9 81.2
Indéterminés 692 242.62 31(2) 28 9 10
Indéterminés estimés - - 1'410 394 446 100
Total 1'178 1610.2 1'984 2'223 548 556.4
Bronze final IIb-IIIa Bronze moyen Bronze ancien
ensemble 1.3 ensemble 2.1 ensemble 2.2
Tableau 28 : Spectre de faune obtenus pour les différents ensembles de l’Âge du bronze. NR : nombre de restes ;
PR : poids des restes.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 122 -
Espèces NR PR NMI NR PR NMI
Bœuf (Bos taurus) 13 94.6 2 1 10.2 1
Caprinés dom.
(Mouton/Chèvre)
16 55.1 2 5 13 3
Mouton (Ovis aries) (4) (33) (1) - - -
Porc (Sus domesticus) 14 60.9 3 4 3.3 1
Chien (Canis familiaris) - - - 1 0.4 1
Total mammifères
domestiques
43 210.6 7 11 26.9 6
Coq (Gallus gallus) 11 8.7 2 - - -
Total animaux domestiques 54 219.3 2 11 26.9 6
Cerf (Cervus elaphus) 1 11 1 - - -
Total mammifères sauvages 1 11 1 11 26.9 6
Grands ruminants 6 11.3 - - - -
Suidés indéterminés 1 0.9 - - - -
Petits ruminants 14 25.4 - 2 0.6 -
Microfaune - - - 2 0.02 -
Indéterminés Taille Moyen 36 56.3 - 12 16.1 -
Indéterminés Taille Grand 17 98.1 - 4 9.3 -
Indéterminés 23 12.7 - 85 30.23 -
Indéterminés estimés 179 52.5 - - - -
Total 331 487.5 10 116 83.15 6
ensemble 1.1. ensemble 1.2.
Tableau 29 : Spectre de faune obtenus pour les ensembles de l’Âge du fer et de l’époque romaine. NR : nombre
de restes ; PR : poids des restes ; NMI : nombre minimum d’individus.
Légende des photos (Planche 1)
N°1. Stries de découpe sur un stylohyoideum de boeuf, un élément de l’appareil hyoïdien qui soutient
entre autres la langue.
N°2. Stries de découpe sur un basi-occipital de suidé.
N°3. Fragments de plastron (haut) et scapula (bas) d’une cistude d’Europe (Emys orbicularis).
N°4. Elargissement d’une des éminences articulaires d’un métapode de bœuf.
N°5. Première et deuxième molaires supérieures gauches et deuxième molaire inférieure gauche d’un
même sujet montrant une usure anormale de leur surface occlusale.
N°6. Deuxième molaire supérieure présentant des striations au niveau de la racine.
N°7. Quelques exemples d’altérations (lustré, dissolution) liées à l’ingestion des os par des carnivores.
N°8. Strie d’écorchage sur une mandibule de martre.
N°9. Dents de lait de chute appartenant à des caprinés (gauche), des bœufs (droite) et des suidés (bas).
N°10. Marques de dents de rongeur sur un humérus de suidé.
N°11. Stries de décarnisation sur la face interne d’une côte appartenant à un mammifère de taille
moyenne (cf capriné).
N°12. Impact sur une vertèbre lombaire de petit ruminant.
N°13. Désarticulation du coude perceptible sur un humérus de capriné.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 124 -
Figure 67 : Poids moyen (PR/NR) des restes osseux par ensemble chrono-culturel, selon qu’ils soient ou non
déterminés. La catégorie « déterminés » comprend des vestiges identifiés au niveau de l’espèce, de la catégorie
d’espèces (caprinés domestiques) ou du genre.
Figure 68 : Nombre et poids des restes osseux déterminés par ensemble chrono-culturel. La catégorie
« déterminés » comprend des vestiges identifiés au niveau de l’espèce, de la catégorie d’espèces (caprinés
domestiques) ou du genre.
Figure 69 : Nombre et poids des restes osseux indéterminés par ensemble chrono-culturel.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 125 -
Figure 70 : Part relative des diverses catégories d’espèces présentes dans chaque ensemble chrono-culturel. Le
rapport est établi sur la base du nombre de restes. Les dents de lait de chute ne sont pas comprises dans ces
décomptes.
Figure 71 : Part relative des diverses catégories d’espèces présentes dans chaque ensemble chrono-culturel. Le
rapport est établi sur la base du poids des restes.
Figure 72 : Nombre de dents de lait de chute répertoriées dans chaque ensemble chrono-culturel pour
différentes catégories d’espèces.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 126 -
Figure 73 : Part relative des restes osseux par ensemble chrono-culturel, selon qu’ils soient ou non déterminés.
Le rapport est établi sur la base du nombre de restes.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 127 -
CHAPITRE VIII
Etude des restes humains épars, analyse préliminaire
Jocelyne Desideri
Les diverses interventions archéologiques menées dans la grotte de l’Abbaye ont livré un certain
nombre de fragments humains (n=102, H1 est un fragment de maxillaire avec 5 dents qui a été
considéré comme un seul élément). Les restes se répartissent, en nombre, en parts sensiblement égales
entre fouilles anciennes (n=53) et fouilles récentes (n=49). Deux tiers des fragments humains
appartiennent au cranium (n=63) et, par conséquent, un tiers au postcrânien (n=39).
1 - Les fouilles anciennes
L’analyse des fragments humains découverts lors des fouilles Jean Reymond effectuée dans les année
1960 a été réalisée à partir d’une photographie. Cette dernière, malgré sa bonne qualité, permet une
détermination assez sommaire des parties anatomiques conservées (Figure 74). Il a été possible de
recenser 53 fragments (A1 à A53) dont la moitié est représentée par des éléments crâniens (dents et
pièces osseuses). Le postcrânien est, quant à lui, composé de 4 fragments de côtes, 2 fragments de
vertèbres, une patella, un métacarpien, 9 phalanges de la main et 2 phalanges du pied (Figure 75).
L’ensemble des pièces osseuses ne présente aucun élément à double et pourrait appartenir à un seul et
même sujet adulte. Notons qu'une pathologie touchant l’articulation d'un doigt de la main a été mise en
évidence et se traduit par une ankylose interphalangienne proximale (A24).
Il est, en revanche, possible de distinguer la présence d’au moins 2 individus par l’étude de la
dentition. Une canine déciduale supérieure probablement droite dont la racine semble en cours de
résorption permet d’avancer la présence d’un sujet immature. Il est possible de lui attribuer un âge au
décès de 6 +/- 2 ans selon la méthode de Moorrees et al. (1963a/b). Les 7 dents permanentes
présentent un stade d’usure relativement similaire et pourrait appartenir à un même individu. Elles
permettent ainsi de donner une estimation de l’âge au décès d’un sujet adulte ayant entre 20 et 30 ans
selon la méthode de Lovejoy (1985).
Aucun élément ne permet de dissocier le lot de dents permanentes et les fragments de pièces osseuses,
c’est pourquoi les fouilles anciennes semblent avoir mis au jour un NMI de 2 individus composé d’un
immature et d’un jeune adulte.
2 - Les fouilles récentes 1993-2003
Les fouilles récentes ont mis au jour 49 restes humains qui se répartissent dans différents niveaux
d'occupations, les phases anciennes (Néolithique final et Bronze moyen; Figure 76 et Figure 77) et le
Bronze final (Figure 79).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 128 -
Les niveaux du Néolithique final et du Bronze moyen
Les fragments humains dans les niveaux anciens s'élèvent au nombre de 24 (H12, H17, H18, H20 à
H27, H29 à H40). La très large majorité de ces restes appartient au cranium (parties osseuses
uniquement) (n=20) et 4 pièces seulement au postcrânien (2 fragments de diaphyse de fémur, un
fragment de diaphyse de fibula et un métatarsien) (Figure 78).
Toutes les pièces osseuses appartiennent à un adulte. Seule la présence de 2 fragments d'os temporaux
gauches (H26 et H27) permet d'indiquer l'existence d'au moins 2 sujets adultes. Aucun élément
anatomique ne permet d'estimer le sexe ou l'âge de ces individus.
Les niveaux du Bronze final
Dans les niveaux du Bronze final, 25 fragments humains ont été mis au jour (H1 à H6, H8 à H10, H13
à H15, H19, H41, H42). On décompte 9 pièces crâniennes (dents et parties osseuses) et 16 fragments
postcrâniens (une diaphyse de radius, une vertèbre lombaire, un métacarpien, 3 phalanges de la main,
un talus, un cuboïde, 3 métatarsiens et 5 phalanges du pied) (Figure 80).
L’ensemble des restes osseux ne présente pas d'éléments à double et pourrait ainsi appartenir à un seul
et même sujet adulte.
En revanche, il est envisageable de différencier au moins 2 individus par l’étude de la dentition.
D’abord, 2 dents permanentes, une canine inférieure droite en cours de croissance (H10) et une
molaire inférieure droite en fin de croissance (H13), permettent d’avancer la présence d’un sujet
immature. Il est possible de lui attribuer un âge au décès de 7 +/- 2 ans selon la méthode de Moorrees
et al. (1963a/b). Ensuite les autres dents permanentes supérieures peuvent être considérées comme un
ensemble homogène appartenant probablement à un même individu. Ce lot se compose premièrement
de 3e molaires supérieures (H5 et H19) en fin de croissance qui se ressemblent morphologiquement et
qui indiquent que nous aurions plutôt affaire à un jeune adulte. L’usure des autres dents maxillaires de
cet ensemble (H1, H4 et H6) permet d'avancer un âge au décès de 20-24 ans selon la méthode de
Lovejoy (1985).
Aucun élément ne permet de dissocier l'ensemble dentaire attribué à l'individu adulte et les fragments
de pièces osseuses, c’est pourquoi les niveaux datant du Bronze final semblent délivrer un NMI de 2
individus composé d’un immature et d’un jeune adulte.
3 - En guise de conclusion
L’analyse anthropologique des restes humains épars retrouvés lors des diverses interventions
archéologiques et dans les différents niveaux d’occupation de la grotte de l’Abbaye a permis
d’identifier plusieurs individus.
L’ensemble des vestiges humains découverts lors des fouilles anciennes représente 2 sujets, un
immature de 6 +/- 2 ans et un jeune adulte entre 20 et 30 ans. Les niveaux du Bronze final livrent
également les restes de 2 individus (un immature de 7 +/- 2 ans et un jeune adulte entre 20 et 24 ans),
d’âge comparable à ceux mis au jour lors des interventions anciennes. Il est, dès lors, fort probable
qu’il s’agisse des mêmes individus. Cet élément est par ailleurs renforcé par l’absence d’ossements à
double dans ces deux lots.
Les niveaux anciens (Néolithique final et Bronze moyen), quant à eux, présentent un NMI de 2
individus adultes pour lesquels il n’a pas été possible de préciser leur identité.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 129 -
4 - Bibliographie
Cugini (S.). 1983. Disegno e morfologia dentale. Milano: Libreria dello studente.
Lovejoy (C.O.). 1985. Dental wear in the Libben population: Its functional pattern and role in the determination of
adult skeletal age at death. American Journal of Physical Anthropology 68, 47-56.
Moorrees (C.F.A.), Fanning (E.A.), Hunt (E.E.). 1963a. Formation and resorption of three deciduous teeth in
children. American Journal of Physical Anthropology 21, 205-213.
Moorrees (C.F.A.), Fanning (E.A.), Hunt (E.E.). 1963b. Age variation of formation stages for ten permanent teeth.
Journal of Dental Research 42, 1490–1502.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 130 -
Figure 74 : fragments humains découverts lors des fouilles de Jean Reymond (photo Jean-François Buard 1993
au dépôt de fouille du château de Chenavel à Jujurieu).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 131 -
Figure 75 : les fragments humains découverts lors des fouilles anciennes
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 132 -
Figure 76 : plan de répartition des fragments humains découverts dans les niveaux du Néolithique final (ens.31
et 3.3).
Figure 77 : plan de répartition des fragments humains découverts dans les niveaux du Bronze moyen (ens.2.1)
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 133 -
Figure 78 : les fragments humains découverts dans les niveaux du Néolithique final
(ens.3.1 et 3.3) et du Bronze moyen (ens.2.1)
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 134 -
Figure 79 : plan de répartition des fragments humains découverts dans les niveaux
du Bronze final (ens.1.3)
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 135 -
Figure 80 : les fragments humains découverts dans les niveaux du Bronze final (ens.1.3)
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 136 -
fouilles anciennes (A01-A53)
A01 canine sup gauche permanente A50 fragment crâne
A02 1re incisive sup droite permanente A51 fragment crâne
A03 2e incisive sup droite permanente A52 fragment crâne
A04 canine sup droite déciduale A53 fragment condyle mandibulaire G ou D
A05 2e prémolaire sup G ou D permanente A06 1re incisive inf gauche permanente
A07 1re incisive inf droite permanente fouilles récentes (H01-H42)
A08 2e incisive inf droite permanente H01 fragment maxillaire D (canine à 2e molaire)
A09 patella droite permanente
A10 1re côte gauche H02 1re ou 2e vertèbre lombaire
A11 fragment côte G ou D H03 pied (métatarsiens, phalanges proximales) G
A12 fragment côte G ou D H04 1re prémolaire sup gauche permanente
A13 fragment côte G ou D H05 3e molaire sup droite permanente
A14 fragment corps vetrèbre H06 2e molaire sup gauche permanente
A15 fragment processus transverse vetrèbre H08 diaphyse radius droit
A16 phalange intermédiaire main H09 fragment crâne : temporal D
A17 phalange intermédiaire main H10 canine inférieure droite permanente
A18 phalange proximale pied H12 2 fragments crâne : frontal
A19 phalange intermédiaire main H13 1re molaire inférieure droite permanente
A20 phalange intermédiaire pied H14 fragment crâne : pariétal
A21 phalange distale main H15 pied (talus, cuboïde, 1er métatarsien, 5e phalange proximale) D A22 phalange distale main
A23 phalange distale main H17 fragment crâne : pariétal
A24 phalanges intermédiaire & distale main H18 fragment crâne : pariétal
A25 phalange proximale main H19 3e molaire sup gauche permanente
A26 fragment métacarpien H20 fragment diaphyse fibula G ou D
A27 fragment crâne H21 2e, 3e, ou4e métatarsien
A28 fragment crâne H22 fragment diaphyse fémur G ou D
A29 fragment crâne H23 fragment crâne : pariétal ou frontal
A30 fragment crâne H24 fragment crâne : frontal
A31 fragment crâne H25 fragment crâne : temporal
A32 fragment crâne H26 fragment crâne : temporal G
A33 fragment crâne H27 fragment crâne : temporal G
A34 fragment crâne H29 fragment crâne : pariétal
A35 fragment crâne H30 fragment crâne : pariétal ou frontal
A36 fragment crâne H31 fragment crâne : temporal G
A37 fragment crâne H32 fragment crâne : occipital
A38 fragment crâne H33 fragment crâne : frontal
A39 fragment crâne H34 fragment crâne : frontal
A40 fragment crâne H35 fragment crâne : pariétal
A41 fragment crâne H36 fragment crâne : occipital
A42 fragment crâne H37 fragment crâne : occipital
A43 fragment crâne H38 fragment crâne : occipital
A44 fragment crâne H39 fragment crâne : occipital
A45 fragment crâne H40 fragment diaphyse fémur G ou D
A46 fragment crâne H41 5e phalange intermédiaire main
A47 fragment crâne H42 main (1re phalange proximale G ou D, 2e,
A48 fragment crâne 3e ou 4e phalange proximale G ou D
A49 fragment crâne et 5e métacarpien
Tableau 30 : inventaire des fragments humains.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 137 -
CHAPITRE IX
Approche technologique du matériel lithique des niveaux inférieurs de la grotte
de l’Abbaye
Gerald Bereiziat
1 - Introduction
Les objectifs de cette étude préliminaire sont conditionnés par la fouille de trois secteurs restreints, IL-
10/12 – MN-12/13 ainsi que ST-18/19, et à la valeur quantitative de l’échantillon. Dans ce contexte,
un choix méthodologique a été opéré pour permettre de présenter des résultats cohérents et
significatifs.
Le matériel de l’ensemble 9 sera abordé succinctement du fait de la pauvreté de la série. Nous avons
par contre opté pour un examen plus détaillé du matériel concernant les ensembles sous-jacents 10-12
et 13. La totalité des données lithiques des niveaux tardiglaciaires a été volontairement rapprochée au
sein d’une étude commune du fait de leur rapport technologique étroit, et opposée pour la perspective
lithologique. Cette deuxième approche des artefacts permettra de juger des variabilités ou des
constances observées entre ces deux ensembles par une mise en corrélation de la matière première
avec les orientations techniques sollicitées. Elle nous livrera des renseignements sur
l’approvisionnement en matériaux siliceux et permettra d’évaluer une partie des territoires parcourus.
2 - Regard sur le matériel de l’ensemble 9
Le matériel de l’ensemble 9 se compose de 22 éléments dont 3 éclats corticaux, 6 éclats de mise en
forme, 5 lames provenant d’une séquence de plein débitage, 5 éclats d’entretiens, une lame à crête
partielle et un nucléus.
Nous notons donc la présence de 5 produits laminaires ce qui est intéressant malgré la faiblesse
numérique de l’assemblage. Sur deux extrémités proximales, nous pouvons observer deux talons lisses
abrasés portant une surface de contact large ainsi que des bulbes proéminents esquillés. Ces stigmates
sont caractéristiques d’un débitage au percuteur de pierre dure.
Au sein de ce corpus, nous signalerons également un nucléus (Figure 87 S004) dont les dimensions
(29x31x25 mm) et la morphologie des enlèvements évoquent une production de lame courte. Le plan
de frappe et les contre-bulbes présents sur les négatifs d’enlèvement montrent une nouvelle fois
l’emploi d’une percussion directe à la pierre.
Les observations menées sur ce matériel ne vont pas à l’encontre de la datation obtenue pour cet
ensemble (10010±70 BP) et l’attribution au Mésolithique ancien, même si l’absence de supports
retouchés ne permet pas de préciser davantage cette industrie.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 138 -
3 - Technologie des ensembles 10-12 et 13
Données quantitatives de base :
Les vestiges lithiques sont au nombre de 1400 et se répartissent comme suit :
Ens. 10-12 Ens.13 Secteur T18-19
éclats 95 100 6
lames 16 20 1
lamelles 6 20 6
nucléus 0 2 0
outils 6 3 3
Total (hors esqu.) 123 145 16
esquilles 1116
Tableau 31 : Comptage des silex des ensembles 10-12, 13 et du secteur T18-19.
Les esquilles n’ont pas été intégrées à notre lecture technologique. Ce sont donc 284 objets qui
composent notre échantillon d’étude, dont 16 appartiennent au secteur T18-19. Nous avons souhaité
rattacher cette petite série aux ensembles 10-12 et 13 du fait de leurs proximités morpho-techniques et
lithologiques.
Les supports retouchés
12 supports retouchés (Tableau 32) ont été répertoriés ce qui représente seulement 4% du total du
matériel (hors esquilles) :
Pour l’ensemble 10-12, nous comptabilisons :
- 1 grattoir sur lame retouchée
- 2 troncatures sur lame et sur lamelle
- 1 encoche
- 2 lamelles à bord abattu
Pour l’ensemble 13 :
- 1 burin dièdre
- 1 perçoir
- 1 lamelle à bord abattu
Pour le secteur T18-19 :
- 1 perçoir
- 2 lamelles à bord abattu
Cet outillage est provisoirement dominé par les lamelles à bord abattu (Figure 87, S003, S002, S030 et
S026 – Figure 88, S511) qui sont confectionnées sur des supports réguliers, fins et allongés. Ces 5
éléments à armatures sont tous fragmentés. Ils se répartissent en 3 parties mésiales, une extrémité
proximale et une extrémité distale, concernant 5 cassures par flexion inverse, une franche et une brisée
par le feu. La fracture est droite pour 2 et oblique pour 3.
La valeur dimensionnelle des supports livre une indication variable car l’échantillon ne peut être
représentatif de son ensemble. Signalons toutefois que les fragments ont tous une longueur inférieure à
30 mm. Cette limite semble s’expliquer par la probabilité plus élevée de cassures naturelles dans cette
fourchette dimensionnelle. Les largeurs se situent entre 11 et 6 mm et les épaisseurs entre 3 et 2 mm.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 139 -
Sur 2 supports, la retouche du dos est bilatérale, rasante et semi-abrupte. Pour 3, elle ne concerne
qu’un coté, essentiellement droit.
Les sections du support par rapport à la retouche sont dans 4 cas triangulaires, et trapézoïdales dans 2.
La légèreté des produits suppose une sélection des supports à section symétrique, centrée sur la table
d’enlèvements, plutôt que décalée par rapport à l’axe et synonyme d’un débitage antérolatéral, dans
quel cas nous aurions une épaisseur plus développée sur le pan débordant.
Parmi les outils du fond commun, nous signalerons la présence d’un burin dièdre déjeté réalisé sur une
lame peu régulière (Figure 88, S547) et d’un grattoir sur bout de lame retouchée (Figure 88, S709). Ce
support s’insère dans les premières phases du débitage comme le montre la plage corticale localisée en
partie mésio-distale. Des retouches denticulées irrégulières sur les bords pourraient laisser entrevoir un
emmanchement, et des stigmates d’utilisation sont perceptibles par un esquillement situé sous le front
actif.
Les deux perçoirs sont réalisés sur un produit lamellaire (Figure 88, S554) et un éclat (Figure 87,
S031), et possèdent un rostre dégagé et déjeté à gauche. Pour le perçoir S031, la morphologie de la
partie active dessine davantage un bec et laisse entrevoir une fonction différente de celle proposée par
des perçoirs à la pointe plus fine.
2 troncatures dont une troncature oblique (Figure 88, S507) et une droite (Figure 88, S508) ainsi
qu’une encoche (Figure 88, S509) réalisée sur éclat laminaire complètent également ce corpus.
Les restes de débitage
Les objectifs du débitage
La prépondérance du projet laminaire apparaît quand on examine les supports transformés en outils
retouchés. Les lames et lamelles représentent 83 % (10 unités) des produits façonnés. Seulement 2
éclats ont été sollicités. Parmi les restes de taille brute, la proportion des produits laminaires est
moindre (25%, soit 69 unités), et plus élevé pour les éclats de mise en forme et d’entretien (70% pour
201 unités)
les nucléus
Seuls 2 nucléus sont présents dans ces deux ensembles :
M13.C4.d69a.v7 n° 24 (S552 – Ens.13) – (Figure 89)
Nucléus prismatique à lame courte (49x35x22 mm). Le débitage est placé sur la face large du nodule
et mené frontalement sur surface élargie, à évolution semi-tournante. Les flancs sont restés naturels,
ainsi qu’une partie du dos qui montre une préparation par le retrait d’un éclat depuis la base. Nous ne
constatons aucune crête latérale ou postéro-latérale. Ces dernières jouent souvent un rôle actif dans la
préparation avant son exploitation en régularisant et assainissant les flancs et permettent également de
contrôler le déroulement du débitage et de corriger certaines erreurs.
Le plan de frappe ne montre pas d’abrasion fine à la jonction avec la table. Par contre, un ravivage est
exercé par le retrait d’éclats courts (petits esquillements répétés) sur la partie antérieure du plan de
frappe. Son inclinaison est assez prononcée (70°).
Le débitage est unipolaire avec la trace d’un outrepassement qui a emporté la base du nucléus, produit
non retrouvé dans les restes de débitage. Le dernier élément visible par un négatif d’enlèvement
mesure 40 mm de longueur pour 18 mm de largeur, soit une lame courte assez robuste. La table
d’enlèvement ne montre pas de zone affectée par un quelconque problème (réfléchissement, cassure),
et l’abandon du nodule serait peut-être lié à la difficulté de gérer le plan de frappe très accidenté,
même si une correction restait encore envisageable.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 140 -
N13. d69e.v2 n°9 (S.517 – Ens.13) – (Figure 89)
Nucléus prismatique, à vocation lamino-lamellaire (45x25x23 mm). On remarque la mise en place
d’une crête prostérolatérale gauche contrôlée par un dos en méplat. Le nodule est entièrement séparé
de sa gangue corticale. L’orientation du débitage est unipolaire, mais toutefois secondée par un plan
opposé permettant une correction de la table. Le nodule est très exploité avec un plan de frappe exigu
et facetté par le retrait d’éclats courts. L’angle est obtu (60°). L’abandon est du à un rebroussé
important porté sur l’arête centrale. Par contre, nous suggérons que la fragmentation du nodule dans sa
partie mésiale a du intervenir après cet accident, d’origine peut-être post-dépositionnelle.
Les pièces techniques
La phase de préparation : décorticage, préparation de crête
Nous intégrons dans cette catégorie tous les produits portant une plage non résiduelle de fractures
anciennes ou de cortex. Notons que plusieurs éléments laminaires possédant un pan cortical ne sont
pas pris en compte dans cette séquence mais dans une phase de progression latérale et de cintrage des
surfaces de débitage.
Sur les 15 familles de matières premières différenciées, les pièces corticales sont bien représentées
pour un seul groupe, M1. Ils sont peu présents dans les assemblages M3, M5, M10, M11, M14 et
totalement absents pour M4, M6, M7, M12, M13 et M15 (Tableau 33).
37 pièces sont corticales dont 27 ont la face supérieure totalement envahie par du cortex et 10 ont une
plage qui occupe plus de la moitié du support.
La moyenne dimensionnelle des éclats corticaux et semi-corticaux entiers de mise en forme est de 25,4
mm pour la longueur, 21 mm en largeur et 6,7 mm d’épaisseur. La distribution de tous les éléments
entiers (n : 10) ne montre pas de produits aux dimensions importantes. Ils se situent surtout entre 40 et
20 mm. Un seul est au-delà de 50 mm. Cette tendance se confirme pour les épaisseurs qui sont
concentrées entre 5 et 7 mm, ce qui montre une volonté de ne pas débiter de gros éclats de préparation.
Ces éclats représentent 9,5 % du total du matériel analysé. Cette proportion apparaît faible mais sans
une fouille plus étendue, il est difficile d’interpréter cette donnée. Nous signalons que le contexte
siliceux local ne propose pas de nodule de taille importante, entre 10 et 20 cm de longueur, ce qui ne
nécessite pas une phase d’épannelage intensive et écarterait l’hypothèse d’une exploitation
périphérique des blocs sur le lieu de ramassage.
Les produits à crêtes et à traces de crêtes
Ces produits sont peu présents dans les assemblages et représentent seulement 3,8% des restes de
taille. On compte une lame à crête à un versant, 5 lames à crête partielle, 2 lames sous-crête, une
lamelle à crête à un versant (Figure 88, S652) et 2 lamelles sous-crête. Cette faible représentation
serait à rapprocher de la morphologie des nodules qui sollicitait une mise en forme simplifiée, suivant
les arrondis naturels offerts par le bloc. D’ailleurs, sur l’ensemble des produits à crête, aucun ne porte
une préparation bifaciale dite totale caractéristique de la phase d’initialisation du débitage. On
remarque par contre la présence de crêtes à un seul versant impliquant une face avancée du débitage.
Elles s’inscrivent dans l’entretien et la remise en forme de la table, procédé que l’on retrouve aussi
bien dans la production laminaire que lamellaire.
Le plan de frappe :
Les ravivages de plan de frappe sont peu nombreux. Nous recensons seulement 2 éclats de ravivage et
une tablette.
L’éclat de ravivage (M13.d67.Cm, n°5 - S691 - Dim : 22x25x4mm) montre un débitage frontal
détaché depuis la table. La lecture de la face supérieure est difficile en raison d’une concrétion
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 141 -
recouvrant cette partie de la pièce. Nous n’observons pas de facettage mais le retrait d’un éclat
couvrant toute la surface.
La tablette (N13.d69a.v5, n°8 – Figure 88, S570 – Dim : 31x26x4mm) montre un débitage strictement
frontal sur table resserrée. L’orientation de la production est lamellaire et perceptible par 3 négatifs
d’enlèvement. La face supérieure est lisse et correspond au retrait d’un éclat laminaire. L’inclinaison
du plan de frappe est peu prononcée. L’absence de cortex sur la partie distale du support indique que
le dos n’était pas resté naturel mais préparé et en méplat.
Les produits d’entretien :
Le recentrage des nervures guides et le recintrage de la table sont assurés le plus souvent par le
détachement d’éclats laminaires (61) dont certains débordent sur les flancs et possèdent un pan cortical
(8). La méthode de rectification des nervures guides en supprimant les négatifs réfléchis par
l’inversion du débitage sur un plan de frappe opposé n’est pas un moyen d’entretien souvent sollicité
puisque rare sont les pièces ayant des négatifs inverses. Des témoignages de cette méthode sont
constatés sur un nucléus ainsi que sur une lame et une lamelle de plein débitage. La présence plus
marquée de néocrêtes (crêtes à un versant) a servi au cintrage de la table active et à la correction
d’accidents de taille.
La production lamino-lamellaire
L’industrie est assez concassée, il y a peu de produits entiers (11). Parmi les fragments, nous comptons
12 extrémités distales, 22 mésiales et 22 proximales (Figure 88, S627). Sur l’ensemble de ces pièces, 2
raccords ont pu être réalisés.
Les mensurations de longueur indiquent que les lames entières (7) possèdent un petit gabarit. Deux
spécimens dépassent en effet le seuil parlant de 50 mm (2 objets à 51 mm). La moyenne se situe à 42,4
mm. Ces valeurs dimensionnelles iraient tout à fait dans le sens du contexte siliceux local qui livre des
nodules de petites tailles (Féblot-Augustins, 2002 a).
Concernant les largeurs et les épaisseurs prisent sur l’ensemble de l’échantillon, elles donnent une
meilleure estimation du module des produits laminaires. La largeur varie de 10 à 29 mm (moy : 17,3
mm) et l’épaisseur de 2 à 11 mm (moy : 4 mm).
La grande majorité des talons lisibles sur 19 extrémités proximales sont lisses abrasés (15) et 4 sont
lisses sans préparation antérieure au détachement.
Concernant les lamelles, 28 pièces sont fragmentées et 4 sont complètes. La longueur des lamelles
entières est comprise entre 27 et 45 mm. Les largeurs de l’ensemble du corpus se situent entre 6 et 14
mm (moy : 10) et les épaisseurs entre 2 et 4 mm (moy : 2,7). Rapprochées aux lamelles à bord abattu,
où 4 des 5 supports ont une largeur qui se situe entre 6 et 9 mm, nous constatons que les lamelles
brutes sont plus larges de 3 à 4 mm en moyenne. La retouche du dos grignoterait ainsi peu le support
brut. La recherche de produits rectilignes est soulignée par le profil peu convexe des produits, évitant
de ce fait une gestion plus délicate des courbures et un emploit plus aisé, notamment pour un
emmanchement. Les talons sont lisses abrasés pour 8 proximaux, filiformes pour 4, punctiformes pour
2 et lisses pour une. Les talons linéaires et le caractère filiforme de la surface soulignent que les coups
étaient portés très près de la corniche.
Que retenir des techniques de percussion adoptées sur le matériel lithique des ensembles10-12 et
13 ?
Les différentes observations réalisées sur le matériel montrent que pour la majorité des éléments de
plein débitage, la zone de percussion, la morphologie générale, l’angle de chasse et les bulbes sont
compatibles avec l’emploi d’un percuteur tendre organique (Figure 88, S687). Nous ne pouvons
exclure la pierre tendre, mais les caractéristiques de cette percussion, à savoir la présence régulière
d’un cône de percussion net, accompagné de rides très marquées à proximité du bulbe, parfois un
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 142 -
esquillement pouvant emporter l’ensemble du talon et du bulbe, double bulbe (Pelegrin, 2000), ne
satisfont pas les observations réalisées sur les surfaces de contact. Ces stigmates sont par contre
davantage représentés sur les produits d’entretien tels que les lames et les éclats débordants (Figure 88,
S528).
Quant au percuteur minéral dur, qui permet une extraction moins astreignante, simplifiée et beaucoup
plus tributaire d’une morphologie spécifique de la table (Monin, 1998), il n’argumente pas, dans le cas
du plein débitage, les sections régulières et parallèles, caractéristiques des surfaces de débitage
exploitées au percuteur tendre (Valentin, 1995). Cette percussion rentrante est sollicitée pour la phase
de mise en forme des nucléus et le détachement d’éclats épais et dissymétriques.
4 - Approche lithologique des ensembles tardiglaciaires
Contexte siliceux local et origine des matières premières présentes à l’Abbaye I
Dans le secteur centre-sud, bassin de Belley, des lambeaux de conglomérats oligocènes montrent des
silex variés appartenant au Valanginien et à l’Urgonien, ainsi que trois groupes localisés à Andert
concernant des silex sénoniens du Crétacé supérieur (Féblot-Augustins, 2002 (a-b) / Riche et Féblot-
Augustins, 2002) :
- CC2 : ensemble homogène. Blocs ou rognons réguliers atteignant parfois 20 cm. Le cortex est fin et
usé, lisse ou piqueté. La teinte est grise ou marron. L’aspect est mat à semi-brillant. Le grain est
moyen à fin avec présence par endroits de diaclases. La texture est de type wackestone. Les
microorganismes sont signalés par des bryozoaires, chéilostomes et quelques spicules de spongiaires.
- CC3 : silex marron rouge à caramel. La trame est uniforme, le matériau est très homogène, semi-
brillant à brillant, semi-translucide et à grain fin. La texture est mudstone (à Wackestone) avec de rares
foraminifères et spicules de spongiaires.
- CC4 : matériau peu abondant, gris brun clair à foncé, uniforme ou marbré, diffus, assez homogène,
semi mat à grain fin/moyen. La texture est de type wackestone à packestone. On note des fragments de
bryozoaires et de spicules de spongiaires
Plus au sud, à Thuys, un gîte hauterivien sous forme de bancs ou grosses plaquettes de 5 à 7 cm a été
localisé. La couleur du silex est dans la gamme brun-gris à jaune roux avec une présence non
permanente de litage colorimétrique et/ou textural, ce qui s’explique par la présence ou l’absence
d’éléments à pigmentation ferrugineuse et de bandes calcédonieuses. On note la présence de bioclastes
tels que les lamellibranches, échinodermes, bryozoaires, serpulidés et spicules de spongiaires. Les
foraminifères sont assez rares (Féblot-Augustins, 2002 a).
Le Bas-Bugey livre donc des matériaux variés, tous situés en position secondaire. Cette première
collection de référence autorise à nous renseigner, en ayant conscience que d’autres formations,
remaniées ou en place, sont à rechercher dans d’autres secteurs, sur l’origine d’une partie des séries
archéologiques présentes à l’Abbaye.
J. Féblot-Augustins (2002 a) avait déjà précisé la provenance d’une partie du matériel de l’ensemble
10 ainsi que la collection Reymond provenant d’un sondage réalisé en 1960. Les conclusions de cette
étude avaient permis de rapprocher une part importante des artefacts aux silex présents dans les
conglomérats oligocènes voisins (Valanginien et Sénonien) et en bien moindre quantité au Crétacé
inférieur (Hauterivien). Qu’en est-il des pièces concernant les niveaux sous-jacents ?
Notre détermination s’est principalement fondée sur des caractères macroscopiques. Il a été possible
de distinguer 15 familles de matières premières pour les deux ensembles 10-12 et 13 (Tableau 33). 5
sont communes aux deux ensembles (M1-M2-M3-M4 et M5). Ce sont les matériaux les plus
représentés dans les niveaux tardiglaciaires.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 143 -
Pour l’ensemble 13, les matières premières M1, M2, M3, M7, M8 et M9 peuvent être rapprochées des
silex du Crétacé supérieur du bassin d’Andert, soit 78% de la totalité des matériaux représentant ce
niveau. Le silex hauterivien est représenté par M4 et M5, avec un doute concernant M6, soit un taux
de 9,6 %.
Pour l’ensemble 10-12, les silex du Crétacé supérieur (M1, M2, M3 et M14) concernent 45,5% alors
que le silex du Crétacé inférieur, hauterivien (M5 et M12), ne représente qu’un peu plus de 7% de
l’effectif.
La provenance des autres catégories de silex est difficile à établir du fait de nos connaissances limitées
du site et du contexte siliceux environnant, mais une partie pourrait avoir une origine en Chartreuse en
raison d’une variété très comparable avec certaines matières présentes dans ce secteur (Féblot-
Augustins, 2002 a). Par contre nous ne constatons aucun apport de matériaux provenant du nord du
Bugey, notamment de la vallée de l’Ain.
Les principales sources d’approvisionnement se trouveraient donc aux abords du gisement et à
quelques kilomètres plus au sud pour le silex hauterivien, confirmant ainsi les observations déjà
réalisées par J. Féblot-Augustins. Le niveau magdalénien CIII de Thuys II (Reymond, 1964, Bereiziat,
thèse en cours), distant de 6 kilomètres de la grotte de l’Abbaye I et situé au contact direct du gîte du
Crétacé inférieur, montre un approvisionnement similaire où les silex sénoniens et valanginiens
d’Andert sont également bien représentés. Il est possible que l’attrait de ce territoire par les
préhistoriques (5 gisements tardiglaciaires répertoriés) soit à rapprocher de son potentiel siliceux non
négligeable.
Regard sur la gestion des matériaux
Figure 81 : répartition des silex M1 à M5 par catégorie d’objets. A gauche, ens.13, à droite ens.10-12
Les matières premières ne sont pas toutes présentes d’un ensemble à l’autre (Tableau 33). Ainsi pour
l’ensemble 13, 4 matériaux (M6, M7, M8 et M9) ne se retrouvent pas dans l’ensemble 10-12.
Inversement, les matériaux M10 à M15 de l’ensemble 10-12 ne sont pas représentés dans l’ensemble
13. Cette distribution différentielle semble dessiner une variabilité des zones d’approvisionnement
pour certains silex, mais cette hypothèse serait à confirmer du fait de l’exiguïté de la surface fouillée.
Pour les matériaux communs aux deux ensembles (M1 à M5), nous remarquons une exploitation
divergente centrée sur les objectifs de production (Figure 89). Pour l’ensemble 13, le débitage est axé
sur une production lamino-lamellaire alors que pour l’ensemble 10-12, l’orientation du débitage
concerne principalement la production laminaire (12) plutôt que lamellaire (4). Par contre, nous
retrouvons dans des proportions assez comparables toutes les catégories représentant les étapes de
mise en forme et d’entretien du nodule.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 144 -
Les matériaux concernant des éléments esseulés (divers, Tableau 33) traduisent éventuellement un
apport en support utilitaire comme il est courant de le voir à la période magdalénienne. Sur les 13
éléments répertoriés, 6 correspondent à des produits de plein débitage (3 lames et 3 lamelles) dont 3
sont façonnés.
5 - Conclusion : insertion du matériel dans un cadre chrono-culturel.
Les trois datations calent l’ensemble 10-12 dans la biozone du Bölling (Figure 30, p.41). Elles se
rapprochent de celles observées sur de nombreux sites du Jura méridional, mais ne sont pas strictement
contemporaines. Elles s’intercalent entre deux phases culturelles : une première phase pour des sites
du Magdalénien supérieur et situés en limite fin du Dryas ancien et début du Bölling, pour Les
Romains (niv. III 12 690 +/- 60 B.P., niv IIb 12 540 +/- 400 B.P. et 12 830 +/- 60 B.P. – Pion, 2000
p.154), La Chênelaz (12 610 +/- 200 B.P. et 12 780 +/- 75 B.P. – Cartonnet et Naton, 2000, p.240),
Les Hoteaux (niv. inférieurs, 12 830 +/-75 B.P. – Pion, 2004) et l’abri Gay (niv. F2 d, 12 980 +/- 70
B.P. – Pion, 2000, p157), et une deuxième phase, d’azilianisation, pour les sites de La Raillarde
(12 180 +/- 80 B.P. – Pion, 2000, p.160) et l’abri Gay (niv. F2a/b 12 160 +/- 60 B.P. – Pion, 2000,
p.157). Il est très probable que la datation engagée pour l’ensemble 13 soit contemporaine, sinon
légèrement plus ancienne, que l’ensemble 10-12 étant donné le peu de divergence rencontré entre les
deux assemblages.
La pauvreté du corpus ne nous permet malheureusement pas de préciser davantage le cadre chrono-
culturel de l’industrie lithique. L’absence de fossiles directeurs limite notamment la portée de notre
jugement.
Pour plusieurs sites régionaux, la présence, même à l’unité, d’éléments caractéristiques permet
souvent de replacer une série dans un contexte défini. Nous pouvons citer ici l’exemple de deux outils
spécifiques, une pointe de Teyjat et une pointe de Lingby, qui ont permis de replacer le matériel
lithique non daté de La Bonne Femme (Brégnier-Cordon) et de La Grand’Baille (Leymiat – Poncin)
au sein d’un magdalénien final (Desbrosse, 1976) d’affinité méridionale pour le premier (sud-ouest de
La France) et septentrionale pour le second (Nord de la France, Suisse et Allemagne du sud).
Technologiquement, les modalités du débitage précisées dans cette étude s’inscrivent dans la tradition
d’un magdalénien évoluant vers l’épipaléolithique. La mise en forme, souvent simplifiée (absence de
préparation en crête bilatérale), confère à la table de débitage un cintre et une carène assez régulière.
L’objectif de la production est essentiellement laminaire ou lamellaire. Les produits sont
majoritairement obtenus par percussion tendre organique dans le cadre du plein débitage et parfois
secondée par la pierre tendre pour l’entretien de la surface. Caractéristique des techniques de la fin du
tardiglaciaire, l’emploi de la pierre tendre pour la percussion peut être un élément permettant de situer
ces ensembles au sein d’un magdalénien tardif (final ?), dans une période de transition où l’évolution
des comportements humains, tant au niveau de la gestion du territoire que de la composition
matérielle, coïncide avec des changements environnementaux importants. Dans cette optique, la
connaissance de la faune chassée par les paléolithiques sera une donnée importante pour pouvoir
caractériser un peu plus ces occupations.
Nous conclurons en rappelant que nos observations sont réduites à la taille de l’échantillon et nous
espérons qu’une fouille élargie puisse un jour argumenter davantage notre perception actuelle du
matériel.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 145 -
Ens. 13 identité description objet
burin dièdre M13-d.69a-C4-V6 10 (S547)
Dim : 32x19x6 mm Burin dièdre déjété à gauche. Réalisé sur lame de plein débitage fragmenté en partie proximale par flexion inverse. Section triangulaire, silhouette légèrement torse. Biseau localisé en position distale, d'une épaisseur de 5 mm et angulation de 60°. 2 ravivages exercés à droite.
perçoir M13-d.68a-V7 (S554)
Dim : frag. distal actif : 18x8x3 mm - après remontage : 32x11x3 mm Perçoir avec rostre déjeté à gauche. Réalisé sur lamelle de plein débitage fragmentée en partie proximale par flexion inverse. Remontage avec extrémité proximale possédant un talon lisse abrasé. Section trapézoïdale et silhouette torse. Rostre en partie distale à retouche directe abrupte et subparallèle sur le côté droit. Pointe fragmentée.
lamelle à bord abattu M13-d69e-V2 12 (S511)
Dim : 27x11x3 mm Réalisée sur lamelle de plein débitage, fragmentée par flexion inverse en partie proximale et par cassure franche en partie distale. Support retouché sur les deux bords : une retouche directe abrupte irrégulière et totale sur bord droit et inverse sur bord gauche. Section triangulaire et silhouette légèrement torse.
Ens. 10.12 identité description objet
grattoir M14-S13 21 Dim : 70x28x10 mm Grattoir sur lame retouchée. Réalisé sur lame débordante de plein débitage à deux nervures, de profil convexe et de délinéation régulière. Support fragmenté par flexion inverse proximale. Front localisé en partie distale de 27 mm de largeur et 8 mm d'épaisseur. Retouche non convergente irrégulière. Angle du front = 80°. Observations supplémentaires : bords denticulés correspondant à un possible emmanchement / petit esquillement sur face inférieure du front.
troncature N12-d60 22 (S507) Dim : 58x20x7 mm Réalisée sur lame fragmentée de plein débitage de section trapézoïdale et de silhouette torse. Troncature oblique en partie distale par des retouches directes assez marginales. A noter de fines retouches "encochées" sur les bords.
M13-d47-C4 (S508) Dim : 23x11x5 mm Réalisée sur une lamelle de plein débitage assez irrégulière de section à 4 pans. Troncature droite à retouche semi-abrupte en partie distale.
encoche M13-C4-d27 (S509) Dim : 34x18x3 mm Réalisée sur éclat laminaire débordant. Série d'encoches sur le bord droit.
lamelle à bord abattu M12-d40 (S002) Dim : 14x7x3 mm Réalisée sur lamelle de plein débitage, fragmenté (éclaté au feu) en partie distale. Retouche totale abrupte, subparallèle sur le bord droit. Section trinagulaire et silhouette plane. Talon punctiforme abrasé.
M13-d49 (S003) Dim : 16x7x2 mm Réalisée sur lamelle de plein débitage fragmentée par flexion inverse en partie mésio-distale. Section trapézoïdale et silhouette plane. Retouche semi-abrupte sur le bord droit, parallèle et de délinéation régulière et légèrement concave.
Secteur T18-19 identité description objet
bec T19-d63 (S031) Dim : 21x11x6 mm Perçoir-bec avec rostre déjeté à gauche. Réalisé sur un éclat fragmenté en partie proximale. Rostre dégagé sur une longueur de 10 mm, désignant de ce fait plus un bec qu'un perçoir. Retouche bilatérale abrupte.
lamelle à bord abattu T18-d41(S030) Dim : 24x6x2 mm Réalisée sur lamelle de plein débitage, très fine et très régulière. Support fragmenté par flexion inverse en partie proximale. Section triangulaire. Retouche bilatérale partielle et rasante.
T19-d63 (S026) Dim : 25x9x2 mm Réalisée sur lamelle de plein débitage fragmentée par flexion inverse en partie distale et proximale. Section trapézoïdale et silhouette légèrement courbe. Retouche semi-abrupte à rasante, droite et parallèle sur le bord droit.
Tableau 32 : Description technologique des outils des ensembles 10-12 et 13 et du secteur T18-19
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 146 -
Figure 82 : secteurs concernés par la séquence inférieure (plan J.F. Buard).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 147 -
Figure 83 : plan de répartition des supports des ensembles 10-12 (pièces cotées, plan J.-F. Buard)
Figure 84 : plan de répartition des matières des ensembles 10-12 (pièces cotées, plan J.-F. Buard)
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 148 -
Figure 85 : plan de répartition des supports de l’ensemble 13 (pièces cotées, plan J.-F. Buard)
Figure 86 : plan de répartition des matières de l’ensemble 13 (pièces cotées, plan J.-F. Buard)
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 149 -
MATIERES PREMIERES ENS 13
PHASE FONCTION SUPPORT M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 divers brûlé TOTAL
1 Mise en forme Eclat cortical 12 1 1 1 1 2 18
Eclat 10 6 4 1 1 1 1 1 2 8 35
2a Plein débitage Lame brute 7 4 1 1 4 1 2 20
Lamelle brute 5 9 2 2 1 1 20
2b Entretien du nucléus
Lame à crête 1 1 2
Lamelle à crête 1 1
Produit de correction 17 5 9 1 2 4 2 1 1 42
Eclat de ravivage 2 2
3 Abandon nodule Nucléus 1 1 2
4 Façonnage
Outil sur lame 1 1
Outil sur lamelle 1 1 2
Outil sur éclat 0
TOTAL 52 29 19 3 3 8 6 4 3 0 0 0 0 0 0 7 11 145
MATIERES PREMIERES ENS 10-12
1 Mise en forme Eclat cortical 9 2 1 1 1 2 3 19
Eclat 2 3 1 3 4 1 1 11 26
2a Plein débitage Lame brute 6 2 4 1 1 2 16
Lamelle brute 2 1 1 1 1 6
2b Entretien du nucléus
Lame à crête 2 1 1 4
Lamelle à crête 1 1 2
Produit de correction 6 2 7 12 1 4 3 3 1 3 1 43
Eclat de ravivage 1 1
3 Abandon nodule Nucléus 0
4 Façonnage
Outil sur lame 1 1 1 3
Outil sur lamelle 1 1 2
Outil sur éclat 1 1
TOTAL 26 7 19 14 4 0 0 0 0 11 6 5 4 4 4 6 13 123
Tableau 33 : Décompte numérique par matière première et par catégorie technologique pour les ensembles 10-12 et 13. Case colorée en orange : matières premières communes aux deux
ensembles.
- 151 -
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012
Figure 87 : secteur NM-12/13, silex provenant de la séquence inférieure. Ens.9.21 : s004; Ens.10, horizon
St14: s005, s006, s506; Ens.10 horizon St23 : s002; Ens.11 : s003; matériel du secteur T18-19: s050, s030,
s031, s026 et s041 (Dessin T. Perrin et S. Perret).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 152 -
Figure 88 : S511, ens. 13 : lamelle à bord abattu ; S554, ens.13 : perçoir déjeté – raccord avec partie
proximale ; S547, ens.13 : burin dièdre ; S507, ens.10-12 : troncature ; S508, ens.10-12 : troncature ; S509,
ens.10-12 : encoche ; S652, ens.10-12 : lamelle à crête à un versant (néocrête) ; S570, ens.13 : tablette de
plan de frappe ; S709, ens.10-12 : grattoir sur lame retouchée ; S659, ens.10-12 : remontage éclat lamellaire
et lame courte outrepassée ; S528, ens.13 : fragment de lame débordante portant des stigmates de percussion
à la pierre tendre ; S687, ens.10-12 : fragment lame portant un talon caractéristique d’une percussion tendre
organique. S627, ens 10-12 : fragment de lame (ech : ¾, Dessin J. Patouret).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 153 -
Figure 89 : Nucléus de l’ensemble 13 (dessin G. Bereiziat)
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 154 -
6 - Références bibliographiques mentionnées :
CARTONNET M. et NATON H.G. 2000 – Le Magdalénien de la grotte de La Chênelaz à Hostias
(Ain). In, PION G. (dir.) et alii 2000 - Le paléolithique Supérieur récent : nouvelles données sur le
peuplement et l’environnement. Actes de la table ronde de Chambéry, 12-13 mars 1999, Société
Préhistorique Française, mémoire XXVIII, p.235-243
DESBROSSE R. 1976 - Les civilisations du paléolithique supérieur dans le Jura méridional et dans les Alpes du
Nord ; in : La préhistoire française : Les civilisations paléolithiques et mésolithiques de la France ; Ed.
CNRS ; Nice. t.1, p.1196-1213
FEBLOT-AUGUSTINS J. 2002 (a) – Provenance des matériaux lithiques de la grotte de l’Abbaye I
(fouilles anciennes et récentes). In Buard J.-F. et alii, 2002. Abbaye I, Chazey-Bons, Ain : rapport
de synthèse 2002 (Inédit, Service Régional de l’Archéologie, Direction Régionale des Affaires
culturelles, Rhône-Alpes. p. 63-70
FÉBLOT-AUGUSTINS J. 2002 (b) - Exploitation des matières premières et mobilité dans le Bugey. Un aperçu
diachronique du Magdalénien moyen au Néolithique. In BAILLYM., FURESTIER R. & PERRIN Th. (éds),
Les industries lithiques taillées holocènes du Bassin rhodanien. Problèmes et actualités. Montagnac, Éditions
Monique Mergoil (collection Préhistoires), p. 13-27.
MONIN G. 1997 – Approche technologique des assemblages tardiglaciaires des grottes de la
Passagère et Colomb, à Méaudre (Vercors, Isère). DEA de préhistoire. U.F.R Civilisations et
Humanités, Université de Provence Centre d’Aix. 152 p.
PELEGRIN J. 2000 – Les techniques de débitage laminaire au Tardiglaciaire : critères de diagnose et
quelques réflexions. In L’Europe centrale et septentrionale au Tardiglaciaire. Acte du colloque de
Nemours, 13 - 16 mai 1997. Mémoires sur Musée de Préhistoire d’Ile de France.p.73-86
PION G. (dir.) et alii 2000 - Le paléolithique Supérieur récent : nouvelles données sur le peuplement
et l’environnement. Actes de la table ronde de Chambéry, 12-13 mars 1999, Société Préhistorique
Française, mémoire XXVIII, p.147-164
PION G. 2004 - Magdalénien, Epipaléolithique et Mésolithique ancien au Tardiglaciaire dans les deux Savoies et le Jura Méridional. Thèse de 3ème cycle. Université de Besançon
REYMOND J. 1964 – Nouveaux gisements préhistoriques dans le Bugey. Extrait du bulletin mensuel
de la société linéenne de Lyon. Fasc, 33ème année, n°4, p.139-147
RICHE C. & FÉBLOT-AUGUSTINS J. 2002. La caractérisation pétrographique des silex. Application de la méthode à deux contextes géologiques et géographiques particuliers (sud Vercors et Bugey. In BAILLY M., FURESTIER R. & PERRIN Th. (éds), Les industries lithiques taillées holocènes du Bassin rhodanien. Problèmes et actualités. Montagnac, Éditions Monique Mergoil (collection Préhistoires), p.
29-50.
VALENTIN B. 1995 - Les groupes humains et leurs traditions au Tardiglaciaire dans le Bassin
Parisien. Apports de la technologie lithique comparée, Thèse de Doctorat, Université Paris I, 3
vol., ex. multigraph., 834 p.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 155 -
CHAPITRE X
Examen archéozoologique de la faune de la séquence inférieure de La grotte
de l’Abbaye Chazey-Bons, Ain
Jean-Christophe Castel
et
Mathieu Luret
L’examen du matériel que nous avons entrepris a été réalisé selon les méthodes qui sont
habituellement mises en œuvre pour les sites du Paléolithique supérieur notamment dans le Sud-
ouest de la France (cf. Castel rapports de fouille des sites de Castanet, Roc-de-Marsal, Le Piage,
Petit Cloup Barrat, etc.). Nous avons examiné la totalité du matériel récolté en octobre 2009 dans le
département d’archéozoologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
Le matériel faunique paléolithique (US10.2, 11.1, 11.2, 12, 13, 13.1 et 13.2) a été analysé en deux
corpus qui ont fait l’objet de deux analyses distinctes :
- les vestiges numérotés (coordonnés) à la fouille ont été caractérisés le plus précisément possible ;
la plupart de ceux de plus de 30 mm ont été déterminés au moins d’un point de vue anatomique à
un niveau assez large (diaphyse d’os long, fragment de côte, etc.).
- les vestiges récoltés au tamisage, qui sont de toutes petites dimensions, ont été caractérisés de
façon plus sommaire (cf. Castel 2005). Ceux de ces vestiges qui ont été considérés comme
déterminables ont été isolés et joints à la base des vestiges numérotés.
1 - Taphonomie
Caractérisation des vestiges non déterminables récoltés lors du tamisage
Quelques 110 sachets de tamisage examinés ont permis de décompter 27.333 fragments osseux qui
ont été caractérisés en fonction de :
- les tissus osseux,
- leur longueur,
- leur degré de combustion.
Les fragments inférieurs à 10 mm de longueur n’ont pas été caractérisés en fonction des tissus
osseux. Etant donné que les vestiges de petites dimensions sont susceptibles de constituer une part
significative du total de la matière osseuse conservée dans le gisement, cet examen permet une
approche complémentaire à l'analyse des vestiges enregistrés et numérotés à la fouille.
Dans le cadre de ce travail, ce corpus a été traité globalement sans tenir compte des unités
stratigraphiques. Les données recueillies pourraient contribuer à la définition de ces unités donc de
la mise en place du Paléolithique de la grotte de l'Abbaye mais nous avons considéré que les
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 156 -
informations sur ces unités étaient suffisamment précises (cf. rapports des fouilles de J.-F. Buard et
al.). De plus 96 % du nombre de vestiges se rapporte à l’ensemble 13 (13, 13.1, 13.2).
Dimensions des vestiges
1
10
100
1000
10000
100000
< 10 mm 10 à 20
mm
20 à 30
mm
30 à 40
mm
40 à 50
mm
50 à 60
mm
60 à 70
mm
70 à 80
mm
80 à 90
mm
90 à 100
mm
NR n. b.
de plus
de 100
mmLongueur
No
mb
re d
e r
este
s
Non brûlés
Brûlés
Dimensions des vestiges
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
< 10 mm 10 à 20
mm
20 à 30
mm
30 à 40
mm
40 à 50
mm
50 à 60
mm
60 à 70
mm
70 à 80
mm
80 à 90
mm
90 à 100
mm
NR n. b.
de plus
de 100
mmLongueur
No
mb
re d
e r
este
s
Non brûlés
Brûlés
Figure 1 –
Figure 90 : US 10.2, 11.1, 11.2, 12, 13, 13.1 et 13.2. Décompte du nombre total de vestiges récolté lors des
fouilles (y compris les vestiges numérotés et/ou déterminés). Echelles logarithmique et arithmétique.
La figure ci-dessus permet de rendre compte de la fragmentation extrêmement importante du
matériel (mais aussi de la qualité de la récolte archéologique). Une large proportion des vestiges
mesure moins d’un centimètre (83 %). L’assemblage étant constitué d’os d’ongulés de taille
moyenne (le cerf – voir plus loin), les vestiges déterminables sont relativement peu nombreux : les
vestiges de plus de 30 mm comptent pour moins de 1 % de l’assemblage et environ 300 restes. Les
restes de plus de 50 mm (longueur à partir de laquelle on peut espérer déterminer un fragment de
diaphyse de cerf) ne sont que 77. La mesure de ce concassage est accentuée si l'on ne prend en
compte que les diaphyses de plus de 30 mm dont la longueur moyenne n'est que de 45 mm ce qui
est très faible pour un animal de la taille du cerf.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 157 -
Les os brûlés sont présents en grandes quantités parmi les fragments de moins de 30 mm. Leur
proportion augmente dans les classes les plus petites.
Les tissus osseux représentés sont principalement de l’os compact, que ce soit pour les os brûlés ou
les non-brûlés. Les os spongieux et les côtes représentent 30,8 % du matériel non brûlé de petites
dimensions (10 à 40 mm) et 18,6 % des os brûlés. Ces valeurs sont relativement faibles (cf.
Costamagno et al. 2008). Il n’y a donc pas de sélection de l’os spongieux (+ côtes) pour l’utiliser
comme combustible.
Compte tenu de la forte représentation des diaphyses – donc de l’os compact - parmi les fragments
de plus de 30 mm, on peut conclure qu’il y a une forte sous-représentation de l’os spongieux et des
côtes dans les couches paléolithiques de la grotte de l’Abbaye
Compact
Côtes
Spongieux
Dents
Brûlé Compact
Brûlé Côtes
Brûlé Spongieux
Brûlé Dents
Figure 91 : pourcentage des différents types de tissus pour 10 < L < 40 mm (NR=3944)
Etats de surface
Ce qui caractérise principalement les os de la grotte de l'Abbaye est leur concrétionnement
superficiel. Ce phénomène est très répandu parmi le matériel examiné (photo 1) mais ne semble pas
nuire à la bonne conservation des vestiges (Figure 92). En revanche cela empêche l'observation des
stigmates d'origine anthropique telles que les stries ; malgré cela, la moitié des vestiges se prête à
une observation correcte (dans le cas de concrétions marginales ou absentes). Les autres
dégradations des os sont modérément développées (érosion mécanique des angles assez importante,
dissolution et exfoliation rares, trace de racines rares). On peut donc conclure qu'à part le
concrétionnement les os de la grotte de l'Abbaye sont bien conservés.
Photo 1 : exemple de concrétionnement des vestiges osseux de la grotte de l’Abbaye.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 158 -
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
10 à 20 mm (90)
20 à 30 mm (160)
30 à 40 mm (134)
40 à 50 mm (68)
50 à 60 mm (36)
sup à 60 mm (38)L
on
gu
eu
r (+
NR
)
% de restes
nulle (0%)
marginale (5-10 %)
peu étendue (15-25 %)
importante (30-50 %)
couverte (60-100 %)
Figure 93 : extension des concrétions parmi les vestiges non brûlés de plus de 30 mm.
La couleur des os a également été notée (Figure 94). Les concrétions sont de couleur blanche ou
grise (Figure 95). Nous n’avons pas exploité ces informations qui pourraient permettre de préciser
la nature des différentes unités stratigraphiques.
Blanc
Jaune
Orangé
Brun
Brûlés
Figure 94 : couleur des os (NR = 540) parmi les vestiges côtés et/ou déterminés.
Blanc
Jaune
Gris
Noir
Figure 95 : couleur des concrétions (NR = 441) parmi les vestiges côtés et/ou déterminés.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 159 -
Aucune morsure de carnivore n’a été observée parmi les vestiges de la base de données principale
ou parmi les non-cotés.
2 - Activités humaines
Les taxons représentés
L’assemblage examiné plus précisément, de petite taille, comporte 544 vestiges. Une majorité n’est
pas déterminée au-delà de la classe de taille ou au-delà de l’identification sommaire en ce qui
concerne les fragments de diaphyses. Si l’on ne retient que les restes déterminés anatomiquement
ou taxonomiquement le corpus est de 132 restes.
L’assemblage est pratiquement monospécifique et composé de cerf (NR = 106). Seul un reste de
lynx vient ajouter un peu de variété. Ce dernier est un petit fragment proximal de 3ème
métacarpien
(photo 2). A cela s’ajoutent 27 autres restes déterminés anatomiquement qui peuvent correspondre
au cerf. Sur la base du secteur fouillé, le cerf représente donc l’objet principal, sinon exclusif, des
chasses organisées par les Magdaléniens de la grotte de l’Abbaye.
Photo 2 : fragment proximal de 3ème
métacarpien de lynx.
Age et saison d’abattage
Sept restes crâniens ou mandibulaires portant des dents ont été identifiés ; ils correspondent à trois
individus minimum, tous de jeunes adultes (24 mois à 6 ans) (photo 3). A signaler, la présence de
deux os de fœtus d'un mammifère qui n’a pas pu être déterminé (photo 4). Ils signalent un abattage
et une présence hivernale.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 160 -
Photo 3 : fragment de mandibule de cerf ; celui-ci est le mieux conservé de l’assemblage.
Photo 4 : scapula de fœtus de mammifère artiodactyle.
Représentation anatomique du cerf
Taxon
Crâ
ne
Dent
isolé
e
Ma
ndib
ule
Hyoïd
e
Vert
èbre
s
Côte
s
Cein
ture
s
Hum
éru
s
Radiu
s
Uln
a
Fé
mur
Tib
ia
Basip
ode
Mé
tacarp
ien
Mé
tata
rsie
n
Méta
pode in
d.
Phala
nges
Phala
nges v
estig
ielle
s
Sésam
oïd
es
To
tal
Moyen ou grand mammifère ind. 1 1 1 3
Cerf 3 10 4 1 4 2 2 1 1 3 2 4 4 3 4 34 15 9 106
Ongulé moyen indéterminé 3 1 1 7 4 2 1 19
Petit ou moyen ongulé ind. 1 1
Lynx MC3 1
Mammifère indéterminé 1 1 2
Total 9 11 5 2 11 6 3 1 1 3 3 4 7 1 3 4 34 15 10 132
Tableau 34 : représentation squelettique des principaux taxons.
Le NMI ne dépasse l'unité que pour les restes dentaires. Le squelette axial est extrêmement peu
représenté. Les 11 fragments vertébraux identifiés sont petits (longueur moyenne : 28 mm) et
correspondent à différents types de vertèbres. Celles-ci ont subi une destruction très importante.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 161 -
Les côtes sont encore plus rares : NR = 5 (longueur moyenne 40 mm) ce qui, cumulé, ne fait même
pas l'équivalent d'une seule côte de cerf. Les ceintures sont tout aussi mal représentées.
La situation est similaire pour les épiphyses des os longs et les os du basipode. Les diaphyses sont
un peu plus abondantes mais ce sont surtout les phalanges des doigts principaux et accessoires qui
dominent le corpus. Cette abondance des phalanges vestigielles contraste avec la rareté des
métapodes notamment celle du métacarpien qui n'a pas été identifié malgré le caractère très aisé de
cette détermination. Les différents os longs sont présents, réduits en fragments de petites
dimensions.
Nous avons tenté de mesurer l'éventuel déficit des diaphyses par rapport au crâne ou aux extrémités
distales des membres. 219 fragments de diaphyses de plus de 30 mm ont été comptés (tamisage +
détermination par classe de taille + détermination précise). La longueur totale de ces fragments a
été estimée à 9901 mm (somme précise pour les plus de 40 mm qui ont en totalité été mesurés +
évaluation pour les 30-40 mm dont seule la partie numéroté et déterminée à été mesurée). La
largeur moyenne de ces fragments est estimée très sommairement à 18 mm. Cela donne la surface
totale de 178000 mm2. La surface totale des os longs d'un squelette de cerf de taille comparable est
de 241600 mm2 (humérus : 150x100x2 ; radius : 220x90x2 ; MC : 200x80x2 ; fémur : 180x100x2 ;
tibia : 290x100x2 ; MT : 230x100x2). La surface totale des vestiges diaphyses conservées de plus
de 30 mm est donc légèrement inférieure à celle d'un cerf complet. Si l'on ajoute les fragments
inférieurs à 30 mm on atteint probablement une valeur de surface légèrement supérieure à l'unité ce
qui reste très peu.
Le déficit en épiphyses d'os longs et en os du basipode est encore plus important. Il ne peut pas être
justifié par le concassage de ces parties. En effet, il n'y a pas assez d'os correspondants
(essentiellement de l'os spongieux) parmi les petits fragments (< 30 mm). Les diaphyses étant
présentes en proportion plus importante, on doit suspecter une destruction des épiphyses et des os
du basipode dans le site, donc après transport. Cette destruction peut être d'origine naturelle ou
anthropique.
La combustion de l'os a manifestement joué un rôle important dans la zone de fouille. L'os compact
représente 81 % des fragments de plus de 10 mm de longueur. Il ne semble donc pas y avoir de
combustion préférentielle de l'os spongieux dans ce foyer ou alors celui-ci est totalement détruit
(cet os spongieux peut-il être identifié par des analyses micromorphologiques comme le pensent
certains auteurs (Gé et Courty com. pers.). Au terme de cette analyse, l'origine du déficit en os
spongieux des membres n'est pas déterminée. Quant à celui du squelette axial la situation est encore
moins précise puisqu'il n'est pas certain que les vertèbres et les côtes aient été introduites dans la
grotte (au vu des informations du secteur de fouille d'extension limitée).
L’origine de cette sur-représentation des phalanges reste à déterminer. L’abondance des phalanges
vestigielles incite à la prudence. Il ne s’agit pas simplement d’extrémités de pattes qui auraient été
rejetées ou de phalanges abandonnées dans une peau de renne devenue inutile. Ce mode de
conservation des peaux n’explique pas la présence des phalanges vestigielles.
L’hypothèse d’un rejet des bas de pattes dans les foyers n’est pas satisfaisante non plus puisque il y
a très peu de phalanges brûlées alors que ces os sont aisément identifiables même sous forme de
petits fragments.
Découpe et fracturation des os à moelle
Seuls trois os striés ont été repérés (photo 5); ces stries sont parfaitement identifiables et nettes et
les stigmates similaires plus ou moins effacés sont rares (strie de frottement d’origine naturelle ou
dont l’origine anthropique est douteuse). Cela fait extrêmement peu compte tenu de la relativement
bonne conservation des vestiges. Les sites en grotte du Paléolithique supérieur en livrent
généralement une plus forte proportion même si les os sont médiocrement conservés. Cette rareté
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 162 -
des stries est donc le résultat d'un mode d'exploitation particulier des carcasses et non des
conditions de fossilisation.
Photo 5 : exemple d’os strié (Echelle millimétrique).
Les os longs ont subi une forte fracturation (intentionnelle, sur os frais) qui va au-delà de la simple
ouverture des diaphyses pour accéder à la moelle. Les fragments de plus de 30 mm ont une
longueur moyenne de 45 mm ce qui est très peu.
Toutes les premières et secondes phalanges ainsi que 75 % des troisièmes phalanges sont
fragmentaires. La fracturation intentionnelle est attestée sur certains de ces fragments qui
présentent des bords lisses et obliques. La récupération de la moelle des phalanges est donc attestée
mais la proportion concernée ne peut déterminée avec précision.
Industrie osseuse et parure.
Nous n’avons observé de retouchoir. A signaler la présence d’un petit fragment partiellement brûlé
d’un objet appointé (photo 6).
Photo 6 : fragment de poinçon ou outil assimilé, partiellement brûlé.
Comparaisons régionales
Le corpus de données régionales bien datées est assez important (Bridault et Chaix, 2009). Le cerf
est présent dans la majorité des sites contemporains (ca. 12.350 cal. BC) mais sont ceux où il
domine autant qu’à l’Abbaye sont peu fréquents ; on peut mentionner Rochedane (Doubs, Bridault,
1993 et Bridault et Chaix, 2009) et Hauterive-Champréveyres (Morel et Müller 1997).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 163 -
Quant au lynx, sa présence se limite au site de Hauterive-Champréveyres où il serait présent au
Magdalénien supérieur comme à l’Azilien.
3 - Perspectives
Le présent travail ne représente pas l’aboutissement de ce que l’on peut dire de la faune de la grotte
de l’Abbaye mais une étape suffisamment détaillée. Il conviendrait notamment de mieux
déterminer l’origine de la représentation anatomique si particulière de la grotte de l’Abbaye et de
mieux assurer les comparaisons régionales. Enfin, si l’on souhaite que la grotte de l’Abbaye
contribue à une connaissance des comportements des Magdaléniens à l’échelle régionale il serait
judicieux d’étendre la zone de fouille afin de déterminer si les informations obtenues sur moins de
4 m2 – mais en réalité M13 représente 99 % du matériel récolté – sont représentatives de
l’ensemble de l’habitat. Ainsi la nature de cet habitat pourrait être mieux déterminée : halte de
chasse ou de séjour prolongé ? On peut y ajouter les questions suivantes : Quelle saison de
fréquentation, quelle sélection du gibier ? Il va sans dire que les conditions actuelles de gisement ne
rendront pas aisée une telle recherche.
4 - Bibliographie
Bridault A, 1993 Les économies de chasse épipaléolithiques et mésolithiques dans le Nord et l'Est de la France.
Thèse, Université de Paris X, non publiée.
Bridault A. et Chaix L., 2009. Réflexions sur la recomposition des spectres fauniques dans le massif jurassien et
les Alpes françaises du nord durant le Tardiglaciaire. In : Pion G. (Dir.) : La fin du Paléolithique supérieur
dans les Alpes du françaises et le Jura méridional. Société Préhistorique Française, Mémoire 50, p. 59-71.
Castel J.-C., 2005. Economie préhistorique, boucherie et décompte des fragments osseux. Revue de
Paléobiologie, Genève, vol. spéc. 10, Hommages à Louis Chaix. p. 23-30.
Costamagno S., Théry-Parisot I., Castel J.-C., Brugal J.-Ph., 2009. Combustible ou non ? Analyse
multifactorielle et modèles explicatifs sur des ossements brûlés paléolithiques. In : Théry-Parisot,
I., Costamagno S., Henry, A. (Eds) : Fuel and Mangement during the Palaeolithic and Mesolithic periods :
new tools, new interpretations. BAR Int. Series 1914 : 65-84. Actes du colloque international de l’IUSPP,
Lisbonne 2006. p. 65-84.
Morel P. et Müller W., 1997. Hauterive-Champréveyres, 11. Un campement magdalénien au bord du lac de
Neuchâtel : étude archéozoologique (secteur 1). Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie ; Archéologie
neuchâteloise, 23.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 165 -
Annexes
1 - Références
- Nom du site : Grotte de l'Abbaye I. - Commune : Chazey-Bons.
- Département : Ain. - Pays : France.
- Site archéologique : No 01 098 001 AP. - code PATRIARCHE : 7624
- Carte IGN : 1:25 000 3231 est. - Coordonnées Lambert II étendu :
- Altitude : 270 m. 859.350 / 2093.585 km.
- Parcelle cadastrale : No 271, Chazey-Bons feuille A1, révision 1986.
- Propriété : Anthelme Charpy (Gevrin, Ain).
- Responsable de l’étude : Jean-François BUARD
Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie
Institut F.-A. Forel
Sciences de la Terre et de l’environnement
Université de Genève
18 rue Gustave-Revilliod
CH - 1211 GENÈVE 24.
2 - Abréviations utilisés dans les catalogues :
Ens. : ensemble stratigraphique.
E, F, St : empierrement, foyer, structures.
P, M, G, B : pierres de petite (3-7), moyenne (7-15), grande taille (15-25) et bloc (>25 cm.).
rub : rubéfié (Mrub : pierre de taille moyenne rubéfiée).
A, L, S : argiles, limons et sable (SL : sables limoneux).
Cn : concrétion.
Ro, Rj, Rs : rubéfactions orange, jaunes et sombres.
Cb, Cg, Cgc, Cgs, Cgn : cendres blanches, grises, gris claire, gris sombre, gris-noirâtre.
Ch : charbons.
Galets pp : petits galets
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 166 -
3 - Catalogue des empierrements
NoE Recoupements Statut Type pierres rub origine Us Phase
E1 E3 Obsolète 7.1 Chasséen ancien
E2 Obsolète 7.2 Chasséen ancien
E3 E18, E31, F33, St6
Important grand-rejet, dépotoir
oui anthropique. 7.1 Chasséen ancien
E4 Obsolète 2.21 Bronze ancien
E5 E12 ? Vague 4 NMB
E6 E16? Vague -2 Contexte incertain
E7 E18 Obsolète 7.1 Chasséen ancien
E9 Vague petit oui anthropique? 3.11 Néolithique final sup
E10 Important moyen-rejet oui anthropique. 2.1 Bronze moyen
E11 Cohérent. Géol. remplissage St49
géologique. 7.2 Chasséen ancien
E12 E5 Important niv. pierreux oui niveau pierreux 4 NMB
E13 Cohérent moyen-rejet oui anthropique. 3.11 Néolithique final sup
E14 Cohérent petit géologique ? 5 Chasséen moyen
E15 Cohérent petit géologique ? 5 Chasséen moyen
E16 F19, F24 Important niv. pierreux oui niveau pierreux 5 Chasséen moyen
E18 E25, F34, E3, E31
Important niv. pierreux oui niveau pierreux 7.1 Chasséen ancien
E8 F30 Cohérent base foyer oui niveau pierreux 2.21 Bronze ancien
E19 E18 Obsolète 7.1 Chasséen ancien
E20 E25, F27 Cohérent. Géol. moyen oui géologique. 7.1 Chasséen ancien
E21 Obsolète 7.1 Chasséen ancien
E22 Cohérent. Géol. remplissage St44
géologique. 7.2 Chasséen ancien
E24 E23 Cohérent. Géol. remplissage St43
géologique. 7.2 Chasséen ancien
E25 E20, E18 Cohérent. Géol. remplissage St45
géologique. 7.2 Chasséen ancien
E26 Cohérent. Géol. niv pierreux géologique. 8 Atlantique ancien
E27 Cohérent petit-rejet oui anthropique. 1.3 Bronze final IIIa
E28 F29, F35, St48 Cohérent base foyer oui anthropique. 7.2 Chasséen ancien
E29 Cohérent petit-rejet oui anthropique. 2.1 Bronze moyen
E30 Cohérent petit anthropique ? 2.1 Bronze moyen
E23 E24, E31 ? Cohérent. Géol. niv pierreux oui niveau pierreux 7.2 Chasséen ancien
E31 F38, E3 Important niv pierreux oui niveau pierreux 7.2 Chasséen ancien
E32 F44, F45 Important niv pierreux oui niveau pierreux 3.2 Néolithique final inf.
E33 St50 Cohérent zone pierreuse
niveau pierreux 7.1 Chasséen ancien
E34 St23 Important petit oui géologique ? 11.1 Magdalénien
E35 St23 Cohérent petit géologique. 11.1 Magdalénien
Tableau 35 : catalogue des empierrements.
Descriptions
NoE Statut Description
E1 Obsolète Concentration de PMG, reposant sur Les FSJDCN. repéré en L14, dans S3, après la vidange des remblais des fouilles Reymond. E1, vu en stratigraphie, correspond à E3 en décapage.
E2 Obsolète Concentrations de pierres à traces d'agrégats de gravillons blanchâtres observées en L.10-11. Dégagé en d0, d1 et d2, démonté en d4. E2 est à mettre en relation avec le sommet de Ens8.
E3 Important Empierrement apparaissant en M14.d6a, N14.d10.d12 et démonté en d13-d15. Contient principalement des PM en N.M14. E1.E3 se prolongent massivement (PMG) dans le secteur LN-15 ou il apparaît base d21-d25, et est démonté de d27 à d34. En L15, il se confond avec le complexe St.8-F38.En N15 il rentre en contacte avec E18. En LN-16/17, l'empierrement est plus diffus (LP-16.17.d60 à d62.). E3 a été subdivisé en 2 avec E3s au sommet (LMN-15.d22-
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 167 -
NoE Statut Description
d26), en E3c, niveau riche en matériel, puis, en E31, niveau de base, correspondant en LP-16/17 et en IJK-16/17 à l'arrivée sur les FSJDCN. En LMN-14/15, la situation est plus compliquée avec l'apparition dans E31 d'une nouvelle couche pierreuse entre le sommet de E31 et le niveau d'ouverture des structure en creux dans les FSJDCN.
E4 Obsolète Alignement de pierres en découvert en N15.d9 et démonté en N15.d10. Pas très concluant.
E5 Vague surface de petites M très dense, souvent rubéfiée, dégagée en LP-15.d13.14 et enlever en d15 (Sauf en M15 ?) correspond au niveau pierreux du sommet de l'ensemble 4
E6 Vague Alignement de M en bordure Nord de N-M15.d16 base. Appartient à E16 ?
E7 Obsolète Disque de B en jonction O15 / N15, visible dès N15.25, démonté jusqu'en N15.d36. En O15. d27-d34, rien de particulier n'a été remarqué. pas très concluant. Partie de E18.
E9 Vague Concentration pierreuse repérée dans du LA gris claire cendreux en L17.d34.d35 et d36, et démontée en d34a et d34b. E9 est bordé à l'Est par F42.
E10 Important Grand empierrement constitué de M et G imbriquées contre la paroi Nord et Est du secteur IK-16/17 en IJ-17. E10 couvre les m2 : K17, J17, I17 et I16. Il Apparaît base d8, s'étend de d9 à d13, est démonté en d15-d15a. E10 contient de nombreuses pierres rubéfiées et un peu de matériel.
E11 Cohérent. Géol.
Amas de pierre remplissant, dans le secteur LO-20/21, une structure en creux dans les FSJDCN (St49). E11 apparaît progressivement de d18 à d31 et est démonté en d39.
E12 Important Empierrement situé en L17, apparaissant base d41, dégagé en d42 et d45, démonté principalement en d48.v1, qqu. pierres résiduelles en d52. niveau. pierreux suite de E5 en plus concentré ?.
E13 Cohérent Empierrement assez dense situé à l'Est du secteur IK-16/17, en IJ-16/17 . Apparaît en d16 lors de l'enlèvement des sédiments riche en cailloutis et P sous-jacent à E10. E13 sera décapé en d18 (phase 1) et en d22 (phase 2). E13 repose sur l'ensemble 3.3. Sa matrice et le matériel qui s'y trouve, en tous cas au sommet (d18.v1), appartient à l'ensemble 3.1
E14 Cohérent Empierrement riche en MP +- circulaire situé en NM-17, apparaissant en d48-d52. Une première phase de PM est enlevée en d54. La base de E14 se distingue des sédiments entourant en d55e et d57e.
E15 Cohérent Petite cuvette remplie de P et cailloutis imbriquées remplissant l'espace sis entre F19 et F24. E15 est repéré en O17.d53.d54 et est démonté en d55f.v1. E15 ressemble à E14. Comme E14, E15 repose sur sédiment riche en graviers jaunâtre, contenant localement une nappe sableuse jaunâtre-noirâtre (sommet ens.6). E15 est postérieur a et endommagé F19 et F24.
E16 Important A l'origine Petit E sur lequel repose F24. Par extension ensemble des M et des G de l'ensemble 5 (anc. cailloutage sup.) quatre gros blocs calcaire (O14, M15, MN.16, K15.16, O14.15).
E18 Important Empierrement formé de BGM, concentré en NP-15/17. Découvert dans les secteurs OP-14/15 (d21 à d29) et N15 8 (d21 à d26) ou il est démonté en 1995 (N15 d27 à d36) et en 1996 (OP-15 d34-d35). On le retrouve en 2001 dans le secteur LP-16/17 à partir de d48. Il s'y étend de d48 à d58 pour y être démonté en d60a, d61d, d61e (E19), d64a et d64c. Il repose sur soit le sédiment nommé caramel Isabelle, soit sur des structure en creux dans les FSJDCN de l'ensemble 8 (St.43, St.44) ou à plat (E23). Cet empierrement se subdivise en une bordure orientale (E19), et un sommet sur le quel repose F24 (E16). E18 se distingue par sa matrice, grise assez sombre, et la taille imposante de ses pierre (G et B très nombreux).
E8 Cohérent P16.d30 - d30b / F30 : pierres base F30, concentration de MG, dont une grande partie est rubéfié et repose sur un pâle de rubéfactions (Rb3).
E19 Obsolète Maintenant bordure orientale de E18. Démonté en d61e.
E20 Cohérent. Géol.
Empierrement situé à l'ouest de E18. Apparaît en P-16/17 à la base de d55. S'étend en d55f, d56f et d58. Est démonté en d61b. Base d61b apparaît une langue de FSJDCN dans le coin NO de E20 (P17). qui s'étend en d64b (base de E20 : sommet de St43 et St45). Comme E18, E20 repose sur des structures en creux (St34 et St45 et E23). E20 sert d'assise à F27.
E21 Obsolète Anciennement Bande de MG située dans la moitié Nord de LMN-17, maintenant réparti en E3~ et E31~.
E22 Cohérent. Géol.
Empierrement de remplissage de St44. Découvert en N17.d61c et vider en N17.d63a, v1 et v2.
E24 Cohérent. Géol.
Pierre de remplissage de St43. Repérer en P16.d64b, démonté en d65b et d66b. le sommet de E24 (E24s.St43) est en connexion (ou recouvert ?) par E23. Sa base est nettement en creux.
E25 Cohérent. Géol.
Amas de pierres et de gros blocs, reposant dans une légère structure en creux (St45) sous E20.
E26 Cohérent. Géol.
Epierrement reposant au sommet de l'ensemble 8. Il est situé au Nord-est de IJK-16/17. Apparaît à la base de I17.d26, au fond d'un trou résultant d'une erreur de décapage. S'étend progressivement lors des décapage suivant, pour être complètement dégagé en d32, lors de l'arrivée sur l'ensemble 8.
E27 Cohérent Amas caillouteux = St26 avec PM rub. Un gros Os pour datation (Dt.9). Apparaît base d4. Démonté en d18.
E28 Cohérent Empierrement de base de F29 et corps de F35 replissant une structure en creux peu profonde dans les FSJDCN (St48). Apparaît : zone nord - S17.d45, S16.d46 zone centre : S16.d49a, S15.d50a zone sud : S15.d45, S14.d36 E28 comble St48.
E29 Cohérent Empierrement lâche, +- circulaire (E29) PM, parfois rubéfié, céramiques en périphérie. Amas de rejet possible. Repérer en NO-20.d9. Enlevé en d12-d12a. Zone de rejet possible. Base Ens.2.1.
E30 Cohérent Contre la paroi est, amas de P et de M centré sur M20, apparaît en M20.d9.d10. Démonté en M20.d13.
E23 Cohérent. Géol.
Empierrement situé en P15-P16, lié à St20.St21 Découvert en P15.d37 et P16.d64b, sous E20 et en continuité avec E24. Démonter en P15.d37-d38 et en P16.d66b. Correspond à l'unité S6.7d2. correspondance avec E31? E23 pourrait recouvrir E24 !! à réinterpréter.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 168 -
NoE Statut Description
E31 Important Empierrement (GB) situé à la base de E3 et de F38. en LMN-14/15 et pierres situées sur les FSJDCN sales (Ens.7/Ens.8) en LMN-17. Dans ce secteur E31 diffus apparaît en d55d.g.h, en d56 et en d57c. Est démonté en d61c. Annulé = E31 diffus
E32 Important Couche pierreuse, étalage de MP assez dense au sommet duquel reposent les foyers endommagés F44 et F45. MP rub épars. rub Ce niveau pierreux à probablement protégé la bande S de l'érosion périphérique.
E33 Cohérent Arc de cercle pierreux délimitant Les LACgs-Cn de St50 (empierrement probablement géologique ?)
E34 Important Empierrement circulaire reposant sur une dalle. Vu en M12 dés d31-d34 et démonté principalement en d61 et d66. Démontage de la dalle de E34 en M12.d66.
E35 Cohérent Petit amas de M>G concrétionné dans le coin NE de M13. Pendant nord de E34 ? Principalement démonté en d47 et d60.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 169 -
4 - Catalogue des structures de combustion
F/St Statut Conservation Recoupement Forme Aménagement US Phase d'occupation
F1 Cohérent moyenne F39 ? cuvette sans 9.1 Mésolithique
F2 Cohérent mauvaise plat sans 9.1 Mésolithique
F3 Important bonne E3, E18, F34 nappe ch sans 6 Chasséen moyen
F5 Vague moyenne Tr1 fosse ? 0.33 Tranchées Tournier
F10 Important bonne plat sans 3.13 Néolithique final sup
F11 Important moyenne F40-Rb2 plat Sole-Ro/Rj 2.11 Bronze moyen
F12 Important bonne F16, F31, F42 plat Sole-Ro/Rj 3.11 Néolithique final sup
F13 Important bonne F40-Rb2, E32 plat Sole-Ro/Rj 2.22 Bronze ancien
F14 Important bonne F32 plat Sole indurée 3.3 Néolithique final inf
F15 Important moyenne plat Sole-Ro/Rj 2.21 Bronze ancien
F16 Important mauvaise F12, F25?, F32 plat Sole indurée 3.3 Néolithique final inf
F17 Important bonne plat Sole-Ro/Rj 1.2 Hallstatt ancien
F18 Vague mauvaise F23 nappe Cg sans 3.12 Néolithique final sup
F19 Important bonne E14, E16 plat Pierres 5 Chasséen
F21 Important moyenne plat Sole-Ro/Rj 3.2 Néolithique final inf
F22 Cohérent mauvaise indet. indet. 4 NMB
F23 Vague mauvaise F18 nappe Cg sans 3.12 Néolithique final sup
F24 Important Excellent E14, E15, E16 plat Pierres 5 Chasséen moyen
F25 Important bonne E17 nappe Cgc sans 3.3 Néolithique final inf
F27 Important bonne E20 cuvette Blocs 7.1 Chasséen ancien
F28 Cohérent moyenne F38, E3 plat Pierres 6 Chasséen ancien
F29 Important moyenne E28 sur dalle Dalle 7.1 Chasséen ancien
F30 Important mauvaise E8 plat Pierres 2.21 Bronze ancien
F31 Important moyenne F12 plat Sole indurée 3.11 Néolithique final sup
F32 Important mauvaise F14 plat ? indet. 3.3 Néolithique final inf
F33 Cohérent moyenne E3 cuvette Pierres 6 Chasséen ancien
F34 Vague mauvaise E18, F3 plat ? Pierres 6 Chasséen ancien
F35 Important bonne F29, St50 cuvette Pierres 7.2 Chasséen ancien
F36 Vague mauvaise St8, F37, F38 plat ? indet. 6 Chasséen ancien
F37 Cohérent bonne St8, F36, F38 plat Sole-Ro/Rj 7.1 Chasséen ancien
F38 Important bonne St8, F36, F37, E3, E31 plat Pierres 7.1 Chasséen ancien
F39 Important moyenne F1 ? cuvette sans 9.1 Mésolithique
F40 Important moyenne F11-Rb13 plat Sole-Ro/Rj 2.22 Bronze ancien
F41 Cohérent bonne plat Sole-Ro/Rj 1.2 Hallstatt ancien
F42 Important bonne F12 plat Sole-Ro/Rj 3.11 Néolithique final sup
F43 Cohérent bonne plat ? Sole-Ro/Rj 1.1 Romain
F44 Vague mauvaise E32, F45 ? plat ? indet. 2.22 Bronze ancien
F45 Vague mauvaise E32, F44 ? plat indet. 2.22 Bronze ancien
F46 Cohérent moyenne indet. Pierres 9.22 Mésolithique
F47 Cohérent bonne plat Sole-Ro/Rj 1.1 Romain
F48 Important moyenne plat Pierres 7.2 Chasséen ancien
St8 Important bonne E3, E3, F36 zone de combustion complexe cf. : F37 et F38.
7.1 Chasséen ancien
St6 Cohérent moyenne E3, E31, St41 cuvette Pierres 7.1 Chasséen ancien
St9 Cohérent mauvaise St10 plat Sole-Ro/Rj 5 Chasséen moyen
St10 Important bonne St9-Rb1 fosse fosse 3.3 Néolithique final inf.
St14 Important moyenne nappe ch. indet. 10.1 Magdalénien
St23 Important mauvaise E34, E35 plat indet. 10.2 Magdalénien
St27 Cohérent bonne St33 cuvette Pierres 1.3 Bronze final IIIa
St31 Important bonne cuvette Pierres 1.1 Romain
St33 Important bonne St27 cuvette Pierres 1.3 Bronze final IIIa
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 170 -
F/St Statut Conservation Recoupement Forme Aménagement US Phase d'occupation
St46 Cohérent bonne cuvette Pierres 13.2 Magdalénien
St47 Cohérent mauvaise Tr1 fosse fosse 3.3 Néolithique final inf.
St50 Important bonne E33, F35, E28 cuvette Pierres 7.1 Chasséen ancien
Tableau 36 : catalogue des structures de combustion.
Descriptions
F/St Statut Description
F1 Cohérent Nappe cendreuse à lentilles charbonneuses centrée sur L11. Apparaît base L11.d6. F1 s'étend en L12.d1 et L11.d8. Forme une légère cuvette de 14 cm de profondeur pour son point central, vidangée en d8a. Quelques poches charbonneuses résiduelles en L12.d3 peuvent lui être rattachées. Traces résiduelles constatées en L11.d9.
F2 Cohérent Nappe de Cgs à lentilles charbonneuses avec une languette de Cb centrée sur K10. Repéré en K10.d6 et démonté en K10.d8. Structure de combustion analysée en détail par Dominique Sordoillet (prélèvement sédimentologie A93-1 = M3). Combustion locale probable, lessivage avéré.
F3 Important Concentration de LA brun-noirâtre charbonneuse située au sommet de E3 en NO-14/15. Bien visible en coupe dans S1. Prolongement partie sud en MN-16 (F3 diffus). Apparait en 1993 et défini l'ensemble 6. Est rattaché à F34 dont il constitue un épandage charbonneux.
F5 Vague Structure en creux à la base de Tr.1 remplie de LA noirâtre charbonneux. Prise à la fouille pour un foyer (appelé C1). Découverte de Rj en périphérie (J10.d3b. F5 est creusé dans les FSJDCN. cf.: Jk.10.d0-d3. F5 est situé dans l'axe de Tr1. Il peut s'agir d'un fond de tranchée. Si le bord Nord de F5 a été trouvé en d2-d3 (A93.Fl22.16A.jpg), rien dans S1 ne permet de le distinguer de Tr1 (A93.FL21.2A.jpg).
F6, F7, F8 et F9 Phases d'allumage de St10
F10 Important Foyer en légère cuvette apparaissant contre la stratigraphie Nord du secteur LO-20/21. Ce foyer est repéré durant la campagne de pâques 1999 à la base de d17 (traces de ch de Cg). Les résidus de combustions sont enlevés en d23 (cf. : P184), en d27 et d28 (cf. P200, 202, 203). Ces résidus s'organisent en trois phases avec - au sommet (d23), une matrice poudreuse de cendres mixtes à dominante claire (Cgc + taches de CH + taches de Cgs), riche en P et cailloutis rub, avec apparition à la base de d23, d' une zone un peu bleutée - ensuite (d27, 28) d'une cendre mixte foncée riche en ch. (Cgs à ch.) reposant sur une Rs (bœuf bourguignon) à infiltration de Cgs. - à la base un niveau de Rs enlevé en d32. Celui-ci est passablement infiltré par les Cgs de la phase 2.
F11 Important Complexe de combustion poly-phasique situé entre S15 et S16. Découvert base d21 sous des LA brunâtre par quelques taches de Ch. La dernière utilisation correspond aux cendres dégagées en d21a et enlevée en bonne partie en d23 (F11 sup.). Elle repose sur une fine nappe de rubéfaction qui enlevée en d23 dans la partie nord et en d23 b dans la partie ouest. Sous cette phase rubéfiée on trouve (d23 au nord et d23b à l'ouest) un nouvel épandage cendreux. Dans la partie centrale et au nord, une incertitude subsiste sur les cendres blanches et mixte repérées base d23. La seconde phase de F11 (F11inf) est décapée de d23b à d23 g. La phase sup. de F11 est datée (Dt39).
F12 Important Grande structure de combustion visible base d37 dans le secteur LP-16/17, à plusieurs phases et zones d'allumages. Situé dans les LA gris claire à reflets brunâtres. Repérer base M17.d37. Fouillé de d37a à d37km. puis repris en d42f, d42h, d43. Deux phases d'allumage se distinguent (F12sup : d37a à g et F12inf : d37 g à m, d42f, g, h, d43) avec rechapage de Rb9 entre F12sup et F12inf. A la base, sous les résidus de combustions, un dégradé allant de Rj à Ro. La Rj forme un boudin en arc de cercle. Le foyer en légère cuvette a été partiellement perturbé par un réseau de terrier. Daté, F12s, Dt17 - Ly-2240(OxA) : 4130 ± 40 F42, situé au sommet de F12s est peut-être un extension (nappe de Ch-Cgs). La base de F12i se confond avec F16...
F13 Important Zone de combustion repérée base A00.S15.d29 par l'émergence de poches de Cb. et, dégagés en d33 par un épandage grisâtre cendreux. Les cendres sont démontées en d34a (Dt38), 34b consécutivement à l'apparition d'une belle surface de rubéfaction orangée au nord (d34b) et jaune au sud (d33 base). La plaque de rubéfaction, qui s'étend en d37, sera démontée en d38. L'influence calorifique de F13 semble se prolonger ??? dans les sédiments sous-jacent (d44, d44a = St51+Dt25).
F14 Important Foyer à plat à sole rubéfiée (Ro) entourée de RS et résidus de combustion (séquence complète). Le foyer à été partiellement endommagé par un réseau de terrier. Les résidus de combustion sont repérés en ON17-d41 base. Enlevé en ON17.d42a à d42c et d44. La sole rubéfiée est enlevée en d44à, d44c, d47.zone I. Les influences sous-jacentes persistent encore en d48.zone II. corps 1 et 2.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 171 -
F/St Statut Description
F15 Important Foyer en K16 du secteur IK-16/17 visible en coupe après la vidange de Tr.1 (A99.K16.d1) et en plan après K16.d16. Foyer en légère cuvette dont la combustions est enlevée en d19a phases 1, 3 et 5 et la rubéfaction en d19a phases 3 à 6. F15 semble appartenir à un complexe de combustion à deux phases d'utilisation.
F16 Important Nappe de Ro située à l'intersection N17/M17, reposant sous le flanc Ouest de F12 et comprise à l'origine comme une extension de F12. F16 se confond sur son flanc Ouest avec F32. Lorsque Rb8 s'agrandi durant d42h (poches de Cb-ch. sous Rb9 de F12) - d44 (nouvelle surface de Ro en N17 sous les Rs de base Rb9-F12) et d45, devient F16. La rubéfaction de base de F16 (Rb8) est démontée en d45b avec mise en évidence d'encroûtement.
F17 Important Apparition dans le secteur LP / 16-17 en d4 (A97.Fl42) d'un foyer à plat indiqué par un sol de rubéfaction brun orange puis jaunâtre sous un petit niveau gris cendreux sombre. Cette sole est dégagée en O16.d5, Fouillé en O16.d5a et d5b. Ce foyer et bordé par un sol d'occupation attesté par une surface de piétinement. (NP-16/17-d.6 à d8 riche en cailloutis et petites pierres rubéfiées. A ce niveau est rattaché un jarre à cordons appuyé verticalement et à col court. alt. sommet : 104. alt. base : 110.
F18 Vague Foyer situé au NE de K16, découvert à la base de F15 (d19a.v5), et fouiller en d19b. Consiste en qu. poches de Cg et de Cb, trouvées sous la rubéfaction de F15. Reflet de rubéfaction, Fumier de bergerie ?
F19 Important Petit foyer à plat découvert en P17.d50.d51, abordé ça et là en d53.d54. Ses résidus de combustions et quelques petites poche de Ro sont enlevés en d55c.(v2 à v4). Son substrat, composé d'un niveau pierreux appartenant à E16 et reposant sur les LS jaunes gris sales (démontée en d65f). F19 est recoupé par E15.
F21 Important Foyer à plat découvert en S-16/17 de d27? à d30. F21 s'étend en d34. Ses résidus de combustion seront décapés en d27 et d29, puis en d34c et d, sa rubéfaction en d34e et g.
F22 Cohérent Foyer en très mauvais état découvert en L16.d48.v2, constitué de qqu. pierre rubéfiées et de poches de Cgs-ch, de quelques points de Ro et d'une petite nappe de RoRj. F22 est démonté partiellement d48.v2 et surtout en d54.v1. F22 se situe sur une plaque sans pierre obtenue base d54.
F23 Vague Foyer pas claire = fumier de bergerie ? En K16.d19b.v1 à v3 puis en d20, d20a, sous la Ro F18, on observe une nappe de Cg avec une zone de Cb. Ces résidus de combustion reposent sur des reflets de RoRs et sont bordés à l'Est d'une frange de Ro un peu pâle.
F24 Important Foyer à plat apparaissant en ON-17 d48 à d53 et démonté en d54a, d55, d55b, d56b et terminé en d57f. F24 repose sur E16, et est recoupé par E14 et par E15. Daté, Dt40 : Ly-2769 : 5110±35 BP.
F25 Important K16.d23 - d23a : zone de combustion type fumier brûlés, définie par des marques de Rj. diffuses, qu. poches de Cb. située sur le flanc EST de St37. Lui est associé une datation (Dt.26) et quelques prélèvements (P308, P320). F25 apparaît à la base de la phase 2 de d23. Démonté en d23a (phase 1 à 3). Dt.26 est une excellente datation pour F25 (Datation réalisée : Ly-2766 : 4670±35).
F27 Important Foyer situé juste sous F19 (1.5-2 cm.) découvert en P17.d56f. constitué de deux zones, une centrale (d56f.v1, d56f.v2, d58f) à Cb., ch., Ro-Rs et d'une zone périphérique diffuse à ch (d58f). F27 repose sur quelques pierres (E20) et quelques Blocs. F27 est principalement démonté en P17.d56f, OP.P17.d58f et P17.18.s9v2. Sa base est nettoyée en d62b lors du démontage de E20.
F28 Cohérent d54 : apparition d'une poche sombre qui s'étend en d55a, d55d, d56 et d56h pour formé un arc de cercle. F28 est démonté en d57a (3 phases, dec. propre à F28) ou apparait nettement un arc de cercle de pierres noircies (base d57a.v2), résidus en d61c. La partie nord de F28 est altéré par une CN. Base F28 (d57a.v3), quelques traces de Rj possibles. F28 se connecte bien avec la tache cendreuse située au sommet de F38 (K16/17.d26 base). Il peut s'agir de deux foyers superposés.
F29 Important Foyer reposant sur une dalle calcaire calée par quelques G, toutes rubéfiée. Le sommet de la dalle apparaît base S15.d46. Un amas charbonneux, entourant la dalle est décapé en S14/15.d48, d49a, d49c, 50a et 50b. La dalle est enlevée en d49d. F29 repose sur E28. Sont fonctionnement semble lié à St50
F30 Important Foyer piétiné à plat. P16.d30-d30a : concentration de MG (E8) située à la base de l'ensemble 2 (P16.d30). Un bon nombre est rub (P16.d30a). Sa base repose sur une rub. (Rb3 - P16.d30b).
F31 Important LA gris compacte riche en graviers et cailloutis rub. enlevé en A99.M17.d36 au Nord-Ouest du m2, reposant sur une plaque de LA brun-très compacte rubéfié orangé à poche de Rj (Rb4) posée à la base de d36. La plaque Rb4, sans doute rubéfiée, était délimitée à l'Est par un petite concentration (~2 cm.) de P rub.
F32 Important Foyer démantelé. Déduit de l'observation de Rb7. Apparaissant en N17.d37j-N17.d41 (Poches de Ro et qu. Mrub). Quelques poches de Cb. et de ch. observées corps N17.d42. Base d42, la frange sud de N17 est occupée par une bande de Rs qui sera démontée en 42g. (ev. en z2 de N16.d47).
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 172 -
F/St Statut Description
F33 Cohérent Foyer en creux en grande partie recoupé par les fouilles Reymond. Il apparait à la base de M14.d4 et est démonté de façon non isolée en d6 et d6a. Le foyer est creusé dans E3 (ens.7.1).
F34 Vague Foyer situé en OP-15, au sommet du cailloutage dense GBM (E18) dans une zone fortement concrétionnée. Mal vu-mal fouillé. (A95.FL6-A95.FL7). Les résidus de combustions qui apparaissent dés d23.24, sont bien visible base d27 et enlevé en OP-15.d29, décapage qui leur est destiné. Il repose sur un niveau de MGB (E18) dont plusieurs sont rubéfiés. (d34). F34 est sans doute lié à F3.
F35 Important Gros foyer se confondant avec E28. Il apparaît sous la forme d'une zone de LA brun sombre-noirâtre (S-15/16.d45) s'étendant en d46 et d47. Les résidus de combustions superficiels sons enlevés en d49a et d50a. La masse centrale (d51a, Cgs, Cb,Ch) et sa périphérie, arc de cercle de suie (d51b, d52), sont décapés par phases et par zones) jusqu'à l'obtention d'une zone de Ro et de Rj émergeant des pierres noircies de E28 . Les pierres (E28) sont démontées en d53, permettant l'extension des Rubéfaction qui sont enlevée en d54a.
F36 Vague Apparition en K16.d26.v2, dans la partie grise cendreuse du secteur IJK, d'un disque brunâtre plus ou moins rubéfié entamé en d28. F36 est partiellement endommagé par un léger concrétionnement (cf.d28) et se confond ou jouxte, à l'Est, F37. La partie plus ou moins rubéfiée, démontée en d28, s'éclairci et se concrétionne (d28 base), et jauni (d30a). La Rj concrétionnée vue en d30a pourrait également définir la frange occidentale de F37. L'interprétation comme foyer de F36 reste sujette à caution. Il peut s'agir d'un foyer endommagé appartenant à la base de l'ensemble 6, foyer positionné sur la partie ouest de F37.
F37 Cohérent Foyer à plat découvert en J16.d27.v3. Situé à l'Est de St.8, F37 apparaît sous la forme de Cg-Cb à l'Ouest et Ch à l'Est qui sont finement décapés en d30a, faisant alors apparaître un Ro au Nord et un mélange de MCg-Cgs. Ces dernier, décapé en d31a, repose sur une nappe de Ro, dense au Nord et diffuse au sud. En bordure Nord-Ouest, la Rj de F.36, se confond avec la Ro de F37 (d31a). Pas mal de céramique d'os de très petites taille (0-1, K16 50, J16 94 os).
F38 Important Foyer situé dans St.8, mis en évidence en K16.d26 à d28, en L15.d28 à d30 et en K15 d34 par l'émergence dans un LA gris assez sombre cendreux à taches noirâtres charbonneuses et poche de Cb base d26 (DSCN1236.JPG). En d28 et surtout en d31b, la poche de Cb s'étend. Suite à la décision de la CIRA de ne pas terminer les décapages en cours, F38 n'a pas été démonté. F38 se situe au sommet de E31, sous E3, succession visible en L15 et en K15.
F39 Important Epandage de Cgs à poche de Ch centré sur KL-10, apparaissant base d8.d9 où il est interprété à la fouille comme des infiltrations de F2. F39 est démonté en d8a, et d8b. F39 se constitue au sommet d'une nappe de Cgc, enlevée en d8a, et à la base de Cgs, enlevée en d8b (reflet orangé à la base).
F40 Important Foyer à plat composé d'une large plaque de rubéfaction (Rb2) surmontée de cg. Découvert base A98.S15.d19 (Cg). La RO (Rb2) apparaît de S15.d22 à S15.16.d27 ou elle atteint son extension max. Rb2 est principalement démonté en d31 et d31a. Lors du démontage de Rb2, découverte des résidus de combustion de F13.
F41 Cohérent Foyer vu contre la stratigraphie durant N17.d6. dépassant sur ~10 cm. Ro prélevée en P111. F41 s'étend considérablement lors de la rectification de la stratigraphie S9.
F42 Important confondu avec le sommet de F12, F42 est un petit foyer à plat situé au Nord de M17, appuyé contre le flanc ouest de E9. Ses combustions sont découvertes base d37, enlevées en d37a, b, c, d, e. Il repose sur une rubéfaction (Rb10) légère, jaunâtre démontée en d37i, j, h et m. Résidus possibles en d42d et d42g. Elabo 2006, Rb10 = fumier de bergerie et F42 est une extension de F12.
F43 Cohérent Foyer marqué par une belle Ro sur laquelle repose un filet de Rs ponctué de quelques petites zones de Ro. Suit un filet de Cgs-Ch, et enfin une nappe de CgsCb. Bien vue dans S7.S7a. Démonté en P14.d2-d3. Partiellement endommagé par un creusement issu des flancs des fouilles Reymond (Anc. St29).
F44 Vague Foyer abimé apparaissant en S16.d27. F44 est principalement fouillé en d34. F44 est défini par une Ro (Rb12) et quelques résidus de combustion (base d27). Repose sur E32.
F45 Vague Foyer très abimé. Reflets de Ro-Rj et poches de Cgc-Cgs. Repose sur E32.
F46 Cohérent Foyer découvert à la base de la stratigraphie S11 lors de sa rectification (relevé du 11.6.03). Attribution stratigraphique base Ens.9.
F47 Cohérent Foyer découvert au sommet de S8 lors de sa rectification.
F48 Important Foyer à plat vu et démonté en M15.d37-M15.d45. F48 repose sur les FSJDCN. Il se continue d'un épandage gris charbonneux et repose sur une concentration de pierres rubéfiées. Le foyer n'a été repérer en ni en M14 ni en L15.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 173 -
F/St Statut Description
St6 Cohérent Ouverture : ~ 173 (N15 d28 base) Base : 181 (N15.d35 base). Structure constituée d'une périphérie de pierres et d'un centre de charbonneux. Son sommet apparaît sensu scripto en N15.d28 et se termine avec d35. St.6 pourrait être repérable dés N15.d25 (ev. N15.d23) par un disque de LA. compacts bordé de G. Elle se perd cependant en N15.d27. Décapages sûrs : d28, d29, d30, d35.
St8 Important Zone de combustion complexe, riche en sédiment gris-sombre cendreux, reposant sur un lit de MG dense (E31) : regroupe F36, F37 et F38. Secteur LN.15 : Zone de LA brunâtre-noirâtre observée dès L15 d25, détaillée en L15.d30. En L15.d13 1/4 NE, une petite tache gris-sombre légèrement sableuse enlevée en d25. La surface se couvre alors de P et de M et semble disparaître en d27 (?). En d28 elle est à nouveau bien individualisée et plus grande (LA gris-brunâtre sombre meuble à M dense). En d30 elle occupe toute la bande E du M2 (1/3). par un LAA brun-grisâtre foncé peut pierreux. En d34, elle se fait assez charbonneuse et caillouteuse, en LA gris brunâtre meuble. Sa base est atteinte en L15.d44 (petits galets rubéfiés). Secteur IK-16/17 : St.8 apparaît dans le secteur IK-16/17 à la base de d26 sous la forme d'une nappe grise cendreuse assez sombre bordé à l'Est par une plaque vaguement rubéfiée (F36) . L'épis-centre de St.8, défini par F38, est plus sombre et repose sur un empierrement débordant en L16 (cf. : L16.d61c).
St9 Cohérent St.9 est un foyer à plat reposant sur un niveau de rubéfaction (Rb1) partiellement conservé. Ouverture d19 (alt.= ~149). La structure St9 a été découverte durant la campagne 1995. Elle est apparue près de la base des fouilles anciennes. La structure a d'abord été interprétée avec St.10 , puis séparée lors du colloque de 2000-2001. St9 a été perforée par St10. Comme St10, une partie de St9 a du être enlevée lors des fouilles anciennes.
St10 Important Visible dès la base de O13.d1, percé en d2 (en bordure de Tr3). En O13 : Fosse foyer profonde d'une vingtaine de cm. à plusieurs phases d'utilisations, considérée à la fouille comme partie intégrante de St.9, puis séparée lors de la rédaction du colloque 2000-2001. Actuellement il est établi que St10 est postérieure à St9. Sont niveau d'ouverture est inconnu (Fouille ancienne), corps Ens.3. (CF Journal de fouille No1, p.108 et 118 et FL2.20a = base d3, FL5.25a et 26a = base d19-d20). Sommet = base d19 (~150) Base = base d22L + infiltration (d22m, d37, d38) (alt.= ~ 170). A la fouille il nous est clairement apparu que son remplissage était relatif à plusieurs phases d'utilisations (F6, F7, F8 et F9), les deux dernières (F7-F8) étant séparées par une coulée latérale, et la seconde vidangée avant la dernière. Son sommet (F6) est actuellement interprété comme le sommet de St10. (F6 = base d19 et enlevé en d22 à d22a corps). St10 a été minutieusement fouillée et son contenu prélevé de façon quasi systématique (Prélèvements : 48,.49, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 99).
St14 Important Ellipse de LS noirâtre à cailloutis et graviers. Repose sur ou perfore l'horizon St23. Qq. silex (S005).
St23 Important Sous un cailloutage PM dans LS gris cendreux clair (Ens.9.22), épandage gris cendreux charbonneux noirâtre caillouteux avec tâche blanchâtre (cns?) centrée sur M12.C4 - M13.C1. Visible dés M12.d21 base - M13.d14. Principalement compris durant la campagne 1997. Repérer en M13.d14 - M12.d10b (c4)-d21/ Démonté dés M12.d21/22, puis, surtout, en M12-13.d26 et suiv. St23 est délimité au sud par E34 et au Nord par E35.
St27 Cohérent Sous F41, concentration grise pierreuse en creux. Mal vu en fouille. Confondu avec la partie nord de St33. Bien visible en Stratigraphie. (A03.S9).
St31 Important Structure localisée en T-15/16 à deux phases de remplissage alternant niveaux caillouteux à la base et niveaux. gris sombre-noirâtre au sommet. Le sommet est très riche en faune. Analysé en détail dans André, Buard, Lhemon, Diaz 1998 et repris en élaboration par André (2002-2003). Combustion in-situ non avérée.
St33 Important Bassin de LA gris-sombre à noirâtre, nette en A97.ON-17 d8 (A97.FL40). Apparaissant sans doute entre d6 et d7. Recouvert par un épandage cendreux lié à F41 et à F17. St.33 est fouillé en tant que telle en d8a, puis contourné en d9 à d14. d15 et ses sous décapage (a à j) lui sont spécifiquement attribués. Le 1/8/98, découverte en dans le bassin d'un fragment de mandibule d'homme assez robuste (A98.N17.d15c.6). Pierres rubéfiées et ch. épars, nodules d'argile brûlé abondants. St.33 correspond apparemment à une petite cuvette centrée sur O16 (C4)-O17 (C2)-N16 (C3)-N17 (C1). Connexion avec St27.
St46 Cohérent N13.d63.v3, perforation de St.46 côté Ouest. N13.d69e.v1, v2 : fouille de St46 côté Ouest. M13.d67.v2 : apparition de LS noirâtre qui s'étende en M13.d68. M13.d69a.v1 à v7 : fouille d'un épais niveau de LAS noirâtre charbonneux gras à granulométrie croissante, très riche en faune écrasée, et fragment d'os, souvent brûlés, nombreux silex.
St47 Cohérent Fosse à remplissage noirâtre charbonneux repéré contre le flanc Ouest de Tr3. Analogue à la fosse St10. O12-13.d1 et d2. (nommé St5 en 95).
St50 Important Structure composée d'un arc de cercle en pierre (E33) délimitant une nappe de Cgs. Les Cgs (S-15/16.d45) apparaissent de plus en plus nettement entre d46 et d47. Ces résidus de combustions sont décapés en d49a et d50a. Comme F29, St50 recouvre partiellement le binôme E28-F35. Leur fonctionnement semble lié.
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 174 -
Phases (Ens.) rayon
inf. à 40 cm. 40-60 61-100 sup. à 100 cm.
Romain (1.1) F47 F43, St31
Âge du Fer (1.2) F17, F41
Bronze final IIb-IIIa (1.3)
St27, St33
Bronze moyen (2.1) F11
Bronze ancien (2.2) F13, F15, F30, F40
Néolithique final (3) F31, F42, St10, St47 F10, F12, F14, F16, F18, F21, F25, F32,
NMB (4)
Chasséen moyen (5) F19, F24, St9,
Chasséen ancien (6) F33, F34 F28 F3
Chasséen ancien (7) F27, F29, F48 F35, F37, St50 F38
Mésolithique (9) F1, F2, F39
Magdalénien sup.
(10-12)
St14 St23
Magdalénien sup. (13) St46
Tableau 37 : répartition des principales structures de combustion par taille.
5 - Nivellements (41'580 éléments côtés)
Les données de nivellements concernent les aménagements anthropiques (empierrements,
rubéfactions, résidus de combustion), les dépôts sédimentaires (ex : argiles brun sombre) et enfin
les restes anthropiques (céramique, faunes, silex etc.) qu’elles permettent de représenter dans
l’espace tridimensionnelle. Pour chaque cotation en XYZ sont indiqués : M2, décapage, structure
(éventuelle), attribution stratigraphique, numéro de matériel (éventuel) et type de cotation (type de
matériel, de sédiment…).
Exemple d’information avec un des tessons du vase C002 (ensemble 7.1 – Chasséen ancien)
Idt : 4934 , DateSaisie : 11.10.2002 X : 11, Y : 45, Z : 178
NoMat : C002 , Type : céramique , Structure : E3
m2 : M15 , décapage : d28 , No : 4*1
*1
numéro de prélèvement de M15.d28.
Attribution stratigraphique : Ens.7.1 : horizon E3-E18-F38 (mat.)
Exemple d’information avec une des pierres de l’empierrement E3 (ensemble 7.1 – Chasséen
ancien)
Idt : 61503 , DateSaisie : 13.08.2004 X : 70, Y : 35, Z : 165
NoMat : / , Type : mCaR*2
, Structure : E3
m2 : M16 , décapage : d60 , No : / *2
pierre moyenne calcaire rubéfiée
Attribution stratigraphique : Ens.7.1 : horizon E3-E18-F38 (St.)
nombre de points
Grotte (voute et relief au sol avant fouille) 2'482 Matériel archéologique 4'927 Pierres (isolées ou dans empierrement) 7'375 Rubéfactions (nappage) 6'359 Résidus de combustions (nappage) 5'920 Sédiments (nappage) 14'517
41'580
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 175 -
Table des matières
INTRODUCTION .......................................................................................................................................................... 5 1 - Présentation .............................................................................................................................................. 5 2 - Les études réalisées depuis 2008............................................................................................................... 6 3 - Travaux divers ........................................................................................................................................... 6 4 - Collaborateurs .......................................................................................................................................... 7 5 - État d'avancement du manuscrit ............................................................................................................... 9 6 - Bliographie .............................................................................................................................................. 11
PRESENTATION GENERALE ....................................................................................................................................... 13 1 - Contexte géographique et géomorphologique ......................................................................................... 13 2 - Historique des fouilles ............................................................................................................................. 17 3 - Orientation stratigraphique .................................................................................................................... 19 4 - Présentation synthétique des ensembles stratigraphiques de la séquence supérieure ............................ 25 5 - Présentation synthétique des ensembles stratigraphiques de la séquence inférieure ............................. 39
ETUDE TECHNOLOGIQUE DES CERAMIQUES DE L'AGE DU BRONZE ........................................................................... 43 1 - Bronze final IIb-IIIa (ensemble 1.3) ........................................................................................................ 43 2 - Bronze moyen (ensemble 2.1) .................................................................................................................. 47
ETUDE TECHNOLOGIQUE DES CERAMIQUES DU NEOLITHIQUE MOYEN ..................................................................... 55 1 - Ensemble 4 .............................................................................................................................................. 55 2 - Ensemble 5 .............................................................................................................................................. 56 3 - Ensembles 6 et 7 ...................................................................................................................................... 56 4 - Synthèse ................................................................................................................................................... 56 5 - Comparaison ........................................................................................................................................... 57 6 - Bibliographie .......................................................................................................................................... 58
LES SILEX DE LA SEQUENCE SUPERIEURE DE LA GROTTE DE L’ABBAYE ................................................................... 65 1 - État de la série ........................................................................................................................................ 65 2 - Méthodologie .......................................................................................................................................... 66 3 - Définitions ............................................................................................................................................... 66 4 - Analyse des données ................................................................................................................................ 67 5 - Commentaire général .............................................................................................................................. 92 6 - Conclusion .............................................................................................................................................. 96 7 - Bibliographie .......................................................................................................................................... 96
L'INDUSTRIE OSSEUSE DE LA GROTTE DE L'ABBAYE................................................................................................. 99 1 - NMB (Ensemble 4) .................................................................................................................................. 99 2 - Néolithique final supérieur (Ensemble 3.11)......................................................................................... 100 3 - Pièces hors contexte .............................................................................................................................. 100 4 - Synthèse ................................................................................................................................................. 101 5 - Bibliographie ........................................................................................................................................ 101
LA FAUNE DE LA SÉQUENCE SUPÉRIEURE DE LA GROTTE DE L’ABBAYE À CHAZEY-BONS (AIN, FRANCE) ............ 105 1 - Introduction ........................................................................................................................................... 105 2 - Observations générales ......................................................................................................................... 105 3 - Description des ensembles .................................................................................................................... 107 4 - Synthèse et perspectives ........................................................................................................................ 116 5 - Remerciements ...................................................................................................................................... 118 6 - Bibliographie ........................................................................................................................................ 118
ETUDE DES RESTES HUMAINS EPARS, ANALYSE PRELIMINAIRE .............................................................................. 127 1 - Les fouilles anciennes ........................................................................................................................... 127 2 - Les fouilles récentes 1993-2003 ............................................................................................................ 127 3 - En guise de conclusion .......................................................................................................................... 128 4 - Bibliographie ........................................................................................................................................ 129
APPROCHE TECHNOLOGIQUE DU MATERIEL LITHIQUE DES NIVEAUX INFERIEURS DE LA GROTTE DE L’ABBAYE .... 137 1 - Introduction ........................................................................................................................................... 137 2 - Regard sur le matériel de l’ensemble 9 ................................................................................................. 137 3 - Technologie des ensembles 10-12 et 13 ................................................................................................ 138 4 - Approche lithologique des ensembles tardiglaciaires ........................................................................... 142 5 - Conclusion : insertion du matériel dans un cadre chrono-culturel....................................................... 144 6 - Références bibliographiques mentionnées : .......................................................................................... 154
La grotte de l'Abbaye I, Chazey-Bons - Rapport de synthèse 2010-2012 - 176 -
EXAMEN ARCHEOZOOLOGIQUE DE LA FAUNE DE LA SEQUENCE INFERIEURE DE LA GROTTE DE L’ABBAYE CHAZEY-
BONS, AIN ............................................................................................................................................................. 155 1 - Taphonomie ........................................................................................................................................... 155 2 - Activités humaines ................................................................................................................................. 159 3 - Perspectives .......................................................................................................................................... 163 4 - Bibliographie ........................................................................................................................................ 163
ANNEXES ............................................................................................................................................................... 165 1 - Références ............................................................................................................................................. 165 2 - Abréviations utilisés dans les catalogues : ............................................................................................ 165 3 - Catalogue des empierrements ............................................................................................................... 166 4 - Catalogue des structures de combustion ............................................................................................... 169 5 - Nivellements (41'580 éléments côtés) .................................................................................................... 174
TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................................ 175
![Page 1: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/88.jpg)
![Page 89: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/89.jpg)
![Page 90: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/90.jpg)
![Page 91: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/91.jpg)
![Page 92: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/92.jpg)
![Page 93: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/93.jpg)
![Page 94: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/96.jpg)
![Page 97: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/99.jpg)
![Page 100: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/100.jpg)
![Page 101: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/101.jpg)
![Page 102: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/102.jpg)
![Page 103: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/104.jpg)
![Page 105: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/105.jpg)
![Page 106: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/109.jpg)
![Page 110: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/111.jpg)
![Page 112: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/112.jpg)
![Page 113: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/113.jpg)
![Page 114: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/115.jpg)
![Page 116: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/116.jpg)
![Page 117: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/118.jpg)
![Page 119: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/119.jpg)
![Page 120: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/120.jpg)
![Page 121: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/121.jpg)
![Page 122: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/122.jpg)
![Page 123: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/123.jpg)
![Page 124: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/124.jpg)
![Page 125: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/125.jpg)
![Page 126: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/126.jpg)
![Page 127: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/128.jpg)
![Page 129: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/129.jpg)
![Page 130: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/130.jpg)
![Page 131: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/131.jpg)
![Page 132: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/132.jpg)
![Page 133: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/133.jpg)
![Page 134: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/134.jpg)
![Page 135: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/135.jpg)
![Page 136: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/136.jpg)
![Page 137: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/137.jpg)
![Page 138: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/138.jpg)
![Page 139: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/139.jpg)
![Page 140: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/140.jpg)
![Page 141: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/141.jpg)
![Page 142: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/142.jpg)
![Page 143: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/143.jpg)
![Page 144: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/144.jpg)
![Page 145: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/145.jpg)
![Page 146: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/146.jpg)
![Page 147: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/147.jpg)
![Page 148: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/148.jpg)
![Page 149: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/149.jpg)
![Page 150: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/150.jpg)
![Page 151: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/151.jpg)
![Page 152: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/152.jpg)
![Page 153: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/153.jpg)
![Page 154: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/154.jpg)
![Page 155: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/155.jpg)
![Page 156: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/156.jpg)
![Page 157: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/157.jpg)
![Page 158: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/158.jpg)
![Page 159: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/159.jpg)
![Page 160: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/160.jpg)
![Page 161: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/161.jpg)
![Page 162: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/162.jpg)
![Page 163: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/163.jpg)
![Page 164: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/164.jpg)
![Page 165: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/165.jpg)
![Page 166: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/166.jpg)
![Page 167: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/167.jpg)
![Page 168: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/168.jpg)
![Page 169: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/169.jpg)
![Page 170: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/170.jpg)
![Page 171: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/171.jpg)
![Page 172: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/172.jpg)
![Page 173: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/173.jpg)
![Page 174: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/174.jpg)
![Page 175: BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051313/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/html5/thumbnails/175.jpg)