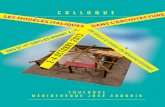Quelques aspects de l'architecture végétative des Conifères, Claude Edelin, 1981
L'architecture, le contexte économique et l'archéologie de la forge de l'abbaye de Fontenay
Transcript of L'architecture, le contexte économique et l'archéologie de la forge de l'abbaye de Fontenay
Parmentier Jérôme 04/06/2012
1ère Master en archéologie nationale
Séminaire d’archéologie nationale (LARKO 2673)
L’architecture, le contexte économique et l’archéologie de
l’abbaye de Fontenay
Prof. L. Verslype
Université catholique de Louvain-la-Neuve
Faculté de Philosophie, Arts et Lettres
Département d’Archéologie
Année académique 2011-2012
2
INTRODUCTION
Le séminaire d’archéologie nationale se déroula en Bourgogne du 16 au 21 avril
2012. Le travail personnel de ce séminaire traite des dimensions architecturales,
économiques et archéologiques relatives à la forge de l’abbaye de Fontenay.
Cet ensemble abbatial cistercien renferme un patrimoine architectural bien conservé,
évocateur de ce que devait être une abbaye à l’époque médiévale.
Le site de l’abbaye de Fontenay (fig. 1) est tout indiqué pour abriter un complexe
économique. En effet, par les mandements de la règle de saint Benoît, l’ordre cistercien avait
principe d’être isolé et de se suffire à lui-même. En 1119 Saint Bernard fonde Fontenay, fille
de l’abbaye de Clairvaux. Vers 1130 le site se déplace et s’implante en vallée, le long d’une
rivière qui lui permet ainsi d’utiliser la force hydraulique.1
La base de ce travail repose sur les récentes études architecturales sur la forge2 et
les recherches métallurgiques du site des Munières3, selon les demandes du travail et la
documentation disponible. Deux ouvrages généraux sur l’abbaye de Fontenay furent
également consultés4.
1 ANDRÉ, L., 2003, p. 14.
2 BENOÎT, P., 1986, p. 50-52 ; AQUILINA, L., BAPTISTE, P. et DEROIN, J.-P., 1991, p. 299-314 ;
CAILLEAUX, D., 1991, p. 327-329 ; CAILLEAUX, D., 1996, p. 401-411. 3 BENOÎT, P., DEROIN, J.-P., LORENZ, C. et LORENZ, J., 1992, p. 133-148 ; BENOÎT, P., GUILLOT,
I. et DESCHAMPS, C., 1991, p. 275-288 ; BENOÎT, P., 1991, p. 289-298. 4 BÉGULE, L., 1912 et ANDRÉ, L., 2003.
3
L’ARCHITECTURE
Le complexe abbatial de Fontenay dispose d’un bâtiment considéré par la tradition
comme une forge. Ce site est marqué par l’architecture gothique cistercienne, caractérisée
par sa sobriété (fig. 2).
La forge est un bâtiment rectangulaire long de 53 m. et large de 13, 5 m., situé au
sud de l’ensemble abbatial (fig. 1, n°17 et fig. 3). Elle dispose de quatre salles. Cet édifice fut
construit dès le XIIe siècle en trois étapes successives et peu espacées dans le temps (fig. 4)
car on remarque des similitudes entre les décors (ex. consoles, chapiteaux et ogives). Un
premier état était constitué de deux bâtiments distincts : d’une part d’un moulin à blé pour
moudre la farine et d’autre part d’une salle de travail et d’une autre pour les fourneaux. La
pièce de jonction entre ces deux bâtiments daterait du début du XIIIe siècle.5
Un premier moulin à blé est construit perpendiculairement à la fausse rivière (fig. 4,
phase A et fig. 5), dont une travée enjambait le conduit (fig. 6), ensuite s’installe un bâtiment
parallèle à la fausse rivière (fig. 4, phase B) et enfin une salle réunit ces deux constructions
(fig. 4, phase C).6
La salle de la forge dans laquelle étaient forgées les loupes de fer est la salle B.
Haute de 11 m., des amorces d’ogive sont conservées sur des culots dans les angles de la
pièce. Alors que Bégule indique que la voûte était vraisemblablement terminée par un
lanternon et devait atteindre le sommet du bâtiment, Caillaux s’interroge sur la réalité de son
édification7. On y conserve le sommet des hottes et les piédroits de deux grandes
cheminées. La construction est caractérisée par du calcaire rose pour les ogives, les arcs et
les montants des deux cheminées (fig. 7).8 Une de ces deux cheminées a été reconstituée
telle qu’elle devait l’être au XIIe siècle lors des récentes restaurations qu’a subi le bâtiment.
On distingue donc trois différentes étapes à la construction de la forge. Une étude
géologique détermine l’usage de 3 types de pierres (ex. mur sud de la salle B en fig. 7). Une
phase initiale identifie un type de calcaire rose au XIIe siècle, suivi d’une phase
d’aménagements et de remaniements au début du XIIIe siècle caractérisée par un type jaune
et une ultime phase plus récente avec l’usage de calcaire blanc lors de la période de
l’installation de la papeterie au XIXe siècle.9 Des restaurations commencèrent dès le début
du XXe siècle pour rendre à la forge son aspect initial.
5 CAILLEAUX, D., 1996, p. 402-403.
6 CAILLEAUX, D., 1991, p. 327-329 ; CAILLEAUX, D., 1996, p. 409 et ANDRÉ, L., 2003, p. 120.
7 BÉGULE, L., 1912, p. 80 et CAILLEAUX, D., 1991, p. 317.
8 AQUILINA, L., BAPTISTE, P. et DEROIN, J.-P., 1991, p. 302 et CAILLEAUX, D., 1991, p. 317-318.
9 AQUILINA, L., BAPTISTE, P. et DEROIN, J.-P., 1991, p. 304.
4
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Le développement commercial cistercien débute dès le troisième tiers du XIIe siècle.10
On connait pour cette époque des exemples de vente de la production pour les sites de
Clairvaux (en 1168), Morimond (en 1182) et Vauluisant (en 1188). De plus, cette vente
répond à un but commercial et non à l’écoulement d’une production de fer excédentaire.11
Les Cisterciens extrayaient et produisaient du fer à travers le système économique des
granges qui consistait en de directs faire-valoir12. Il résulte donc une importance de
l’exploitation du fer dans la production cistercienne13. L’absence de documentation écrite ne
permet cependant pas de s’affirmer sur ces points pour l’abbaye de Fontenay mais pourrait
le laisser supposer. En outre, l’auteur Bégule émet l’hypothèse que la forge de Fontenay, en
plus de subvenir aux besoins de l’abbaye, devait aussi fournir du matériel aux communautés
voisines14.
D’après les recherches actuelles, il demeure trois mentions dans des documents
écrits des XIIe-XIIIe siècles référençant les termes de « mola fabri » et qui pourraient faire
référence au bâtiment de la forge de Fontenay.15
Une question se pose au sujet des travailleurs. S’agit-il de convers ou salariés ?16
Dans le cas des exploitations sidérurgiques cisterciennes en Champagne et en Bourgogne,
Verna suppose la présence de frères convers pour constituer la main-d’œuvre à l’origine et
seraient remplacés par des ouvriers salariés après 1200.17
D’autres productions artisanales sont également à considérer à l’intérieur de ce
bâtiment industriel. On sait que de la farine y était produite pour le pain18 dans la salle du
moulin. Caillaux y suppose également le travail du chanvre et cuir19.
10
ANDRÉ, L., 2003, p. 119. 11
VERNA, C., 1983, p. 210. 12
VERNA, C., 1983, p. 210 et ANDRÉ, L., 2003, p. 119. 13
VERNA, C., 1983, p. 209. 14
BÉGULE, L., 1912, p. 79-80. 15
BENOÎT, P. et CAILLEAUX, D., 1991, p. 270 et 272 ; BENOÎT, P., GUILLOT, I. et DESCHAMPS, C., 1991, p. 275 et ANDRÉ, L., 2003, p. 119. 16
BENOÎT, P., 1991, p. 296. 17
VERNA, C., 1983, p. 210. 18
BENOÎT, P. et CAILLEAUX, D., 1991, p. 269. 19
CAILLEAUX, D., 1991, p. 330.
5
L’ARCHÉOLOGIE
D’après les fouilles réalisées au XIXe siècle, le site n’était pas vierge d’occupation car
des structures gauloises ou antérieures y furent découvertes20. Une exploitation antérieure
du minerai lors de l’Antiquité est même envisagée21.
Divers sites d’exploitations minières furent repérés aux alentours de l’abbaye (fig. 8).
Le site des Munières, situé en forêt à 500 m. de Fontenay, fut analysé avec grande minutie
par l’équipe dirigée par Paul Benoît. Ils y ont découvert 14 puits d’extraction de minerai (fig.
9). Neuf d’entre eux étaient des puits aveugles, c’est-à-dire sans débouché sur le filon, et les
cinq autres descendaient vers le gisement22. Par les espaces vides laissés par l’extraction,
les chercheurs estiment la quantité de minerai extraite à environ 250 à 300 m³, ce qui
équivaut à un an de production23. Cela implique donc la nécessité de différents sites. Trois
secteurs sont d’ailleurs considérés comme lieu d’extraction : le champ des Munières, l’usine
Choiseau et la forêt du Grand Jailly24. La période d’exploitation est évaluée entre 1150 et
1350, époque d’apogée de la sidérurgie cistercienne en Bourgogne25.
En ce qui concerne les indices d’extraction, aucun instrument n’a encore été
découvert mais quelques traces d’outil ont pu être repérées. Le travail des mineurs s’est
limité à décrocher le minerai du karst, ce qui n’a pas laissé beaucoup de traces. Il demeure
cependant des empreintes dans le puits 1, 2 et 4. Par ces traces, les chercheurs supposent
que les mineurs ont utilisé un outil à percussion posée, telle une pointerolle ou un ciseau, en
raison de l’exigüité des galeries.26
En raison de sa provenance géologique, le minerai extrait du gisement des Munières
est de bonne qualité ; en effet, la teneur en fer du minerai est de 64%, sous forme
d’hydroxyde. Ce taux élevé permet donc une réduction directe en bas fourneau.27 Des
scories furent d’ailleurs découvertes dans une tranchée de fouille à proximité de l’abbaye28.
20
ANDRÉ, L., 2003, p. 14. 21
BENOÎT, P., GUILLOT, I. et DESCHAMPS, C., 1991, p. 278. 22
ANDRÉ, L., 2003, p. 121. 23
BENOÎT, P., 1986, p. 51 ; BENOÎT, P., 1991, p. 293 et BENOÎT, P., DEROIN, J.-P., LORENZ, C. et LORENZ, J., 1992, p. 145 et 148. 24
BENOÎT, P., GUILLOT, I. et DESCHAMPS, C., 1991, p. 276. 25
VERNA, C., 1983, p. 208-211 et BENOÎT, P., 1991, p. 296. 26
BENOÎT, P., DEROIN, J.-P., LORENZ, C. et LORENZ, J., 1992, p. 145-146 et ANDRÉ, L., 2003, p. 121. 27
BENOÎT, P., GUILLOT, I. et DESCHAMPS, C., 1991, p. 278 et ANDRÉ, L., 2003, p. 122. 28
BENOÎT, P., GUILLOT, I. et DESCHAMPS, C., 1991, p. 285-286.
6
CONCLUSION
La forge de Fontenay est un bâtiment exemplatif et bien conservé du contexte
économique et de la production de fer à Fontenay au Moyen Âge.
L’apport de l’archéologie du bâti permet d’identifier les modifications successives et
l’historique du bâtiment car, bien que l’ensemble de pièces semble homogène, après
analyse on y distingue différentes phases de construction.
Il est à noter en outre l’importance pour ce sujet de la recherche multidisciplinaire sur
terrain et de l’archéologie expérimentale, permettant ainsi d’assembler les approches de
différents spécialistes et de conforter des hypothèses par la reproduction des pratiques
métallurgiques.
Bien que le bâtiment soit conservé, on prend conscience de l’importance de réaliser
des fouilles archéologiques en raison du petit nombre et des vagues témoins écrits.
Organiser des fouilles de la forge demeure cependant nécessaire pour compléter ces
informations.
Certains éléments ont été mis en lumière mais il reste quelques questionnements
concernant les travailleurs, l’emplacement de mines et la provenance du minerai, la
production métallurgique et son caractère économique. L’absence de documents écrits
n’aide pas à comprendre le contexte dans sa globalité.
Le site de Fontenay est implanté dans un riche et idéal milieu naturel pour convenir à
sa subsistance. En effet, la rivière proche fournit l’abbaye en eau et en énergie hydraulique,
les forêts avoisinantes procurent du bois et les diverses mines des environs pourvoient la
forge en minerai de fer de bonne qualité.
7
BIBLIOGRAPHIE
ANDRÉ, L., L'abbaye de Fontenay. De saint Bernard au patrimoine mondial, Paris, 2003
(Les destinées du patrimoine). [UCL : BST-ARCH ; 4 9 AND]
AQUILINA, L., BAPTISTE, P. et DEROIN, J.-P., Etude géologique des matériaux de
construction de la forge de l’abbaye de Fontenay (Bourgogne, France), dans
BENOÎT, P. et CAILLEAUX, D., Moines et métallurgie dans la France médiévale,
Paris, 1991, p. 299-314. [ULB : S.706438]
BÉGULE, L., L'abbaye de Fontenay et l'architecture cistercienne, Lyon, 1912. [BNF :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6108722x.r=abbaye+fontenay.langFR]
BENOÎT, P., La forge de l'abbaye de Fontenay, dans Dossiers : histoire et archéologie,
n°107, juillet-août 1986, p. 50-52. [UCL : FA-542 DOAR 107]
BENOÎT, P., Les mines de Fontenay, dans BENOÎT, P. et CAILLEAUX, D., Moines et
métallurgie dans la France médiévale, Paris, 1991, p. 289-298. [ULB : S.706438]
BENOÎT, P., DEROIN, J.-P., LORENZ, C. et LORENZ, J., Environnement géologique du
minerai de fer de Fontenay (Côte-d'Or) : son exploitation au Moyen Âge, dans Les
techniques minières de l'Antiquité au 18e siècle : actes du colloque international sur
les ressources minières et l'histoire de leur exploitation de l'Antiquité à la fin du 18e
siècle réuni dans le cadre du 113e Congrès national des sociétés savantes
(Strasbourg, 5-9 avril 1988), Paris, 1992, p. 133-148. [KBR : 9A/1993/3.378
(Magasin-Salle de lecture générale)]
BENOÎT, P., GUILLOT, I. et DESCHAMPS, C., Minerai et métallurgie à Fontenay, dans
BENOÎT, P. et CAILLEAUX, D., Moines et métallurgie dans la France médiévale,
Paris, 1991, p. 275-288. [ULB : S.706438]
CAILLEAUX, D., Enquête monumentale sur la forge de l'abbaye de Fontenay et les
bâtiments industriels cisterciens. Premiers résultats, dans BENOÎT, P. et
CAILLEAUX, D., Moines et métallurgie dans la France médiévale, Paris, 1991, p.
315-352. [ULB : S.706438]
CAILLEAUX, D., La "salle du moulin" à la forge de l'abbaye de Fontenay (Côte-d'Or, France),
dans PRESSOUYRE, L. et BENOÎT, P., éd., L'hydraulique monastique : milieux,
réseaux, usages, Paris : Créaphis, 1996, p. 401-411. [ULB : 4 NIV 628.1 PRES]
VERNA, C., La sidérurgie cistercienne en Champagne méridionale et en Bourgogne du Nord
(XIIe-XVe siècle), dans Flaran, t. 3 : L’économie cistercienne. Géographie. Mutations,
Auch, 1983, p. 207-212. [UCL : FH-1 P FLA/3]
8
ILLUSTRATIONS
Fig. 1 : Plan de l’abbaye de Fontenay (ANDRÉ, L., 2003, p. 27).
Fig. 2 : Forge de l’abbaye de Fontenay (©Parmentier J.).
9
Fig. 3 : Plan de la forge de Fontenay (CAILLEAUX, D., 1991, p. 316).
Fig. 4 : Phasages de la construction de la forge (CAILLEAUX, D., 1991, p. 329).
Fig. 5 : Salle D, dite la salle du moulin (CAILLEAUX, D., 1996, p. 405).
10
Fig. 6 : Coupe de la salle D (CAILLEAUX, D., 1996, p. 405).
Fig. 7 : Mur sud de la salle B de la forge, dite la salle des cheminées (AQUILINA, L.,
BAPTISTE, P. et DEROIN, J.-P., 1991, p. 309).



















![BEREIZIAT, Gérald, et al., BUARD, Jean-François (Ed.). La grotte de l'Abbaye I Chazey-Bons : Rapport de synthèse 2010-2012. [Mandate from:] Institut Forel. Genève : Institut Forel,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6341a489ffdbc0c03c02e0f4/bereiziat-gerald-et-al-buard-jean-francois-ed-la-grotte-de-labbaye-i.jpg)