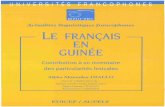Le fidèle lecteur dans le palais des glaces de "The dark tower"
CASTORIO Jean-Noël, "Le ‘monde des morts’ à Nasium". In : MOUROT Franck, DECHEZLEPRETRE...
-
Upload
univ-lehavre -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of CASTORIO Jean-Noël, "Le ‘monde des morts’ à Nasium". In : MOUROT Franck, DECHEZLEPRETRE...
232
Inv. n" t6 : (haut) Statuette de Mercuteen bronze. Ûétouverte
a Nasium tu XIX 5.
(bas) Pour rcmParaison :M e rcu re d e Pa nt- s u r- lrtle u se.
Musee Barrois, {lichés P.-A. Martin"
Belles ou Iaides,toutes ces sculptures se ressem-blent : à toutes il manque l'originalité de laco m positi o n, I' i nté ret d e I'express io n.C. lullian, Histoire de la Gaule,Yl,lgzo,à propos des figurations divines gallo-romaines.
Le jugement de Camil leJull ian peut paraÎtresévère èt il est certain qu'il souffre quelquesexceptions ; i l n'en demeure pas moins qu' i lest le reflet d'une réalité : l'art gallo-romain,plus qu'un art de création, est un art de lavariat ion sur des modèles empruntés au réper-toire gréco-romain. Et souvent ces modèles,une fois intégrés au vocabulaire des atel iers decette province de l'Empire, vont s'affadir, par-fois même être déformés.
C'est sans doute l'art du petit bronze figuréoui i l lustre le mieux ce caractère essentiel del 'art gal lo-romain, ce " provincial isme "
; létu-de des oeuvres de ce type découvertes sur leterritoire de l'antique Nasium, qu'il s'agisse destatuettes ou déléments d'applique, permet-tra de prendre la mesure de ce constat : c'estun échanti l lonnage suff isamment caractéris-tique en effet pour mettre en valeur ce quiforme la substance de cet art mineur.
Avant cela, il convient toutefois de s'attardersur les problèmes spécif iques que posent cesbronzes, qu' i ls proviennent de Nasium oud'ai l leurs ; i ls i l lustrent tout à la fois les précau-t ions qu' i l convient de prendre à leur égard etlétendue des interrogations qui demeurent àleur sujet.
l-Es pnoBlÈnRrs
llampleur des pertesPendant longtemps, ces bronzes n'ont eu
d'autre valeur que celle de l 'once de métal, etcela quelle que soit leur valeur art ist ique. DomCalmet nous rapporte ainsi qu'en t7o4 unhabitant de Nasium vendit à un chaudronnielpour du cuivre, une importante quantité demonnaies romaines, ainsi que le pouce et le
Jearu-NoËr_CASTORIO
bras d'une statuette en " (...) or massif ",.Combien d'autres ont connu le même sort ?lmpossible à dire, mais i l doit s,agir sans doutede la majorité d'entre elles.Les premières victimes de cette récupération,ici comme ailleurs, ont été les bronzes degrandes dimensions, certainement refonouspour certain, dès lAntiquité ; on n,en possèdeplus, à Nasium, que des vestiges bienqofestes : un doigt (tnv. n. r) et un pied (lnv.n" z). Mais les pertes ne concernent pas que tesæuvres exceptionnelles de ce type et, surtour,ne remontent pas toutes à des temps anciens,loin s'en faut I
On peut s'en faire une idée grâce aux texres,qui mentionnent, et décrivent parfois, oesDronzes aujourd'hui perdus, mais aussi grâceaux dessins, que lbn peut considérer commerelativement fiables, de Félix Liénard,b,, (tnv.n" 3). Que sont devenues les pièce, qr,ir ,reproduites ? À quoi ressemblaient exacte_ment " (...) ces petites flgurines d,animaux ",découvertes par C.- F. Denis en rgrg, ou encorecet " Antinous " et cette ', (...) petite statue aeDiane en bronze de Corinthe [sic]
"'découvertsen 1750". Comment expliquer ces disparitionsd'æuvres pourtânt encore connues et locali_sées au siècle dernier ?
Par d'anciennes négligences tout d,abord.F. Liénard est, par exemple, tout à fait affirma_tif à propos de cette figurine de Victoire décou_ugrtg..? r8r5, qu'il dit " superbe ,'
itnv. n. 3b) :el le " (. . .)fait part ie du Musée de Verdun "5 : lesrecherches afin de la retrouver sont restéesvaines...
Mais le principal responsable de leur dispa_rition est sans doute l'attrait quèlles ont toujours su exercel même les plus modestesdêntre elles, sur les collectionneurs. pour s,enconvaincre, i l suff ira de l ire l ,art icle dA.Bretagne' sur le so i -d isant " lara i re " deNasium,contenant quatre petits bronzes, donrnous reparlerons plus bas. prévenu, on ne sait
trop comment, de la découverte, faite par unagriculteur; A. Bretagne se rend ', immédiate_ment " sur les l ieux et achète l ,ensemble, pourun prix qubn imagine très raisonnable. Tourela saveur de l'article tient dans cet adverbe," immédiatement " : i l nous laisse imaginerces notables, souvent membres des sociétéssavantes des grandes villes de la région, quigravitaient autour du site dans l,espoir de col_lecter les plus belles pièces ; i l nous iaisse aussrdeviner le véritable marché paral lèle d,an_tiques qui sétait mis en place autour des ves_tiges de l'agglomération gallo-romaine.
233
Inv. n" z : Fragment de pîed ayantappartenu à un bronze de qrandedimension. Découverte Xt* s.Musée Barrais. Cliché p-A. Martin.
234
!*v. n'4:Stçtaaffe de n Mars "en hnnze. Ëpoque MûdemÊ.
Musèe Et" 'ots.L l i the D. â . Mar t i : .
Ainsi, presque tous les bronzes étudiés icisont passés par des collections privées, les" cabinets dAntiques " de F. Bellot-Herment, C.-F. Denis, A. Dufresne, É. Huber ou F. Liénard lui-même, avant de parvenir dans les col lectionspubliques des musées lorrains. D'autres sontpartis en dehors des frontières régionales : onen s ignale un dans la fameuse col lect ionOppermann , qu i en r i ch i ra l e Musée desAntiquités Nationales de Saint-Cermain-en-Laye; d 'aut res, dans ce l le d 'une cer ta ineMme Roll in-Feuardent de ParisT, col lectionapparemment perdue ou d isPersée.D'inventaires en inventaires, négligeant par-fois la provenance, de legs en ventes publiquesou privées, combien de bronzes de Naix,a ujou rd' h u i a p pa rem ment perd u s, figu rent-i I sdans des collections avec la mention " sansDrovenance connue " ?
[hémorragie est ancienne donc, et el le estloin dêtre guérie : on connaÎt les ravages de la" Doêle à frire ", de ces détecteurs de métaux deplus en p lus sophis t iqués qui a l imentent unmarché paral lèle toujours vivace.
De,, I'adaptation libre "
moderne au < faux rrDeuxième problème, né lui aussi de l 'exis-
tence de ce marché d'æuvres antiques : celuides " faux ". On en retrouve dans presquetoutes les col lections de bronzes f igurés. Maisce problème est en fait plus complexe qu' i l nepeut y paraître a priori : en effet, il n'est pasfaci le de dist inguer le " faux " authentique (!),conçu par un faussai re pour êt re venducomme une æuvre antique, de la simple copiemoderne, considérée, avec le temps, l 'oubli ,comme une pièce ancienne.
Un bronze de Nasium, au Musée de Bar-le-Duc, illustre bien cette difficulté. ll s'agit d'unestatuette de guerrier en cuirasse, portant uncasque à cimier, en laquelle on a, un peu vite,
reconnu Mars militaris ilnv. n" 4). Le style del 'æuvre, certains détai ls de la panoplie commeles bottes bouffantes, le petit trou, au niveaudu coude dro i t qu i permet d ' imaginer unavant-bras mobile ne laissent subsister aucundoute : i l s 'agit d'une ceuvre moderne. On enretrouve d'ai l leurs des exemplaires presques im i la i res dans de nombreux musées ; àchaque fois cependant, un détai l dif fère : ici latête tournée vers la gauche,là vers la droite ; icila cuirasse incisée, là vierge de tout dessin aucontraire. Mais toujours la même tai l le, au mir-l imètre près, et la même manière, le mêmecanon longil igne.
Une étude leur a été consacrée qui situeleur réalisation sous la Régence; ces petitesfigurines couronnaient en effet à l 'origine despendules de style Boulle'. l l ne s'agit donc pas,stricto sensu, de " faux ", mais, pour reprendrela formule de S. Boucher', d' " adaptationsl ibres " sur un thème antique, produites demanière presque industriel le. Ce qui est trou-blant, en revanche, c'est que l'inventaire duMusée Barrois soit aussi formel : la pièceconservée dans les col lections a été vendue àF. Bellot-Herment comme ayant été découver-te à Nasium. Et ce n'est pas le seul exemple oùces petits " Mars " se voient conférer, commeprovenance, un site antique: à Bar-le-Ducmême, une autre statuette tout à fait similaireproviendrait, selon l'inventaire là encore, desfouil les du Louvre à Paris ; à Figeac, au MasdAgenais ou à Sens, des objets identiques sontégalement donnés comme issus de fouil les.On discerne bien le gl issement : si ces piècesne sont oas des " faux " au moment de leurconception, el les le sont devenus par la suite,peut-être par oubli ou omission, sans douteplus souvent encore par malhonnêteté. Onnotera en effet que tous les " Mars " que nousvenons de citer sont passés par des cabinets d'" Antiquaires " :y auraient-i ls mis le même prix
s' i ls avaient su qu' i l s 'agissait d'æuvres viei l lesd'à peine un siècle ? l l nous paraît certain quele vendeur avait compris que ce ne serait sansdoute pas le cas...
Quelle fonction ?Troisième problème : l'absence fréquente
de localisation exacte du site de la découverte,ou, qua.nd cette information est donnée, soncaractère fréquemment très vague.
De mains en mains, de collections en collec-t ions, on a sans doute souvent oublié les cir-constances de la découverte, si el les ont iamaisété connues ;ainsi pour la majorité des piècesétudiées ici, le contexte archéologique est unmystère. Cela est loin d'être sans consé-quences car il devient dès lors très difficile dedéterminer la fonction de ces bronzes :s'agit-ildbbjets de culte ? D'offrandes destinées à undéfunt ? De simples éléments de décoration ?Ou d" 'æuvres d 'ar t " au sens p le in du terme,conçues pour des amateurs et col lectionnéesdès lAntiquité ? Si un même objet peut avoireu plusieurs de ces rôles à la fois - ou successi-vement -, i l n'en demeure pas moins que ladétermination de son emploi principal, quipasse presque nécessairement par une bonneconnaissance du contexte archéologique, peutdonner à l 'historien des informations essen-t iel les. On songe par exemple aux bronzesreprésentant des divinités découverts enmil ieu funéraire : ne sont-i ls pas, même s' i lconvient de rester prudent, le témoignageconcret du caractère psychopompe de certainsdieux, considérés comme des " passeursd'âmes " ? Comme l 'a bien démontréC. Moitrieux, Hercule, par exemple, dont onrencontre parfois l'image debronze dans dessépultures, a pu avoir ce rôle-.
Quelques pièces, dont la découverte estassez bien documentée, font toutefois exceo-tion à Nasium : malgré les multiples incerti-
tudes qui pèsent sur la topographie exacte del'agglomération a ntique, elles sem blent toute-fois proven ir d'ha bitars".
Plus problématique est la découverte, entB79,de ce que l 'on a supposé être, alors, un"laraire" c'est-à-dire un de ces lieux de cultedomestique dont on a récemment tenté déta-blir la typologie en Caule.. C'est à A. Bretagne,déjà cité, que l'on doit cette interprétation : ilse fondait notamment sur le contexte puisqueles pièces avaient été regroupées, à uneépoque indéterminée, " (. .) sous une petitevoûte en pierre de taille, de forme surbaissée ",
et sur la présence, parmi les quatre bronzesdécouverts, d' " (...) un petit autel ". Les autrespièces auraient figuré " (...) Hygie pour conser-ver i la] santé, la chouette emblème oeMinerve pour obtenir la sagesse et un géniepour protéger f la] maison " : le laraire ainsicomposé aurait démontré, toujours selon cetauteur, " (. ) que son possesseur était douéd'un grand fonds de raison, quali té qui s'estperpétuée chez les Lorrains jusqu'à nosjour5 "" I Ces pièces, à l'exception de la chouet-te, perdue mais connue par le dessin qu'en adonné V. Cuny dans l'article d'A. Bretagne {tnv.n' 5), se trouvent actuellement au MuséeHistorique Lorrain de Nancy ; l'hypothèse deBretagne, certes tentante, n'est pas corroboréepar leur étude. [ " autel ", de bien trop petitesdimensions pour que l 'on puisse réellement luiassigner cette fonction, est en réalité un élé-ment d'applique (lnv" n' 6) ; i l en va de mêmed'ailleurs pour la prétendue " Hygie "
ilnv. n" 7).Les éléments de décoration qui figurent lebuste d'une divinité féminine sont très fré-quents en Caule ; i l est impossible de se pro-noncer sur l ' identité de la déesse, le diadèmebouleté qu 'e l le por te pouvant auss i b ienappartenir à Tutela, qu'à la Fortune oulAbondance, voire à Vénus ou Junorr.llhétérogénéité de ce matériel, puisque les
r : Dom Calmet,1762, p.116.rbis : F. Liénard, r881, pl. XXV| et XXVz : F. Liénard, r88r, p. zz ; i l se serait ati d'uncoq, d'une vipère et d'un lézard.3 :Dut iva l ,V79,p .354, qu i p réc ise que las ta tue f te de D ia le e la r t ' ( . . ) de la haJ teu lde quatre pouces [environ onze centi-mètresl, la jambe gauche mutilée ".
4 : Ont a ins i d isparu , sans que nous so ien tparvenus de dessins ou de descriptionsdignes de ce nom : un bæut décoLvert en1750 et identif ié à tort, comme cétait fré-quemment le cas à lépoque, comme unefiguraLion du dieu Apis (C.-f. Denis (iré parMourot,2oo1, p.4r5) ; une figurine de boucet un torse de femme retrouvés en 1824 (F.Ljéoard, r88r, p. 23) : une statueLte d aigledécouverte l'année suivante (ibid., p.24) ;une Vénus. mise au Jour en t88o e i rmmediatement vendue, coiffée d'un diadème ettenant , dans une main , un mi ro i r d isparu ,dans l 'âutre une mèche de ses cheveux (M.Belin cité pa r F. Mou toT,2oo1 ?. +14).5 : Ê L iénard ,188r , p .16 .6 : A. Bretagne,1883.7 : F Liénard, r88r, p. 3r : i l s'agirait debronzes an imal ie rs : un l ion , un dâuph in e tun coq, d'abord acquis par un certainBenard qur le< vend i l ensu i te à la nommeeRollin Feuardent.8 : M. Pressouyre, 196 6, p. 252-254.9 | S. Boucher D76, p. 265.1o : C. Moitrieux, 2002, p.3og.1r : Ces l le cas no tamment de la s ta tue t tede Minerve découverte en 1818 auxTussottes, voir Denis, r8r8, p. 6 ; peut-êtreaussi de la Diane, citée supra, voir Mourot,2oo1, P. +19.12 : C. Coulon,D98, p. 6+ 66.13 : A. Bretagne, r883,p 36gjj i.
235
736
lrv" n" # : Statuette efi b{tnzereprésentant un *moçr a!lé
Ûécauverte X!X' s'Musée Larrai*, Nanty.
tlictté P.-A. Martin.
f nv" n" 7 : Apgtlique ds meubleen branze flgurant une divinité
indéterminée. Dérauverte XlX.' s.Musée Larrain, Nan*Y.
Clichi4 P.-4" Mû{tin.
autres bronzes, la chouette et une statuetted'Amor (lnv. n' 8), sont des pièces autonomeset non des appliques, incite donc à reconnaÎtredans cette découverte non un " laraire ", maisplutôt un dépôt, voire une cache'. Mais pour-quoi cette concentration ? Dans quel contextea-t-elle été découverte exactement ? A-t-elleun l ien avec les sanctuaires reconnus à proxi-mité, sur le plateau de Mazeroie ? l l est impos-sible de répondre à ces questions en létatactuel de la documentation.
Bronzes figuréset religion gal lo-romaine
Cet exemple démontre f inalement bien qu' i lest souvent impossible de déduire de cespièces de bronze l'importance de tel ou telculte, au moins à léchelle locale. On voit pour-tant fréouemment des études consacrées à lavie rel igieuse d'une agglomération, ou d'une" cité " au sens antique du terme, recensertoutes les apparit ions de tel ou tel dieu : danscette approche très " comptable " de la vie reli-g ieuse en Caule romaine, sont mises aumême plan les f igurations de bronze, les sculp-tures de pierre, les inscriptions ; bref toutes les" épiphanies " de la divinité.
C'est oublier les problèmes spécif iques queposent les petits bronzes : la difficulté à déter-miner leur fonction bien sÛr; mais aussi le faitqu'il s'agisse d'æuvres " voyageuses " dont ilest souvent bien difficile de savoir en quel lieuelles ont été produites, et qui, de plus, au coursde leur diffusion ont pu perdre de leur sensrel igieux originel. l l convient ici de citer un Pas-sage du livre XXXIV consacré à la sculpture, del'Histoire Naturelle de Pline lAncien ; il nousdécrit ces amateurs, au rang desquels Néronou Alexandre le Crand, " (. . .) si amoureux deleurs bronzes dits de Corinthe qu' i ls les empor-tent avec eux en voyage "'5. Belle illustration
des déconvenues auxquelles on risque de seheurter si on cherche à distinguer trop nefte-ment la fonction cultuel le de la destinationprofane, " culturelle ", de ces æuvres d'art"' :ces collectionneurs aimaient-i ls ces bronzespar attachement à la divinité représentée ousimplement pour les quali tés plastiques de laf iguration ? Les deux sentiments ne semêlaient-i ls pas ?
Ce passage i l lustre aussi la circulation deces sculptures dans tout l 'Empire ; ce sont desæuvres que l'on pouvait facilement transpor-ter et qui, pouvaient donc être l'objet d'une dif-fusion à grande échelle, déchanges dans lecadre d'un marché dont les l imites dépas-saient sans doute celles de la "cité". Où ont étéproduites les pièces découvertes à Nasium 7Difficile à dire tant les ateliers de bronziers enCaule sont mal connus, leur déterminationreoosant souvent, comme l'a bien montréStéphanie Bouchel sur l'argument ubi multa,ibi domestica. plutôt que sur de véritablespreuves archéologiques. 5i une productionlocale ne doit pas être exclue puisque l'on pos-sède des traces, il est vrai difficiles à interpréter,de l'activité probable de bronziers à Nasium ,il est certain que nombre d'entre elles ont étéfabriquées ai l leurs, peut-être même en dehorsdes frontières de la Caule.
On peut d'ai l leurs se demander si ce proces-sus de diffusion n'a pas inévitablement pourconséquence une perte de la valeur cultuel lequ'avaient certaines de ces figurations à l'ori-gine. Une statuette de tel dieu, produite à telendroit en fonction de la demande locale quiprivilégie le culte de cette divinité, a pu serépandre bien au-delà de sa zone de produc-tion et perdre ainsi son rôle de témoignaged'une dévotion particulière pour ne plus deve-nir qu'un objet apprécié pour ses quali tésesthét iques une f igurat ion d iv ine parmid'autres. Ne doit-on pas interpréter ainsi la
grande d i f fus ion qu 'ont connu, en Caule, lesfigu r i nes d'ous hebtis et d'Osi r is fu néra i res,8plutôt qu'y voir un aspect de la pénétrationdes cu l tes or ienta ux da ns l 'Occ identromain ? Et pourquoi en irait- i l dif férem-ment pour les f igurat ions de d iv in i tés dupanthéon c lass ique ?
Cer ta ins documen ts son t d 'a i l l eu rs p lusexpl ic i tes et montrent le g l issement del ' iconographie d iv ine du monde cul tue lversle s imple langage décorat i f . Une appl iquede Nasium f igurant le buste de Minerve( lnv. n" 9)en est l ' i l lus t rat ion. .E l le appar t ientà une sér ie , d 'assez médiocre qual i té , qu isemble surtout avoir été diffusée dans lenord-est de la Caule. La valeur rel igieuses'efface ici au profi t des possibi l i tés gra-phiques qu 'of f re l ' iconographie habi tue l tede la déesse : son image devient décor, jeufait de courbes et de formes géométriques,grâce au développement donné au c imierou casoue.
Ces petits bronzes ne se prêtent doncguère, selon nous, à cette " comptabil i téd iv ine " que nous évoquions, qu ' i ls ne peu-vent que fausser, au moins à petite échelle.5 ' i ls nous renseignent f ina lement , c 'estavant tout sur l 'env i ronnement cu l ture ldesCal lo-Romains, sur la d i f fus ion du " goûtromain " qui a pénétré, progressivement,toute la société, et cela notamment grâce àla diffusion massive d'objets de ce type. Lescouches moyennes et " popula i res "
n 'é ta ien t sans dou te pas en res te : demodestes objets, comme le buste-appliquede Minerve, ont auss i contr ibué à les impré-gner de l ' imager ie gréco-romaine. C 'estpour cela surtout que ces petits bronzessont des témoignages p lus que préc ieux.
Le problème de la chronologieC'est le dernier que nous évoguerons;
inut i le de d i re que ce n 'est pas le moindre. . .[absence de contexte archéologique connuest ic i un handicap de ta i l le , mais i l ne four-nit, de toutes façons, qu'un terminus adquem puisque les æuvres de ce type ont pucirculer pendant des temps extrêmementlongs'e. Ce qui est plus préoccupant f inale-ment, c'est I 'absence de critères de datationf iab les tout cour t | " En fa i t , nous ensommes réduits (.. .) à des approximations, àdes probabi l i tés " , remarque S. Boucher quien a dressé la l iste, et de noter plus loin que" (.. .) pour un même objet, [ i ls] sont souventcontradictoires " 'o. Car dans le domaine oubronze comme dans celui de la sculoturesur pierre, i ls sont avant tout styl ist iques ;etl 'on en rev ient a lors tou jours au mêmeschéma : une pér iode de format ion, autourde la naissance du Chr is t , à laquel le on at t r i -bue souvent les æuvres atyp iques; unepér iode de matur i té , du mi l ieu du 1" , s iècreapr . J . -C. au début du l l t " s ièc le, ce l le despièces de la mei l leure qual i té ; une pér iode,enf in , de décl in , le l l l " s ièc le, pour les p iècesles plus frustes. Arnold Toynbee et son cycledes c iv i l isat ions ne sont pas lo in . . .
Non que ce schéma n 'a i t pas quelquevalidité : on peut suivre, dans l 'art off iciel,I 'évolution des formes vers un langage plusabstrait et plus décoratif . Mais cette évolr,t ion est-el le valable pour les petits bronzesgallo-romains dont l 'essentiel a dû être pro-dui t dans de pet i ts a te l iers b ien é lo ignésdes grands centres de création art ist ique del 'Empire ? Tel le æuvre, où la s ty l isat ionprend le pas sur le natura l isme, ne doi t -e l lepas être considérée comme Ia productiond'un bronzier médiocre, schématisant lesformes de modèles qu' i l ne sait reproduire,p lu tôt que comme un repère chronolo-
14: Les découvertes de bric-à-brac de cetype ne sont pas rares : voir par exemple ladécouverte récente de Dury en Picardie, oùon a mis au jour, dans la cave d'une vil la,plusieurs centaines de bronze de toutessortes ; Favier, Quére1,1994.i5:Signis quoe uocont Corinlhia plerique intantum capiuntur ut secum circumJerqt(Histoire noturelle,xXXlV 48, trad. H. leBonniec).r6 : Comme le rappelle Boucher, t976, p. 6r.17 : Ê Mourot, 2oot, p. 37o.18 :Turcan, t989, p. too ; plusieurs sta-tuettes de ce type se rencontrent enLorraine, notamment dans les collections duMusée lorrain de Nancy.19 : Alnsi les nombreuses flgurinesd'Hercule, supposées étrusco-italiques,retrouvées en contexte gallo-romain.20 . S. Boucher, Dj 6, p. 247.
238
l t ] t r t ' t u i l : 5 ' - a rue l t e È t , b ron t 'd 'af ,6nr. çsç61tysr te XIX \
Musè- Barta i : .L!irhé F.-A" Martitt.
g ique ? On peut même inverser le ra isonne-ment : la mu l t i tude de p ièces f rus tes de cetype ne témoigne- t -e l le pas de l 'exp los ionde la product ion des pet i ts bronzes f igurés,avec , pour coro l la i re , une ba isse de Ieur qua-l i té moyenne, e t donc de la v i ta l i té d 'un ar tou i se répand dans tou te la soc ié té . B ien desp ièces " s ty l i sées
" pour ra ien t a lo rs da terdes temps d 'apogée de la pax romana.Toutes ces remarques nous inc i ten t à ne pasproposer i c i de da ta t ion préc ise pou r leso ièces de Nas ium. dont la réa l i sa t ion do i tê t re p lacée dans une fourchet te la rge , du l " 'a u l l l ' s i è c l e a o r . J . - C .
Un bronze tou te fo is a des chances d 'avo i ré té réa l i sé à une époque an tér ieure : i l s 'ag i td ' u n e f i g u r i n e d e p e t i t e s d i m e n s i o n s ,conservée au Musée de Bar - le -Duc, repré-sentan t un bceuf i !nv ' . t t ' ' .1 ' ; ; . E l le a é tédécouver te à Bov io l les ; i l peu t s 'ag i r d 'unind ice chrono log ique pu isque l 'occupat ionde cet oopidum est surtout attestée à LaTène f ina le" : i l fau t tou te fo is res te r p rudent
c a r d u m a t é r i e l d e l ' é p o q u e i m p é r i a l e y aéga lement é té découver t . Ava n t tou teschoses , i l conv ien t de sou l igner la g randequal i té de cette pet i te f igur ine. Ses formesschémat ioues n 'on t r ien à vo i r avec lesceuvres maladro i tes que nous évoqu ionsp l u s h a u t ; i c i , n u l d o u t e q u e l a s t y l i s a t i o nso i t vo lon ta i re . Les dé ta i l s impor ta ien t peu :les yeux , le muf le sont à pe ine ind iqués parde cour tes inc is ions . C 'es t une épure debronze, à laque l le on reprochera s imp le-ment son ar r iè re- t ra in un peu ra ide .
Ou fut produite cette pet i te sculpture ?On peut -on doit ?- hési ter entre deux hypo-thèses : une produc t ion gau lo ise ou uneimpor ta t ion i ta lo -é t rusque ' ' . Le cho ix en t reces deux poss ib i l i tés es t rendu ex t rême-ment complexe par le fa i t que les a r ts de cesdeux c iv i l i sa t ions se so ien t in f luencés réc i -
p r o q u e m e n t , e t a u - d e l à , c a r n o m b r e d e
leurs o roduc t ions re lèvent f ina lement d 'unmême espr i t . S i les musées i ta l iens regor -gent de p ièces de bronze à su je t an ima l ie rh icn nrorhcc dr r hcpuf de Bov io l les , nousser ions tou te fo is p lu tô t par t i san d 'y vo i rune æuvre réa l i sée dans l 'a i re ce l t ique . La
tendance à l 'abs t rac t ion qu i carac tér ise cepet i t bæuf, le goût pour la courbe se retrou-vent en effet sur une série de pet i tes f igu-r ines de l 'âge du Fer , qu ' i l s 'ag isse de f igura-t i o n s a n i m a l e s , c o m m e c e l l e s q u i o n t é t edécouver tes dans l 'opp idum de Joeuvres ,d a n s l a L o i r e ' i , o u d e r e p r é s e n t a t i o n shumaines comme la pe t i te s ta tue t te repré-sentan t un joueur de t rompe t rouvée àSt radon ice en Bohême' '1 . Ce sens de l 'épurees t p résent éga lement sur les chenets defer, ornés de protomés de taureaux, prove-nant de la r i che tombe de Bro tonne dont le
m a t é r i e l , d a t é d u l l " s i è c l e a v . J . - C . , e s t
conservé a u Musée de Rouen '5 . On Ie vo i t , ona d e b o n s e x e m p l e s p r o c h e s , a u m o i n s d a n sl 'espr i t , p rodu i ts en Cau le même ; c 'es t cequ i nous inc i te à y reconnaÎ t re une æuvrec e l t i q u e , m a i s , e t n o u s i n s i s t o n s s u r c epo in t , i l ne s 'ag i t là que d 'une hypothèse.
À que l le époque fu t p rodu i te la p ièce deB o v i o l l e s ? [ e s p r i t q u i l a c a r a c t é r i s e s ere t rouve sur de pe t i t s b ronzes an imal ie rs , àvocat ion sans doute décorat ive, dont la pro-
duc t ion s 'é ta le durant tou t le second âge duFer , depu is le lV" s ièc le jusqu 'au l " ' s ièc le av .J . -C '6 . On cons idère tou te fo is généra lementque c 'es t à la f in de l 'époque la tén ienne qu 'a
é té réa l i sée la ma jor i té d 'en t re euX: e r ra t tendant mieux , on proposera donc le l l " o -le l" ' s iècle av. J.-C.
l l fau t ins is te r une dern iè re fo is sur laq u a l i t é d u t a u r e a u d e B o v i o l l e s ; o n e n p r e n -
dra la mesure en le comparant à ce qu i
fo rme I 'essent ie l des bronzes gau lo is de
même thème, except ion fai te, bien sûr, desæuvres que nous avons c i tées p lus haut .
P. - M. Duval a bien décri t les caractér is-t iques essent ie l les des bronzes an imal ie rsce l tes , réa l i s tes " ( . . . ) ma is sans le mouve-ment , la v io lence, le carnage, n i la tens ionm u s c u l a i r e c o n t e n u e q u ' e x p r i m a i e n t l e s
t LI tal iques, les Etrusques, les Scythes ( ) etd isons- le , sans la fougue romant ique : c 'estPompon, p lu tôt que Barye " ' r
; la comparai -son a fait f lorès. Les nombreuses reorésen-tat ions du sangl ieç l 'an imal fé t iche du bes-t i a i re gau lo i s , t émo ignen t b ien de cemanque de v igueur , d ' i nsp i ra t i on ; t ou tmouvement mais aussi tout raff inemenrsont exc lus de la représentat ion de l 'an imalb ien campé sur ses quatre pat tes. Malgrédes tentatives récentes pour rendre à cespièces quelques le t t res de noblesse '8, is 'ag i t b ien de l 'express ion la p luscommune d 'un " a r t m ineu r " . Letaureau de Bovio l les s 'en d is-t ingue ; certes, ce n'est pasune p ièce du " Crand Ar t" , ma is le b ronz ie r a suinsu f f le r à l ' an ima l unecer ta ine dynamique ;
i l a su également , sans que ce la nuise à lareprésentat ion, ê t re p lus a l lus i f que descr ip-t i f . C'est une quali té que l 'on retrouve dansl 'ar t monéta i re, l 'une des p lus bel les expres-s ions de l 'ar t gaulo is , où la f igure se décom-pose progressivement pour ne plus devenirqu'un assemblage de courbes ;or c'est entre ledébut du l l 'siècle et la conquête que cette ten-dance est la plus nettement visible dans lemonnayage, ce qui confirmerait donc la data-tion assez tardive du bronze de Boviolles.
l l est possible que deux autres bronzes deNasium puissent également être datés d'uneépoque antérieure à la conquête. ll s'agit toutd'abord d'une figurine très maladroite, de peti-te tai l le, représentant un homme nu, les brasécartés, tenant dans la main droite un obietcirculaire { lnv. n" tr}. El le nous renvoie au typede l"' offrant ", si courant dans la productionétrusco-italique" ; ffiâis il est bien difficile dese prononcer sur la provenance dans le casprésent, tant la pièce est de médiocre qualité :on pourra donc tout aussi bien songer qu' i ls 'agit là d'une importation que d'une copiegauloise maladroite ou encore d'une oeuvre
d 'époque romaine ex t rêmementfrustej'. Un autre bronze de Naix,ent ré dans les co l lect ions du
Musée des Antiouités Nationalesde Saint-Cermain-en-Laye en r868,
d'un style, selon Salomon Reinach, "
( . . . ) d 'une tel le grossièreté qu'on r isque des'avancer beaucoup en prêtant au modeleur(...) l ' intention de faire une caricature "r1, poseun problème f inalement ident ique { lnv. n 'r : ) .
a[étude des bronzes de Nasium soulève donc
bon nombre de problèmes qui sont ceux aux-quels se heurte toute étude sur les bronzes deCau le ;on re t rouveéga lementdans ce lo t lesprincipales caractér ist iques de cette formed 'ar t te l le qu 'e l le se présente à nous danscette province de l 'Empire.
239
2r :Voir ici-même la partie consacrée àl'oppidum parT. Dechezleprêtre etÊ Mourot.22 : l l est en effet souvent très délicat dedistinguer es pièces produites en ltalieavanI la ro rquêre romaine . e t i -po .1ee5en Cau le , de ce l les fabr iquées sur p lace e tqu i on t pu s 'en insp i re r ;vo i r par exempleles hésitations de Boucher, t97 6, p. 247, oude Ogg iano B i ta r , r984, p . 60 , n '78 . Pourcompara ison, vo i r les b ronzes an imal ie rsétrusco-ita l iques étu diés pat Adam, 1984,p. r36rl8, nos r76i8o.4 : Aft celtique,1983,p.1g2,nos 249 25a.24 : Musique, 2oo2, p. 114, n" 82.25 : Celtes,i997, p. +33.26 : P. M. D uval, 1977, p. 161-163.27 : P. M. Duval, Bj7, p. 162.28 : E.Vial, " Une statuette de sanglier enbronze découverte anciennement sur l 'oppidum de Sion " dans Princesses,2oo2,p.114-11S,fig.29 | Notamment Oggiano-Bitar, 1984,p .54-55, n" 6 r , même pos i t ion , ma is hab i l ée t p lus soph is t iqué.30 : La scu lp tu re sur p ie r re nou5 a hab i tuéà des figurations sommaires de ce typ..da tan t de I 'Empi re . Pourquo i en i ra i t i1 d i f -féremment pour le bronze ? Voi parexemple les scu lp tu res de Sou losse, danses Vosges, où les æuvres les plus sophisti
quéeq vo iq na .er I ave i de ver i tab es car i ra -tu res ; Kahn, r99o.31 : S. Reinach,1894, p. 2ro.
Inv. n" to:Sfaf$etfe en bronze
reprësentant un taureçu.Déæuverte sur l'appidurn deBoviolles au XIX' s. Musée Barroistlithé P.-A. Martin.
lnv. n" ry : Statuette en branzerepresent*nt Jupiter au Neptufre.Dëcouverte XIX s. Musee Barrois.
Cliché F.-A," Martin.
Lrs enoNzEs DE Nagum:uN ENSEMBLE CARACTÉntSflqUr Orlhnr ou BRoNzE FtcuRÉEN GAULE
La domination presque sâns partage dustéréotype
[essentiel des bronzes gallo-romains n'estque copie plus ou moins adroite, de modèleslmportés ; c'est le cas à Nasium commeail leurs. Si lbn en cherche le prototype, i l fau-dra se tourner, dans la majorité des cas, versl'art grec. On peut les mettre en série puisquel'on rencontre presque toujours, sur le territoi-re de la Caule et au-delà, des pièces compa-ra bles.
I Les divinités masculinesÀ tout seigneur; tout honneur : Jupiteç te
dieu des dieux, est représenté par deux frag-ments provenant de Nasium. On peut toute-fois hésiter sur cette identification : les attri-buts ont en effet disparu dans les deux cas, eti l pourrait alors aussi bien s'agir de Neptune,qui, sur bon nombre de f igurations gallo-romaines, est représenté de la même manièreque son frère olympien. Quoi qu' i l en soit, cesdeux fragments (lnv. n" t3-r4) semblent bienavoir appartenu à une représentation enmajesté, à la manière de la statue de culte dutemple de jupiter Tonnant sur le Capitole deRome, æuvre inspirée du Zeus brontaios deLéocharès, sculpteur du lV" siècle av. J. - C. qui,lui-même, aurait emprunté son modèle à soncontemporain, Lysippej' : le dieu devait alorss'appuyer de son bras gauche levé, soit sur lesceptre, soit sur le trident, et présenteri dans lamain droite tendue, le foudre ou un dauphin.Ce modèle en majesté est très répandu enCaule et dans les provinces voisines ; on le
retrouve d'ai l leurs en plusieurs exemplaires, dequali tés inégales, en Lorraine même : le muséede Toul en possède par exemple deux, retrou-vés dans le chef-l ieu de la " cité ".
Deux statuettes perdues se rattachaientsans doute à des représentations dApollon(lnv. n'3d et e) ; leur muti lat ion pourrait inciterà la prudence quant à cette identification,ma is, là encore, on possède en Ca u le toute u nesérie de statuettes semblables, bien conser-vées, qui s' inspirent de prototypes gréco-romains. La première (tnv. n' 3e) f igurait unjeune homme nu, la main gauche levéecomme pour saisir un objet disparu : ce mou-vement se retrouve sur des f igurines du dieumusicien, part icul ièrement courantes dans lecentre et le nord de la Caule, inspirées d'un ori-ginal grec de la seconde moitié du lV" siècle av.J.- C. ; l'objet posé à ses côtés devait donc êtrela lyre, quant à celui qu' i l t ient dans son autremain, le plectre. La seconde {lnv. n. 3d), acépha-le, se rattache à un autre type, inspiré cette foisde modèles grecs préclassiques, et dont onconnaît plusieurs copies en Caule, notam-ment les deux grands bronzes de Li l lebonne etVaupoisson.
La belle statuette d'Hercule marchant duMusée Barrois nous donne, quant à el le, à voirun modèle qui, s' i l n'est pas le plus couram-ment choisi en Caule pour représenter le dieu,se retrouve en revanche fréquemment dansl 'Occident romain, à tel point que CérardMoitr ieux le quali f ie ici-même de " poncif ".
Enfin, le beau petit Amour du Musée Lorrain{lnv" n' 8), en course et la coiffure en corymbe,se retrouve dans presque toutes les grandescollections de bronzes antiques de France.
I Les divinités fémininesCe sont également des modèles grecs qui
sont à l'origine des représentations en bronzede déesses retrouvées à Nasium.
, - . a ,lnv. n" jd : Statuêtte repré-sentant Apollon ?Découverte XIX s.Gravure de F. Liénard, r88r.
lnv. n" t4 : Fragment de sta-tuette en bronzefigurant unbras armé d'une lsnce.ûécouverte XlX" s"Musée de Metz.CIiché Service du musée.
J2 | S. Boucher, 97 6, p. 67 1 o
242
l , ; . 1 r , \ l \ { r - , f L l è l : Ê r l e , i , l . r , , s
'- i ' , - . / i . ' 1
tlititi:, st;.;!te d# '11t:irjr
Ven r rs es t renrésenf ée n : r der rv even l -nlaireç C'eçf l : déeçse de la beauté et delAmour que l'on doit, en effet, reconnaîtredans la p lanche de F . L iénard ( i i r v r '3a i :e l le es treprésentée nue, ne portant qu'un diadème,suivant un modèle courant dès lépooue clas-s ique, qu i a connu un grand succès en Cau le .La perte des bras ne nous permet malheureu-sement pas d' ident i f ier la var iante exacte àlaquel le el le se rapporte. Ce n'est pas le cas enrevanche pour une autre f igur ine conservée àMetz {lriv rr" r5j : i l s'agit cette fois du type bienconnu de la Vénus du Cap i to le , cachant pud i -quement son sexe et sa poitr ine de ses mains,et sem bla nt rega rder; de sa tête tou rnée vers lagauche, l ' intrus qui v ient de la surprendre. Ladate de la créat ion de ce modèle. inspiré delAphrodite de Cnide de Praxi tèle, est t rès dis-c u t é e : o n h é s i t e g é n é r a l e m e n t e n t r e l esecond classicisme et les débuts de l 'éooouehe l lén is t ioue.
La Victoire qu'a dessiné F. Liénard i i*r i 1r) estauss id 'un modè le ex t rêmement courant danstout l 'Occident,qui rappel le la Niké de Paionios,mais en moins déshab i l léer j ; la pos i t ion de lamain , qu i t ien t un pan de la d raper ie , rap-proche notre représentat ion des mult ipleste r res cu i tes he l lén is t iques f iguran t cethème' ' .
Qi""- iq u,: t v ?rf ài iof f i g
pr*pi'*rl'i*rut g* è l*-r*rv:a i ru*sLes rares pièces qui ne trouvent pas leur
équivalent exact dans l 'art gréco-romain n'ap-portent en fait que de légers changements àdes types connus, sans en modif ierfondamen-talement la structure : i l ne s'agit que de varia-t ions. l l semble b ien a ins i que la représenta-t ion de Mercure nu, le bras droit tendu pourprésenter la bourse, est une spécif icité gallo-romaine i lnv. i :" , ,h *i rÛJ ;on n'en connaît eneffet que très peu d'exemplaires hors de Caule
t r t v . n " lb " | t ç l t tp t te ren te-
sentatt l urte Virtoi,e ai iee.Çrçvure de L Liénard, r88r"
Ji.i!: $ lrl r "iicri*;;ri* **\i4::us.5va':urt d*: F. Li*::t:4,i;1âT"
Ill;,. *" t:: Ëri;r?t"u:*l;f rj* "çi*'
I u eti*'rr p r*s r: n!r; r: i u n l:; r a :,d ;'* p i. tu1 t; : i * ;-.i*-,.{...'};rïr.{irrirr -lrrxrrl *t.r llr'lule*,
où ce type a, en reva nche, con nu u n formidablesuccès. Comment I 'expl iquer ? On a pensé qu' i lpouvait en fai t s 'agir de copies du Mercuremonumenta l - i l aura i t mesuré o lus de t ren temètres de haut- qu'aurai t réal isé le sculpteurZênodore pour les Arvernes, avant de se consa-crer à l 'ef f ig ie colossale de Néron à Romer; ; i lne s 'agi t toutefois que d'une hypothèse : maisdans ce cas, i l faudrai t encore reconnaître quec'est un Crec qui est à l 'or igine de l 'un desmodèles que l 'on considère comme une spéci-f ic i té de l 'art du bronze gal lo-romain !
Mercure est sans doute représenté égale-ment par un fragment de chlamyde, couvrantle f lanc et le bras gauche du dieu, conservé àMetz i inv . i l j : ce modèle est moins or iginalque le précédent, puisqu' i l se retrouve dansd'autres provinces:: . l l est, là encore, t rès cou-rant en Caule : le Musée Barrois en oossèdeainsi un autre exemplaire meusien découverià Pont-sur-Meuse.
*m* *r'e: pr* r:ts i**r:*gnæ Bh i{T si*sO_uelques f igurat ions sont plus atypiques,
mais i l ne s 'agi t pas pour autant de créat ionsga l lo - romaines : on a s imp lement empruntel ' iconographie propre à une divini té pour enreprésenter une au t re . C 'es t le cas de laA l i n c r r r p n p r d r r e , , , , , ' , . : l n r < n t t c l c q r c n r é -
sentat ions de cette déesse sont généralementd r r tvne "en ma ieqté" el le sem ble ma rcher ic il l ex is te que lques para l lè les ga l lo - romains ,mais i l s semblen t re la t i vement ra res ; on nepeut s 'em pêcher en tout cas, en les examinant,de songer au type bien connu de la Victoire quise pose au sol après son vol. Y-a-t-il eu conta-minat ion d'une iconographie par l 'autre ? C'estpossible,et l 'on a vu que cétai t déjà le cas pourde nombreuses représentat ions de Neptune,calquées sur cel les de.Jupiter. Minerve n'est-d'ai l leurs pas la seule dont certaines ima==.sont insnirées de cel les de laVictoire :a t \ ,J"- : -
lnv. n" t8 : Statuette en bronze repré-sent6nt un pe{sonnqge allongé.Musée de Metz"Cliché Service du Musée.
ELuna est également représentée ainsi .
O_ui est le petit personnage apparemmentjuvén ile, a I longé, tena nt u n attribut indéterm i-né dans ses bras ( lnv" n' tB) ? Nous n'avons pastrouvé d'exemples comparables : quelquespièces à la thématique dionysiaque sont tou-tefois proches de ce petit bronze.Représentation apparemment atypique donc ;mais l 'est-el le tant que cela ? N'est-ce pas là laposture de ces dieux fleuves qui ornent si fré-quemment les édif ices gréco-romains ?
Pénétration de l'imaginaire gréco-romain jusque dans les objets de la viequotidienne les plus modestes
Plus que les f igurations divines, les deuxpièces portant les n' 19 et zo de l'inventaireconstituent des témoignages de la diffusionde l ' imagerie gréco-romaine dans la vie detous les jours en Caule romaine. l l ne s'agit pasd'objets de luxe, mais simplement délémentsde décor bon marché ou d'amulettes ; leurvaleur art ist ique est minime. Ce serait pour-tant une erreur de les négliger, car i ls nousmontrent la pénétration, dans tout l 'Empire -on en retrouve d' identiques partout dans lemonde romain- , de l ' imaginai re gréco-romain ;on peut y voir la preuve de l'existenced'une véritable koinè, qui partage un mêmevoca b u la i re, de mêmes réfé rences esthétiq ues.O_u' i ls so ient modestes, sans doute de peude pr ix , fa i t justement tout leur in térêt ,c a r i l s o n t a i n s i p u p é n é t r e r m ê m e l e sca tégo r ies soc ia les l es mo ins favo r i sées .Ob je ts m ineu rs , ce son t des i ns t rumen tsma jeu rs de l a " roman isa t i on " .
ll en va ainsi de cette petite amulette (lnv.n' t9),f igurant un masque de théâtre : masquestragiques ou comiques, comédiens, bateleurs etacrobates se retrouvent sur la vaisselle de bron-ze,les lampes,la céramique ou les peintures par-
tout dans l'Occident romain.Le nain grotesque, aux moustaches déme-
surées et au ventre énorme, Silène sans doute,f iguré sur le pied d'un ustensile indéterminé,fait également partie de ces thèmes directe-ment importés et universellement répandus(lnv. n' 20) : on n'a trouvé des exemplairespresque exactement s imi la i res jusqu 'enOrient.
[art animalier en bronzede l'Époque rCImaine
Les bronzes animaliers constituent une Dannon négl igeable des bronzes de la Cauleromaine ; l'ensemble de Nasium ne fait pasexceotion.
Certains posent le problème de leur auto-nomie : s'agit- i l de pièces indépendantes ou defragments de figurines ? Prenons-le cas de cecoq, de très médiocre quali té ( lnv. n" zr) : i l luimanque les pattes et l'on ne peut être certain,dès lors, qu' i l ne f igurait pas au pied deMercure ou encore d'un Lare". Même dans lecas où l 'animal est f iguré sur un socle, on nepeut être sûr que sa représentation n'a paspour but de rappeler la divinité à laquelle i l esttradit ionnellement associé : le paon du Muséede Verdun (lnv. n' zz) évoque-t- i l Junon ? Lachouette perdue, du prétendu " laraire " (lnv.n' 5), Minerve ou Harpocrate qu'elle accom-pagne parfois ? Enfin i l est possible qu'un cer-tain nombre de ces animaux ait orné desustensiles divers, de la vaisselle, leur état frag-mentaire ne permettant que rarement d'enjuger : l 'art romain s'est plu à les mult ipl ier surce type de supports.
Le hasard, sans doute, a voulu que l 'onretrouve à Nasium des f igurations d'ani-maux qui sont , par a i l leurs, assez rares enCaule. On ne peut , a ins i , qu 'ê t re étonné par
243
lnv. n"jc (haut) : Statuette enb ron ze re présenta nt Mi ne rve.Çravure de F. Liénard,r88r.
lnv. n" rz {b*s} : Statuette enbronze fruste ssnservée auMusée des AntiquitësNçtionales.33 : Boârdman, 1995, p. i76, f ig. 139.34 : Voir L.l.M.C., r984-, I l , 1, nos 435, 885.35 : Pline, Nrf H6t., XXXIV 45.36 : S. Boucher, r976, p.116.37 : Le tyoe de la Mi .e .ve en cou.se es tconnu dès Iepoque archa ique en Crèce:voir L.l.M.C., 1984-, 11,1, p.1056, nos 53-64, etp.1o89, nos 2oo-2o7 Mais , la représenta-tion de Nasium,plus en marche qu'en course, névoque que lointainement ce prototy-pe gréco-romain.38 : Statuette d'argent du trésor de Mâconconservee au Br iL rsh MuseJ- ; vo i rWalters, r921, p. 9, n" 28.39 : Voir Lebel, 1962, p. 19-2o, n' r5.
{ ;
))l l ' .iai,, r{rf
744
lnv. n" e3 : Statuette en brcnzerep résenta nt u ne chauette.
Musée Barrois.
Cliché P.-A. Mûrtin.
40 : C.- F. Denis cite une chouette décou-verte en même temps que la statuette de
- Minerve perdue(Den is , r818,p .6) : i l pourrait s'agir de celle du Musée de Barle-
Duc ;j 'en doute toutefois puisque l 'auteurprécise que " (...) cet oiseau de Minerve estmoins b ien f in i que la s ta tue " , a lo rs que lachouette de Bar est de très bonne qualité.
4 i : S u p r a , n . 4 , 6 e t 9 .
l e n o m b r e d echouet tes debronze décou-vertes : t roisa u t o t a l ,
p e u t - ê t r equat re même4o, a lo rs que
d a n s u n r e c e n s e m e n trécent C. Le Cloirec n'en
c o m p t a b i l i s a i t q u e t r o i soour l 'ensemble de la Caule
{lnv. n'3 g, S et 23). Le succès rencontré parce thème s 'expl ique sans doute par les pos-sibi l i tés graphiques qu'offrait la f igurationdu p lumage de cet an imal , à l 'a ide d ' inc i -s ions, ce dont témoignent la chouet te duMusée de Bar- le-Duc et ce l le dess inée parF. Liéna rd, deux pièces très ornées. C'est sa nsdoute la même ra ison qui expl ique qu 'unbronzier a chois i de f igurer un paon ( lnv.n" 2z) , an imal dont les représentat ions sonttout auss i rares :comme pour les chouet tes,on retrouve en effet sur cette f iguration lasurcharge d ' inc is ions pour suggérer le p lu-mage f lamboyant. lours { lnv n" z4) enfin estauss i re la t ivement peu f réquent ; not rereprésentation n'est toutefois pas sans évo-
lnv. n" zz et 3 g : Statu*tes en branze figursnt un paonet une chouette à ailes déplayées.
Dessins extroifs du rr.tanuscrit du musée Earrais{1" Maxe-Werty, sd. x).
quer le p lus cé lèbre de ses congénères debronze, ce lu i qu i accompagne la déesseindigène Art io sur un petit groupe retrouvédans la rég ion de Berne.
À côté de ces représentations relative-ment inhabi tue l les, sont également pré-sents des animaux dont la oroduction s'estfaite en série, et dont on n'aura pas de mal àt rouver des exempla i res quasiment s imi-la i res dans presque tous les musées deFrance : c'est le cas.du coq déjà évoqué, deces deux appl iques f igurant des protomésde l ion et d 'a ig le ( lnv" n" z5-26) , sans doutede ce bouc, ce boeuf ou ce dauphin dont onne garde plus de traces,,.
Un cheval é ta i t auss i représenté ( lnv.n" 27), mais i l n'en reste qu'une patte, ce quine permet p lus de juger s ' i l se rat tachai t àune reorésentat ion iso lée ou à une statueéo uestre.
Souvent des æuvres d'artisansplus que d'artistes
On l 'a compr is , dans l 'ar t du bronze, lestéréotype est la loi, la production en sériesouvent la règle ; les æuvres de très grandequalité sont donc rares : objectivement, cen 'est le cas d 'aucune des f igurat ions deNasium. Prenons l 'exemole de la statuettede Jupi ter /Neptune ( lnv. n" rz) . C 'est uneæuvre natural iste : les règles de l 'anatomiesont connues, le canon est correct. Mais dèsque l 'on examine cette pièce de plus près,on se rend compte que de nombreux déta i lsde la musculature ont é té négl igés, que lamolesse des formes guette. C'est dans levisage, complètement inexpressif, que lesl imi tes de I 'ar t du bronzier sont les o lusv is ib les. La s tatuet te d 'Hercu le est demei l leure venue ; l 'ar t is te a même su rendreun peu de l a l ass i t ude du d ieu , épu isé pa rses travaux. l l n'empêche, l 'étude de détai l
lnv. n' zt : Coq en bronze. Muséede Verdun. Cliché P-A. Martin.
lnv. n' z4: Applique en bronzeflgurant un ours. Musée Barrois.Cliché P.-A. Martin.
révèle une anatomie p lus lourde que puis_sante, cel le du visage des traits trop sché_mat ioues.
Et pourtant ces deux æuvres sont oarmice qui se fa i t de mei l leur dans l 'ar t du bron_ze gal lo- romain ; dans de nombreux cas, onest très loin de cette quali té. eue dire duMercure du Musée Barrois ( lnv. n' r6), si cen'est qu' i l s 'agit plus d'une caricature qued'unrhommage de qual i té au d ieu favor idesCal lo-Romains ? On doi t ê t re t rès é lo igné del'art de Zénodore... Et où est la grâte deVénus, déesse de la beauté, où sont resformes abondantes, qui ont fait la renom-mée de sculpteurs comme prax i tè le , surcette médiocre statuette du Musée de Merz( lnv. n" 15) ?
a
[ensemble de bronzes de Nasium, appa-remment modeste, o f f re donc un boncondensé de ce qu'est I 'art du bronzefiguréen Caule. Son abord n 'est pas a isé, mais i l nefait f inalement que soulever des problèmesqui apparaissent dès que l 'on s' intéresse àce genre de matériel.
Au travers de son étude, on découvre unart du stéréotype, un art qui n'est pas decréat ion mais de var ia t ion sur des modèlesimportés. Comme le montre son étude stv-l ist ique, i l serait vain d'y chercher des chefs-d 'æuvre : mâ is peut-on at tend re a ut rechose de pièces qui ne sont, in f ine. que descopies ?
Ce n'est donc pas avec une vision d'histo-rien de l 'art, ou plus exactement d'historiendu " Crand Ar t " qu ' i l convient de les abor-del la déception ne pouvant qu'être grandeface à leur fréquente médiocrité, mais plu-tô t en tant que soc io logue de lAnt iqu i té : onpeut alors reconnaître en ces obiets, dont la
nature même a faci l i té la diffusion au seind 'un Iarge éventa i l de mi l ieux soc iaux, unformidable out i l de pénétrat ion de l , ima-ger ie g réco- romaine dans la soc ié tég a l l o - r o m a i n e , e t , a u - d e l à , d e sconcept ions e t de l ' imag ina i re du .monde méd i te r ra néen conq uéra n t .Bref un inst rument de la " romanisa-t ion ". Le peu de déformations, au moins ico-nographiques, qu 'ont subi ces thèmes, resuccès qu' i ls ont rencontré, montre bien ouecette pénétration ne s'est heurtée qu,à peude résistances.
l r uveNTAIRE DEs BRoNzEs
246, | . Fragment d'un bronze degrandes d imensions : doigt .Découvert à Naix en 't834 par C.-F Denis (Liénard, t88t. p. z6-27, Pl.XXVI, n" 5) ; conservé au Musée deVerdun (inv Az.rro, don Dumont de1869). Lg. : 36 mm; ép. : t3 mm.
Fonte creuse.
f . Fragment d 'un bronze degrandes d imensions : p ied.Découvert à Naix selon I ' inventairedu Musée de Bar le-Duc où i l estconservé (inv.877.tz.z4).H. : 50 m m ;l. : 65 mm : êp. : z4 mm. Fonte plei-
l i .o,.nrrrru d'une sandale, ayantappartenu à une f ig ,urat ion debronze d 'assez grandes d imen-sions, sans doute d'une soixantainede centimètres de haut. Le travail
de ce fragment est soigné ; on devi-ne une représentation de bonneq u a l ité.
B . Bronzes anthropomorphes etzoomorphes perdus, dessinés parLiénard, t88t. pl. XXVI et XXV|l.
t,0,. Vénurs. Statuette, haute de qua-
torze centimètres, représentantune divinité nue, portant un diadè-me. l l do i t s 'agi r de Vénus ; a com-parer pa( exemple avec Menzel,',227:,'u':;:" ":: :',:iiJ; 'i:in" 66. Une figurine proche est éga-lement conservée au Musée deVerdun. Elle fut découverte en 1845et acquise a lors par A. Dutresne ; onen perd ensuite la trace.
le . Victoire. Figurine, " superbe "
selon Ê Liénard, représentant uneVictoire ailée. Ce type, d'inspiration
sans doute hellénistique, est trèsf requent en Caule ( le musée d 'Épi -nal en conserve, par exemple, deuxexemplaires : voir Haudidier, 1973,p. zg de Sion-Vaudémont et 3z deCrand), et , au-delà, dans toutl 'Occident romain : vo i r notam-menl Schweiz, 1g;i, p.r39, f ig. 55(même mouvement de la main qui
retient un pan de la draperie) ouPannonie,tgSz, p.37 Découverte enr8r5. e l le . r t , .qr i r . a lors par C. -
F. Denis ; en r88r, F. Liénard la signa-
ff;ffi;Î:lîrdunoù nousne
lc . Minerve. Une représentationde Minerve, haute de vingt-trois àvingt-quatre centimètres, décou-u . r t " . n t 8 z t a u l i e u d i t l e s
I:';îffiJ"i#;: ï":i;fl; ..qui est relativement rare puisqu'elle est, dans l 'a rt du bronze commede la pierre, le plus souvent repré-sentée en majesté ; il existe toute-
:ï,,d;:'o::1,5:li'l' :i':Chalon-sur-Saône (voir S. Boucher,t976, fig. z4o-z4t). Ce type, rare,nous semble dériver de la figura-tion de la Victoire qui a contam.inel ' image de la déesse guerr ière.Cette statuette était accompagnéed 'une choue t te , éga lemen t enbronze, qui ne fut pas reproduitepar F. Liénard. lensemble est perdu.
to . Apollon ? le corps, acephale etmutilé à ses extrémités, d'une divi-nite masculine, aux cheveux longs,découvert en mai 1834 lors desfouil les de C. -F. Denis.La chevelure longue, avec deux
nat tes qui retombent sur les
248 li' ir$i:: i'i r!,j ; tlçi U:itn:l'l r-1';l r:l r :1..
Mème provenance que le précédent ;au Musée Historique Lorrain,n" inv. : XXlV. l . 37. H. : 18 mm ; l . :
50 mm :ep . : 25 mm. B ronze p le in :paL:ne légerement jaunâtre. i l s agi tvra isemblablement d 'un e lémentd 'app l i que . e t non d 'un
' au te l "
comme l 'a f f i rmai t A. B 'etagne.O_uatre p ieds en forme de g landsass r r ren l sa s tah i l i t é . Sa fo rmeevoque une sorte de socle a gra-d ins , ma is aucune f i gu r i ne néLa iLdest inée à le surmonLer.Des i rcrustat ions d 'arpent dessi -ncnt qrr r I ro iç .1Ês fares deS r in-ceaux sty l isés: à comparer a unsocle conservé au Musee de Vienne(France), dans Boucher. ry8 j, p.t44-
45,n'14o.
Pour les conditions de decouvefte,voir le n" 5 ; au Musée HistoriqueLo r râ in , n " i nv : XX IV I . 26 . H . :b O m m : | : 4 0 m m ; e p . : 2 5 m m .l-onte pleine ; patine noire, Lracesd'oxvdation.Appl ique représentant le busted'une divinité féminine, couronnéed'un diadème bouleté, placé dansun f leuron à sept peta les. Le t ra i te 'ment est t rès sommaire; i l do i ts'agir d'une pièce produite en série.l a c h r r c l o < - e n n l i n r r e < i e r c t r r n c
çont en ef fet t req corr rants enCaule ; i ls sont raremenl de qual -
té : voir par exemple Schnitzler,t 9g ; , p 8z -83 , n B5 e t 89 . Ro l l and ,1965,p. t63,n" 367 (peson de balan-ce), et surtout Lebel, 1962, p. 3o,n ' 4zdeMandeure (couronne identtque), I e /vlusee iorrarn en conseryed'a i l leurs p lus ieurs. nolamment le
n ' d ' inv. A.264 de provenanceinconnr;e cui f igure à aussi unei c e ç ç c c n r r r n n n é p A R r c t : o n p
reconna issa i l Hyg ie dans ce t te
peti te piece ; en real i te, fauLe d at
t r ibu ts ind iv idua l i ses , i l es t va in ,
dans la g rande ma1or i te des cas . de
chercher a reconna i t re dans ces
bus tes-app l iques une d iv in i te p re-
c tse .
' ' ' i l " ' t '
V o i r n ' 5 ; a u M u s e eHistor ioue Lorra in, n" inv. : XX|Vl . 39.H. : 74 rnm ; H. tête : t7 mm. l lmanque l a rna in gauche . l onLen l p i n p . n r t i n o n n i r e| - ' . ' ' ' . .Amour aile, coiffé en corymbe, lebras gauche tendu vers Iavant , lajambe et le bras droit en arrièrepour suggérer la col,rse. Le mouve-menl esï renou 0e lacon conventionnelle, les détails du visage et ducorps sont neglrges. Lette prece nemanque toutef o is pas de charme. IAmour en course est un desthemes favor is de lar t du pet i tbronze : voir par exemple les no"n-breux exempla i res du MuséeDenon de Chalon-sur-Saône(Boucher, r983, n 33-37 avecq ueiques variations toutefois drunepiece a I 'autre).
'li . I :.inl:irt- ir ïç;i i t iti., ;'*1-:-it.:e{,'i:l lt i:
Au Musée Ba r ro i s .Minerve, en buste ; cette appligueappart ient â une ser ie t rès repandue de pièces de si médiocre quali-té que r'on a parfois hésite entreune f igurat ion de Minerve ou deMars. t l les sont caracter isées par ledeveloppement exagere du Lrmlerdu casque : vo i r pa r exemp leSchnitzler, ry95. p 47, n' 21, ou
D ^ , , - t . ^ r r ^ h ^ t " a r r ^ + 1 , n " 5 5I L U L t , t y t ) , Y .
t
(Mars ?). l l faut également signalerun exemplaire très proche conserveau Musee lorra in de Nancy (n" inv :XXIV J55 ; inedi t )
ii! , :".:iir*:is 'iû iri.irîri,:, Cettefigurine provient de I 'oppidum deBovio l les (Mourot , 2oo1. p. 37a,l ip . z ïz \ : e l le est conservée au' ' o - - - t
Musee Barrois, n' inv. : 88t.4-7.t.
H . : {2 mr r ;1 . : 2 { r r tm ; ep . : 17 mn^.
Patine noire ; un peti t tenon, sousl ' r r n e r l e < n r t l e < : r r e n i- . - , - , p o u r r a Ïind iouer que la p ièce éLai t f ixee aun support de nature indétermlnee. Le Musee Barrois possède egalemenl une copie en p lât re de cebronze, offerte à son découvreur,L. Maxe-Werly. Guvre gauloise desI le-ler siècles av. ).-C. I Voir su pra.
. 5 e l o n I i 'ventaire du Musée Barrois, où elleest conservée (n"inv. : 877.t276,\cette figurine proviendrait de Nalxl l cor v ient toute lo is d 'èt 'eprudent : e l le a appartenu, avantce la , au cab ineL d 'an t i ques deF. Bellot-Herment, dont on a vu qu'lne contenait pas que des piecesant iques I ' r , . : : ' r ' , " ,1 . r . H. : 57 mm :l - . tê te : 12 mm ; l . : l / mm ; eo.8 mm. Pat ine no,re.Petite figurine tres fruste, represe'-tant un hom.ne nu, les bras ecaneslenant dans la main dro i te r - ,nesorte de boule, l l s'agit vraisembla-b lement d un 'o f f rant" , themcrepandu dans l a p roduc t i on c :bronzes ét rusco- i ta l iQue ; vor .nolamment I ' impor lante sér 'e o;p ieces de ce type du Cabinet deiMédai l les, Adam, r984. p. 1gg 2c_-
nos 3o9-328. La très médioçre qua
l
fiil
r1r
: i l peut tout aussi bien
Schni tz ler 1995, p. 39, n"
r , p l ' , "
ete découvert à Naix à une date taireinconnue (ms. de L Maxe-Werly cité parfa
îi
a
i
750 F. Liénard (fig. 3a) ? Dans le doute,
nous avons toutefois pre[ere I ' inte
grer a cet inventa i re. H. :102 mm.Venus pudique, de Lype CaPi to l in(voi r Boardman,ryq,p.8o, f ig . 99-ror) , surpr ise a la to i le t te et cher-
chanL , ma lad ro i t emen t a d i ss imu-'er son 5exe et sa poi i r ine. C'esL un
type extrêmement bien représentéen Cau le : vo i r pa ' exemp le l es
nombreux exemples de comparaison dans le Rëpertoire de Reinach,
t8g7-tg3o, par exemple, lll, p. to9
n' j de Cologne, n" 9 de Troyes, lV
p.zt6. r " z de Ceneve, n" 3 de LYon,
p.27.n" 4.le style de cette pièce estmediocre: les mains sont d isoro-portionnées, le corps sans formes,le v isage inexoressi I
'hl,' f'|l irl:li lq' i ' i i l l;i;ll i ll it*lr:r..:i1..
In t rée dans les col lect ions du
Musee de Bar- e Duc en t877,
comme le reste de la collectionF. Bel lo t -Herment ; l ' inventa i reindique Nasium comme provenan-ce : i l n'y a guère de raison d'en dou-
ter cette fois, puisque divers écrits
conservent la trace de cette décou-
vefte en r 8zo (F. Bellot-Herment etL. Maxe-Werly cités par Mourot,zoot, p. 4]3).H. : 72 mm ; H. de la têtes a n s l e s a l l e t t e s : 1 7 m m ; l . :
45 mm : ep. : 17 mm. PaÏ lne nol re,fonte pleine.Mercure nu, reconnaissable aux
ailetLes dans ses cheveux et à labourse qu'i l tend de la main droite.Ce type a connu un formidable suc-ces en Caule : vo i r Boucher, 1976.p. ro4-to5,fig. i59-r68. En Lorraine, i l
est représenté dans presque toutes
les collections :au Musée iorrain de
Nancy, deux exempla i res (un deScarponne, n ' inv. : C.385, et un de
pfovenance inconnue, l ( . 3r ) ; au
Musée de Metz, trois exemPlaires(deux de provenance connue, leHérapel et Metz). Le bronze perdudessine par l . I ienard ( f ig . 3 heures) ,pourra i t se rat tacher au même
type.
' i I " i:r:,r l,t:rtt::: ' l , ait:: .:. i i ' ] i l l ir ' i :*,: ' ; ' . :: ' i ir:
. : i i . i l i ] : r : : i : r ' i : - : . : ; ; l l l i i : : ; . r ; : : ; : ; i ' i l l :a i :
Musee de Metz (n' inv. :z 8o5) , ancienne col lect ionDufresne. H. : 84 mm. l l s'agit d'un
bras gauche, drapé dans une chla-
myde ; i l pourra,t s'agir des vestiges
d'une figuraLion de Mercure : c'est
en tout cas l 'hypothèse émise, pour
un_fragment identique, dans R.A.E.,19bl . p .23o.Le type de Mercure à la chlamydelongue, posée a ins i sur l 'épaule
gauche, est lréquent ; on en Possè-de d 'a i l l eu rs un be l exemp la i remeusien, provenant de Pont-sur-Meuse, conservé au Musée Barrois.Crand er a egalement donne un :vo i . Ha ud id ier , : .973, p. 15.
1!: f l " ,115 1j l1: i l1 ;51,* : :ur l : ,= StatUette
découverte par A. Dufresne, enmè.ne temps que la f 'gur ine delion peroue (fig. l i) : à la différencede cette oernière, on la reLrouvedans les collections du Musée de
Metz (n" inv. : z 78g, 'nais indiquee
de " provenance inconnue ". La comparaison avec la gravure deF. Liénard (Llénard, r88r, pl. XXV|l,n' 8), ne laisse toutefois subsisteraucun doute sur son origine. H. :
40 mm ; lg . :52 mm.l l s 'agi t d un pet i t oersonnage au
corps nu apparemment juvénile,
allongé et tenant un long attribut
diff ici le à identif ier dans son bras
gauche. la p iece. d ' ;n s ty le somme
touLe assez maladroi t , est en t resmauvais éta[ , ce qui re permel Pasde decider de la nature exacte delobjet tenu. On a proposé Loutefois
d 'y reconnaî t re la massue
o Hercule, mais le d ieu n 'est jamais
f i g u r é a i n s i e n C a u l e ; v o i '
Moi t r ieux, zooz. On a voulu egale-
menL y reconnaÎ t re egalementBacchus ivre, [enant le Lhyrse, ma;s
là encore on se heurte à l 'absence
de representat ions connues de ce
type. Notons toutefois que les rares
f igur ines qui présentent a ins i ur
personnage a l longe f igurent par-
fo is des pÀrronnrg. , du f h iase d io-nysiaque; voi r tebel , 96z, P. 29.n" 39 (s i iene) , et Boucneç r97r , p.84,
n ' 39 (Bacchus ou Amour selon
l 'auteur) . l l semblera iL donc b ien
que ce soi t dans ce[e d i rect ionqu i l convienne de chercher d 'au-tant p lus qu ' i l est possib le que ledieu a i t e té couronné de pamPres,
ce qui expl iquera; t son aPParenLe'hydrocéphalie ".
" " " :
. Decouver le a Naix enr838, elle est conservée au Muséede Mefz (n" inv. : z37t) .H. : 8 t mm.Pel i t pendent i f orné d 'un masquer ie theâfre Ce nel i t oh iet se rat
lache a toute une sér ie ce Pieces.d e m o b i l i e r n o t a m m e n t , q u i
empruntent leur rhème au reper 'Loi re du Lheàtre : vo i r t andes (d i r . ) ,
t 98 9, p. t37 -t 43, f ig. t 6 - 27,
. ; " " i i . ,
*r gi*llrq*c. Au Musée de Verd un,
don Maujean de û72; l ' inventaireindique qu'i l provient de Nasium.
i
I
{il
254
Fig. t : Cravure d'une partie desscu I ptu res découvertes pa rC.-F. Denis en ût8. Ms 6j8,
Médiathèq ue de Ba r- le-D uc.
r I E . Espérand ieu , R. Lant ie r ,19o7 j965.2 : F . L iénard ,1881, P .1o .
3 : E. Espérandieu, R. La ntier, 1907 1965, Vl,n" 4655.
4 | E . Espérand ieu , R. Lant ie r , l9o7 1965, lX ,n '7258 ; on ne sa i t ce qu 'e l le es t devenue
ensu l Ïe
5 | E . Espérând ieu , R. Lant ie r , r9o7r965,V l ,n '4662.
6 : on trouvera une liste comPlète de cesdisparit ions dans F Mourot, 2ool, p.413-
415.
La référence en mat ière de sculpturegal lo- romaine demeure le " Crand oeuvre "
d ' É m i l e E s p é r a n d i e u , p o u r s u i v i P a rRaymond Lantier : le Recueil des bas-reliefs,statues et bustes de Ia Caule romaine, enquinze vo lumes, publ ié à par t i r de t9o7. Cetimmense t ravai l , qu i recense p lus de neufmi l le sculptures ret rouvées sur le ter r i to i rede la Caule, n 'a pas d 'équiva lent , i l faut lerappeler , dans les aut res pays européens quiont fait part ie, dans lAntiquité, de l ' impe-rium romanum.Ces dernières années toute-fois, le besoin d'une réfection de ce formi-dable out i l de recherche se fa isa i t de p lus enplus pressant :en ef fe t , depuis r965, date dela parut ion du dern ier vo lume, les décoLr-ver tes ont é té nombreuses, contr ibuanta ins i à renouveler not re v is ion de l 'ar t ga l lo-romain. C 'est au jourd 'hu i chose fa i te : lecha nt ier est désormais en cou rs , sous lepatronage de lAcadémie des Inscr ip t ions etBelles-Lettres et la direction de M. HenriLavagne , D i rec teu r d 'é tudes à l 'Éco lePrat ique des Hautes Études. Les nouveauxvolumes regrouperont l 'ensemble du maté-r ie l découver t depuis quarante ans, souventpubl ié dans des revues ou des monogra-phies diff ici les à rassembler, et permettrontde réétudier les sculptures qui avaient é tein tégrées au Recuei l . Inut i le de préc iser qu ' i ls 'ag i t là d 'un t ravai l de t rès longue hale ine,o u i n e s a u r a i t a b o u t i r e n s e u l e m e n tq uelq ues a n nées. . .
Les t ravaux pré l iminai res ont débuté dèsl 'an passé pour la " c i té ' des Leuques, e t lessculptures de Nasium ont fait l 'objet despremières invest igat ions. l l ne saura i t ê t reouest ion ic i de les étudier toutes : not repropos sera s implement de présenter unétat de l 'avancement de la recherche ; unerecherche qui a appor té son lo t habi tue l dedécept ions, dues essent ie l lement à l 'am-
pleur des per tes, d ' incer t i tudes, mais auss id'a gréa bles su rp r ises, avec la (re)découve rtede o lus ieurs oeuvres inédi tes.
Des oÉcrPT toNS. . .
C ' e s t b i e n l e p r e m i e r s e n t i m e n t q u e I ' o n
ressent lo rsque l 'on s ' in té resse à la scu lp -
t u r e g a l l o - r o m a i n e d e N a s i u m : i l y a e nef fe t un déca lage cons idérab le en t re lesnombreuses découver tes , s igna lées dansla l i t té ra tu re anc ienne, e t le fa ib le nombrede o ièces conservé dans les co l lec t ions desm u s é e s m e u s i e n s .
l l y a d e s d i s p a r i t i o n s a n c i e n n e s , q u i
s 'exp l iquent a isément par le peu d ' in té rê tq u e p o r t a i e n t l e s h a b i t a n t s d e N a i x à c e sves t iges du passé : on imag ine en e f fe ts a n s p e i n e q u ' u n n o m b r e c o n s i d é r a b l e d es c u l p t u r e s , r e n c o n t r é a u h a s a r d d e s
l a b o u r s , a f i n i r e m p l o y é d a n s l e s m a i s o n s
d u v i l l a g e . l l y a a u s s i l e v a n d a l i s m e q u e
s u s c i t a i e n t c e s r e p r é s e n t a t i o n s , i n q u i e -ta n tes ca r d 'u n a u t re tem ps : Fé l i x L iéna rdn o u s r a p p o r t e a i n s i q u e l ' o n d é c o u v r i t , a -X V l l l " s i è c l e , u n e " s t a t u e c o l o s s a l e d em a r b r e b l a n c " , e t q u ' e l l e f u t i m m é d i a t e -m e n t m i s e e n p i è c e s p a r l e s h a b i t a n t s d uv i l lage ' ; la mosa ' ique d i te
" de l 'en lève-m e n t d ' E u r o p e
" c o n n a Î t r a , a u s i è c l e s u i -v a n t , l e m ê m e s o r t . E t p u i s i l y a d e s d i s p a -r i t i o n s m o i n s c o m p r é h e n s i b l e s , p u i s -ou 'e l les concernent des re l ie fs , des rondes-bosses , conservés au début du XX" s ièc lee n c o r e d a n s l e s m u s é e s d u d é p a r t e m e n t . . .
D a n s l e m e i l l e u r d e s c a s , o n p o s s è d e u nc l i c h é d e c e s s c u l p t u r e s d i s p a r u e s : i l e n v aa i n s i p o u r u n r e l i e f r e p r é s e n t a n t u n p e r -s o n n a g e e n a r m u r e , c a s q u é , p e u t - ê t r eM a r s , q u i é t a i t a u M u s é e d e l a P r i n c e r i e àVerdun ' ; de même pour ce t te f igura t iond ' u n e d i v i n i t é m a s c u l i n e a c é p h a l e , l e b a sd u c o r p s d r a p ê , d a n s l a q u e l l e É m i l e ii
-II
Espérand ieu reconna issa i t un " Cén ie " e rqu ' i l nous d i t conse rvée pa r l ' abbéDepoisson de Naixu. La p lupar t du tempstoutefo is , on doi t se contenter de dess ins,p lus ou moins f iab les ; c 'est tout ce qu ' i lreste par exemple de la p lupar t des décou-ver tes réal isées lors des fou i l les de Claude-François Denis , en 1818 ( f ig . r ) : des p ier resf igurées dans ces p lanches, nous n 'avonsret rouvé, au Musée de Verdun, que le f rag-ment in fér ieur d 'une é légante représenta-t ion de Fortuna assise {f ig. z) ' .
Ma is p lus souven t enco re , l es scu lp tu resde Nasium ne sont p lus connues que parq u e l q u e s l i g n e s , d e s d e s c r i p t i o n s t r o pbrèves, t rop impréc ises :à quoi ressembla i tpar exemple cet te tê te d 'Hercule qu 'avai tacquise C - F. Denis en r8og ? Cet te s ta-t u e t t e d ' E s c u l a p e , u n s e r p e n t e n r o u l éautour du bras, haute de v ingt -c inq cent i -mètres ? Cet te tê te de p ier re, d 'une d iv in i -t é " ( )qu i pou r ra i t ê t re Cybè le " , don t l eMusée Ba r ro i s se rend i t acq ué reu r ent8470 ?
Difficile, on le voit, de se faire une idée préci-se sur la sculpture découverte dans cetteagglomération, une forme d'art dont on saitqu'el le est un bon indice de la pénétration de la" romanité " dans les communautés provin-ciales ; dif f ici le aussi de se faire une idée iustesur les cultes, d'autant plus que la dispaii t ionde ces sculptures n'est guère compensée par letrop faible nombre d'inscriptions retrouvé. Etla tâche est rendue encore plus compliquéepar les incert i tudes qui pèsent quant à lbrigi-ne de plusieurs pierres conservées dans lesmusées meusiens: cest le cas notammentpour une bel le tê te mascul ine du MuséeBarrois.. . .DES I NCERTITU DES AU55 I . . .Urue rÊre scuLprÉE D' r t r tsptRaloN HEL-L E N T S T t q U E A U M U S E E B A R R O T S
Cette magnif ique tête (f ig.Z-+), en rondebosse, mesure vingt et un centimètres etdemi de haut , qu inze et demi depuis lementon jusqu 'au sommet du crâne ;e l le estépaisse, au maximum, de se ize cent imètreset large de dix-neuf. Son état de conserva-t ion est sat is fa isant : on note s implementqu 'une par t ie du nez a d isparu et que depetits éclats ont endommagé la lèvre infé-r i eu re a ins ique que lques mèches de l a che -velure. Le travail est très soigné, comme entémoigne la surface de la pierre, intégrale-ment égr isée. E l le a pu appar teni r à unbuste, comme à une représentat ion de l ' in-tégra l i té de la d iv in i té : on ne peut malheu-reusement p lus en juger puisqu 'e l le a étésciée à la base du cou. l l est à noter toutefoisque l 'ar r ière est négl igé, les mèches de lachevelure étant à peine modelées à cerendro i t , ce qui ind ique que cet te sculptureétait destinée à être vue de face.
l l s 'ag i t d 'un v isage juvéni le , aux jouesple ines, constru i t à l 'a ide d 'un ovale presqueparfait; la bouche entrouverte, le regardvers le haut, confèrenr aupersonnage un a i r ex ta -t i que . La bouche , don tseule la lèvre inférieure estmodelée, est profondé-m e n t c r e u s é e ; à l ' i n t é -rieur, une série de petitesdépress ions, réa l isées sansdoute à l 'a ide d 'une gouge,comme d 'a i l l eu rs resnar ines, ind ique la dent i -t ion. Le nez, dont i l ne restepas grand chose, est droit,f in ; ses arêtes se prolon-gen t dans l es a rcadessourc i l ières, qu i semblentlégèrement f roncées. Lapaup iè re supér ieu re , t aseu le qu i so i t i nd iquée , es t
Jrnru-NoËrCASTORIO
F!9. a : Partie i*prieure d"unestatue de Torlunu. Cal&ire ouli-thique.Dénuverte C.-f. Denis, t8t8.J\4usée de Verdus:.t!iclté P.-A. Martin.
7 | l l n 'es t pas imposs ib e , comme nous L 'asuggéré Yves Crandiean, que l ' ir is ait éte
pe i ' t çJ t la lenr t le 'a ns i fo r -e"8 : Notamment J.J. HalÏ,1957,p.94 99.
9 : LJ. Hatt, 1957 Pl. X.ro : E . Espérand ieu , R. Lant ie r , l907 r966,V | ,
n'4902 ; conservée au MuséeDépartemental des Vosges à Épinal.
i l : Une autre tête, conservée au MuséeDépartemental des Vosges d'Epinal, est
ega lement d u re , oncept ton o oche : vo t tE . Espérand leu , R. LanT ie \9o l 1966,V ,
n" 4842. E . Espérand ieu ne conna issa i t Passa provenance ;1a proximité de style, et surtou t les d imens ions s t r i c tement ident iques
à celles de la tête de 6rand -toutes deuxont z3 cm de haut , ne permet ten t e les pas
d ' imag iner une or ig ine ident ique ?r2 : F. Bellot Herment cité par F. Mourot,
2ao1, p. 41413 : P . B i l o re r . r97o. p . 2ga )gô . f ig . 25 e l
B . Humber t ,1983, P . 52-53 .r4 : Pour compara ison, vo i r no tamment
Stewart, 1993, f ig. l lz (buste dAlexandreconservé à New York), ainsi que les nombreux exemples reprodu i ts par Schre iber ,
r903, p l .V e t X l sur tou t .r5 : Vo i r Charbonneaux, Mar t in , V i l la rd , 197o,
P.297. " 8 . )22 .
u n e, sor te de
l a n g u e t -' te , en
f o r t e
, i sa i l l i e , q u i
! . p r o j e t t e50n omDres u r l ' i r i s ; l e
t ra i tement dec e d é t a i l d e
C S I
d ' a i l l e u r sr e m a r q u a b l e , c a r
re la t i vemen t i nhab i -t u e l d a n s l a s c u l p t u r e
r é g i o n a l e : a l o r s q u ' i l e s t g é n é r a l e -m e n t n é g l i g é , o u i n d i q u é à l ' a i d e d e l ' i n c i -s ion , p lus ra rement du t répan, l ' a r t i s te l ' a i c iap lan i , pour mieux capter la lumière ' � . Lefront, assez bas, est, comme les joues et lementon, so igneusement mode lé . Les sur -faces p lanes de ce t harmon ieux v isage s 'op-posent aux mèches, b ien fou i l lées e t d 'undess in re la t i vement complexe, de la cheve-l u r e m i - l o n g u e q u i l ' a u r é o l e : s u r l e s c Ô t é s ,e l les fo rment une sér ie de longues ondu la-t ion s ; su r le dess us d u c râ ne , e l les sont p lu scourtes, mais se détachent toutefois avecv igueur du f ron t .
Paradoxa lement , ce sont les indén iab lesqua l i tés p las t iques de ce t te be l le tê te qu iexp l iquent qu 'e l le a é té nég l igée jusqu 'àorésent : on l 'ava i t en e f fe t écar tée desv i t r ines du Musée Bar ro is car , t rop
" g réco-romaine
" , on la cons idéra i t comme douteu-se I Certes, son travai l contraste avec celuiqu i carac tér ise hab i tue l lement la p roduc-t ion Iap ida i re de la rég ion ; i l n 'en demeurepas moins qu ' i l s 'ag i t b ien d 'une scu lp tu red 'époque romaine : la p lén i tude des fo rmes,l a m a î t r i s e d e s c o n t r a s t e s d e l u m i è r e ,
d 'a i l l eu rs reche rchés pa r l e scu lp teu r , l ' ex -press ion proche de l 'extase, témoignenten fa i t à merve i l l e de l ' i n f l uence de l as c u l p t u r e h e l l é n i s t i q u e s u r l ' a r t g a l l o -roma in , i n f l uence que JeanJacques Ha t t ,n o t a m m e n t , a b i e n m i s e n é v i d e n c e o .Dans tou t l e no rd -es t de l a Cau le , on enr e t r o u v e d ' a i l l e u r s d e s t é m o i g n a g e s :p a r m i l e s p l u s r e m a r q u a b l e s , l e s s c u l p -tu res d u tem p le de Mon tma r t re , P rèsdAva l l on dans l 'Yonne . On pou r ra a ins icomDare r à l 'æuv re du Musée Bar ro i s unetê te ba rbue qu i en p rov ien t , ce r tes , p lusempre in te de pa thos , p lus tou rmen téeq u 'ex ta t i q ue , b ref p l u s" p e r g a m é n i e n n e " , m a i s q u i n ' e n d e m e u -r e p a s m o i n s d ' u n e i n s p i r a t i o n t r è sprochee .
Uru arri lrn ,rtNÉRA^lr oA,vsIA PARTI6 OCCIAENTALE
DË LA " c l rË " 0r5 l ruquËs ?D a n s l a r é g i o n , c ' e s t v e r s C r a n d q u ' i l
f a u t s e t o u r n e r p o u r t r o u v e r d e s æ u v r e sc o m p a r a b l e s ; u n e t ê t e m a s c u l i n e r e t r o u -v é e d a n s l a " b o u r g a d e - s a n c t u a i r e
" v o s -g i e n n e e s t d ' u n t h è m e e t d ' u n e s P r i ts t r i c t e m e n t s e m b l a b l e s ' " . C e q u i e s t p l u st r o u b l a n t , c ' e s t q u e l ' o n r e t r o u v e d e sd é t a i l s , d a n s l e t r a i t e m e n t , a b s o l u m e n ti d e n t i q u e s : l ' i r i s a p l a n i , l a p a u p i è r e s u p é -r i e u r e i n d i o u é e à l ' a i d e d ' u n e s o r t e d el a n g u e t t e , l a n é g l i g e n c e d e s p a u p i è r e si n f é r i e u r e s e t d e l a l è v r e s u p é r i e u r e . An o t r e s e n s , i l n e f a i t a u c u n d o u t e q u e c e sd e u x t ê t e s o n t é t é r é a l i s é e s , s i c e n ' e s t p a ru n m ê m e s c u l p t e u r , d u m o i n s P a r u nm ê m e a t e l i e r " .
L a s c u l p t u r e d u M u s é e B a r r o i s p r o v i e n -d r a i t - e l l e . a l o r s , d e C r a n d ? [ i n v e n t a i r e d .m u s é e n e n o u s e s t m a l h e u r e u s e m e n td ' a u c u n s e c o u r s p u i s q u ' i l l ' i g n o r e t o t a l e -
Fig.3 et 4 :Tëte Nulptëe représentantApol I an- Hé | ios. Cç lta i re ool ith iq ue "
ll" s. apr. J.-C. Dëcouverte XlX s.Musée Barrois. Clicl'té P-A. Martin.
ment ! On sa i t t ou te fo i s que du ma té r ie ldécouve r t dans ce t te agg loméra t i on -no tamment une g rande insc r i p t i on funé -raire et un graff i te représentant un poisson-a été déposé au Musée Barro is à la f in duXlX" s ièc le et au début du su ivant : mais ,dans la l i t térature ancienne, i l n 'est nu l lepar t quest ion d 'une p ièce de ce type, qu ia u ra i t d û, de pa r ses gra ndes q ua l i tés, att i-rer l 'attention. l l est en revanche fait men-tion de la découverte, au XlX" siècle, d'unetête dApollon et l 'on verra plus bas que c'estbien cette divinité qui est représentée ici, àNasium, tête qui fut acquise par FrançoisBel lo t -Herme f l t " ; or on sa i t qu 'une bonnepar t ie de la co l lect ion de cet " ant iquai re " are jo in t le Musée Barro is .
Alors, Crand ou Nasium ? En l 'état actuerde la documentat ion, i l est b ien d i f f ic i le dese prononcer ; l 'é tude pétrographique, qu i adémontré que la tê te éta i t scu lptée dans leca l ca i re oo l i t h ique l oca l , d i t " deSavonnières ", n'apporte pas d'élément déci-s i f pu isque cet te p ier re est u t i l isée dans lesdeux sites.l l n'y aurait toutefois r ien d'éton-nant à ce que l 'on retrouve, dans l 'agglomé-rat ion meusienne, les t races de l 'act iv i téd 'un ate l ier ayant également t ravai l lé dansla " bou rgade-sanc tua i re " dApo l l onCrannus: les deux s i tes ne sont , après tout ,séparés que par deux journées de marche.Et l 'on peut même, peut-être, al ler encoreau-delà en imaginant un ate l ier i t inérant ,ayant æuvré aux conf ins des actuels dépar-tements de la Meuse et des Vosges : eneffet, la proximité, styl ist ique comme icono-graphique, qui existe entre ces deux têtes etcer ta ines sculptures provenant du sanctuai -re de Sorcy-Saint -Mart in est t roublantes.Mais i l ne s 'ag i t là , répétons- le , que d 'unehypothèse de travail , que les recherches àvenir permettront peut-être de confirmer.
À ta BrcutBcueDE LA SOURCE D, INSPIRATION
Qui est la divini té représentée ? Pour latê te de Crand, Émi le Espérand ieu suggéra i t ,t im idement , " ( . . . ) peut -ê t re Apo l lon " , ma iss a n s a v a n c e r d e c o m o a r a i s o n s c o n v a i n -cantes. Cel le du Musée Barrois offre oeut-ê t re un é lément d ' iden t i f i ca t ion p lus tan-g ib le :à l ' a r r iè re de la tê te , on vo i t en e f fe tcinq cavi tés dest inées à recevoir un élémentrapporté. Quel le étai t sa nature exacte ? Onsonge d 'emblée à un d iadème, e t on no terad 'a i l leurs que la scu lp tu re a é té conçue pourle mettre en évidence, puisque les mèchesdu dessus de la tête contrastent, par leurmanque de volume, avec le reste de la coi f-fu re , p lus ample : i l s 'ag issa i t v ra isemblab le -ment de ne pas d iss imu leç der r iè re la p ie r re ,ce t é lément de méta l o réc ieux . Ma is onpeut , peut -ê t re , a l le r p lus lo in dans l ' i den t i -f icat ion de cet at tr ibut, malgré sa dispari-t ion, et cela grâce à l 'examen de ces cavi tés :e l les sont en e f fe t é tonnamment la rges(p lus d 'un cent imèt re e t demi )e t p ro fondes(près de trois cent imètres). Ne peut-on alorsimag iner qu 'e l les é ta ien t des t inées à main-ten i r en p lace les p ics , sans doute en bronzed o r é , q u i a u r é o l e n t l e v i s a g e d A p o l l o n -Hé l ios p lu tô t qu 'à recevo i r une s imp le cou-ron ne ?
f iden t i f i ca t ion du modè le qu i a insp i ré latê te du Musée Bar ro is permet à coup sûr detransformer cette hypothèse en cert i tude :en effet , et le paral lèle n'aura échappé àaucun amateur de l 'a r t an t ique, e l le para î tc la i rement dér iver des reorésenta t ions he l -lén is t iques du d ieu du So le i l , f iguré sous lest ra i ts dA lexandre le Crand ' , . E t on songen o t a m m e n t à u n e t ê t e c o n s e r v é e a uM u s é e a r c h é o l o g i q u e d e R h o d e s ' 5 , c o p i ep o s s i b l e d u f a m e u x " ( . . . ) c o l o s s e d u 5 o l e l ,( . . . ) , æuvre de Charès de L indos , é lève de
258
r6 : Notamment une s tè le de L l l lebonne,conservée à Rouen, certes beaucoup plus
r rus te mdi< o , le d ieu e ' . i i g - re rad ie j ve-n i le , la cheve lu re mi - longue comme a Na ix ;
voir Espérandieu, LanTier,l9ol 1966, V,n ' 3086. on pour ra auss l consu l te r 'a r t i c le
du L . l .M.C. sur ' i conograph ie de So l , Le t ta ,p .592-625. parn i es s .u p 'u 'esqL i repro
duit, on voit que les rayons peuvent être,soit intégrés à u ne cou ronne, soit ja i l l i r
d l rec tement de la tê te du d ieu .
Lysippe " (P l ine lAncien, His t . Nat . , XXXIV
4 t ) , I ' une des sep t merve i l l es du monde .D ' a i l l e u r s o n p o s s è d e e n C a u l e p l u s i e u r srep résen ta t i ons du même d ieu , ce r tesm o i n s v i r t u o s e s , m a i s d o n t q u e l q u e sdé ta i l s , no tamment dans l a cheve lu re ,démon t ren t qu 'e l l es pu i sen t à l a mêmesource d ' i nsp i ra t i on ' r . Apo l l on -Hé l i os -Alexandre donc ; reste à déterminer lequeldes membres de cet te " t r iade " un habi tantdu nord-est de la Caule, v ivant b ien lo in desl ieux où ont é té é laborés ces modèles ico-nog raph iques , reconna issa i t dans ce t tetête : ce la est cer ta inement dest iné à resterun mystère pour nous. . .
/rupr usrurg #fr d"rÉe{tû{JggT ËJ-'trGldÛT##Jg
Es t - i l poss ib le de p réc i se r l a da te de l a
réa l isat ion de cet te æuvre ? Comme tou-jou rs , c ' es t une ques t i on éP ineuse .Cénéra lement , on s 'accorde toutefo is àcons idé re r que l es i n f l uences he l l én iquessont sur tout sensib les dans la sculpturega l l o - roma ine du l l " s i èc le ;a l l e r en deçà decet te large fourchet te chronologique, e tce la à l 'a ide de la seule étude sty l is t ique,sera i t témérai re.
Doi t -on imaginer qu ' i l s 'ag i t là de l 'æuvred 'un ate l ier d 'or ig ine ét rangère, comme onl 'a souvent écr i t à propos des réal isat ions leso lus " he l l én i s t i cues " re t rouvées enCaule ? Pas nécessai rement ; on peut toutauss i b ien penser à des ate l iers locaux, for -més à la manière gréco-romaine et ayantpa r fa i t emen t i n tég rés ses p r i nc ipes .D'a i l leurs, s i les tê tes de Crand, de Bar- le-Duc et de Sorcy sont , comme nous avonscherché à Ie démontrer , d 'un t rès beau sty le ,i l n 'en demeure pas moins qu 'e l les sont éga-lement empreintes d 'une légère lourdeur ,d 'une express iv i té un peu convent ionnel le ;
les grands modèles qui les ont inspi réessemblent dé jà " prov inc ia l isés ' .
{*
La tête du Musée Barrois est donc peut-êtreun témoignage de l 'existence d'un atel ier i tr-nérant, dont on peut reconnaÎtre la main dansla sculpture de plusieurs sites antiques, toussitués aux confins des actuels départementsde la Meuse et des Vosges, dans la port ionoccidentale de la " cité " des Leuques. Lesmodèles d' inspiration de cet atel ier sont àchercher dans les créations de l 'époque hellé-nist ique, ce qui pourrait indiquer qu' i l a æuvrédans le courant du l l" siècle apr ).- C. On peutespérer que les recherches à venir permet-tront, en confrontant notamment les décou-vertes que nous avons présentées ici auxautres sculptures retrouvées dans la région,d'en apprendre davantage sur cet atel iel mais,quels que soient les résultats de ces investiga-t ions futures, on peut déjà écrire que l 'on a iciune excellente i l lustration de la pénétration enCaule de l ' imager ie et des modèles hel lé-n rq ues.
. . . MArS ÉCAlrnnrrurD ' H E U R E U s E s D É c o u v E R T E S !
For t heureusement , tou tes les scu lp tu resant ioues conservées dans les musées meu-s iens ne posent pas de prob lèmes de prove-n a n c e a u s s i a r d u s à r é s o u d r e : l a t ê t e d efemme en ronde bosse ( f ig . 5 ) , inéd i te , quenous présentons ic i , provient en effet , sansaucun doute cette fois, de Nasium. El le a étédécouver te dans le cana l , par un éc lus ie r , àune da te p réc ise indéterminée, ma is dans laseconde moi t ié du XX" s ièc le semble- t - i l ; cedern ie r en f i t don à une hab i tan te de Na ix ,avant de passer , en Egg, aux enchères (e l le
serva i t auparavant d 'épouvanta i l dans un
Fig.5 :Tête sculptée représentant unefemme.
Calcaire oalithique.' Découverte XtK s.
Musée Sarrais. (liché P.-A. Martin.
lardin l) et d'être alors achetée par la vi l lede Bar- le-Duc pour la somme d 'env i ron c inqmi l le f rancs.
Elle est haute de trente centimètres à oeuprès, de vingt-trois depuis le menton jusqu'ausommet du crâne ; son épaisseur maximaleatteint vingt et un centimètres, sa largeur;vingt. D'un travail bien moins virtuose que latête d'Hélios, el le est également moins bienconservée : le nez a complètement disparu,lestra its sont usés ; des éclats et des griffu res pa r-sèment presque toute la surface. Là aussi, latête a été sciée au niveau du cou, ce qui ne per-met pas de déterminer la nature originelle dusupport : les proportions toutefois semblentplutôt correspondre à une statue en pied qu'àun simple buste ; le fait que la tête sembleavoir été penchée vers l'avant pourrait suggé-rer une représentation grandeur nature enmouvement. ll s'agit, comme pour toutes lessculptures de Nasium, de pierre " deSavonnières "
; el le présente aujourd'hui unepatine légèrement jaunâtre. [ensemble estassez soigneusement égrisé.
fcl te fÂfe nlzrâa à l 'eXtfémité d'Un lOnst t t L L u U t t t v t 1 6
cou, est également construite sur un ovaleparfait. Le modelé est assez brutal : la bouchen'est qu'une fente, dont seule la lèvre inferieu-re est indiquée ; les si l lons naso-labiaux sontassez sommairement suggérés par de légèresdépressions. Le modelé laisse même parfois laplace à l ' incision, comme pour le pourtour desyeux en amande. Le front est légèrement bos-selé et recouvert par de longues mèches, sépa-rées par une raie médiane ; ces mèches sontensuite t irées vers la nuque, recouvrant ainsiles orei l les dont seul le lobe est visible, puisremontées vers le dessus du crâne où el les for-ment un gros chignon. Cette masse de che-veux n'est animée que par de profondes rai-n u res, légèrement ond u lées.
Les formes sont également ici d' inspiration
classique, mais le traitement est beaucoupplus sommaire que celui de la tête d'Hélios : rabrutal i té du modelé, la négligence de certainsdétails, comme les paupières, le recours à l'in-cision en sont l'illustration. [intérêt de cettesculpture réside f inalement surtout dans refait qu'elle se prête à une datation relative-ment fine, puisque la coiffure renvoie à desmodèles impériaux : c'est relativement raredans la région, où on a souvent préféré, auxarrangements complexes qu'arboraient lesimpératrices et les princesses, des coiffuresplus fonctionnelles, souvent indatables. Legros chignon sur le dessus du crâne est eneffet caractéristique de la mode en vogue sousles premiers Antonins'7; on peut donc propo-ser du décalage entre Rome et les provinces,une datation dans les deux premiers t iers du l l"siècle.
3Ces deux têtes démontrent bien oue c'est
à tor t qu 'on a négl igé, jusqu 'à présent , l 'é tu-de de l a scu lp tu re de Nas ium; i l es t v ra ique ,si l 'on excepte les sculptures de Mazeroie,les découver tes peuvent paraî t re moinsimpress ionnantes que ce l les fa i tes à Crandou dans l ' agg loméra t i on vo i s ine deSoulosse-Sol ic ia ;mais ce sera i t négl iger unparamèt re : l ' amp leu r des d i spa r i t i ons . l lfaut en fait compenser cette faiblesse quan-t i ta t ive par une étude déta i l lée, p lus qual i -tat ive, de ces sculptures et par leur compa-raison avec celles qui ont été découvertesdans la rég ion et , au-delà, dans tout le nord-est de la Caule : on peut alors reconnaîtredans Nasium, si ce n'est un véritable centrear t is t ique, du moins un mi l ieu propice àl 'épanouissement des grandes in f luenceses thé t i ques qu i an imen t l ' h i s to i re de l asculpture en Caule, ,
259
260
Fig. r : Statue de "déesse-mère".
Découverte en î884 au Breail(5a i nt-A m a n d - s u r- O r n a i n).
Calcaire aolithique.Fin l" s. ûp{. J.-C.Musée Barrois.
Cliché P.-A. Martin.
1 : 5ur ces divinités, on pourra consulter P-M. Duval,1957 p. 52 et suiv, ou, plus récem-
ment, S. Deyts, r992, p. 55-68.2 : A. Thévenot, 1969, p. 17o.
3 : l.J. Hatt, r957, p. 90-92 ; êSalementi966, p.4't-5o.
4 : H. Koethe,1937 p.2o9-21o.
5 : 5ur les conditions de la découverte. voirL. Maxe-Werly, r885, p. tttrt5, pl. h.-t. ; à
compléter par la consultation de la biblio-graphie établie par F. Mourot, 2oo1, p.415 ;
l e < r r r l n T r r r p e c + r e r e n c é e d a n s
E. Espérandieu, R. Lantier, 19o7j965, Vl, n'
4678. Comme E. Espérandieu l 'aff irmaitdéjà, elle est tail lée dans le calcaire ooli-
th ique que l 'on surnomme " p ie r re deSavonnières "
:voir I 'analyse pétrogra-ph ique.
6 : Par exemple ThévenoT,1969, p.169 :hypothèse reprise par la suite dans la plu-
part des ouvrages cites ici.
Avant toutes choses, i l convient d' insistersur le fa i t que cet te dénominat ion, " déesse-mère " , n 'est qu 'une ét iquet te commodepour dés igner une d iv in i té dont le nomexact nous échappe. Certes, cette sculpture(f ig. r) se rattache par de nombreux aspectsde son iconographie ( la f igurat ion ass ise, lesf ru i ts) aux mul t ip les représentat ions gal lo-romaines de déesses protectr ices et pour-voyeuses, que les inscr ip t ions qual i f ient tourà tour de Matres,de Matronae, parfois ausside lunones ' , mais i l n 'en demeure pas moinsque la d iv in i té f igurée devai t avoi r une iden-t i té propre, sans doute même une mytholo-g ie qui n 'appar tenai t qu 'à e l le : s i ce n 'é ta i tpas le cas, pourquoi le sculpteur aura i t - i lautant ind iv idual isé ses t ra i ts , ins is té a ins isur sa v ie i l lesse ? On a l ' impress ion d 'avoi raffaireà un portrait.
l l ne peut, être question ici d'essayer derépondre à toutes les interrogations quesoulève cette f iguration ; on toucherait là audoma i ne de l 'h is to i re re l ig ieuse ga I lo- romai-ne, à la définit ion, très controversée, de lapart qu'y occupent les mythes et les djvini-tés d 'avant la conquête. D 'a i l leurs, Emi leThévenot n'écrivait- i l pas, précisément àpropos de cette sculpture, que " (. ) I ' igno-rance où nous restons des mythes qui ontdû l l ' l insp i rer ( . . . ) rend l ' in terprétat ion a léa-toire ". ? On se contentera donc d'en analy-ser le style, et cela à part ir de l 'excellentedéf in i t ion qu 'en a donné Jeanlacques Hat t ' ,pu i s de ten te r de l a rep lace r dans soncontexte : ce lu i de la sculpture gal lo- romai-ne des premiers temps du l " ' s ièc le apr . l . -
C. Car les h is tor iens de l 'ar t , à la su i ted'Harald Koethe^, l 'ont bien démontré : la" déesse-mère " de Naix,f iguration atypiqueet archai 'que, constitue un jalon essentielpour comprendre l 'évo lut ion de la sculpturegal lo- romaine.
Drs corrrDrnoNs DË DÉcouvERTE DIFFI-C I L E s À I N T E R P R É T E R . . .
Avant ce la toutefo is , i l faut s 'ar rêterquelques instants sur le contexte de ladécouverte, trop souvent négligé : el le a l ieule z6 août 1884 au l ieu d i t le Breui l ; les ter -rassiers sont alors à l 'æuvre pour dévier lecours de I 'Ornain, ce la af in de fac i l i ter l 'é ta-bl issement d'une nouvelle voie ferrée. C'estau fond du nouveau l i t qu ' i ls met tent aujour la " déesse-mère "
; la découverte n'estpas isolée puisque l 'on retrouve également,à prox imi té, p lus ieurs sépul tures à inc inéra-t ions, : les travaux venaient de rencontrerl 'emplacement de l 'un des " espaces funé-ra i res " de l 'agglomérat ion ant ique (vo i r lapart ie consacrée au " monde des morts ").
Que peut b ien veni r fa i re une sculpturecomme celle-ci, que l 'on a parfois considé-rée, du fa i t de ses grandes d imensions,comme une s ta tue cu l tue l l e ' , dans uncontexte auss i c la i rement funéra i re ? On nepeut qu'émettre des hypothèses à ce sujet ;les recherches archéologiques menées parLéon Maxe-Werly, qui supervisait les travauxde terrassement, ne nous apportent en effetaucun é lémen t de réponse : comme sou -vent au XlX" siècle, l 'essentiel était alors ladécouverte du " bel objet ", une quête quitenai t l ieu, à e l le seule, de problémat ique defoui l le .
Une seule chose paraî t sÛre f ina lement :c'est que Ia statue est d'un poids bien tropconsidérable pour qu 'on puisse imaginerqu 'e l le a i t é té déplacée sur une longue d is-tance. Plusieurs pistes peuvent alors êtreexplorées. On peut par exemple imaginerqu 'e l le prenai t p lace dans un édi f ice cu l tue lsitué à proximité immédiate de la nécropo-le : ce vo is inage sera i t d 'a i l leurs une consé-quence log ique de l 'appl icat ion de la lo irépubl ica ine des Douze Tables, qu i repous-
d
r
262
7 : Volr Van Andringa, 2aoo, P. 12-13.8 : Voir Boppert, i992, p. 44 n' 2or ; i l fauttou t qe méme reco^ré ' . e que le pê t i tch len , qu i v ien t se f ro t te r aux jambes de adéesse, paraît bien inoffensif en regardd 'an imaux au carac tère ch ton ien incontestable, symbo es de la ' mort dévoratrice ,comme la ' Tarasque dAv ignon, qu i t ien tde ses deux pattes des têtes coupées, ou lesmonst res androphages,
' dévoreursd tsom-e> . i ' .equenr . da s eS - . - ro -
poles " de nos régions I
9 : Voir, par exemple, Lin|z, 2oa1, p. 67 ; c'esll ' a t t r ibu t que semble ten i r une dé fun ted 'une s tè e de Sou osse (So l ic ia ) dâns lesVosges, voir R. Bil oret, D16, p. 316377,fig. zS.ro : J .J . Hat t ,1957 P. 90 .r : 5. Deyts,1984, P. 1r5.r2 : H . Koethe ,1937 P. 2 ro .r3 : S . Dey ts ,1984.14 : J.-1. Thévenard, 1996, p. 154,fiT. 91.r5 : E . Espérand ler , R . Lant ie r , r907 1965, V l ,nos 483r e t 4839.
seai t les sépul tures en dehors de la v i l le ,dans l 'espace pér i -urbain, un espace egale-ment dévolu aux sanctuai res ' . On peut éga-lemen t a l l e r p lus l o in e t supposer qu ' i l y aun l ien p lus d i rect ent re cet te déesse et lemonde des morts :cer ta ins é léments de soniconographie - le ch ien, par exemple, danslequel on a par fo is reconnu un symbole delAu-Delà', les clés aussi, que l 'on retrouve dansl'i magerie et les dépôts fu nérai res' - pou rra ienttrès bien être interprétés en ce sens.
Mais tout ce la, rappelons- le , n 'est qu 'hy-pothèses, et si l 'on cherche à démontrerl 'une p lutôt que l 'aut re, on sera nécessal re-ment condui t à sur- in terpréter tant l ' icono-g raph ie de ce monumen t , qu i demeure l a r -gement incompréhensib le, que le contextede la découver te, mal connu. La prudences ' impose donc, mais l 'on ne peut toutefo iss 'empêcher de penser que l 'on a là un docu-men t de p lus qu i démon t re que l ' on au ra i ttor t de voulo i r systémat iquement chercherà d i s t i ngue r de man iè re t rop ne t te , a -mo ins dans l ' o rgan isa t i on de l ' espaceurba in , l e monde des d ieux de ce lu i desmorts : dans toute la Caule l 'archéologie al iv ré des témoignages de l ' in terpénétrat ionde rec di f férentes snhères.
i-"'H t * rugï g&1tr Ë *md*R,&Ti F"C 'es t l ' express ion q u 'a fo rgée Jea n-
Jacques Hat t pour qua l i f ie r le s ty le de ce t tescu lp tu re e t de ce l les qu i en sont p roches ' ;express ion qu i a l ' avantage de met t re en
v a l e u r u n e d e s d i m e n s i o n s e s s e n t i e l l e s d e
cet te oeuvre , qu i n 'es t percept ib le quelo rsque l 'on se t rouve face à e l le , que l 'oné tab l i t un contac t p resque phys ique avec cemonument . Les v is i teurs du Musée Bar ro is ,où e l le es t conservée, en on t ma in tes fo is
fai t l 'expérience. En effet , c 'est une sculpturei m p r e s s i o n n a n t e , i n t i m i d a n t e m ê m e ; u n e
énorme masse de p ie r re à laque l le la com-
posi t ion du groupe, en pyramide, confèreune s tab i l i t é que l ' on d i ra i t i néb ran lab le . Cesent iment , ce lu i , sans doute, que ressen-taient déjà ses dévots, naÎt moins, f inale-ment , de ses d imensions, qu i n 'ont r ien dedémesurées -e l l e mesure p resque cen tso ixante cent imètres de haut , pour une lar -geur, à la base, de quatre-vingt-treize centi-mètres et une profondeur de quarante-qua t re cen t imè t res env i ron - que de l amajesté, p le ine de ra ideur et de sévér i té , dela " déesse-mère " .
C'est el le, représentée assise au centre,sur un fauteui l à haut doss ier , les jambesécar tées, qu i domine le groupe ; c 'est toutjuste s i l 'on remarque, à ses p ieds, un pet i tch ien, qu i v ient se f ro t ter contre ses jambes.À ses cô tés , se t i ennen t debou t deuxfemmes -e l les por tent en ef fe t la tun iquelongue fémln ine - ses servantes sans doute,ma lheu reusemen t au jou rd 'hu i acépha les ,qui por tent , pour ce l le de dro i te , une crucheà long bec ( f ig . z) , pour ce l le de gauche unvase à panse g lobula i re et à haut co l , a ins iqu 'un t rousseau de c lés ( f ig . 3) . Leurs mou-vements - l 'une d 'e l le s 'apprête à verser lecontenu de son réc ip ient - n 'a t ténuent enr ien l a s t r i c te f ron ta l i t é de l arep résen ta t i on ; ces f i gu res pe inen td 'a i l leurs à se détacher de la por t ion de p ier -re dans l aque l l e es t scu lp tée l a déesse :e l l essont dans son ombre ( f ig .d.
La tê te de la d iv in i té , d ispropor t ionnéepar rapporl a u reste d u corps, renforce enco-re l 'h iérat isme de la composi t ion : e l le estcomme f igée, e t semble dévisager de sesimmensesyeux au regard f ixe, le spectateur ,jusqu 'à fa i re naÎ t re en lu i un cer ta in mala ise.Les t ra i ts sont ceux d 'une v ie i l le femme, auxjoues creuses, aux rides profondes ; toutefém in i té a d i spa ru de ce v i sage . l l y ad 'a i l leurs là un contraste qui mér i te d 'ê t resoul igné, ent re la sécheresse de ces t ra i ts e t
Fig" a :"}éesse-mère", détail de la servante de droite et deses *ttributs {uuche ù bec tubulaire).lViusée Earrais. Cliché P.-A. Martin.
Fig.3 :"téesse-mère", détail de la servante de gauche etde ses attributs {*mphorette et clés).*4usée Earrois. C!iché P.-A. Martin.
les fruits, des pommes et des sortes oeprunes apparemment , que semble of f r i r ladéesse, et qui la rapprochent de ces " déesses-mères " pourvoyeuses,fécondatrices, que nousévoquions (f ig.S)
Le t ra i tement t rès décorat i f de l 'en-semble, d 'un " maniér isme presque exacer-bé " a-t-on écrit", ne nuit nul lement à cetteimpress ion de majesté, presque inquiétan-te, qu i se dégage de la sculpture. l l est sur-tout sensib le dans le rendu du p l issé desdraperies, agencées de manière complexe,qui recouvrent in tégra lement le corps de ladéesse sans la isser dev iner en aucun endro i tles formes sous-jacentes : les pl is, courbes,sont serrés, profonds, leur dessin n'a r ien ceréaliste. C'est " ( ) un style de draperie auto-nome, qui n ie les formes du corps " écr iva i tHarald Koethe',. Ce traitement graphique, cegoût pour l 'ornementat ion, t rès é lo igné del 'esprit classique, se retrouvent dans la déco-ration du dossier du siège, faite d'une tressesurmontée d 'une f r ise d 'esses en doubrecrosse, un motif récurrent de l 'art celte.
Enrrne "cr rÉs"Dcs LruoursET DE5 Lrr ïCOhtS :I JN ATËL IER DË 6RANDË STATUAIRT
On peu t donc qua l i f i e r ce g roupe d '" archaique " pu isqu ' i l témoigne, tant parson iconographie que par son sty le , de lapersistance, après Ia conquête, des concep-t i ons a r t i s t i ques e t es thé t i quesantér ieures ; s i les témoignages d 'une te l lepersistance sont relativement rares, la plu-par t des sculptures découver tes dans larégion se présentant comme les variantesprov inc ia les de thèmes et de s ty les déf in isdans l 'a i re médi ter ranéenne, la " déesse-mère " n 'est pas pour autant iso lée : S imoneDeyts a en effet bien montré, dans un art iclepubl ié en r984, , que p lus ieurs aut res s tatuesdiv ines, re t rouvées en Haute-Marne, aux
marges de la "c i té" des L ingons et de ce l ledes Leuques, sont d'un style et d'un esprit siproches qu ' i l ne semble fa i re aucun doutequ'e l les a ient é té réa l isées par un mêmeate I ie r.
C 'est notamment le cas d 'un grouperetrouvé à Chatonrupt-Sommermont, petitv i l lage s i tué à une t renta ine de k i lomètresseu lemen t de Na ix - ; i l es t ac tue l l emenrconse rvé dans une co l l ec t i on o r i vée .I iconographie est presque ident ique : unedéesse ass ise, tenant sur ses genoux unecorbei l le de f ru i ts ; on ret rouve auss i , dans laf iguration à ses côtés d'une servante, lemême pr inc ipe de h iérarch ie des ta i l les. Lesdimensions sont également comparables ;le s ty le sur tout , qu i se la isse l i re malgrél 'usure de la p ier re, paraî t ext rêmementproche : on remarque par exemple les p l iscouchés, en z igzag,qui an iment la re tombéede draper ie ent re les jambes de la déessehaut-marnaise, ident iques à ceux que l 'on l i tsur le f lanc gauche de son alter ego deNasium.
Les para l lè les sont également t rès netsavec les représentat ions de grandes d imen-s ions d 'un coup le d i v in , re t rouvées à5ommerécour t , à une c inquanta ine de k i lo-mètres de Naix à vo l d 'o iseau, à la l imi te desactuels départements des Vosges et de laHau te -Marne ' ' . e l l es son t ac tue l l emen tconservées au Musée dépar tementa l desVosges à Épinal . Le v isage du d ieu notam-ment est presque en tout po ints ident ique àcelui de la déesse de Nasium (f ig. 6 et 7).
Ce dern ier rapprochement permet de d is-ce rne r dans que l l e amb iance i n te l l ec tue l l eet re l ig ieuse oeuvra i t cet a te l ier de sculp-teurs, v is ib lement spécia l isé dans la grandestatuaire de culte ; en effet, plus encore quecel le de la " déesse-mère " , l ' i conographiedes statues de Sommerécourt est étrangèreau monde gréco-romain :en témoignent le
264
r6 : E . Espérand ieu , R. Lant ie r , l9o7 r965, lVnos l34o et 336r.
r7 : La massivité et l 'hiératisme sont enque que sorte inhérents à a représentation
assise en majesté ; seuls, i ls ne peuventdonc être considérés comme des é éments
permettant de déterminer le sty e d'un at. 'l ier On notera par ai leurs que l 'état du
Me.curp ce Dampie i le ne pe 'met gLe ed'avoir une idée précise de son traitement ;
quant à la déesse de Langres, mieux conser-vée, el e se distingue des scu ptures de Naix
ou de chatonrupt , à la fo is par ses d imens lons -e le ne mesure que 65 cm de haut - e t
par e e 'du de 'o r p l i sse , o -s ca 'se .r8 vo I Boppe'T. r992 p. n8-60. ̂o\ r (sLe e
or te cu coup le "e ran de Mayen.e l . ,(c te le a i te " de B l -ssJ5 " de Mayerce) t
(s te l " a - )e zer )i9 :5ur ce mode de représenta t ion ,vo i r la
synthèse de Boppert, 1992, p. 24'45.20 : La déesse de Naix porte en effet trois
bagues, à 'aur icu la i re , l ' annu la i re e t l ' i ndexde sa main gauche -1a main dro l te a
prêçque con p lè ie re lL d isoa u- . a nsr qJe0eux Drace ers.
2r I S. Deyts,1984, P.121.22 | Ch. Nerz ic ,1989, P . 130.
4 : l.l. la|t, 1966, p. 41 50.24 : H. Koethe, r937 p. 2o9.
por t du torque et la présence du serpent àtête de bél ier , " cr iophore " , f iguré par deuxfois déjà sur cette æuvre maîtresse de l 'or-fèvrer ie ce l t ique qu 'est le fameux chaudronde Cundestrup.
Simone Deyts a proposé d'autres ra??ro-chemen ts rég ionaux , no tamment avecdeux scuIptures, une autre "déesse-mère" etun Mercure, re t rouvés respect ivement àLangres et à Dampierre, une commune voi -s ine du che f - l i eu de l a c i t é des L ingons ; i l ya en ef fe t une réel le parenté iconogra-phique entre ces deux æuvres et ce l les quenous avons décr i tes p lus haut : i l s 'ag i t éga-lement de représentat ions d iv ines ass ises,massives et h iérat iques. Mais la parenté s ty-l is t ique est moins net te : on n 'a pas dans cecas d 'é léments déc is i fs , comme la tê te d.d ieu du Sommerécour t ou le t ra i tement d-p l issé de la déesse de Chatonrupt , qu i per-mettraient d'aff irmer, en toute cert i tude,qu ' i l s 'ag isse b ien de product ions issuesd ' u n m ê m e a t e l i e r q u e l e g r o u p e d eNasium'1 .
i * l rur arRE DAcf lvr rÉs 'É; r runAruT JLjsqu Au Rul ru I
S imone Deyts a cherché à a l ler au-delà deces para l lè les micro-régionaux et s 'est tour-née pour ce la vers la sculpture funéra i rerhénane : e l le a ef fectué toute une sér ie derapprochements avec des æuvres prove-nant de Mayence et de ses envi rons, deSelzen notamment 'u . E l le se fonde sur tout ,l à enco re , su r l es p rox im i tés i conogra -phiques : dans le mode de représentat ion,puisque les défunts de ces s tè les sont f igu-rés assis, à l ' image de la "déesse-mère", ceoui est re la t ivement inusuel dans l ' icono-graphie funéra i re ' ' ; dans cer ta ins déta i lsauss i , comme la présence, sur la s tè le deSe lzen , d 'un ch ien , i den t i que à ce lu i qu i
Êin z , " l ' tào<<o-màro"I t 9 , 4 . u " J J v , , , v , t '
détail du visage et de lacoiffu re. Musée Ba r ro is.CIiché P-A. Martin.
Fig. 5 :"Aéesst-màre",détait de la partie inié'rieure de la sculpture.Entre les plecls, un thiensvec collier et grelat.Musée Earrais.{lithé P.-A. !t4artin.
accompagne la d iv in i té de Nasium, ou, sur-tout , la " surcharge de b i joux " , bagues etbracelets , par fo is pendent i fs , que l 'onret rouve auss i b ien sur les déesses que surles défuntes"'. La parenté apparaît égale-ment dans l 'agencement , ornementa l p lusque natura l is te , des draper ies.
" Pour toutes ces ra isons, conclut S imoneDeyts, i l ne nous paraîI pas trop hasardeuxde proposer l ' idée d 'un ate l ier de grandestatuai re qui aura i t t ravai l lé de Mayence ( . . . )à Chatonrupt e t Sommerécour t ( . . . ) e t sansdoute même jusqu 'à Langres. Dès lors est - i lt rop r isqué de se demander s i l 'a te l ier -car i ls 'ag i t b ien à notre av is d 'un ate l ier - n 'aura i tpas æuvré en deux temps ? Dans un Pre-m ie r t emps i l au ra i t t r ava i l l é à Na ix e tCha ton rup t . Les rep résen ta t i ons dedéesses-mères ass ises entre des servanteslu i au ra ien t i nsp i ré l e re l i e f de Se lzen . l lau ra i t ensu i te beaucoup p lus i nd i v idua l i séses commandes :d 'une par t à Mayence, desportraits funéraires parfaitement modelésdans le schéma r igoureux d 'austér i té bour-geoise, d'autre part, à Sommerécourt, desd i v i n i t é s e m p r e i n t e s d ' i n d i v i d u a l i s m eautochtone (.. .). l l resterait à se demander,dans cet te conjecture, s i les ar t isans decet te s tatuai re ne sera ient pas venus t ra-v a i l l e r e n C a u l e , d e p u i s l ' l t a l i e , p a r l aLo r ra ine , c ' es t -à -d i re pa r l a c i t é desMéd iomat r i ques . Les t rès r i ches décou-vertes faites à Metz ces dernières années etencore à l 'époque actuel le pourra ient nousen appor ter la conf i rmat ion " ' ' .
S i I 'on peut accepter , sans grandes hési ta-t ions, l 'hypothèse se lon laquel le les f igura-t ions d iv ines découver tes dans les deux" c i tés " vo is ines du nord-est de la Caulesera ient issues d 'un même ate l ier , les aut resproposi t ions de Simone Deyts nous la issentp lus scept ique: les découver tes de sculp-
tures dans l ' Î lot SaintJacques à Metz n'ont
en effet pas apporté la confirmation qu'es-péra i t cet auteur ; quant aux l iens avecl ' l ta l ie du Nord, dé jà suggérés par Hara ldKoethe, i ls restent à étayer plus sol idement'Surtout, si les stèles funéraires de Mayencepartagent, certes, un certain nombre de
traits communs avec les æuvres de Nasium,Chatonrupt e t Sommerécour t , les d i f fé-rences sont également notables : dans l 'es-pr i t généra l de la représentat ion, où I 'h iéra-t isme déjà s 'a t ténue, où la peur du v ide, qu i
caractérise la déesse de Naix, se fait moinsfor te ; dans les déta i ls auss i , notammentceux du p l issé, p lus souple, p lus réal is te .
l l ne s 'ag i t pas ic i de cr i t iquer le t ravai l deSimone Deyts qui a le grand mérite d'avoirat t i ré l 'a t tent ion sur les incontestablespara l lè les qui pouvaient ex is ter ent re ces
æuvres é lo ignées géograph iquemen t ;nous voudr ions s implement montrer qu ' i l
ex is te au moins deux manières de les expl i -quer. l ly a tout d'abord l 'explication a maxi-ma, qu i ins is te sur les prox imi tés p lus quesur les différences : c'est cel le de SimoneDeyts, ce l le d 'un ate l ier un ique. E l le a été
reprise, et explicitée, par Chantal Nerzic, qui,
dans son ouvrage de synthèse sur La sculp-
ture en Caule romaine, note que " les diffé-rences existant dans l 'exécution de [ces]oeuvres ne sont pas en contradict ion avec
[' ]hypothèse [d'un atel ier unique] ; i l estcertain que de nombreux art istes étaientnécessai res au fonct ionnement d 'un ate l ier
de cette importance ; si l 'art du maÎtredéterminai t une constance de l ' insp i rat ion, i lne réalisait pas en personne toutes les æuvresqui lui étaient commandées "-
Et puis i ly a l 'explication a minima,dontnous serions plus volontiers part isan : f l '€St-ce 0as téméraire en effet que d' interpréterces différences comme le reflet du mode de
fonctionnement d'atel iers dont on ne sait
f ina lement presque r ien ? Les para l lè les,incontestables, peuvent en effet s'expliquerau t remen t ; à l a no t i on d 'a te l i e r , ma lconnue, mal définie, on peut en effet substi-tuer ce l le d ' " ambiance
" cu l ture l le et ar t is -t ique commune : on peut a lors imaginerdes off icines de sculpture diftérentes, éloi-
gnées les unes des autres, mais oeuvrantdans un même espr i t , re f le t d 'un temps oÙles règles qui régissent l 'art gréco-romainn'ont pas encore pénétré en profondeur la
sculpture gallo-romaine. Bref, les fruits, à la
saveu r a ppa rem ment ident iq ue, d 'u ne
même pér iode de t rans i t ion, où les hér i -
tages styl ist iques et iconographiques de la
oéi iode antér ieure se mêlent aux acquis dela romanisation progressive de l 'art, maisdes fruits tout de même issus d'arbres diffé-rents.
D'ai l leurs, on retrouve dans tout le nord-
est de la Caule et dans les rég ions avois i -nan tes des æuvres témo ignan t d 'unemême inspi rat ion, d 'un même espr i t ;Jean-Jacoues Hatt en a dressé la l iste et les areoroduites'r : on retiendra notamment la
statue de "déesse-mère" de Cissey-sur-Ouche ou les f igurat ions du p i l ier de Mavi l lyen Bourgogne. Plus que toutes autres c'estla " s tè le monumenta le
" de Nickenich,conservée au Musée de Bonn, qu i nousparaît proche du groupe de Naix; HaraldKoethe, déjà, rapprochait ces sculptures':même système de draperie, même hiératisme,même surcharge ornementale, même abon-dance de bi joux. On n'a jamais écrit pourtantou'el les étaient issues d'un même atel ier ;et i lest vrai que, dans le détai l , la distance appa-raît : mais est-elle finalement plus importanteque celle qui sépare la " déesse-mère
" de cer-
taine des stèles funéraires de Mayence que
l 'on a voulu attr ibuer à un même atel ier ?
266
25 : ). ).1'aT1,1951,p.79 et p . l l , f ig. 5.26 : on peut , par exemple , se demander s ' i l
ne convlent pas de reconnaltre, au milieude a p laque, un d isque, ma ladro i tementfiguré, plutôt qu" (...) une protubérance
semi - to r ique ' i es f ibu les à d isque med ian
sont da tées du mi l ieu du le r s ièc e av . l .C . d ra f in dL s è ( e .L iva ' t pdr M. fe rgère .
i985,p.26j 27o, p1.99 (type 15).27 : Par exemp e, Flttschen, Zanker, t983,
nos 5o (Auguste) et 75 (Néron-Vespasien).28 : Bopper t ,1992.
29 : Panhuysen,2ooo.30 : Koethe, 1932 P. 21o.
t-i ru r se u LPrt-i Rç PRÉÇ&{rSi nous avons par lé de " pér iode de t ran-
s i t ion " , c 'est que tout ind ique que la sculp-ture de Nasium, et ce l les que l 'on a Puregrouper autour d'el le, sont assez précoces.C'est JeanJacques Hat t qu i , le premier , acherché a préc iser l 'époque de réal isat ion dela " déesse-mère "
; pour ce la, i l s 'est fondésur un déta i l qu i passe souvent inaperçu, laprésence, sur l 'épaule gauche de la d iv in i té ,d 'une f i bu le :pou r l u i , i l s ' ag i ra i t d ' un t ypep rov inc ia l , ' ( ) du temps C laude-Néron " " . l l
a également cherché à dater la déesse deSommerécour t , ma is d 'ap rès l a co i f f u recet te fo is : les " angla ises " sur les épaulessera ient caractér is t iques des por t ra i ts del 'époque c laudienne.
C'est donc vers le mi l ieu du l " ' s ièc lequ 'aura i t æuvré l 'a te l ier dont sont issuesces sculptures ; i l convient peut-être toute-fo is d 'ê t re un peu p lus prudent que ne l 'a é tél 'h is tor ien de la sculpture gal lo- romaine. Laf ibu le qu 'arbore la " déesse-mère " est eneftet d'un dessin assez grossier - ce qui estassez log ique puisque ce déta i l est presqueinv is ib le - e t l 'on peut a lors hés i ter ent replus ieurs types, moins b ien datés que ce lu ique reconnaî t J . -J . Hat t , mais tous généra le-ment Drécoces'" ; les études récentes mon-trent pa r a i l leu rs q u' i l est préféra ble, pou rces pet i ts ob jets , d 'é larg i r au maximum lafourchet te chronologique de leur d i f fus ion.Quant aux " angla ises " ,on les ret rouve déjàsur des por t ra i ts augustéens, e t jusqu 'à laf in du l " ' s ièc le" ; de manière p lus généra le,la datation par la coiffure soulève un pro-b lème pa r t i cu l i e r : ce lu i du temps de d i f f u -s ion des modes impér ia les dans les pro-v inces é lo ignées du centre de l 'Empire, untemps qui a sans doute pu êt re par fo isassez long. l l faut également ten i r comptede la déformation des coiffures impériales
en mi l ieu prov inc ia l , e t donc, peut-êt re, nepas a t tache r t rop de va leu r à ce r ta insdé ta i l s , comme pa r exemp le l a l ongueur deces " angla ises " : c 'est leur présence sur-tout qu iest s ign i f icat ive p lus que leur appa-rence.
5i la datation proposée par ).-J. Hatt estdonc sans doute t rop f ine, e l le n 'en demeu-re pas moins per t inente ; c 'est b ien à desceuvres du l " 's ièc le après J . -C. , sans doute deses premiers temps, que l 'on a af fa i re ic i .[étude styl ist ique confirme en effet les pré-sompt ions que l 'on pouvai t avoi r grâce à cesdéta i ls apparemment modestes que sont laf ibu le et les " angla ises " : l " ' archalsme " deces représentat ions est la marque d 'unehaute époque, où demeure sensib le l 'hér i ta-ge ce l t ique.
D'a i l leurs, tous les para l lè les que l 'on a puétabl i r renvoient au l " ' s ièc le apr . J . -C. : lesstèles de Mayence, par exemple, ont étéétudiées par W Bopper t qu i en s i tue la réa-l i sa t i on dans l a p remiè re mo i t i é de ces ièc le" ; le f ragment de p i l ier de Nimègue,aux Pays-Bas, cer tes d ' inspi rat ion p lus c las-s ique que l e g roupe de Na ix , ma is qu i se ra t -tache, par b ien des aspects, à un langageident ique, a été daté récemment , grâcenotamment à l ' inscr ip t ion qu ' i l por te, duregne de T ibère ;c 'est auss i dans la premiè-re moi t ié du l " ' s ièc le apr . J . -C. que l 'on s i tuegénéra lemen t l a réa l i sa t i on du p i l i e r deMavi l ly e t ce l le du monument funéra i re deN icke n ich.
Coruclustotrt :ART GALLO-ROMAIN ET ART ROMAN
ll faut rappeler; en conclusion, qu' i l est toutà fai t except ionnel de pouvoir suivre ainsi l 'ac-t iv i té d'un atel ier de sculpture ant ique : lesf igurat ions divines de Naix, Sommerécourt et
Chatonrupt nous offrent la possibilité, rare,d'en entrevoir un à l'æuvre, dans les premierstemps du l" 'siècle, se déplaçant, dans un rayond'une cinquantaine de ki lomètres, peut-êtredavantage, d'agglomérations en sanctuaires,pour sculpter des images de culte encoretoutes e m prei ntes des conception s rel igieusesde l 'époque de l ' indépendance.
Nous voudrions terminer en soulignant unparadoxe. ll suffit de parcourir les musées lor-rains, de s'attarder quelques instants sur leurscollections de sculptures dépoque romaine,pour constater que le style de la "déesse-mère"
n'a guère eu, dans les siècles suivants, de réellepostérité ; progressivement en effet, dans l'artde la Caule, l 'archaïsme va s'atténueI laisser laplace à un art " romanisé ", réaliste sans excès," provincial " pour tout dire. C'est dans le nord-est de la Caule d'ai l leurs oue se trouventquelques-unes des sculptures les plus emblé-matiques de cet art : les vestiges des piliers
funéraires de la bourgeoisie trévire.Apparemment pas de postérité donc, mais l'onne peut quêtre frappé toutefois par la proxi-mité qui existe entre cette æuvre et certainessculptures médiévales ; Harald Koethe déjàl'avait noté : " (...) le bas-relief de Naix [est lasculpture] qui, peut-être, rappelle le plus forte-ment, de tous les ouvrages du l"' siècle, l'artroman "". lmaginons, à la place de ces fruits, unenfant, et l'on ne serait pas bien loin d'uneimage de Vierge théotokos byzantine.
Des contextes historiques différents peu-vent donc donner naissance à des productionsart ist iques d'un esprit proche ; l 'histoire del'art est traversée de courants antithétiques,q u i s'opposent, luttent les u ns contre lesautres, se mêlent par fo is , d ispara issentaussi,et réapparaissent : entre la déesse deNaix et les vierges romanes, c'est comme sil ' a r t g r é c o - r o m a i n n ' a v a i t é t é q u ' u n eoa ren thèse .
Fig" 6 et 7 : Figîiratians divinesde Sammerécourt{Haute-Marne).{!iché Servicedu Musëe d'Epinat.
267
268
r :Vo i r parexemple les t ravaux de N Lorauxsur " la Be l le Mor t " ou ceux de A. Schnapp-Courbe i l lon dans Cno l i , Vernant , 1982, p 27-
44'77-882 : t xpress ion fo rgee. pou 'Lne aJr re pér io
de que ce l le que nous é tud ions ic i , parP Ariès ; voir Ariès, 1975.
3 : Vovel e, 1982, P. ro9 127
4:E.Ctubézy dans A'. Ferdière (dir), 2ooo,p.14'15
On l ' a beaucoup d i t , beaucoup éc r i t , l estombes , l es néc ropo les , l es usages funé -ra i res , que déc r i t l a l i t t é ra tu re an t i que ouque l ' on dev ine au t rave rs des ves t i gesm a t é r i e l s q u e r é v è l e l ' a r c h é o l o g i e ,s e r a i e n t l e " m i r o i r d e l a s o c i é t é d e sv i van ts " : u f l e expos i t i on su r l a mor t dansles soc ié tés an t i ques , qu i s ' es t t enue enA l l e m a g n e e n 1 9 8 9 , n e s ' i n t i t u l a i t - e l l epas, d'ai l leu rs, Graber, Spiegel des Lebens ?Les t ravaux des ethnologues, des anthro-po logues , des h i s to r i ens des men ta l i t éson t pou r tan t démon t ré que l ' on ne pou -va i t p lus sousc r i re p le inemen t à ce t teidée cou ran te : non , l e monde des mor t sn 'est pas le ref le t du monde des v ivants,ou, p lus exactement , n 'est pas son ref le texac t . Ca r Dar de là l a dou leu r rée l l e l i ée àla d i spa r i t i on , l ' émo t ion " v ra ie " qu 'e l l esusc i te , l ' i n t rus ion de l a mor t es t , dans l emonde an t i que comme dans l es soc ié tésc o n t e m D o r a i n e s d ' a i l l e u r s , u n m o m e n t"pr iv i lég ié" , où Ia soc iété va s 'o f f r i r enspec tac le , donner à vo i r une image idéa l i -sée d 'e l l e -même, e t ce la au moyen d 'unemise en scène où chacun a sa P lace , oùchaque geste, répété à chaque nouveaudeu i l , a sa s ign i f i ca t i on p rop re ' . De l à na Î tc e t i p c r o y a b l e p a r a d o x e : l a m o r t , q u idev ra i t t ou t chambou le r , a é té , e l l e auss i ," app r i vo i sée " pa r l 'Homme ' ; a lo rs qu 'e l -l e dev ra i t dés tab i l i se r l a soc ié té , i n te r ro -ger les s t ructures d 'encadrement soc ia leset menta les, e l le ne fa i t que les renforcer .Et l 'on aura i t tor t de cro i re que ce la n 'estv ra i que pou r l a mor t des " C rands " , ca rm ê m e s i l e s e n j e u x n e s o n t P a s l e smêmes , s i l ' " i déa l i sa t i on " a t te in t sou -ven t son comb le dans l es g randes cé ré -mon ies qu i accompagnen t l a d i spa r i t i ondes hommes de pouvo i r , de p lus en p lusd 'é tudes démon t ren t au jou rd 'hu i qu ' i l enva de même pour l e t réPas du qu idam.
La mort phys ique d 'un êt re s 'accom-pagne donc tou jou rs de ce que l ' on peu tqua l i f i e r de " d i scou rs su r l a mor t " pou rpa raphrase r M . Vove l l e r : o rgan isé , cohé -rent , émanant de " ceux qui restent " , c 'estauss i un d i scou rs qu i pe rme t de l ég i t imerla soc iété des v ivants. Chercher à le com-prendre, à le décrypter , est au jourd 'hu i lap r i n c i p a l e p r o b l é m a t i q u e d e s t h a n a t o -l ogues spéc ia l i s tes de lAn t i qu i té : e t ce lan 'est pas chose a isée, car ce d iscours esten g rande pa r t i e i nconsc ien t . En Cau leromaine, la d i f f icu l té est accentuée parl 'absence presque tota le de textes ; not resource exc lus ive est a lors l 'archéologie,qu i ne dévo i l e souven t que des fa i t s , àpar t i r desquels on peut , cer tes, reconst i -t ue r des ges tes , ma is ra remen t a l l e r au -delà et reconnaÎ t re les mot ivat ions qui leson t gu idés . Ce la n ' i nc i t e guè re à l ' op t im is -m e : É . C r u b é z Y é c r i v a i t P a r e x e m P l erécemment que s i l es " p ra t i ques funé -ra i res " se l a i ssen t au jou rd 'hu i dev ine r , "
l es r i t es funé ra i res , assoc ia t i on d 'une p ra -t i que e t d ' une c royance , nous son t com-p lè temen t i nconnus " ' .
Ce constat est peut-êt re toutefo is ànuancer , au mo ins pou r l a pé r iode h i s -to r i que : une enquê te pa t i en te peu t don -ne r que lques résu l ta t s , nous l a i sse r en t re -vo i r que lques aspec ts de ce " d i scou rs " '
j . Pea rce donne a ins i l ' exemp le des sépu ' -t u res d 'une peup lade i ns ta l l ée au t re fo i sdans l e sud -oues t de lAng le te r re : on ano té que dans l es tombes de l a f i n du l " 's ièc le av. J . -C. e t du début du l " ' s ièc le apr .J . - C . n e s e r e t r o u v e n t q u e c e r t a i n e sfo rmes de cé ramiques l oca les , don t l a d i f -f us ion ne dépasse pas l es l im i tes du te r r i -t o i r e d e l a t r i b u , a l o r s q u e l e s a u t r e sfo rmes de cé ramiques p rodu i tes l oca le -ment se rencontrent en dehors de cesl im i tes . Ce la ne peu t ê t re , sans s ign i f i ca -
r::.:.4:ll
::iit.]l:i,l:ri:ll:liaa:i:. a.iat:at:
Jrnru-NoËLCASTORIO
Fig" t : {urte d* lscalisatiandes espaces funéraires deI'ugglawêration.Û.'A.A. F. Maurot.;t.7i::|l::::*:l
fig. a : Fi*les en v?rre dët*uvertes durant ln deuxiÈmemaitiâ du XlXe s. dans des t*mbes e intinérstlan, l"'-lll' s.
Dessins extrcèits dLt ni?r!uscritdu MusÉe ffarrois {1. Maxe-We rly, sd., x}.
270 t i o n : l ' u n e d e s e x p l i c a t i o n s a v a n c é e s e s tque I ' on au ra i t l à l a t race d 'une s t ra tég iedes t i née à p rése rve r l a cohés ion du g rou -pe t r i ba l à un momen t où , p réc i sémen t , semu l t i p l i en t l es con tac ts avec l e mondeextér ie u r ' .
Ce t exemp le démon t re b ien qu 'au jou r -d ' h u i , d a n s l e d o m a i n e d e l ' a r c h é o l o g i efunéraire, i l est nécessaire de prêter atten-t ion à tous les déta i ls , le p lus anodin enapparence pouvant se révéler des p lus s ign i -f icati fs ; c'est à ce seul prix que pourrontapparaî t re ces "d is tors ions" , s i lourdes desens, qui existent entre "Monde des morts"et "Monde des v ivants" . l l fa i t égalementapparaître, en négatif , notre désarroi face àla documentat ion re la t ive au monde funé-ra i re dans les esDaces mosan et mosel lanant iques : une t rop grande par t ie de ce quenous savons sur le " Monde des morts " danscette région, on le doit en effet à des fouil lesanciennes, du XlX" s ièc le sur tout , gu idées,comme l ' immense major i té des invest iga-t ions archéologiques de ce temps, par leseul souci de la découverte de l 'objet rare etpréc ieux. Sont a ins i passées sous s i lence,dans les maigres comptes-rendus du temps-ouand i ls existent !-, toutes ces traces, sotr-ven t d i f f i c i l emen t d i sce rnab les , pa r fo i sin f imes, qu i nous permet tent d 'ent revoi r ler i tue l ; nous vo i là donc condamnés à n 'en-t revoi r la " mor t vécue " - tou jours
M. Vovelle...- qu'au travers du prisme défor-mant d 'une "archéologie à papa" : le s i te deNas ium, d 'une i ncon tes tab le r i chessecomme nous a l l ons l e vo i r , ma is qu i , ma l -heureusement, est resté à l 'écart des pro-g rès mé thodo log iques de l ' a r chéo log iecontemporaine, est sans doute l 'une desmei l leures i l lust rat ions de ce constat enLorra in e.
LEs "
HspAe Ë$ Ft" iNÉff iaIKË$ "
Diff ici le en effet de chercher à pénétrerles usages funéra i res des habi tants de cet teagglomérat ion ant ique a lors que l 'on peineencore à s i tuer avec préc is ion ses " espacesfunéra i res " , des espaces sur la nature exac-te desque ls pèse bon nombre d ' i nce r t i -t udes !C 'es t d ' a i l l eu rs pou r ce la que nousoréférerons év i ter ic i le terme t rad i t ionnelde "néc ropo le " : comment pa r le r de " v i l l edes morts " a lors que ne nous sont parve-nues , pou r cnacun de ces espaces , queque lques sépu l tu res , ma l connues e t ma llocal isées ?
For t heu reusement , les t rava ux deF . Mouro t ' , a ins ique ceux qu ion t é té en t re -pr is en vue de la préparat ion de cet te expo-s i t ion, permet tent au jourd 'hu i d 'y vo i r unpeu p lus c la i r e t de proposer une car te deloca l i sa t i on des "g i semen ts " -pou r
reprendre une express ion chère aux archéo-logues- avec leu r pos i t ion par rappor t à l 'ha-b i ta t ant ique i f ig . t ) ;car te qui a pu êt re réa-l isée en confrontant les données issues dessources anc iennes aux i nd i ca t i ons descadastres. Au to ta l , i l semble b ien que l 'onpuisse, en l 'é ta t actuel de la documentat ion,en dénombre r qua t re , c inq s i l ' on t i en tcompte de l a t ombe monumen ta le du Cu 'du Breui l dont nous repar lerons p lus bas ' .
i l f ,"espace funénaire"
du Sreui l / {oeusse
I e nremier " ecnace funéra i re " se t rouve àL g H '
ç " " L ' ! J H v v ç
l ' es t de l 'agg loméra t ion an t ique : i l s 'é tendsur les deux l ieux d i ts Cocusse e t le Breu i , .l lexamen de la carte ( f ig. t ) permet immé-d ia tement de d iscerner le p r inc ipa l p rob lè -m e q u ' i l s o u l è v e : l ' O r n a i n , q u i l e t r a v e r s e d ep a r t e n p a r t . Y a v a i t - i l , o r i g i n e l l e m e n t , d e u x
' a - o # iri.-.**
ij
i
"--**rl
"espaces funéra i res" , séparés par ce coursd 'eau ? Ou s 'ag i t - i l d ' un seu l e t mêmeesDace ? En l 'é ta t actuel de la documenta-t i o n , i l e s t i m p o s s i b l e d e t r a n c h e r ; o nnotera toutefo is que les deux points lesp lus é lo ignés où des sépu l tu res on t é tédécouver tes ne sont d is tants 0ue de deuxcents mètres envi ron -du moins s i l 'on sef ie aux sources de l 'époque- et que l 'on nesa i t s i l e cou rs de l 'O rna in a connu , à ce tend ro i t , de s ign i f icat ives va r ia t ions da nsson t racé . Seu les des fou i l l es a rchéo lo -g iques, accompagnées d 'une étude géo-morpho log ique , se ra ien t à même d 'appor -ter u ne réponse à cet te q uest ion. . .
Cet "espace funéra i re" , que l lon connaî tsur tout grâce aux t ravaux de déviat ion ducours de l 'O rna in , réa l i sés dans l es annéest87o - t88o pou r l ' é tab l i ssemen t de l a vo ieferrée, a l iv ré p lus ieurs sépul tures à inc iné-ra t i on t -une d i za ine au to ta l , ma is commeon le verra p lus bas, ce ch i f f re n 'a que peude va leu r dans l ' abso lu - accompagnées dematér ie l du Haut-Empire, dont un f rag-ment de s tè le funéra i re ; les découver tesa u l ieu d i t Cocusse, ma lheu reusement t rèsma l documen tées , pou r ra ien t i nd ique r uneu t i l i sa t i on j usqu 'à lAn t i qu i té ta rd i ve oul ' époque mérov ing ienne , pu i sque l ' on yau ra i t éga lemen t m is au j ou r des i nhuma-t ions en sarcophages de p ier re.
Cet te (ces ?) " nécropole(s) " set rouvai (en) t en bordure immédiate de l 'ag-g lomérat ion ant ique ; cet espace pér iphe-r ique éta i t également par tagê, semble- t - i , ,pa r des l i eux de cu l te ( ce qu i es t sommetoute log ique puisque la lo i des Xl l Tables,
du mi l ieu du ve s ièc le av. J . -C. , généra le-men t b ien app l i quée en Cau le , repousseles " nécropoles " en pér iphér ie de l 'espaceu r b a i n , l i e u d ' i m p l a n t a t i o n t r a d i t i o n n e rdes sanctuai res) : c 'est en tout cas ce que
peut la isser cro i re la découver te, en mêmet e m p s q u e p l u s i e u r s s é p u l t u r e s , d e l a"déesse-mère" de Na ix , u ne scu lp tu re q uede nombreux au teu rs cons idè ren t commeu ne statue de cu l te" .
t f" espace funÉraire" de la Fossottet ' ^ ' ^^ ' ^ ' "a ^ '+ au l ieu d i t la Fossot teL C > P d L C > U U - C > 1 , d U i l C U U t L t d f U > > U L L s ,
devenu aujourd 'hu i Aux Fosset tes, sera i ts i tué à prox imi té immédiate d 'un édi f icede spectac le ; i l se t rouvera i t égalementnon l o in d 'une vo ie seconda i re menan t dela v i l l e à l a " bou rgade-sanc tua i re " deCrand . La p lus g rande p rudence s ' imposetoutefo is à propos de cet " espace funéra i -re " , tout comme, d 'a i l leurs, à propos duthéâtre hypothét ique 'n : on ne le connaî ten ef fe t que grâce à une ment ion t rèsvague de C.-F. Denis qui y s ignale la décorr -ve r te de ( ) p ie r res sépu l c ra l es [e td ' ] u rnes funé ra i res " , ma is sans p réc i se r n il eu r nombre , n i l eu r na tu re exac te . Onpourra i t même hési ter à c lasser ce s i tedans l es "esDaces funé ra i res " :on sa i t enef fe t l 'usage abusi f fa i t du terme "urne
funéra i re" au XlX" s ièc le : toutefo is . dansun manusc r i t i néd i t conse rvé au MuséeBarro is , L . Maxe-Wer ly donne une descr ip-t i on p lus poussée de l ' une des tombes ,fa i te d 'un cof f re contenant une urne deverre ' ' , ce qui ne la isse guère de doutes surl ^ ç - ; + ̂ , , ' i t - ' - - i - - : b i e n d , i n c i n é r a t i o n sr E r d r L v u i l ) d 5 r > ) c
d'époque romaine. l l n 'empêche, en at ten-dant de nouvel les invest igat ions sur le ter -ra in , on se gardera b ien d 'u t i l iser ic i leterme de "nécrooole" ou de "c imet ière" .
Pour conclure sur ce "g isement" , notonsque L. Maxe-Wer ly y ment ionne la décot , -ver te d 'un débr is de sarcophage' r qu i pour-ra i t dater de lAnt icu i té tard ive ou du haurMoyen-Age.
5 : J. Pearce dâns Ceoflroy,Batbé (dn.),2oot,p.is' 16+.6 : F. Mourot,2ooi, p.439-444,fi9.323-330.7 :On poufta noter quelques divergencesentre la synthèse de F. Mourot et l 'étudenrê \ - r l - . c - ô r I F léeLablies en accord avec l 'auteur8 : La source essentie le est L. Maxe Werly,r885 ; nous ne donnerons , dans ce qu i su i t ,que les références bibliographiques princi-pa les .pou 'une invesr iga t ion p lus poJssée.voir la bibliographie établie par F. Mourot,2041.9 :Voir ici même notre contribution à proposde cette sculpture.1o I L. Maxe-Werly,1888, p. lor ; i l ne fait tou-te fo is aucJn doute qu un ed i f i ce anr ique. denature indéterminée, a bien existé à cetendroit. lec membra dis,ecn qLi y onr eredécouverts en font foi.11 : C . -F . Den is , t834, f " 6 ; complé té parL. Maxe Werly, s.d., f 329.12 : L. Maxe-Werly, s.d., f ' 327.r3 | L. Maxe-Wedy,1888, p. ror.
t --*,i .-"._, _.-"".1
!
271
212
14 . L. Maxe Werly,s.à.,f 46,321.15 : Cêst bien à cet endroit, est non auCocusse Breu i l comme le Pensa l tF Mourot, qu'i l convient de placer cettedécouverte : e manuscrit de L. MaxeWer ly ne la isse aucun doute à ce su je t ;voir Maxe Wer y, 5.d., f" 261, 263, 328-33a.
ffi lJ "espace funér"airfl" du{hemir: de Ligny
l l " espace funéra i re " ouest , du l ieu d i t Auchemin de L igny, est mieux documenté. Lesdécouver tes ont eu l ieu en rB4r 'e t en tB5z:i l s 'ag i t de tombes à inc inérat ions, maisauss i d ' i nhumat ions , don t une en sa rcopha-ge de p lomb ' . Cet te nécropole paraî t doncavoi r é té ut i l isée pendant une assez longuedurée, du Haut-Empire à lAnt iqu i té tard ive,et peut-êt re même au-delà ; mais on nen a r r l i , , n a r À ' Â t r e . f U e l l e S d i S C O n t i n U i t é SP L U L J U 6 L I
dans l 'occupat ion, e t ce la faute d 'une explo-ration méthodique. Cet espace est à mettreen re la t ion avec un d iver t icu le, qu i sembleavoi r doublé, sur la r ive gauche de l 'Ornain,l a g r a n d e v o i e m e n a n t d e R e i m s -Durocortorum à foul-Tullum ; sa relationavec l 'agglomérat ion est d i f f ic i le à détermi-ner , faute d ' invest igat ions dans la par t ieouest de Nasium, occupée par le v i l lageac tue l . La d i s tance à l ' agg loméra t i onant ique ne semble toutefo is pas avoi r excé-dé un demi-k i lomètre.
ff i lJ "espace funtûraire" du Pré XVTairie
On ne peut que supposer l 'ex is tence, a-nord-ouest de Naix , au l ieu d i t Pré Mair ie ,sur la r ive dro i te de l 'Ornain, d 'un quatr ième" e q n a r e f r r n é r a i r e
" ' r e t t e h v n o t h è q e n eL T P q L L " l Y " . '
repose en fa i t que sur le résul ta t de pros-pections pédestres et sur la découverte àcet endro i t d 'un f ragment d 'ép i taphe, enco-re inédi t . On notera la re la t ion év identeentre ce s i te et le grand axe Reims-Toul .
oAu tota l donc, deux " espaces funéra i res "
seulement sont re la t ivement b ien doct , -mentés : le Breui l -Cocusse et Au chemin deLigny. Dans ces deux cas, i l pourra i t ne pasêtre trop exagéré de parler de " nécropoles ",
même s i on est t rès lo in d 'en connaî t re l 'ex-tens ion et l ' impor tance. Pour ce qui est dela Fossotte et du Pré Mairie, i l convientd 'ê t re beaucoup p lus prudent : seules devé r i t ab les i nves t i ga t i ons a rchéo log iquesDermet t ra ien t de dé te rm ine r l a na tu reexacte de ces " gisements ".
l l convient également d 'ê t re t rès prudents i l 'on cherche à déterminer avec préc is ionles rappor t s qu i ex i s ta ien t en t re cesespaces et la v i l le ant ique: cer tes, la car tedémontre qu ' i ls se s i tuent tous à sa pér i -phérie et, comme c'est très souvent le casai l leurs, en bordure de vo ies de p lus oum o i n s d ' i m p o r t a n c e ; m a i s s i n o t r econnaissance de la topographie ant ique del 'agglomérat ion a fa i t , notamment grâce àla photographie aér ienne, d 'énormes pro-grès, e l le demeure encore lacunai re pourque l 'on puisse se permet t re aucune af f i r -mat ion qui se voudra i t déf in i t ive à ce su jet .l exemp le de l ' " ensemb le funé ra i re "dAvenches en Chapl ix , en Suisse, démontreque la prudence doi t ê t re la règ le dans cedoma ine , en l ' absence d 'une exp lo ra t i oncomplète du s i te funéra i re et de ses envi -rons. Cet ensemble, qu i comprend p lus ieurs" mauso lées " p récoces assoc iés à unenécropole du l le s ièc le, ne se s i tue qu 'à c inqcents mètres du p ied de l 'enceinte f lav ienned 'Aven t i cum: i 1 pou r ra i t a lo rs pa ra Î t relog ique qu ' i l so l t en re la t ion avec la v i l le ;pour tant , les recherches menées là ontmontré qu ' i l s 'ag issai t vra isemblablementde l ' espace funé ra i re d 'un doma ine ru ra lqu i , avec l 'extens ion de la v i l le , s 'est t rouvéinséré dans l 'espace suburbain '6 . Prudencedonc : l a p rox im i té apparen te - j ama is p lusr f e r i na ren tç mè t res v i s i b l emen t - des' Y ' - '"espaces funéra i res ' que nous avons décr i tset de la v i l le ant ique ne pourra i t ê t re qu 'unleu r re , au mo ins dans ce r ta ins cas ; pou r
274 déterminer la nature exacte de leurs re la-t ions, i l faudra i l pouvoi r se fonder sur desdonnées b ien p lus préc ises, e t sur tout d is-poser d 'une évolut ion chronologique com-oa rée.
Pour conc lu re su r l es "espaces funé -ra i res " , no tons en f i n que d 'assez nom-breuses découver tes ne sont pas local iséesavec préc is ion dans la l i t térature ancienne,et que d 'aut res ont eu l ieu en p le in cæur del 'espace urbain : i l s 'ag i t de remplo is .
Lrs nnooss DË sÉPULTURE
Les progrès récents de l 'archéologie fune-ra i re démontrent à lo is i r que r ien n 'ests imp le dans ce doma ine ; bon nombre deschémas t roo s impl is tes ont a ins i é té remisen cause ces dern ières années : on sa i t parexemp le au jou rd 'hu i que , sous l e Hau t -Empire, ont pu coexis ter inhumat ions etinc inérat ions, que l ' inc inérat ion a pu perdu-rer dans cer ta ins s i tes b ien au-delà desf ront ières chronologiques qu 'on lu i ass igne
sénéra lement . Toutes les étudesdémon t ren t éga lemen t
o t ) e n À r d e l à r e r t a i n s
t r a i t s c o m m u n s àtoute une région,
i l a pu ex is teroes usageslocaux, moinsa t y p i q u e sq u ' i l n epour ra i t ypa raître àp r e m i è r e
vue, des "d is-
tors ions" m u l -t ip les, r iches de
sens, par rapporT
d 'évo lu t i on des r i t es funé ra i res dansl 'Emo i re .
C'est donc à l 'échel le locale, à l 'échel led 'un s i t e donné , d 'une communau té huma i -ne rédu i te , qu ' i l conv ien t au jou rd 'hu i de ra i -sonner avant d 'émet t re quelque généra l i téque ce so i t ; sans ce la , on r i sque d 'app l i que rt rop mécaniquement de grands pr inc ipesque presque toutes les études par t icu l ièrestenden t à n ua nce r a u jou rd 'h u i .Malheureusement , à Nasium, la documen-tat ion est t rop lacunai re pour ent revoi r lamoindre évolut ion, pour sa is i r le schémagénéra l e t les s ingular i tés qui l 'accompa-gnent presque nécessai rem€î t : nous 5om-mescondamnés à t ravai l ler sans perspect i -ve d iachronique, dans l 'abst ra i t . On ne t rou-vera donc ic i qu 'une synthèse cr i t ique dessources anciennes ;ce t ravai l n 'est pas pourautant inut i le car i l pourra peut-êt re ?repa 'rer un t ravai l d ' invest igat ion à veni r , sur leterrain cette fois.
I Les sépul tures à inc inérat ions
Typalagie : coffres ef cistesOn possède quelques descr ip t ions assez
préc ises d ' inc inérat ions ; mais leur ut i l i téest réduite : î 'ont en effet été décrites quecel les qui présenta ient un mode de protec-t ion spécia l , les cof f res monol i thes en p ier redest inés à recevoi r l 'u rne et les tombes àc is te. l l n 'est jamais fa i t ment ion de sépul -tures à inc inérat ion en p le ine ter re, a lorsque la p lupar t des fou i l les de nécropolesrégionales ont démontré qu ' i l s 'ag issai t dutype le plus courant. A Cutry, en pays trévire,au nord du dépar tement de Meurthe-et -Moselle, les coffres monolithes représen-tent moins de c inq pour cent de l 'ensembledes séoul tures à inc inérat ion exhumées etl es aménagemen ts en c i s te , mo ins d -quar t : les deux t iers des sépul tures éta ient
Fig.4 : lncinération en coffre.Mise en scène avetla verrerie du site.
Musée Barrois.Cliché P-4. Martin.
au schéma généra l
en p le ine ter re, les ossements ayant étédéposés, la p lupar t du temps, à même le so l-protégés par un réc ip ient ou un sac enmat iè re pé r i ssab le ? - ou dans une u rne encé ramique , pa r fo i s s imp lemen t dans unfond de vase'7. Ce type est également majo-r i ta i re dans la nécropole du Vieux-Pâquis àD ieu loua rd -Sca rponne (Meur the -e t -Mosel le) , en ter re leuque cet te fo is ' ' . l l n 'enva pas différemment en dehors des fron-t ières régionales : l 'exemple de la nécropoled u C h a m p d e l ' l m a g e à A r g e n t o n - s u r -Creuse/Argentomagus est de ce point devue par t icu l ièrement éc la i rant . Avant quene débute la fou i l le , dans les années so ixan-te, la nécropole éta i t dé jà connue, notam-ment grâce à p lus ieurs s tè les funéra i res et àdes cof f res c inéra i res de p ier re qui avaientété découver ts au XlX" s ièc le; on aura i tdonc pu penser que ce mode de protect ionéta i t t rès courant dans ce c imet ière : pour-tant la fou i l le n 'en a l iv ré que c inq en p lace,Dour un to ta l de o lus de cen t - so i xan tetom bes fou i I lées''. A Arg e ntom ag us, commeà Naix , on vo i t donc que les in format ionsrappor tées par les érudi ts locaux du XlX"siècle, intéressés surtout par les vestigesmatér ie ls les p lus " remarquables " , ont poureffet de déformer la réali té des " esDacesfuné ra i res " ; une réa l i t é nécessa i remen tcom p lexe pu i sq ue vo i s inen t des modesd'ensevel issement très va ria bles.
Nous n 'avons donc d ' in format ions ut i l i -sables que pour des tombes que l 'on peutconsidérer comme " except ionnel les " , qu ine sont oas le ref le t de la norme en cedomaine, e t ce la même s ' i l do i t ex is ter unere lat ion entre la propor t ion de sépul turesen coffre dans les " nécropoles " et la pré-sence, à prox imi té, de carr ières explo i tab leset faci lement accessibles, un fait avéré àNasium'o.
Un dess in de F. L iénard permet d ' imagi -ner comment se présenta ient or ig ine l le-ment ces incinérations en coffre. Le conte-nant de p ier re, rectangula i re et so igneuse-ment ta i l lé -comme c 'est souvent le cas- ,é ta i t en te r ré dans l e so l ; u f l € ra inu reindique qu ' i l é ta i t dest iné à recevoi r un cou-ve rc le de p ie r re qu i , sans dou te , deva i témerge r en pa r t i e du so l pou r i nd ique r l asépul ture. A l ' in tér ieur , une urne contenai tl es ossemen ts ca l c inés :dans un seu lcas . auCul du Breui l , on nous rappor te que lescendres éta ient p lacées à même la p ier re.Les coffres signalés -on entend par là la par-t ie inférieure du coffre, le couvercle ayant lep lus souvent d isparu b ien avant la décou-ver te- sont généra lement quadrangula i re ,de p lan ca r ré ou rec tangu la i re , ma isL. Maxe-Wer ly rappor te également ladécouverte de pierres cyl indriques' ' , et, dansles réserves du Musée Barrois {f ig. 4), unexemplaire, qui provient sans doute de Naix,est de forme hexagonale. lls n'excèdent jamaisune quarantaine de centimètres de haut; leplus large dêntre eux, celui du Cul du Breuil , aquarante-six centimètres de largeur sur songrand côté. Les trois qui sont conservés dansles musées départementaux (un au Musée dela Princerie à Verdun, deux dans les réserves duMusée Barrois) sont tous tai l lés dans le calcai-re ool i th ique local , la p ier re d i te " deSavonnières ".
On ne possède q u'u ne description de tom beà ciste. Elle a été découverte au Breuil en 1884 :elle consistait, selon L. Maxe-Werly, en " (...)quatre pierres sciées, dènviron o,o4m dépais-seur et de o,z3 m en carré, [à côté se trouvait]une cinquième servant de couvercle, entai l léevers ses bords d'une rainure destinée à mairr-tenir dans leur écartement les Dierres latérales( . . . ) ,ce monument aura i t également contenuune urne c inéra i re " " .
r7 : D 'après A. L iéger ,199718 :Y Burnand, 199q p . 182.r9 : A la i ' . L Fardue l , M. Tù ' feâu-L ib 'e e r a .1992 ; quinze au total donc, avec ceux découverts au Xlxe siècle.20 : l l ny a que que lques k i lomèt res deNas ium aux g isements exp lo i tab les de ca lcâire dit " de Savonnières ".
21 : L. Maxe'Werly, r885, p. 112.22 : L. Maxe-Werly, r885, p.112.
Les urnes cinérairesLes seules urnes c inéra i res conservées. ou
dont on possède une descr ip t ion déta i l lée,sont en verre ; on a là encore une preuve f la-grante de la sé lect ion des in format ions quenous évoquions p lus haut : en ef fe t , dansles néc rooo les du no rd -es t de l a Cau lequand urne i l y a , e l le est généra lement encéramique commune, souvent gross ière.A ins i à A rgen tomagus , au Champ del ' lmage, on n'a retrouvé que sept urnes deverre'r ; à Cutry, aucun récipient de verre n'aété ut i l isé pour recevoi r les cendres, les raresverreries com plètes retrouvées a ppa rtena ntaux dépôts secondai res de c inq tombes'a.Pour prendre des exemples de nécropolest rès récemment publ iées, on c i tera le casdes Sagnes à Pontar ion, dans la Creuse, oùt ro is tombes seulement , sur t ro is cent c inqexhumées, présenta ient une urne de verre 'S
où cel le de la Ci tadel le , à Chalon-sur-Saône,où les urnes de verre sont, certes, plus nom-breuses, mais t rès lo in de concurrencercel les de céramioue
Notons que ces récipients étaient parfoisbouchés. Pour ce la, un tesson ou un fond devase éta i t généra lement employé. Dans uncas toutefo is , on s ignale un mode de pro-tect ion p lus rare puisqu ' i l s 'ag i t d 'un cou-verc le de p lomb, sur lequel nous rev ien-drons car i l avai t Ia par t icu lar i té de por terune inscr ip t ion. Un autre cas, décr i t par C.-F.Denis , est également atyp ique ; l 'auteurnous rappor te que l ' urne éta i t p lacée dansun coffre et que la part ie supérieure ducoffre, pour une fois encore en place aumoment de l a découve r te , é ta i t mun ied'"(.. .) une protubérance len sonl centre (.. .)laquel le s 'appl ique sur l 'urne et la ferme"" .La conceotion du coffre était donc condi-
Fig.5 : Urnes en verre de deuxtombes à incinération.l"-lll" s.
Musée Barro!s.Clithé P.-A. Martin.
&--
lliH,triÏ,fnÙt '{Luf
Fig.6 : Couvercle de tombe en plomb avec inscription.Découverte XIX s.
Dessin extrait du manuscrit du Musée Barrois(1. Maxe-Werly, sd., x).
t ionnée par l 'urne qu ' i l é ta i t dest iné à rece-voi r ; ce la éta i t - i l rendu poss ib le par l 'u t i l i -sat ion exc lus ive d 'un seul type d 'urne ? Eneffet, à u ne exception près, toutes celles q uenous connaissons sont d 'un genre unique, àpanse pommiforme, p ied annula i re et décorde côtes'E {fig S).
Pour terminer à propos de ces urnes,notons que, dans deux cas, e l les éta ientl iées, à l 'a ide d 'arg i le , à leur suppor t de p ier -re : un témoignage de p lus du grand so inapporté à la conception et à la protectionde ces tombes qui , rappelons- le , ne peuventêt re considérées comme la norme.
Les offrandesOn a t rès peu d ' in format ions sur les
offrandes qui accompagnalent Ie défunt.Dans un cas seulement , la sépul ture du Culdu Breui l , i l est fa i t ment ion d 'é léments quiont pu appar teni r au dépôt pr imai re, c 'est -à-d i re aux objets je tés sur le bûcher aumoment de la crémation, et donc retrouvésbr isés et ca lc inés. C. - F. Denis a donné ladescr ip t ion de cet te tombe ; i l s 'ag i t d 'uncoffre avec son couvercle: à l ' intérieur, àmême la cav i té , i l a remarqué " ( . . . ) quant i téd 'os humains, tous f r iab les et restes decombustion ; des tessons d'urcéoles lc'est-à-d i re de céramiques] rouges, des cendres,de la ter re ( . . . ) , deux coqui l les qui forment leb iva lve d i t pe igne, lesquel les sont b ienintactes" 'e . On ne peut êt re cer ta in quecet te dern ière of f rande a appar tenu audépôt pr imai re ou au dépôt secondai re,c'est-à-dire aux objets placés dans la tombeau moment de l ' enseve l i ssemen t ; quo iqu ' i len so i t , la présence de ce coqui l lage n 'apas de quoi é tonnef : on s ignale en ef fe tdes ves t i ges i den t i ques dans de nom-breuses nécropoles, comme à Saint -Pau' -Trois-Châteaux dans la Drômer'. S. Leoetz
remarque d 'a i l leurs qu ' i l est t rès probableque ces restes de mol lusques, qu i n 'ont b iensouvent guère att iré l 'attention, ont été enréal i té p lus nombreux dans les sépul turesgal lo- romaines qu 'on ne pourra i t a pr ior i lepenserr ' .
Du dépôt secondai re on ne sa i t pas grandchose non p lus : là encore, ce sont les objetsles p lus " remarquables " qu i ont a t t i ré l 'a t -tention. À l 'exception d'une lampe en terrecui te , o f f rande courante dans les sépul ture -une tombe à mobi l ier sur deux en contenai tune à Saint -Paul -Tro is-Châteaux3' - , à va leursans dou te fo r temen t symbo l i que , l esseules of f randes que l 'on s ignale sont env€f fe : i l s 'ag i t de " ba lsamaires " de formesvariables:3. Ces petites f ioles (f ig.7), que l 'onqual i f ia i t aut refo is de " lacrymato i res " care l les aura ient é té dest inées à recuei l l i r lesdernières larmes du défunt'4, contenaientcer ta inement , pour une bonne par t d 'ent reel les, des par fums et des onguents ; lesétudes récentes démontrent égalementqu 'e l les pouvaient recevoi r d 'aut res sub-stances, malheureusement d i f f ic i les à iden-tifier.
Les ssseffients des défuntsLa seule in format ion à ce su iet est ind i -
recte : i l s 'ag i t d 'une inscr ip t ion ( f ig . 6) , quenous avons déjà signalée, gravée sur le cou-verc le de p lomb d 'une urne de verre : i ly estécrit que les ossements d'une certaine lul iaMdlis et de sa mère, tVais, y étaient mélan-gés" . Ce texte, except ion nel , renvoie,comme le notait L. Maxe-Werly, à un usageb ien a t tes té pa r l a l i t t é ra tu re an t i que :Suétone rappor te a ins i que la nourr ice deDomit ien, Phyl l is , f i t déposer les cendres del 'empereur , après sa mort , dans l 'urne quicontenai t dé jà ce l les de lu l ia , f i l le de sonfrère Titusr6. Cette pratique qui consiste à
23 : De type lsings 94 ; voirV Arveil ler-Dulong dans Allain, l. Fauduet, M.Tuffeau-Libre et a1., 1992, p. 145-147,fi9. 52.24 : A. Liêget., 1997, p. 66.) ( . l i n f T e f r l
z6 :Augros, Feugère (di.),zooz.27 : C. F. Denis, 1819, p. i +3-1 44.28 | l l s'agit du type lsings 67c (lsings, t957,p .88 ; éga lement Mor inJean,1913, p .5o-5r ,f ig. 25, type 5) : ce type d'urne, courantdans le Nord de la Cau le , <e rencon l re rar lde la f in du le r s ièc le au début du l l l esiècle ; voir Arveil ler, Arveil ler-Duiong, 1985,p. 85-86. l l n y a qu'une exception, uneurne dessinée par le Comte de Caylu5(Caylus, r762, p. 3r8-3r9, pl. CXIV h.-t.), à lapanse presque sphérique : i l s'agit du type94 d'lsings, dont les exemplaires connusdans le Nord de la Cau le o r [ é té reLrouvesdans des contextes archéologiques datésde la fin du ler siècle au lve siècle.29 : C. F. Denis cité par L. Maxe-Werly, s.d.,f' 245.30 :Vo i r Be l e t a l . ,2oo2, p .13731 : 5. Lepetz dans A. Ferdière (dir), r993,p 42.32 . Bel eï al., 2oo2, p. i44-145.33 : l l s'agit des types lsings 8 et 28b essen-t ie l lement .)4 tOvide, Fastes, lll, 561.l5 : C . l .L . , X l l l ,4 640.36 : Suétone, Dom., XVll.
278 mélanger les ossements de p lus ieurs per-sonnes, sans doute apparentées, est égale-ment bien attestée par les études ostéolo-g iques menées aujourd 'hu i systémat ique-ment lors des fou i l les de sépul tures : auChamp de l ' lmage à Argentomagus, Ôouzetombes à i nc iné ra t i on con tena ien t a ins io lus ieurs défunts , e t dans d ix d 'ent re e l les, i ls 'ag issai t préc isément d 'un adul te et d 'un "
jeune " . Dans le cas présent , on ne sa i t s i lescendres des deux défuntes ont é té p lacéesd a n s l ' u r n e s i m u l t a n é m e n t o u à d e smoments différents.
Ce bref tour a'f 'oriIn suffit à démontreroue nous ne savons f inalement que trèspeu de choses. Nous ne d isposons d ' in for -ma t ions conséquen tes que su r l es sépu l -tures " remarquables
" , e t , ces in format ionst rès incomplètes : aucune notat ion sur la
nature des ossements, leur aspect (é ta ient -
i ls t r iés et lavés ou p lacés dans l 'urne pêle-mêle avec les cendres du bûcher ?) ; peu depréc is ions sur l 'éventuel mobi l ier (por ta i t - i ldes t races de c rémat ion ? 5 'ag i t - i l d ' undépôt pr imai re ou secondai re ?) Inut i le depréciser que le contexte de la découverte
Flg. T : Fides en verre.("halsa'ma!res") pravenant des tombes ainrtqé"atia" de ' 'nqq!omé'a icn
Musée 8ûffilis.tlichés P.-A. rtAçttir.
(traces de rubéfaction au sol) présence demobi l ier hors du cof f re- n 'est jamais décr i t .Seule l 'ouver ture de nouveaux sondagesdans les d i f férents espaces funéra i res per-met t ra de répondre aux problémat iquesactuel les de recherche.
I Les inhumat ionsl l est b ien présomptueux de notre par t
d 'u t i l iser ic i le p lur ie l : en réal i té , i l n 'y aqu 'une sépu l tu re à i nhumat ion que l ' onpuisse dater , en toute cer t i tude, de l 'époqueromaine. 5 i l 'on s ignale la découver te dansl 'espace funéra i re ouest , en. même tempsque ce t te tombe , d 'une d i za ine d ' i nhuma-t ions en sarcophage de p ier re, un moded'ensevel issement qui , rappelons- le , n 'estpas uniquement réservé à l 'époque méro-v ing ienne - ce qui est à l 'or ig ine de b ien desconfusions | - r ien n'est conservé du maté-r ie l qu 'e l les contenaient , ce qui in terd i t b iende les dater avec préc is ion. . .
Notre inhumat ion a été découver te eni85z : i l s 'ag i t d 'un sarcophage en p lomb" (
) d e g r a n d e d i m e n s i o n [ d a n s l e q u e l ]étaient rassemblés des objets divers, desplats en terre cuite rouge et en gris, desvases à panse, des coupes en verre de formegrac ieuse, un peigne d ' ivo i re for t cur ieux,une st r ig i l le , des f ragments de lacryma-toires en verre, des grains et des chaînettesde co l l i e r s , une l unu l l e en a rgen t , r3o à r5opet i ts bronzes de Constant in " r ' . B ien que lematér ie l a i t é té rap idement d ispersé - lesm e m b r e s d e l a C o m m i s s i o n d u M u s é eBarro is se p la ign i rent d 'a i l leurs amèrementque l ' ins t i tu t ion so i t t rop pauvre pour pou-voi r s 'en rendre acquéreur l - e t que le sarco-phage a i t é té fondu deux ans p lus tard, ledépô t moné ta i re , a ins i que l ' usage d ,p lomb, ne l a i ssen t aucun dou te su r l a da ta -t ion de cet te sépul ture : lAnt iqu i té tard ive,
et sans doute le lV" s ièc le. Ce qui est remar-quable ic i , c 'est la r ichesse du dépôt : e l ledémontre b ien que de te l les sépul tures,nécessai rement coûteuses, ne pouvaientêtre réservées qu'aux classes sociales resp lus a i sées .
l ] ruorcnnoN DE LA ToMBE
La major i té des sépul tures semble avoi rété indiquée au sol : on constate en effet,dans de nombreuses nécropoles, qu 'e l les nese recoupent pas -mais ce n'est pas toujoursla règ le non p lus- , même quand la pér ioded'ut i l isat ion a été longue. Ce marquagen'est que rarement repéré lors des fou i l les,et ce la pour d iverses ra isons : tout d 'aboroparce qu ' i l a pu s 'ag i r de matér iaux pér is-sa b les, com me le bois -on a même évoo ué rapossib i l i té d 'arbres ou d 'arbustes, de haies-ou d ' insta l la t ions qui , par leur modest ie -assemb lages de tu i l es , amas de p ie r res -n 'ont pas at t i ré l 'a t tent ion des archéo-logues ; ensui te parce que ces s t ructures,qui émergeaient du so l , ont é té les pre-mières à d isparaî t re avec le temps. Commebien souvent a i l leurs, ce n 'est donc que laforme de marquage de la tombe la p lus "
nob le " qu i es t connue à Nas ium, la p lusapte à rés is ter au temps : le monument oepierre sculpté oulet inscr i t . P lus ieurs typesde p ier res tombales sont a t testés.
t Les stèles-maisorisl l y a tout d 'abord ce que l 'on appel le la"s tè le-maison" , mais qu ' i l est préférable de
qual i f ier de "c ippe en forme de maison"r3.Rappelons br ièvement ce qui caractér ise cetype de monument funéra i re : tout d 'abord-et ce la pourra i t sembler une lapal issade s ile terme n'était employé fréquemment àtort et à travers-, ces monuments ont la
279
Fig.8 : Epitaphe de Matcus6 rçecu s. Cs | ffi i re aol ithiq ue.Musée Barrois. Clicl,të F.A. &tlnrtin.
J / : Le l l re de l - . Be l Io l -herment ad e5see aLpréfet ie 28 mars 1852, copiée dans L. MaxeWerly, s.d., f 26r.J8 : À la d i f fé .ence de ,a s tè le g réco- roma -ne, ces cippes ont en effet des faces laté-raJes f réquemment p lus la rges que leurfaçade.
Fig.10 : Monurnent funéraire de Paterna. Calcaire ooli^thique. découverte XIX' s. Musée de Verdun'
Cliché P.-A. Martin.
780
iFrg" g : lkicr..urrlr nt J'ut'!âr{:t,{r
r ' ç t t â<e , t i on f . n i ; j tYq ; ' t ' 4 r ' .
" i ; t t - : t g f r " nn ! ( r 1 , , ' n l ' , ! e v ' "
sa rc.aysli a g *. Sirc:;vnrfe'{i'.d' s.
Dessir". *xficil rCu nianus$il GuM ' ' ' ' 3 r ' r " i '
:1. N\i;xe-WrrlY, sd." x).
3 9 : A u c h e m i n d e L i g n y ; v o i r L . M a x e -Wer ly s.d.
' z16
4 0 : 5 ù r c e r i l e . v o i ' o a e / e - p e J - l T " L t1951' p.15'77
4 1 : E . L i n c k e n h e l d , 1 9 2 7
42 : J. N. Castor io, 2oo3.
4 J . ' . L e n a r d . 1 8 8 1 0 r 8
44, C. l .L. ,Xl l l , 4701, au Musée départemen
t a l d e s V o s g e s à E P i n a l .
4 5 : F . L i é n a r d , 1 8 8 r , P 3 7
46 : C.-F. Denis dans L. Maxe-Werly, s d , f"243
forme d 'un édi f ice, qu ' i l s 'ag isse d 'une caba-ne, d'une insula, voire d'un petit templum ;ensui te , i ls sont l iés au r i te de l ' inc inérat ionet présentent donc à Ieur base une cav i té , leIoculus, destiné à recevoir la part ie supé-r i eu re de l ' u rne qu ié ta i t posée dans un réc i -p ient de p ier re. Ces c ippes ne sont donc queles couvercles des coffres que nous avonsd é i à e x a m i n é s ; d ' a i l l e u r s l ' u n d ' e u x , m a l -heu reusemen t pe rdu , semb le avo i r é tét rouvé en p lace dans l " 'espace funéra i re"ouest , pu isque L. Maxe-Wer ly rappor te quela sépul ture, contenue dans le cof f re c iné-raire,arborait un couvercle de forme " pris-mat ique " re. Une autre caractér is t ique deces monuments est qu ' i ls présentent f ré-quemment , à leur base, un pet i t condui t qu imène au loculus: ce condui t est le témoi-gnage d'un ri te, celui des profusiones, quiconsis ta i t à veni r régul ièrement fa i re desl i ba t i ons en l ' honneur du dé fun t su r sasép u l tu reo".
Deouis l 'é tude d 'É. L inckenheld4r , on sa i toue ces p ier res tombales sont sur tout f ré-ouentes dans la "c i té ' des Médiomatr iques,au no rd de ce l l e des Leuques à l aque l l e serat tachai t Nasium ; un pré-recensemente f fec tué récemment Pa r nos so lnsdémontre toutefois que cette dernière
" cité" a l iv ré un nombre considérable de " c ippesen forme de maison ", la majorité n'étantm a l h e u r e u s e m e n t c o n n u e q u e P a r d evagues descr ip t ionso ' . Les deux exempla i resprovenant de Nasium sont actuellementconse rvés au Musée de l a P r ince r ie àVerdun ; i ls ont é té découver ts en remplo id a n s l ' e s p a c e u r b a i n , a u l i e u - d i t l e sTussottes4r. l ls sont de forme courante, l 'und 'eux ayant l 'aspect d 'une cabane, l 'aut red 'un pet i t temple ( f ig . tz) .
l l est inut i le de chercher à c lasser chro-nologiquement ces formes, comme l 'avai tf a i t É . L inckenhe ld : tou t i nd ique en e f fe t
que les types apparemment les p lus pr imi-
t i fs , comme la cabane, ont pu vo is iner avecdes formes beaucoup p lus complexes.
ffi Les stèlesSecond type de p ier res tombales : les
stè les. C 'est le type le p lus courant en
Cau le , où i l a connu un succès cons idé rab le .l l s ' a g i t s i m p l e m e n t d ' u n e d a l l e , d o n tl 'épaisseur est tou jours in fér ieure à la lar -geur en façade; cette dernière, souventp lus hau te que l a rge , es t généra lemen tdestinée à recevoir les eff igies funéraireset /ou une inscr ip t ion. Le type gal lo- romainde la s tè le est d 'un genre s impl i f iê par rap-po r t à ce lu i qu i es t en v igueur dans l emonde gréco-romain : à l 'except ion de lan i che , l es é lémen ts a rch i tec ton iques -
p i last res, f ronton- , qu i caractér isent la s tè lec lass ique sont en ef fe t souvent négl igés.Les s tè les de Naix sont , pour l 'essent ie l , per-
dues ; on ne conserve d 'e l les que des f rag-ments, par fo is une photographie ou desdessins i f ig . g et i r ) . Notons que sur les t ro ismonuments reprodui ts f ig . l : , les défuntssont représentés à mi-corps a lors que dansla t rès grande major i té des cas, dans la
région, i ls sont f igurés en p ied, à l ' image dudéfunt de la p ier re tombale présentée f ig ' 9 .
Plus ieurs de ces monuments témoignentd 'une "contaminat ion" de la s tè le par le"c iooe en forme de maison" : sur les s tè lesrep rodu i tes pa r F . L iéna rd , on vo i t pa r
exemple le condui t en façade qui caractér i -se les "s tè les-maisons" ; Çuant aux propor-t ions de ces monuments, peu aér iennes,el les évoquent aussi cette forme. La stèle dePaterna, au Musée de Verdun, en est peut-êt re le mei l leur exemple de cet te contami-nat ion { f ig . r l } :ce pet i t monument conser-ve l 'év idement in terne qui caractér ise les "
c ippes en fo rme de ma ison " , a ins i que l es
t . /
, t;
: t
t ' " '
,-!{,*-;^"":^;
. t i ,
. , .i l
r':"'
.li,
%*';.-=-
proport ions de ce type, même s' i l a déjàpe rdu beaucoup de son épa isseu r ; l a faça -de, composée de regis t res superposés, lerat tache en revanche à la s tè le c lass ioue. Onremarquera également la pos i t ion atyp iquede l 'ouver ture à l ibat ions, en p le in mi l ieu dela façade; e l le éta i t , à l 'or ig ine, bouchée àl ' a ide d 'une p ie r re mob i l e au jou rd 'hu id i spa -rue.
Une des p ier res tombales de Naix estassez atypique (f ig. B) : i l s 'agit d'une simple"borne" -on préférera ce terme à ce lu i de"stè le"- por tant l 'ép i taphe. Ce type, malgrésa s impl ic i té , est t rès rare .dans une régionoù l e g rand nombre de monumen ts scu lp -tés témoigne de la préférence accordée àl ' image p lutÔt qu 'à l 'écr i t : on en t rouve tou-tefo is un exempla i re presque ident ique àSoulosse-Sol ic ia (Yosges) , agglomérat ionsecondai re de la c i té des Leuoues s i tuée àune quaranta ine de k i lomètres de Nasium,, .
A côté de ces formes de marquagesimples -mais déjà except ionnel les puisquerares éta ient sans doute ceux qui avaientles moyens de payer une p ier re tombale- , onconserve la t race d 'un monument funéra i red 'une toute autre amoleur .
LA , ,ToMBE MoN UMENTALE ' '
D U C U L D U B R E U I L
La découverte a eu l ieu en r845, lors dest ravaux de c reusemen t du cana l de l aMarne au Rhin ; les recherches que nousavons menées en compagnie de F. Mourotpermettent de resituer cette découvertedans le fond de la va l lée, au p ied de l 'oppi -dum de Bovio l les, e t non sur la côte commel'avait écrit F. Liénardo'. C. - F. Denis, qui serendi t sur les l ieux après la découver te,nous rappor te qu" ' ( . ) un immense monu-
men t a dû ex i s te r j ad i s à ce t end ro i t ;ma ison n 'a eu besoin d 'en at taquer qu 'une par-t ie . l l é ta i t c i rcu la i re , car les b locs sont appa-re i l lés en courbure, e t , comme cel le-c i estfa ib le , ce la i nd ique un l ong c i r cu i t " ; p luslo in , i l rev ient sur ce monument en préc i -sant que l " ' ( . . . ) on a abat tu une épaissemaconner ie . Dans son massi f se t rouvai tune médail le moyen bronze de Tibère aurevers de I 'autel de Lyon"+e ; suit enfin la des-cr ip t ion de l 'ensemble du matér ie l exhuméet notamment des sculotures.
On a proposé d iverses in terprétat ionspour ces vestiges : C.-F. Denis croyait à unetour ou à un for t in ; Th. Oudet a émis l 'hy-pothèse d'un édif ice de spectacle. La naturedes sculptures découver te i ne la isse pour-
Fiû. n : Stàles f$nérû i resa persan**ges.të{auvette KIX' s. {:Hvu{esextraites de F. Lienard, t8&t.
l:ig. rz : Monument lunèraire deCl*uriia lbrtia. Ca!r*ire *aii-thique. Découve{Le X;X" \. Musépde Verdun. tlirhë P^A. Mnrtirs.
Fig. B : Frise de la tombe monumentale. Calcaire ooli-thique. Musée Barrois. cliché P-A Martin.
Fig.14 : Stlhinx orncnt la t*mbe rnonur*entçle"Mttsée Sarrais. tliché P.-A. Mçrtin'
282
47 : Landes (d i r ) ,2oo2, p 33 , p l . lV V
48 :5ur ces " tombes monumenta les , Insp i rées du tumulus , vo i r Von Hesbefg , 1992 '
p. g4-1B,fig. 49-62, et Ctos,2oal, p.422 435,f ig .5o3-528
49 r Renard ,1950.
50 1 . LàvaBne. ' Les -asq-e< fu rer r re '
dans Landes (d i r ) , 1989.
5 .Vo i r M ig-o ' :ooo. p .5z-s1 . t ig .
monumenta le" r ichement décorée. En ef fe t ,la sphinx ( f ig . r4 i e t le masque de théâtre
{ f ig . r7} re t rouvés a lors appar t iennent aurépe r to i re c lass ique de l ' a r t f uné ra i reroma in . La tombe monumen ta le c i r cu la l rede Nasium n'est pas isolée. On connaît dansle nord-est de la Caule p lus ieurs édi f ices dep lans e t de d imens ions p lus ou mo ins com-p a r a b l e s : l ' i m p o s a n t t o m b e a u d i t " d e
Drusus" à Mayence, par exemple, ou les éd ' -f i ces d i t s " t emp les de P lu ton e t deProse rp ine " dAu tun , des tombes monu-menta les c i rcu la i res en fa i t dont le d ia-mètre avoisine trente mètres47' Les sourcesd ' insoi rat ion de te l les s t ructures sont vra i -semblablement à chercher à Rome même,et l 'on songe notamment au " mausolée "
dAuguste ou à celui deCaecil ia Metel lao'.AuMusée de la Cour d 'Or à Metz sont egale-
Le tombeau de Nasium éta i t r ichementdécoré, comme le montrent les b locs auxd imens ions impor tan tes conse rvés auMusée Barro is ( f ig . r3 et r5) . La sphinx,comme le masque, sont des "ponci fs" del 'ar t funéra i re ; leur or ig ine est à rechercherdans l e monde méd i te r ranéen . La sph inx ,par exemple, se retrouve en acrotère auxang les de que lques monumen ts d ' l t a l i e duNord, notamment à Sars ina ; ce thème aconnu un f ranc succès en Caule, comme ledénrontre la consultation du Recueil d'E.Espérandieu et de R. Lant ier , à te l po int quel 'on a imaginé qu ' i l avai t acquis , dans cet terégion, une s ign i f icat ion propre4e : l 'exem-p la i re de Na ix , assoc ié à un monumen t don tles prototypes sont sans doute à rechercheren l ta l ie , ne se prête guère à une te l le lectu-re. l l en va de même pour le masque théâ-t ra l , thème courant lu i auss i e t que l 'on aéga lemen t c ru " ce l t i sé " : H ' Lavagne arécemment dressé l ' inventa i re des sculp-tures de ce type en Caule ; i l a recensé qua-ran te -s i x exemp la i res comparab les , endimensions, à ce lu i du Musée Barro is , dontla majorité provient de Narbonnaise5". C'estv is ib lement dans cet te d i rect ion géogra-phique qu ' i l convient de chercher les éven-tuels modèles du mausolée de Nasium, etsans dou te au -de là , ve rs l a p la ine padane ;les para l lè les ex is tants avec les édi f ices deCucuron dans l e Vauc luse e t Sa rs ina , ma iségalement avec ceux qui ont é té récem-ment mis au jour à Orange5' , mi l i tent en cesen 5.
Nous ne saur ions proposer ic i de data-t ion pour cet éd i f ice puisque le matér ie lest encore en cours d'étude : on s'orientetoutefo is , sur la base des para l lè les quenous venons d 'évoquer , vers une réal isa-t ion précoce.Une dern ière remarque sur la pos i t ion de
men t exposés l esvest iges de Plu-
s i e u r s é d i -
. Ï lces Ïu ne-r a i r e s d e
l 'édif ice : comme c'est fréquemment le cas,i l se t rouve à peu de d is tance d 'un grandaxe, ic i la vo ie Reims-Toul , de laquel le i l é ta i tcer ta inement v is ib le . l l se t rouve t rop lo indu Breui l -p lus de c inq cents mètres- pourque l ' on pu i sse imag ine r qu ' i l a é té en re la -t ion avec cet "espace funéraire" ; la photo-graphie aér ienne a permis, en revanche, derepérer, à moins de deux cents mètres, unvas te éd i f i ce suburba in composé d 'unegrande cour enc lose avec, sur l 'un de sescôtés, une série de grandes pièces : cettedemeure (?) , apparemment r iche, a t -e l leavec la " tombe monumenta le" ?
CONCLUSION : ET LES MORTS DANsTOUT CELA ?
On l 'aura compr is : on ne sa i t presquer ien d 'eux ; l es seu ls su r l esque ls on possèdeque lques i n fo rma t ions son t ceux qu ié ta ien t su f f i samment a i sés pou r ou 'unmonumen t en p ie r re so i t é levé à l eu rmémoire, e t ces monuments sont , commeon l 'a vu, b ien peu nombreux. [ép igraphiefunéra i re n 'est que de peu de secours. On nep o s s è d e a i n s i q u e q u e l q u e s é p i t a p h e sbrèves et s téréotypées, com me c 'estpresque tou jours le cas dans le nord de la
C a u l e : t o u j o u r s l ' i n v o c a t i o n a u x D i e u xMânes, abrégée D.M., au nom du défunt e t àsa f i l i a t i on . R ien de p lus ; r i en en tou t casqui nous permet te de. je ter les bases d 'uneétude soc ia le de la populat ion de Nasium.
F i n a l e m e n t , l e p r i n c i p a l a p p o r t d u"monde des morts" à ce domaine est l 'ex is-tence avérée d 'une grande " tombe monu-menta le" : e l le démontre qu ' i l ex is ta i t danscet te agglomérat ion une t rès haute bour-geois ie , dés i rant , jusque dans la mort , a f f i r -mer haut et fort sa " romanité ", et cela enempruntant d i rectement au monde médi-te r ranéen son symbo l i sme funé ra i re , l aforme de ses tombeaux. Et peut-être mêmea-t -e l le fa i t appel , pour ce la, à des ate l iersissus d ' l ta l ie du Nord ou de Narbonnaise.Mais ce que l 'on a imera i t savoi r c 'est qu iéta i t exactement le défunt honoré. ouel lesétaient ses fonctions, d'où l 'aristocratie àlaquel le i l appar tenai t t i ra i t ses revenus,quels éta ient ses l iens avec la campagneenvi ronnante, avec le " pet i t peuple " de l 'ag-g lomérat ion. O_uel é ta i t son rayonnementaussi . . . Autant de problémat iques qui do i -vent or ienter les fu tures recherches surNasium et les autres agglomérations de laLorra ine ant ique.
283
Fig. t5 : Fwgment de carnirh*tlécçrçnt la t*mbe mçnumentçle"A4usée Esrr*is. {lirtse F.-ê". Martin.
çig 16 :Vue de la foce û!'ttptiptt!pde ln sphinx. {lirhe F.-A. l\4rzrtin.
Fiç t7 : Masque funéy*ire mçnu-m I {?ta l. M çs*t Bç t{* ; s.ili:]zt P.-A. Mçrtin.