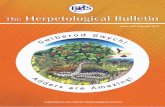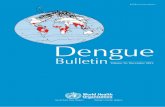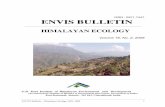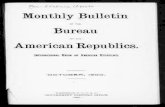Le bulletin des lettres2009 10
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le bulletin des lettres2009 10
Fondateur :A. Lardanchet
Ancien rédacteur en chef : V.H. Debidour
Rédacteur en chef, Directeur de la publication :Bernard Plessy
Editeur :Association des Amis du Bulletin des Lettres39 bis rue de Marseille69007 LYON
http://www.bulletindeslettres.asso.fr ou http://www.bulletindeslettres.fre-mail : [email protected]
Domiciliation :Crédit Lyonnais n° 01000 0000791571QIBAN FR72 3000 2010 0000 0079 1571 Q71BIC : CRLYFRPP
Impression : Imprimerie des Monts du Lyonnais69850 Saint-Martin-en-HautTél. 04 78 19 16 16
Dépôt légal :3ème trimestre 2009ISSN 0007-4489C.P.P.P.n°0505 G 79850
LACOUTURE Jean Les Impatients de l’Histoire Grasset 26
LARBAUD Valery Journal Gallimard 5
LE CHATELIER Hélène Dernière adresse Arléa 14
LECLERC Éloi Sainte Jeanne Jugan Desclée de Brouwer 46
LENOIR Frédéric Socrate, Jésus, Bouddha : trois maîtres de vie Fayard 46
LENTZ Thierry - MACÉ Jacques La mort de Napoléon Perrin 27
LEWERTOWSKI Catherine Les enfants de Moissac, 1939-1945 Rééd. Champs histoire 27
LIEBMANN Irina Berlin-Moscou-Berlin Christian Bourgois 28
MADIRAN Jean Histoire de la messe interdite Via Romana 47
MARIE Jean-Jacques L’antisémitisme en Russie de Catherine II à Poutine Tallandier 28
MARSEILLE Jacques L’argent des Français Perrin 35
MARTINEZ GONZALES Emilio Sur les traces de Jean de la Croix Cerf 29
MASSON Robert Elisabeth Lafourcade Sur les pas du P. de Foucauld Parole et Silence 47
MENTZEL Zbigniew Toutes les langues du monde Seuil 14
MINH TRAN HUY La double vie d’Anna Song Actes Sud 15
MORAZZONI Marta L’invention de la vérité Actes Sud 15
NODET Bernard Le Curé d’Ars par ceux qui l’ont connu F.-X. de Guibert 44
NOTHOMB Amélie Le Voyage d’hiver Albin Michel 19
NOVARINO-POTHIER Albine Cent poèmes d’un bestiaire enchanté Omnibus 41
PASCAL Caroline La femme blessée Plon 16
PAYAN Paul Entre Rome et Avignon - Une histoire du Grand Schisme Flammarion 29
PIERRON Jean-Philippe Le climat familial, une poétique de la famille Cerf 37
POULAT Emile Aux carrefours stratégiques de l’Église de France XXe siècle Berg international 38
POULIN Jacques L’anglais n’est pas une langue magique Lemeac Actes Sud 16
POUMIRAU Patrick Emportez-moi Robert Laffont 16
PUEL Hugues o.p. Les raisons d’agir Cerf 39
QUINSON Henry Moine des Cités : de Wall Street aux Quartiers-Nord de Marseille Nouvelle Cité 48
RAZOUX Pierre Histoire de la Géorgie, la clé du Caucase Perrin 30
ROCHE Marie-Jeanne Pétra et les Nabatéens Les Belles Lettres 31
ROGNET Richard Un peu d’ombre sera la réponse Gallimard 41
ROIG José Miguel Soleil coupable Mercure de France 19
SHAVIT Yaacov Faut-il croire ce que dit la Bible ? Albin Michel 48
SILVANISE Frédéric Langston Hughes, poète jazz poète blues ENS Editions 42
SMARTT BELL Madison La ballade de Jesse Actes Sud 17
SOLNON Jean-François Le turban et la stambouline Perrin 32
SORRENTINO Gilbert La Lune dans son envol Actes Sud 17
TASSIN Claude L’apôtre Paul, un autoportrait Desclée de Brouwer 49
THEROUX Paul Suite Indienne Grasset 18
VALENTIN Claude La fabrique de l’enfant Cerf 39
VELUT Stéphane Cadence Christian Bourgois 18
VENNER Dominique Ernst Jünger Éd. du Rocher 33
WESSELING Henri Les empires coloniaux européens 1815-1919 Gallimard 33
Le bulletin des lettres
••• Tarifs •••Abonnements
• 10 numéros (1an)
France ...................................49 €Etranger.................................52 €
• 6 numéros .............................30 €
• 3 numéros .............................15 €
• Etudiants (10 numéros)...............25 €
• Version virtuelle sur Internet ............................25 €
• Abonnement de soutien .............................76 €
Boîtes (une année par boîte)
• Ensemble 2 boîtes..................8 €
• Ensemble 5 boîtes ...............14 €
• Ensemble 10 boîtes..............22 €
Règlement à l’ordre del’Association des Amis du Bulletin des Lettres39 bis rue de Marseille
69007 LYON
Si vous souscrivez un abonnement-cadeau,veuillez préciser sur votre commande si voussouhaitez que le bénéficiaire sache, par nossoins, de qui il tient cet abonnement.
Toute reproduction doit mentionner « Extrait du Bulletin des Lettres - Lyon »
S ommaireOctobre 2009
� La vie du Bulletin
� Valery Larbaud, écrivain dégagé, par Pierre Charreton
PRISMEDes rêves et des noms, par Bernard Plessy
ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES
HISTOIRE, BIOGRAPHIESL’envers de l’histoire napoléonienne, par Rémy Hême de Lacotte
SOCIÉTÉPauvre France? Allons donc! par Michel Rustant
POÉSIE
SPIRITUALITÉ
VIE DES COLLECTIONS
� Index
50
43
40
20
34
8
6
Les ouvrages que les rédacteurs ont préférés dans ce numéro sont signalés par la vignette de leur couverture.
Ont collaboré à ce numéro:
Yves AVRIL, Pierre BÉRARD, Henri BONNET, Pierre CHARRETON, Jean-François CLERET, MichelineCOCHARD, Claire DAUDIN, Michel DEBIDOUR, Jacques FERRATON, Rémy HÊME de LACOTTE, HenriHOURS, François LAGNAU, Béatrice MARCHAL, Roger PAYOT, Bernard PLESSY, Pierre PUPIER, MichelRUSTANT, Marie-Hélène VALENTIN
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 1
2
Notre Comité de rédaction s’est réuni le 5 septembre pour préparer une rentrée litté-raire qui s’annonce chargée d’un flot d’ouvrages qui trouveront, nous l’espérons, l’échonécessaire dans le Bulletin de novembre. Mais sur la joie des retrouvailles a plané l’ombre(légère) de quelques déceptions. La première, faut-il le dire ? a dû atteindre notrerédacteur en chef. C’était le jour de son anniversaire. Un bel anniversaire en chiffres ronds.Il s’attendait à être fêté à la manière du Bulletin, c’est-à-dire avec générosité et discrétion.Il s’était imaginé que ses rédacteurs lui apporteraient, pour ce numéro, un Prismeétincelant et varié, une sorte de Mélanges en somme. Il en a été pour ses frais : rien ! Pasune ligne. Il ne lui restait donc plus qu’à remplir, de sa plume, la page restée blanche pardéfection de sa garde rapprochée. Dans ce Prisme de dernière minute, nul doute quetout l’art de B.P. se révélera dans la manière de masquer au lecteur ce qui pourrait laissersupposer une quelconque improvisation. Mais lisez-le de près. Peut-être sous le ton légerrecèle-t-il quelque éclat rentré d’humeur désenchantée… À vous de le découvrir.
Autre déception. Technique celle-là. Les vignettes signalant les livres qui ont eu lapréférence des rédacteurs dans le numéro d’août - septembre ont refusé de rentrer.Cette vacance nous amène à présenter nos excuses aux auteurs et éditeurs concernés,et à citer ici ce que nous n’avons pu signaler à temps et autrement. Dans la rubriqueRomans: Arnaud Delalande, Les fables de sang, Grasset ; Pierre Michon, Les Onze, Verdier ;Mario Soldati, L’incendie, Le Promeneur ; Antonio Tabucchi, Le temps vieillit vite, Gallimard.Dans la rubrique Histoire : Pierre Milza, L’Année terrible tome I La guerre franco-prussienne,Perrin. Enfin, dans la rubrique Mots et langues : Claude Hagège, Dictionnaire amoureuxdes langues, Plon/ Odile Jacob.
Et puis, un petit message sympathique et généreux est venu donner des couleurs ànotre courrier des lecteurs. Une charmante abonnée propose, par notre intermédiaire,« à qui en serait intéressé une collection importante et peut-être même complète de Vieet Langage, l’excellente revue publiée par Larousse. » « Je donnerai volontiers, ajoute-t-elle, cette collection qui peut rendre service ». Cela vise aussi bien un particulier qu’unebibliothèque. Il suffit de se signaler par courrier ou par mail ; nous ferons suivre. On peutle constater : c’est une offre en lignes : nous n’avons plus rien à envier à eBay.
M.R.
La vie du Bulletin
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 2
VALERY LARBAUD, ÉCRIVAIN DÉGAGÉ
par Pierre CHARRETON
Voici que paraît l’« édition définitive » du Journal de Valery Larbaud, ouvrage de plusde 1500 pages, rassemblant l’intégralité de tout ce qui a pu être retrouvé de la plumedu diariste, entre 1901 et 1935, et dont divers extraits avaient déjà été publiés. Établissantle texte, Paule Moron note scrupuleusement et méticuleusement toute page manquante,volontairement supprimée ou simplement perdue, toute ligne « caviardée », tout motbiffé. Au début de chaque période figure une présentation des manuscrits. À la suite, desnotes très abondantes, en petits caractères, élucident toutes les allusions et références,et donnent des indications sur presque tous les noms apparaissant au cours du texte.Réparties au fil de l’ouvrage, ces notes ne sont pas faciles à consulter. À la fin s’égrèneun précieux et volumineux Index des titres, des noms et des lieux. À la première lecturecursive, on reste un peu étourdi ou assommé devant cet énorme travail, qui a supposéde nombreuses années de recherches, de démarches et de vérifications jusque dans lemoindre détail.
Grand voyageur cosmopolite et grand polyglotte, Larbaud rédige parfois directementen anglais. On trouve aussi de nombreux passages ou de courts textes en italien ou enespagnol, et des citations en langues anciennes, surtout en latin, où l’auteur excellait (detemps à autre, il se remet à lire, par exemple, Tite Live, Ovide ou Aulu-Gelle ; à Corfou ilcite Pausanias).
Essayons de classer les divers points de vue qui peuvent susciter diversement l’intérêtdu lecteur. Tout d’abord les impressions de voyage. Il arrive que Larbaud se livre à unesimple énumération en style télégraphique de ses faits et gestes, en forme d’« aide-mémoire », ou bien cela prend la forme d’un « journal de bord », en voiture, en train ouen bateau. Sont souvent notées des « choses vues », (j’emprunte l’expression à V. Hugo) :anecdotes dans la rue, à l’hôtel ou au restaurant, descriptions des paysages, des rues oudes monuments. L’auteur s’intéresse aux faits de sociabilité, rarement aux faits qui relèventde la « question sociale », comme on disait alors. Sa préférence va à la simplicité des gensdu peuple, tandis que les « bourgeois » l’indisposent souvent. Les villes traversées sontl’occasion de promenades et de « flâneries » dont la relation fait le charme du récit, maiselles font parfois l’objet d’une véritable analyse qui relève de la géographie humaine etmême de l’économie politique: ainsi Marseille ou Montpellier, Trieste, Naples ou Alicante,Londres, Anvers ou même Tirana (l’auteur s’interroge: dans quelle mesure cette dernièreville appartient-elle à l’Europe ?...) Un regret personnel : en 1911, avec L.P. Fargue,Larbaud a parcouru le Forez et visité Saint-Étienne « en détail » (il a assisté à une soirée àl’Eden-Théâtre). Il dit en avoir fait le « récit », mais il n’en subsiste absolument rien… Entreses voyages, l’auteur séjourne à Vichy, à Paris ou dans la propriété familiale de Valbois.
Le Journal est aussi parsemé de confidences de l’écrivain sur lui-même, bien qu’il aitfort peu tendance à l’introspection. Né en 1881, il a pour père le riche propriétaire de lasource Saint-Yorre, mort peu après. Il s’est senti étouffé par la tutelle aimante mais pesantede sa mère, de sorte qu’il lui a fallu « gagner [sa] liberté » et « [s]’affranchir du joug familial »ainsi que de la société « bourgeoise » de l’époque qui ne s’est pas privée de« dénigrement et calomnies » à l’encontre de ce littérateur en rupture de ban.
3
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 3
Au cours de cette longue lecture, nous n’apprenons rien sur ses amours, rien sur sarencontre avec celle qui sera la compagne de sa vie (appelée « Maruccia »), mère d’unepetite Laeta à laquelle Larbaud s’attache beaucoup, notant ses traits de caractère, sesprogrès en français (sa langue maternelle étant l’italien) ou en lecture. Sa santé chance-lante (il sera réformé), ses indispositions, ses dépressions – son « Humeur » - ses nuitsd’insomnies reviennent comme un leitmotiv. Quand son corps le laisse tranquille il lui arrivede faire de longues promenades ou même de jouer au tennis.
Sur le plan de la religion, il ne semble pas se poser de questions. S’il évoque des messesou des offices dans diverses églises d’Europe, c’est surtout pour noter des impressionsesthétiques. Une fois, très mal en point, il avoue: « Je prie régulièrement ». De même ilpriera pour Cocteau gravement malade. Sa religion ne le tourmente pas et semble allerde soi.
On est stupéfait de voir à quel point la politique est évacuée de ses préoccupations.Une seule entorse à ce qui semble être un principe: en 1934, il s’étonne que le « Fascisme »tienne lieu d’« épouvantail », alors que c’est « un vrai mouvement démocratique » qui semontre bénéfique « au moins pour l’Italie ». Voilà qui, rétrospectivement, a de quoi laisserrêveur… Il est vrai qu’à cette époque beaucoup de bons esprits se sont laissés aveugler.Mais dans l’ensemble, les événements politiques et sociaux ne trouvent presque pasd’échos dans ce Journal, même pas la Guerre de 14 !
Enfin Larbaud nous livre quelques confidences sur son statut d’écrivain. Recevant del’administration un courrier avec la mention « Homme de Lettres », il juge ce titre « ridiculeet lamentable », car lui du moins ne fait pas « métier d’écrire » ! Il y revient quelques annéesplus tard: il préfère le titre de « riche amateur », c’est-à-dire un écrivain qui « ne s’est jamaisforcé, n’a jamais écrit que pour son plaisir » - à part certaines préfaces. Et il s’interroge surce « complexe de situation privilégiée », qui doit toucher aussi un Proust ou un Gide…C’est aussi pourquoi, l’argent n’étant guère une préoccupation, il n’en est presque jamaisquestion.
Cela dit, l’essentiel reste la culture et la littérature. Écrivain « privilégié », certes, tropsouvent assimilé à son personnage, le dilettante Barnabooth, Larbaud n’en a pas moinsété un bourreau de travail, un boulimique de lectures, fréquentant assidûment biblio-thèques et librairies, où ses recherches s’orientent dans des domaines très variés. Ainsi onest étonné de voir l’intérêt passionné qu’il porte aux thèses de Darwin et aux questionsde l’évolution. Il y revient souvent, et cette obsession le pousse à lire en détail Lamarck,Spencer, Le Dantec et d’autres encore. C’est aussi l’une des raisons de son intérêt pourSamuel Butler, qui n’a cessé d’être une urgence de son œuvre de traducteur (Butler estcité plus de cent cinquante fois selon l’Index, c’est son nom qui l’emporte quantitati-vement).
Cette tâche de traducteur l’occupe constamment, le plus célèbre et le plus difficileécrivain auquel il s’est attelé étant Joyce. Le « domaine anglais » est le plus important,mais il traduit aussi divers auteurs espagnols ou italiens. Son Journal s’arrête parfois sur depetits problèmes de traduction auxquels il est confronté ou qu’il rencontre dans seslectures. D’ailleurs il a souvent servi d’intermédiaire, par exemple pour la traduction deLa Porte étroite en espagnol. Au cours de l’ouvrage apparaissent presque tous les nomsqui comptent dans la littérature contemporaine surtout européenne, parfois américaineou sud-américaine, sans compter beaucoup d’obscurs ou d’oubliés. On lit au passagedes esquisses de critique littéraire, dont certaines seront développées dans de nombreuxarticles, et cela sur des auteurs aussi dissemblables que Léon Bloy et Katherine Mansfield.Larbaud se montre réservé sur les « Dadas » et les « Surréalistes » : ils offrent sans doute unintérêt en tant que « mouvement », mais leurs « œuvres », elles, n’en présentent guère…
Valery Larbaud, écrivain dégagé par Pierre CHARRETON4
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 4
En 1935, devant « le flot des romans tout neufs sur l’étalage », il réfléchit sur l’avenir dece genre littéraire, qui lui semble daté. Lui objecte-t-on ceux de Gide: ce ne sont pas« de vrais romans » ! Il s’oppose au « modernisme » excessif de l’Enseignement Supérieur,qui fait commencer la littérature française « avec Marcel Proust ». Lui-même ne s’interdirapas une causerie radiophonique sur Maurice Scève, ou encore relisant Voiture, il lui trouveune parenté poétique avec Verlaine qui sans doute lui doit plus qu’on ne pense… Il luiarrive de s’interroger sur la notion de « littérature nationale », et il s’insurge contre ce qu’ilconsidère comme une étroitesse de vue. La littérature des grands pays d’Europe toucheau monde entier, et de ce fait « every french writer is an INTERNATIONAL poet » !
Pour les publications, la grande affaire de sa vie, c’est la NRF (s’agissant de cettepériode, on y revient toujours !) Il ne cesse de correspondre avec Rivière, Gallimard,Paulhan et bien sûr Gide. Larbaud est tenu, dit-il lui-même, pour un « collaborateur trèsinfluent » de la revue. Cependant, sans vouloir dresser un palmarès, on sent que pour luiles deux plus grands écrivains français contemporains (avec Proust et Gide), sont Claudelet Valéry, qui ont certes été en relations étroites avec la revue mais sans appartenir à soncénacle. Il suit l’œuvre de Claudel avec grande admiration, et Valéry l’enchante aupoint qu’il finit par connaître par cœur La Jeune Parque, à force d’en répéter la lecture.Évidemment, sont souvent mentionnées ses propres œuvres, mais il ne s’exprime pas surle fond, ni sur le parti littéraire choisi, encore moins sur leurs arcanes, et le lecteur serapeut-être déçu de ne trouver aucune confidence ni aucun commentaire éclairant sapropre création littéraire. Pourtant, on aurait aimé que nous soit donné sur ce chef-d’œuvre qu’est Enfantines un peu plus que deux ou trois « clefs ». Il est surtout questionde délais d’édition, de correction d’épreuves (que de fautes agaçantes !) ou deproblèmes de réception : à sa parution, Fermina Marquez ne touche qu’un petit cerclede lecteurs.
Avouons-le : au cours de ces centaines de pages, il arrive que le « vice » de la lecturesoit « puni » par un sentiment d’impatience. Le spécialiste trouvera là de quoi assouvir sasoif de connaissances, ou réagir devant tel jugement littéraire. Le lecteur ordinaire secontentera de picorer, glaner, butiner, s’arrêtant sur de nombreux passages où semanifeste le talent de l’écrivain, tantôt vagabond et prolixe, tantôt enclin à la concisionpour relever tel détail, suggérer un paysage ou une atmosphère. D’autres s’intéresserontplutôt à l’homme Larbaud, sa personnalité, ses goûts cosmopolites, et liront ce Journalcomme un autoportrait de l’auteur en écrivain « dégagé ».
LARBAUD Valery, Journal, 1602 p., 70 € Gallimard
�
Valery Larbaud, écrivain dégagé par Pierre CHARRETON 5
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 5
P rismeDES RÊVES ET DES NOMS
par Bernard PLESSY
Rêve de noms
Je rêve d’une étude sur les noms de personnages de romans. Où les romanciers lesprennent-ils? Quels effets en tirent-ils? Elle existe peut-être, mais c’est à mon insu. Jepropose donc quelques variations, mélange d’observations et d’intuitions, auxquellesseule une enquête collective pourrait apporter confirmation ou infirmation, et précisions.
Il me semble que certains romanciers, et non des moindres, je pense à Balzac et àZola, n’attachent pas grande importance à la résonance obtenue du nom propre. Jedirais volontiers que leurs personnages s’appellent comme tout le monde. Ce sont des“réalistes”, le roman rivalise avec l’état civil : comme dans la vie, les noms sont acquis,qu’ils sonnent bien ou mal, ceux qui les portent n’en sont pas responsables, eux-mêmesn’entendent plus leur nom, et les autres ne s’en étonnent pas.
Il est une attitude tout à fait opposée, que Cocteau a bien formulée dans Le Secretprofessionnel, en montrant le parti qu’on peut en tirer en poésie. « Connaissez-vous lasurprise qui consiste à se trouver soudain en face de son propre nom comme s’il appar-tenait à un autre, à voir, pour ainsi dire, sa forme et à entendre le bruit de ses syllabessans l’habitude aveugle et sourde que donne une longue intimité. Le sentiment qu’unfournisseur, par exemple, ne connaît pas un mot qui nous paraît si connu, nous ouvre lesyeux, nous débouche les oreilles. Un coup de baguette fait revivre le lieu commun. » Cetteobservation vaut pour le roman. Chaque terroir comporte un gisement de noms de lieuxet de personnes dont la riche expressivité est comme offusquée par l’habitude. Au paysoù j’écris ces lignes fleurit, comme partout, une puissante onomastique, Bougerol,Grataloup, Tronchon, Flachat… Or ces noms ne me font plus dresser l’oreille, non plusmême que Ravachol, entré pourtant dans les injures du capitaine Haddock. Il faut le“coup de baguette” de Cocteau. Je prends l’exemple d’un nom très répandu dans monvoisinage, Patouillard. Dans L’Éducation sentimentale, Mme Arnoux fait visiter à Frédéricla fabrique de faïences de son mari à Montataire. « - “L’important, c’est la préparationdes pâtes.” Et elle l’introduisit dans une salle que remplissaient des cuves, où virait sur lui-même un axe vertical armé de bras horizontaux. - “Ce sont les patouillards,” dit-elle.Frédéric trouva le mot grotesque, et comme inconvenant dans sa bouche. »
On conçoit ainsi que certains romanciers puissent jouer sur les pouvoirs des patro-nymes et toponymes et en tirer des effets puissants. Je n’ai pas cité Flaubert entre Balzacet Zola. C’est à cause du Citoyen, toujours dans L’Éducation sentimentale, le fameuxRegimbart, dont le nom est l’image poussée à la caricature selon le proverbe: nomenest omen. Et le maire de Yonville-l’Abbaye se nomme Tuvache, « avec ses deux fils, genscossus, bourrus, obtus ». Lors de la scène des Comices, quand il apostrophe la vieilleservante récompensée pour cinquante-quatre ans de service dans la même ferme (« - Êtes-vous sourde? dit Tuvache, en bondissant sur son fauteuil »), qui a la dignité entreCatherine-Nicaise-Élisabeth Leroux et le Tuvache qui la bouscule, entre « ce demi-sièclede servitude » et ces bourgeois épanouis? Et toujours pendant ces fameux Comices, effetplus marqué encore, le contrepoint entre la séduction d’Emma par le bellâtre Rodolpheet la proclamation des récompenses agricoles. « - Oh! non, n’est-ce pas, je serai quelque
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 6
chose dans votre pensée, dans votre vie? “Race porcine, prix ex æquo : à MM. Lehérisséet Cullembourg; soixante francs. »
Deux autres exemples, plus proches de nous. Lorsque le Grand Meaulnes, après troisjours de fugue, apparaît à la porte de la classe, « la tête haute et comme ébloui »,comment se nomment les ricaneurs ? Jasmin Delouche, Boujardon, Moucheboeuf,Giraudat…, dont les noms sonnent un peu autrement que celui de l’ami, François Seurel.Dans Gaspard des Montagnes, Pourrat doit nommer des bourgeois d’Ambert, deux frères,spéculateurs de grains, profiteurs de famine, affameurs de canton, sans compter d’autresvices. Il fait appel au nom d’un village de la Limagne d’Issoire et il en tire le patronymede Chargnat. Admirable. Il y a les a de l’avarice, rat, rapiat, rapace, mais avec des articu-lations qui disent la hargne et l’impitoyable acharnement sur le pauvre monde. J’entendsHarpagon: « Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu’elle peut donnerà sa fille? Lui as-tu dit qu’il fallait (…) qu’elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? » Cet imparfait du subjonctif a la violence du tragique.
Noms de rêve
L’effet inverse n’est pas moins saisissant. S’il y a des noms qui nous font entrer en pleinepâte humaine, il est aussi des noms dont l’aura idéalise celles (comment éviter le féminin?)qui le portent.
Revenons au Grand Meaulnes. Oublions Delouche et Moucheboeuf. Lors de la fêteétrange, le jeune homme et la jeune fille échangent quelques paroles au bord de l’étang,transposées de « la grande, la belle, étrange, et mystérieuse conversation » du 11 juin1905, jour de la Pentecôte, de Saint-Germain-des-Prés à la Concorde. « “Mon nom?… Jesuis mademoiselle Yvonne de Galais. (…) – Le nom que je vous donnais était plus beau,dit-il – Comment? Quel était ce nom?” fit-elle, toujours avec la même gravité. Mais il eutpeur d’avoir dit une sottise et ne répondit rien. “Mon nom à moi est Augustin Meaulnes.” »Cette scène appelle quelques réflexions. La répartie de Meaulnes ne va pas sans muflerie.Elle est à l’image d’Henri Fournier. « Seules, les femmes qui m’ont aimé, peuvent savoir àquel point je suis cruel. Parce que je veux tout. Je ne veux même plus qu’on vive danscette vie humaine. Vous voyez d’ici le héros de mon livre, Meaulnes » (28 septembre 1910à Jacques Rivière). Cette répartie est reprise de la scène réellement vécue. Et pourtantla réponse de la jeune fille importunée dut être : « Je suis mademoiselle Yvonne deQuièvrecourt. » La clé est donnée par la sœur d’Alain-Fournier, Isabelle Rivière, dansImages d’Alain-Fournier, quand elle ajoute la confidence de son frère : « C’est Mélisandeque je voulais dire. » Les jeunes gens cultivés de cette époque, khâgneux, normaliens,étaient « pélléastes ». Leur imaginaire était subjugué par l’opéra que Debussy avait tiréde la pièce de Maeterlinck. Poètes ou romanciers, ils ont donné des sœurs à Mélisande,qui elle-même n’était pas étrangère à l’Adrienne de Sylvie. Je pense aux nouvelles deFrancis Jammes, Clara d’Ellébeuse, Almaïde d’Etremont. Je pense à un jeune poète, quime fut ami cher en ses vieux jours, Louis Pize. Il avait vingt ans en 1912, quand il écrivaitses Petites élégies pour le tombeau d’Angélia de Montauvers :
Angélia, trop belle et triste châtelaineD’un pays de fayard qu’autrefois j’ai chanté…
Ce ne serait pas un des moindres charmes de cette étude que l’évocation de cesnobles demoiselles promenant dans les allées des domaines, avec la conscience d’enêtre les dernières héritières, leurs grâces aristocratiques – et parfois la Grâce même, ôBlanche de la Force.
Rêves… Et s’il fallait décider du prénom, élégant et spirituel, de ceux dont elles étrei-gnent le cœur, ce serait Augustin. Pour Meaulnes, mais aussi pour Augustin Méridier, etsa douloureuse passion pour Anne de Préfailles dans Augustin ou le Maître est là (1933) –un des plus beaux livres du siècle dernier, mais oublié et même inaccessible en librairie.Tout simplement parce que notre temps n’est plus, ne sera jamais plus à sa hauteur.
Des rêves et des noms par Bernard PLESSY 7
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 7
Romans, Récits, Nouvelles
ALBERTI de MAZZARI Silvia
La reine vénitiennePygmalion
Histoire romancée de Catherine Cor-naro, fille d’un riche marchand apparte-nant à l’une des plus anciennes et illustresfamilles de Venise. Jacques, roi de Chypre,au vu de son portrait, l’a demandée enmariage (1471). Mais il meurt un an plustard, probablement empoisonné. C’estque Chypre est le point de rencontre dedeux ambitions, celle du roi de Naples etcelle de la république de Venise ; l’île, eneffet, est une base stratégique importantedans le combat, sans cesse renaissant,contre les Turcs. Après la mort du roi,Catherine assure la régence au nom deson fils, un bébé ; elle s’acquitte de sacharge à la satisfaction de tous ses sujets,mais, au bout de quelques années, doitcéder le royaume à Venise, où elle se retireet finit ses jours en 1510.
Dans cette histoire les amours et lescomplots s’entremêlent, et l’auteur nenous aide guère à suivre le fil des intrigues :les personnages sont très nombreux, sou-vent peu individualisés, et le récit estpresque toujours allusif. De plus, au gréd’une disposition typographique quiajoute à la confusion, les époques alter-nent, et les lieux ; nous sommes tantôt àChypre, au début de l’histoire, et tantôt àVenise, une quarantaine d’années plustard, dans la chambre où Catherine vamourir.
L’atmosphère de la cour de Chypre,parfumée de roses rouges et de fleurs decitronniers, est peinte avec brio, mais lestoilettes et les bijoux qui parent les beautésde la cour, masquent, sans les faire oublier,les rivalités, les cruautés et les meurtres,
dont la cour du pape Borgia elle-même necesse de donner l’exemple. Bref ! Atmo-sphère éclatante, mais roman confus. 383p., 21 € M.C.
BASS Rick
La vie des pierres Christian Bourgois
Les dix nouvellespubliées ici sont toutespuissantes et originales.Rick Bass excelle dansla description d’activi-tés souvent étrangesd’adolescents : deuxgarçons et une fille bri-colent une sorte debathyscaphe et seplongent dans l’eaud’un golfe en manipu-
lant une grue usée, une très jeune femmetue un élan à un endroit interdit, deuxfrères tentent d’arriver sur les lieux desincendies avant les pompiers, deux amisachètent à bas prix des veaux malades etfugueurs.
Mais le plus important thème de cesrécits est la nature. Un personnageaccomplit un travail épuisant d’abattagede bois, une femme convalescente etvivant dans une maison complètementisolée entre en relation avec une familleéloignée, un homme qui amène sa femmeà la maternité doit se frayer un chemin à latronçonneuse.
Ce sont des péripéties difficiles et péril-leuses. Mais la nature n’est jamais mau-dite, ni exaltée en termes emphatiques, niperçue comme une victime à travers lesgémissements d’une écologie effrayée.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 8
9
L’auteur, qui fut un géologue de profes-sion, ressent les arbres, les pierres, lesrochers, les montagnes, les plantes, lescours d’eau, les couches souterraines,comme une totalité multiple dans sesformes, mais unique dans son essence, ilappréhende les inondations comme destémoignages, les frémissements du sol etles mouvements telluriques comme dessystèmes organiques. Sans pathos aucun,ces descriptions sont impressionnantes. 272p., 25 € R.P.
BERNHARD Thomas
Extinction, un effondrement L’Imaginaire/Gallimard
Ex t inc t ion d ’unhomme, d’une famille,d’un pays. L’hommec’est Murau le narra-teur, fils cadet d’uneriche famille qui vitd a n s u n g r a n ddomaine, Wolfsegg etle pays c’est l’Au-triche, état corrompu
aux yeux de Thomas Bernhard par l’his-toire ignoble du nazisme. Murau a fuiWolfsegg pour vivre selon ses goûts àRome. Deux événements le forcent à yrevenir, le premier le mariage d’une deses sœurs, le second les obsèques de sonpère, de sa mère et de son frère aîné vic-times d’un accident de voiture. Le dramefamilial fait remonter à la conscience deMurau des souvenirs terribles. Enfant il aété en but à l’hostilité de ses parents, plusattachés à son frère. Méchanceté d’unemère qu’il haït, mépris d’un père qu’ildéteste, le portrait est terrible. Ce qu’illeur reproche, c’est leur adhésion totaleau national-socialisme jusqu’après la finde la guerre. Il les évoque comme uncouple de philistins qui l’ont « complète-ment déformé, détruit». Il se décritcomme tourmenté par ses deux sœursqu’il méprise également. Wolfsegg apourtant été un paradis pour Murau danssa petite enfance, mais il s’est rapidementtransformé en enfer.
Le récit de Murau a pour objectif ladestruction, l’effondrement de Wolfsegg.Sa détestation va jusqu’à lui faire haïr la langue allemande et sa littérature.C’est pourtant l’outil de destruction qu’ilutilise ! Voilà une attaque féroce de toutce qui est autrichien. Il vilipende et pré-sente « l’homme autrichien entièrementpar nature un homme national-socialiste-catholique». On reconnaît bien là la férocité de Thomas Bernhard à l’égardde ses compatriotes. Cette entreprise de destruction est aussi celle qui désagrège Murau et l’anéantit. Il n’y sur-vivra pas.
On sort de la lecture de ce livre sidérépar sa force, sa virulence sans concession,son impitoyable cruauté. C’est le dernierroman de Thomas Bernhard paru en Alle-magne en 1956. Ce pourrait être ses der-niers mots. 508 p., 9 € M.H.V
BRESSANT Marc
La citernede Fallois
La guerre d’Algérie ne cesse, depuiscinquante ans, d’alimenter souvenirs, récitsou œuvres de fiction avec, généralement,le souci de justifier, de dénoncer ou d’ex-pliquer. La neutralité, l’indifférence auxenjeux du conflit n’existent pas, pas plusqu’une impossible objectivité, preuve quele fossé d’incompréhension n’est pasencore comblé. Marc Bressant (Grand prixdu roman de l’Académie française 2008pour La dernière conférence) ne précisepas s’il a fait appel à ses propres souvenirs ;on peut le supposer en ce qui concerne lecadre de vie du narrateur, sous-lieutenantappelé, chargé d’assurer vers la fin de laguerre l’administration d’un secteur enprincipe « pacifié ». La galerie des person-nages qui constituent ses interlocuteursrelève par contre davantage de l’imagi-nation, tant l’éventail des opinions en estlarge et complet : qu’il s’agisse des mili-taires de carrière, des appelés, des colons,des Musulmans, Marc Bressant a réuni unéchantillon représentatif de toutes les ten-dances, de toutes les nuances présentes
Romans, Récits, Nouvelles
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 9
10
sur le sol algérien, du sabreur imbécile auprofiteur, du rebelle au harki obstinémentfidèle, de l’attentiste à l’homme de paix.J’avais déjà relevé, dans le précédent livrede l’auteur, cette volonté d’incarner dansquelques figures caractéristiques la diver-sité des conditions et des opinions. L’au-thenticité du tableau en souffre probable-ment un peu, mais pas l’exactitude de lareconstitution. Le sous-lieutenant Werner, lenarrateur, a ainsi, du conflit, une visiond’ensemble, équilibrée et sensée, que nepossédaient sans doute pas ceux qui,effectivement, peinaient dans un posteisolé ou dans une S.A.S. Il est certes plusfacile, longtemps après, d’adopter ainsi lavoie de la raison, mais c’est aussi le moyend’expliquer les choses aux générationsd’aujourd’hui. Dans ce beau livre à l’écri-ture très classique, Marc Bressant s’y estemployé avec intelligence et conviction.365 p., 18 € J.F.
BRINK André
Dans le miroir suivi de Appassionata
L’amour et l’oubli (rééd.)Actes Sud
Dans les années 1970-1980, les der-nières du régime d’apartheid, la littératurede l’Afrique du sud blanche, de langueafrikaans ou anglaise, dont le grand publicfrançais ne connaissait guère que l’émou-vant roman d’Alan Paton, Pleure, ô monpays bien aimé, a vu paraître des étoilesde première grandeur, Nadine Gordimer,J.-M. Coetzee, Breyten Breytenbach etAndré Brink. De celui-ci nous avions beau-coup aimé Au plus noir de la nuit, Une sai-son blanche et sèche, Un instant dans levent, Rumeur de pluie... Était-ce la séduc-tion du pittoresque et de l’exotisme, lacuriosité pour l’histoire d’une région bienmal connue, l’admiration pour la coura-geuse dissidence d’un écrivain qui bravaitles autorités de son pays? Tout cela entraitsûrement beaucoup dans notre intérêt.Même si les œuvres qui nous sont ici pro-posées portent encore la trace doulou-reuse du passé, aujourd’hui que l’écrivain
est reconnu, que ses positions rejoignentfinalement celles d’un conformisme – jene donne ici aucun sens péjoratif à ce mot– assez général dans le monde de sespairs, nos dispositions de lecteur se sontmodifiées et nous sommes devenus plusexigeants.
L’amour et l’oubli, c’est le récit auto-biographique d’un écrivain sud-africain,au soir de sa vie – L’Ecclésiaste 12 : 3, citéau cours du récit, donne pathétiquementle ton –, qui, pendant qu’il veille sur les der-niers moments de Rachel, victime d’unaccident ou plus probablement d’unmeurtre, évoque pour lui-même lesfemmes qu’il a aimées dans le passé. Ilmêle à ces souvenirs ceux de l’époque del’apartheid ou des années qui suivirent sonabolition. Il s’absente parfois pour rendrevisite à sa mère centenaire qui vit aussi sesdernières heures et dont les souvenirs sebrouillent dans les brumes de l’âge. L’ac-tualité brutale de la seconde guerre d’Irakdont il suit les débuts à la télévision etqu’est en train de filmer George, le mari deRachel, reporter-photographe, vient encontrepoint à ces évocations et leurdonne un surcroît de tragique et de vio-lence dont l’écrivain est d’ailleurs parfai-tement conscient. Les femmes qu’il aaimées sont nombreuses, quinze, vingt,mille e tre peut-être, on ne sait plus, jeunes,moins jeunes, il en a joui dans des ébatsdécrits souvent avec les plus extrêmes pré-cisions anatomiques, en tout cas sansaucune retenue ni pudeur, mais le seulvéritable amour, l’unique (à l’exceptiond’un visage entrevu, un instant, au départd’un train, regret de sa vie), vécu dans ladurée mais jamais entrepris ni satisfait parloyauté d’ami à l’égard du couple queRachel forme avec George, est sans doutecelui qu’il éprouve encore, épuré, pourcelle dont il attend la fin. Ce n’est nil’amour ni l’oubli qui dominent ici mais lamort. Le personnage de Don Juan ou deDon Giovanni, si fréquemment évoqué,n’est décidément pas un messager deliberté.
Les deux nouvelles qui, nous dit-on, for-ment un triptyque avec La porte bleue,précédemment parue aux mêmes édi-tions, sont aussi des récits d’amour et de
Romans, Récits, Nouvelles
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 10
11
violence dans l’Afrique du sud, désormaisaffranchie de la discrimination légale desraces. Elles se distinguent du roman parleur brièveté et surtout leur genre, proched’un fantastique qui ne dit pas son nom. Àvrai dire, la première est presque un conteou une parabole. Steve, son protagoniste,un jeune architecte bien dans sa peau,satisfait de ses prestigieuses réalisations, dela beauté de sa femme Clara et de l’intel-ligence de ses filles, sans préjugés appa-rents mais d’opinions prudentes, évoluantau même rythme, croit-il, que le mondequi l’entoure, n’a pas subi, comme le luimontre son miroir à forme symbolique, lamême métamorphose que celle dont estvictime le malheureux Grégoire Samsa,mais celle-ci, réelle ou non, lui impose deredoutables questions d’identité qu’il estimpuissant à résoudre. Comme Appassio-nata, la seconde nouvelle, dont les héros,un couple illégitime, sont des connais-sances de Clara et de Steve – une mêmescène est racontée dans les deux récitsmais différemment selon les protagonistesde l’un ou de l’autre –, Dans le miroir se ter-mine dans la violence et le drame. 483 p.,9,50 € et 216 p., 20 € Y.A.
CESSOLE Bruno (de)
Le moins aiméÉd. de la Différence
Le 2 avril 1696,apprenant dans sonchâteau des Rochers,où il vit paisiblementavec sa femme, quesa mère, Mme de Sévi-gné, est gravementmalade chez sa filleMme de Grignan, enProvence, Charles semet en devoir de lui
écrire une longue lettre. Fiction peu vrai-semblable (« Ne vous étonnez pas, surtout,si, me penchant sur mon passé, je relatedes faits qui ne vous sont que tropconnus »), mais permise au roman, et debon aloi (on est loin du genre le plus sou-vent piteux des pseudo-mémoires), et debelle fécondité. Car cette manière de
confession est taraudée par une questionque le fils pose à sa mère, respectueuse-ment, sans grief mais non sans chagrin :pourquoi lui avoir préféré sa sœur à cepoint? pourquoi l’avoir ravalé au rang de« petit compère », de « petit frater », plai-sant, drôle, mais sans envergure? Il a, lui,quelques éléments de réponse : il tenaitde son père ce dont la marquise a soufferten son bref mariage, folles amours, prodi-galité, défaut d’ambition, goût de la tran-quillité, refus de se dégrader en courtisan,attachement à la Bretagne – « péchésvéniels », plaide-t-il, au regard de l’essen-tiel : s’il n’a pas été le héros de roman dontpouvait rêver sa mère, il a été un honnêtehomme. Il y a, dans cette psychologie dela famille, un exercice subtil et sommetoute utile : la stricte biographie a moins deliberté.
Outre cela, on revisite, comme on dit,toute une part du XVIIe siècle, celle quiétait dans la mouvance des Sévigné etdes Rabutin, la Ville plutôt que la Cour, leparti des Frondeurs d’hier, et, au gré de lavie agitée du jeune Charles, les milieuxgalants (Ninon de Lenclos, la Champ-meslé), littéraires (Despréaux, Chapelle,La Fontaine, Racine…), et militaires(« éternel guidon », ironise sa mère,Charles n’en fit pas moins une carrièrecourageuse et se signala par son intrépi-dité à Candie ou à Philipsbourg). Celafait du monde, et du beau monde, etbien des traits et des faits savoureux. Etjamais rien de vraiment inventé, si je puisdire, car le référent n’est jamais loin : leslettres de la marquise et la littérature quigravite autour d’elles (Retz, Le Rochefou-cauld, Bussy-Rabutin, Mme de LaFayette…) Et la manière dont B. de Ces-sole sollicite cette source prestigieuse faitle plaisir du connaisseur, jeu d’échos, d’al-lusions, d’emprunts (sans jamais, et c’est larègle du jeu, la moindre référence: à vousde trouver !), qui n’a rien du pastiche,mais beaucoup de la réécriture de conni-vence. Savez-vous ce que c’est quefaner, direz-vous? Non, la Sévigné de B.de Cessole n’est pas la Sévigné de tout lemonde, comme dit Proust. Mais « corpsde papier mouillé, âme de bouillie, cœurde citrouille fricassée dans la neige »,
Romans, Récits, Nouvelles
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 11
12
mais « des panerées de tétons, des pane-rées de cuisses, des panerées de bai-sers », mais les « beurrées infinies » auxRochers, et Mme de Sévigné fière d’im-primer toutes ses dents dans le beurre deLa Prévalaie, mais dix, mais vingt pas-sages. Et de temps à autre le change:« Ce serait une belle chose que de voya-ger, s’il ne se fallait point se lever simatin… » Sévigné ? Non, La Fontainedans le Voyage de Paris en Limousin. Et lelangage est traité à la même enseigne:sans affectation, mais avec des expres-sions d’époque, « réduire au lambel »,« atteler à plusieurs chevaux » (en parlantd’une femme)…
Bref, vous le comprenez, j’ai pris plaisir,grand plaisir à cette lecture, et je la recom-mande. « Comme l’on m’aura méconnu,ma mère, et vous la toute première » s’ex-clame Charles au terme de cette lettre,qu’il renonce à envoyer. Lecture faite, et lebref épilogue n’y est pas pour rien, je faisvolontiers confiance à B. de Cessole :Charles n’a pas été « le mal aimé, mais lemoins aimé ». Il n’en a pas moins aimé etadmiré sa mère, aimé sa douce femme, etses nièces et son neveu. Un honnêtehomme, qui a fini sa vie au Faubourg Saint-Jacques dans une retraite pieuse et aus-tère. Il ne fut pas facile pour lui d’être le filsde sa mère et le frère de sa sœur. Bruno deCessole montre qu’il s’en est plutôt bientiré. 288 p., 17 € B.P.
COX Michael
Le livre des secretsSeuil
Vous avez aimé,j’en suis persuadé, LaNuit de l’Infamie (Bull.662), œuvre d’imagi-nation érudite maiscaptivante du très res-pectable éditeur et critique britanniquequ’était Michael Cox.En voici la suite – vingt
ans après les événements fondateurs - toutaussi foisonnante, subtilement conduite etd’une impeccable maîtrise dans la recons-
titution de l’Angleterre victorienne. Ce serahélas ! la fin de cette longue et sombre his-toire, l’auteur étant décédé peu après laparution du livre. Il est bon de préciser queles deux romans peuvent être lus indé-pendamment l’un de l’autre mais que lalecture de l’un appelle immanquablementcelle de l’autre. La captation criminelle del’héritage du richissime Lord Tansor, originede toute l’affaire, vers 1850, avait été soi-gneusement préparée et exécutée ; lavingt-sixième baronne Tansor pouvait ainsiespérer jouir en paix, avec ses deux fils, dufabuleux domaine d’Evenwood. C’étaitsans compter avec la persévérance del’héritier évincé – ou se prétendant tel – etde la poursuite, par un petit groupe deconjurés, du « Grand Dessein » tendant àrétablir l’ordre normal des choses. Choisiepour s’introduire à Evenwood et en sur-prendre les secrets, la jeune Esperanza vaaller de surprises en découvertes jusqu’audernier coup de théâtre où toutes chosescachées seront alors révélées. En dire plusserait imprudent. On trouvera dans cesecond livre moins de références histo-riques et littéraires mais la même précisionhorlogère dans la combinaison des des-seins tortueux des hommes et des jeux duhasard. Les personnages, éminents repré-sentants de l’aristocratie britannique duXIXe siècle, évoluent sans souci d’argent nide frontières entre Londres, Paris, Madèreou Florence. L’intrigue est d’une diabo-lique ingéniosité et le tout d’un goût par-fait. 584 p., 24,50 € J.F.
FADANELLI Guillermo
BoueChristian Bourgois
Roman d’une dérive, Boue est lalongue « confession » d’un professeurd’Université incarcéré pour homicide. Lerécit commence par sa rencontre avecune jeune vendeuse de supérette qui vafaire basculer sa vie. Au seuil de la cin-quantaine, ce célibataire amateur defemmes enseigne la philosophie, d’où unetotale maîtrise de l’expression et de la pen-sée. Mais, comme il l’affirme au terme deson aventure, « les études ne tuent pas les
Romans, Récits, Nouvelles
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 12
13
passions ». Fou amoureux d’Eduarda (detrente ans sa cadette), il la cache chez luiquand elle commet un délit dans la supé-rette où elle travaille et se trouve embar-qué avec elle (et quelques autres) dansune fuite loin de Mexico, vers cet État duMichoacan où, plus qu’ailleurs, ilsdevraient échapper à tous les risques. Lasuite prouvera qu’on n’est jamais maîtrede son destin : des péripéties indépen-dantes des événements antérieurs condui-ront à deux morts d’hommes, mais c’estencore, ironie de l’histoire, pour un toutautre motif que notre « héros » se retrou-vera en prison. La passion qu’il éprouvepour cette toute jeune femme est totale-ment irrationnelle, totalement animalepourrait-on dire. Et, paradoxalement, c’estsans doute cela qui rend si… humain ceprofesseur habitué à manier et exposer lesgrandes idées philosophiques, pétri de cul-ture mais aussi doté d’une grande facultéd’autodérision et quelque peu marginal.Ce roman, bien construit et bien traduit,est, semble-t-il, le meilleur de GuillermoFadanelli. 348 p., 23 € F.L.
FRANCK Julia
La femme de midiFlammarion
Nous sommes en1945, à Stettin ; laguerre est terminée; lesRusses ont envahi l’Al-lemagne. Sur un quaide gare, un petit gar-çon de 7 ans, Peter, estassis sur un banc, unepetite valise sur lesgenoux. Il attend samère, Hélène; elle ne
reviendra pas, elle l’a abandonné. Dix ansplus tard, Peter refuse de rencontrer samère qui, pour la première fois, tente de lerevoir. Par la fente du plancher il l’aper-çoit. « Qu’elle ait du chagrin, Peter le luisouhaitait. Il ne pouvait s’imaginer qu’ellen’ait pas de chagrin. Il n’y avait qu’unechose dont il était sûr, il ne voulait plus larevoir de sa vie. » Entre le début et l’épi-logue de ce très beau roman, Julia Franck
tente de faire comprendre au lecteurcomment Hélène a pu commettre cetacte monstrueux. Un long retour en arrièrecommence. Il débute dans la région deLusace en pays sorabe. C’est le cadre del’enfance d’Hélène et de sa sœur aînéeMartha. Les deux jeunes filles, fuyant lamisère familiale, sont recueillies par unetante. Leur jeunesse se déroule dans le Ber-lin des années vingt. Si Hélène participepeu à la vie frénétique de la capitale, sasœur Martha se perd dans un mondebohème et court de cabarets en boites denuit, où la drogue circule facilement. La vieest très difficile dans l’Allemagne en proieà la crise économique. Son métier d’infir-mière lui permet tout juste de survivre.C’est alors qu’elle rencontre Wilhem quil’épousera et sera le père de son enfant.Très vite ils se séparent car lui est entière-ment pris par le parti national-socialisteauquel il adhère totalement. Une foisencore Hélène est restée en retrait, indif-férente aux autres et aux événements. Lepersonnage inspiré par la grand-mère del’auteur demeure énigmatique jusqu’auxdernières pages. Le lecteur s’interroge surle pourquoi de cet abandon. On lira ceroman émouvant et terrible avec le plusgrand intérêt. 370 p., 21 € M.H.V.
GEORGE Antoine
L’enfant du Bon DieuCerf
Le héros de cette brève histoire est unprêtre, élevé chez « les bons pères », entréplus tard à la Trappe puis autorisé à la quit-ter pour exercer un ministère paroissial enbanlieue. Il trouve d’abord son épanouis-sement au contact des jeunes délaissés,puis comme une voie de l’enfer dans sonimplication (injustifiée) dans une affaire depédophilie. Résumée aussi abruptement,cette histoire semble céder aux sirènesmédiatiques de notre époque et, si l’ons’y arrête, on y trouvera en effet bon nom-bre de poncifs. Le propos de l’auteur n’estsans doute pas là. Il veut surtout, croyons-nous, retracer l’itinéraire intérieur d’unhomme livré aux vicissitudes ordinaires dela vie. Il le fait, pour cela, parler à la
Romans, Récits, Nouvelles
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 13
14
première personne, sous forme demémoires apocryphes dont le rédacteuraurait décidé de renoncer à toute com-plaisance envers lui-même. L’atmosphèredes collèges religieux, des monastères cis-terciens, des cures peu douillettes de lapériphérie parisienne, et enfin des prisonsoù règnent ensemble la terreur et la soli-darité, nous est ainsi restituée avec un réa-lisme sobre et impressionnant. On ne sait sile romancier a connu ces différentsmilieux ; si oui, c’est un fort témoignage, etconvaincant ; si non, une belle réussite del’imagination littéraire. L’écriture est sou-ple et agréable, les situations bien renduessans excès de pathos, la personnalité dunarrateur nous apparaît dans toute sanudité, faiblesses et grandeurs confon-dues. Le roman ne fera probablement pasdate, mais il soulève des interrogations pro-fondes et vraies sur le destin de l’hommeécartelé entre la magnificence d’un Dieuqu’il appelle et la misère d’un mondeinexorable qui broie en aveugle mais porteaussi en lui les germes de l’éternité. 100 p.,12 € J.-F.C.
LE CHATELIER Hélène
Dernière adresseArléa
Se glisser, à trente ans, dans le person-nage d’un très vieille dame, écrire, à lapremière personne, une sorte de journalintime des derniers mois d’une pension-naire âgée en maison de retraite (l’auteurpréfère le vocable plus accueillant de nur-sing home), imaginer ce que peut être,vue de l’intérieur, la prise de consciencede sa décrépitude n’est pas chose facile.Mais c’est aussi chose méritoire que dechercher à dépasser tant les banalitésd’usage que les navrantes images ressas-sées dans les médias. La vieille dame d’Hé-lène Le Chatelier a toute sa tête ou en adu moins conservé l’essentiel mais faiblessephysique, égarements passagers, répu-gnance à se nourrir ont conduit ses enfantsà la « placer » dans un de ces homes pro-videntiels où tout est organisé pour assurerla sécurité de l’aïeule et la tranquillité d’es-prit de ses descendants. Elle, attachée plus
que tout à sa liberté, n’aura plus qu’à selaisser vivre ou, plutôt, à abandonner défi-nitivement à d’autres le soin de la faire sur-vivre. Le livre est peut-être un peu courtpour retracer les mois ou les années decette fin de vie. Peut-être aussi pourra-t-ons’étonner du contraste paradoxal entre lediscours, très raisonnable, de la narratriceet l’état de sénilité partielle censé être àl’origine de son internement. Mais c’est làaffaire de liberté du romancier qui recons-titue à sa manière, avec sa propre visiondes choses, le monologue intérieur, secret,de la vieille dame abandonnée à ses sou-venirs. Dans ce délicat exercice, Hélène LeChatelier fait preuve de beaucoup desensibilité et de perspicacité. Elle y affirmeaussi d’indéniables qualités d’écriture. 90p., 13 € J.F.
MENTZEL Zbigniew
Toutes les langues dumonde
Seuil
Si la mère de Zbyszko Hintz ambitionnaitpour son fils une brillante carrière qui fûtreconnue en Pologne d’abord et dans lemonde entier ensuite et l’imaginait appre-nant quantité de langues étrangères, lui,malgré sa bonne volonté et ses efforts,n’en put maîtriser aucune, pas même l’an-glais, l’allemand ou le russe. Il faut dire queni ses professeurs, extravagants, ni lesméthodes qu’il imaginait lui-même et s’im-posait de suivre ne pouvaient le conduireà un résultat satisfaisant. Cela reste pour-tant chez lui une obsession que des rêveseffrayants, le recours au mythe de Babelinspiré par le bruit d’une bétonneuse, unvoyage en Angleterre (où apparemmentil ne parle pas anglais), concourent àentretenir.
Ce qui fait le charme de ce curieuxroman, sans intrigue bien définie, mené defaçon plutôt désinvolte, c’est le ton déta-ché et naïf du héros-narrateur, docilecomme Candide, ses observationscocasses sur la société polonaise del’époque communiste (obtention d’unvisa, locataires imposés, poésie pompière
Romans, Récits, Nouvelles
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 14
15
et ouvriériste) et surtout la personnalité deses parents, un père, ancien officier del’armée polonaise devenu préparateur enpharmacie, ponctuel jusqu’à la manie,bien qu’il ait parfois un comportementpour le moins surprenant, et surtout d’unepatience angélique face à son épouse,mégère hargneuse déçue dans ses ambi-tions. Mais ce dernier jugement, c’est lelecteur qui le porte, non le narrateur.
L’action du roman commence et finitle 17 janvier 1997, anniversaire du mariagede ses parents, de l’entrée des arméessoviétiques à Varsovie et jour où l’hôpitalanti-infectieux où travaille le père du nar-rateur fête son départ à la retraite. 222 p.,19 € Y.A.
MINH TRAN HUY
La double vie d’Anna SongActes Sud
Ce « roman-greffe » procède de deuxinspirations totalement différentes l’une del’autre : d’une part, l’histoire d’une grandepianiste dont les enregistrements, encen-sés par la critique, se révèleront, après samort, être des faux (affaire réelle, celle deJoyce Hatto, qui a défrayé la chroniqueen 2006-2007) ; d’autre part, le destind’une femme dont la famille a fui le Viet-nam bien avant sa naissance et qui vitmentalement dans l’obsession de sesracines asiatiques. Ces deux thèmes, dontchacun pourrait donner matière à unroman, semblent artificiellement associésjusqu’à ce que les toutes dernières pagesjustifient ce lien, éclairant l’ensemble. Làoù le jeu littéraire s’avère plus subtil, c’estqu’une partie de ce qui raconte l’impos-ture musicale est elle-même une impos-ture… Un roman intéressant, donc, à deuxréserves près : la psychologie du narrateur,au moment de son adolescence, n’estguère crédible (encore que…) ; l’écritureest trop sage, trop académique, sanscette touche d’originalité ou d’inventivitéqui est la marque d’un « style ». 188 p., 18 € F.L.
MORAZZONI Marta
L’invention de la vérité Actes Sud
Compris dans sonsens premier et fort,inventer veut direcréer du nouveau parla force de l’esprit.Inventer la vérité signi-fie, à partir de réalitéschoisies et, en appa-rence au moins, diffé-rentes, les confrontersans les assimiler,dégager une relationplus vaste et plus
riche. Seul l’art peut permettre, entamer etachever cette nouvelle forme.
Ce petit et précieux livre, insolite etpoétique, met en relation la fabricationartisanale de la Tapisserie de Bayeux, sousla direction savante et vigilante d’unereine jamais nommée, et, huit siècles plustard, la visite, qui sera la dernière de savie, que John Ruskin, âgé et fatigué,consacre à la cathédrale d’Amiens. Ilpubliera son ouvrage le plus célèbre, LaBible d’Amiens, où l’on peut lire : « L’exté-rieur d’une cathédrale est semblable àl’envers d’une étoffe qui vous aide à com-prendre comment les fils produisent le des-sin tissé ou brodé du dessus ».
La composition du double récit résulted’une trouvaille remarquable. En alter-nance parfaite, en courts chapitres de troisà quatre pages chacun, nous assistonstantôt au travail, minutieux et harassantde trois cents brodeuses venues de toutesles régions de France, tantôt aux déam-bulations et observations du célèbre écri-vain qui retrouve les détails de l’édificepuis s’égare dans le labyrinthe des ruesd’une laide petite ville.
Entre ces deux trajets parfaitementindépendants se trament des correspon-dances extrêmement fines. Mais ils neconduisent nullement vers une issue unifi-catrice. Terminée, la tapisserie est portée àla cathédrale. Après son errance, Ruskinrejoint son hôtel. Achèvement de deux
Romans, Récits, Nouvelles
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 15
16
parcours qui ont été subtilement confron-tés par la grâce de l’imaginaire. 151 p., 16 € R.P.
PASCAL Caroline
La femme blesséePlon
Histoire d’un couple d’abord idéal surle plan des conventions sociales (elle :grande bourgeoise provinciale ; lui : politi-cien local « d’avenir »), puis, vingt ans plustard, sur le point de se disloquer pour desraisons, banales et éternelles, de lassitudedes jours, ce roman échappe à toutrésumé cohérent qui ne ferait que déflorerson ambiance et peut-être faire croirequ’on l’a déjà lu. Oublions donc l’argu-ment, cependant bien campé, pour s’at-tacher plutôt à l’atmosphère et au stylenarratif, tous deux assez plaisants. Tracta-tions politiques ou réunions de famille,chauds désirs ou sourdes animosités, bon-heurs éclatants des premiers temps ouangoisse de la femme qui se croyait par-faite et se découvre « blessée », lesenfants, les amis, les amours… et les haines,rien de tout cela n’est trop appuyé maistout est cependant d’une lourde pré-sence. La méthode d’écriture, qui renvoieentre chaque chapitre, du présent aupassé, pour mieux souligner, ou dénoncer,la différence entre les deux, avive encorele sentiment qu’on a de l’oppression dutemps sur les êtres. La fin elle-même, sansque ce soit là la révéler, est sujette à cesincertitudes et reste ouverte à toutes lesinterprétations. C’est un bon point pour celivre qui laisse ainsi à son lecteur sa facultéd’évasion. 260 p., 19 € J.-F.C.
POULIN Jacques
L’anglais n’est pas une langue magique
Lemeac Actes Sud
Ce titre facétieux, venu du Québec,est un hymne à la lecture et à la languefrançaise. C’est celui du roman que Jack,le frère du narrateur, s’efforce d’écrire
depuis des années. Francis, lui est un “lec-teur sur demande”. Une annonce dans leJournal du Québec, un coup de fil, et ilarrive dans sa Mini Cooper pour vous liredes livres en français. Il a des clientes atti-trées, friandes d’histoires d’Indiens et derécits de la conquête de la Louisiane. Il y aaussi une femme mystérieuse, qui leconvoque mais n’est jamais là quand ilarrive, tout en laissant sa porte ouverte. Lavie de Francis oscille entre les rêves qu’en-tretient la lecture et la réalité qui parfoisprend trop de place: modestes aventuresqu’on lit avec plaisir. 155 p., 16 € M.H.V.
POUMIRAU Patrick
Emportez-moiRobert Laffont
Un jeune romancier, venu à Londresporter un manuscrit à son éditeur, setrouve, par un malencontreux hasard, prisdans une action de la brigade antiterro-riste et, grièvement blessé, agonise sur lequai du métro. Dans des éclairs de lucidité,il perçoit comme dans un brouillard les per-sonnes qui l’entourent, passants inconnusou policiers, a une demi conscience dessoins qu’on veut lui prodiguer ou des bru-talités qu’on lui administre et, dans cecourt fragment de vie chancelante, revoittous les événements de son existence. Lascène d’ouverture est, nous dit l’auteur, etelle seule, inspirée de faits réels, et leroman est d’ailleurs dédié À Jean-Charlesde Menezes, abattu par erreur de plu-sieurs balles dans la tête par ScotlandYard. Elle est assez haletante et le lecteurprend tout de suite fait et cause pour cettemalheureuse victime d’une consternantebavure policière. Il s’attend ensuite àquelques développements sur les originesde cette tragique méprise pouvant sehausser jusqu’à l’analyse du phénomèneterroriste irlandais en Grande-Bretagne. Ilen sera, en fait, très peu question, le blessése concentrant de toutes ses forces sur lefilm de sa vie, son enfance, sa mère, sesamours, ses velléités d’écrivain pas encorereconnu. C’est ce qui arrive, dit-on, lorsquel’on voit la mort de près, et l’histoire n’estdonc pas invraisemblable. Mais tout cela
Romans, Récits, Nouvelles
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:46 Page 16
17Romans, Récits, Nouvelles
semble un alibi pour permettre à l’auteurde parler un peu de lui. Et d’une façondont la complaisance n’est pas tout à faitabsente. Cela ne rend pas le livre dés-agréable, même si ces récits fragmentésfinissent par lasser quelque peu, mais onreste frustré par cette trop grande person-nalisation d’une histoire qui aurait pu avoir,disons plus de sens politique et social. Leroman ne mérite pas, loin de là, le rejet, etil est assez bien écrit, à défaut d’être soli-dement construit. Mais il manque d’ambi-tion intellectuelle et littéraire. Dommage!200 p., 18 € J.-F.C.
SMARTT BELL Madison
La ballade de JesseActes Sud
Pour qui ignore tout de la musiquerock, country ou blues, de ses traditions, deses chefs de file, l’histoire de la tournéed’un petit groupe d’artistes dans les barsmiteux de la côte est des Etats-Unis peutsembler a priori dénuée d’intérêt littéraire,voire d’intérêt tout court. Madison SmarttBell, lui-même pratiquant assidu, mais aussiromancier, démontre brillamment lecontraire. Jesse, vingt ans, a trouvé dans legroupe Anything goes une sorte deseconde famille, la première se réduisant àun père alcoolique et violent. Le métier demusicien de nuit dans les « Black cat »successifs (comme le chef du groupe auniformément baptisé les salles qui l’ac-cueillent) avec alcool, drogue, rixes oca-sionnelles et amours d’un soir, n’est pour-tant pas facile. La tournée, sous la férulede Perry, le manager, aura pourtant pourle jeune guitariste d’évidentes vertus régé-nératrices. En améliorant son jeu, en élar-gissant son répertoire, en écrivant lui-m ê m e q u e l q u e s c h a n s o n s , i l v aprogressivement s’intégrer au groupe,prendre conscience de ses capacités etmême se réconcilier avec son père. Madi-son Smartt Bell connaît parfaitement lemilieu et les classiques du genre. Nourri àl’évidence de ses propre souvenirs, sonlivre montre en particulier les multiples dif-ficultés rencontrées pour maintenir, mal-gré les défections et conflits internes, la
cohésion d’un groupe par ailleurs exposéà l’indifférence d’un public apathique ouà la modestie des rentrées financières.C’est un peu, réduite à quatre ou cinqmembres, l’ambiance d’une troupe théâ-trale sans grands moyens où le charismedu chef doit à la fois soutenir le moral desartistes et veiller à la bonne organisation duspectacle. Avec des déceptions, des ran-coeurs mais aussi la chaleureuse camara-derie qui peut naître lorsque chacun atrouvé sa place et que le public sait recon-naître la qualité du jeu. L’expériencehumaine que Jesse, le narrateur, raconteici avec une sympathique ingénuitédépasse largement les décors minables etles moeurs douteuses qui en sont l’envi-ronnement habituel ; elle justifie parfaite-ment une immersion provisoire dans un uni-vers culturel probablement assez éloignéde celui des lecteurs du Bulletin mais dontl’influence est considérable. 355 p., 22,50 €J.F.
SORRENTINO Gilbert
La Lune dans son envol Actes Sud
A première vue, ces vingt nouvellesbrossent un portrait sinistre de la jeunesseaméricaine des années 60-70. Person-nages paumés, dégénérés par l’alcoo-lisme, tortueux et égocentriques, fréné-tiques dans la haine et le mépris, obsédéssexuels pervers, ce qui nous inflige desscènes récurrentes et répétitives (car, dansce domaine, les variantes sont peu nom-breuses) où les femmes sont encore plusvicieuses que les hommes. L’auteur secomplait visiblement dans une attitude devoyeur minable. Pourtant, le lecteur doitsurmonter son dégoût, car Sorrentino,auteur typiquement américain malgré laconsonance de son nom, déploie une ori-ginalité formelle assez attachante. Il sedéclare convaincu que le langage esttout à fait incapable de saisir les chosesdans leur objectivité et leur vérité et doncque le procédé et l’imagination sont libresd’élaborer des récits interchangeables etdifférents, sans aucune valeur supérieurede l’un ou de l’autre. Ainsi, il intervient en
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 17
18 Romans, Récits, Nouvelles
son nom propre dans ses textes, juge cequ’il écrit, se moque de ses propos ou ren-voie des poncifs à la poubelle, répète,d’une nouvelle à l’autre des paragraphesentiers, installe les mêmes personnagesdans des contextes divers. C’est peut-êtrepourquoi ses descriptions cyniques et sathématique pornographique constantesont les symptômes finalement assez tou-chants de son étiage littéraire 315 p., 22,80 € R.P.
THÉROUX Paul
Suite IndienneGrasset
Trois longues nouvelles composentcette suite indienne. Les protagonistes sonttous Américains. Dans la première, un cou-ple est venu pour un séjour de remise enforme dans un grand hôtel sur les contre-forts de l’Himalaya. Au contact d’une Indeque leur arrogance, leur incompréhensionles empêchent de saisir, mari et femme seséparent. Le rêve exotique se transformeen un cauchemar qui les engloutit à la fin.
Même incompréhension des gens etde la vie à Bombay pour l’homme d’af-faires venu en Inde pour négocier dejuteux contrats de sous-traitance. En fran-chissant la ”Porte de l’Inde” qui sépare sonhôtel de luxe de la ville, il passe dans unautre monde. « L’Inde vous attirait, ellevous prenait au piège, vous subvertissait etvous transformait jusqu’à vous rendreméconnaissable. »
C’est bien aussi la transformation queva subir la jeune étudiante qui a entreprisun grand voyage de découverte dumonde. Naïve, trop sûre d’elle et de sesconvictions d’occidentale, elle se retrouveen but aux assiduités d’un jeune Indien quila poursuivra sans relâche et la violentera.Le dieu éléphant Ganesh sera l’instrumentde sa vengeance dans une conclusiondramatique de ce voyage.
Paul Théroux évoque admirablementle fourmillement des gens dans unegrande ville, la touffeur insupportable desjours qui ne connaît pas de répit. L’Inde est
aussi le pays où coexistent les éléphantssacrés des temples et les centres d’appeloù l’Occident trouve assistance. On liraces récits avec beaucoup d’intérêt et deplaisir. 423 p., 20,90 € M.H.V.
VELUT Stéphane
Cadence Christian Bourgois
Le narrateur de ce livre insolite, quitranche sur la production actuelle, est unpeintre munichois qui, à l’arrivée de Hitlerau pouvoir, est chargé par les nazis depeindre une enfant représentative de lasplendeur du peuple allemand. On lui livreune fillette, taciturne et passive, qu’il vatraiter selon un projet qui relève, il le sait lui-même, d’une démence atroce et raffi-née. Aidé par un ami, prothésiste de génie,il enferme graduellement la petite dansune cuirasse de métal et de cuir, unearmature complète d’une raideur impla-cable qui ne lui laisse que des possibilitésde mouvements minimes et douloureux, illa transforme en robot, en carapace d’in-secte qu’il peut, dans l’intention, dit-il, delui permettre du repos, pendre au mur etau plafond.
À vrai dire, la fiction d’un automate quisemble vivant, d’une créature artificielle,est un thème courant et même un mythe,de Pygmalion à Metropolis de Fritz Lang,en passant par le Golem, Mary Shelley,Hoffmann, Villiers de L’Isle-Adam, Collodiou Karel Capek. Mais ici, il s’agit du pro-cessus inverse : plaquer le raide sur le sou-ple, le mécanique sur le vivant, la machinesur l’organe, l’artifice sur le naturel. Il estclair que l’auteur recherche un parallé-lisme entre la réalisation inhumaine (ausens premier du terme) et l’expansion dunazisme. Métaphore pleine de sens, maisseulement jusqu’au moment où leshumains se transforment en animaux, allu-sion au Rhinocéros de Ionesco, ce quidonne lieu à une description longue etpeu réussie. L’issue grand-guignolesque etsanguinolente est peu convaincante, maispeu importe car l’ensemble donne à pen-ser. 189 p., 15 € R.P.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 18
19Romans, Récits, Nouvelles
Les rédacteurs ont lu aussi…
CHEVRIER Jean-Marie – Départemen-tale 15 - Le narrateur quitte Paris pour unpetit village de l’Indre, où il se rend régu-lièrement en pèlerinage. En route, il prenden stop un jeune homme dont la petiteamie, enceinte, ne donne plus de ses nou-velles. Puis se joint à eux une femme à quison amant a posé un lapin dans un hôtelde charme. Ce curieux road movie à lafrançaise, sur les routes de Touraine, faitcohabiter pendant quelques jours trois per-sonnages que rien ne devait réunir et quetout oppose, âge, goûts, expériences, sta-tut social. Leur point commun: une soli-tude qui va pouvoir se dire à la faveur debrèves confidences. La fin déçoit. 176 p.,14 € F.L. Albin Michel
HINFRAY François – L’homme qui parleen marchant sans savoir où il va – Dans detrès courtes nouvelles, échos d’un universcosmopolite, sont évoqués avec douceurces moments de la vie où une rencontre,une parole, un incident de parcours sem-blent marquer un tournant, fournir la cléqu’on attendait. Les brèves histoires de ceshommes et de ces femmes auxquels l’au-teur s’adresse comme le ferait un doublebienveillant mais vigilant constituent unesorte de carnet d’instantanés de la condi-tion humaine dans ce qu’elle a de plusaléatoire et de plus fragile. 223 p., 18 € J.F.de Fallois
NOTHOMB Amélie - Le Voyage d’hiver- Dix-huitième titre de la fantasque roman-cière francophone… Choquerai-je les lec-teurs du Bulletin en affirmant qu’il est désolant de savoir que nombre de jeunesécrivains ne sont jamais publiés, faute denotoriété et non de qualités d’écriture,quand Amélie, elle, peut compter sur unéditeur certain de réaliser une bonneaffaire financière. Mais « littéraire » nerime que faussement avec « financière » !Certains parviendront peut-être à trouverdes qualités à cette histoire (heureusementbrève). Pour ma part, je n’y ai vu que duvide: Amélie Nothomb n’utilise les lettresque pour produire du néant. 134 p., 15 €F.L. Albin Michel
ROIG José Miguel – Soleil coupable –Une tragique et longue histoire (vingt-cinqannées) sur fond de luttes révolutionnairesau Vénézuela mais que la modeste épais-seur du livre réduit à une sorte de résumé,d’ailleurs privé du dénouement expliciteque l’on attendait. L’intéressant scénarioimaginé par l’auteur aurait, me semble-t-il,justifié soit un long récit nourri de tout ceque le contexte politique, familial, profes-sionnel, pouvait impliquer, soit quelquechose comme un thriller. En l’état, leroman est quelque peu décevant. 169 p.,22 € J.F. Mercure de France
Et quand les météorologues se fontromanciers…
FOLIN Sébastien - Les fils du volcan -Recueil de contes inspirés par le folklore dela Réunion. Le cadre est à la fois fantaisisteet précis, car les petites îles volcaniquesdisséminées dans l’Océan des Indiens ontdes formes géométriques et sont peupléesde tribus attachées à leurs différences. Cescontes ont, pour la plupart, une intentionmorale: le Rwa vaniteux, fainéant et tyran-nique, ne sera pas choisi à nouveau parl’Oiseau Magique, l’égoïste comprendrason erreur et se convertira. Le tout dansune atmosphère enchantée où foisonnentles manguiers, les goyaviers, les flam-boyants … dans le parfum de la vanille, etles brûlures du piment. Les illustrations sontfraîches, gaies et décoratives. Un joli petitlivre. 182 p., 18 € M.C. Anne Carrière
LABORDE Catherine – Maria del Pilar –La célèbre présentatrice de la météoraconte ici une histoire vécue, celle de samère, jeune Espagnole installée à Tarbesqui fut passionnément amoureuse d’un deses camarades de la Résistance. À la Libé-ration, elle cherche avec obstination àsavoir ce qu’il est devenu après son arres-tation par les nazis, mais en mai 45 elleapprend la vérité sur son sort – une véritéqui la laisse à jamais meurtrie, même si ellese résigne à épouser un ami commun.Roman qui vaut plus par l’émotion qu’ilsuscite que par ses qualités d’écriture. 166p., 17 € F.L. Anne Carrière
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 19
H istoire, Biographies
L'ENVERS DE L'HISTOIRE NAPOLÉONIENNEpar Rémy HÊME de LACOTTE
Normandie, 1807. La police démantèle une organisation chouanne soupçonnéed’avoir fomenté, quelques mois plus tôt, l’attaque d’un transport de fonds publics. Parmiles conjurés, deux femmes de l’ancienne noblesse. La marquise de Combray,condamnée à vingt-deux ans d’emprisonnement, subira à Rouen, six heures durant, lapeine de l’exposition. Sa fille, qui a prétexté une grossesse pour retarder son exécution,est guillotinée quelques mois plus tard. Les balzaciens avertis auront reconnu l’histoire deMme de La Chanterie, qui sert d’intrigue à L’Envers de l’histoire contemporaine. Peut-être cependant ignorent-ils qu’elle s’inspire de très près d’un épisode réel que restitue ledernier ouvrage de Jean-Paul Bertaud (lequel ne souffle mot il est vrai de ce remploi litté-raire, mais la correspondance des faits est trop patente pour que l’identification soitfortuite). Encore la réalité surpasse-t-elle, ici, le roman: audacieusement évadé du Temple,l’instigateur du coup de main et modèle du chevalier du Vissard, Armand Le Chevalier,n’hésitera cependant pas à revenir s’y livrer contre la liberté de sa belle-sœur retenue enotage et sur la foi d’un sauf-conduit dont il pourra, comme son ancien général Frottéquelques années auparavant, mesurer toute la valeur devant le peloton d’exécution.
L’ambivalence préside aux rapports des royalistes et de Napoléon. Déçus par l’échecde leur « Grand Assaut » contre le Directoire en 1799, les premiers ont été tentés de voirdans l’homme de Brumaire un nouveau Monck, et pour certains ont été longs à sedéprendre de cette illusion. Quant au pouvoir, consulaire puis impérial, qui a pris la mesurede la force de cette opinion, il a opté pour une répression ciblée mais impitoyable desopposants les plus déterminés, associée à un programme bien connu de retour au calme,d’assainissement financier, de conservatisme social et d’apaisement religieux susceptibled’entraîner sinon l’adhésion du moins l’acceptation sereine du nouvel ordre des choses.Avec la monarchisation progressive du régime (consommée en 1810 par le mariage autri-chien), s’ajoutera une intégration de plus en plus poussée (et parfois forcée) desanciennes élites dans les nouveaux cadres administratifs, militaires ou curiaux, à laquellebien peu échappèrent finalement, si l’on veut bien prendre en compte jusqu’auxéchelons les plus modestes (mairies des villages), avec des résultats contrastés : très minori-taires seront en fin de compte les ralliements sincères et durables à la IVe dynastie (commecelui de Las Cases, l’homme du Mémorial, ancien soldat de l’armée de Condé devenuchambellan de Napoléon) en 1814-1815. Une telle politique pouvait-elle de toute façonréduire le royalisme? La faible structuration du courant, son caractère hétéroclite tantdans sa composition que dans ses méthodes et ses moyens (les tentatives d’attentatcontre Bonaparte sont loin de faire l’unanimité; la frontière est parfois ténue entre chouan-nerie et brigandage), qui entrave son action, fait aussi la force d’un mouvement qui relèveplus d’une sensibilité et, à ce titre, se nourrit des motivations et des mots d’ordre les plusdivers. Il est difficile de mesurer ce que pèse la fidélité aux Bourbons ; les déclarations deLouis XVIII ne rencontrent pas toujours un grand écho, mais les Princes ne sont pas si oubliésqu’on ne le dit communément. La marquise de Combray, ainsi, tient toujours une
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 20
21
chambre prête pour accueillir le roi à son débarquement en France; resterait à savoir cequ’elle connaît réellement de lui. En revanche, la cause peut sans doute compter sur lamémoire des malheurs de la famille royale, propre à entretenir un royalisme sentimental.Plus généralement, le souvenir des combats menés sous la Révolution, la cohérence avecles choix passés et la force des habitudes contractées est aussi un ressort important,quoique trop oublié, de la permanence d’une activité royaliste : « périssons du moins avecgloire puisque nous ne pouvons vivre avec honneur » écrit à Fouché Armand Le Chevalierdans une lettre superbe que J.-P. Bertaud reproduit presque intégralement. Enfin, leroyalisme, entré en sommeil à partir de 1807, apogée de l’Empire, exploite discrètementmais habilement les faux pas du régime, le caractère de plus en plus insupportable dela ponction en hommes, le marasme économique ou les prisons de Pie VII : lorsque lesChevaliers de la Foi contribuent à répandre les documents pontificaux, ils ouvrent la voieau retour des Bourbons, même si rien n’aurait pu se faire sans la trahison des anciens digni-taires impériaux et l’accord des souverains alliés, tous ralliés à cette idée. En ce sens, leroyalisme de la Restauration est tout à la fois résurgence et résurrection, avant que lescontroverses autour de la Charte puis les Cent-Jours ne lui impriment une marquenouvelle.
Longtemps, cette histoire-là fut l’apanage d’érudits, dont les affinités avec le sujetétaient évidentes. Il fallut pratiquement attendre la synthèse toujours utile de JacquesGodechot en 1961 sur La contre-révolution pour que cette dernière acquière son pleindroit de cité universitaire, suscitant depuis d’assez nombreux travaux. Jean-Paul Bertaudunit avec bonheur le meilleur de ces deux traditions, en n’hésitant pas recourir aux travauxdes premiers pour exhumer maints épisodes souvent oubliés : qui se souvient encore de« Louis XVII » Fruchart, un paysan qui de décembre 1813 à février 1814 tint tête avec unmillier d’hommes aux troupes régulières dans le Nord ? Ou des séminaristes et des collé-giens de Vannes se joignant au soulèvement contre Napoléon lors des Cent-Jours? Onretiendra également le réel talent d’écriture de l’auteur, un art consommé de l’expo-sition des faits (on s’en convaincra dès le chapitre liminaire, avec le récit très vivant del’assaut des Blancs contre Toulouse le 6 août 1799), la chaleur de son évocation. Surtout,on appréciera la compréhension presque intime que Jean-Paul Bertaud – ancien secré-taire général de la Société des études robespierristes, mais aussi fils de la Vendée, toutautant familier des soldats de l’an II que des journalistes « amis du roi » – manifeste àl’endroit de ses personnages : une empathie discrète qui parcourt tout le propos mais setient exempte de toute complaisance et qu’éclaire la conclusion. Dans un système quicherche à étouffer l’espace public et dispose pour son compte de tous les relais d’infor-mation (administration, presse, clergé) « les royalistes sont quasiment les seuls à donnerune contre-lecture des événements politiques et militaires » (p. 405). Témoin un de leursplus brillants représentants : « c’est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dansl’Empire » (Chateaubriand).
Peut-on conclure sans signaler quelques petites inexactitudes qui se sont glissées dansle texte, fautes de transcription (l’abbé Bernier, qui pacifia la Vendée pour le compte deBonaparte, est qualifié p. 69 de curé de Saint-Loup et non de Saint-Laud d’Angers ; p. 250les Quatre Articles de 1682 sont datés de 1692) ou erreurs plus factuelles (ainsi p. 327 : leduc d’Angoulême n’a pu apparaître en uniforme anglais aux côtés de Louis XVIII lors del’entrée de celui-ci dans la capitale le 3 mai 1814 ; à cette date, ce prince était encoredans le Midi) ? Autant dire que pour tout autre livre, on s’en serait dispensé sans scrupuleaucun. Mais sous la plume de Jean-Paul Bertaud, on craindrait trop qu’elles ne s’accré-ditent.
BERTAUD Jean-Paul, Les royalistes et Napoléon, 463 p., 25 € Flammarion
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 21
22
BACHELOT Bernard
Raison d’Etat L’Harmatton
Ce petit livre très dense et très docu-menté évoque un épisode peu connu durègne de Louis XIV. Le roi souhaitait établirune base navale sur la côte de l’Algériepour surveiller les barbaresques qui sévis-saient en Méditerranée (n’avaient-ils pascapturé, entre autres, Cervantès et lefutur St Vincent de Paul, pour les vendrecomme esclaves?). Le port choisi étaitGigeri (actuellement Jijel), et le com-mandant de l’expédition le Duc de Beau-fort, cousin du roi ; autour de lui uneconstellation d’officiers aux états de ser-vice souvent brillants, et Colbert, associéà cette opération en tant que conseiller.Mais Gigeri fut un échec ; les troupesdurent rembarquer à la hâte sous la pres-sion conjointe des Berbères et des Turcs ; ils durent même abandonner leurscanons.
Il s’ensuivit un procès où les officiersjugés responsables de la défaite durent se défendre. Il ressort de ces interroga-toires que le vrai responsable était le Ducde Beaufort, mais, cousin du roi, il étaitintouchable, c’est donc l’honnêteGadagne qui fut choisi comme boucémissaire. Pour achever le tout, on pré-texta qu’une épidémie de peste auraitforcé les officiers à décider du retrait pré-cipité de leurs troupes. C’est là l’histoired’une défaite dont la véritable cause futsans doute la zizanie qui régnait entre lesofficiers et le présomptueux Duc de Beau-fort.
M. Bachelot présente cette histoiresous forme de dialogues entre juges etaccusés, ou d’extraits de lettres et demémoires du temps. Le style de l’auteurs’est fait mimétique; nous pouvons goûterla langue du XVIIe siècle, sans erreur nifaute de goût. Nous avons là un courtrécit, certes un peu austère par le sujet,mais d’une grande qualité d’écriture. 170 p.,16,50 € M.C.
BANDE Alexandre
Le cœur du roiTallandier
A partir du XIIIe siècle les rois capétiens,puis les Valois, adoptèrent l’usage, pournous bizarre et peu ragoûtant, de donnerà leurs défunts des funérailles multiplesaprès « partition » du corps : ici le corps(dûment découpé, bouilli et réduit auxossements), là les entrailles, ailleurs le cœur.Après d’ardents débats théologiques etune fois vaincues les réticences du pape,la coutume s’installa et devint même unespécialité de la famille royale française etde ses proches.
A l’origine, toute cette triperie était unenécessité quand on voulait ramener àSaint-Denis le défunt mort parfois très loin.Il n’y avait pas de camion frigorifique… Etpuis, on retrouva les images de l’Antiquitégrecque et biblique sur le cœur, siège desvertus et des vices, du courage et de lavolonté, également sur les entrailles, siègede la miséricorde. Et la pratique se répan-dit largement à partir du XVIe siècle.
Le présent livre raconte de façon cir-constanciée les funérailles des rois, reineset princes royaux jusqu’à la fin du XIVe siè-cle et, pour les siècles suivants, se contentede donner les grandes lignes. Il ne va pasjusqu’à éclairer la conception même dupouvoir royal, comme l’avait fait le livrepuissant et inspiré de Jean Nagle, La civili-sation du cœur (Bull. octobre 1998). 255 p.,21 € H.H.
BERGER-MARX Paule
Les relations entre les Juifs et lescatholiques dans la France del’après-guerre 1945-1965
Parole et Silence
Dans l’histoire de ces relations, lapériode choisie par l’auteur est décisive: lechoc émotionnel violent causé par ladécouverte des abominations hitlériennes,et l’évolution intérieure rapide de l’Églisecatholique en ces vingt années, entraînè-rent l’abandon définitif de certaines habi-
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 22
23Histoire, Biographies
tudes de pensée et l’apparition de com-portements nouveaux. Toutefois, les causesprofondes d’incompréhension, parfois detension, ne furent pas éliminées entrecatholiques et Juifs. Si l’on voulait résumeren quelques mots cette thèse universitaire,on pourrait le faire ainsi : du côté juif,défense farouche, exigeante et pointil-leuse de la judéité, dont le sentiment s’estintensifié sous l’épreuve; du côté catho-lique, renforcement d’un mouvement néavant guerre, tendant non seulement àéradiquer l’antisémitisme, mais à recon-naître l’héritage juif dans le christianisme,et donc à créer un climat nouveau. Lesefforts catholiques obtinrent un premierrésultat important en 1965, dans la décla-ration conciliaire Nostra aetate.
De part et d’autre, en fin de compte,les acteurs furent peu nombreux. D’uncôté, avant tout, Jules Isaac, le pionnier,l’animateur, actif jusqu’à sa mort, surve-nue en 1963, sans qui il ne se fût pas passégrand’chose ; avec lui, naturellement,quelques autres, dont le grand rabbinKaplan. De l’autre, le Père Démann, avecles Pères et les religieuses de Notre-Damede Sion. L’association des Amitiés Judéo-chrétiennes, fondée en 1948 avec deshommes comme Maritain, Daniélou, Mar-rou, Madaule, faisait le lien et menait uneaction de réflexion et de diffusion.
Rencontres, débats, publications,furent innombrables. Si l’on excepte lesquestions du « déicide » et de l’expression« perfidis judeis » dans la liturgie du Ven-dredi Saint, humainement pénibles, maisthéologiquement secondaires, le litige por-tait essentiellement sur deux points, quin’en font qu’un: Israël est-il toujours le peu-ple élu? l’Église du Christ est-elle le « nou-vel Israël », né après que le premier eûtaccompli sa tâche? Les positions fonda-mentales des deux parties étant difficile-ment conciliables entre elles, tous les dia-logues imaginables ne pouvaient guèrefaire autre chose que rendre les discus-sions moins aigres et les relations plus cour-toises ; c’était déjà un résultat non négli-geable. Du côté catholique, tandis qu’unpetit nombre était prêt à beaucouplâcher, d’autres se montraient plus réser-vés ; il y eut des ruptures, la plus notable
entre Isaac et Marrou. En 1953, l’atmo-sphère se trouva gravement alourdie parl’affaire Finaly, puis en 1963 par la cam-pagne lancée contre la mémoire de Pie XIIà partir de la pièce Le Vicaire. Mais unapaisement relatif se produisit quandmême, conséquence, pour une grandepartie, des profonds changements inter-venus dans l’Église (en l’occurrence, chezles Pères et surtout chez les Dames de Sion)après la mort de Pie XII et au début duconcile.
Cette histoire, on le voit, affronte desquestions difficiles, délicates, demandantprofondeur, finesse et respect. On eût, jepense, gagné à les présenter dans touteleur ampleur, sans se contenter de repro-duire tout au long des pages les exigenceset les accusations de la partie juive. 549 p.,32 € H.H.
BOUCHARD Françoise
Le Père Louis BrissonSalvator
Prêtre du diocèse de Troyes, Louis Brisson(1817-1908) fut chapelain puis aumônierdes visitandines de cette ville. Confesseur,prédicateur, professeur dans l’institutiontenue par les religieuses, il se pénétra de laspiritualité de saint François de Sales,conçue pour des laïcs dans le siècle.
Il prit en mains la section champenoisede l’Association Catholique de saint Fran-çois de Sales fondée en 1857 par Mgr deSégur. Il créa des patronages puis desfoyers pour les jeunes ouvrières isolées. Sonœuvre principale est la fondation de deuxcongrégations salésiennes étroitementliées à la Visitation : les Oblates de saintFrançois de Sales, en 1868, consacrées àl’apostolat éducatif auprès des jeunesouvrières (foyers, écoles, ateliers, etc.), etles Oblats de saint François de Sales en1873, des prêtres voués à l’enseignement.L’expansion hors de France permit à cesinstituts de survivre lors des crises anticléri-cales. Il est intéressant de noter que Brissonreçut une aide efficace de Mgr Mermillod,évêque de Genève, l’une des têtes ducatholicisme social de ce temps.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 23
24
Ecrit sur un ton très familier, le livrebaigne dans une atmosphère curieuse :l’abbé Brisson et la supérieure des visitan-dines bénéficiaient de façon quasi natu-relle de lumières particulières qui les gui-daient dans leurs décisions ; dans lesmoments délicats, de discrètes interven-tions venues d’en haut les aidaient à pas-ser le cap… Quoi qu’il en soit, c’est untémoignage sur la fécondité du premiercatholicisme social au XIXe siècle. 309 p., ill.,22 € H.H.
CHANTRAINE Georges
Henri de Lubac T. II Les annéesde formation (1919-1929)
Cerf
Le deuxième volume (sur quatre !) decette monumentale biographie couvre lesannées de formation d’Henri de Lubacdans la Compagnie de Jésus, depuis lenoviciat jusqu’au « troisième an » (ou troi-sième année de noviciat, après la prêtriseet la fin de la théologie). Quand il intègrele noviciat en 1919, ce n’est plus un toutjeune homme, mais un ancien combat-tant, blessé de guerre, que les lésions àl’oreille interne vont faire souffrir et gênerdans son travail intellectuel durant toute lapériode et au-delà, en permanence.
Deux faits dominent ces dix années, àtravers les résidences et les situations diffé-rentes. D’abord, Lubac découvre etapprofondit la philosophie, à laquelle ildonne toute son intelligence, guidé pardes aînés aimés et respectés, les PèresAuguste Valensin et Victor Fontoynont.Sous l’inspiration posthume du Père PierreRousselot, il découvre saint Thomas et luireste attaché quand, avec bonheur, il voitdans la pensée de Blondel la possibilitéd’une philosophie non séparée de la théo-logie : il se sent « blondélien et thomiste » ;autant dire indépendant. Très vite, et deplus en plus, sa réflexion se centre sur lemystère du Surnaturel et les relations del’homme à Dieu (création, Incarnation…).Sa rencontre avec la pensée de Teilhardde Chardin, tout en l’intéressant, me sem-ble avoir pour lui moins d’importance.
Autre fait notable : cet intense travailintellectuel se fait en liens étroits avecquelques jeunes jésuites de sa génération:surtout Robert Harmel (le confident) etGaston Fessard, mais aussi Yves de Mont-cheuil et quelques autres. Entre eux, la cor-respondance est intense, confiante, etagite les problèmes philosophiques les plustechniques. Il y aura même à Fourvière,en 1927-1929, un « groupe Lubac », quifera froncer le nez de quelque supérieursoupçonneux.
Au passage, on relève quelques nota-tions intéressantes. Celle qui revient le plus souvent, au point de former commeun fond de scène, porte sur le faibleniveau des études dans les maisons deformation de la Compagnie, facilementencombrées d’habitudes vieillottes et deconceptions intellectuelles étriquées.Ceux qui sortaient un peu trop des sentiersbattus devaient garder quelque pru-dence dans l’expression de leurs idées.Comme le précédent, ce volume veut présenter tout ce qu’il est possiblede savoir sur la vie de Lubac: ses activitéset occupations, même mineures, sesdéplacements, ses relations de famille et d’amitié, ses travaux intellectuels. Les documents qui émanent de lui ou lui sont adressés sont ici analysés, résumés, découpés, cités avec une minutie certes rigoureuse, mais qui nefacilite pas la lecture ordinaire. 843 p., 56 € H.H.
CHAUDUN Nicolas
Haussmann, Georges Eugène,préfet-baron de la Seine
Actes Sud
Haussmann (1809-1891) a à son actifdeux grandes œuvres : la restructurationde la capitale, aux destinées de laquelleil présida 16 années durant, et sa propreimage, soigneusement entretenue dès lesdébuts de sa carrière et dont sesMémoires, du fond de son ultime retraite,nous ont légué le récit exemplaire, celuid’un grand commis de l’État, d’un servi-teur du pouvoir, préfet à poigne et
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 24
25
homme d’ordre, mais aussi d’un adminis-trateur moderne et éclairé, épris de pro-grès, en butte à la mesquinerie et à la pin-grerie des élites locales. La première lui avalu une renommée inégalée aux quatrecoins du globe (où n’a-t-on haussman-nisé?), la seconde l’a inscrit depuis long-temps au panthéon du Second Empire, àrang égal avec les Morny ou Persigny, loindevant nombre de ministres ou de hautsdignitaires aujourd’hui bien oubliés. Dèsson vivant, l’homme avait fini par incarnerle régime dans son versant autoritaire, aupoint de faire de sa destitution, obtenuepar Émile Ollivier dans les tout premiersjours de son ministère en janvier 1870, legage et le symbole du passage à l’Empirelibéral. De fait, le préfet de la Seine étaittrop en vue et touchait à trop d’intérêtspour que l’opposition négligeât cettecible de choix. Autoritarisme, affairisme,vandalisme: point n’était besoin d’allerchercher bien loin la litanie des chefsd’accusation, tandis que la verve pari-sienne y trouvait, sans efforts excessifs, soncompte, fustigeant tour à tour « OsmanPacha » ou « l’Attila de l’expropriation »avant d’éplucher, sous la conduite deJules Ferry, Les Comptes fantastiquesd’Haussmann.
Ni portrait officiel (deux sontreproduits dans l’ouvrage), ni caricature,l’essai biographique décapant de Nico-las Chaudun rend à Haussmann ses cou-leurs, fait ressortir les nuances et contrastesestompés. Il éclaire les ressorts intimes del’itinéraire d’un fonctionnaire longtempsrelégué à des postes subalternes en pro-vince sous la monarchie de Juillet, qui nedevint préfet qu’avec l’accession au pou-voir de Louis-Napoléon Bonaparte, avantsa fulgurante ascension jusqu’à l’Hôtel deVille de Paris. De là un bonapartisme à toutcrin, d’autant plus affiché qu’il a été tardif.À ce fidèle zélé, l’empereur ne ménageapas son affection, mais Haussmann eutsans doute moins l’oreille du souverain qu’ilne l’a laissé entendre ; en tout état decause, son influence se bornait à sondépartement (dans les deux sens duterme), même si elle lui permit par exempled’enterrer plusieurs fois les projets géné-reux que suggérait à Napoléon III sa fibre
sociale. Mais c’est surtout le bilan urbanis-tique qui mérite d’être révisé, moins dansses résultats (il suffit d’observer un plan dela capitale pour constater que les inter-ventions furent le plus souvent superfi-cielles) que dans les considérations qui ontguidé l’entreprise. Il apparaît que, loind’être le fruit des réflexions d’un visionnairegénial, elles reproduisent en fait pour l’es-sentiel les conceptions des contemporains,certes appliquées avec une remarquableénergie mais sans souplesse ni largeur devue (l’obsession de la ligne droite !). Enfin,s’impose la nécessité de décloisonnerl’épisode haussmannien pour le réinsérerdans une continuité administrative. Le pré-fet du Second Empire y perd certainementen singularité, mais qu’importe : rarementa-t-il été mieux saisi qu’ici, dans sa simpleet finalement touchante vérité. 279 p., 25 € R.H.L.
DOUCET Marc
Des hommes travaillés parDieu Histoire de l’abbayede Belloc
Cerf
Le Père Marc Doucet, moine bénédic-tin de Belloc, et archiviste de son monas-tère, a passé plusieurs années à réunir lesdocuments qui lui permettent de livreraujourd’hui ce fort volume retraçant,depuis la fondation en 1875 jusqu’à nosjours, l’histoire complète et détaillée deson abbaye. Le sujet peut paraître trop cir-conscrit, austère et minutieux à qui ne s’in-téresserait pas spécialement à la vie béné-dictine, étudiée dans le seul cadre de la Congrégation de la Pierre-qui-Vire(aujourd’hui de Subiaco) et de l’une deses maisons. Mais il s’agit d’un travail d’his-torien consacré à la naissance et l’évolu-tion d’une communauté religieuse au paysbasque. Le livre remplit donc parfaitementson but.
Menée avec une parfaite probité,l’étude ne dissimule rien des difficultés quiont jalonné cette histoire, nées soit ducontexte extérieur soit des imperfectionsde ses acteurs. On y verra donc comment
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 25
26
une communauté, éprouvée dès le débutpar les lois anticléricales (quelques pagestrès fortes sur les expulsions), puis par la dis-persion de nombre de ses moines pendantles deux guerres mondiales, enfin par lesdissensions qui n’ont guère cessé de semanifester entre certains de ses membres,a pu garder son unité et son désir de vivrepleinement un projet de vie spirituelle etpastorale qui perdure encore aujourd’hui.C’est donc d’abord une sociétéd’hommes qui nous est décrite, sujettecomme toutes les autres aux doutes, auxangoisses, aux faiblesses, aux pressionsextérieures. Le tableau, malgré un styleparfois un peu « notarial », retient sanspeine l’attention et donne finalement àvoir un XXe siècle dont les turbulencesn’auront épargné personne. 630 p., 48 €J.-F.C.
LACOUTURE Jean
Les Impatients de l’Histoire Grasset
Un journalisteparle de journalistes.Spécialiste des bio-graphies exhaustives,Jean Lacouture pré-sente ici plusieursgrandes figures quiont durablement mar-qué l’histoire de saprofession : ce qui l’in-téresse, ce n’est pas
de retracer leurs vies et leurs carrières (unvolume n’y suffirait pas), mais de mettreen évidence quelle conception de leurmétier a amené tous ces hommes depresse à s’engager radicalement dansl’actualité de leur temps – au risque, par-fois, de se faire les auxiliaires du pouvoir enplace ou de virer dans l’extrémisme nau-séabond (cf. le « lanternier » Henri Roche-fort devenu le chantre de l’antisémitisme).Il n’y a pas lieu ici de discuter les choix del’auteur : il s’en explique dans son Avant-propos. Il n’est pas surprenant qu’il privi-légie, par le nombre de pages, six d’entreeux qu’il a personnellement connus et/ouavec lesquels il a travaillé, ni que, sur les 14
noms retenus, 7 appartiennent au XXe siè-cle, moment où la presse a commencé àacquérir une dimension mondiale. Plussurprenantes la présence de Daumier (quifut aussi journaliste) et celle de BernardPivot, hommage autant à la télévisionqu’au livre qui « fait événement ». À Théo-phraste Renaudot revient le titre d’« inven-teur » (de la gazette, c’est-à-dire « petitepie » !) puisqu’il fut bien un pionnier en lamatière ; puis Rivarol et Desmoulins mar-queront la presse encore balbutiante duXVIIIe siècle, défendant les idées nou-velles ; Rochefort et Bernard Lazare reste-ront eux aussi associés à des momentsforts du XIXe siècle. Mais la figure-phare dela profession, pourrait-on dire, reste AlbertLondres, qui n’eut de cesse de dénoncercertains aspects scandaleux de la Répu-blique, comme le bagne, les asiles ou lesabus de la colonisation… avec de réelssuccès puisque ses emportements serontsuivis d’effets. Parmi les quatorze nomsfigurent ceux de deux femmes: FrançoiseGiroud bien sûr, puisque, redoutableorganisatrice autant qu’esprit clairvoyant,elle fut « la femme faite journal » ; maisaussi Geneviève Tabouis, aujourd’huioubliée alors qu’elle fut l’une des journa-listes politiques les plus audacieusementhostiles aux régimes totalitaires de l’en-tre-deux-guerres – au point d’être nom-mément prise à partie par Adolf Hitler lorsdu rassemblement nazi au stade olym-pique de Berlin, le 1er mai 1939! Le rôled’un Beuve-Méry, avec la fondation duMonde, comme celui d’un Mauriacdénonçant la torture en Algérie (au granddam de ses amis politiques) ne sont plus àdémontrer, ni l’aura qui entoure encore lenom de Jean Daniel, « le maître de notregénération » ; mais on a toujours plaisir àretrouver, sous la plume alerte et parfoislyrique de Lacouture, ces grandsmoments de la presse écrite, qui déjàsemble appartenir au passé. Car, enmême temps qu’un hommage à deshommes, c’est aussi un retour un brin nos-talgique sur un mode d’information d’uneautre époque, tant les méthodes et lesmoyens de diffusion connaissent depuisdeux décennies une mutation radicale !420 p., 19,50 € F.L.
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 26
27
LENTZ Thierry - MACÉ Jacques
La mort de NapoléonPerrin
« Ce n’est pas un événement, c’estseulement une nouvelle. » On connaît laréaction de Talleyrand à l’annonce de lamort de Napoléon le 5 mai 1821. C’est diresi les pseudo-controverses qui ont prospérédepuis sur le compte des derniersmoments de l’ancien empereur des Fran-çais (empoisonnement, substitution decadavre, que sais-je encore?…) n’intéres-sent nullement l’histoire ni les historiens. Il estbon toutefois, de temps à autre, de pro-céder à un assainissement nécessaire, souspeine de voir ces débats ineptes interférerindûment dans l’espace scientifique et leparasiter durablement. Fins connaisseursde Napoléon, Thierry Lentz et JacquesMacé étaient plus que qualifiés pour tordrele cou à ces légendes tenaces. Saluonsleur mérite, car à la vérité rien de plus fas-tidieux que ce genre de travaux qui tien-nent plus souvent de l’enquête policièreque de la quête historique, qui plus est dis-putée dans le cas présent sur le terrainparfois sordide de la médecine légale. Dece périlleux exercice où il leur faut condes-cendre à discuter les plus infimes et insi-gnifiants détails, nos deux auteurs se tirentfort heureusement et avec les honneurs,démontant avec succès les thèses fantai-sistes de leurs antagonistes, lesquels,gageons-le, n’en seront pas convertis pourautant, tant dans ce domaine la crédulitése confond avec la croyance. Peu importeaprès tout. Répétons-le une fois encore: iln’est rien ici de proprement historique. 226p., 17, 50 € R.H.L.
LEWERTOWSKI Catherine
Les enfants de Moissac,1939-1945, Rééd.
Champs histoire
Saluons la réédition du très beau livrede Catherine Lewertowski, Morts ou juifs, lamaison de Moissac, paru en 2003 chezFlammarion. Regrettons avec elle la trans-formation du titre, qui estompe le carac-
tère subjectif et passionné de l’ouvrage.Car le texte de Catherine Lewertowski, sibien informé soit-il, si rigoureux sur le planhistorique, n’en est pas moins un défi et unhommage. Un défi aux puissances de mortà l’œuvre pendant la Deuxième Guerremondiale, un hommage à ceux qui ris-quèrent leur vie pour sauver celle desenfants juifs réfugiés à Moissac. Dans lamaison réquisitionnée sur les bords du Tarn,Shatta et Bouli Simon, cadres du mouve-ment des Éclaireurs Israélites de France,ont rassemblé, maintenu en vie, éduquédes centaines de jeunes juifs, pour la plu-part arrivés d’Europe centrale et parquésavec leurs parents dans les camps d’inter-nements français du Midi. Dans l’esprit duscoutisme et d’un judaïsme vécu commeressource spirituelle vitale, ces enfants ontété sauvés de l’anéantissement. Un livretout vibrant d’admiration et de foi en ceque l’humanité a de meilleur, à mettreentre toutes les mains. 286 p., 8 € C.D.
LIEBMANN Irina
Berlin-Moscou-BerlinChristian Bourgois
Je me demande qui connaît - neserait-ce que de nom - Rudolf Herrnstadt.Lorsque j’ai appris qu’il fut l’un des diri-geants de l’Allemagne de l’Est et que safille était sa biographe, j’ai pensé ne pasouvrir le livre. Mais enfin, il a été traduitavec le concours (c’est-à-dire les subven-tions) du Centre national du Livre, éditépar une prestigieuse maison, salué par desarticles élogieux. Il me faut donc alerternos lecteurs.
Né en 1903 dans la grande bourgeoisiede la Haute Silésie, Herrnstadt devint trèsjeune journaliste au prestigieux BerlinerTageblatt, dont il fut le correspondant àVarsovie. Converti au communisme, ildécida une fois pour toutes de se soumet-tre totalement à l’Union soviétique. Il futembauché comme organisateur, enPologne, d’un réseau d’espionnage auservice de l’Armée rouge. Il est très insolite(ou, au contraire, facilement explicable)qu’il en soit le seul survivant, tous les autresagents ayant été destitués puis assassinés
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 27
28
sur ordre de Staline. En attendant, il resteau Berliner Tageblatt. Après la prise dupouvoir par Hitler, il en est le dernier jour-naliste juif, et ses articles ne contiennentaucun signe de critique du nazisme.
Cependant, fin août 1939, il reçoit l’ordrede rejoindre Moscou. En 1943, il prendcontact avec les communistes allemandsréfugiés en URSS, et qui dépendent duKomintern. Dimitrov le propulse à la directiond’un journal qui exhorte les officiers et soldatsdu Reich à renverser Hitler et à se retirer surles frontières. Il leur promet une Allemagnenouvelle où seraient respectés tous les droitset protégées toutes les libertés dont l’aboli-tion est totale en URSS. Cette propaganden’obtient évidemment aucun résultat.
En 1945, il reçoit l’ordre de revenir enRDA, fonde un véritable empire de presse,élabore des plans pour la reconstructionde Berlin, et enfin, probablement grâce àl’ambassadeur russe, s’insinue au Politburodu parti. Isolé, il ne rencontre que méfiance,voire hostilité, car, dans ce véritable nœudde vipères, tout le monde déteste tout lemonde, l’essentiel est déjà décidé avantmême les parodies de discussion.
Mais brusquement, en 1953, boulever-sements : mort de Staline, prise du pouvoirpar Beria, grèves importantes à Berlin-Est.Herrnstadt croit son heure venue. Probable-ment téléguidé par Beria, il attaque vive-ment le grand chef, Walter Ulbricht, et réus-sit à l’acculer à la démission. Or, le mêmejour, Beria est éliminé. Ulbricht revient sur sadémission, retourne la situation, attaqueHerrnstadt, le fait condamner et expulserde Berlin. Humilié, surveillé, menacé, il pas-sera les treize dernières années de sa viedans des bourgades minables. Il s’occupecomme il peut en écrivant des défenses quine sont évidemment pas publiées.
On n’en voudra pas à Mme Liebmannde dénoncer les crimes des gouverne-ments et partis d’URSS et de RDA, pourmieux défendre son père. Mais personnene pensera qu’il ignorait toutes ces abo-minations. D’ailleurs, elle insiste souvent sursa servilité à l’égard des Soviétiques. Et fairede lui le héros romantique et persécuté dela liberté et de la démocratie est vraimentabsurde. Son style confus, lourd, ampoulé,
ponctué de points d’exclamation et d’in-terrogation, farci de remarques person-nelles insanes et répétitives aura au moinsréussi à dissuader ses compatriotes de toutaccès de nostalgie. 475 p., 27 € R.P.
MARIE Jean-Jacques
L’antisémitisme en Russiede Catherine II à Poutine
Tallandier
Ce livre, bien que cela ne soit pas ditexpressément, semble avoir été écrit enréponse à l’œuvre de Soljénitsyne, Deux siè-cles ensemble. On lira (pp. 405 à 412) lespages consacrées à ce dernier ouvrage etla phrase qui les ouvre rend les choses par-faitement claires : « Alexandre Soljénitsyneentreprend alors de donner à l’antisémi-tisme russe ses lettres de noblesse ». Quel’écrivain ait tenu, malgré lui, à s’exprimer surcette douloureuse question, qu’il essaie decomprendre pourquoi les juifs ont été, tantde fois et en si grand nombre, victimesd’une haine impitoyable, qu’il leur reprochela part qu’ils ont prise dans le mouvementrévolutionnaire, que le titre même de sonouvrage, indépendamment de soncontenu, indique que, selon lui, Russes etjuifs ne forment pas un seul peuple, ne signi-fie pas qu’il ait été antisémite. Le pèreAlexandre Schmeman qui nourrissait à sonégard des sentiments de grande affectionet d’admiration, notait en 1978 dans sonjournal qu’il se sentait « étranger à tout cedont [Soljénitsyne] s’occupait avec tant depassion, ce dans quoi il était si totalementplongé, – cette « défense » de la Russiecontre ses détracteurs, ce règlement decompte avec Février – avec Kerenski, Miliou-kov, les SR, les juifs, l’intelligentsia ». La posi-tion de Soljénitsyne s’explique ainsi, non parun nationalisme ou un patriotisme étroits,mais par son amour pour la Russie et sonamertume de la voir, à son avis, injustementattaquée et déconsidérée. La question estdonc beaucoup moins simple, commed’ailleurs tout ce qui concerne les juifs.
Cela dit, on doit mettre au crédit deJean-Jacques Marie, d’avoir, en consul-tant les archives, les livres d’histoire, lapresse, les romans, les mémoires, les écrits
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 28
29
polémiques (contrairement à Soljénitsynequi puise une très/trop grande partie deses références dans les encyclopédiesjuives), fait une mise au point sur la diffé-rence entre l’antisémitisme nazi et l’anti-sémitisme russe : le premier est historique-ment circonscrit, théorisé, organisé,radical, systématique, le second, àl’époque des tsars aussi bien que sous Sta-line et ses successeurs et dans la Russieactuelle, est presque toujours irrationnel etépisodique, souvent d’origine populaire(les grotesques tentatives de rationalisa-tion sont marginales), ce qui ne veut pasdire, loin de là, que son expression et samise en œuvre soient moins brutales etcruelles. La seule parenté évidente vien-drait de son instrumentalisation politique,plus évidente encore sous le régime com-muniste que sous l’ancien régime. À cetégard, l’analyse du comportement de Sta-line, complexe et apparemment contra-dictoire (Birobidjan, soutien au jeune Étatd’Israël, affaire des « blouses blanches »),est tout à fait éclairante et convaincante.
On reprochera à cette étude sérieusebien que souvent polémique d’avoir laissépasser maintes redites (voir en particulierpp.322 et 323) et, plus gravement, d’utiliserparfois un vocabulaire à couleur partisanequi ne devrait pas trouver place dans unlivre d’histoire. Pourquoi, à l’exemple duPCF et de la langue de bois soviétique,qualifier de « fasciste » le régime national-socialiste ou tout adepte d’un systèmeautoritaire et raciste? Enfin, sous prétextequ’en russe, pour désigner les juifs, le motjid, à la différence du mot iévreï, est dépré-ciatif, est-il vraiment approprié de le tra-duire par « youpin » qu’il s’agisse de propostranscrits ou de déclarations, actes, éditstout à fait officiels? 447 p., 27 € Y.A.
MARTINEZ GONZALES Emilio
Sur les traces de Jean de la Croix
Cerf
Courte mais dense, cette nouvelleapproche biographique - comme le dit lesous-titre - du célèbre religieux, mystique etpoète espagnol est d’un grand intérêt.
L’auteur étant provincial des Carmesdéchaussés de Castille, on aurait pu crain-dre qu’elle soit entachée d’un certain partipris, mais c’est exactement le contrairequi se produit. Le P. Gonzales s’attacheen effet avant tout à éprouver les écrits deceux qu’il appelle « les hagiographes »,tant contemporains de Jean de la Croixque plus modernes, à la vérité plus incon-testable de documents historiques dontbeaucoup étaient jusque-là peu ou pasconnus. Le résultat est passionnant, car ilnous donne à voir un Jean de la Croix plushumain, et donc plus saint sans doute, quen’ont souvent voulu le laisser entendre seszélateurs. La tâche, ardue, de l’auteur adonc été de trier dans les sources celles quipouvaient paraître les plus fiables pourdessiner un portrait plus réaliste d’un per-sonnage qu’on a pu, dès après sa mort,idéaliser dans le but, non avoué mais cer-tain, d’obtenir très vite sa béatification.Jean de la Croix n’en sort pas diminué carcette « pâte humaine » dont il était pétridonne tout son prix à ce qui a fait le véri-table projet de sa vie terrestre : s’aban-donner tout entier, en dépit des contrarié-tés, des refus et des souffrances, à lavolonté toute-puissante de Dieu.
Saluons donc ce beau travail histo-rique. La spiritualité du grand Carme n’yest pas abordée, sinon par résonance,mais ce n’était pas le but de l’ouvrage.Cependant, par la lumière qu’il fait surl’homme, il incite fortement, et ce n’estpas son moindre intérêt, à prolonger parune plongée dans les écrits même deJean de la Croix, réputés difficiles d’ac-cès mais qui le seront sans doute moinsaprès une si féconde introduction. 205 p.,32 € J.-F.C.
PAYAN Paul
Entre Rome et Avignon Unehistoire du Grand Schisme
Flammarion
Le Grand Schisme, voilà une vieille his-toire qui remonte à six cents ans ! Entre1378 et 1417, deux (et même finalementtrois) papes se partagèrent l’obédience
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 29
30
des différents États chrétiens de l’Europe.Peut-on encore trouver à dire du neuf là-dessus? Mais oui, ne nous y trompons pas !C’est que les perspectives historiques ontprogressivement changé. Le chercheurs’intéresse moins aujourd’hui à reconstruirela succession détaillée des événements (ilssont assez bien connus), ou à distribuer lesbons et les mauvais points entre papesauthentiques et antipapes: l’auteur a d’ail-leurs volontairement banni cette dernièreexpression, précisément pour ne pas sefocaliser sur les aspects juridiques relatifs àl’origine de la querelle en prenant partid’emblée entre des bons et desméchants. En réalité, les torts semblentbien avoir été partagés. Le schisme nereposait en rien sur une question dedogme, mais plutôt de politique, à uneépoque où l’Église n’avait pas encorerenoncé à exercer dans le monde unedomination politique, voire militaire. Carl’obédience détermine les rentrées d’ar-gent, dont la cour, mais surtout l’actionpolitique des pontifes, ont le plus grandbesoin. Le royaume de France, sans cesserd’être chrétien, a bien tenté pendantquelques années la soustraction d’obé-dience, et les princes étaient eux-mêmesmus par des motifs rien moins que désinté-ressés… Nous observons aussi une vie dupeuple chrétien, une vie qui semble conti-nuer. Pourtant certains sont en proie à ladésespérance, on recherche des prophé-ties, on s’ouvre à de nouvelles formes depiété aussi bien qu’à la sorcellerie. Nousavons conservé sur cette époque desdocuments nombreux, mais il est difficilede prétendre restituer après coup la psy-chologie des cardinaux, encore moins desfidèles. Se sont-ils vraiment posé la ques-tion : à quel pape faut-il obéir? Disons quela réponse est en général facile, conformedéjà au principe cujus regio, hujus religio,comme ce sera le cas plus tard à l’époquede la Réforme. Sans que le lien soit direct,il est d’ailleurs certain que les polémiquessuscitées par le schisme ont contribué àfaire mûrir ensuite la Réforme protestante.« Peut-on se passer de pape? » On a oséposer à ce moment cette question, ainsique celle de la suprématie conciliaire, etc’est bien ainsi que le problème finit parêtre résolu : le concile de Constance par-
vint à déposer les deux papes pour en élireun autre, de façon définitive. Et c’est làque l’actualité moderne aide peut-être àfaire comprendre le passé: l’auteur plaide,et avec beaucoup de brio, pour qualifiercette assemblée conciliaire de « premièreassemblée de l’Europe ». 319 p., 23 €M.D.
RAZOUX Pierre
Histoire de la Géorgie, la clé du Caucase
Perrin
Historien et responsable au Collègede défense de l’OTAN à Rome, l’auteur aaccompli plusieurs missions en Géorgie.Les événements d’août 2008, l’ont sansdoute incité à éclairer ses lecteurs sur lescirconstances qui y ont conduit. À vraidire, le titre de l’ouvrage est trompeur : lapériode qui précède l’annexion par lestsars, à la fin du XVIIIe siècle, c’est-à-direplus de deux mille ans d’histoire, est traitéeen 80 pages et le XIXe siècle continuéjusqu’à la Révolution de 1917 en 30pages ; pour la « parenthèse soviétique »à peu près autant. Mais les vingt annéesqui viennent de s’écouler, depuis la dis-parition de l’URSS jusqu’à la guerre qui asuivi la sécession des provinces d’Abkha-sie et d’Ossétie du sud avec l’interven-tion de l’armée russe, occupent unebonne moitié du volume. Sur cettepériode, décrite avec une objectivitédigne d’estime (responsabilités partagéesde la Russie de Medvedev-Poutine et dela Géorgie de Saakachvili), la lecture del’ouvrage est très utile : l’auteur montrebien les causes, les caractères et lesenjeux du conflit : particularisme des dif-férentes régions, Mingrélie (noms defamille en -ia : Beria), Géorgie orientale (-chvili : Djougachvili, nom de Staline; l’au-teur remarque qu’ainsi pendant une quin-zaine d’années, la Russie a été soumiseainsi à une association de deux tyrans,l’un dictateur, l’autre policier, d’originegéorgienne), partie occidentale (-dzé :Chevarnadzé) etc. ; environnement cau-casien avec des pays d’origine, delangue, de religion différentes : Azerbaïd-
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 30
Histoire, Biographies 31
jan, Arménie, Tchétchénie, Daghestan,Kabardino-Balkarie, Ossétie, et des conflitsnon réglés comme la rivalité de l’Arménieet de l’Azerbaïdjan à propos du Nagorno-Karabakh et du Nakhitchevan ou laguerre en Tchétchénie ; corruption éten-due et difficilement réprimée des acteursde la politique et de l’économie ; pré-sence du grand voisin, soucieux, aprèsl’effondrement de sa puissance, de gar-der la maîtrise politique sur son ancienvassal, chose facilitée par deux accèscommodes : la Mer Noire et l’Abkhazied’une part, le tunnel de Roki qui perce leCaucase et l’Ossétie du sud d’autre part ;passage du pétrole et du gaz de l’Azer-baïdjan, moyen de chantage perma-nent, par l’oléoduc Bakou-Soupsa qui tra-verse le centre du pays, et les oléoduc etgazoduc BTC au sud; enfin, et ce n’estpas la moindre source de conflit, l’attrac-tion de l’Union européenne et surtout del’OTAN, attraction activée et d’ailleursdramatisée par les relations privilégiéesque la Géorgie entretient, pour des rai-sons historiquement très compréhensibles,avec des pays comme l’Estonie, laPologne et aussi l’Ukraine. L’ouvrage setermine par une intéressante prospectiveen plusieurs hypothèses.
Notons la présence de cartes claireset en quantité suffisante, d’une abon-dante bibliographie et d’une chronologiedétaillée. 400 p. 21,50 € Y.A.
ROCHE Marie-Jeanne
Pétra et les NabatéensLes Belles Lettres
« Je suis belle, ô mortels, comme unrêve de pierre », fait dire Baudelaire à labeauté. Ce qui reste de la ville de Pétraest la concrétion de ce rêve, inscrit dansle temps du 1er siècle avant J.-C. et dansl’espace du désert que l’on ditaujourd’hui jordanien. Le but de la col-lection des Guides des civilisations n’estpas d’abord de faire rêver, mais de faireconnaître.
Ainsi saurons-nous ce qu’il en a été del’histoire et du territoire des Nabatéens, le
peuple nomade d’origine arabe qui s’estspécialisé dans le commerce des aro-mates en direction de la Méditerranée eta trouvé à Gaza son port étape par excel-lence. Les royaumes hellénistiques, puisRome, en ont été les bénéficiaires, avantl’annexion à l’Empire en 106 de notre ère.Entre ces deux siècles de part et d’autrede J.-C., s’est jouée l’expansion duroyaume nabatéen qui a précédé la finde cette culture et l’instauration du chris-tianisme. La langue dérivée de l’araméenrelève de l’arabe.
Ce sont ces vicissitudes historiques quel’ouvrage de M.-J. Roche fait revivre, sansperdre de vue, presque stricto sensu parles illustrations, le site de Pétra particuliè-rement grandiose et bien placé sur lesroutes du commerce trans-arabique, dansson paysage traversé par le Wâdi Mûsa etson défilé du Sîq. De là on va vers la mer,mais aussi vers Damas, par Mabada,Amman et Bosra. La société nabatéenne,très hétérogène, a évolué du statutbédouin à un statut sédentarisé. Plutôtque les noms des rois, mieux vaut retenir lavariété des produits du commerce descaravanes qu’augmentent les ressourcesde l’élevage des chameaux et du petitbétail.
Quand tous ces aspects relatifs à la viedes Nabatéens sont analysés avec leursprolongements culturels, religieux, artis-tiques, on revient, comme ne cesse de lefaire l’auteur du guide, à la réussite extra-ordinaire que représente Pétra jusque dansla vie quotidienne. Les annexes bibliogra-phiques permettent de reprendre toutesles questions et un index général, des lieuxet des personnes, de les retrouver facile-ment. Grâce à un guide comme celui-ci,Petra et les Nabatéens font encore partiede notre humanité d’aujourd’hui ainsi quel’atteste la « tête d’homme en pierre » quiorne la couverture : la cité de grès rosefavorise, après l’oubli, plutôt le rêve, et l’his-toire des Nabatéens, notre goût de laconnaissance des civilisations. La collec-tion, dirigée par Jean-Noël Robert, nedemande qu’à être suivie sur les routesd’une mondialisation bien comprise. 280p., 17 € H. B.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 31
32
SOLNON Jean-François
Le turban et la stambouline Perrin
1453 : prise deConstantinople; 1571 :Lépante; 1683 : siègede Vienne. On résu-merait volontiers à cestrois dates l’histoire desrelations entre l’Occi-dent chrétien et l’Em-pire ottoman. A quoi ilfaudrait sans douteajouter, pour les
Serbes, la bataille du Champ des Merlesen 1389. Pourtant, comme le montre fortbien Jean-François Solnon, les affronte-ments de quatre siècles n’ont jamais tota-lement exclu les compromis, encore moinsune fascination réciproque dont l’art et lalittérature offrent d’innombrables exem-ples. La chute de Constantinople, si sym-bolique qu’elle ait été, ne faisait que met-tre un terme à une patiente conquête desBalkans. L’Empire byzantin ne comprenaitalors plus guère que sa capitale et les ter-ritoires proches, et les relations entre le vieilempire chrétien et le jeune émirat otto-man avaient déjà connu bien des com-promissions, des alliances, voire desmariages. Les admonestations du papePie II Piccolomini ne parviendront d’ailleurspas à susciter la croisade contre MehmetII, qui confie au Vénitien Bellini le soind’exécuter le célèbre portrait aujourd’huià la National Gallery. C’est aux voisinsimmédiats du Grand Turc, partagés entreannexion et protectorat, qu‘il revient d’or-ganiser une résistance où s’illustrentnotamment Skanderberg et celui qu’ondénommera plus tard Dracula. François Iern’hésitera pas quant à lui à s’unir au GrandSeigneur contre Charles-Quint. Le règnede Soliman le Magnifique (1520-1566)marque l’apogée d’un empire que labataille de Lépante affaiblira moralementsans l’abattre mais il faudra attendre ladéfense réussie de Vienne pour mettre unterme définitif à l‘expansion territorialeottomane. Devenu inoffensif, le Turc va setransformer, pour l’Européen, en sujet de
curiosité durable que cafés, kiosques, caf-tans et autres turqueries vont popularisertandis que s’organisent peu à peu desrelations diplomatiques dont les chroni-queurs et peintres de l’époque ont laissédes témoignages pittoresques. Pour l’Eu-ropéen du XVIIIe siècle, le Turc restecependant l’incarnation du despotisme.La Turquie accède tardivement à l’impri-merie et aux techniques venues de l’Oc-cident. C’est Mahmud II qui imposera lasuppression du turban au profit du fezavant l’invention, au siècle suivant, de la“stambouline”, sorte de redingote inspiréedes costumes européens. En 1867, le sultanAbdulhaziz est reçu à Paris mais c’est l’Al-lemagne qui aidera principalement l’Em-pire à moderniser ses forces armées. Cetteévolution, déplorée par beaucoup, y com-pris par des intellectuels européens telsque Pierre Loti, s’accompagne d’unedécomposition progressive jusqu’à ce quela Turquie apparaisse comme « L’Hommemalade » que les Occidentaux s’efforcentcependant de protéger des ambitions dela Russie. Celle-ci prendra sa revanche enencourageant les mouvements indépen-dantistes. La paix de Sèvres, en 1920,consacre le démantèlement de l’Empire,précédant de peu la fin du califat. C’estalors que Mustapha Kémal opte avecvigueur pour une Turquie nationaliste etlaïque. Jean-François Solnon évoque infine, sans prendre parti, le souhait de laTurquie d’intégrer la Communauté euro-péenne; c’est en effet un autre sujet, oùl’Histoire n’est pas seule en cause. Onretiendra de cet ouvrage très complet ettrès agréablement écrit l’extraordinairecomplexité de ce face-à-face qui, durantsix siècles, opposa deux mondes officielle-ment inconciliables mais entre lesquels lacuriosité ou l’intérêt ouvrirent de nom-breuses passerelles. Il n’était pas facile, ensix cents pages, d’en écrire l’histoire poli-tique, militaire et diplomatique tout enaccordant une place convenable auxmultiples acteurs mineurs, écrivains, artistesou savants, qui s’illustrèrent en marge dugrand affrontement. Jean-François Solnons’y est employé avec talent. 626 p., 26,50€ J.F.
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 32
33
VENNER Dominique
Ernst JüngerÉd. du Rocher
1895-1998…Le célèbre écrivain ger-manique a connu une longévité excep-tionnelle et aussi « un destin européen »,qui a une certaine parenté avec celui deson biographe ; ce dernier a publié eneffet en 2006 Le siècle de 1914. Utopies,guerres et révolutions au XXe siècle. Unesorte de sympathie et de connivence intel-lectuelle rapproche les deux auteurslorsqu’ils évoquent les troubles du « pluscruel des siècles ».
Ernst Jünger, selon le fondateur de laN.R.H., a enregistré, tel un sismographe, lesmouvements politiques et idéologiques quiont secoué l’Europe, rythmé sa propreévolution et inspiré ses ouvrages. Il futd’abord le guerrier exemplaire de 14-18,un conflit qu’il a magistralement dépeintdans Orages d’acier. En un deuxièmetemps il a été l’un des penseurs les plus envue de « la Révolution conservatrice »,analysée ici avec beaucoup d’intelli-gence et de précision. Le nationaliste alle-mand fit – comme tant d’autres – un boutde chemin derrière Hitler ; mais dès Lesfalaises de marbre – cette allégorie queJulien Gracq considérait comme un maî-tre-livre – le charme est rompu. Après unedeuxième guerre mondiale plus paisibleque la première et passée, on le sait, engrande partie à Paris, l’ancien officier,entomologiste à ses heures, opère un« grand retournement » : le chantre de laguerre purificatrice devient un militantpour La Paix, le nationaliste ombrageux unpromoteur du rapprochement franco-alle-mand et de la réconciliation entre les peu-ples.
Cette « biographie intellectuelle », quilaisse peu de place à la vie privée, retracedonc, non sans quelques répétitions, un iti-néraire hors du commun. Témoin-type deplusieurs époques? Modèle pour l’Europe?Original inclassable? On hésite à définir laplace que tiendra pour la postérité ce« guerrier méditatif », brillamment présentépar M. Venner. 240 p., 18 € P.B.
WESSELING Henri
Les empires coloniauxeuropéens 1815-1919
Gallimard
C’est une syn-thèse, inédite, d’unerare ampleur, quenous offre ce livre tra-duit du néerlandais.L’historien de Leydetraite à la fois de laconquête, de l’occu-pation, de l’organisa-tion et de l’exploita-tion des colonies
européennes. Et d’absolument toutes lescolonies, répandues sur trois continents,les vastes ensembles comme les îles iso-lées, les territoires acquis par les petits paysautant que ceux des grandes puissances.
Un lecteur français qui connaît son his-toire coloniale n’apprendra sans doutepas grand chose et pourra même s’éton-ner de menues lacunes : Auguste Paviepour les acteurs, Raoul Girardet pour lessources. En revanche, il sera informé avecprécision sur « le cas à part » que consti-tuent les Indes néerlandaises, naturelle-ment étudiées ici en détail, ou encore surles possessions allemandes. Aucun aspectn’échappe au regard perspicace de M.Wesseling, ni l’économie, ni la société, nimême la littérature ou l’art inspirés par lesaventures impériales.
Remarquable aussi la sérénité et la pru-dence avec lesquelles notre auteuraborde les plus délicates questions liéesau « colonialisme » : « Toute généralisationest malaisée » conclut-il au terme de sonchapitre intitulé « Pertes et profits ». Et lesjugements, élogieux comme péjoratifs,relèvent plus de la mentalité de l’époqueoù ils ont été proférés que de l’exacte réa-lité. Un livre à conseiller aux anticolonia-listes patentés ! 560 p., 9,10 € Folio-histoiren°166 P.B.
�
Histoire, Biographies
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 33
S ociété
PAUVRE FRANCE? ALLONS DONC!
Par Michel RUSTANT
L’argent des Français, que vient de publier Jacques Marseille, est-il un ouvragecourageux ou provocant? Provocant, à coup sûr. Sous des dehors bonhommes, cetexcellent chroniqueur et directeur de l’Institut d’histoire économique et sociale à laSorbonne, nous prive de l’un des derniers plaisirs qui nous reste : celui de nous plaindre.De la dégradation du pouvoir d’achat à la “fracture sociale”, tout est balayé d’un reversde main. Le sous-titre, Les chiffres et les mythes, laisse entendre, avec une pointe derésignation – ou d’agacement, que les données réelles de l’économie sont incapablesde venir à bout du misérabilisme ambiant et d’une sinistrose érigée en dogme sociétal.L’auteur ne lésine pas sur les ratios, les pourcentages, les taux de conversion et les tableauxcomparatifs pour démontrer que les Français d’aujourd’hui vivent mieux que ceux d’hieret que l’écart entre riches et pauvres tend à rétrécir. Affirmer pareille chose, par les tempsqui courent, c’est vouloir se faire descendre par la critique. Alors, provocant oucourageux? Optons pour courageux.
Le sérieux du propos va bien au-delà du clin d’œil. Deux exemples désarmants. Lepremier concerne le PIB (Produit intérieur brut). On sait le culte voué à cet indice dont onguette la moindre inflexion puisqu’il est censé mesurer le « bien-être » de la collectivité.Or J. Marseille fait observer que le PIB est construit à partir des déclarations de TVA desentreprises, ce qui revient à comptabiliser comme “richesse” les milliards que coûtent lesaccidents ou les épidémies, et à considérer qu’un pays touché par une catastrophepourrait ainsi afficher un taux de croissance du PIB bien supérieur à celui de son voisinépargné. Observation si judicieuse qu’elle vient d’être reprise par la Commission sur lamesure de la performance économique et du progrès social qui propose de remplacerle PIB par le produit national net (PNN), qui prendra en compte les effets de la dépré-ciation du capital dans toutes ses dimensions : naturel, humain, etc. Deuxième exemple.Chacun se souvient de la piètre considération de F. Mitterrand pour l’argent corrupteur,celui que l’on gagne en dormant. Pourtant, c’est sous sa présidence, puis sous le gouver-nement Jospin, que la Bourse a connu ses plus belles heures, avec une hausse de53,6%. Force est donc de constater que les politiques ont peu de poids sur les grandesévolutions financières ; à l’heure d’un nouveau G20, cela n’est guère rassurant.
En monnaie constante, le revenu moyen de la population a été multiplié par 4,5 ausiècle dernier, tandis que l’écart entre “riches” et “pauvres” a fortement diminué, passantd’un rapport de 300 à la veille de la Première Guerre mondiale à 50 ou 60 dans lesdernières années du XXe siècle.
En réalité, la France est le troisième pays le plus “riche” du monde si l’on rapporte lepatrimoine national net au nombre d’habitants, mais l’épargne non investie représenteun poids mort considérable pour l’économie. Les dépôts non ou peu rémunérés s’élèvent
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 34
35Société
à 672 milliards d’euros. Le besoin des Français d’épargner « pour leurs vieux jours »relèverait d’une attitude fort avisée si elle ne dénotait pas, avant tout, un signe dedéfiance en l’avenir : un bas de laine triste.
Ce qui empoisonne le climat social et politique, ce qui taraude l’opinion publique,c’est le sentiment prégnant d’inégalité : les pauvres se plaignent d’être toujours pluspauvres, et les riches, supposés toujours plus riches, protestent contre une fiscalité qu’ilsconsidèrent comme injustement pénalisante. On remarquera, à ce propos, que nul« expert autorisé » ne s’aventure à donner une définition claire du pauvre et du riche.Mais on sent bien que derrière ces notions, Capital et Travail sont prêts à rompre deslances. Ce qui n’empêche pas Marseille le Téméraire d’affirmer que le partage deux tiersun tiers entre capital et travail, tel que l’avait mis en évidence Keynes, se révèle être uneconstante sur le long terme: lorsqu’il y a croissance du capital, il y a progression du travail(diminution du chômage) et du pouvoir d’achat. Il apparaît donc dérisoire de les dresserl’un contre l’autre, et imprudent de vouloir en changer arbitrairement la répartition.
Le fond du problème réside dans la confusion entre les notions d’inégalité, d’injustice,de misère et de pauvreté. Rien n’y fait. La société ne parvient pas à mettre ces notionsà leur place; nous sommes dans le domaine de la subjectivité et du mimétisme cher àRené Girard : « Tant qu’il y aura des riches, il y aura des pauvres. » Cet aphorisme, pourbrutal qu’il soit, montre bien que ce n’est pas un taux de pauvreté que l’on s’attache àmesurer, mais un taux d’inégalité. L’accroissement du revenu ne suffit pas à faire le“bonheur” des êtres. Pour deux raisons. La première tient au besoin de toujours secomparer, la seconde à l’habitude de s’installer : les chercheurs de l’université de Leydeont ainsi calculé que l’effet d’une augmentation sur le sentiment d’avoir atteint un bonniveau de vie s’annule totalement au bout de trois ans, et que le sentiment d’insatis-faction reprend le dessus…
Il faudrait dire encore un mot sur tout le mal que Jacques Marseille, libéral grand teint,pense de la BCE et de Jean-Cl. Trichet, son président, arc-bouté sur la maîtrise de l’inflationet des déficits budgétaires. Cette rigidité sans nuance est plus qu’un frein au dévelop-pement de l’économie, c’est, toujours selon l’auteur, une cause directe de la propa-gation de la crise ; il faudrait aussi parler de ses propositions de refonte de la fiscalité, quisont littéralement révolutionnaires… et séduisantes ; souligner l’intérêt des 50 pagesd’annexes dont la lecture laisse pantois. Mais où trouver la place? quand il ne reste quecelle d’inviter les lecteurs à se plonger dans ce livre indispensable.
MARSEILLE Jacques L’argent des Français, 395 p., 20 € Perrin
BASTAIRE Jean et Hélène
Pour un Christ vertSalvator
Jean Bastaire signe ici un texte militantauquel il associe sa défunte épouse, entémoignage d’un amour conjugal plus fortque la mort et spirituellement fécond. Celuiqui fut le promoteur ardent d’un Péguycontestataire, débarrassé des poussiéreuxoripeaux dont l’avait affublé la postérité, sepassionne à présent pour l’écologie et sadimension chrétienne. Pour un Christ vert
ne relève pourtant pas du manifeste écolo-giste. Il s’agit, plus largement, ou plus radi-calement, d’une mise en cause du mondemoderne soumis à l’argent-roi, et d’un appelà vivre une pauvreté évangélique dontl’Église elle-même aurait perdu la notion. Encourts chapitres, J. Bastaire, de son écritureaisée et incisive, nous invite à cette conver-sion. Exempt de tout désespoir, il porte unjugement sévère sur notre monde, maisavec la passion du prophète. On sort decette lecture revigoré et reconnaissant, carc’est sur la foi de tels justes que notre monderepose. 118 p., 12, 90 € C.D.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 35
36 Société
BERTRAND Jacques A.
Les autres, c’est rien quedes sales types
Julliard
Sous ce titre, qui ne laisse d’avoirquelque apparence de vérité, de brèves“physiologies”, genre à la mode au tempsde Balzac. La première est celle, sauf votrerespect, du Con. L’auteur raffine. Je m’entiens, quant à moi, à l’expérience d’unecclésiastique, trop tôt disparu, qui en avaitrépertorié quatre variétés : le Con, le Puis-samment Con, le Sale Con (mais j’ap-prouve la variante teigneuse de l’auteur : leSale petit Con) et le Con solennel, qui amon indulgente reconnaissance : l’obser-vation (à distance !) du phénomène aide àsupporter l’épreuve des réunions mon-daines. Suivent l’Imbécile heureux, le Pari-sien, le Provincial, le Conjoint, le Psychori-gide, l’Agélaste (dont la chute estempruntée à Joseph Folliet, avec ses dates,1907-1972 : « Heureux celui qui a appris à rirede lui-même : il n’a pas fini de s’amuser »),le Lambda, etc., il y en a vingt, et même leGroupe. En fait, c’est l’école de Vialatte. Lamarque, c’est l’enfilade des conséquencesen assertions asyndétiques (formulation quime rapproche d’une variété susdite). Parexemple pour le Touriste : « Il passe par uneagence, qui l’oriente vers un “tour-opéra-teur”, qui lui promet un bungalow à six ousept étoiles sur une île déserte. Les presta-tions prévues par contrat ne sont pas tou-jours honorées. La compagnie de chartersdépose son bilan. Le Touriste arrive enretard à l’usine. » Pour la forme, du Vialatte.Pour le reste, c’est selon. Mais le plus sou-vent plaisant, judicieux, facétieux, facile (leSaint). Je m’en tiens là, crainte de m’expo-ser. Mais il n’y a ni le Critique, ni le Profes-seur. 140 p., 15 € B.P.
COQ Guy
Inscription chrétienne dansune société sécularisée
Parole et Silence
Pour parler simplement, il s’agit de laplace du christianisme dans le monde
actuel et de la marque qu’il peut lui impri-mer. Le sujet n’est pas neuf, et la contribu-tion que lui apporte le présent livre suscitedes sentiments mêlés. D’une part, leregard porté sur notre temps y décèleavec justesse et pertinence plusieurs fai-blesses graves : dans la recherche fébrilede l’instantané, notre monde perd le sensde la durée, et donc celui de la tradition,de la transmission ; et donc le sens del’éducation enseignante dans une hiérar-chie naturelle des savoirs et des généra-tions. Dans cet environnement, le chrétiensemble le mieux préparé pour éduquer,c’est-à-dire pour rendre plus humains leshommes en devenir.
Puis, rapidement, on a l’impression quedans la pensée de l’auteur, l’Église a telle-ment besoin de s’adapter au monde quele point de vue de ce dernier s’impose.Son devenir, le monde, finalement, peut leconstruire en se guidant sur ses propreslumières, dans le grand mouvement qui leporte vers son accomplissement : la démo-cratie laïque, en respectant avec ferveurla séparation des Églises et de l’État, dansle culte des valeurs universelles qu’a révé-lées la Déclaration des Droits de l’Homme.Nous y allons, nous y sommes. Restent seu-lement à réduire quelques scories rési-duelles, ou quelques obstacles, commel’intolérance, inacceptable même dansl’Islam (mais oui).
Et là-dedans, le rôle de l’Église ? Bienentendu, il ne s’agit plus de magistère(d’ailleurs, ne s’est-elle pas toujours trom-pée dans ces domaines ?). Non, elle doits’adapter, et pour cela pratiquer le dia-logue, notamment « entre foi et culture »,même si l’on ne sait pas très bien de quelleculture il s’agit. Que si l’Église prétendquand même exercer son magistère, alorsles choses se gâtent. L’auteur qui, naguèreencore, louait Benoît XVI de maintenirl’union entre foi et raison, se joint soudain àla meute hurlante qui s’est dressée contrelui dans l’hiver dernier, et dénonce vio-lemment les « trois scandales » du pape.Puis il s’apaise, et termine par quelquesconseils bienveillants aux évêques et àl’Eglise. Mais il ne suffit pas de prendre leton d’un prophète pour en être un. 213 p.,18 € H.H.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 36
37Société
DUTEURTRE Benoît
Ballets rosesGrasset
Beaucoup se souviennent du scandaleauquel fut directement mêlé l’un des per-sonnages les plus influents de la IVe Répu-blique finissante, Jacques Le Troquer, alorsPrésident de la Chambre des Députés,successeur d’Edouard Herriot à ce poste.Benoît Duteurtre plonge le lecteur dans lesannées 40 et 50, depuis les années deRésistance jusqu’à l’arrivée de De Gaulleau pouvoir, revenant au passage sur lesoppositions politiques comme sur les rivali-tés de personnes – qui remontaient parfoisà l’époque de la guerre. Le Troquer, sep-tuagénaire encore bien vert, a certescommis de sérieux faux pas, d’autant plusque des mineures sont impliquées. Maisl’affaire fut largement exploitée à des finspolitiques, le général De Gaulle lâchanttout simplement un homme qui symboliseune époque révolue et pour lequel iln’éprouve aucune sympathie particulière.L’homme politique au parcours exem-plaire (enfant naturel, boursier, poilu cou-rageux devenu manchot lors des combatsdes Éparges, député de Paris) et amateurde belles (et jeunes) femmes devint ainsi,d’un coup, la métaphore d’un systèmevoué à disparaître. Jeté en pâture à lapresse, il écopera d’une peine finalementlégère (un an avec sursis) : comme l’auteurle fait remarquer avec pertinence, de nosjours « la pédophilie représente une obses-sion devenue presque irrationnelle et dési-gnant le pire des crimes possibles ». Sontaussi mis en lumière les liens existant entrele monde politique et le milieu interlopedes souteneurs et autres « mauvais gar-çons » qui ont leurs entrées du côté des ser-vices secrets … Peut-on être sûr que cettecollusion a disparu ? 244 p., 17€ F.L.
GUILLEBAUD Jean-Claude
La confusion des valeursDesclée de Brouwer
Jean-Claude Guillebaud, journaliste detalent, écrivain responsable et homme de
cœur, réunit ici une petite centaine dechroniques qu’il a fait paraître dans l’heb-domadaire La Vie entre 2001 et 2008. Ellestouchent à presque tous les sujets desociété qui sont abordés avec la franchiseet la conviction que l’on connaît chez l’au-teur. Même sans suivre toujours les ana-lyses développées, on retrouvera avecplaisir et profit ce regard lucide et géné-reux sur les premières années du XXIe siè-cle. Le recueil se termine par une sélectiond’articles intitulée « Et l’espérance ? ».Beau programme, n’est-ce pas ? 275 p., 17 € J.-F.C..
PIERRON Jean-Philippe
Le climat familial, unepoétique de la famille
Cerf
Les discours sur la famille ne manquentpas. L’approche de J.-Ph. Pierron se veutpoétique, non pourtant au sens littéraire duterme, qui pourrait laisser croire à uneanthologie de la famille mise en vers et enstrophes. Il s’agit, dans ce gros livre exi-geant, d’interroger les significations de lafamille à travers ce qu’elle a d’impalpableet d’irréductible à la fois : l’air de famille, sidifficile à définir, et pourtant indéniable.Cette tentative pour penser dans la famillece qui s’y vit sans qu’on y pense, ne va passans mise en perspective historique, bienque l’essentiel du propos ne soit pas là.L’auteur prend acte d’une métamorphosede la famille en « post-chrétienté », ayantrompu avec un modèle dogmatique etnormatif qui, si on le suit bien, ne seraitautre que la sclérose de la famille chré-tienne pétrifiée par le cléricalisme et la« moraline ». Pas de nostalgie, donc, enversla famille dite traditionnelle, mais une priseen compte des pertes et profits de lamodernité qui, en revalorisant l’individu etla subjectivité, ont permis l’émergence dela « famille démocratique ». Vulnérable,cette famille n’en est pas moins « écoledes capacités » et lieu de transmission, unetransmission qui s’effectue désormais par letémoignage plus que par l’affirmation devaleurs. On pourrait objecter que, de touttemps, l’authenticité de la transmission
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 37
38 Société
repose sur l’adhésion du dire et du faire.Bien d’autres questions surgissent à la lec-ture de cet ouvrage important, qui a lemérite de refuser les oppositions crispéesentre modèles différents, et de nous récon-cilier in fine, sous le signe d’une tendressequi libère autant qu’elle protège, avec« ces autres qui sont les nôtres ». 445 p., 39 € C.D.
POULAT Émile
Aux carrefours stratégiques del’Église de France XXe siècle
Berg international
Dix-huit études sont ici réunies, sur unterrain depuis longtemps familier à l’au-teur et labouré par lui dans tous les sens :les problèmes posés en France, au XXe siè-cle, par la présence de l’Eglise dans la citéet dans la société. Une cité et une sociétédont la sécularisation est à peu près ache-vée : le religieux étant confiné dans l’inti-mité du privé, la vie sociale et la viepublique peuvent s’organiser en l’ignorant.Une Eglise qui, dans la première moitié dusiècle, réveille en elle l’espoir de « tout res-taurer dans le Christ » en rechristianisant lasociété et en tenant sa place dans la viepublique. Entre les deux, si les heurts vio-lents disparaissent peu à peu, l’oppositionn’en est pas moins fondamentale et irré-ductible. Que faire ?
Plutôt que de proposer des réponses àla question, les présentes études tententd’en éclairer les données, trop souventdéformées dans les esprits. Naturellement,on rencontre d’abord la laïcité. Mais dequoi s’agit-il exactement ? « La » laïcitéexiste-t-elle quelque part ? On trouvera icides pages lumineuses sur les multiples cas-sures qui font autant d’obstacles : entreles Français qui acceptent l’héritage révo-lutionnaire et ceux qui le refusent ; chez lescatholiques, entre les « ralliés » (mot perti-nent depuis 1890), et ceux que les histo-riens appellent les « intransigeants » (motque je persiste à juger très mal choisi) ;entre les tenants de la contre-révolutionpolitique et ceux de la contre-révolution
catholique ; chez les catholiques sociaux,entre les conservateurs et les démocrates ;etc.
Force est de constater que, durant toutle siècle, l’Eglise n’a guère connu que desdéceptions dans ses efforts dans cetteœuvre de rechristianisation. Sur le moder-nisme, la « condamnation » de l’ActionFrançaise, la J.O.C., les Semaines Sociales,l’Humanisme intégral de Maritain, l’espritmissionnaire nouveau, et bien d’autressujets, noua avons ici des éclairages vrais,et cela pour plusieurs raisons.
D’abord une érudition qui semble iné-puisable et, l’accompagnant, une grandeattention portée au sens des mots, d’oùune pensée claire et précise. Ensuite, uneindépendance d’esprit, trop occupé àdécouvrir le vrai pour suivre le confor-misme intellectuel aujourd’hui régnant.Par exemple, qui, parmi les historiens, oserappeler que le modernisme ne se réduitpas à une antique querelle d’exégètes,mais est un chapitre de la sécularisationde la pensée catholique ? Qui, devantl’opposition entre l’Eglise et la « moder-nité », ose écrire tranquillement cette évi-dence : « La foi chrétienne est à contre-courant de notre monde moderne tel qu’ilmarche » ?
Enfin, un sens aigu de la pensée del’Eglise. Par exemple, il montre comment,dans la « condamnation » de l’Action Fran-çaise, Pie XI ne chercha pas le succès detelle politique, ni même d’abord la pro-motion de telle forme d’apostolat, maissurtout l’expansion de la pensée de l’Eglisesur l’assainissement de la vie des Etats etdu droit public.
Ce livre peut être précieux, non pourune explication de l’histoire, mais pour enaborder les problèmes avec des vues plusvraies. Il ose enfin rappeler que l’un desbuts essentiels de l’histoire de l’Eglise, etmême du christianisme (puisqu’on veut lesdissocier), est de « comprendre ce quis’agite au plus profond de la consciencechrétienne ». Ce qui inclut que cette his-toire-là ne peut pas être laïque. 233 p., 19€H.H.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 38
39Société
PUEL Hugues o.p.
Les raisons d’agirCerf
H. Puel dirigea pendant 10 ans la revueÉconomie et humanisme, aujourd’hui dis-parue. Chacune des Chroniques pour cedébut de siècle, publiées entre 2002 et2007, prend pour sujet l’actualité politiqueou sociale et s’interroge sur les raisons et lespassions qui ont poussé les acteurs decette actualité à agir comme ils l’ont fait.
La chronique sur le catholicisme social,dont l’évolution est remarquablementrésumée, s’interroge : « La foi est-elle uneraison d’agir ou de ne pas agir ? » Questionpertinente qui rappelle la fameuse contro-verse entre Luther et le pape sur la ques-tion des œuvres et de la foi.
Ce qui frappe, au long de ces pages,c’est la distance qui sépare la contin-gence de l’esprit. Le monde est fragilepuisqu’il n’a de pire ennemi que lui-même : la mondialisation, l’économie demarché phagocytée par le capitalismefinancier, la poudrière moyenne-orientale,le terrorisme, l’instabilité chronique ducontinent africain, les États imprévisiblesque sont l’Iran ou la Corée du Nord, sanscompter les déchirements au sein de laFédération russe, le réveil du nationalismechinois ou les flux migratoires impossibles àendiguer. Face à autant de dangers etde peurs que peut opposer le mouvementsocial chrétien dans lequel s’inscrit H.Puel ? Ce dernier répond : dialogue vrai,interaction, échange… Certes, il est dansson rôle, et tous ces articles se signalentpar la même élévation d’esprit. Rien quipuisse braquer le lecteur lorsqu’il affirmeque l’homme, créature et reflet de Dieu,mérite créance en toute chose. On nepeut, cependant, s’empêcher de penserqu’affronter la réalité demande plusqu’une certaine facilité de langage. Enrevanche, une intelligente analyse de lalaïcité, considérée comme moyen de libreaccès à la foi, retiendra l’attention du lec-teur, de même qu’une annexe sur l’his-toire, les grandes heures et les malheursde la revue Économie et humanisme. 236p., 23€ M.R.
VALENTIN Claude
La fabrique de l’enfantCerf
Voici un livre dont le titre et la couver-ture suscitent immédiatement l’intérêt.Ajoutons à cela un avant-propos du pro-fesseur Marcel Rufo, quelques lignes louan-geuses en quatrième de couverture deJacqueline de Romilly, et l’on se diraqu’avec un tel parrainage, le sort de cetouvrage est assuré. L’avant-propos estremarquable : on y lit une apologie de lalittérature comme discours menant aubien, et un appel à créer des passerellesentre les hypokhâgnes et les études demédecine, entre la réflexion philosophiqueet la pratique médicale. Mais à la questionde savoir comment on fait les enfants, ou,pour le dire autrement, comment, cultu-rellement, la notion d’enfant se fait jour, lesréponses de ce livre laissent à désirer. L’au-teur choisit de se pencher sur trois civilisa-tions : la Mésopotamie, la Grèce antique,et l’univers biblique. Il tient pour acquis quele médecin est le personnage le plus àmême de rendre compte de la considé-ration vouée à l’enfant. Ce postulat estaffirmé de chapitre en chapitre. S’il nousvaut quelques développements intéres-sants sur l’histoire de la médecine et sesdéfinitions dans les trois civilisations étu-diées, il n’est pourtant jamais convaincant,faute de sources suffisantes sur lequel l’as-seoir. Cet ouvrage, qui est une thèsepubliée, souffre de sa rhétorique : les par-ties, les sous-parties, les chapitres s’emboî-tent, les introductions s’empilent et la com-pilation d’articles scientifiques tient lieu dematière. Le lecteur, si bien intentionné soit-il, est vraiment malmené, et sa soif intel-lectuelle somme toute bien peu soulagée.412 p., 33 € C.D.
�
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 39
PoésieCHAIN Anne
Les acrostiches de NanoEdifree
Acrostiche: l’initiale des vers donne lethème du poème et souvent reprend letitre. C’est un jeu qui ajoute une contrainteà celle de la rime. La poésie fait bonménage avec le jeu, le hasard avec l’ins-piration, la contrainte avec la trouvaille.D’Arc-en-ciel à Compassion, Nano (hypo-coristique, je veux dire petit nom d’Anne?)nous offre 48 pièces d’alexandrins (enjouant sur la souplesse du e muet). Un mots’impose, qui n’a pas son acrostiche: sim-plicité, qu’on pourrait décliner en bonho-mie, franchise, humour et humeur bonne.Et de la variété des thèmes inspirés par lecours d’une vie (Compétition, Hiver blanc,Enseignement, Mathématiques), s’esquissetrait à trait un portrait fort sympathique,car on devine que la sagesse intérieure,gagnée sur l’inquiétude (Attentes, Soucis),inspire un art de vivre familial et amical(Béatitudes, Enfants adorables, Famille,Fidélité, Jardin potager…). Faut-il un acros-tiche emblématique? Alors c’est, p. 35, Jesuis vivante. 60 p., 10 € B.P.
ÉLUARD Paul - RAY Man
Les Mains libresPoésie / Gallimard
Ce recueil d’Éluard, paru en novembre1937 n’est pas des plus connus. Il est léger :peu de substance, et évanescente, desgrappes de mots, un arpège verbal, des“vers” qui étaient alors langage neuf. Nullecontrainte, de rime ni de raison: pourvuque les mots s’accordent et sonnent juste.Style et (absence de) forme d’époque. Le
titre le dit, joliment: Les Mains libres. La poé-sie se libérait de siècles de forme(s). Nonsans danger. Je pense à Valéry : « Lesbelles œuvres sont filles de leur forme, quinaît avant elles. » Et à Gide (du moins jecrois) : « L’art naît de contraintes, vit deluttes, et meurt de liberté. » L’originalité,c’est le mariage de ces “poèmes” avecdes dessins de Man Ray, plus connu par sesphotographies : style et ligne d’époque,celle de Cocteau, moins sûre, mais plusd’inventions fantasques. Aujourd’hui, unecuriosité, très datée. 160 p., 8,60 € B.P.
GOFFETTE Guy
Tombeau du CapricornePresqu’elles
Gallimard
« Tout est mystère dans l’Amour, / SesFlèches, son Carquois, son Flambeau, sonEnfance. / Ce n’est pas l’ouvrage d’unjour / Que d’épuiser cette Science. » LaFontaine. Ouverture d’une fable peuconnue, L’Amour et la Folie, source possi-ble Louise Labé en son Débat de Folie etd’Amour. On peut en dire autant pour laPoésie. Tout est mystère en elle, ses motscernés de larges plages blanches sur pla-quette de grand format (ô noble traditionde Gallimard), ses rites, ses rythmes, sestitres. Il ne s’agit pas d’épuiser cettescience, mais ici Tombeau est bien le nomde loin venu de l’hommage funèbre renduen vers ; et Capricorne celui d’un café dela Bastille où quatre amis poètes se retrou-vaient pour célébrer la vie. Au nombredesquels Paul de Roux, né en 1937, et lepremier parti. Guy Goffette le revoit partir,laissant « le poids de son silence ». Qu’a-t-il à offrir pour alléger ce poids? Une élégie,ce tombeau, qui boite en vers de neuf syl-
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 40
41Poésie
labes, jusqu’à l’Envoi qui retrouve l’aplombdu décasyllabe pour le briser à la chute.« Adieu Maison où nous faisions la fête /Chaque jeudi n’importe la saison / Nous nereviendrons plus le temps s’arrête / À tescloisons ».
Presqu’elles. Autre recueil, même édi-teur. Des proses, et même des récits. C’estVerlaine cette fois qui me vient à l’esprit.Souvenir de L’autre Verlaine de Guy Gof-fette? Non, un sonnet de Sagesse, un desplus beaux : « Beauté des femmes, leur fai-blesse, et ces mains pâles… » Pour lerêveur de Goffette, les jambes, longuesjambes fuselées, qui se croisent et sedécroisent, s’ouvrent et découvrent, X hié-roglyphique symbole de toutes séductions(souvenir d’une étonnante affiche depublicité pour des bas) et de toutes vani-tés (tibias croisés sous la tête de mort). Ces“récits”, ce sont rêves de poète entre fan-tasmes et fantaisie, qui prennent essor,tournent court, trouvent le relais d’un pein-tre, Modigliani pour l’élongation, Rem-brandt pour les rondeurs de Saskia.Presqu’elles. Pas tout à fait. Presque nes’élide pas dans le bon usage. Guy Gof-fette le sait. Il le fait. L’apostrophe, cetteaspiration, est le signe de son rêve. GuyGoffette n’est jamais que poète. 48p.,12,90 € & 136 p.,12,90 € B.P.
KHOURY-GHATA Vénus
A quoi sert la neige?Le Cherche Midi
La réponse à la question est donnéedès la première page, en exergue à tout lerecueil : « À effacer la terre pour la réécrirecorrectement ». À quoi tout sert-il, la forêt,l’école, la lucarne, un renard, etc. ? Laquestion disparaît de plus en plus, mais pastotalement, dans des inventaires qui n’ontni queue ni tête, au gré d’un carnaval oud’un caravansérail de mots. Nous avons làune belle leçon de poésie - en rire -, peut-être destinée aux enfants, mais un peu,avec sa voie lactée et ses chutes d’étoiles,comme l’est le Petit Prince, c’est-à-dire àceux qui ont gardé un esprit d’enfance etne dédaignent pas plus la fantaisie (« Lesgrenouilles ont bu l’eau du bénitier ») que
la gravité (« Rêve de pluie annonce deslarmes »), la physique des choses que lamétaphysique des mots. Les rêveries quis’alignent, allant à la ligne sans rimes niponctuation, ont pour elles, ici, la raisond’un Bachelard et la déraison d’une alchi-mie. 64 p., 9 € H.B.
NOVARINO-POTHIER Albine
Cent poèmes d’unbestiaire enchanté
Omnibus
Bonne et belle idée : un animal, unpoème pour le chanter, une image pour lemontrer. Cent : d’abeille à vipère. Lespoèmes sont des XIXe et XXe siècles dansleur immense majorité. Quelques “incon-tournables” comme le pélican de Musset,l’albatros, les chats et les hiboux de Bau-delaire, le petit cheval de Paul Fort et« l’âne si doux / marchant le long deshoux » de Francis Jammes que je récitaisjoliment, paraît-il, en mon jeune âge. Etsans surprise larges emprunts aux poètesanimaliers : Jules Renard, Maurice Rollinat,Leconte de Lisle au XIXe siècle, Duhamel,Supervielle, Jacques Roubaud au XXe. Pourla surprise, des inconnus, des oubliés, oudes absents, délibérément peut-être : LaFontaine, deux fables contre quatre à Flo-rian. Bref ! de quoi discuter, découvrir,s’amuser et rêver. La mise en page est soi-gnée, mais une lacune surprenante :aucune indication, nulle part, sur l’originedes planches (certaines proviennentd’éditions de La Fontaine). Pour qui ce belalbum couleur sépia? Si vous connaissezun enfant qui aime les bêtes, les images etles poèmes, n’hésitez pas. Mais l’espèceest rare. 216 p., 24 € B.P.
ROGNET Richard
Un peu d’ombre sera la réponse
Gallimard
C’est « à qui sait voir en marge/de lavie » et « demande où/est la vie promise »,selon la belle expression reprise à Guy Gof-
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 41
42 Poésie
fette, que ces poèmes offrent une réponseà travers des phénomènes ténus, légers,quasi insaisissables, de ceux qu’onrecueille au cœur du silence, dans le blancde la neige ou l’« écriture des branches ».On y retrouve les constantes d’un univers :l’intimité avec la nature, où tout - de l’hum-ble pétale d’hortensia traversant l’hiver à« ma précieuse aurore » - travaille coura-geusement à préserver « notre envie devivre » ; l’évocation tour à tour tendre,amusée ou émue du pays et des gensordinaires ; l’enfance enfin où s’enracineune blessure aussi vive que mystérieuse, etoù brille aussi la chaleur de la « chèrefamille ». Cependant la voix atteint ici uneclarté, une simplicité telles qu’elle endevient bouleversante. D’autant que dis-séminée à travers le recueil, surgissant audétour d’un vers, se murmure la confi-dence d’un amour défunt, avec unepudeur qui laisse entendre son intensité etsa douleur. C’est donc un livre « entreclarté/et nuit » mais « l’ombre heureuse » yest, pour Richard Rognet, « l’enfantdes/étoiles éteintes », moins blessante, plusriche et plus vraie, que la lumière qui n’enest que « la vomissure ». Un peu d’ombresera la réponse ou un poète au sommetde son art. 138 p., 17 € B.M
SILVANISE Frédéric
Langston Hughes, poètejazz poète blues
ENS Editions
Il vaut mieux commencer par lire lesauteurs plutôt que les critiques, recom-mandait à juste titre Sainte-Beuve. Maislorsque les circonstances ont fait que, parexemple, vous ne connaissez pas l’auteuret que vous arrivent les critiques, il n’estpas indifférent de se jeter à l’eau et defaire les découvertes qui se proposent.Vous avez vraiment l’impression de trouverdu nouveau.
En rapport avec la « Renaissance deHarlem » autour de 1920, un poète afri-cain-américain va profiter et vous faireprofiter des connivences et des différencesdu discours poétique et du discours musi-
cal de ces années, dans ce que l’auteurlui-même appelait ses « poèmes jazz » etses « poèmes blues ». Vous ne connaissezpas? Une introduction met bien en évi-dence ce que F. Silvanise appelle « un tra-vail d’alchimiste ». Ensuite deux parties fontpasser des « formes métissées » des pre-miers recueils (1926-1927) à la « grandeforme poétique africaine-américaine » desrecueils polyphoniques (1951-1961) quesont Montage of a Dream Deferred et Askyour Mama qui « empruntent au jazz unecertaine idée de sa structure, son langagevocal et, sur un plan plus politique, sa puis-sance revendicatrice ». De cet itinérairevous vous ferez une idée assez précise etengageante (engagée aussi) grâce auxpoèmes cités et traduits par l’auteur de lathèse. Finalement une lecture de ce genreest stimulante lors même qu’elle vousentraîne dans l’inconnu.
Cet inconnu peut vous paraître plusconnu qu’au premier abord lorsque vouspensez à l’aventure de Léopold Sedar Sen-ghor qui a composé lui aussi avec lamusique. New-York, un de ses plus beauxpoèmes, pactise avec Harlem, « bourdon-nant de bruits de couleurs solennelles etd’odeurs flamboyantes […] » et l’auteurdes Ethiopiques écrit en 1956, donc à unedate proche des grandes formes deHughes : « Nombril du poème, le rythme,qui naît de l’émotion, engendre à son tourl’émotion », comme si le noir de Harlem,malgré la perte de l’Afrique, conservaitson héritage noir. Précision finale oupresque : « L. S. Senghor rappelle qu’il[Hughes] était considéré par les écrivainsde la négritude comme le plus grandpoète noir américain, car c’est bien lui quirépondait le mieux à la définition du termedans le domaine poétique ».
Autour de la notion d’émotion, c’estbien la poésie qui se communique entreun Senghor et un Hughes, entre l’Afrique etl’Amérique, entre la poésie elle-même etla musique. Ainsi même l’atavisme fran-çais ou occidental ne se met pas « horschant » ni ne sent dépaysé. 230 p., 27 €H.B.
�
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 42
S piritualitéTrois ouvrages sur le Curé d’Ars
Jean-Marie Vianney est mort il y a 150 ans, le 4 août 1859. Cet anniversaire est mar-qué par une année “sacerdotale”, voulue par Benoît XVI. L’événement est propice àdiverses publications. Voici déjà trois livres, différents et complémentaires.
Tout d’abord la réédition de l’ouvrage de l’abbé Nodet (1911-1990), Le Curé d’Ars parceux qui l’ont connu. Lors du procès diocésain en vue de la béatification, dit procès del’Ordinaire, ouvert dès 1861, 66 témoins furent interrogés. Il en résulta des milliers depages. L’abbé Nodet, prêtre du diocèse de Belley, familier d’Ars, eut l’idée d’en tirer desextraits en les classant par thèmes (23, de l’enfance à la mort). Étonnante déposition ensa double diversité : sociale, du forgeron au comte Des Garets, de la servante CatherineLassagne aux vicaires successifs du Curé, aux confrères des alentours et aux missionnairesde passage; de contenu, en fonction de la relation au Curé qui l’inspire. Certes, nousavons là le matériau brut qui attend l’historien et le postulateur de la cause, mais à petitestouches, dont la maladresse peut être gage d’authenticité : c’est la vie du Curé au jourle jour, déchiré entre le souci (sens étymologique du mot) de son ministère paroissial etla charge écrasante du “pèlerinage” qui attire des pénitents par milliers. Un regret.L’abbé Nodet a tenu, dit-il, à conserver sa marque particulière à chacun de ces témoi-gnages, se permettant seulement de corriger les fautes d’orthographe. Fort bien. Pour-quoi faut-il que l’éditeur ait cru bon d’en rajouter un nombre considérable? Il est mani-feste que les épreuves n’ont pas été relues.
Dans la collection Prier à… (DDB), Mgr André Dupleix prend la distance nécessaire avecla précieuse naïveté de ce premier portrait, et même avec les premières biographies quien sont tributaires (Trochu en particulier), à la lumière des travaux plus récents (Mgr Four-rey). Au gré de dix points d’ancrage « sur les pas du saint », du village natal de Dardilly àla basilique souterraine, l’auteur éclaire la vie et le ministère de M. Vianney en montrantcomment peu à peu le prêtre, tout en restant dans l’obéissance la plus humble, s’est libéréde la spiritualité fortement jansénisante de sa formation, voire des pratiques de l’Église deson temps, pour en arriver à une “pastorale” (en terme d’aujourd’hui) inspirée par le pri-mat de l’Amour. La formule adoptée par l’auteur est aussi originale que pénétrante.
Enfin les Actes d’un colloque (le sixième), organisé par la Société Jean-Marie Vianneyet le Sanctuaire d’Ars, sur le thème Prêtres pour le salut du monde: 14 communications,bien introduites par l’avant-propos du P. Vincent Siret. On lira en particulier celle du P.Jean-Philippe Nault, actuel recteur du Sanctuaire, qui ouvre le colloque: Le Curé d’Arset l’angoisse du salut. Elle constitue le prolongement idéal des deux ouvrages précédents.
S’il faut un mot de conclusion, j’en reviens à ce qui est pour moi une évidence. Onpeut respecter et même admirer les grandes constructions qui jalonnent l’histoire de lapensée pour donner un fondement historique (voyez l’article récent sur les travaux deSoler), rationaliste, scientifique à l’athéisme. Il suffit d’un trait de la vie d’un saint commele Curé d’Ars, d’un mot de ce prêtre prétendument ignorant, pour ruiner leurs efforts etleurs prétentions. « La sainteté est inscrite dans l’histoire comme la plus permanentemanifestation de Dieu » (Mgr André Dupleix). Pascal le savait. Et Bernanos, qui l’a dit etredit, avec quelle force (« Si l’Église ne comptait que des prêtres moyens et des parois-siens dociles, on peut se demander quelle y serait la place des saints. (…) Nous appren-
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 43
44 Spiritualité
drons de Dieu, le jour venu, quels liens mystérieux lient les grands pécheurs aux grandssaints. ») Et c’est aussi pourquoi, selon le mot de Léon Bloy, « il n’y a qu’une tristesse, c’estde n’être pas des saints. » B.P.
NODET Bernard, Le Curé d’Ars par ceux qui l’ont connu, 226 p., 18 € F.-X. de GuibertDUPLEIX André Mgr, Prier à Ars avec Jean-Marie Vianney, 152 p., 12 € Desclée de Brouwer
Prêtres pour le salut du monde, 268 p., 25 € Parole et Silence
ALENÇON Guillaume (d’)
Un chartreux provençald’Ancien régime face à la Révolution. Dom Hilarion Duclaux
Pierre Téqui
Un tour de force ! Ecrire la vie d’unhomme sur qui, excepté ses actes de bap-tême en 1727 et de décès en 1793, onpossède à peine un ou deux documents,guère substantiels. Que sait-on de lui? Nédans une famille de vieille noblesse pro-vençale dont plusieurs membres occupè-rent des charges judiciaires, il fut moinedans la chartreuse de Bonpas près d’Avi-gnon, fut à plusieurs reprises envoyéséjourner dans d’autres maisons par sessupérieurs (pour des raisons inconnues denous), fut avec ses frères chartreux expulséde son monastère par la Révolution en1792, et mourut dans sa famille. Et c’esttout.
Mais l’auteur s’est souvenu que la vieordinaire d’un chartreux est tout entièrecontenue dans la spiritualité et le coutu-mier de l’ordre. Aussi, chapitre après chapitre, est développé ici ce qui fait lavie cartusienne: vie « au désert », adora-tion, contemplation, silence, ascèse, équi-libre, obéissance, dépouillement de toutsauf de l’essentiel. Ce qui restait uneombre prend peu à peu consistancegrâce aux textes puisés chez saint Brunoet de nombreux chartreux, anonymes ounon, mais aussi chez saint Jean de la Croixet autres auteurs spirituels anciens etmodernes.
Ainsi revit, avec assez de vraisem-blance, Dom Hilarion Duclaux, qui donneson nom à ses frères restés dans l’obscurité.108 p., ill., 15 € H.H.
DAHAN Gilbert
Interpréter la Bible au Moyen Âge
Parole et Silence
Édité dans le cadre des publicationsde l’École Cathédrale de Paris, ce petitlivre propose cinq traductions d’écrits duXIIIe siècle sur l’exégèse de la Bible etextraits des œuvres, célèbres ou non, deThomas de Chobham (mort vers 1235),Thomas d’Aquin, Pierre de Jean Olieu(1248-1298, franciscain plus connu sous lenom erroné de Olivi), Henri de Gand (morten 1293), et Nicolas de Gorran (domini-cain, mort en 1295). Ce sont des textesassez courts mais denses qui constituentune admirable méditation sur le sens del’Écriture et le travail exégétique tel qu’ilétait conçu à cette époque. Ne croyonspas qu’ils ont vieilli : les interrogations qu’ilssoulèvent demeurent encore pour beau-coup d’entre elles, même si les méthodesd’investigation ont évolué. Dans une intro-duction concise et lumineuse, GilbertDahan donne les lignes directrices de l’her-méneutique médiévale, qui s’appuieessentiellement sur la théorie des « quatresens de l’Écriture » magistralement explo-rée dans les années 1960 par l’Exégèsemédiévale de Henri de Lubac. Cetouvrage n’est donc pas réservé aux spé-cialistes. 183 p., 14 € J.-F.C.
DUCROCQ AnneGuide spirituel des lieux deretraite dans toutes lestraditions
Albin Michel
Près de quatre cents adresses de « lieuxde retraite » en France, Belgique, Suisse etau Luxembourg, avec toutes les indica-
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 44
45Spiritualité
tions nécessaires sur les conditions d’ac-cès, d’accueil et de séjour éventuel, ainsique sur l’esprit même de ces lieux. L’auteursemble en avoir fréquenté personnelle-ment bon nombre, et pour des raisons quin’apparaissent pas comme uniquementprofessionnelles ou touristiques. Il y a donc,ici ou là, plus ou moins d’empathie, maison ne lui en voudra pas car cela donne aulivre un ton de confidence assez éloignédes sécheresses descriptives des guidesordinaires. Au lecteur, ensuite, de faire sonchoix, s’il le désire, pour aller se frotter ausilence dans telle ou telle « maison » chré-tienne – des trois confessions –, ou boud-dhiste, ou hindouiste, et voir s’il n’y auraitpas là de quoi recentrer, pour un temps aumoins, son propre projet de vie. 490 p., 22 € J.-F.C.
EISENBERG Josy
Dieu et les juifsLa cabbale dans tous sesétats
Albin Michel
Le sujet du premier ouvrage, comme lelaisse prévoir l’illustration de la couverture– un détail de La lutte de Jacob avecl’ange de Rembrandt – est essentiellementune interprétation des rapports del’homme avec son Dieu, rapports parfoisconflictuels – mais l’ange qui maîtriseJacob porte sur lui un regard infinimenttendre et Jacob semble même s’endormirdans ses bras. Dieu, « si loin, si proche », està la fois l’inconnaissable, qu’on ne peutsaisir ni donc nommer, mais c’est aussicelui qui veut que l’homme le recherche,d’où ce dynamisme de la foi juive surlequel les différents auteurs ne cessentd’insister.
Le détail de La fête de Balthazar quiillustre la couverture du second ouvrage,montre le doigt de Dieu inscrivant sur lemur de la salle du festin les paroles mysté-rieuses que seul le prophète Daniel putexpliquer. C’est le mystère de l’interven-tion et de la présence de Dieu (création,transcendance et immanence) que tente
de comprendre la cabbale, née au XIIIe
siècle en Espagne et renouvelée au XVIe
siècle à Safed et au XVIIIe en Italie. Onsent dans les différentes variantes expo-sées une forte influence platonicienne(mythe de l’androgyne, nature de l’âme),même si les spécialistes interrogés par l’au-teur la nuancent ou tentent de la limiter.Chacun d’eux éclaire bien cetteapproche de l’Inconnaissable. Il y est trèspeu fait allusion à ce que le profane unpeu curieux peut connaître de la cabbale(« première Création », « brisure des vases »et tikkoun ou « réparation »). En revanche,et le premier ouvrage y a aussi abon-damment recours, on fait maintes foisintervenir la grammatologie et la guéma-tria, qu’un chrétien peut juger jeu gratuitou même dangereux car, à force demanipuler les lettres d’un mot trilittère ouquadrilittère, de les intervertir, d’addition-ner leur valeur numérique, on se laisseentraîner à des rapprochements peut-êtredus à des coïncidences et on en tire desconclusions qui n’emportent pas laconviction. Mais on sait que pour lejudaïsme, religion où le matériel est spirituelet le spirituel matériel, la lettre est esprit etl’esprit est lettre. Éliane Amado Lévy-Valensi parle, en se référant au Zohar, desrapports judéo-arabes et cite un versetsurprenant du Coran, vraiment peuconnu: « Nous avons dit aux Enfants d’Is-raël : “Habitez la terre.” Puis, lorsque vien-dra la promesse de la [vie] dernière, Nousvous ferons venir en foule. » Elle est moinsbien inspirée lorsque l’ignorance du latinlui fait commettre une erreur que je nesignalerais pas si elle n’en tirait des conclu-sions scandaleuses. Ainsi assure-t-elle :« L’instinct de mort, comme dirait Freud, amarqué l’Occident et je crois que jen’exagérerais pas en disant que la Shoahest une belle production de l’Occident »et elle affirme qu’en français « Occident »a la même racine que « occire », en pré-cisant dans une note que « les deux motsviennent du latin occidere (ob-cadere),qui signifie “tomber ” ou “faire tomber” »,alors qu’il s’agit de deux verbes qui n’ontaucun rapport, sinon d’être homographes(mais non homophones). 161 p., 15 € &174 p., 15€ Y.A.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 45
46 Spiritualité
GRIGNARD Hervé
La vie spirituelle du cardinalEugène Tisserand
Parole et Silence
Ceci n’est pas une biographie ordi-naire. Ayant eu accès aux papiers du car-dinal Tisserand (notes intimes, correspon-dance avec ses directeurs spirituels),l’auteur s’attache à en tirer les caractéris-tiques de sa vie spirituelle. Admis en 1916dans la Société sacerdotale Saint-Françoisde Sales, Eugène Tisserand, toute sa vie(1884-1972), suivit la ligne du saint qui, aufond, correspondait assez à son tempéra-ment : le chemin de sainteté passe parl’accomplissement du devoir d’état, pourla plus grande gloire de Dieu et le servicede l’Eglise, dans l’amour de ses frères.
Dans ses travaux d’érudition orienta-liste, dans son activité à la BibliothèqueVaticane, dans ses responsabilités à la têtede la congrégation des Eglises orientales,il se montra gros travailleur, exigeant sur leplan intellectuel, attaché à son devoir maisaussi à ses droits, amoureux du vrai. Lesmesquineries, les injustices, les mauvais pro-cédés résonnaient en lui et provoquèrentdes crises de dépression spirituelle, alorsqu’il déplorait déjà, en temps normal, lasécheresse et la pauvreté de sa prière.Dans de très belles lettres, son directeur,Mgr Ruch, lui conseillait de persévérer,d’adapter sa prière à son tempérament,de se prendre comme il était, et finale-ment de s’abandonner à la confiance deDieu. Le tout, dans l’exercice paisible deson devoir d’état : ligne toute salésienne. Ilcomprenait alors que la recherche de laperfection ne coïncide pas toujours avecla sainteté.
Il est permis de penser que l’on auraitpeut-être pu attendre encore une ving-taine d’années avant de livrer au publictoute cette intimité : Tisserand n’est mortque depuis 37 ans. De toute façon cettebelle étude aide à comprendre unhomme qui fut un grand serviteur del’Eglise, proche de quatre papes, dontl’exemple montre que la vie spirituelle doitêtre simple, et faite de détachement. 118p., 13 € H.H.
LECLERC Éloi
Sainte Jeanne JuganDesclée de Brouwer
Les Petites Sœurs des Pauvres sont trèsconnues. Leur fondatrice l’est moins. Deson vivant, l’abbé Le Pailler a presque réussià la faire oublier pour s’approprier sonœuvre: durant les 27 dernières années desa vie, abandonnant sans murmurer uneoeuvre immense, elle vécut commeoubliée parmi les novices. Sa canonisation,le 12 octobre, ramène justement et utile-ment la lumière sur elle. Éloi Leclerc, fran-ciscain, lui a déjà consacré un livre (DDB,2000). Il a voulu celui-ci simple et bref pourune large diffusion. Il est aussi plaisant d’as-pect, avec une illustration dans le style desicônes (pas un mot sur son origine). La vied’abord, de sa naissance à Cancale en1792 à sa mort en 1879 à La Tour en Saint-Pern, près de Rennes, siège de la Maisonmère. Puis un chapitre sur « le secret d’unevie » : de l’action à l’enfouissement, de lacréation prophétique d’une œuvre audépouillement pour devenir elle-mêmeœuvre de Dieu. Le seul ennui est que cetteseconde partie répète trop la première.Mais ce petit livre est une bonne approched’une grande sainte. 64 p., 4 € B.P.
LENOIR Frédéric
Socrate, Jésus, Bouddha:trois maîtres de vie
Fayard
Traiter dans une même étude ces troisgrandes « figures » universellement connuespeut paraître incongru, mais le sous-titredonné par l’auteur justifie le rapproche-ment. Quelles que soient ses croyances ouses convictions, chacun sait que ces troisnoms provenant de l’Antiquité évoquentau moins la sagesse, au plus la spiritualité,à coup sûr des réflexions et des préceptesqui ont marqué l’histoire de la pensée etfont vivre encore des millions d’humains.Cela, malgré une particularité communeaux trois, assurément paradoxale : aucund’eux n’a laissé d’écrit. Mais leur présenceau monde, le rayonnement qu’ils ontexercé sur leur entourage, l’enseignement
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 46
47Spiritualité
qu’ils ont prodigué ont tout naturellementpoussé leurs proches à vouloir transmettrela mémoire de leurs maîtres comme lecontenu de leurs paroles. Cherchant ledénominateur commun entre Bouddha,Socrate et Jésus (ordre plus satisfaisant,puisque chronologique), Frédéric Lenoiravance qu’ils ont tous trois fondé un« humanisme spirituel ». Appliquée à Jésus,cette formule semble quelque peu réduc-trice, mais la démarche de l’auteur se veutobjective, et non dictée par une foi parti-culière, chrétienne en l’occurrence. D’oùla première question, surprenante maisexplicable par le souci de méthode: « Ont-ils réellement existé? ». Sans parler du Boud-dha, l’existence historique de Socrate n’ajamais vraiment été mise en douteet, depuis longtemps, celle de Jésus n’estpas reconnue par les seuls chrétiens. Autresurprise : la volonté de mener une étuderigoureusement parallèle aux trois « sages »conduit l’auteur à évoquer leur « originesociale » et… leur « vie sexuelle » (ce qui luipermet, au passage, de régler leurcompte, une nouvelle fois, aux élucubra-tions du Da Vinci Code, qui reposent surl’Evangile – apocryphe - de Philippe). Celadit, même si l’on peut inévitablementémettre quelques réserves sur tel ou telpoint (l’auteur est journaliste, non théolo-gien), l’ensemble est solidement docu-menté et permet au lecteur d’approfondirsa connaissance des trois « maîtres de vie »en constatant, dans la seconde partie inti-tulée « Que nous disent-ils? », une réelleconvergence entre leurs messages. Quel’on se rassure : Frédéric Lenoir ne cherchepas à forger un syncrétisme (qui serait bienillusoire !) ni à étayer quelque thèse « una-nimiste » : ainsi, il ne gomme pas les parti-cularités de chacun, en particulier celle deJésus, « seul maître spirituel dont la résur-rection est affirmée par ses disciples ». 302p., 19 € F.L.
MADIRAN Jean
Histoire de la messe interditeVia Romana
Le deuxième fascicule du récit decette incroyable histoire couvre, en gros,les dix années qui suivirent la mort du pape
Paul VI, en 1978. Elles furent marquées, ence qui touche le sujet, par la rupture écla-tante d’Ecône, et par les petits pas avan-cés par Jean-Paul II pour libérer la messetraditionnelle de l’interdiction imposée enfait, non en droit, par un épiscopat obsti-nément engoncé, de façon inexplicable,dans ce qu’on est bien obligé d’appelerune opposition larvée au pape. Il va de soique la rupture ne favorisa guère le succèsdes petits pas.
Comme dans le premier fascicule (voirBulletin, janvier 2008), le récit des faits estaccompagné d’une chronologie détail-lée et appuyée sur une masse de citationséclairantes. Le tout, dans un esprit, non depolémique, mais de critique impitoyable,attaché à établir la réalité des faits. 161 p.,17 € H.H.
MASSON Robert
Elisabeth Lafourcade Sur lespas du P. de Foucauld
Parole et Silence
Ceci n’est pas une biographie, mais laprésentation, assez confuse, d’une voca-tion exceptionnelle suivie de façon radi-cale. E. Lafourcade (1903-1958) sentit, aucours de ses études médicales, naître et sedévelopper en elle une vocation de laïqueconsacrée au service des plus déshérités,et s’agrégea pour cela à l’association(puis institut séculier) « Jésus ouvrier », qui sefondait à Tours à cet effet. Ayant accu-mulé les diplômes de médecine et de chi-rurgie, elle s’installa d’abord, en 1931, enTunisie, puis, en 1948, dans le Tafilalet, dansle Sud marocain, comme médecin chefde l’hôpital de Ksar es Souk.
Sans que ce soit clairement dit, il sem-ble que ce soit la lecture de la vie du P. deFoucauld par René Bazin qui l’ait orientéevers l’Afrique du Nord. De fait, comme lui,elle vécut pauvrement, entièrement don-née à ces populations au milieu desquelleselle vivait, pratiquant médecine et chirur-gie à l’hôpital, chez elle, sous les tentes,dans la pensée explicite d’accomplir unetâche missionnaire silencieuse en paysmusulman, exactement dans la ligne del’ermite du Hoggar.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 47
48 Spiritualité
Le livre est constitué de commentairesjetés, dans le plus grand désordre, sur lesaspects divers d’une spiritualité de dontotal reposant sur une foi d’abandon etde confiance. Mais il est impossible de sefaire une idée sur les conditions de sa vie.Suivent des témoignages et souvenirsrecueillis auprès de proches et moinsproches, qui permettent de reconstituer àpeu près les principales étapes de cetteexistence marquée de bien des souf-frances, animée par la foi, l’espérance etla charité vécues sans concession.
Une personnalité inconnue du public, àdécouvrir. Mais on aimerait pouvoir dispo-ser sur elle d’une biographie composéeavec quelque cohérence. 173 p., ill., 14 €H.H.
QUINSON Henry
Moine des Cités: de WallStreet aux Quartiers-Nordde Marseille
Nouvelle Cité
L’itinéraire de l’auteur est étonnant :de père franco-américain et de mèrefrançaise, il est né aux USA et a étudié enEurope, mais, à 28 ans, vit à nouveauoutre-Atlantique, où ses activités profes-sionnelles dans le domaine bancaire sontà mille lieues de la règle monastique !Cependant, l’appel à une vie de prièrel’a depuis longtemps saisi, et il va y répon-dre brutalement, quittant tout à coupcette existence dorée, mais un peu folle,pour une autre sorte de folie : l’enfouisse-ment dans la vie religieuse à Tamié, enSavoie. Curieusement, il a conscience, enrejoignant une telle communauté céno-bitique ancrée dans une tradition quiremonte à saint Benoît et à saint Bernard,que ce n’est peut-être pas là sa vocationprofonde: « Dans ma prière, j’ai vu que jefaisais l’école aux enfants maghrébins deMarseille ». Ce long cheminement jusqu’àla cité phocéenne durera plus de six ans :pour y parvenir, il lui faudra expérimenterd’abord l’impossibilité physique de laprière de nuit, puis les mirages esthétiquesde la communauté de Bose. Ne dit-onpas à juste titre que « Dieu écrit l’histoireavec des lignes courbes » ? Plusieurs mois
sont nécessaires avant que la fraternitémarseillaise ne voie enfin le jour, en octo-bre 1997, dans le quartier de Saint-Paul.Son objectif : être un « relais d’Église, pré-sence évangélique dans le contexte duvoisinage immédiat », en partageant lavie de familles que leur culture et leur reli-gion marginalisent et en apportant, grâceà une équipe de bénévoles, l’aide néces-saire aux progrès scolaires des « jeunes-des-cités ». Une telle entreprise doit, pourporter ses fruits, reposer sur une confianceréciproque durable et sur l’exempled’une vie authentiquement ouverte auxautres et dépouillée de tout confort inu-tile. Dans l’esprit des moines de Tibhirine,la vie de la petite communauté reposedonc sur la prière, le travail, l’hospitalité etle partage, dans la pauvreté de la vieordinaire : « Vous, vous êtes de vraismoines parce que vous accueillez tout lemonde chez vous », dit Dahabou. On estbien loin des golden boys new-yorkais !218 p., 22 € F.L.
SHAVIT Yaacov
Faut-il croire ce que dit laBible?
Albin Michel
L’archéologie moderne est-elle, oudoit-elle être, un apport scientifique propreà révolutionner l’appréhension et la com-préhension des textes de l’Ancien Testa-ment, et notamment des plus contestésquant à leur véracité historique tels que laGenèse et l’Exode, ou même que les Livresdits « historiques » de Josué, des Juges, deSamuel, des Rois? Le professeur Shavit, del’université de Tel Aviv, se pose honnête-ment la question, en la replaçant dansl’histoire culturelle d’Israël. Son livre n’yrépond pas complètement, mais sesignale par un ton mesuré, loin de toutepolémique savante. Et il nous dit, enrésumé, que oui, bien sûr, les découvertesscientifiques des archéologues ontapporté des éléments décisifs, et qu’ellesont pu parfois remettre justement en causedes « traditions » trop obscurémentancrées. Mais aussi qu’elles ont leurs limitesdans l’usage qu’on en peut faire à l’égarddes textes sacrés, parce que, à ses yeux, laBible n’est pas d’abord un corpus à voca-
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 48
49Spiritualité
tion narrative et historique, mais bien avanttout la Parole de Dieu. S’il est normal etsalutaire que cette Parole, dans sa trans-cription humaine, soit éprouvée sans cesseau feu de la critique scientifique, quitte àébranler quelques vieilles convictions, il estnon moins nécessaire que la foi ne s’enoffusque pas et y puise au contraire desraisons nouvelles de se fortifier. Il n’y a doncpas d’opposition fondamentale entre lafoi et la science qui doivent au contraire senourrir l’une l’autre. La thèse n’est pas nou-velle, et le magistère catholique romain laprofesse volontiers ; il est particulièrementintéressant de la voir exposée, même souscette forme condensée, par un fils d’Israëlexaminant le problème avec à la fois uneérudition impartiale et une fidélité intacte.175 p., 8,50 € J.-F.C.
TASSIN Claude
L’apôtre Paul, un autoportrait
Desclée de Brouwer
Parce qu’il parle à la première per-sonne, Paul est le seul des auteurs cano-niques du Nouveau Testament dont onpuisse faire l’autoportrait. Claude Tassin,bibliste reconnu, qui en est l’interprète, cor-rige à la fin le tir : « un semblant d’autobio-graphie », étant entendu que la part del’interprétation est grande par sa subjecti-vité. Pour aller dans le sens d’une certainelimitation du genre, précisons qu’il ne fautpas attendre des documents laissés parPaul un autoportrait qui fouillerait les petitscôtés de sa personnalité, le tas de secretscher aux investigateurs modernes. On sedemande même si l’ouvrage de ClaudeTassin n’est pas surtout une synthèse desgrands mouvements de la pensée de Paul.A ceci près encore que les Actes des Apô-tres sont délaissés - comme matériaux bio-graphiques - au profit de ses épîtres etmême seulement des sept considéréescomme authentiques: Romains, 1ère et 2ème
aux Corinthiens, Galates, Philippiens, 1ère àTimothée, Philémon. Dans ce corpus d’épî-tres, qui ne sont « pas des traités théolo-giques mais des réactions à des problèmesconcrets », la 2ème aux Corinthiens est deloin la plus sollicitée, de même que dansles voyages et séjours de Paul, c’est en
Grèce qu’on se retrouve le plus souvent, ladernière partie de sa vie étant la moinsélucidée et le projet d’un prolongementen Espagne n’ayant pu être réalisé.
Quels traits de l’autoportrait de Paulsont retenus? Sans vouloir suivre l’ordre deClaude Tassin, on sautera même plutôtvers la fin à « l’homme de prière » qu’il aété : la prière « fait partie de son activitéapostolique comme acte de discerne-ment et même, dans les relations avec lesÉglises, elle ressortit à la stratégie mission-naire ».
De cette stratégie qui, enracinée dansle patrimoine juif, va « du ministère d’unealliance nouvelle à celui de la réconcilia-tion », les composantes sont aussi bien lesmétaphores parentales, « père et mère »de Paul, que le combat contre les adver-saires visibles et invisibles. « La parole de lacroix » est on ne peut plus centrale, dans lavie apostolique comme dans le reflet desa personnalité : « C’est toujours commeministre de la Parole, serveur (diaconos)de la Parole, que Paul se comprend. » Lelangage cultuel, le culte chrétien en parti-culier, s’inscrit dans cette Parole et finit parfaire de lui le « liturge du Christ Jésus ». Pauln’est pas désincarné pour autant : son rap-port à l’argent se cherche entre ce qu’ilest capable de faire, lui le skénopoios, lefabricant de tentes, pour gagner sa vie(« premier prêtre-ouvrier ») et ce qu’ildemande aux communautés commeaide de participation. Claude Tassin sou-ligne au passage (dans une simple note)l’unité profonde entre l’évangile et l’êtreprofond de l’apôtre ou, en d’autrestermes, « la visée divine de sa vocationpersonnelle ».
Plus qu’un essai, qui suppose quelquechose d’aléatoire, l’ouvrage de ClaudeTassin qui clôt bien l’année saint Paul, estune étude parfois difficile, mais le plus sou-vent convaincante et toujours fondée enesprit et en vérité. Avec lui, qui cite alors unautre bibliste, « l’évangélisateur était unpenseur et le penseur un homme d’ac-tion. Ses écrits invitent à concilier théologieet apostolat, perspectives exégétiques etmissionnaires. » Dans son « semblant d’au-tobiographie de Paul », Claude Tassin abien tenu les deux bouts de la chaîne. 324 p., 27 € H. B.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 49
V ie des Collections
ALBIN MICHEL
RENCONTRES
L’art, un miroir du sacré (Coll.) La trame de cet ouvrage est tissée sur les rapports del’art et du sacré. Les huit contributions données ici s’attachent à développer, sur la basede quelques exemples puisés dans les diverses religions (surtout le bouddhisme et l’islam),une méditation intime et souvent empreinte d’une grande poésie. Ce sont des textesécrits par des spécialistes, philosophes, artistes, écrivains ou historiens de l’art, mais quidemeurent très accessibles. 205 p., 12 €
Le sacré, cet obscur objet du désir (Coll.) pourrait se résumer par la question abruptesuivante: dans la recherche du salut, le divan freudien a-t-il remplacé les lieux de culte?Quelques signatures connues et de sensibilités variées tentent d’apporter une réponsehonnête et mesurée. Mais l’on sent bien, au fil des interventions, que même si le sacrépeut se lire parfois, et s’interpréter, dans les rêves, il est loin d’avoir succombé. C’est unebonne nouvelle. 180 p., 12 € J.-F. C.
LES BELLES LETTRES
CLASSIQUES EN POCHE
Dernier titre (98) : Pour Sextus Roscius ou Pro Roscio. Bien connu des latinistes pour êtrela première plaidoierie de Cicéron dans une affaire criminelle. Le jeune avocat (26 ans)a joué là son alea jacta est. Ou il échouait et risquait le pire : l’affaire était politique et Syllarestait redoutable. Ou il l’emportait et devenait aussitôt célèbre. Il a gagné. Comment?Pourquoi? L’introduction de Jean-Noël Robert le dit très bien. 213 p., 9,50 € B.P.
LA VÉRITABLE HISTOIRE
Le principe de cette nouvelle collection repose sur la présentation, à partir de textesd’auteurs, d’un personnage historique précis. Les commentaires occupent une placelimitée, ne servant qu’à introduire les textes cités ou à assurer le lien entre eux. C’est àJean Malye (directeur de la collection) qu’est dû l’ouvrage consacré à Alexandre leGrand (n° 3), tandis que Paméla Ramos s’est chargée de l’histoire de Marc Aurèle (n° 4).Alcibiade, Périclès, Caligula, sont également disponibles. Six titres sont prévus chaqueannée. 11 à 13 € le vol.
LAROUSSE
Le petit Larousse illustré 2010
Larousse n’est pas une collection, mais on peut en faire collection, millésime aprèsmillésime. Une étude minutieuse des mots entrés et sortis constitue un document de premierordre sur l’évolution de la langue. Quant à la présentation, quel changement du blocrougeâtre des premières années au gros livre richement illustré d’aujourd’hui ! Outre cela,
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 50
51Vie des Collections
la loi du marché le veut, chaque nouvelle édition doit présenter quelque chose denouveau, un événement si possible qui fasse argument de vente. Les anniversaires s’yprêtent. En 2005, ce fut celui des cent ans du Petit Larousse illustré : j’en avais tiré un Prisme(octobre 2004). 2010 sera celui des cent vingt ans de la Semeuse dessinée par EugèneGrasset pour le Larousse de 1810. Elle aussi a bien changé, les akènes du pissenlit ne sontplus que douze petites croix, et la devise a disparu. Pour marquer cet anniversaire, uneidée inattendue: 40 dessinateurs “de renom” ont illustré un mot ou le plus souvent uneexpression selon leur inspiration : poétique, humoristique, satirique – en fait le plus souventla locution est prise au pied de la lettre. Plus souvent décevant qu’amusant. L’initiativen’est pas destinée à rester. Plus heureuses sept nouvelles planches su fond noir, qui siedaussi bien aux orchidées, aux coquillages qu’aux souveraines mythiques. Et, cela va desoi, des mots, communs et propres, et des sens nouveaux. Leur nombre varie dans le dossierpublicitaire de 100 à 150. Mais ce qu’on ne sait jamais, c’est le nombre des discrètes dispa-ritions, car il faut bien que le dictionnaire s’allège en même temps qu’il s’enrichit. 15 X 23cm, 1952 p., prix anniversaire 27,90 € ; grand format, 19 X 28 cm., 2016 p., 44,90 € B.P.
LE PETIT MERCURE
LE GOÛT DE …
Les Lacs italiens et les Iles grecques, monstres sacrés du tourisme international. Un seulauteur est présent dans chacun: Michel Déon. Pour le reste, les textes choisis mêlent lesgrands écrivains (Stendhal, Goethe, Taine, Barrès, Gide, Giono d’un côté ; Nerval,Chateaubriand, Jules Verne de l’autre) et les romanciers du cru (beaucoup moins d’Ita-liens que de Grecs toutefois). Pour les îles grecques, la présentation est conforme àl’habitude; les lacs italiens par contre sont illustrés par un plus grand nombre d’extraits –une quarantaine – et selon un plan plus recherché: « poétique lacustre ; parfums, couleurset génie du lieu…à vos rames héros des lacs ». On regrettera avec plus de raison quejamais pour pareils sujets, l’absence de toute carte. 128 p., 6,50 € le vol. P.B.
Pour la Grande Bretagne, due à la plume d’Anne-Marie Cousin, le choix va de Shakes-peare aux romanciers anglo-indiens. Ce sont moins les paysages et les coutumes que lesAnglais eux-mêmes qui en sont les sujets. Perpétuelle source d’étonnement pour des conti-nentaux que continue de fasciner une certaine excentricité insulaire. Le choix des textesest dans l’ensemble judicieux même s’il conforte souvent les stéréotypes que les Françaisse plaisent toujours à entretenir sur leurs voisins d’outre-Manche. Quelques éclairages pluscontemporains auraient été, pourtant, les bienvenus. 133 p.
New York est présenté par Jérôme Neutres selon quatre grands thèmes : « Rêver, Voir,Vivre et Penser la ville. » La ville emblématique du XXe siècle a attiré de nombreux écrivainsfrançais comme Jean-Paul Sartre, Paul Morand, André Breton dont les textes figurent àcôté de ceux de Walt Whitman, Henry Miller ou Paul Auster. Ville mythique de lamodernité, tantôt infernale, tantôt idéale, elle séduit et inquiète. Les choix de l’auteur nepeuvent être exhaustifs mais ils invitent à la découverte et au voyage. 140 p., 6,80 € M.H.V.
SKIRA
SkiraMiniARTbooks
Cette collection de petits livres d’art se développe avec un artiste (Klimt) ; unmouvement (dadaïsme) à travers ses “chefs d’oeuvre” ; une école d’art et d’architecturerévolutionnaire : le Bauhaus, 80 ans après sa fondation ; un thème: le nu masculin, desGrecs aux Baigneurs de Cézanne. À noter que ces volumes ont le même auteur, FlaminioGualdoni, professeur d’histoire de l’art à l’Académie de Brera, à l’exception du Klimt, dûà Federica Armiraglio. Chaque volume 96 p., 13,50 X 17 cm., 5,90 € B.P.
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 51
Index Octobre 2009ALBERTI de MAZZARI Silvia La reine vénitienne Pygmalion 8
ALENÇON Guillaume (d’) Un chartreux provençal d’Ancien régime face à la Révolution. Dom Hilarion Duclaux Pierre Téqui 44
BACHELOT Bernard Raison d'Etat L'Harmatton 22
BANDE Alexandre Le cœur du roi Tallandier 22
BASS Rick La vie des pierres Christian Bourgois 8
BASTAIRE Jean et Hélène Pour un Christ vert Salvator 35
BERGER-MARX Paule Les relations entre les Juifs et les catholiques dans la France de l’après-guerre 1945-1965 Parole et Silence 22
BERNHARD Thomas Extinction, un effondrement Gallimard 9
BERTAUD Jean-Paul Les royalistes et Napoléon Flammarion 21
BERTRAND Jacques A. Les autres, c’est rien que des sales types Julliard 36
BOUCHARD Françoise Le Père Louis Brisson Salvator 23
BRESSANT Marc La citerne de Fallois 9
BRINK André Dans le miroir suivi de AppassionataL’amour et l’oubli (rééd.) Actes Sud 10
CESSOLE Bruno (de) Le moins aimé Éd. de la Différence 11
CHAIN Anne Les acrostiches de Nano Edifree 40
CHANTRAINE Georges Henri de Lubac T. II Les années de formation (1919-1929) Cerf 24
CHAUDUN Nicolas Haussmann, Georges Eugène, préfet-baron de la Seine Actes Sud 24
CHEVRIER Jean-Marie Départementale 15 Albin Michel 19
COQ Guy Inscription chrétienne dans une société sécularisée Parole et Silence 36
COX Michael Le livre des secrets Seuil 12
DAHAN Gilbert Interpréter la Bible au Moyen Âge Parole et Silence 44
DOUCET Marc Des hommes travaillés par Dieu Histoire de l’abbaye de Belloc Cerf 25
DUCROCQ Anne Guide spirituel des lieux de retraite dans toutes les traditions Albin Michel 44
DUPLEIX André Mgr Prier à Ars avec Jean-Marie Vianney Desclée de BrowerPrêtres pour le salut du monde Parole et Silence 44
DUTEURTRE Benoît Ballets roses Grasset 37
ÉLUARD Paul - RAY Man Les Mains libres Poésie / Gallimard 40
EISENBERG Josy Dieu et les juifsLa cabbale dans tous ses états Albin Michel 45
FADANELLI Guillermo Boue Christian Bourgois 12
FOLIN Sébastien Les fils du volcan Anne Carrière 19
FRANCK Julia La femme de midi Flammarion 13
GEORGE Antoine L’enfant du Bon Dieu Cerf 13
GOFFETTE Guy Tombeau du CapricornePresqu’elles Gallimard 40
GRIGNARD Hervé La vie spirituelle du cardinal Eugène Tisserand Parole et Silence 46
GUILLEBAUD Jean-Claude La confusion des valeurs Desclée de Brouwer 37
HINFRAY François L'homme qui parle en marchant sans savoir où il va de Fallois
KHOURY-GHATA Vénus A quoi sert la neige? Le Cherche Midi 41
LABORDE Catherine Maria del Pilar Anne Carrière 19
52
BDL_OCTOBRE_OK:Mise en page 1 28/09/09 11:47 Page 52
Fondateur :A. Lardanchet
Ancien rédacteur en chef : V.H. Debidour
Rédacteur en chef, Directeur de la publication :Bernard Plessy
Editeur :Association des Amis du Bulletin des Lettres39 bis rue de Marseille69007 LYON
http://www.bulletindeslettres.asso.fr ou http://www.bulletindeslettres.fre-mail : [email protected]
Domiciliation :Crédit Lyonnais n° 01000 0000791571QIBAN FR72 3000 2010 0000 0079 1571 Q71BIC : CRLYFRPP
Impression : Imprimerie des Monts du Lyonnais69850 Saint-Martin-en-HautTél. 04 78 19 16 16
Dépôt légal :3ème trimestre 2009ISSN 0007-4489C.P.P.P.n°0505 G 79850
LACOUTURE Jean Les Impatients de l’Histoire Grasset 26
LARBAUD Valery Journal Gallimard 5
LE CHATELIER Hélène Dernière adresse Arléa 14
LECLERC Éloi Sainte Jeanne Jugan Desclée de Brouwer 46
LENOIR Frédéric Socrate, Jésus, Bouddha : trois maîtres de vie Fayard 46
LENTZ Thierry - MACÉ Jacques La mort de Napoléon Perrin 27
LEWERTOWSKI Catherine Les enfants de Moissac, 1939-1945 Rééd. Champs histoire 27
LIEBMANN Irina Berlin-Moscou-Berlin Christian Bourgois 28
MADIRAN Jean Histoire de la messe interdite Via Romana 47
MARIE Jean-Jacques L’antisémitisme en Russie de Catherine II à Poutine Tallandier 28
MARSEILLE Jacques L’argent des Français Perrin 35
MARTINEZ GONZALES Emilio Sur les traces de Jean de la Croix Cerf 29
MASSON Robert Elisabeth Lafourcade Sur les pas du P. de Foucauld Parole et Silence 47
MENTZEL Zbigniew Toutes les langues du monde Seuil 14
MINH TRAN HUY La double vie d’Anna Song Actes Sud 15
MORAZZONI Marta L’invention de la vérité Actes Sud 15
NODET Bernard Le Curé d’Ars par ceux qui l’ont connu F.-X. de Guibert 44
NOTHOMB Amélie Le Voyage d’hiver Albin Michel 19
NOVARINO-POTHIER Albine Cent poèmes d’un bestiaire enchanté Omnibus 41
PASCAL Caroline La femme blessée Plon 16
PAYAN Paul Entre Rome et Avignon - Une histoire du Grand Schisme Flammarion 29
PIERRON Jean-Philippe Le climat familial, une poétique de la famille Cerf 37
POULAT Emile Aux carrefours stratégiques de l’Église de France XXe siècle Berg international 38
POULIN Jacques L’anglais n’est pas une langue magique Lemeac Actes Sud 16
POUMIRAU Patrick Emportez-moi Robert Laffont 16
PUEL Hugues o.p. Les raisons d’agir Cerf 39
QUINSON Henry Moine des Cités : de Wall Street aux Quartiers-Nord de Marseille Nouvelle Cité 48
RAZOUX Pierre Histoire de la Géorgie, la clé du Caucase Perrin 30
ROCHE Marie-Jeanne Pétra et les Nabatéens Les Belles Lettres 31
ROGNET Richard Un peu d’ombre sera la réponse Gallimard 41
ROIG José Miguel Soleil coupable Mercure de France 19
SHAVIT Yaacov Faut-il croire ce que dit la Bible ? Albin Michel 48
SILVANISE Frédéric Langston Hughes, poète jazz poète blues ENS Editions 42
SMARTT BELL Madison La ballade de Jesse Actes Sud 17
SOLNON Jean-François Le turban et la stambouline Perrin 32
SORRENTINO Gilbert La Lune dans son envol Actes Sud 17
TASSIN Claude L’apôtre Paul, un autoportrait Desclée de Brouwer 49
THEROUX Paul Suite Indienne Grasset 18
VALENTIN Claude La fabrique de l’enfant Cerf 39
VELUT Stéphane Cadence Christian Bourgois 18
VENNER Dominique Ernst Jünger Éd. du Rocher 33
WESSELING Henri Les empires coloniaux européens 1815-1919 Gallimard 33
Le bulletin des lettres
••• Tarifs •••Abonnements
• 10 numéros (1an)
France ...................................49 €Etranger.................................52 €
• 6 numéros .............................30 €
• 3 numéros .............................15 €
• Etudiants (10 numéros)...............25 €
• Version virtuelle sur Internet ............................25 €
• Abonnement de soutien .............................76 €
Boîtes (une année par boîte)
• Ensemble 2 boîtes..................8 €
• Ensemble 5 boîtes ...............14 €
• Ensemble 10 boîtes..............22 €
Règlement à l’ordre del’Association des Amis du Bulletin des Lettres39 bis rue de Marseille
69007 LYON
Si vous souscrivez un abonnement-cadeau,veuillez préciser sur votre commande si voussouhaitez que le bénéficiaire sache, par nossoins, de qui il tient cet abonnement.
Toute reproduction doit mentionner « Extrait du Bulletin des Lettres - Lyon »