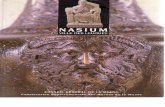CASTORIO Jean-Noël, "Sculptures funéraires gallo-romaines de Toul (Meurthe-et-Moselle) " Latomus,...
-
Upload
univ-lehavre -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of CASTORIO Jean-Noël, "Sculptures funéraires gallo-romaines de Toul (Meurthe-et-Moselle) " Latomus,...
Societe d’Etudes Latines de Bruxelles
Sculptures funéraires gallo-romaines de Toul (Meurthe-et-Moselle)Author(s): Jean-Noël CastorioSource: Latomus, T. 59, Fasc. 2 (AVRIL-JUIN 2000), pp. 364-398Published by: Societe d’Etudes Latines de BruxellesStable URL: http://www.jstor.org/stable/41542169 .
Accessed: 14/06/2014 07:47
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societe d’Etudes Latines de Bruxelles is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access toLatomus.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Sculptures funéraires gallo-romaines de Toul
(Meurthe-et-Moselle)
Toul, Tulium (0 ou Tullium (2), fut durant les premiers siècles de notre ère le chef-lieu de la cité des Leuques (3). Cette ciuitas , qui occupait la quasi- intégralité de la moitié méridionale de l'actuelle région Lorraine, était rattachée, durant le Haut-Empire, à la province de Gaule Belgique ; après le nouveau découpage administratif de la fin du 111e siècle, elle intégra la Belgica Prima. Installée sur la rive gauche de la Moselle, à un endroit où celle-ci est navi- gable (4), et au point de jonction de deux des principales routes de Gaule, là où la voie transversale venant de Durocortorum (Reims) rejoignait Taxe
(1) It. Ant. 365, 4 ; 385, 10 ; Not. Gall., V, 4. (2) Ptolémée, Géographie II, 9, 7 ; Table de Peutinger II, A 1. (3) La réalité de ce statut a parlois été contestee, du moins pour le Haut-bmpire,
au profit de Nasium (communes de Naix-aux-Forges et de Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse) ; voir, par exemple, É. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs , statues et bustes de la Gaule romaine , VI, Belgique , 2e partie , Paris, 1915, p. 108 ; plus récemment, N. Gauthier, L'évangélisation des pays de la Moselle , Paris, 1980, p. 33. Une inscription découverte à Valkenburg aux Pays-Bas (A E, 1975, 634 ; voir également B. Humbert, Une nouvelle attestation du nom antique de Toul dans Études touloises 16, 1979, p. 11-14), qualifiant Toul de Tulium Leucorum, «Toul des Leuques», semble de nature à clore le débat ; en effet, l'association du nom d'une ville à celui du peuple de la cité n'est attestée à ce jour en Gaule Belgique que pour les autres chefs-lieux des bords de la Moselle : Metz appelée Diuodurum Mediomatricorum (CIL, XIII, p. 662) et Trêves, Augusta Tïeuerorum (CIL, XIII, p. 583). L'inscription de Valkenburg serait datée, d'après le contexte archéologique, de 40-42 ap. J.-C. (J.-E. Bogaers, Zweimal Valkenburg (Prov. Zuid- Holland ) dans Festoen-Opgedragen aan A. N. Zadoks-Josephus Jutta bijhaar zeventigste Verjaardag, Groningen-Bussum, 1976, p. 123-125), ce qui indiquerait donc que Toul possédait le statut de chef-lieu dès le début de notre ère.
(4) Lexistence d infrastructures liées au commerce lluvial pourrait etre attestée par la découverte, lors de dragages effectués en 1971 au lieu-dit «le Jard» situé au sud- est de la ville, d'un pavage antique identifié au moment de sa publication comme les vestiges d'un quai de manutention (voir R. Billoret, Informations archéologiques, circonscription de Lorraine dans Gallia 30, 1972, p. 355 ; A. Liéger et R. Marguet, Découvertes récentes dans les dragages de Toul et de Chaudeney-sur- Moselle (Meurthe- et-Moselle) dans R.A.E. 25, 1974, p. 230) ; l'imprécision des observations incite toutefois à considérer cette interprétation avec une certaine prudence.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 365
Carte 1. - Le site de Tulium (d'après N. Gauthier, Province [n. 6], p. 57).
méridien reliant Lugdunum (Lyon) au limes rhénan (5) - la voie d'Agrippa - , la ville bénéficiait d'une situation privilégiée sur les plus importants axes de circulation et de commerce du nord-est de la Gaule (voir la carte n° 1).
Le statut de Tulium , son emplacement favorable, n'ont pas dû être sans conséquences sur son développement ; cette affirmation, aussi simple soit-elle, n'en demeure pas moins une hypothèse, nos connaissances sur la ville antique, sur sa topographie urbaine (6), étant des plus limitées. Cela s'explique avant
(5) Voir R. Jolin, Le passage de la voie romaine de Lyon au Rhin à travers la Lorraine dans Ann. de la Soc. ďhist. et d'arch. lorraine 80, 1980, p. 80-85, fig., qui a suivi le tracé de la voie d'Agrippa aux abords de la ville.
(6) Plusieurs courts essais de synthèse des connaissances acquises sur le site ont été publiés : on consultera principalement P. Goessler, art. Tulium (Tullium) L£uco - rum dans R.E. VII, A, 2, 1948, col. 1336-1340 ; N. Gauthier, Topographie chrétienne
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
366 J.-N. CASTORIO
tout par le nombre très restreint de vestiges de l'époque gallo-romaine qui y ont été mis au jour, moindre que pour certaines agglomérations secondaires de la cité comme Solicia (commune de Soulosse-sous-Saint-Élophe, Vosges) ou Scarpona (commune de Dieulouard, Meurthe-et-Moselle). La consultation des quelques pages consacrées à Toul par M. Toussaint, dans son répertoire archéologique du département publié en 1947 (7), en rend bien compte ; il n'y recense, outre trois des monuments funéraires étudiés ici, que de rares trouvailles, isolées ou trop fragmentaires pour prêter à la moindre conclusion : des monnaies, de la céramique, quelques fragments de mosaïques et de peintures murales, de rares substructions qui ne laissent rien deviner de l'existence probable d'une parure monumentale (8). Cet ensemble, d'ailleurs pour l'essentiel détruit lors de l'incendie du premier musée communal en décembre 1939 (9) ou anciennement dispersé, n'a connu qu'un accroissement assez restreint depuis.
des Cités de la Gaule des origines au milieu du vnř siècle , I, Province ecclésiastique de Trêves (Belgica Prima), Paris, 1986, p. 55-59, 1 carte; P. Braillard, Toul: archéologie et urbanisme du territoire dans Pays lorrain 76, 1995, p. 130-132, 2 fig.
(7) M. Toussaint, Repertoire archéologique du departement de Meurthe-et- Moselle , Nancy, 1947, p. 1 16-124 ; l'auteur, travaillant essentiellement de seconde main, s'est inspiré d'un certain nombre de répertoires antérieurs : A. Dufresne, Notice sur quelques antiquités trouvées dans l'ancienne province leuke (évêché de Toul) depuis 1832 jusqu'en 1847 , Metz, 1849 (extrait des Mém. de l'Acad. nat. de Metz 1848-1849), p. 1-13, 8 pl. h.-t. ; J. Beaupré, Répertoire archéologique pour le département de Meurthe-et-Moselle - Époques préhistorique, gallo-romaine, mérovingienne , Nancy, 1897, p. 134-136 ; Em. Olry, Répertoire archéologique de la ville, des faubourgs et du territoire de Toul , Nancy, 1870 (extrait des Mém. de la Soc. d'arch. lorraine 2e sér., 12, 1870), 92 p.
(8) J. Choux et A. Liéger rapportent qu avaient ete remployés, dans la portion des fondations de l'enceinte gallo-romaine qu'ils ont pu explorer entre 1946 et 1949, «[...] des vestiges d'une grande construction à arcades, soit porte monumentale, arc de triomphe ou édifice public indéterminable» (J. Choux et A. Lîéger, Découvertes gallo-romaines à Toul (Meurthe-et-Moselle) (1946-1949) dans Gallia 7, 1949, p. 95). On notera également que le musée de la ville conserve un sarcophage mérovingien (numéro d'inventaire 990.56.1), découvert au faubourg Saint-Èvre, dont la cuve a été taillée dans deux blocs architecturaux ayant probablement appartenu à un édifice gallo- romain, et qu'un fragment d'entablement mutilé a été mis au jour lors de fouilles non publiées du rempart, rue Qui-qu'en-grogne.
(9) Voir M. Hachet, Le Musée de Toul dans Pays lorrain 71, 1990, p. 43 ; les catalogues et leurs suppléments publiés à la fin du xixe et au début du xxe siècle par les conservateurs successifs permettent de se faire une idée de la teneur des collections avant la première guerre mondiale. L'un des suppléments au catalogue mentionne le moulage d'une «[...] stèle romaine» ( Ville de Toul - Musée - supplément au catalogue , Toul, 1895, p. 3, n° 331) encastrée dans l'un des contreforts de l'église Saint-Gengoult ; la copie détruite, l'original n'étant pas actuellement visible, il est impossible de vérifier cette information et de déterminer ainsi la destination, votive ou funéraire, de ce relief.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 367
À la suite de C. Jullian (l0), doit-on pour autant en déduire que Toul n'a été qu'un gros bourg sur la voie impériale ? S'il est incontestable que la capitale leuque ne peut soutenir la comparaison avec les deux autres métropoles de Belgique mosellane (n), Diuodurum (Metz) et Augusta Treuerorum (Trêves), il convient néanmoins d'éviter tout jugement hâtif : aucune fouille programmée et méthodique n'y a été menée à ce jour (12), et les nombreux remaniements qui ont affecté le sol de cette agglomération, appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'histoire de la Lorraine médiévale et moderne, ne peuvent être que de nature à donner une image assez imprécise de son importance et de sa topographie à l'époque gallo-romaine.
Si l'organisation intra muros demeure donc très largement méconnue, les découvertes de matériel funéraire échelonnées sur plusieurs siècles, au nord de la ville, à l'endroit où devait s'élever par la suite le faubourg Saint-Mansuy, permettent d'y situer, sans grand risque d'erreur, la nécropole antique. En effet, dès 1707, le R. P. Benoît-Picart signalait que l'on y avait mis au jour, au siècle précédent, «[...] des tombeaux, des tasses vernies, où l'on avoit brûlé l'encens, des fioles remplies d'eau, des vaissaux de parfum, des épitaphes et des inscriptions» (,3). Ce matériel est malheureusement perdu, tout comme l'essentiel de celui exhumé, au gré des circonstances, au xixe siècle (,4). De récentes fouilles ont mis en évidence la très longue durée d'utilisation de cette nécropole, des premiers siècles de notre ère jusqu'à l'époque moderne (,5). Il
(10) Qui ne voyait en Toul qu'«[...] un petit centre administratif et agricole, qui intéressait uniquement les hommes de son voisinage et les habitués des conseils publics» (C. Jullian, Histoire de la Gaule , VI, la civilisation gallo-romaine : état moral , Paris, 1920, p. 470-471) ; voir également les jugements sévères d'E. M. Wightmann, Gallia Belgica , Londres, 1985, p. 164, et de N. Gauthier, Évangélisation [n. 3], p. 33.
(11) Voir Y. Burn and, Les deux peuples antiques de la Lorraine actuelle : similitudes et dissemblances dans Ann. de l'Est 1983 (1), p. 12-13.
(12) Les fouilles menées à Toul ont essentiellement été, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des opérations de sauvetage ; voir les comptes rendus qui en ont été régulièrement publiés dans les Informations archéologiques de Gallia par É. Delort (i Gallia 6, 1948, p. 233-236), R. Billoret ( Gallia 32, 1974, p. 339 ; 34, 1976, p. 357- 358) et Y. Burnand ( Gallia 36, 1978, p. 336 ; 38, 1980, p. 422). On regrettera par ailleurs que l'on n'ait pas jugé nécessaire de saisir l'opportunité, qui s'est pourtant présentée à plusieurs reprises à la faveur des importants travaux de rénovation et de reconstruction entrepris à Toul dans les quarante dernières années, pour explorer méthodiquement un ou plusieurs Quartiers de l'aeelomération antiaue.
(13) R. P. Benoît-Picart, Histoire ecclésiastique et civile de la ville et du diocèse de Toul , Toul, 1707, p. 194 ; voir également les découvertes décrites par A. Calmet, Notice de la Lorraine ..., II, Nancy, 1762, p. 613-615.
(14) A. Dufresne, Notice [n. 7], p. 10-13, pl. I-VIII ; M. Toussaint, Meurthe- et-Moselle [n. 7], p. 122.
(15) Voir A. Liéger, R. Marguet et D. Steinbach, Sépultures du Haut Moyen- Àge à l'abbaye Saint-Mansuy de Toul dans Études touloises 20, 1980, p. 25-29, 2 pl. h. - 1., 1 plan, 1 fig.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
368 J.-N. CASTORIO
n'est pas impossible que ce cimetière ait eu son pendant à l'autre extrémité de l'agglomération, également le long de la voie d'Agrippa, à l'emplacement de l'actuel faubourg Saint-Èvre (16).
À l'exception peut-être de la pierre portant ici le n° 9, perdue mais décrite par Dom Calmet, qui rapporte qu'elle fut découverte «[...] dans les terres de [V' abbaye de Saint-Èvre» (17), sans plus d'indications, les monuments étudiés n'ont pas été retrouvés in situ dans la (ou les) nécropole(s), mais proviennent, pour l'essentiel, des fondations du rempart de l'Antiquité tardive, l'un des seuls éléments de l'urbanisme antique qui ait pu être partiellement étudié (18). Dès le xvine siècle, Dom Calmet relate qu'il apprit «[...] de feu M. de l'Aigle, grand archidiacre de Toul, que quand on démolit les murailles de cette ville en 1700, on trouva que les anciens murs étoient posés sur de grandes pierres chargées d'inscriptions, la plupart sépulchrales, qu'il les avoit décrites et ramassées, mais qu'elles étoient égarées parmi ses papiers» (19). Aucune d'entre elles ne nous est parvenue, mais deux reliefs, provenant de la même campagne de démantèlement, sont connus pour l'un (n° 4) par la photographie (20), pour l'autre (n° 8) par le dessin (21). C'est également du
(16) A. Dufresne y signalait la découverte, en 1836, de matériel antique : un cercueil de plomb et deux vases de verre «[...] de la forme de ceux qu'on nomme lecythus » (A. Dufresne, Notice [n. 7], p. 9). La fouille, menée en 1974, de la nécropole mérovingienne située à cet endroit a également permis de mettre au jour une tombe à incinération gallo-romaine ; voir J. Guillaume, A. Liéger et R. Marguet, Sépultures mérovingiennes de l'abbaye de Saint-Èvre à Toul (Meurthe-et-Moselle) dans R.A.E. 35, 1984, p. 304.
(17) A. Calmet, Notice [n. 13], p. 611 ; malgré son imprécision, cette remarque est un autre élément qui incite à penser que l'actuel faubourg Saint-Mansuy ne fut pas le seul lieu de sépulture lié à la ville antique.
(18) L'enceinte gallo-romaine, réutilisée pour partie dans la muraille élevée à partir de 1239 par Roger de Marcey (ou de Mercy), évêque de Toul, fut démantelée en 1700 lors de la construction de nouveaux remparts à la Vauban. Son tracé est cependant bien connu, à la fois grâce aux plans qui en furent dressés au moment de sa destruction et aux vestiges qui en subsistent dans les caves des habitations qui l'ont recouvertes ; voir B. Humbert, L'enceinte gallo-romaine de Toul dans Actes du 95e congrès national des sociétés savantes , Reims, 1970, Section d'archéologie et d'histoire de l'art , Paris, 1974, p. 94-95, fig. 2. L'exploration de sa portion sud / sud-ouest entre 1946 et 1949 a donné un certain nombre d'éléments qui incitent à situer son édification, non sous le règne de Valentinien 1er (364-375) comme on l'avait fait jusque là sur la foi d'un passage mal interprété d'Ammien Marcellin, Histoire , XXVIII, 2, 1, mais à fin du iiie ou au début du IVe siècle ; voir J. Choux et A. Liéger, Découvertes [n. 8], p. 95.
(19) A. Calmet, Bibliothèque lorraine..., Nancy, 1751, p. III. (20) Ce relief avait été remployé dans l'enceinte de 1700, à l'angle du bastion Saint-
Mansuy près de la porte de Metz, comme pierre de revêtement. Retiré du rempart au xixe siècle et donné au musée de la ville par le Génie militaire, il a disparu dans l'incendie de décembre 1939. Un moulage en avait été réalisé, mais il n'a pas été retrouvé à l'occasion du récent inventaire du trésor de la cathédrale où il avait été déposé.
(21) B. de Montfaucon, auteur du dessin, signale également la découverte, lors de
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTORES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 369
rempart que pourrait provenir la stèle n° 3, aujourd'hui disparue (22) mais connue elle aussi grâce à plusieurs clichés ; G. Save rapporte en effet qu'elle fut trouvée, avant 1893, date de sa publication, «[...] dans les fondations de la maison qui touche le cloître Saint-Gengoult, sur la place du marché» (23), c'est-à-dire soit sur le tracé même du Castrum , soit à quelques mètres seulement (voir la carte n° 2), l'absence de données complémentaires sur le lieu et le contexte archéologique ne permettant pas de trancher. À ces trois trouvailles anciennes, toutes recensées par É. Espérandieu (24), s'en sont récemment ajou- tées quatre, jusqu'ici inédites : un fragment de ce qui semble avoir été un monument funéraire (n° 7), mis au jour en 1990 lors des travaux de construc- tion d'un foyer pour personnes âgées, quai de la Glacière, et, surtout, trois importantes pierres (nos 1, 2 et 5), quasi complètes mais malheureusement mutilées, retirées en 1992 de la cave d'une maison située au numéro six de la rue Qui-qu'en-Grogne par M. D. Steinbach (25). Ces quatre derniers reliefs sont actuellement exposés dans la salle lapidaire du Musée de Toul. Nous avons ajouté à cet ensemble, un cippe (n° 6), remployé à une époque indé- terminée dans une grange de la commune voisine de Dommartin-lès-Toul ; en effet, cette pierre a, selon toute vraisemblance, une origine touloise (26).
la même campagne de travaux, d'un cippe funéraire aniconique mais portant une inscription (CIL, XIII, 4677), mediculae formam Habens » (В. De Montfaucon, Bibi. Nat., Mss. Lat., 11912, fol. 110).
(22) Après sa découverte, la stèle a été acquise par un pharmacien de Toul, С. Husson (sur cet archéologue amateur et son père, qui avaient amassé une importante collection d'antiquités diverses provenant de Toul et de ses environs, voir P. Labrude et R. Nodet, Nicolas et Camille Husson, pharmaciens, archéologues et chercheurs, à Toul, dans la seconde moitié du xixe siècle dans Études touloises 74, 1995, p. 30- 39, fig.), puis est passée, à sa mort, chez un certain Clairier. Elle a été enfin achetée par un marchand parisien où É. Éspérandieu affirme l'avoir vue en 1913 ; on en perd ensuite la trace.
(23) G. Save, Stèle romaine à Toul dans La Lorraine Artiste 9e année, 19 mars 1893, p. 180.
(24) Ê. Espérandieu et R. Lantier, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine , 15 tomes, Paris, 1907-1966.
(25) Le rapport alors adressé par l'inventeur au Service Régional de l'Archéologie précise que les pierres «[...] reposaient, face sculptée vers le sol, sur un radier de galets et de pierres formant un hérisson [et qu'il y a tout lieu de croire que] cet arrangement a servi de niveau de base pour l'édification de la muraille» (Rapport de prospection 1992, n° 1029 ; voir également Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l'Archéologie, Bilan scientifique 1992 , Marly, 1993, p. 23). (26) Si l'on se fie à la nature du matériau employé et aux dires de son actuel
propriétaire, M. G. Martin. Ce cippe, inédit, sert actuellement de bloc de fondation au pilier soutenant la poutraison de la grange. De Dommartin-lès-Toul provenait également un «[...] débris important d'un monument funéraire gallo-romain, sur lequel [était] gravé rosc/o» (Em. Olry, Toul [п. 7], p. 84), qui avait été retiré «[...] de la Moselle, à cinq cents mètres au-dessus du pont de Toul» ( Dons faits au Musée lorrain dans Journ. de la Soc. d'arch . lorraine , 1860, p. 1 19). Ce fragment est absent du récent
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
370 J.-N. CASTORIO
Carte 2. - Localisation des découvertes de monuments funéraires dont la prove- nance est connue.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 371
Avant de procéder à l'étude de ces monuments, il convient de mentionner deux œuvres qui posent en termes identiques le problème de leur destination originelle. En effet, aborder la sculpture gallo-romaine d'un site en distinguant les œuvres à caractère funéraire du reste de la production lapidaire soulève immanquablement des interrogations quant à la fonction de certains reliefs employant une thématique commune à la sculpture votive et à l'art sépulcral. À Toul c'est tout d'abord le cas d'un bloc d'assez grandes dimensions (27), sur la face la plus large duquel est sculptée, dans une niche peu profonde délimitée à sa droite par un pilastre à cannelures, la figure d'Attis, conservée jusqu'à la taille, dans l'attitude d'affliction classique qui est la sienne, la main droite portée au menton (fig. 1). La représentation de ce dieu oriental est un poncif assez courant dans la sculpture funéraire du nord-est de la Gaule (et c'est ce qui explique sans doute que J.-J. Hatt l'ait inclus, un peu hâtivement, dans sa liste des «Attis funéraires» gallo-romains (28)) ; cependant le fait qu'elle ne soit pas réservée à ce domaine de l'iconographie (29), ainsi que l'absence de données quant au contexte archéologique de la découverte (30),
catalogue de la sculpture gallo-romaine du Musée historique lorrain de Nancy (G. Moitrieux, Images du monde gallo-romain, la sculpture figurée gallo-romaine du Musée lorrain de Nancv . Nancv. 1992. 91 п.. 54 fm.ì où il avait alors été Hénnsé
(27) É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n°4711 ; G. Moitrieux, Images [n. 26], p. 72-73, fig. 47.
(28) J.-J. Hatt, Les croyances funéraires des Gallo- Romains d'après la décoration des tombes dans R.A.E. 21, 1970, p. 71. Cette liste, si elle a le mérite de mettre en évidence le caractère surtout funéraire qu'a revêtu la représentation de ce dieu dans l'iconographie gallo-romaine, n'en est pas moins à utiliser avec précautions comme le prouve d'ailleurs le cas des deux figurations leuques d'Attis, celle de Toul, l'autre, actuellement perdue, provenant de Sion (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 4774), qui y sont intégrées sans preuves objectives de leur destination funéraire. J.-J. Hatt y recense, qui plus est, des reliefs qui ont toutes chances d'être votifs si l'on en juge d'après les supports, peu utilisés dans le domaine sépulcral, voire inconnus de la typologie traditionnelle des monuments funéraires gallo-romains : stèles en haut-relief (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 238 ; 6405) ; fût de colonne (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 4008) ; rondes-bosses (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 4271 ; 5113; 6410; 6928); pierre à quatre divinités (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 7491).
(29) Outre les exemples mentionnés dans la note précédente, voir notamment É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 892 ; 930 ; 938 ; 1267 ; 2676 ; 2716 ; 6932 ; 7687 ; 8080 ; Supplément Germanies , Paris, 1931, nos 58 ; 758.
(30) La seule chose qui soit sûre est que le bloc a été découvert avant 1863, date à laquelle il est mentionné pour la première fois dans les collections du Musée historique lorrain de Nancy (C. Cournault, Catalogue des objets d'art et d'antiquité exposés au Musée lorrain , Nancy, 1863, p. 5, n° 19). À cette difficulté s'ajoute l'encastrement du revers du bloc dans le mur de la salle où il est exposé, ce qui rend impossible l'étude d'éventuelles traces de liaisonnement qui permettraient d'imaginer le type de monument auquel il se rattachait.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
372 J.-N. CASTORIO
invitent à la prudence : si une destination funéraire est possible, elle demeure du domaine de l'hypothèse. Cette conclusion est également valable pour un fragment actuellement exposé au musée de Toul(31) (fig. 2). Il préserve la base d'un pilastre, délimitant une surface plane réduite aujourd'hui à presque rien, à l'intérieur duquel est gravé un cratère d'où semblent avoir jailli, originellement, des plantes dont seule subsiste la base des tiges. Tout comme la figure d'Attis, si ce motif, le «vase de vie», est surtout employé comme élément de la décoration annexe dans l'imagerie funéraire gallo-romaine (32), celle-ci n'en a nullement l'exclusivité (33). La très faible épaisseur de ce fragment (10,5 cm à sa partie supérieure) incite à le considérer comme un élément architectonique ; mais la nature du petit édifice auquel il s'intégrait demeure indéterminée.
Au total, le corpus des sculptures funéraires touloises se réduit donc à neuf œuvres (34), dont cinq inédites à ce jour. Malgré leur nombre peu élevé, il est possible de les répartir dans quatre catégories. Les deux premières sont définies en fonction de critères d'ordre typologique : quatre monuments (nos 1 à 4) se rattachent en effet au type classique et importé de la stèle, tandis que les deux suivants (nos 5 et 6) appartiennent à la famille d'origine indigène des cippes en forme de maison, également dite des «stèles-maisons». Dans la troisième catégorie, nous avons regroupé deux fragments (nos 7 et 8) dont tout laisse à penser qu'ils ont pu se rattacher à des monuments funéraires, l'aspect originel de ces derniers ne se laissant plus aujourd'hui deviner. Enfin, nous avons isolé la pierre n° 9 pour laquelle nous ne possédons que la description de Dom Calmet qui n'est pas suffisamment explicite pour permettre de définir le type auquel elle se rattachait.
Les sculptures conservées sont taillées dans un calcaire oolithique clair de provenance locale. De bonne qualité, son grain serré a permis une exécution
(31) Numéro d'inventaire 948.197 ; ce fragment inédit a été découvert en 1948 dans un contexte archéologique non défini, lors des travaux de reconstruction de la ville.
(32) Le motif apparaît fréquemment sur les faces latérales de stèles d'assez grandes dimensions (voir notamment les exemplaires franc-comtois reproduits et commentés par H. Walter, La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté , Paris, 1974, p. 154-155 ; nos 20 ; 68 ; 111 ; 112 ; 114) ou dans les pilastres angulaires de petits mausolées (par exemple É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 5154 ; 8423).
(33) Voir, par exemple, Ë. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 1300 ; 1574. (34) Nous avons écarté à dessein du cadre de cette étude les monuments funéraires
aniconiques provenant de ce site et conservés au musée de Toul : deux «stèles-maisons» et le fragment d'une structure de même type. Les deux monuments complets ont en effet fait l'objet d'une étude détaillée : l'un, provenant des remparts, par É. Delort, Inf. arch. VI [п. 12], p. 235-236, et par J. Choux et A. Liéger, Découvertes [п. 8], p. 95-97 ; l'autre, découvert en remploi au lieu-dit «le Jard», par A. Liéger et R. Marguet, Dragages [n. 4], p. 230-231, fig. 7.1. L'intérêt du fragment, inédit mais très mutilé, est surtout épigraphique.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 373
soignée des reliefs et un rendu assez précis des détails ; sa dureté moyenne a assuré une bonne résistance des reliefs à l'usure.
♦
L'état de mutilation des quatre stèles ci-dessous décrites ne permet plus d'opérer en leur sein la traditionnelle distinction d'après le couronnement. Il convient toutefois de séparer les deux premiers reliefs, conservés, des deux suivants, perdus ; l'impossibilité de mener une étude directe de ces derniers laisse planer une part d'incertitude quant à leur interprétation, variable il est vrai, selon la qualité des clichés qui nous en sont parvenus.
1. Stèle de couple à mi-corps (35) (fig. 3 et 4). La stèle, conservée au musée de Toul, a été découverte rue Qui-qu'en-Grogne
en 1992. Ce monument, très mutilé, a été retrouvé en de multiples fragments, de
dimensions variées, que l'on a pu recoller. Sa partie supérieure (couronnement, cintre de la niche) manque. Le relief a beaucoup souffert : de larges brisures le sillonnent qui, s'alliant à l'usure et à l'alvéolisation, rendent parfois délicate la lecture de détail ; la majeure partie des traits des défunts a été arasée. Enfin, sur la façade et la face latérale gauche, la pierre présente une coloration de surface brunâtre, due à sa présence prolongée en milieu aqueux.
Le relief a été égrisé mais quelques traces de gradine subsistent dans le fond de la niche et sur le crâne du défunt. Le revers et les faces latérales ont été aplanis au ciseau (36).
Ensemble - H. max. conservée: 118,5cm, 1. max.: 77,5cm, ép. max.: 37,5 cm.
Base non décorée = H. : 35 cm. Cartouche = H. : 25 cm, 1. : 63,5 cm, 1. des moulures : 2 cm. Niche = H. conservée : 40 cm, 1. : 62 cm. Défunts = H. de l'homme: 36cm, H. de sa tête 15,5cm; H. de sa
compagne : 35,5 cm, H. de sa tête : 17 cm ; saillie max. du relief : 12 cm. Inscription - H. des lettres de la première et de la troisième ligne : 4 cm,
de la deuxième ligne : 3,7 cm. L'épitaphe, aux caractères soignés et régulièrement agencés, est placée dans
un cartouche délimité par deux moulures, la moulure extérieure étant plus saillante.
(35) Dans les descriptions, les notions de droite et de gauche sont définies, non par rapport au spectateur, mais par rapport au monument.
(36) Pour l'identification des traces d'outils, voir J.-C. Bessac, L'outillage traditionnel du tailleur de pierre de l'Antiquité à nos jours , Paris, 1986 (R.A.N., suppl. 14), 319 p., 61 fig.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
374 J.-N. CASTORIO
On peut lire : D M
MARINO PACATI FILIO ET MATERNAE . VXORI.H.P.C
D(is) M(anibus) / Marino Pacati filio et / Maternae uxori h{eres) p(onendum) c(urauit), «Aux Dieux Mânes, à Marinus, fils de Pacatus, et à Materna, sa femme, leur héritier a fait élever (ce monument)».
Le T et le E de Maternae sont ligaturés. Les lignes horizontales gravées pour permettre de centrer l'inscription n'ont pas été effacées par la suite.
Les trois noms qui apparaissent sur cette épitaphe sont assez courants dans la région : les formes Pacatus et Materna ne se rencontrent pas ailleurs dans la cité, mais elles sont en revanche attestées chez les Médiomatriques et les Trévires (37) ; la forme Marinus, fréquente en Gaule, se retrouve au sud de la cité, à la frontière avec les Séquanes, sur une stèle funéraire provenant de Monthureux-sur-Saône (Vosges) (38).
La façade de cette stèle est organisée en trois niveaux superposés : une haute base, libre de sculpture, délimitée à sa partie supérieure par une large encoche horizontale ; le cartouche contenant l'inscription ; la niche où sont représentés les personnages. Le couronnement ne nous est pas parvenu, mais la présence de deux lobes, soigneusement dessinés, de la valve d'une coquille en arrière du personnage masculin suggère que la niche possédait un sommet cintré. À l'extrémité du montant gauche, les vestiges d'un petit chapiteau cubique en légère saillie sont encore visibles.
Les personnages sont traités en un vigoureux bas-relief, proche de la ronde- bosse pour les têtes. Coupés au niveau du sternum, ils semblent comme accoudés au rebord d'une fenêtre. L'inscription indique qu'il s'agit d'un couple marié, la femme se tenant, comme le veut la tradition, à la droite de son mari. Le sculpteur a cherché à rompre la frontalité de la représentation et à établir un lien entre les deux défunts en les tournant légèrement l'un vers l'autre ; il n'a cependant pas totalement maîtrisé cette posture : l'épaule gauche de Marinus, notamment, se trouve maladroitement relevée par rapport à celle de droite.
L'usure de la pierre rend les attributs portés difficilement identifiables. La femme ramène à sa poitrine, de sa main droite, un gobelet. L'objet qu'elle tient au niveau de son épaule gauche est plus énigmatique : sa forme biconique pourrait évoquer une quenouille, la laine qui l'entoure étant suggérée par de petites stries concentriques. L'homme tient dans la main droite une petite
(37) Pour Pacatus, C/L, XIII, 4349 ; 1 1400 de Metz ; pour Materna, CIL , XIII, 4020 d'Arlon ; 4373 de Metz.
(38) CIL, XIII, 4712.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 375
hache dont le tranchant repose sur son épaule droite, et dans la main gauche, par le col, une bourse allongée.
Marinus est vêtu d'une tunique munie d'une capuche. Il est chauve ; son oreille droite, traitée sous la forme d'un large bourrelet en S, est encore visible, de même qu'une partie de son œil droit, dont l'orbite enfoncée est placée sous un front bombé ; la paupière supérieure en arc de cercle, très épaisse, délimite un globe oculaire à peine saillant. Peu de choses subsistent des traits de Materna : une partie de ses joues et de sa coiffure ; celle-ci, simple, forme une calotte à peine travaillée sur le dessus du crâne, tandis qu'un large bourrelet, au niveau des tempes, évoque deux larges mèches, couvrant à moitié les oreilles, qui devaient se rejoindre sur le sommet de la nuque pour former un chignon. Elle est vêtue d'une tunique dont l'encolure ronde est soulignée par deux bourrelets concentriques et qui est animée, à l'image de celle de son mari, de plis formant un large V sur la poitrine.
Le sculpteur a produit un travail soigné, tant du point de vue de la réalisation du cadre architectural et de la gravure de l'inscription que de celui de l'exé- cution des effigies funéraires. Le plissé soigneusement modelé, le traitement des doigts légèrement fuselés dénotent une recherche d'élégance, s'alliant à une volonté d'individualisation très sensible dans les traits du visage de Marinus (calvitie, pomme d'Adam) qui font songer à un véritable portrait. Son art n'est cependant pas exempt d'une certaine tendance à la schématisation, voire à l'exagération, perceptible dans le rendu de certains détails anatomiques (œil, oreille) et dans les proportions (légère proéminence de la tête).
2. Stèle à deux personnages à mi-corps (fig. 5). Ce monument, également conservé au musée de Toul, provient du même
endroit que le précédent. Sciée lors du remploi, toute la partie haute du monument, au-dessus des
épaules des défunts, est perdue. L'angle inférieur droit de la face latérale gauche et la base du montant gauche de la niche ont été emportés par des éclats. Malgré quelques petites altérations (épaufrures, traces d'usure), la portion de relief conservée demeure très lisible. La blancheur du calcaire est partiellement masquée, pour les mêmes raisons que pour le précédent relief, par une patine brune.
Le revers et les faces latérales ont été aplanis au ciseau. Ensemble = H. max. conservée : 61,5 cm, 1. max. : 52,5 cm, ép. max. à la
base : 24 cm, ép. max. au niveau des figures : 20 cm. Personnages - H. conservée : 27 cm.
Cet important fragment préserve la haute base d'une stèle et les deux personnages, acéphales désormais, qui y étaient sculptés dans une niche peu profonde. Un empattement au pied de la façade du monument est destiné
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
376 J.-N. CASTORIO
à en renforcer la stabilité. À l'extrémité du montant droit subsiste l'ébauche d'un petit chapiteau mouluré.
Les effigies des défunts, deux hommes sans doute (leurs tuniques semblent munies d'une capuche, indiquée par un large bourrelet autour du cou, qui caractérise ce type particulier de vêtement masculin qu'était le cucullus (39)), sont travaillées en bas-relief. Coupés à mi-corps, ils sont représentés comme «à une fenêtre» Í40), leurs attributs pendant sur la base non sculptée. La compo- sition n'est pas très adroite ; les personnages paraissent à l'étroit, celui de droite étant légèrement tourné vers son voisin en position parfaitement frontale. C'est sans doute l'exiguïté de la niche qui a incité le sculpteur à figurer le bras droit de son personnage de gauche en un raccourci, malheu- reusement assez peu habile, souligné par un ample pli en U renversé sur la manche.
Les défunts sont tous deux vêtus d'une tunique à emmanchures lâches, au plissé modelé, essentiellement vertical à l'exception du large V qu'il dessine sur leur poitrine. Le défunt de droite tient devant lui, de ses deux mains, une bourse ; l'index de sa main droite, fuselé et à peine modelé, est tendu ; le pouce et l'index de sa main gauche enserrent le bas de l'objet à la manière d'une tenaille. Ce traitement très décoratif des doigts est encore accentué pour l'index et l'auriculaire des mains de son voisin, démesurément allongés et étrangement tordus au niveau de la deuxième phalange. De sa main gauche, ce dernier ramène à sa poitrine une hache munie d'un court fer et d'un très long manche qui se prolonge sur la base et est affecté du même tracé sinueux que ses doigts. De son autre main, il porte un objet difficilement identifiable, entièrement sculpté sur le socle, sorte de lanière pourvue à son extrémité droite d'une petite excroissance sphérique.
L'œuvre, sans conteste naturaliste, fait montre cependant d'une recherche d'élégance qui l'emporte sur la volonté d'exactitude anatomique. Cela est surtout sensible dans l'exécution des mains, que n'auraient pas désavouée les grands maniéristes lorrains du xviie siècle. Si l'index et/ ou l'auriculaire tendus se retrouvent sur un certain nombre de stèles funéraires gallo-romaines (41),
(39) On remarquera de plus que la bourse, portée par le personnage de droite - place réservée à la défunte dans les représentations de couple - , est un attribut généralement masculin. Ainsi, sur les quinze autres monuments funéraires de la cité où cet objet apparaît, il n'est tenu que dans un seul cas par une femme (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 4846 de Soulosse-sous-Saint-Élophe).
(40) Sur ce type de présentation illusionniste des défunts, assez rare dans le nord- est de la Gaule mais qui semble avoir connu un certain succès chez les Leuques (voir également la stèle n° 4), voir H. Walter, Franche- Comté [n. 32], p. 21, et la liste d'exemples qu'elle fournit.
(41) Voir A. Colombet, Une particularité de certaines stèles funéraires gallo- romaines : l'index tendu dans B.S.A.F. 1965, p. 258-264, fig., pl., qui a notamment dressé une liste non exhaustive d'œuvres présentant ce trait stylistique, et F. Braemer,
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTORES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 377
nous n'en connaissons toutefois guère d'exemples où ce détail aboutisse à une déformation des membres à ce point outrée.
3. Stèle rectangulaire (?) avec figuration de deux femmes en pied (42) (fig. 6). Cette stèle, perdue, avait été découverte avant 1893, brisée en trois fragments
- elle fut ensuite restaurée - , dans les fondations d'une maison de la place du Marché.
D'après É. Espérandieu : H. : 155 cm, 1. : 90 cm, ép. : 20 cm. Au-dessus de la niche, ont pouvait lire :
[D] M ...] NEBNICCAE F («)
[D(w)] M(anibus) I [...]nebniccae flilia), «Aux Dieux Mânes, [...] fille de [...]nebnicca».
Deux clichés de ce monument ont été publiés, l'un par G. Save, l'autre par É. Espérandieu. Associés aux commentaires qui les accompagnaient, ils sont de qualité suffisante pour permettre une approche descriptive et stylistique. Il demeure toutefois difficile de juger si le couronnement reproduit correspond à l'aspect originel de la stèle ; il est en effet possible que celui-ci ait été prolongé par un fronton scié lors du remploi, ce qui expliquerait l'absence du D dans l'invocation aux Dieux Mânes.
Dans une niche en cul-de-four surbaissé, dont le cintre, divisé en deux par la clé d'une valve de coquillage, est souligné par une incision, deux femmes
À propos de l'index tendu de certains personnages des monuments funéraires , ibidem , p. 264-268. Cette particularité a été étudiée en détail sur les monuments de Franche- Comté par H. Walter, Franche-Comté [n. 32], p. 160.
(42) Le monument a été étudié en détail, à la fin du siècle dernier, par G. Save, Stèle [n. 23], p. 180-182, pl. Il est répertorié par É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 4712 et XIV, p. 84, et cité dans divers ouvrages et articles : L. Hahl, Zur Stilentwiklung der Provinzialrömischen Plastik in Germanien und Gallien , Darmstadt, 1937, p. 35 (non vidi); P. Francastel, Sculpture gallo-romaine et sculpture romane dans R.A. , 1944, И, p. 137 ; M. Toussaint, Meurthe-et-Moselle [n. 7], p. 121-122 ; R. Bianchi-Bandinelli, Rome, la fin de l'art antique , Paris, 1970, p. 157. L. C. Kahn lui a consacré quelques lignes dans sa thèse sur la sculpture gallo-romaine de Soulosse ; voir L. C. Kahn, Gallo-roman sculpture from Soulosse, France , Diss. Boston Univ., 1990, p. 216-217.
(43) CIL , XIII, 4673. La reconstitution de cette épitaphe est problématique : en effet, si l'on se fie au cliché reproduit par É. Espérandieu, il semble qu'un nom difficilement lisible ait précédé la filiation ; mais son absence d'alignement avec celui de Nebnicca, la présence, après la première lettre, d'un petit point en bas de ligne au lieu du milieu de celle-ci comme il se doit, enfin le fait qu'il n'apparaisse pas sur la photographie publiée par G. Save peuvent faire douter de l'origine antique des cinq lettres qui le composent. Il est dès lors impossible de déterminer si le nom Nebnicca est complet ou non.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
378 J.-N. CASTORIO
se tiennent debout, se détachant vigoureusement du fond de la niche. Celle de droite ramène à mi-corps, de sa main droite, un grand couteau (**) dont la pointe touche son bras, et de son autre main, à l'index et à l'auriculaire tendus, une serviette (mappa) peut-être. Sa voisine semble présenter au spectateur le contenu d'un coffret à bijoux (45), décoré sur sa face principale de deux rectangles imbriqués.
Elles sont vêtues de la même manière : une tunique ample et à larges emmanchures, s'arrêtant au-dessus des chevilles, surmonte une tunique de dessous, à encolure ronde moins large, couvrant en partie les pieds, et faite d'une étoffe moins épaisse. La femme de droite porte de plus une écharpe enroulée de façon lâche autour de son cou et retombant en un large pan sur son flanc gauche. Le plissé, qui semble avoir été fortement modelé, est essentiellement vertical et tuyauté ; de petits plis obliques rompent par endroits, au niveau des genoux et des bras, cette stricte verticalité et soulignent la position des membres. Sur les jambes, l'étoffe épouse le corps et dévoile les déhanchements opposés des deux personnages, la femme au coffret ayant la jambe gauche libre, à l'inverse de sa voisine.
Les deux visages sont construits sur des ovales pleins ; les traits, fermes, en sont assez proches. Seule la coiffure les différencie nettement. La femme de gauche a sa chevelure divisée en deux par une raie médiane, de longues mèches légèrement ondulées encadrant de part et d'autre ses joues et couvrant ses oreilles. L'arrangement de la coiffure de la femme de droite est plus complexe : elle est composée, selon G. Save, «[...] d'un bandeau plat, collant au crâne, par dessus lequel une calotte, à bourrelet partant du milieu du front, semble se prolonger en pans assez longs pour faire deux fois le tour du cou, comme le chaperon du XVe siècle» O*6). Plus que d'un couvre-chef, il doit s'agir d'un arrangement spécifique de la coiffure, en bandeaux, à la mode antonine.
L'impression générale est d'élégance, mais une élégance dont la recherche, à la différence de la stèle précédente, ne nuit pas au naturalisme de la repré- sentation. Si les poses sont légèrement affectées, les doigts, artificiellement tendus, l'artiste a su construire des figures solides (le canon semble avoir été
(44) Comme le notait É. Espérandieu, il est insolite de trouver cet attribut dans des mains féminines ; il ne s'agit toutefois pas d'un hapax comme il le pensait puisque l'on trouve un couteau dans la main gauche d'une défunte figurée sur un cippe de Bains-les-Bains (signalé par M. Toussaint, Répertoire archéologique du département des Vosges , Épinal, 1948, p. 6).
(45) Un coffret de ce type, ouvert et empli de bijoux, est tenu par une femme peinte sur l'un des caissons du plafond du palais impérial de Trêves ; voir le catalogue de l'exposition La civilisation romaine de la Moselle à la Sarre , Mayence, 1983, p. 238, n° 288.
(46) G. Save, Stèle [n. 23], p. 180. Cet auteur proposait de reconnaître en ce per- sonnage un prêtre, mais la coiffure et le vêtement, long, permettent d'identifier avec certitude une défunte.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 379
proche de la normale, aucune disproportion n'est perceptible) et les extraire avec vigueur du fond de la niche. En leur appliquant les procédés classiques (déhanchement, «draperie mouillée»), il est également parvenu à rendre tangible la présence du corps sous la lourdeur des étoffes.
4. Stèle rectangulaire (?) figurant une femme à mi-corps (47) (fig. 7). Aujourd'hui perdue, cette stèle avait été découverte lors du démantèlement
du rempart en 1700. D'après É. Espérandieu : H. : 60 cm, 1. : 35 cm. En dessous de la niche, en caractères de bonne qualité, dans un cartouche
mouluré : CAROSAE
MELINDI FIL (48) Carosae Melindi fìl(iae ), «À Carosa, fille de Melindus». Le M et le E de Melindi sont ligaturés, le D est barré (49).
(47) La littérature à son propos est très abondante ; elle se contente pour partie de critiquer ou de diffuser les légendes qui se sont développées au sujet de ce relief après qu'il eut été encastré dans le parement du mur d'enceinte de Vauban (voir par exemple A. D. Thier y, Histoire de la ville de Toul et de ses évêques, Toul, 1841, p. 34, grav. ; Daulnoy, Histoire de la ville et cité de Toul depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours , Toul, 1881, p. 5, n. 1 ; François, Études sur Toul Ancien. Les Toulois aux xvne et xvrne siècles , Toul, 1891, p. 239). En effet, surnommé le «Fils du gouverneur», il aurait été censé représenter l'enfant du gouverneur de la ville ressuscité par saint Mansuy, l'évangélisateur de Toul, mais on y a également vu une préfiguration de l'eucharistie ou la figuration de Jésus enfant. Plusieurs articles plus sérieux lui ont été consacrés (R. Mowat, Inscription de Toul à bas-relief dans B.S.A.F. 1889, p. 251-253, fig. = L. G[ermain], La stèle de Carosa à Toul dans Journ. de la Soc. d'arch. lorraine 41, 1892, p. 80-85, fig. ; abbé Vanson, intervention dans B.S.A.F 1891, p. 83 ; A. Benoît, La stèle de Carosa à Toul dans La Lorraine Artiste 12, 1894, p. 114-115) et il a fait en outre l'objet d'assez nombreuses citations (De Ladoucette, Appendice à la «Notice sur la ville et le comté de Scarpone» du P. Le Bonnetier dans Mém. de la Soc. des Antiq. de France 10, 1834, p. 99-100 ; A. Dufresne, Notice [n. 7], p. 5 ; H. Lepage, Le département de la Meurthe, Statistique historique et administrative , II, Nancy, 1843, p. 577 ; abbé Guillaume, Histoire du diocèse de Toul et de celui de Nancy , I, Nancy, 1866, p. 87 n. 3 ; Em. Olry, Toul [n. 7], p. 13 ; [Gilbert], Musée de Toul, Historique, règlement et catalogue , Toul, 1894, p. 79, n° 297 = [H. Calot], Musée de Toul, historique, règlement, catalogue , Toul, 1909, p. 64, n° 14 ; J. Beaupré, Les études préhistoriques en Lorraine , Nancy, 1902, p. 196-197 ; M. Toussaint, La Lorraine à l'époque gallo-romaine, Nancy, 1928, p. 140 ; Meurthe-et-Moselle [n. 7], p. 119-120 ; J.-J. Hatt, La tombe gallo-romaine , Paris, 1951 [1986], p. 162). Il est répertorié par É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 4713.
(48) CIL, XIII, 4672. (49) Le и barre correspondrait a un son de la langue gauloise qui ne pouvait être
correctement rendu en utilisant l'alphabet latin traditionnel ; voir Y. Burn and, Histoire de la Lorraine, I, Les temps anciens, 2, De César à Clovis , Nancy, 1990, p. 145.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
380 J.-N. CASTORIO
Les deux noms qui apparaissent sur cette épitaphe sont vraisemblablement d'origine celtique : la forme masculine de Carosa, Carosus, se rencontre à Metz i50) ; le nom Melindus est un hapax (51).
De cette stèle nous ne possédons que deux médiocres photographies (52). Apparemment rectangulaire (comme pour le monument précédent, rien ne permet toutefois d'affirmer que le couronnement n'ait pas été anciennement perdu), elle est divisée en deux registres : le cartouche contenant l'épitaphe, surmonté de la niche cintrée où est figurée la défunte à mi-corps.
Elle est représentée comme à une fenêtre, la mappa qu'elle ramène à sa poitrine de sa main gauche pendant à la partie inférieure, sur le haut du cartouche. Sur le geste qu'elle effectue de la main droite, les interprétations se sont succédé. Dans un premier temps, on a cru qu'elle tenait dans cette main une boule (53). R. Mowat en proposait une tout autre lecture : «[...] de la main droite elle paraît caresser la tête d'un quadrupède indéterminé (chien ? chat ?) posé sur ses épaules» (M). C'est l'abbé Vanson qui a suggéré l'interprétation que nous retiendrons (55) : en la comparant à un relief de Trêves représentant une scène de toilette (56), il a pensé à la représentation d'un miroir ; il est vrai que la tête, légèrement tournée vers la droite, ne se situe pas en face de l'objet, mais cette maladresse est fréquente dans les scènes de ce type (57).
Les clichés ne permettent pas une description plus poussée. L'art de cette stèle semble avoir été d'une certaine qualité, naturaliste, mais sans subtilité.
*
Le cippe en forme de maison, type d'origine indigène communément qualifié de «stèle-maison» (58), est représenté par deux monuments.
(50) Voir A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz , I, Leipzig, 1896, p. 801. (51) Voir A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz [n. 50], II, Leipzig, 1904, p. 536. (52) L'une est reproduite dans l'article de R. Mowat, l'autre accompagnait la notice
que lui a consacrée É. Espérandieu. (53) A. Dufresne, Notice Гп. 71, p. 5. (54) R. Mowat, Bas-relief [n. 47], p. 251. (55) Abbé Vanson, Intervention [n. 47J, p. 83. (56) Ë. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 5142. (57) Voir les exemples reproduits par C. Nerzic, La sculpture en Gaule romaine ,
Paris, 1989, p. 234 ; H. Walter, Franche-Comté [n. 32], p. 148 ; nos 25 ; 35. (58) Il s agit du terme consacre depuis retude a n. linckenheld, bes sietes en
forme de maison chez les Médiomatriques et en Gaule , Strasbourg, 1927, 160 p., 30 fig., 4 pl., 5 pl. h.-t. ; toutefois, comme l'a noté F. Pétry, Typologie des monuments funéraires de Saverne (Bas-Rhin). Des modèles romains aux formes locales dans R.A.E. 23, 1982, p. 59 n. 10, il est en fait assez peu adapté, puisque la plupart de ces monuments ont une épaisseur égale ou supérieure à la largeur de leur façade, ce qui les assimile plus au cippe qu'à la stèle.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 38 1
5. Cippe en forme de maison avec figuration en façade d'une femme à mi- corps (fig. 8 et 9).
Conservé au musée de Toul, il a été découvert dans les mêmes conditions que les stèles nos 1 et 2.
Si la figure humaine a été intégralement préservée, l'architecture du cippe a, en revanche, beaucoup souffert. Le monument est actuellement en deux fragments : le plus important constitue toute la portion avant ; le second, de taille plus réduite, devait, malgré sa présentation actuelle au bas de la pierre, constituer la partie supérieure de son revers. La face latérale gauche a été retravaillée au pic lors du remploi, entraînant la disparition du rebord gauche de la façade et du rouleau angulaire qui le surmontait. À l'image des stèles nos 1 et 2, le calcaire présente une coloration de surface brunâtre.
Bien que très altérés, le revers et les faces latérales semblent avoir été originellement aplanis. La cavité cinéraire a été creusée à l'aide d'une pointe- rolle et le fond de la niche est couvert des griffures du ciseau.
Fragment antérieur = H. max. conservée, correspondant à la hauteur originelle du cippe : 95,5 cm, 1. max. conservée : 31 cm, ép. max. à la base : 38 cm.
Fragment postérieur = H. max. conservée : 55 cm, 1. max. conservée : 32 cm, ép. max. : 31 cm.
Personnage = H. totale : 35 cm, H. de sa tête : 12,5 cm ; saillie max. du relief : 6,5 cm.
Niche = prof. : 4 cm. Ouverture et cavité cinéraire = 1. de la moulure soulignant l'ouverture :
3,5 cm ; prof, de la cavité cinéraire : 21 cm.
Ce cippe, haut, long et étroit en façade, peut être rattaché à la catégorie des «stèles-maisons» en ce qu'il présente un certain nombre d'éléments qui évoquent tant la grande architecture que l'habitation domestique : son cou- ronnement semi-cylindrique, accosté à chaque angle de deux rouleaux, est parcouru, en son centre, sur toute sa longueur, par une traverse imitant une poutre faîtière ; à la base de la façade, une très large ouverture en plein-cintre, soulignée par une épaisse moulure, communique avec la cavité cinéraire (loculus), voûtée en cul-de-four, où venait se loger l'urne contenant les cendres de la défunte.
À la partie supérieure de la façade, au-dessus d'une base élevée laissée libre de sculpture, une femme est représentée jusqu'au haut des cuisses, dans une niche à couronnement cintré surbaissé et à fond plat. Si la figure se détache assez nettement du fond de la niche et fait saillie par rapport à ses montants, le sculpteur a privilégié l'incision au modelé pour l'essentiel du rendu des détails.
La défunte ramène, de ses deux mains, à mi-corps, un vase à la panse
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
382 J.-N. CASTORIO
large et trapue (59). Elle est vêtue d'une tunique dont les plis ondulés sont répartis concentriquement autour du récipient ; sur ses épaules est jeté un manteau-écharpe qui dessine un large bourrelet autour de son cou. Couvrant sa chevelure jusqu'au haut de la nuque, un voile forme une sorte de repli au sommet de son crâne et dégage quelques mèches incisées de sa coiffure ainsi que les oreilles, petites et trop basses.
Au-dessus d'un cou cylindrique dont la robustesse contraste avec la maigreur des joues, les traits du visage se composent de formes géométriques simples : la bouche, dont seule la lèvre inférieure est modelée, est une incision rectiligne ; le nez fin, en triangle, se prolonge sans discontinuité dans les arcades sourcilières, en quart d'ovale, qui font saillie par rapport au front bas et projettent leurs ombres sur les orbites enfoncées, au centre desquelles le globe oculaire forme une petite protubérance en amande délimitée par deux courtes entailles. La succession d'angles droits constitués par le menton et le nez confère au visage, vu de profil, un léger prognathisme.
D'un point de vue typologique, s'allient ici la forme indigène de la «stèle- maison» et la représentation en façade du défunt à la mode gréco-romaine. Le relief quant à lui, s'il s'inspire également de l'art académique, en méconnaît les principes élémentaires : la figure est disproportionnée, la tête proéminente ; le modelé, quand il ne laisse pas place à l'incision mise au service d'une recherche ornementale, notamment pour le traitement du drapé, se caractérise avant tout par sa brutalité.
6. Cippe en forme de maison avec figuration de couple à mi-corps en façade (fig. 10).
Ce cippe, mis au jour dans des conditions inconnues, est actuellement conservé chez M. G. Martin à Dommartin-lès-Toul.
Le couronnement de ce monument a été scié, à une époque indéterminée, pour permettre son remploi, et sa face latérale droite retaillée en oblique pour la même raison. Un important éclat a emporté une partie du cintre de la niche ; de plus petits ont endommagé angles et arêtes. L'usure a gommé les parties les plus saillantes du relief, comme le nez et la bouche des défunts.
Le fond de la niche est couvert par les stries de la gradine, également apparentes à certains endroits de la sculpture. Le revers a été aplani à l'aide d'un ciseau fin.
Ensemble = H. max. : 65,5 cm, 1. max. : 56 cm, ép. max. : 44,5 cm. Base - H. : 21,5 cm. Ouverture = H. : 5 cm, 1. max. : 7 cm. Niche = H. max. : 42 cm, 1. max. : 47,5 cm.
(59) Identique à celui tenu de la même manière par la défunte d'une stèle plus savante de Soulosse ; voir É. Espérandieu, Recueil ' n. 24], n° 4862.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 383
Personnages = H. de la défunte : 39,5 cm, H. de sa tête : 16,5 cm ; H. du défunt : 39 cm, H. de sa tête : 15,5 cm ; vigueur du relief : 6 cm.
Bien que les mutilations dont a été victime ce cippe lors de son remploi (qui n'est d'ailleurs peut-être pas le premier : rien ne justifie en effet, dans son usage actuel, la taille oblique de la face latérale droite) aient entraîné la disparition de tout élément évoquant une architecture, son importante épaisseur et la présence à sa base de l'ouverture menant à la cavité cinéraire constituent des caractéristiques propres aux cippes en forme de maison.
En façade, dans une niche à fond plat au cintre surbaissé, sont figurés deux époux à mi-corps. Le bas-relief, peu vigoureux pour les poitrines, se mue en demi-relief pour les visages.
Le défunt ramène à son sternum, de sa main gauche, une bourse, et saisit de son autre main le gobelet à dépressions tenu en avant de sa poitrine par sa compagne, qui l'enlace en retour de son bras gauche. Elle est vêtue d'une tunique à manches serrées, surmontée d'une écharpe couvrant ses épaules et dont les pans sont rejetés dans le dos. L'homme porte deux tuniques à enco- lures rondes, la tunique de dessus semblant munie d'un capuchon. Le plissé, plus incisé que modelé, est essentiellement vertical, à l'exception des trois bourrelets qui animent l'écharpe et en suivent le tracé.
Le visage du défunt, aux joues pleines, est construit à l'aide d'un ovale. Seuls ses yeux, au dessin stylisé, et sa chevelure se prêtent à une lecture de détail : le globe oculaire, légèrement bombé, est bordé à sa partie supérieure par une paupière modelée, à sa partie inférieure par une profonde incision, l'une et l'autre se rejoignant et se prolongeant nettement sur les tempes ; sa coiffure est faite de grosses mèches rabattues sur son haut front animé par deux petites rides. Du visage de sa voisine, en forme d'ovale plus étiré, seule la chevelure demeure parfaitement lisible : elle se compose de larges mèches tirées derrière les oreilles, puis retombant mollement de part et d'autre du visage, avant de se rejoindre, sans doute, en un chignon placé au sommet de la nuque, à la manière des coiffures des princesses sévériennes.
Un contraste d'exécution apparaît assez nettement lorsque l'on examine tour à tour corps et visages. Sur les poitrines, le modelé manque de vigueur et il arrive par endroits (plissé, doigts) que l'incision s'y substitue. La main qui a réalisé cette partie du relief n'est parvenue à lier par le geste les deux défunts qu'au prix de déformations anatomiques : le bras droit du mari, trop court, se casse pour saisir le gobelet tenu par son épouse, tandis que l'enlace- ment provoque un allongement excessif du bras gauche de cette dernière. Si une certaine tendance à la stylisation du détail y est perceptible, l'art des visages paraît plus sûr : solidement construits, modelé (joues, mentons) et incision (rides du front, mèches) y alternent dans une recherche, assez élémen- taire il est vrai, des jeux de la lumière sur les surfaces.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
384 J.-N. CASTORIO
Le motif des Amours porte-cartouche, sculpté sur le fragment n° 7, s'il est un poncif fréquent dans l'art funéraire gallo-romain i60), n'est toutefois pas plus que la figure d'Attis ou le «vase de vie» spécifique à ce domaine de l'iconographie (61). И nous aurait donc semblé plus prudent de l'écarter, si n'existait le dessin d'un fragment (n° 8) très proche, mais perdu, dont l'inscription certifie cette fois le caractère sépulcral et qui démontre que le thème était connu et utilisé dans l'imagerie funéraire de Toul. Il ne peut cependant s'agir que d'une hypothèse.
7. Fragment de stèle (62) (fig. 1 1). Conservé au Musée de Toul, il a été mis au jour quai de la Glacière en
1990. Le fragment est très altéré. Sur tout le pourtour de la niche, sa surface
a été grossièrement retaillée au pic lors du remploi. Des éclats ont emporté les détails des pieds du personnage et rendent les vestiges de l'inscription illisibles. La pierre présente, sur la face latérale gauche notamment, une coloration noire et de multiples traces d'usure.
Le revers, très endommagé, devait être originellement aplani. Ensemble = H. max. conservée : 43,5 cm, 1. max. conservée : 45 cm, ép.
max. : 30 cm. Putto = H. conservée : 15 cm. Feuilles imbriquées - H. max. : 13 cm. Inscription = H. des lettres : 3,2 cm. Une inscription en assez beaux caractères se trouvait dans le cartouche.
L'extrémité des deux dernières lignes est conservée mais, à l'exception du X final de l'avant-dernière, les lettres en sont indéchiffrables (un éclat ne permet pas de déterminer si l'ultime lettre de l'épitaphe est un О ou un D).
(60) Sur les soixante-dix exemples recensés dans le Recueil d'É. Espérandieu et de R. Lantier de monuments ou de blocs sur lesquels est sculpté ce motif, la très grande majorité (cinquante-huit exemples) a une destination funéraire, qu'atteste généralement l'inscription. Il s'agit essentiellement de sarcophages (voir, par exemple, É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 48 ; 1774 ; 2155 ; 5631), mais les putti porte- cartouche ne sont toutefois pas absents du répertoire décoratif de simples stèles funéraires : chez les Leuques par exemple, ils apparaissent sur une stèle de Charmois- l'Orgueilleux dans les Vosges (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 4808) où ils sont placés, de manière inaccoutumée, à la partie supérieure du monument, au-dessus de la niche contenant l'effigie des défunts.
(61) Voir, par exemple, E. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 5504 de Strasbourg ; 4596 du Donon (Vosges). À ce propos, voir N. Blanc et F. Gury, Apports d'une base de données à l'iconographie régionale : quelques aspects d'Amor en Gaule dans Le monde des images en Gaule et dans les provinces voisines, Actes du colloque de Sèvres, 16-17 mai 1987 , Paris, 1988 ( Caesarodunum , XXIII), p. 62-75, 8 fig.
(62) Ce fragment porte le numéro 990.53.4 de 1 inventaire du musée de Toul.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 385
Ce fragment constitue la partie inférieure gauche de ce qui devait être une stèle (63), débitée lors de son remploi dans le Castrum. En façade, dans une niche peu profonde, subsistent les jambes nues, conservées jusqu'au haut des cuisses, d'un petit personnage soutenant un cartouche (une partie de son bras droit est encore visible) : le déhanchement est marqué, la jambe gauche étant de face, tandis que celle de droite est de profil, le bout du pied orienté vers le cartouche. Le travail, assez habile (le relief est peu vigoureux, mais le modelé est soigné), laisse deviner les jambes potelées d'un enfant, sans doute un Amour, qui devait avoir son pendant à l'extrémité opposée. De grosses écailles imbriquées décoraient les faces latérales du monument, comme en témoignent des vestiges sur le côté gauche du fragment.
8. Fragment de monument funéraire (M) (fig. 12). La pierre, découverte lors du démantèlement du rempart en 1700, portait
une inscription (65) dont ne subsistait que la fin des cinq dernières lignes à l'époque où Montfaucon en effectua le relevé :
...]IEM ...]MAN ...]IANI
...] [U]XOR
...] [F]ECIT Le fragment, si l'on se fie au dessin de Montfaucon, représentait un Amour,
de profil, la jambe gauche en avant et la tête de face, les ailes largement déployées, soutenant par deux excroissances courbes un cartouche à la bordure moulurée où figurait l'inscription. Ici, les termes [u]xor et [f]ecit, aisés à restituer malgré la mutilation de la pierre, attestent la fonction funéraire : É. Espérandieu ne s'y est pas trompé puisqu'il a qualifié l'inscription d'épi- taphe. Dans ce cas, à l'image du précédent, ce fragment aurait constitué la partie inférieure gauche d'un monument de plus grande importance.
*
9. Monument funéraire avec figuration d'un défunt, perdu, mais décrit par Dom Calmet.
De ce monument, nous ne savons que peu de choses : la date de la découverte est inconnue, sa localisation (faubourg Saint-Èvre ?) est on ne peut
(63) Il convient peut-être alors d'imaginer un ordonnancement de la décoration assez proche de celui que laisse deviner un fragment provenant de Coblence ; voir É. Espérandieu, Recueil [ n. 241, n° 6182.
(64) Le fragment aujourd'hui perdu n'est plus connu que par le dessin qu'en a laissé le père B. De Montfaucon, Papiers [n. 21], fol. 110. Voir à son propos, É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 4714 ; M. Toussaint, Meurthe-et-Moselle [n. 7], p. 118.
(65) CIL, XIII, 4676.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
386 J.-N. CASTORIO
plus vague et il est impossible de déterminer, d'après la description, à quel type de structure funéraire il appartenait.
Sur la pierre était figuré «[...] un homme en demi-relief, dans une espèce de niche, qui tient de la main droite une bourse, et a la gauche appuyée sur un hoyau couché sur le rebord de la niche ; au-dessous de la figure par en bas il y a une ouverture comme pour faire couler les cendres du mort au fond du tombeau. Cette figure porte des cheveux très courts, et n'a pour tout habit qu'une tunique sans manteau» i66).
La bourse, «attribut-poncif» extrêmement courant dans la sculpture funéraire gallo-romaine, la présence à la base du monument de l'ouverture menant au loculus permettent de reconnaître dans cette description une pierre tombale (67).
*
Si on considère ces monuments comme un échantillon représentatif de ce qu'a pu être la sculpture funéraire touloise, ils nous laissent entrevoir une production qui, dans ses grands traits, ne se démarque que peu de celle d'un assez vaste secteur du nord-est des Gaules. On y retrouve la dualité typologique qui se manifeste surtout chez Leuques et Médiomatriques entre, d'une part, le modèle importé, la stèle gréco-romaine, si courante en Gaule (la stèle n° 3, avec figuration en pied des défunts et report de l'épitaphe à la partie supérieure, hérités de la tradition hellénique (68), peut être considérée comme le parfait spécimen du modèle «standard» dans le reste de la région), et, d'autre part, le type indigène, le cippe en forme de maison (69). L'iconographie est sans surprise, ménageant, au détriment bien souvent de toute décoration annexe, une place prépondérante à l'effigie funéraire, sous niche, régie par d'invariables normes de composition (frontalité, déhanchements opposés par exemple) et
(66) A. Calmet, Notice [ n. 131, p. 611. (67) Dom Calmet aborde ce monument après s'être attardé sur une autre pierre,
également découverte à Saint-Èvre, représentant dans une niche une femme «[...] couverte d'une tunique et d'un manteau, tenant de la main gauche une faucille et de la droite une bêche, qui a un appuy par le haut» (A. Calmet, Notice [n. 13], p. 611). On y reconnaissait alors une représentation de Cérès, ce que n'admet pas Dom Calmet qui se refuse à y voir une figuration divine : la description est trop succincte pour trancher le problème.
(68) Voir F. Braemer, Les stèles funéraires à personnages de Bordeaux (rer - iue siècle). Contribution à l'histoire de l'art provincial sous l'Empire romain , Paris, 1959, p. 99-100; 110.
(69) Sur ces monuments, on consultera essentiellement Ë. Linckenheld, Stèles- maisons [n. 58] ; à l'exception des quelques pages que leur a consacrées J.-J. Hatt, Tombe [n. 47], p. 219-223, on regrettera qu'aucune étude d'ensemble accessible n'ait été entreprise depuis à leur sujet, qui permettrait de renouveler l'ouvrage fondateur, mais vieilli, de cet auteur.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 387
chargée d'«attributs-poncifs» destinés à évoquer la richesse (70) ou les acti- vités (7I) du défunt, plus rarement ses croyances sur l'Au-Delà (72). Enfin, l'étude stylistique permet de distinguer, de manière traditionnelle, une sculpture «savante» ou «semi-savante» (73) (stèles nos 1 à 4, cippe n° 6), appliquant, avec plus ou moins de virtuosité selon les reliefs, les procédés de l'art gréco-romain dans la recherche d'un réalisme simple, d'une sculpture dite «populaire» (cippe n° 5), copie maladroite de la première.
Dans le contexte de l'ensemble de la production lapidaire du nord-est de la Gaule, les monuments funéraires toulois ne font donc pas preuve d'une grande originalité ; à moindre échelle toutefois, la confrontation entre ce groupe de sculptures et les reliefs de même destination découverts dans les autres sites de la cité des Leuques, dont il se distingue par quelques aspects, est révélatrice à la fois des voies de diffusion empruntées dans cette zone par les conceptions artistiques et les modèles gréco-romains et des influences d'ordre régional que ces axes ont véhiculées.
*
Le recours à plusieurs thèmes et motifs permet en effet de reconnaître certaines influences à l'oeuvre au sein du groupe toulois. Il en va ainsi de la scène sculptée sur la stèle n° 4 qui représente une femme portant à hauteur de son visage un miroir. Elle pourrait trouver son origine dans la «scène de la toilette» (74), issue du répertoire funéraire grec, à la composition bien plus complexe puisque la défunte y est entourée de nombreuses servantes qui la
(70) La bourse (nos 1, 2, 6 et 9) ou le coffret à bijoux (n° 3). (71) La houe sur la pierre n° 9. Bien que de nature indéterminée, c'est peut-être
également un attribut de métier qu'il convient de reconnaître dans la lanière tenue par l'un des défunts de la stèle n° 2 : un fil à plomb (par comparaison avec É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 5498) ? La hache (nos 1 et 2) pourrait renvoyer aux professions du bois ; on y objectera toutefois que sur une stèle de Til-Châtel en Bourgogne (S. Deyts, Sculptures antiques régionales, Dijon, Musée archéologique , Paris, 1976, n° 202), où est représenté un bûcheron, l'outil a des dimensions bien plus importantes. La quenouille de la stèle n° 1, plutôt qu'une allusion aux Parques, divinités de la Destinée (voir l'avis de R. Pirling, cité dans Moselle [n. 45], p. 196), nous paraît pouvoir être lue, plus prosaïquement, comme une illustration des activités féminines.
(72) On s'accorde généralement à reconnaître que le gobelet (nos 1 et 6) et la mappa (nos 3 et 4) ont revêtu, originellement, une valeur symbolique ; mais, devenus des poncifs inlassablement répétés, l'ont-ils conservée aux yeux des acquéreurs ? La signification du couteau tenu par la défunte de la stèle n° 3 demeure énigmatique.
(73) Sur ces notions, voir par exemple l'introduction de l'ouvrage de J.-J. Hatt, Strasbourg, Sculptures antiques régionales, Musée archéologique, Paris, 1964 (Inventaire des collections publiques françaises, 9), n. p., 205 ill.
(74) Voir notamment 1 etude que lui a consacrée J. Guerrier, Les origines de la scène de toilette gallo-romaine d'après un relief du Musée de Sens dans R.A.E. 29, 1978, p. 117-123, 4 fig.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
388 J.-N. CASTORIO
coiffent et la fardent. Les exemples les plus complets, dans le nord-est de la Gaule, proviennent de la cité des Trévires (75), et c'est sans doute là qu'il convient de rechercher le prototype qui a inspiré la représentation touloise, seule apparition de ce thème chez les Leuques. La valve de coquillage qui tapisse l'arcature interne de la niche de la stèle n° 1 est également un motif qui semble être parvenu dans le répertoire iconographique toulois depuis le nord. Sans doute importé sur le limes rhénan par les artistes accompagnant le mouvement des troupes militaires (76), ce très ancien ornement s'est vraisemblablement diffusé vers le sud, le long de la voie d'Agrippa en passant par Trêves, où il est assez fréquent de le rencontrer sur piliers funéraires et stèles monumentales (77). Enfin, c'est aussi peut-être à la décoration des mausolées trévires, où elles habillent les couronnements (78), que sont em- pruntées les larges feuilles imbriquées visibles sur la face latérale gauche du fragment n° 7.
On a également voulu voir l'influence de prototypes trévires lors de la découverte à Toul d'une «stèle-maison» aniconique, à couronnement semi- cylindrique (fig. 13) comparable à celui du relief n° 5 (79) et qui serait inspiré de celui de cippes, traditionnellement qualifiés de «demi-cylindres» (80) (fig. 14), localisés dans la cité voisine du nord. Bien que cette hypothèse puisse se trouver corroborée par la découverte récente d'un «demi-cylindre» à Metz (81), ce qui tendrait donc à prouver la diffusion de ce type hors de la
(75) Voir par exemple É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 5142 ; 5145 ; 5189 de Neumagen.
(76) Ce motif est fréquemment utilise sur les steles du 1er siecle en Germanie, voir H. Gabelmann, Die Typen der römischen Grabstelen am Rhein dans B.J. 172, 1972, p. 80-94.
(77) Voir par exemple E. Espérandieu, Recueil [n. 24J, nos 5142; 5147 ; 5150; chez les Leuques, il n'apparaît complet que dans la sculpture funéraire de Soulosse (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 4846 ; 4855).
(/ö) Voir par exemple fc. hspérandieu, Kecueil [n. z4j, nos D1D2 ; ; dzjö. (79) Voir E. Delort, Inj. arch. VI [п. 12], p. 235, 1 hypothèse a ete etayee dans
un article ultérieur par J. Choux et A. Liéger, Découvertes [n. 8], p. 96 ; ces auteurs n'avaient bien évidemment pas connaissance, alors, de l'existence du cippe n° 5 découvert quarante-cinq ans plus tard. On notera que le dessin proposé lors de la publication de ce cippe par É. Delort lui restituait un couronnement parfaitement semi-cylindrique, sans préciser que celui-ci avait en fait été bûché lors du remploi dans le rempart ; il n'est pas impossible qu'il ait en réalité été pourvu d'une poutre faîtière, élément fréquent de l'«architecture» des monuments leuques (à Toul, c'est le cas du cippe n° 5 et d'un cippe funéraire aniconique découvert au lieu-dit «le Jard», mentionné supra n. 34).
(80) Voir, à leur propos, É. Linckenheld, Stèles-maisons [n. 58], p. 51-53, fig. 21 ; J.-J. H ATT, Tombe [n. 47], p. 221.
(ol) Ce cippe, découvert en l^/э lors des travaux de i not baint-jacques, na iait à ce jour l'objet d'aucune publication ; il est conservé dans les réserves du Musée de Metz et porte le numéro d'inventaire 75-38-40. De par sa conception, il se présente comme une sorte d'intermédiaire entre les «demi-cylindres» trévires et les monuments
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 389
cité trévire par l'intermédiaire de la voie impériale, les différences de conception entre cette forme et les deux pierres touloises restent suffisamment importantes, par exemple dans les proportions, pour qu'il ne puisse être exclu que ce genre de couronnement trouve sa source ailleurs ; peut-être dans un développement purement local de la «stèle-maison» si l'on en juge par la présence, à la base des deux monuments leuques, de l'ouverture imitant la porte d'une habitation qui mène au loculus , absente sur les «demi-cylindres» (82).
Malgré cette incertitude, les emprunts iconographiques rendent l'influence trévire manifeste. Quoi de plus naturel d'ailleurs ? Trêves a connu, à partir du ne siècle, un important développement économique, qui a favorisé l'ascension d'une bourgeoisie commerçante à même d'y attirer quantité d'artistes en quête de commandes. La ville s'est ainsi transformée en centre de création, mais aussi de diffusion artistique majeur, rayonnant sur les cités proches comme celle des Leuques par la voie d'Agrippa, principal axe de circulation des idées et des artistes de Gaule sur lequel Toul occupe une place de choix. Mais Toul demeure éloignée de Trêves et, comme on le constate ailleurs, cette diffusion des thèmes, dont le sens originel était déjà souvent altéré à leur arrivée dans les régions du nord-est (83), s'est accompagnée de leur simplification formelle : la valve se mue en un simple pendentif en V sur la stèle n° 3, la «scène de la toilette» se réduit à la seule défunte.
Si les influences septentrionales semblent dominantes, il serait cependant faux de penser que thèmes et motifs n'ont transité le long de la voie d'Agrippa qu'en sens unique, du nord vers le sud. Un monument toulois perdu repré- sentait Y ascia Í84) ; or il est établi que la figuration de cet outil à la signification énigmatique (85) est parvenue dans les cités du nord-est en remontant progressi- vement l'axe rhodanien, puis la voie impériale (86).
de Toul : plus proche des premiers par son aspect trapu, il possède en revanche la large traverse sommitale du cippe n° 5.
(82) On remarquera par ailleurs que ce type de couronnement semi-cylindrique n'est pas propre aux cippes de la région trévire ; on le retrouve par exemple à l'autre extrémité de la Gaule, chez les peuples occupant les hautes vallées des Pyrénées centrales ; voir J.-J. Hatt, Les monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du Cotiserons dans A.M. 54-55, 1942-1943, pl. XI ; XIII ; XX.
(83) Sur la signification originelle de la «scène de la toilette», voir J. Guerrier, Toilette [n. 74], p. 121 ; sur celle de la valve de coquillage, notamment H. Walter, Franche-Comté [n. 32], p. 155-156 ; sur les feuilles imbriquées, E. Will, Le problème du pilier funéraire de Belgique et de Germanie dans Actes du Colloque sur les influences helléniques en Gaule, Dijon, 29-30 avril - 1er mai 1957 , Dijon, 1958, p. 124-126.
(84) Voir supra n. 26. (85) Sa signification reste discutée. W. Deonna a donné un aperçu des multiples
thèses en présence (W. Deonna, L'ascia dans R.A.E. 7, 1956, p. 19-33) ; aucune hypothèse véritablement convaincante n'a été émise depuis.
(86) Voir la carte de répartition établie par J.-J. Hatt, Tombe [n. 47], p. 102, carte n° 7 ; les quatorze monuments leuques sur lesquels est sculpté cet outil proviennent tous d'agglomérations situées le long de cet axe.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
390 J.-N. CASTORIO
Carte 3. - Répartition des figurations d'Amours porte-cartouche en Gaule et dans les Germanies (carte dressée à partir des exemplaires dénombrés dans les quinze volumes du Recueil [n. 24] d'É. Espérandieu et R. Lantier).
Il est plus délicat de déterminer comment a cheminé le motif des Amours porte-cartouche pour parvenir jusqu'à Tulium ; sa carte de répartition pour l'ensemble de la Gaule (carte n° 3) est en effet moins parlante que celle de Y ascia : si sa diffusion doit incontestablement être mise en relation avec la voie d'Agrippa, le fait que le thème soit bien représenté, dès le ier siècle, à la fois dans le sud de la Gaule et dans les régions militaires du nord-est ne permet pas d'avoir de certitude quant au sens qu'il a suivi pour la parcourir.
*
La voie d'Agrippa n'a pas seulement été un axe de diffusion des influences régionales ; plus largement, elle a été le principal vecteur de propagation en Gaule des conceptions artistiques d'origine gréco-romaine et des procédés qui
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 391
leur sont liés. De fait, la majorité des reliefs funéraires toulois, à l'exception du cippe n° 5, témoigne d'une bonne assimilation de ces derniers. En cela, elle se distingue d'une bonne part du reste de la production leuque, pour l'essentiel le fait de petits ateliers installés dans des sites isolés des principales voies de communication, appliquant, le plus souvent sans les comprendre, les principes académiques.
On peut penser que les œuvres découvertes à Toul, taillées dans le calcaire de la cuesta meusienne, ont été produites sur le site même ; aucun élément en tout cas ne permet de supposer l'existence d'importations ou l'intervention d'ateliers itinérants, et il serait pour le moins étonnant que le chef-lieu de la cité, où sont attestées d'autres activités artisanales (87), n'ait pas vu se déve- lopper d'ateliers de sculpture alors que l'on en trouve dans des agglomérations bien modestes (88). Cinq des monuments toulois (nos 1-4 et 6) se rattachent à la sculpture que l'on qualifie traditionnellement de «savante» ou «semi- savante» : on y retrouve notamment la volonté d'extraire les figures du fond de la niche, une science variable du modelé, préféré à l'incision, une assez bonne connaissance des règles de base de construction des figures et, enfin, l'utilisation de procédés classiques (personnages légèrement de trois-quarts [nos 1, 3 et 6], déhanchement et «draperie mouillée» [n° 3]) cherchant à rompre la monotonie occasionnée par la représentation frontale. Ces formules sont appliquées sans génie (en témoignent le peu d'inventivité dans le traitement essentiellement vertical du drapé, la stylisation presque systématique des détails), parfois même avec une certaine dose de maladresse (ainsi du raccourci peu réussi du bras sur la stèle n° 2, de l'épaule trop brusquement relevée du défunt du relief n° 1, du regard qui passe largement à côté du miroir sur la stèle n° 4). Néanmoins, par leur réalisme simple et solide (la stèle n° 2 fait figure d'exception, lui substituant une volonté ornementale, quasi ma- niériste), par les qualités artistiques propres à chacune d'entre elles (on notera surtout l'élégance des silhouettes des défuntes de la stèle n° 3 et l'individua- lisation du visage de Marinus sur la stèle n° 1, l'un des rares témoignages de l'existence, chez les Leuques, d'un art du portrait funéraire), ces oeuvres apparaissent comme partie intégrante du meilleur de la sculpture du nord- est de la Gaule. À parcourir les pages du Recueil d'É. Espérandieu consacrées à la cité des Leuques (89), on s'aperçoit aisément que ces reliefs constituent
(87) Voir B. Humbert, A. Liéger et R. Marguet, Découverte d'un dépotoir de potier gallo-romain à Saint- Èvre dans Études touloises 2, 1974, p. 55-56.
(88) L'étude des sculptures retrouvées par exemple à Escles - Charmois-rOrgueilleux ou dans le rempart frontal du «camp celtique» de la Bure permet d'entrevoir la succes- sion, dans ces deux petites agglomérations secondaires vosgiennes, de plusieurs générations de sculpteurs.
(89) Voir E. Espérandieu, Recueil [ n. 24], nos 4650-4714 ; 4762-4915.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
392 J.-N. CASTORIO
des exceptions : ailleurs, à Escles-Charmois-l'Orgueilleux (90), à la Bure (91), dans les nombreux petits sites vosgiens qui ont livré des sculptures plus ou moins isolées, les principes à l'œuvre à Toul se muent en caricature maladroite, la sculpture «savante» y est atypique, noyée dans les styles locaux, originaux, où le degré d'assimilation des modèles importés est bien moindre.
Les sculpteurs toulois n'ont pas pour autant laissé les types gréco-romains étouffer le fond indigène. Cela est surtout sensible dans le domaine typologique ; le cippe en forme de maison est bien représenté à Toul (92). Les deux exem- plaires figurés (nos 5 et 6) en sont déjà toutefois des spécimens évolués, empruntant à la stèle classique la primauté accordée à la face destinée à recevoir les effigies funéraires.
L'épigraphie funéraire est un autre domaine qui distingue la production touloise de celle du reste de la cité. Cinq des huit monuments portent une épitaphe (nos 1, 3, 4, 7 et 8). Les inscriptions complètes ou quasi complètes (nos 1, 3 et 4) montrent qu'ici, comme ailleurs dans la cité, la brièveté est de règle (93) et cela même si celle de la stèle n° 1, pourtant peu loquace, fait figure d'exception dans l'épigraphie funéraire leuque en ajoutant à l'invocation aux Dieux Mânes, suivie du nom des défunts et de leur filiation, l'indication du lien unissant les deux personnages représentés et en mentionnant en outre le commanditaire par la formule h(eres) p{onendum) c(uravit) (94). Ce qui différencie surtout la modeste épigraphie touloise de celle du reste de la cité, c'est l'utilisation, ailleurs peu fréquente (95), du cartouche (nos 1, 4, 7 et 8), qui montre la volonté qu'ont eue certains sculpteurs d'intégrer l'épitaphe à la composition du monument, et cela dès sa conception. Deux des stèles (nos 1 et 4) traduisent ainsi l'influence peu courante de modèles italiens (96) en
(90) Voir É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 4780 ; 4793 ; 4795 ; 4796 ; 4799-4808 ; 4810.
(91) Voir G. Tronquart, Le «camp celtique» de la Bure , Saint-Dié, 1989, fig. 45 ; 76 ; 77 ; 80.
(92) Les découvertes de «stèles-maisons» en territoire leuque se concentrent essen- tiellement le long de la voie impériale : ainsi Toul, si l'on ajoute aux cippes figurés les exemplaires aniconiques {supra n. 21 et 34), est, après Scarpone et Soulosse, le site leuque qui en a livré le plus grand nombre.
(93) Les fragments nos 7 et 8 pourraient toutefois laisser deviner l'existence d'inscrip- tions plus bavardes, ce que confirmerait d'ailleurs une assez longue épitaphe perdue, et dont on ne sait si elle était accompagnée d'effigies funéraires sculptées, transcrite au xviiie siècle par M. Fourmont (CIL, XIII, 4674).
(94) Chez les Leuques, les épitaphes se limitent dans leur très grande majorité à la seule invocation aux Dieux Mânes suivie du nom du défunt, voire au nom uniquement.
(95) Le cartouche n'apparaît que sur cinq monuments funéraires figurés de la cité : CIL , XIII, 4584 (Scarpone) ; 4641 (Naix) ; 4714 (Plombières-lès-Bains) ; 4722 (Charmois- l'Orgueilleux) ; 5950 (Grand).
(96) Voir E Braemer, Bordeaux [n. 68], p. 113.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 393
présentant une façade divisée en registres superposés, le registre inférieur, surmonté de l'effigie des défunts à mi-corps (97), étant réservé au cartouche inscrit. Rares sont les stèles régionales qui dénotent, à l'image de ces deux dernières, une bonne compréhension de ce modèle (98) : généralement (c'est d'ailleurs ce dont témoigne la stèle n° 2) les artistes n'ont conservé du prototype originel que la figuration à mi-corps, reportant l'inscription, si inscription il y a, sur le bandeau de la niche ou sur le couronnement, à la manière d'un rajout, et rendant ainsi à l'image sa primauté ; principe sans doute plus à même de répondre aux désirs d'acheteurs peu sensibles au formulaire complexe qui caractérise l'épigraphie funéraire latine. Ces deux stèles se distinguent en outre par la graphie soignée de leurs épitaphes, qui tranche avec l'habituelle médiocrité des caractères (") et pourrait indiquer l'intervention de lapicides.
*
Un seul site leuque semble avoir développé en abondance une sculpture funéraire comparable à celle de Toul : il s'agit de Soulosse, agglomération secondaire sise le long de la voie d'Agrippa à une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la cité, et qui a livré plus de soixante monuments funéraires, de style sommaire et «savant», étudiés en détail par L. C. Kahn (10°). L'idée qu'il ait pu exister des liens entre les ateliers des deux sites avait été anciennement émise par É. Espérandieu à propos de la stèle n° 3, qu'il considérait d'après son style comme une production de l'agglomération vosgienne. Cette hypothèse a été reprise et étayée par L. C. Kahn (101), selon qui la sculpture pourrait être issue du même atelier qu'un relief de Soulosse (102) ; elle se fonde sur certains traits communs : même manière de traiter les plis du vêtement dans la partie inférieure du corps, sous les genoux ; coffret décoré à l'identique de rectangles imbriqués ; présence sur les deux stèles d'une clé de coquillage. La démonstration ne convainc guère, les détails invoqués ne paraissant que peu significatifs : ainsi, les petits plis sous le genou, auxquels L. C. Kahn confère tant d'importance, s'apparentent plus à un procédé courant dans la sculpture «savante», pour animer la draperie et
(97) Les imagiers gallo-romains ont bien souvent substitué à la trop solennelle représentation en buste des stèles italiennes, la figuration à mi-corps, plus vivante.
(98) Aucune autre stèle de la cité des Leuques ne leur est comparable : chez les Séquanes, H. Walter en dénombre deux (H. Walter, Franche-Comté [n. 32], p. 139, nos 1 ; 98) ; elles sont tout aussi rares en territoire médiomatrique.
(99) Sur les monuments funéraires figurés leuques, seuls les caractères de CIL , XIII, 5950 (Grand) sont de qualité comparable.
(100) L. C. Kahn, Soulosse [n. 42], 498 p., LXXVI pl. ; une bonne partie de ces reliefs sont reproduits par É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 4845-4890 ; 9242-9244.
(101) L. C. Kahn, Soulosse [n. 42], p. 217. (102) E. Espérandieu, Recueil ' n. 24], n° 4646.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
394 J.-N. CASTORIO
suggérer conventionnellement le corps sous-jacent, qu'à une manière propre à un atelier (,03). Si cette opinion semble donc à rejeter, il n'en demeure pas moins qu'il existe une proximité indéniable, à la fois de composition et de style, entre cette stèle et certaines œuvres de Soulosse. Mais surtout, ce que ces sculptures ont en commun, c'est de constituer en quelque sorte les archétypes de la stèle funéraire, rare chez les Leuques mais telle qu'on la retrouve fréquemment dans le nord-est de la Gaule, traitant de manière habile mais sans excès de virtuosité l'effigie en pied des défunts.
Le cippe n° 6 est peut-être un meilleur témoignage des relations qui ont pu exister entre les deux agglomérations : outre un possible parallèle stylistique (mais ce paramètre ménage une trop large part à la subjectivité quand on ne peut raisonner sur des séries conséquentes), c'est dans les domaines icono- graphique et typologique que le rapprochement se manifeste avec le plus de netteté. Dans la conception du monument, on retrouve en effet ici l'association d'une «architecture» peu aérienne, voire trapue, avec la figuration des défunts à mi-corps en façade qui caractérise toute une série de cippes provenant de Soulosse (104). Pour ce qui est de la présentation des personnages, on notera que la variante de la dextrarum iunctio qui est représentée sur ce cippe, où «l'union des mains droites» est renforcée par l'enlacement du défunt par sa compagne, est peu fréquente (105) et ne se retrouve ailleurs dans la cité qu'à Soulosse (,06) et sur un exemplaire isolé de Charmois-l'Orgueilleux (107).
(103) Ce détail se retrouve ailleurs, dans les sculptures leuque et séquane par exemple ; voir É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 4821 (Monthureux-sur-Saône) ; 5327 (Luxeuil). Le regroupement de ces deux oeuvres, alors que l'une d'entre elles n'est plus connue que par la photographie, semble, par ailleurs, un exercice bien périlleux. Notons enfin que l'abondance des pierres retrouvées à Soulosse, si elle témoigne d'une forte vitalité des ateliers qui y ont exercé, est d'abord le fruit de conditions historiques favorables à la conservation des reliefs, conditions qui ont malheureusement manqué dans le cas de Toul : elle ne peut donc être utilisée comme argument à l'appui de l'hypothèse d'exportations en provenance des ateliers de Solicia comme le suggèrent en filigrane certains auteurs.
(104) Voir É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 4859 ; 4873 ; 4878 (- 4888[a]) ; 4886 ; 4889 ; L. C. Kahn, Soulosse [n. 42], nos 12 ; 15 ; 16.
(105) V. Schildknecht, Les représentations feminines sur les steles Juneraires gallo- romaines des cités des Médiomatriques, des Leuques et des Rèmes (Ier - iiie siècle ap . J.-C.X mm. dact., Univ. de Metz, 1994, p. 54, note l'originalité de ce geste qui n'apparaîtrait ni chez les Médiomatriques, ni chez les Rèmes. Il est représenté par deux exemples chez les Séquanes ; voir H. Walter, Franche-Comté [n. 32], nos 32 ; 105.
(106) C'est une des variantes de la dextrarum iunctio parmi les mieux représentées dans la sculpture de Soulosse avec six exemplaires ; voir É. Espérandieu, Recueil [n. 24], nos 4847 ; 4849 ; 4850 ; 4853 ; 4856 ; 4859.
(107) Voir De Chanteau et H. De Jarry, Rapport sur les Jouules archéologiques faites au Grand'Maldheux dans Ann. de la Soc. d'émul. vosgienne , 1875, fig. 15.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTURES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 395
Même s'il ne peut s'agir que d'indices, la matière à comparaison étant peu abondante, il n'est pas trop audacieux, nous semble-t-il, d'imaginer qu'il y a là plus que la simple expression d'influences artistiques communes, naturelles si l'on considère que les deux sites sont peu éloignés l'un de l'autre, et que les deux centres de production ont été en relation. Plusieurs interrogations sur la nature de ces liens restent toutefois en suspens : peut-on parler d'influences d'un site sur l'autre ? Dans ce cas, dans quel sens ont-elles joué ? Questions insolubles pour l'heure, car si la sculpture de Soulosse est bien connue, celle de Toul ne se laisse encore que deviner. Peut-être sera-t-on amené à les réexaminer si, comme on peut vraisemblablement le croire, le rempart de Toul doit fournir de nouveaux témoignages de la sculpture qui s'est développée dans cette ville.
*
En dernier lieu, se pose le délicat problème de la datation des reliefs toulois. Force est de constater en effet que les critères manquent qui permettraient de discerner en leur sein une évolution chronologique : le remploi des pierres dans les fondations du rempart, s'il fournit un terminus ad quem (108), n'en prive pas moins des précieuses données de la stratigraphie et nous ne croyons guère en la possibilité de dater ces œuvres en nous fondant sur leur étude stylistique (,09). Seules les inscriptions et les coiffures sont donc de quelque utilité.
Grâce aux formules d'épitaphes dont J.-J. Hatt, notamment, a retracé l'évolution chronologique pour l'ensemble de la Gaule (no), il paraît possible
(108) Encore celui-ci n'est-t-il que d'une utilité fort limitée puisque Ton s'accorde généralement pour reconnaître qu'il y a eu, à la fin du 111e ou au début du IVe siècle, dates vraisemblables d'édification de la muraille, un ralentissement, voire un arrêt des productions lapidaires locales dans la plus grande partie du nord-est de la Gaule.
(109) Dans une cité comme celle des Leuques où la production lapidaire semble avoir été pour l'essentiel le fait de petits ateliers se transmettant de génération en génération une manière propre, la datation par le style ne peut aboutir au mieux qu'à l'établissement d'une chronologie relative, mais à la condition que le matériel soit abondant, ce qui est loin d'être le cas pour Toul.
(1 10) J.-J. Hatt, Tombe [n. 47], p. 13. Comme le notait cet auteur, cette chronologie se doit d'être adaptée en fonction des usages régionaux, mais les épitaphes leuques sont trop peu nombreuses pour que l'on puisse les répartir en séries chronologiques. Il convient donc de se tourner vers les Médiomatriques où l'épigraphie funéraire est plus conséquente et a été soigneusement étudiée par F. Pignol, La dédicace du monument funéraire chez les Médiomatriques , mm. dact. inédit, Univ. de Metz, 1974, 70 p., carte, tableaux. Cette comparaison fait bien évidemment intervenir une part d'arbitraire puisqu'elle suppose que Toul n'a pas fait preuve de particularismes par rapport aux agglomérations de la cité du nord, ce qui ne peut être démontré avec certitude. On peut toutefois supposer qu'en raison de sa situation sur la voie impériale, les modes en matière épigraphique, telles qu'elles apparaissent à Metz, n'ont pas dû être trop longues à y parvenir.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
396 J.-N. CASTORIO
de situer la réalisation de deux des monuments toulois au sein de fourchettes chronologiques aux limites lâches. La forme qui apparaît sur la stèle n° 4, où l'inscription se réduit au nom de la défunte au datif suivi de la filiation, est généralement située durant le ier siècle de notre ère (U1) ; dans le cas présent toutefois, cette datation paraît un peu précoce : cette stèle s'inspire en effet d'un poncif qui a toutes chances de s'être transmis à Toul par la région trévire, où il n'est bien attesté qu'à partir du 11e siècle (112), ce qui placerait la réalisation du relief toulois au plus tôt dans la première moitié de ce siècle. L'utilisation du datif après la dédicace aux Dieux Mânes abrégée D. M., telle qu'elle apparaît sur la stèle n° 1, situerait quant à elle la réalisation du relief, si l'on tient compte de l'évolution régionale des formules d'épitaphes (113), durant les trois premiers quarts du не siècle.
L'étude des coiffures est considérée par nombre d'auteurs comme le plus utile des critères de datation pour les monuments funéraires gallo-romains, souvent anépigraphes. Plusieurs remarques s'imposent toutefois à ce sujet. Tout d'abord, s'il est incontestable que les coiffures élaborées dans le milieu impérial se sont propagées dans les provinces, les délais de diffusion restent hautement hypothétiques, ce qui condamne ce critère à ne fournir, au mieux, qu'une fourchette chronologique large. Ensuite, si dans des zones profondément romanisées, l'évolution des coiffures est sensible, on n'y retrouve que très rare- ment les arrangements complexes qui caractérisent par exemple les coiffures des grandes dames romaines du temps des Flaviens. Cette tendance à la simplicité s'accentue encore au fur et à mesure que l'on évolue vers le nord de la Gaule et il semble bien qu'en règle générale, tant chez les Leuques que dans les cités avoisinantes, les modes impériales aient laissé les populations relativement indifférentes ; elles leur ont préféré des coiffures simples et commodes : chevelure tirée simplement vers la nuque pour y former un chignon pour les femmes (comme par exemple pour la défunte de la stèle n° 1) ou tombant tout aussi simplement de part et d'autre du visage (cippe n° 5 et défunte de gauche de la stèle n° 3) ; grosses mèches rabattues sur le front pour les hommes (cippe n° 6). Notons enfin qu'il n'est pas aisé de déterminer la part des modes locales et, sur la méthode, que les coiffures impériales féminines se différencient souvent par la position du chignon, qui n'est que très rarement visible sur des monuments où l'arrière du crâne est pris dans le fond de la niche. Cet ensemble de remarques préalables incite donc à une grande prudence dans l'utilisation de ce critère ; il serait toutefois injustifié de l'écarter totalement. Ainsi deux de nos reliefs présentent des
(111) C'est la datation retenue pour le relief toulois par J.-J. Hatt, Tombe [n. 47], p. 162.
(112) Voir J. Guerrier, Toilette [ n. 74], p. 122. (113) Voir Y. Burnand, Lorraine [n. 49], p. 187.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PLANCHE IV
Fig. 1. - Détail d'un bloc architectural portant la figure cTAttis ; H. : 75 cm, 1. : 144,5 cm, ép. : 32,5 cm ; Musée Historique Lorrain de Nancy.
Fig. 2. - Élément architectonique avec figuration du «vase de vie» ; H. : 48 cm, 1. : 44 cm, ép. à la base : 21 cm, ép. au sommet : 10,5 cm ; Musée de Toul.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PLANCHE V
Fig. 3. - Stèle n° 1.
Fig. 4. - Détail de la stèle n° 1.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PLANCHE VI
Fic,. 5. - Stèle n° 2.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PLANCHE VII
Fig. 6. - Stèle n° 3.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PLANCHE VIII
Fig. 7. - Stèle n° 4.
Fig. 8. - Cippe n° 5.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PLANCHE IX
Fig. 9. - Détail du cippe n° 5.
Fig. 10. - Cippe n° 6.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PLANCHE X
Fig. 1 1. - Fragment de stèle n° 7.
Fig. 12. - Fragment de stèle n° 8.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PLANCHE XI
Fig. 13. - «Stèle-maison» aniconique trouvée à Toul ; H. : 88 cm, 1. : 32 cm ; ép. : 60 cm ; Musée de Toul.
Fig. 14. - «Demi-cylindre» trévire ; H. : 67 cm, 1. : 70 cm, ép. : 96 cm (É. Espérandieu, Recueil [n. 24], n° 5260).
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
SCULPTORES FUNÉRAIRES GALLO-ROMAINES DE TOUL 397
défuntes possédant une coiffure qui peut être rattachée à certaines modes impériales. C'est le cas tout d'abord des larges bandeaux que porte la défunte de droite de la stèle n° 3 : cet arrangement reproduit simplement une coiffure fréquemment portée par les impératrices et les princesses antonines, ce qui situerait la réalisation de ce relief dans la seconde moitié du 11e siècle (l14), datation qui s'accorde bien avec l'utilisation de la formule D(is) M(anibus). Les longues mèches de la défunte du cippe n° 6, retombant mollement derrière les oreilles avant de former, sans doute, un chignon sur la nuque, ne sont, quant à elles, pas sans évoquer les coiffures des princesses sévériennes (115).
Au total, quatre reliefs sur huit semblent donc pouvoir être datés avec une plus ou moins grande précision :
- première moitié du 11e siècle : n° 4 ; - trois premiers quarts du ne siècle :n° 1 ; - seconde moitié du ne siècle : n° 3 ; - première moitié du ine siècle : n° 6.
Encore ces datations sont-elles à considérer avec la nécessaire prudence : elles ne se fondent que sur un indice, épigraphique ou iconographique, au lieu de naître de la confrontation de critères variés, comme il se devrait.
*
En résumé, bien qu'en nombre peu élevé, les monuments toulois laissent deviner l'existence, dans le chef-lieu de la cité des Leuques, d'ateliers qui ont élaboré une sculpture où se retrouvent les grands traits caractérisant une bonne part de la production d'un assez vaste secteur du nord-est de la Gaule. À l'échelle de la cité, cette sculpture n'en apparaît pas moins comme atypique par certains aspects, notamment par la bonne compréhension des schémas académiques gréco-romains dont témoignent certains reliefs. Cela est sans conteste dû à la situation de cette agglomération le long du principal axe de diffusion des concepts et des procédés artistiques classiques, et peut-être, mais il ne s'agit que d'une supposition, à son statut qui n'a pas dû être sans incidences sur le développement d'activités artistiques. La voie d'Agrippa a en outre véhiculé un certain nombre d'influences, l'influence septentrionale, plus particulièrement celle de Trêves, semblant prédominante ; elle a peut-
(114) Voir K. Fittschen et P. Zanker, Katalog der römischen Porträts in der Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, Band III, Kaiserinnen- und Prinzessinnenbildnisse, Frauenporträts , Mainz, 1983, n° 73 surtout (Trajan/ Hadrien) ; mais aussi, plus éloignés, nos 72 (id.) ; 83 (Hadrien) ; 84 (id.).
(115) Voir K. Fittschen et P. Zanker, Katalog [n. 1 14], nos 33-35 (Julia Mamaea) ; 37 (Otacilia Severa) ; 164-169.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
398 J.-N. CASTORIO
être permis aussi d'établir des liens entre Toul et les centres de production lapidaire proches comme Soulosse.
L'adoption des principes de l'art gréco-romain académique n'a toutefois pas totalement étouffé certaines originalités propres à la cité : cela se manifeste dans l'utilisation du cippe en forme de maison, mais également dans cette sculpture moins experte, «populaire», qui s'exprime sur le relief du cippe n° 5.
L'étude de l'épigraphie et des coiffures, seuls critères utilisables, autorise la datation de quatre de ces reliefs, avec une précision toute relative, mais qui permet cependant de constater que leur réalisation s'échelonne entre le début du 11e siècle et le milieu du 111e, période qui voit le nord-est de la Gaule connaître un développement économique favorable à l'épanouissement des arts figurés (116).
Centre Albert-Grenier , Université de Nancy II. Jean-Noël Castorio.
(116) Nous tenons à remercier ici MM. M. Hachet et A. Liéger, conservateurs du Musée de Toul, pour nous avoir donné toutes facilités d'étudier et de reproduire les monuments funéraires de la collection, ainsi que pour nous avoir aimablement signalé l'existence du cippe n° 6. À l'exception des figures 1, 6, 7, 12 et 14, empruntées au Recueil [n. 24] d'É. Es pé ran di eu, les clichés illustrant cet article sont de l'auteur.
This content downloaded from 188.72.126.88 on Sat, 14 Jun 2014 07:47:51 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions