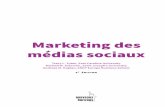"Les mort-nés à Paris au XIXe siècle : enjeux sociaux, juridiques et médicaux d'une catégorie...
Transcript of "Les mort-nés à Paris au XIXe siècle : enjeux sociaux, juridiques et médicaux d'une catégorie...
Population-F, 64 (4), 2009, 687-722
Vincent Gourdon* et Catherine rollet**
Les mort-nés à Paris au XIXe siècle :enjeux sociaux, juridiques et médicaux
d’une catégorie statistique
Lorsqu’un nouveau-né décède avant d’avoir été déclaré sur les registres de l’état civil, doit-on établir un acte de naissance et un acte de décès, ou un seul acte d’enfant « présenté sans vie » ? À partir de quelle durée de gestation un enfant « décédé dans le sein de sa mère » doit-il être enregistré ? Depuis l’instauration de l’état civil laïc après la Révolution, la question de la définition de l’en-fant mort-né et de son enregistrement a été posée au législateur, et les réponses ont évolué au cours du temps. Vincent Gourdon et Catherine rollet présentent les discussions qui ont entouré la mise en place en France, au cours du XIXe siècle, d’une législation dont certaines particularités ont perduré jusqu’à la fin du XXe siè-cle. Ils exposent les enjeux qu’ont soulevés ces définitions dans des domaines aussi variés que le droit, la médecine, la religion et la statistique. Les questions débattues dans cet article sont toujours d’actualité : ce n’est que depuis 1993 que la catégorie des « faux mort-nés » a disparu des statistiques françaises, un acte de nais-sance étant établi pour les enfants décédés avant leur déclaration. Quant à la durée minimale de gestation pour l’enregistrement des enfants mort-nés, elle a été réduite à 22 semaines en 2001 (au lieu de 28 auparavant), puis supprimée en 2008, entraînant des discon-tinuités dans les séries statistiques que n’auraient probablement pas appréciées les statisticiens du XIXe siècle.
« L’ état civil, tel que le possède aujourd’hui la France, peut être offert en modèle à tous les peuples : nulle part les conditions qui fondent la sécurité de l’homme en état de société n’ont été déterminées avec autant de sagesse et de prévoyance : que l’homme naisse, qu’il se marie, ou qu’il meure, la concision admirable de la loi répond au but qu’elle s’est proposé ; que ces circonstances
* Centre Roland Mousnier, CNRS.** Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; Laboratoire Printemps, CNRS.
Correspondance : Catherine Rollet, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Laboratoire Printemps, CNRS, 47 boulevard Vauban, 78047 Guyancourt cedex, tél. : 33 (0)1 39 25 56 49, courriel : [email protected]
V. Gourdon, C. rollet
688
soient seulement constatées avec le soin qu’elle prescrit, et l’état civil est créé ; qu’elle ne soient point constatées, ou le soient avec négligence, l’état civil n’existe pas, le désordre et la confusion prennent la place ».
Extrait du Rapport à M. le préfet de la Seine [Rambuteau] par M. Pontonnier, chef de la première division à la préfec-ture de la Seine (cité dans Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1843, série 1, n° 30, p. 124).
« On désigne sous la dénomination d’enfants mort-nés, non seulement les fœtus qui sont morts dans le sein de leur mère, mais encore ceux qui ne sont pas nés viables, ou ceux qui sont morts pendant les premières heures qui ont suivi la naissance » (Bayard, 1846, p. 3) : ainsi s’exprime en 1846 le docteur Bayard, médecin expert auprès des tribunaux. Contrairement à la belle décla-ration de Pontonnier placée en exergue et à la simplicité apparente dont elle revêt l’état civil français, de fait, la catégorie des mort-nés est loin d’être lim-pide : elle est d’emblée énoncée comme composite. Trois groupes d’enfants sont ainsi énumérés, qui renvoient aux processus de la grossesse, de l’accouchement et de la vie juste après la naissance. On est loin d’une définition homogène et très près des notions floues telles qu’elles existent dans le droit français (par exemple celle d’ « intérêt de l’enfant » dans le Code civil). La catégorie est aussi brouillée du point de vue statistique, puisqu’elle mêle enfants nés vivants et enfants nés morts.
C’est de la construction de cette catégorie ambiguë au XIXe siècle que traite cet article. Il n’a pas pour objet de déconstruire les données statistiques pour évaluer leur pertinence comme reflet de réalités démographiques ou pour les corriger, comme l’ont fait Etienne van de Walle (1974), Noël Bonneuil (1997), Jacques Vallin et France Meslé (1988, 2001), Victor Kuagbenou et Jean-Noël Biraben (1998) ou encore Robert Woods (2008) sur la mortinatalité. Il n’entend pas non plus entrer dans le détail de l’analyse démographique du phénomène de la mortinatalité, à travers ses dimensions de sexe, statut social ou lieu d’accouchement.
Nous voulons éclairer les processus mêmes qui ont conduit à la construc-tion de cette catégorie composite. Ces processus sont complexes car ils résultent de l’interaction de plusieurs facteurs qui se situent dans des registres très différents de la structure sociale. C’est cette complexité que nous interrogerons concernant les « mort-nés ». Comment s’est élaborée cette catégorie sur le plan législatif ? Quelles sont les contraintes administratives, juridiques, médicales, religieuses qui ont pesé sur les choix effectués ? Quelles sont les circonstances qui ont accompagné les mesures prises ?
Les niveaux d’analyse auxquels nous nous situons sont d’abord celui de l’État comme producteur de normes (ministères relayés par les préfectures) dont nous avons examiné les lois, décisions, circulaires, décrets… (Archives nationales, revues comme les Annales d’hygiène publique et de médecine légale ou la Revue d’hygiène et de police sanitaire) ; celui de la ville-département, Paris
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
689
et le département de la Seine, qui applique ces normes et prend des initiatives comme nous le verrons (les archives de Paris ont fourni à cet égard une abon-dante matière) ; enfin celui des productions statistiques élaborées par les services statistiques pour Paris et qui couvrent tout le XIXe siècle (Annuaire statistique de la ville de Paris). Il existe un niveau intermédiaire auquel nous n’avons pas eu accès : celui de l’application concrète des lois et circulaires préfectorales sur le terrain. L’état civil parisien a disparu dans les incendies de l’Hôtel de ville et de ses annexes pendant la Commune, ce qui interdit d’étudier le détail de la rédaction des actes concernant les mort-nés. Cependant, des notes sur cet état civil parisien dans les revues déjà citées et quelques dépouille-ments effectués sur les registres de départements voisins ont fourni des pistes.
Malgré les lacunes des archives, le cas de Paris est intéressant car la capitale est à la pointe des innovations en matière de gestion au quotidien de la vie des citoyens : ses moyens financiers et humains lui permettent, comme d’autres capitales européennes, de se doter de systèmes de contrôle sophistiqués. La ville est aussi le réceptacle des évolutions contrastées en matière de droit et de pratiques sociales : les élites marquent de leur empreinte les comportements concernant les naissances et les décès, voire les baptêmes et les sépultures.
Notre point de départ sera une présentation de l’évolution du taux de mortinatalité dans la ville de Paris pendant tout le XIXe siècle, d’après les données de l’Annuaire statistique de la ville de Paris. Nous verrons ensuite l’en-semble des éléments permettant de comprendre cette évolution en suivant d’abord un plan chronologique depuis l’Ancien Régime, puis un plan thématique analysant plus en profondeur la question des « faux mort-nés », celle des conditions d’un meilleur enregistrement – la vérification à domicile des décès et des naissances – et enfin celle de l’enregistrement des fœtus. Vont alors apparaître les lignes de force du débat entre législateurs, médecins, statisticiens, fonctionnaires municipaux, autorités religieuses mais aussi familles sur cette question si délicate, aujourd’hui encore, des « mort-nés ».
I. Une évolution statistique du taux de mortinatalité qui pose problème
Le taux de mortinatalité, calculé en rapportant les mort-nés (l’Annuaire statistique de la ville de Paris) d’une année aux naissances de la même année (naissances vivantes et mort-nés), se situe entre 5 % et 7 % au cours de la pre-mière moitié du XIXe siècle et dépasse largement 7 % ensuite (figure 1).
La courbe des taux de mortinatalité du département de la Seine (non reproduite ici) est parallèle mais légèrement inférieure à celle de la ville de Paris (l’écart est de deux points). L’enregistrement des mort-nés dans les deux arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, encore très ruraux, est bien moins fréquent qu’à Paris, surtout en début de période.
V. Gourdon, C. rollet
690
Figure 1. Proportion de mort-nés à Paris au XIXe siècle(mort-nés pour 100 naissances et mort-nés)
Ined 2009
9,5
5,5
10,0
4,0
4,5
7,5
8,5
6,5
9,0
7,0
8,0
6,0
5,0
Taux de mortinatalité (p. 100)
Année1815 18551850 1875187018651860 18851880 1905190018951890 19101820 184018301825 1835 1845
Source : Annuaire statistique de la ville de Paris
Ces proportions n’ont pas manqué de frapper les observateurs de l’époque, comme en témoignent les remarques d’Adolphe Trébuchet (1801-1866), chef du bureau sanitaire à la préfecture de police, reprenant celles d’Alexandre Moreau de Jonnès (1778-1870), directeur de la Statistique générale de la France (SGF). Le taux de mortinatalité est deux fois plus élevé à Paris que dans tout le Royaume, ce qui reste difficile à expliquer ; mais, de Jonnès ne retient pas dans les années 1840 l’idée d’une progression des « actions criminelles » dans la capitale. Trébuchet lui-même ne songe pas à s’interroger sur l’enregistrement (Trébuchet, 1851). En 1851-1853, d’après la SGF, le département de la Seine apparaît au premier ou deuxième rang national pour la proportion des mort-nés pour cent naissances (plus de 6 % de mort-nés). Là encore, en quête d’explication, les auteurs négligent l’enregistrement mais soulignent la surmortinatalité des enfants nés hors mariage : « ces circonstances [des unions illégitimes] sont les excès de toute nature ou les privations excessives, la dissimulation prolongée de la grossesse par les expé-dients les plus dangereux pour la santé de l’enfant, les tentatives d’avortement, les accouchements clandestins, etc. » (SGF, Mouvement de la population en 1851, 1852 et 1853, § 6, 7 et 8).
Interrogé par les parlementaires le 4 février 1874 sur l’augmentation du nombre des mort-nés en France, le docteur Louis-Adolphe Bertillon (1821-1883) se montre prudent car, explique-t-il, cet enregistrement est bien postérieur à l’état civil, il n’a vraiment commencé qu’en 1840 : « la population n’est pas encore habituée à l’idée de faire enregistrer à part un mort-né, encore peut-on tenir pour certain que, dans les campagnes, on enfouit encore les avortons et
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
691
maints morts-nés [sic] que l’on fait enregistrer dans les villes » (Rapport à l’Assemblée nationale, 1874, Annexes, p. 110). Pour éviter de regrettables confusions, Bertillon propose de suivre le modèle belge qui distingue clairement les différentes catégories de mort-nés, selon que l’enfant est mort avant, pendant ou après la naissance (Bertillon, 1876).
Comme le confirme en 1905 Jacques Bertillon (1851-1922), la mortinatalité parisienne au XIXe siècle s’est accrue par paliers, jusqu’à dépasser 8 % après 1890, et approcher 9 % peu avant 1900 (Bertillon, 1907).
On notera cependant que le pourcentage des mort-nés tend plutôt à dimi-nuer jusqu’au milieu des années 1820, confirmant la « baisse constante sous le Consulat et l’Empire » de cette proportion à Metz (Lhote, 1970, p. 459). La pratique des institutions tenues par des religieuses, peu enclines à déclarer des mort-nés issus de grossesses peu avancées, semble avoir joué un rôle dans la qualité de l’enregistrement, comme le notent dès l’époque le préfet Chabrol et l’hygiéniste statisticien Villermé (Chabrol, 1826 ; Villermé, 1826). Ce n’est qu’après cette période de décroissance que le taux de mortinatalité augmente nettement jusqu’au pic de 1871, puis au-delà, vers celui des années 1890.
Cette évolution par paliers recouvre plusieurs processus : d’abord les hési-tations du pouvoir civil à légiférer dans ce domaine alors que l’Ancien Régime avait adopté une logique assez simple en la matière ; ensuite, une amélioration de l’enregistrement des mort-nés liée notamment à la prise en compte des nés vivants morts peu de temps après la naissance ; enfin, l’émergence à partir des années 1830-1840 d’un souci croissant d’enregistrer les « fausses-couches » dans le but de prévenir les actes « criminels », avortement et infanticide.
On voit que la catégorie des mort-nés dont témoigne la statistique parisienne touche la question de l’enregistrement et de la construction des statistiques, d’une part en amont, par une réflexion sur la conception ou du moins sur les premiers mois suivant la conception, d’autre part en aval, par un questionne-ment sur la naissance d’un enfant qui peut être né vivant ou mort. C’est cet entre-deux, entre mort et vie, qui va être ici exploré.
II. Le cadre législatif évolue au cours du XIXe siècle
Le legs de l’Ancien Régime
Pour saisir la difficile construction de la catégorie des mort-nés, il convient de revenir sur les registres d’Ancien Régime. L’état civil en France avant la Révolution n’enregistre pas de faits proprement démographiques (naissances ou décès), mais les cérémonies religieuses qui y sont liées. Les ordonnances royales du XVIe siècle imposent au clergé de tenir des registres de baptêmes, de sépultures, puis de mariages. De son côté, le concile de Trente (1545-1563) exige la tenue de registres de baptêmes et de mariages, avant qu’en 1614 le Rituel romain y ajoute le livre des défunts (Le Mée, 1999a, p. 29-36). Ces
V. Gourdon, C. rollet
692
registres n’ont pas de but statistique : il s’agit de mieux connaître les popula-tions paroissiales, de contrôler les mariages, de repérer les éventuels empê-chements de consanguinité ou d’inceste spirituel, etc. Les mort-nés stricto sensu n’ont pas vocation à y apparaître. N’ayant pas vécu, ils n’ont théoriquement pas été baptisés – baptiser un mort est sacrilège –, et par suite, n’ayant pu accéder au statut de membre de la communauté chrétienne, ils ne sont pas censés être inscrits dans des actes de sépulture. Ce non enregistrement traduit une double exclusion plus cruciale. Dans la conception catholique de l’époque, non seu-lement les âmes du mort-né et de l’enfant n’ayant pas vécu suffisamment pour recevoir le sacrement de baptême sont privées de la vision de Dieu (un espace leur est néanmoins réservé, le limbe), mais leurs corps sont aussi exclus du droit d’être inhumés en terre consacrée, auprès de leurs ancêtres, et doivent être enterrés dans un espace séparé et profane (Gélis, 2006, p. 26).
En pratique, ce traumatisme est cependant souvent épargné aux familles. Car bien des mort-nés sont inscrits dans les registres de catholicité au bénéfice du doute (baptême sous condition), ou parce que prêtres et parents reconnais-sent généreusement des signes de vie permettant un ondoiement d’urgence, soit à la naissance, soit dans des « sanctuaires à répit » où le cadavre de l’enfant a été porté dans l’espoir d’un miracle (Gélis, 2006).
Néanmoins, il faut convenir qu’en matière d’enregistrement, les mort-nés, même ondoyés, ne suscitent pas un grand intérêt avant le XVIIIe siècle. Ainsi, même si l’État monarchique se préoccupe très tôt de la répression de l’infan-ticide (l’édit d’Henri II de mars 1556 oblige les femmes non mariées enceintes à déclarer leur grossesse), il faut attendre 1736 pour qu’une déclaration royale exige que tout enfant ondoyé, par un laïc ou un prêtre, soit désormais inscrit dans les registres de baptême (Le Mée, 1999a, p. 38-45). Faut-il y voir un désir nouveau de la part de l’État monarchique de comptabiliser ces situations d’en-tre-deux, ou bien s’agit-il d’une simple transposition de la rigueur désormais recherchée par l’Église en la matière ? Quoi qu’il en soit, le clergé paroissial est incité à mieux distinguer et mentionner les cas de baptême se situant à la frontière entre vie et mort. Pour autant, en pur droit canon, les ondoyés décédés ne sauraient être confondus avec des mort-nés, et cette dernière catégorie, peu pertinente sur le plan religieux, reste jusqu’à la fin de l’Ancien Régime absente comme telle de la législation et donc mal appréciée.
Une législation pleine de contradictions : 1792-1806
La réorganisation générale du droit entamée sous la Révolution et achevée par le Code Napoléon influe sur la définition et l’enregistrement des mort-nés essentiellement par trois voies : le passage à une déclaration de naissance ; la définition des modalités d’enregistrement des décès ; la question des successions.
La laïcisation de l’état civil en septembre 1792 ne dissipe pas d’emblée le flou concernant les mort-nés, sujet accessoire pour l’Assemblée à cette date.
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
693
Elle aboutit surtout à un transfert d’autorité dans la tenue et la conservation des registres, mais sans grande modification de la pratique d’enregistrement. Si l’on parle désormais de « naissance », la procédure apparaît comme une quasi-copie des prescriptions du baptême. L’acte doit être dressé dans les vingt-quatre heures, délai repris de la déclaration royale de 1698 sur les baptêmes. Il faut deux témoins, potentiellement de sexe différent, comme les parrain et marraine. En cas de « péril imminent », l’officier public se rend dans la maison du nouveau-né pour dresser l’acte, suivant l’esprit de l’ondoiement à domicile en péril de mort. Enfin, la rédaction de l’acte reprend l’essentiel du contenu de son modèle catholique (texte de loi in Duvergier, 1834, p. 482-488).
En revanche, le Code Napoléon, s’il n’évoque pas non plus l’enregistrement des mort-nés, modifie les données de la question. Son article 55 stipule en effet : « Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu : l’enfant lui sera présenté » (Code civil, 1909, p. 24). La limite des trois jours, fixée par Bonaparte en per-sonne alors que le premier projet soumis aux délibérations du Conseil d’État reprenait une échéance de vingt-quatre heures (Discussion, 1841, p. 73-74), semble s’inspirer des délais de baptême prescrits par l’archevêché de Paris (synode de 1673), qui se plaçait dans la logique du baptême immédiat confirmé pour les catholiques au concile de Trente. Alors que sous l’Ancien Régime, l’obsession du baptême conduit à considérer des enfants nés morts comme ayant vécu, ce délai élargi introduit plutôt le risque inverse de voir des enfants nés vivants considérés comme mort-nés, puisque décédés avant leur déclaration de naissance. L’expression « l’enfant lui sera présenté » pose en pratique une exigence qui va engendrer de nombreux problèmes concernant aussi bien les naissances que les mort-nés. Enfin l’article 56 complète le dispositif en obligeant toute personne témoin d’un accouchement (père, médecin…) à déclarer la naissance, sous peine d’encourir les peines prévues dans le Code pénal à l’ar-ticle 346 (Code d’instruction criminelle et code pénal, 1910, p. 434).
La législation civile révolutionnaire, puis napoléonienne, est conduite à poser plus directement la question des mort-nés, quand elle abandonne l’en-registrement des sépultures des baptisés pour celui des décès. La loi de 1792 n’y fait certes pas allusion, se contentant de prescrire que la déclaration de décès soit faite à l’officier public par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée (Titre V, article 1), et obligeant ce même officier à se transporter auprès de celle-ci pour s’assurer du décès, puis à en donner acte sur des registres doubles (Titre V, article 2). Mais l’exemple proche d’un canton de la Seine-et-Oise, Montfort l’Amaury, laisse penser que sur le terrain, face à des réalités situées à la marge, des évolutions timides ont lieu. Même si les officiers d’état civil rédigent les actes de façon variée, il ressort qu’ils établissent un seul acte de décès en cas de décès in utero pendant l’accouchement ou de décès très précoce (moins d’une heure de vie) et deux actes (naissance et décès) lorsque l’enfant nouveau-né a vécu quelque temps (au moins une heure). Les
V. Gourdon, C. rollet
694
termes employés pour désigner un mort-né (le terme lui-même n’est jamais utilisé bien que connu des milieux médicaux et religieux) sont très divers (19 cas) : « mort avant la naissance, né mort, déjà mort, mort avant l’accou-chement, mort avant qu’il n’ait vu le jour, venu mort, aucun signe de vie, n’a donné aucun signe de vie, ni avant, ni après » (Malphettes, 1984, p. 7-13). Mais même approximatifs, ces actes permettent de distinguer les enfants vraiment nés morts des enfants ayant vécu, ce qui est déjà un progrès par rapport à l’Ancien Régime, où cette question n’était guère essentielle.
Le Code Napoléon s’inscrit dans la continuité de la loi de 1792. Son arti-cle 77 affirme qu’ « aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier d’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors des cas prévus par les règlements de police ». Des précisions sont données sur les témoins (article 78), la manière de rédiger les actes (article 79), mais rien de spécifique n’est noté concernant les mort-nés.
Cependant, une évolution très significative se produit en l’an III (1795). Voulant préciser la forme des actes d’état civil, l’autorité se soucie pour la pre-mière fois de la déclaration et de l’enregistrement des mort-nés : « une décision du Comité de législation en date du 8 thermidor an III [26 juillet 1795] a seu-lement prescrit à chaque municipalité de recevoir les déclarations relatives aux enfants mort-nés, et d’en faire mention sur les registres de l’Etat civil, et cela pour la sûreté et la tranquillité des familles »(1). Cette décision du Comité de législation se retrouve dans un document émanant du bureau de police admi-nistrative, civile et militaire du département de Paris. Ce document cite un « extrait d’une lettre des représentants du peuple composant le Comité de législation en date du 19 fructidor du présent mois » (5 septembre 1795) s’adressant aux administrateurs du département : « La déclaration concernant les enfans morts nés [sic] doit être portée sur le registre de l’état civil, cette précaution est nécessaire soit pour la sûreté des femmes ou filles qui en étoient mères, soit pour l’intérêt des familles » (pour extrait conforme signé Marquet)(2).
Reste le problème de la fiabilité de ces déclarations. À cet égard le préfet Nicolas Frochot (1761-1828), conseiller d’État et premier préfet du département de la Seine (le 1er germinal an VIII [1800]) prend le 21 vendémiaire an IX (1801) une initiative intéressante ayant sans doute eu un impact, nous y reviendrons, sur l’enregistrement des mort-nés à Paris (Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1843, n° 30, p. 118-159). Considérant que les parents, voisins et officiers d’état civil n’ont pas les compétences nécessaires pour prouver le
(1) Citée dans la lettre adressée par le préfet Chabrol aux maires de Paris en 1817, Archives de Paris, VD6619, n° 1, VD42, pièce 400.
(2) Archives de Paris, DL1 article 3. Nous remercions vivement Vincent Tuchais et Sandrine Aufray de nous avoir indiqué ce document.
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
695
décès et éviter des inhumations précipitées, Frochot met en place un système de vérification des décès au domicile par des officiers de santé. Dès qu’un décès est déclaré, le maire dépêche un officier de santé au domicile de la personne présumée décédée. C’est sur la base de son rapport que l’acte de décès est rédigé et signé. Un délai de vingt-quatre heures est impératif entre la déclaration des parents et l’inhumation, sauf cas particulier. La création du service de vérifi-cation des décès à Paris date de cette époque-là. Une autre lettre de Frochot adressée le 4 thermidor an IX (1801) au maire du 6e arrondissement est inté-ressante, car elle montre l’intérêt des autorités pour les décès des enfants de moins de quinze ans : le préfet invite le maire à dresser l’état exact de tous les enfants décédés, en indiquant leur nom, leur âge, leur sexe et la cause du décès. Un formulaire modèle est joint sur lequel on peut voir mentionnée une colonne « mort-nés »(3). Or ce terme ne sera pas repris dans les textes de loi mais seu-lement dans les statistiques.
Le droit des successions pèse lui aussi sur la manière d’aborder la morti-natalité, en introduisant avec le Code civil une notion importante, celle de viabilité. Le chapitre « Des qualités requises pour succéder » du Code Napoléon prévoit en effet à l’article 725, que « pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder 1° celui qui n’est pas encore conçu, 2° celui qui n’est pas né viable, 3° celui qui est mort civilement » (Code civil, 1909, p. 180). Un enfant non viable est incapable de succéder, et de lui nul ne peut hériter. Seul l’enfant né vivant et viable, même s’il a vécu un court instant seulement, ouvre droit à l’héritage de ses parents ou du parent survivant. Un homme, par exemple, dont l’épouse expire en accouchant et dont l’enfant meurt à deux jours, héritera de son fils des biens transmis par sa mère décédée ; de même si c’est l’époux qui décède, sa veuve héritera de son enfant. En revanche, en l’absence d’enfant, le mari (ou la femme) ne peut hériter de son conjoint. En la matière, on comprend l’im-portance des indications concernant la « viabilité »(4) de l’enfant, la durée de sa vie après l’accouchement, mais aussi, si la mère meurt, l’ordre des décès de la mère et de l’enfant, éléments indispensables pour établir le droit des héritiers. La viabilité est donc une notion fondamentale, même si l’article 725 n’en précise pas les limites.
D’autres chapitres du Code civil laissent néanmoins entendre que la limite de 180 jours de gestation est alors dans l’esprit du législateur, malgré les réti-cences de grands médecins de l’époque (Fodéré, Marc) qui considèrent cette vision de la « viabilité » comme une définition fonctionnelle ex lege plus que comme un fait scientifique (Betta, 2006, p. 121-127). Dans le chapitre « De la paternité et de la filiation », l’article 314 du Code prévoit ainsi que 180 jours
(3) Archives de Paris, VD4 2, pièce 393.
(4) Dans le Dictionnaire des sciences médicales (t. LVII, Paris, Panckoucke, 1812, p. 412), Fodéré propose une définition de la viabilité en médecine légale : « État du nouveau-né, qui le fait déclarer assez fort, assez parfait, pour faire espérer qu’il vivra » (cité in Betta, 2006, p. 121).
V. Gourdon, C. rollet
696
(soit 6 mois) représentent la durée du mariage au-dessous de laquelle un mari ne peut pas désavouer un enfant « si l’enfant n’est pas déclaré viable ». De même, d’après l’article 312, un père ne pourra désavouer son enfant que s’il était dans l’impossibilité de cohabiter avec sa femme entre le 300e et le 180e jour avant la naissance de l’enfant (Code civil, 1909, p. 86-87).
L’enregistrement dans un acte public du mort-né, à terme ou avant terme, n’est donc pas pure affaire d’état civil et de statistiques. Il devient un enjeu essentiel pour les familles, susceptible de créer des conflits successoraux, et de mobiliser le monde de la justice. Pour autant, la catégorie du mort-né et son mode d’enregistrement ne sont toujours pas clairement définis.
Vers le décret du 4 juillet 1806
Cette situation, encore peu débattue, change en 1806 dans le contexte d’une querelle sur la place et le rôle d’une statistique générale de la France. En fait, l’autorité publique semble hésiter depuis 1803 quant à l’orientation à donner aux statistiques : faut-il privilégier les topographies descriptives selon le modèle allemand (et continuer à produire ces grands mémoires statistiques qui don-neront une image complète de la France) ? Ou bien s’orienter selon le modèle anglais, vers l’arithmétique politique, c’est-à-dire vers un usage plus critique de la comptabilité en sciences humaines (Dupâquier, 1985) ? Un des tenants de cette « géométrie » d’État est Emmanuel-Etienne Duvillard, mathématicien genevois (1755-1832), spécialiste des rentes viagères, membre du bureau de la statistique au ministère de l’Intérieur (Thuillier, 1997). Fin 1805 et début 1806, il multiplie notes, mémoires et rapports pour alerter les autorités sur l’impor-tance du calcul et de la vérification par rapport à l’accumulation. Il veut en particulier mettre de l’ordre dans les états du mouvement de la population qu’envoient les préfets au ministre de l’Intérieur et énumère point par point tous les changements à opérer(5). Mais il est loin d’être toujours écouté et subit au cours de cette année 1806 des tribulations professionnelles : après sa pro-motion, désirée, au poste de sous-directeur au bureau de la statistique du ministère de l’Intérieur en août 1805, il n’obtient pas celui de chef du bureau de statistique et redevient sous-chef du bureau en avril 1806.
C’est dans cette atmosphère qu’a lieu, en 1806, une discussion au plus haut niveau sur la question de savoir « comment constater la naissance d’un enfant né vivant, mais décédé avant qu’on ait eu le temps de le présenter à la mairie, et de faire dresser l’acte de naissance ». Certains estiment qu’il ne faut dresser qu’un acte d’état civil, celui du décès « en y consignant la déclaration des témoins, attestant que l’enfant était venu vivant au monde ». D’autres pensent qu’il faut établir deux actes, « celui de naissance et celui du décès, s’appuyant sur ce que, ces deux faits ayant eu lieu, devaient être constatés, suivant les formes prescrites par la loi ». Le préfet Frochot décide de consulter le grand juge, ministre de la
(5) BnF, N.a.f. 20588, folio 25-27, janvier 1806. Voir aussi Reinhard, 1950, p. 103-120 ; Perrot, 1977, p. 64 ; Dupâquier, 1988, p. 22-25 ; Thuillier, 1997.
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
697
Justice. C’est la seconde opinion qu’adopte le 25 mars 1806 le ministre, déclarant qu’il y aurait « des inconvénients infiniment graves, et pour l’ordre des succes-sions et pour la tranquillité des familles, à se borner, dans des cas pareils, à ne faire qu’un acte de décès ». Dans sa lettre du 9 avril 1806 (Archives de Paris, VD41, pièce 66), Frochot invite les maires à se conformer à cette décision, tout en notant qu’il « y aurait quelque chose de répugnant » à exiger des parents de présenter à la mairie un enfant mort. Cette objection a été examinée et discutée, explique Frochot : la formalité de la présentation se trouve implicitement remplie par la vérification du décès. La « décision », prise par le ministre de la Justice exige donc qu’on dresse deux actes d’état civil, un de naissance et un de décès, mentionnant dans le premier, la déclaration circonstanciée des témoins qui certifient que l’enfant a vécu, y notant en même temps qu’on a fait aussi l’acte de décès, « prenant toutes les précautions pour que des tiers puissent plus tard faire valoir leurs droits […] » (Archives générales de médecine, mars 1826). On voit bien apparaître le souci de distinguer les enfants qui sont nés vivants des enfants nés morts, dans le but clairement énoncé de régler au mieux la question des droits en matière d’héritage. On est en droit de supposer que Duvillard n’a pas été étranger à cette clarification.
Or, à peine quatre mois après la « décision » du grand juge, le décret du 4 juillet 1806 formule le problème tout différemment, puisque l’officier d’état civil doit inscrire sur le registre des décès l’enfant qui lui est présenté mort avant la déclaration de naissance. Le texte du décret concernant « les enfants présentés sans vie à l’officier de l’état civil », appliqué non seulement en France mais dans tout l’Empire, en particulier aux Pays-Bas et en Belgique, mérite d’être cité en entier : « Art. 1er. Lorsque le cadavre d’un enfant, dont la naissance n’a pas été enregistrée, sera présenté à l’officier de l’état civil, cet officier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie ; il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l’enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enfant est sorti du sein de sa mère. 2. Cet acte sera inscrit sur les registres de décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non » (Code civil, 1909, Article 79, p. 32).
En complète contradiction avec la pratique adoptée depuis la laïcisation de l’état civil et avec tous les textes produits précédemment, si un enfant meurt avant la déclaration de naissance, il est donc enregistré comme « présenté sans vie » sur le registre des décès ; il n’est pas inscrit sur le registre des naissances ; les vrais mort-nés ne sont pas distingués des enfants que Louis-Adolphe Bertillon proposera plus tard d’appeler « faux mort-nés » (Bertillon, 1876, p. 6). Dans une lettre adressée le 9 novembre 1806 aux maires de Paris, le même préfet Frochot leur recommande d’appliquer les nouvelles règles et leur envoie une « formule des actes à faire en conformité du décret » (document 1). Il n’est rien dit à ce moment-là sur la façon de comptabiliser ces « présentés sans vie » dans les statistiques.
V. Gourdon, C. rollet
698
Document 1. La « formule » à utiliser pour enregistrer les « présentés sans vie »
Source : Archives de Paris, VD41, pièce 70.
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
699
On ignore les raisons réelles qui ont poussé le législateur à trancher dans ce sens. Fut-ce dans le souci de ne pas laisser les officiers d’état civil rédiger un acte de naissance alors même que l’enfant leur était présenté mort ? Ou bien était-ce parce que l’officier d’état civil, n’ayant aucun moyen par lui-même de savoir si l’enfant était né vivant ou mort à la naissance, devait se contenter des déclarations des témoins : ces déclarations ne risquaient-elles pas d’être fausses puisque les parents et tous les chrétiens avaient intérêt à déclarer que l’enfant était né vivant pour lui donner le baptême, ou au moins l’ondoyer, et que cer-taines familles avaient le même intérêt pour fonder les droits à l’héritage ? En tout état de cause, il apparaît que c’est probablement en raison de l’incapacité de l’autorité publique à établir l’exacte vérité des circonstances de la naissance – ce qui ne sera possible que dans le cadre d’une vérification à domicile des naissances et des décès –, que celle-ci a préféré introduire cette procédure « qui ne préjuge en rien » sur la question de savoir si l’enfant a vécu ou non. On voit ainsi le souci de séparer ce qui a trait à l’enregistrement stricto sensu des faits d’état civil de ce qui relève, comme les questions d’héritage, de la sphère de la justice. Cette discussion au sein du couple justice/intérieur se poursuivra pendant tout le XIXe siècle.
Le décret du 4 juillet 1806 va régner jusqu’au XXe siècle. Son premier effet sera de semer la confusion, à la fois dans l’enregistrement et dans la construc-tion des statistiques(6).
Les « présentés sans vie » : application du décret de juillet 1806
Tout montre que les usagers des registres d’état civil n’ont pas été d’accord pendant des années sur la méthode à appliquer pour construire des statistiques. La comparaison, qu’il serait trop long de détailler ici, de différentes sources fournissant les décès par âge de la ville de Paris depuis 1812 (Trébuchet, 1849 ; Chabrol, 1826 ; Annuaire du Bureau des longitudes – BnF, cote V-21601), montre que si les chiffres publiés par Chabrol (1773-1843, préfet de la Seine à partir de 1814) et par l’Annuaire du Bureau des longitudes sont identiques, en revanche ceux fournis par Trébuchet sont souvent très différents à partir de 1816. Par exemple en 1818, Trébuchet comptabilise pour Paris 3 944 décès avant l’âge de trois mois, alors que Chabrol et l’Annuaire des longitudes n’en relèvent que 2 750. La différence est de 1 194. On soupçonne que cet écart provient de l’ajout des mort-nés : or ces derniers figurent déjà dans les chiffres de Chabrol et de l’Annuaire, Trébuchet les aurait donc ajoutés une deuxième fois aux décès. Visiblement, les statisticiens n’ont pas su traiter de façon homogène les chiffres des mort-nés. Une autre preuve d’incohérence vient de la confrontation des données concernant la ville même de Paris et le département de la Seine, qui suggère l’inclusion des mort-nés dans les statistiques parisiennes, mais pas dans celles du département.
(6) C’est pourquoi il nous semble peu probable que Duvillard ait été lui-même à l’initiative de ce décret. D’ailleurs, il n’en avait pas le pouvoir.
V. Gourdon, C. rollet
700
Dans une lettre adressée aux maires des 11e et 6e arrondissements (Archives de Paris, VD6619, pièce 1 ; VD42, pièce 400), Chabrol tente en février 1817 de clarifier la situation. Se référant explicitement à la décision du 8 thermidor an III (1795) et sans mentionner le décret de 1806, il invite les maires, sans rien changer à la tenue des registres de l’état civil, à « vouloir bien, à l’avenir, faire distraire les enfants mort-nés des résumés des décès destinés au travail de la statistique. Il suffit de continuer d’en faire une mention numérique dans la colonne qui leur est réservée particulièrement dans le relevé des actes que vous m’adressez chaque année ». Chabrol veut ainsi cesser de « faire faire continuellement des rectifications qui prennent beaucoup de temps ».
Cette lettre présente plusieurs intérêts : visiblement, les maires des 11e et 6e arrondissements inscrivaient les mort-nés parmi les décès envoyés aux services de statistiques, interprétant de cette façon le décret du 4 juillet 1806. Le préfet leur demande de « distraire » ces mort-nés de la statistique. Ensuite, il manifeste un réel souci d’efficacité ; il s’agit d’éviter de perdre du temps à rectifier les statistiques envoyées par les mairies. Enfin, à l’occasion du rappel de la décision de l’an III (1795), Chabrol explicite le terme de mort-né : « Mais l’enfant qui meurt dans le sein de sa mère, qui n’a point vu le jour, qui n’a pas reçu de nom, enfin qui n’est point compris dans les naissances ne peut, par cette seule raison, être porté dans les décès ». À ses yeux, il s’agit du véritable enfant né mort ; mais l’allusion à la nomination laisse apparaître que Chabrol a aussi en tête une vision sociale de la naissance qui évoque clairement le rite baptismal où l’enfant recevait traditionnellement son nom de baptême. Cette accumulation de critères restrictifs de nature différente n’est pas de trop pour parvenir à cerner une catégorie quelque peu fuyante aux yeux des acteurs de terrain.
On voit bien se dessiner une contradiction majeure entre, d’une part, l’ap-plication administrative du décret de 1806, et d’autre part, l’exploitation des registres de l’état civil aux fins de statistiques.
Le problème vient du fait que la forme du décret convient à peu près à l’état civil mais pas aux statisticiens. Les officiers d’état civil n’ont qu’à enregistrer un fait : l’enfant présenté est mort ou vivant lors de la déclaration. Or « l’enfant qui a vécu et qui conséquemment a hérité et peut transmettre un héritage, est assimilé à celui qui n’a jamais exercé de droits à exercer et à transmettre » (Archives générales de médecine, mars 1826, p. 632). Dans la pratique, les familles ont la possibilité, si elles le désirent, de faire une enquête pour prouver que l’enfant est venu au monde vivant, et elles font établir un acte de notoriété. En conséquence, elles peuvent se prévaloir de la naissance d’un enfant vivant pour régler un problème de succession. En revanche, cette méthode gêne considé-rablement les statisticiens. Les « faux mort-nés » ne sont pas compris dans les naissances et sont mélangés avec les vrais mort-nés dans les décès. Comme l’explique M. Gasc au nom de la Commission de police médicale de l’Académie de médecine, la forme prescrite « ne nuit qu’aux recherches statistiques,
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
701
empêchant une complète exactitude dans les tableaux comparatifs des nais-sances et des décès » (Archives générales de médecine, mars 1826, p. 631).
En janvier 1826, un débat commence en effet à l’Académie de médecine à la suite d’une communication de Louis-René Villermé (1782-1863), commentant les statistiques de Paris pour la période 1817-1821, dressées par Villot, chef des bureaux de statistiques du département de la Seine, et publiées par le préfet Chabrol (Villermé, 1826, p. 237-240).
La discussion est très éclairante pour notre propos. Villermé note une grande différence dans les proportions de mort-nés selon que l’enfant est né à domicile ou hors du domicile : dans le premier cas, « il s’écoule un certain intervalle entre la naissance et la déclaration » – censée se faire dans les trois jours suivant la naissance –, dans l’autre, l’inscription des enfants mort-nés se fait « immédiatement après l’accouchement ». À la maison d’accouchement, « tout enfant qui vient au monde avec des signes non équivoques de vie n’est point compris parmi les morts-nés [sic] » (Villermé, 1826, p. 238). « Il en résulte que la dénomination d’enfans morts-nés [sic] au domicile a en effet trop d’étendue, parce qu’elle s’applique à un nombre assez considérable de nouveaux nés [sic] qui meurent peu de temps après leur naissance » (Chabrol, 1826, Tableau n° 46). En moyenne, sans compter les accouchements de la maison d’accouchement (12e arrondissement), on compte 33 mort-nés pour 1 000 nais-sances pour les accouchements hors du domicile, 61 ‰ pour les accouchements à domicile. Villermé soupçonne aussi qu’une petite partie de la différence provient de la volonté des « établissements publics de charité » de diminuer le nombre des enfants mort-nés. Villermé fait preuve d’une grande lucidité en concluant : « D’ailleurs de toutes les questions qui se rattachent à la population, il n’en est guère qui offre plus d’incertitude que celle des enfants nés-morts » (Villermé, 1826, p. 239). Villermé pointe ici le rôle de la procédure de décla-ration : le fait de devoir apporter en personne le nouveau-né à l’officier d’état civil peut pousser de nombreuses familles, craignant pour la santé du bébé, à attendre au maximum pour sortir l’enfant et effectuer la déclaration – une tendance parallèle à celle observée dès cette époque pour les baptêmes (Gourdon, 2006).
En se prolongeant dans les semaines suivantes, le débat à l’Académie de médecine met bientôt en lumière l’extrême complexité de la question des mort-nés. En février, les incohérences de l’application de la législation sont dénoncées : « C’est d’après ces errements qu’agissent et que doivent agir les officiers d’état civil : seulement quelques-uns mentionnent dans l’acte de décès, les déclara-tions de témoins relatives au nombre d’heures qu’a vécu l’enfant, et en cela, ils agissent arbitrairement […] » (Archives générales de médecine, mars 1826, p. 631). Certains médecins s’interrogent alors sur des améliorations possibles. L’expert en obstétrique Kergaradec regrette que beaucoup d’officiers d’état civil utilisent le terme d’ « enfants mort-nés » au lieu de celui d’ « enfants présentés sans vie », « ce qui exprime une idée toute différente ». Dans le doute, Gasc va
V. Gourdon, C. rollet
702
vérifier lui-même auprès des mairies d’arrondissement le mode d’enregistre-ment, fort variable, des présentés sans vie ; Gardien, rédacteur de l’article « Embryon » du Dictionnaire des sciences médicales (1815), propose que l’acte mentionne, « non seulement si l’enfant a vécu mais encore s’il est né viable ». Suggestion aussitôt rejetée par Adelon (1782-1862), spécialiste de médecine légale (Betta, 2006, p. 167), et certainement soucieux des intérêts de son corps professionnel, qui estime qu’une telle constatation dépasserait les compétences d’un simple officier d’état civil et qu’il vaut mieux en rester à la situation pré-sente : « le décret de 1806 satisfait à tout, explique-t-il, puisqu’il laisse aux intéressés le pouvoir de prouver que l’enfant a vécu ». L’ Académie de médecine finit par se ranger à son avis (Archives générales de médecine, 1826, p. 632).
S’il débouche sur le statu quo, ce débat montre néanmoins que le point de vue de certains médecins, comme celui des statisticiens, peut contredire celui de l’administration pour laquelle la question fondamentale est de pouvoir régler la question des successions, ce qu’un acte de notoriété peut faire, indépendam-ment de l’état civil. Il indique en outre que la pratique locale d’enregistrement est assez variable puisque certains arrondissements parisiens vont jusqu’à mentionner le nombre d’heures vécues par l’enfant présenté sans vie : cette variabilité ne rend pas impossible la résolution des problèmes juridiques, mais elle ne facilite pas la tâche des statisticiens.
Les débats entre ministères
Les autorités elles-mêmes sont divisées et adoptent des positions fluctuan-tes, dont témoignent les différentes circulaires produites dans les années 1830 et 1840. Certes, celle du ministre de l’Intérieur en mai 1837 prescrit à nouveau, pour les enfants morts avant la déclaration de naissance, de rédiger un acte de décès, mais non de naissance (Le Mée, 1999b, p. 75). Mais le débat entre le ministre de la Justice et celui de l’Intérieur, visible en 1806, reste vif, tandis qu’un nouveau différend surgit entre le ministère de l’Intérieur et celui de l’Agriculture et du Commerce.
Une lettre de Rambuteau (1781-1869, conseiller d’État, préfet de la Seine de 1833 à 1848), adressée le 16 avril 1841 au maire du 1er arrondissement de Paris (Archives de Paris, VD42, pièce 404 ; même lettre au maire du 6e arron-dissement, VD41, pièce 230) expose le premier conflit : tandis que le ministre de la Justice veut l’application stricte du décret de juillet 1806 (qui « défend à l’officier d’état civil de constater toute autre circonstance [souligné dans la lettre] que celle de la présentation du corps mort de cet enfant »), le ministre de l’Intérieur souhaite la « distinction entre enfants mort-nés et ceux qui décèdent avant la déclaration de naissance » ainsi que la distinction selon le sexe et la légitimité. Face à ce dilemme, le préfet demande au maire d’établir la distinction selon le sexe et la légitimité des enfants mort-nés en respectant le décret de 1806. Le récepteur de la lettre annote dans la marge : « je ne com-prends pas bien ce qu’on me demande »… On le comprend, le point de vue des ministères est tout simplement contradictoire. Pour l’instant, Rambuteau fait
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
703
prévaloir l’avis de la Justice, mais pour satisfaire le ministre de l’Intérieur, il ajoute un paragraphe demandant à ce que les « procès-verbaux de visite des corps de ces enfants [morts avant la déclaration de naissance] fissent mention des déclarations qui pourraient être faites par les parents relativement à la durée de l’existence de ceux qui ne seraient point sortis morts du sein de leur mère ». Le préfet note que quelques médecins vérificateurs « prennent déjà ce soin » : il faut à l’avenir recueillir cet utile renseignement, ce qui permettra à ses services de « faire rechercher le chiffre des véritables mort-nés qui pourra être établi, si ce n’est d’une manière authentique, au moins avec une probabilité très suffisante ». Ainsi, le préfet décompose la procédure en deux : les officiers d’état civil appliquent à la lettre le décret de 1806, mais les médecins vérifica-teurs ajoutent la mention de la durée de vie, ce qui permettra au bureau de statistique d’établir des statistiques fiables ou du moins suffisamment crédibles. Le décret de 1806 va être de mieux en mieux appliqué mais la vérification des décès à domicile offre, grâce aux bulletins de décès remplis par les médecins, un moyen de contourner ce décret au bénéfice des statisticiens.
Le second débat oppose les services de statistiques issus de ministères différents. Faut-il distinguer les faux mort-nés des vrais mort-nés ? Inclure les uns dans la statistique des naissances mais non les autres ? Les exclure tous ? Le 15 juin 1839 une circulaire du ministère de l’Agriculture et du Commerce (bureau de la « Statistique de France ») recommande de ne pas comprendre les mort-nés parmi les décès, une colonne spéciale devant leur être réservée, et d’ « éviter soigneusement » de compter parmi les mort-nés les enfants morts avant la déclaration de naissance : ceux-ci, explique-t-il, « ne doivent pas être séparés des enfants nés-viables » (Archives nationales, F20552). On a donc deux statistiques, l’une du ministère de l’Intérieur qui applique le décret de 1806, l’autre du ministère du Commerce (SGF) qui demande de distinguer les vrais des faux mort-nés. Les circulaires ou dépêches qui suivent (26 janvier 1844 et 29 novembre 1847) se contredisent, renvoyant à l’existence de plusieurs services statistiques existant séparément, l’un au ministère de l’Intérieur (Bureau d’administration générale dirigé par Alfred Legoyt), l’autre au ministère de l’Agriculture et du Commerce (Bureau de la Statistique générale de la France, dirigé par Moreau de Jonnès de 1835 à 1850).
La réunion de ces deux services en 1852, sous la direction de Legoyt (Le Mée, 1999b, p. 72), commence à éclaircir la situation, non sans mal. Dans sa circulaire du 6 juillet 1852, l’administration du nouveau ministère de l’Intérieur, de l’Agriculture et du Commerce, demande aux préfets de vérifier les deux séries de tableaux envoyés pour la période 1846-1850, une autre vérification ayant déjà été faite pour la période 1841-1845 (Archives nationales, F204405 et F20513)(7). Les réponses des préfets sont bien rassurantes : les tableaux sont
(7) En 1841-1845, la proportion des enfants morts avant la déclaration de naissance pour 100 mort-nés au total varie beaucoup selon les départements : elle est de 13 % dans le Calvados et atteint jusqu’à 51 % dans le Cantal.
V. Gourdon, C. rollet
704
conformes aux instructions, il n’y a pas d’erreurs (Archives nationales, F20552) ! La contradiction est toujours aussi sévère pourtant entre les nécessités admi-nistratives (l’application d’un décret) et celles liées à la comptabilité statistique (nécessité de compter précisément les naissances et les décès). Dans sa lettre du 3 mars 1853 (Archives de Paris, VD42, pièces 406-407), le préfet de la Seine invite les maires, tout en appliquant le décret de 1806, à « totaliser, à part », les enfants mort-nés et les enfants décédés avant la déclaration de naissance, de façon à ne pas faire figurer cette catégorie de décès avec les autres (circulaire du 29 décembre 1852 ; Archives nationales F204407, et F20749). Enfin, le préfet de la Seine envoie le 25 décembre 1853 des extraits de la circulaire du ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics du 24 septembre qui confirment les dispositions de 1852 : « on classera à part les enfants mort-nés » (Archives de Paris, VD42, pièce 408). Mais il ne reproduit pas certains détails intéressants de cette circulaire : dans plusieurs départements, y explique le ministre, en particulier en région de montagne et en milieu rural, les mort-nés sont déclarés à l’autorité ecclésiastique – nécessité du baptême oblige –, mais pas à l’état civil, d’où parfois un nombre de mort-nés minime. On a la trace de cette circulaire dans plusieurs départements montagneux (Brière, 1983, p. 18 ; Malphettes, 1984, p. 31), ce qui laisse présumer une pratique très différente en milieu rural et en milieu urbain, spécialement parisien, là où existait un sys-tème de vérification des décès à domicile.
Dix ans plus tard, le ministre de l’Intérieur, dans une circulaire datée du 15 juin 1863, se plaint de l’augmentation de la mortinatalité, et pointe encore une source d’erreur : il ne faut, rappelle-t-il, inscrire parmi les mort-nés que les enfants décédés avant, pendant et après l’accouchement dont la naissance n’a pas déjà été enregistrée (Dansette, 1985, p. 21).
Cette confusion des administrations, qui suscite les interrogations des acteurs locaux, perturbe nécessairement les résultats statistiques obtenus, et brouille les comparaisons entre départements et localités. Paris a, durant le siècle, une mortinatalité supérieure au reste du pays. Cela tient en grande partie à ce que l’enregistrement des mort-nés y est bien meilleur, du fait notam-ment de la vérification à domicile des naissances et des décès. Mais une autre partie de l’explication réside dans la part excessive, par rapport à d’autres départements, des « faux mort-nés ».
III. Comprendre la statistique des mort-nés à Paris
La part des « faux mort-nés »
La présence des faux mort-nés dans la statistique renvoie bien sûr à la définition ambiguë du mort-né, liée au décret de 1806. À Paris, au début de la IIIe République, a été introduite dans les procès-verbaux établis par les méde-cins vérificateurs une question permettant de distinguer les enfants ayant respiré des autres mort-nés (tableau 1). Les statistiques parisiennes publiées à
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
705
partir de 1877 permettent de calculer qu’entre un cinquième et un quart des mort-nés de plus de six mois de gestation sont en réalité des enfants qui ont respiré, donc de faux mort-nés. Leur proportion parmi l’ensemble des mort-nés (quelle que soit la durée de gestation) oscille entre 13 % et 21 % de 1877 à 1898 (mais la série n’est pas complète).
Tableau 1. Proportion d’enfants ayant respiré parmi le total des mort-nés et les mort-nés de plus de six mois de gestation (Ville de Paris, 1877-1898)
Année
Enfants ayant respiré déclarés mort-nés
Effectif Pour 100 mort-nés Pour 100 mort-nés de plus de six mois de gestation
1877 479 12,6 14,1
1878 833 20,8 23,3
1879 911 21,3 24,9
1880 728 16,8 23,6
1881 792 16,4 23,0
1882 968 18,7 24,0
1883 714 14,3 20,3
1884 759 15,1 20,9
1885 799 16,8 23,3
1886 787 17,3 19,9
1887 733 –(a) 23,1
1888 691 – 22,9
1889 670 – 20,9
1890 601 – 20,1
1891 845 – 23,2
1892 799 – 20,6
1893 767 19,0 21,4
1894 792 14,7 22,0
1895 751 14,1 20,9
1896 738 13,5 20,3
1897 725 13,6 20,8
1898 692 12,9 20,9
(a) donnée manquante.Source : Annuaire statistique de la ville de Paris.
En réalité, un mort-né « viable » sur quatre ou cinq a vécu. Cette proportion élevée correspond à celles calculées par Bertillon (1876, p. 222) pour la Belgique (23,3 % et 22,3 % pour les périodes 1851-1860 et 1861-1865). Un tel niveau montre d’abord l’importance de la mortalité néonatale réelle(8). Mais il traduit aussi l’inquiétude, toujours vive, des parents face à un décès précoce qui risque de priver le bébé du baptême, ou du moins de l’ondoiement. À Paris au XIXe siècle,
(8) Jacques Bertillon en 1893 observe que ce sont ces 600 à 700 « enfants expulsés vivants du sein maternel » à qui la couveuse Tarnier peut rendre service (Bertillon, 1893, p. 544).
V. Gourdon, C. rollet
706
le baptême à l’église est souvent repoussé, mais la forte croissance de la pratique de l’ondoiement en urgence à domicile lorsque la santé du bébé est en péril montre le souci persistant d’assurer son salut (Gourdon et al., 2004). Or l’enfant ondoyé et décédé avant d’être présenté vivant à l’officier d’état civil a de grandes chances d’être considéré comme mort-né (et rangé dans la catégorie des « faux mort-nés »), suivant la déclaration des familles, et ce qu’il ait ou non « réelle-ment » vécu quelques heures ou jours.
Carte 1. Proportion des mort-nés ayant respiré (1907-1910)
France : 14,8 %
> 19 %
De 10 à 19 %
< 10 %
Source : Rollet, 1990, p. 444.
Ce lien étroit entre « faux mort-nés » et pratique religieuse est confirmé par la carte (carte 1) des « mort-nés ayant respiré » en 1907-1910 (tous âges de ges-tation considérés)(9), dressée à partir des données de la SGF (Rollet, 1990). Celle-ci, qui fait ressortir la Bretagne, le Sud du Massif central et quelques dépar-tements de l’Est, correspond assez bien à la célèbre carte Boulard de 1947 sur la
(9) Pour cette période, la SGF a fait faire des relevés très détaillés concernant les naissances, les dé-cès mais aussi les mort-nés : durée de gestation, lieu d’accouchement et statut juridique de l’enfant, assistance médicale et la réponse à la question suivante : « l’enfant a-t-il respiré ? ».
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
707
conformité des pratiques religieuses dans la France rurale (Cholvy et Hilaire, 2000, p. 182 sq.) : les régions catholiques ont tendance à déclarer plus souvent qu’un enfant a respiré, lui permettant d’accéder au baptême ou au moins à l’on-doiement(10). Les proportions peuvent atteindre 25 % à 30 % en Bretagne et dans les deux départements savoyards contre 15 % pour le département de la Seine. Elles avoisinent 10 % seulement dans les départements moins attachés à la reli-gion (Statistique générale de la France, 1907, 1908, 1909 et 1910).
Cependant, le rapport entre geste baptismal et ampleur du phénomène des faux mort-nés est complexe, et on peut envisager des mouvements contradic-toires. La proportion élevée des « faux mort-nés » pourrait aussi témoigner d’un certain recul du conformisme religieux. À Paris (Gourdon, 2006) et dans de nombreuses autres villes et régions françaises (Cholvy et Hilaire, 2000), on observe au XIXe siècle une tendance à retarder autant que possible le baptême à l’église pour des raisons de convenance, notamment dans les milieux aisés où le clergé donne souvent la permission de conférer un ondoiement à domicile pour ne pas faire prendre de risques au bébé (Gourdon et al., 2004). Ce retard peut entraîner, dans une proportion hélas difficile à mesurer, un surcroît de faux mort-nés, car la déclaration à l’état civil peut alors être légèrement repous-sée (afin d’éviter la sortie de l’enfant), offrant de ce fait un risque supérieur de voir l’enfant mourir avant son enregistrement civil (Le Mée, 1999b, p. 74).
Enfin, l’importante proportion des « faux mort-nés » n’est pas sans rapport avec les enjeux que pose, en matière successorale, la notion de « viabilité » au sens du Code civil, dont nous avons vu qu’elle est d’abord une notion juridique. Pour résoudre les questions liées à l’héritage, il convient de définir précisément l’âge gestationnel de l’embryon et du fœtus expulsés morts mais aussi celui des naissances vivantes. On s’attache, à partir de la catégorie floue des « présentés sans vie », à faire le partage entre nés morts et nés vivants, ce qui suppose de bien reconnaître les signes de la vie et de la mort. D’où l’importance de la vérification des naissances et des décès à domicile, rapidement et efficacement organisée à Paris.
L’enregistrement des mort-nés par la vérification à domicile
Une des causes de l’augmentation indiscutable de la proportion des mort-nés à Paris à partir des années 1830 tient au renforcement de l’administration chargée de la vérification des décès, suivi par la mise en place de la vérification des naissances à domicile.
La vérification des décès et l’identification de leurs causes, objet de l’ini-tiative du préfet Frochot dès l’an IX (1801), redeviennent un sujet d’actualité après 1830. Toujours soucieux d’éviter des inhumations précipitées et des crimes camouflés, un rapport très circonstancié publié en 1843, dont nous
(10) Nous n’irons pas jusqu’à affirmer, comme de nombreux médecins du XIXe siècle (de Villermé à Budin) que la sortie de l’enfant pour le baptême immédiat à l’église – qui se maintient dans les régions très catholiques – présente des dangers et peut renforcer justement la mortalité néonatale, donc tendanciellement la proportion de « faux mort-nés » (Gourdon, 2009).
V. Gourdon, C. rollet
708
n’avons pu identifier l’auteur, trace un historique du développement de ce service qui montre ses perfectionnements successifs (Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1843, p. 118-159). D’après le rapport de Pontonnier, chef de la première division à la préfecture de la Seine, présenté le 26 novembre 1836, il existe 35 médecins vérificateurs à Paris, très inégalement répartis dans les arrondissements. Le processus est bien rodé : le maire expédie au médecin, « sous le titre de mandat de visite, l’ordre de se transporter au domicile du décédé, de s’y faire représenter le corps, de constater le décès, d’en indiquer les causes, et de lui adresser immédiatement rapport » (Annales…, 1843, p. 128). Mais Pontonnier veut aller plus loin et il propose d’établir un comité d’inspection (Annales…, 1843, p. 151).
Ce double quadrillage de la ville (les médecins vérificateurs et les inspecteurs de la vérification) ne peut qu’améliorer l’enregistrement des décès, à la fois quan-titativement et qualitativement, y compris celui des mort-nés. Des exemples figurent dans le rapport de 1843 d’inhumations précipitées qui sont surtout le fait des « enfants nouveau-nés : le médecin vérificateur donnait très souvent des certificats d’urgence, ce qui conduisait les pompes funèbres à enlever des corps pour les emporter au cimetière quelques heures seulement après la déclaration à la mairie » (Annales…, 1843, p. 153). Depuis la mise en place du nouveau dispo-sitif, ces inhumations précipitées d’enfants ont disparu. Par cette inspection, l’administration se donne les moyens de faire indiquer systématiquement la durée de vie, « le nombre d’heures que l’enfant a vécu, quelle que courte qu’ait été la durée de la vie après la naissance » (Annales…, 1843, p. 155), donc de différencier les vrais des faux mort-nés, mais aussi de recueillir l’âge du fœtus. En effet, l’indication de l’âge des fœtus expulsés (« durée de la vie utérine de l’enfant ») doit être recueillie d’après l’ « Instruction sur la vérification des décès dans la ville de Paris » publiée dans le Recueil des actes administratifs, n° 14 en 1844 (p. 11). Ces données per-mettront bientôt les études de Bayard sur les fœtus (Bayard, 1846). Enfin, l’admi-nistration se dote d’un outil d’investigation concernant la nature criminelle ou non du décès en exigeant que l’enfant soit examiné démailloté (Recueil des actes administratifs, 1844, p. 10). Là encore, des exemples sont pris concernant des infanticides ou des maltraitances graves ayant entraîné la mort d’enfants (Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1843, p. 156-158).
Paris et le département de la Seine sont à cet égard très en avance sur le reste du pays. D’après un rapport fait à l’Académie de médecine vers 1863, 25 000 des quelque 30 000 communes de France ne feraient pas de constatation des décès (Brière, 1983, p. 13). Du reste, la circulaire ministérielle du 24 décembre 1866 se contentera de recommander fortement l’organisation dans tous les départements d’un service de vérification des décès, sans le rendre obligatoire (Malphettes, 1984, Annexe X ; Brière, 1983, p. 12).
À ce quadrillage concernant les décès va s’ajouter dans le courant du XIXe siècle à Paris la mise en place d’un dispositif de vérification des naissances à domicile. La proposition de création d’un médecin vérificateur des naissances
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
709
avait été faite dès le début du XIXe siècle par Villermé, Baudelocque, Trébuchet et d’autres, pour éviter notamment le danger du transport du nouveau-né à la mairie. Elle est reprise dans les années 1840-1850 par Joseph-Napoléon Loir, qui publie De l’exécution de l’article 55 du Code Civil relatif à la constatation des naissances en 1846 (Gourdon, 2009, p. 111-117). À l’en croire, Douai et Versailles sont en 1846 les premières municipalités françaises à instaurer ce système (Loir, 1846, p. 22-23), et celui-ci veut convaincre les douze maires d’arrondis-sement de Paris de reprendre sa proposition. Ceux-ci refusent majoritairement le projet, constatant que la déclaration à domicile – coûteuse pour les finances municipales – ne remplira certainement pas ses objectifs, puisque la grande masse des nouveau-nés parisiens continuent d’être baptisés et envoyés en nourrice peu après la naissance (Archives de Paris, VD41, pièce 260).
Mais ce blocage initial sous la monarchie de Juillet ne dure pas, et la consta-tation des naissances à domicile, promue sans relâche par les médecins hygiénistes (Monot, 1872, p. 29-34), se met bientôt en place à Paris(11). Au début des années 1860, le système n’est appliqué qu’à titre exceptionnel dans quelques arrondis-sements de Paris, mais il s’étend rapidement avant la guerre de 1870. Sa mise en place est plus lente dans les communes des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, ce qui explique pourquoi le taux de mortinatalité y est systématique-ment inférieur. Une innovation est introduite à partir du 1er janvier 1869 avec l’accord du préfet : la présentation à la mairie de l’enfant né n’est plus obligatoire, l’autorité permet aux officiers d’état civil de déléguer un médecin qui vient à domicile constater les naissances. À Paris, présenter son nouveau-né à la mairie devient vite une démarche exceptionnelle(12). Une naissance parisienne sur cinq est constatée en mairie en 1881, moins d’une sur vingt en 1891 (tableau 2). L’hospitalisation des femmes lors de l’accouchement entame certes un processus de hausse, mais il ne se développe vraiment qu’après la seconde guerre mondiale. Peu avant 1900, la plupart des naissances (quatre sur cinq) sont bel et bien constatées à domicile par un médecin délégué.
Tableau 2. Répartition des naissances selon le lieu de la constatation en 1881, 1886 et 1891 à Paris (%)
Année
Proportion de naissances constatées
EnsembleÀ la mairie À domicile
Dans les hôpitaux, hospices et prisons
1881 19,2 72,0 8,8 100
1886 7,2 82,4 10,4 100
1891 4,0 80,1 15,9 100
Source : Annuaire statistique de la ville de Paris.
(11) On peut suivre cette évolution grâce aux différentes éditions du livre du docteur E. Bouchut, Hygiène de la première enfance, 1862, 1866, 1879.
(12) Nous remercions vivement Sandra Bree, doctorante en démographie, pour ces informations.
V. Gourdon, C. rollet
710
Ce nouveau mode de déclaration des naissances n’a, selon toute vraisem-blance, pas eu le même impact que le service de vérification médicale des décès pour l’enregistrement de la mortinatalité parisienne, mais nul doute qu’il a comme lui contribué à améliorer le recueil public de ces événements situés aux frontières de la vie et de la mort.
L’enregistrement des embryons pour lutter contre le « crime »
Le dernier facteur expliquant la poussée des taux de mortinatalité à Paris au cours du XIXe siècle est la concentration des regards sur la question de l’avortement, qui incite bientôt à un enregistrement renforcé des accouchements prématurés et des fœtus de tous âges de gestation. Au milieu du siècle, cet enjeu mobilise fortement différents milieux, tant politiques, judiciaires, scien-tifiques, médicaux que religieux, comme l’indiquent les débats engagés à l’Académie de médecine en 1827 puis 1852 sur l’avortement thérapeutique, et les réactions hostiles de l’Église dans les décennies suivantes (Betta, 2006 ; Le Naour et Valenti, 2003). La concurrence nouvelle entre savoir médical et rai-sonnement théologique à propos des confins de la vie, et l’affirmation du pouvoir des États dans les domaines de la grossesse et de l’accouchement depuis la fin du XVIIIe siècle – par le contrôle et la formation des sages-femmes, voire l’obli-gation légale de la césarienne post-mortem (Filippini, 1995) –, n’expliquent pas seuls cet intérêt croissant. Il faut y ajouter la question sociale. L’hypothèse « criminelle » d’un avortement ou d’un infanticide, qui existait déjà sous l’An-cien Régime (édit du roi Henri II), se renforce singulièrement sous la monarchie de Juillet, en relation avec les processus d’industrialisation, de paupérisation d’une partie des forces ouvrières et d’urbanisation. On croit ou on veut croire à la poussée de la « démoralisation » de la société, engendrant des tendances à la violence et au crime. Concernant la mortinatalité, cette pensée s’éloigne de celle d’un homme comme Duvillard, qui, sous l’Empire, interprétait ainsi le chiffre élevé des « morts-nés ou avortons » [sic] de l’année 1815 dans le département de la Seine : « Les mêmes raisons, sans doute, de saisissement et de frayeur chez les femmes peuvent avoir donné lieu à ces accouchements prématurés »(13). Les causes que nous appellerions psychologiques sont rem-placées par la suspicion d’avortement volontaire ou d’infanticide.
Un des textes centraux pour notre démonstration est celui présenté par le docteur Henri Bayard en 1846. Ce médecin, inspecteur-suppléant de la vérifica-tion des décès de la ville de Paris, est bien placé pour étudier la question des fœtus et nouveau-nés de la capitale. Grâce aux statistiques publiées et aux dépouillements qu’il a lui-même effectués, il souligne, comme d’autres, la grande progression du rapport des mort-nés aux naissances – on est passé de 1 pour 27 à 2 pour 30 – (Bayard, 1846, p. 3), mais surtout il détermine pour l’année 1845 le nombre de mort-nés par nombre de mois écoulés depuis la conception (durée de gestation). Sans se faire d’illusion sur la qualité des données, il montre que
(13) BnF, N.a.f. 20589, Notes du tableau 1, 1815.
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
711
sur 1 971 mort-nés enregistrés en 1845 (selon la définition de 1806), 882 ne sont pas à terme et 223 ne sont pas viables. À juste titre, il remarque que jusqu’à quatre mois, il n’y a presque pas de déclaration de fœtus dont l’expulsion a été prématurée. Ces « fausses-couches comme on les appelle vulgairement », écrit-il, sont pourtant très fréquentes : la taille d’un fœtus de trois mois, explique-t-il, permet de s’en débarrasser facilement, et les familles n’ont aucun intérêt à déclarer un fœtus non viable (moins de six mois). Plus la durée de la grossesse s’allonge, plus il est difficile de les faire disparaître. À quatre mois, les fœtus atteignent 20 centimètres et pèsent 250 grammes. Si les familles continuent à les laisser sur la voie publique, à les déposer à la morgue, ou à les jeter dans les fosses d’aisance, certaines vont déclarer les accouchements prématurés. Les femmes ne peuvent pas cacher les signes de leur grossesse et tout médecin ou sage-femme qui a été témoin d’un accouchement est tenu par la loi de le déclarer. Le nombre de déclarations augmente donc avec la durée de grossesse et c’est au septième mois que les accouchements prématurés enregistrés sont les plus communs. Bayard souligne la difficulté de séparer les nés vivants des nés morts : on retrouve ici bien entendu la question des faux mort-nés. La suite de la démonstration du docteur Bayard porte sur les expositions (abandons dans la rue) de fœtus et d’enfants à terme dont le nombre a augmenté entre 1836 et 1844, en relation peut-être avec la suppression du dispositif d’abandon (les « tours ») en 1837 (Bayard, 1846, p. 13). À travers cette communication, on entre au cœur de la question de l’enregistrement des fœtus dont on voit clairement la progression à partir de la fin des années 1830 à Paris.
On mesure aussi les progrès dans la connaissance des fœtus aux différents âges de son développement in utero, dont témoigne le nombre important de communications sur ce thème dans les revues de médecine légale : signes de l’infanticide d’un fœtus, relation entre volume du fœtus et âge de la mère, examen du sang et des os du fœtus, à partir des années 1830. C’est à ce moment-là aussi que se précisent les images de fœtus dans leur réalité physique, dégagées des présupposés théologiques (Morel, 2009).
Cet enregistrement des fœtus qui témoigne d’une angoisse face aux « cri-mes » d’avortement et d’infanticide, mais qui signe aussi la médicalisation croissante de l’état civil, n’est pas étranger à l’étude sur l’avortement effectuée par deux médecins, Paul Lecomte et Ambroise Tardieu en 1850.
La contribution de ces deux personnages, l’un fonctionnaire à la préfecture de Paris, l’autre docteur en médecine et inspecteur adjoint à la vérification des décès, éclaire bien la logique de l’enregistrement des embryons, même les plus jeunes, pratique qui s’installe dans les grandes villes et surtout à Paris. Les deux auteurs montrent que la législation devient extrêmement complexe lorsque la « naissance et la mort se confondent et qu’il s’agit d’individus mort-nés ». Ils signalent « une grande confusion », « une sorte de routine arbitraire » à leur sujet. Le problème vient du fait qu’on ne sait pas s’il faut ou non déclarer les fœtus mort-nés lorsque « la délivrance est prématurée ». Examinant la
V. Gourdon, C. rollet
712
législation et la jurisprudence, ils notent les positions contradictoires adoptées par deux cours de justice, l’une jugeant comme non obligatoire la déclaration à l’état civil des fœtus mort-nés (décision de la cour d’appel de Nancy du 17 septembre 1839), l’autre préconisant d’exiger la déclaration et l’autorisation préalable pour l’inhumation de fœtus mort-nés (décision de la Cour de cassation du 2 août 1844). Dans un souci explicite de prévention du « crime d’avorte-ment », les deux auteurs prônent une déclaration obligatoire « de tout accou-chement, quel qu’en ait été le résultat et à quelque époque de la gestation qu’il ait eu lieu » (Lecomte et Tardieu, 1850, p. 415). Les modalités d’application doivent cependant être souples pour ne pas devenir des mesures « vexatoires » ou « iniques » (concernant l’inhumation).
Cette proposition extrême débouche finalement dans la loi du 13 mai 1863 qui modifie l’article 345 du Code pénal : « le produit de toute grossesse doit être déclaré et représenté, quel que fût son degré de développement » (Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1897, p. 147). L’ application stricte de la loi sera aban-donnée par la suite car si elle facilite « la répression des crimes d’avortement et d’infanticide », elle jette « le trouble et l’inquiétude dans les familles » et risque de « blesser la pudeur publique » – les démarches dues à cette législation, à commencer par l’intervention des pompes funèbres, rendent publique toute grossesse débutante. Mais le législateur reste ferme sur la poursuite du crime. La circulaire ministérielle du 24 décembre 1866 sur le danger des inhumations précipitées précise dans le dernier paragraphe : « un examen tout particulier doit être fait lors du décès des enfants nouveau-nés, à l’effet de rechercher si la mort ne serait pas le résultat d’un crime » (Malphettes, 1984, Annexe X).
Dans les faits, l’application de ces nouvelles règles touchant aux fœtus pose problème. La définition d’un âge gestationnel minimal suscite des hésitations. La circulaire préfectorale du 26 novembre 1868 considère que le décret de 1806 ne s’applique qu’aux « produits de la conception ayant au moins quatre mois » ; les embryons de six semaines à quatre mois doivent aussi être déclarés, mais il suffit de transcrire sur un « registre spécial » le certificat du médecin véri-ficateur (Lutaud, 1896, p. 165-166). La circulaire préfectorale du 15 janvier 1869 rappelle qu’il faut inscrire les embryons de moins de quatre mois seulement sur un simple registre de police paraphé par le maire(14), mais la société de médecine légale s’oppose la même année à toute déclaration de fœtus avant quatre mois ou quatre mois et demi, selon les sources. Le préfet de la Seine, le 20 janvier 1875, signale que la circulaire précédente est mal appliquée. La définition d’un « avorton » (terme qu’avait déjà utilisé Duvillard pour les années 1815 et 1816 en assimilant mort-nés et avortons) n’est pas précise : la limite varie de quatre à six mois de gestation selon les documents.
(14) Nous avons une trace de tels registres pour une époque plus tardive dans la banlieue pari-sienne : un « registre de fœtus » est tenu par la mairie de Neuilly-sur-Seine de 1914 à 1954 (Archives municipales de Neuilly, 5E2).
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
713
Malgré ces flottements, Bertillon père souligne en 1874 que « l’habitude […] s’étend, surtout dans les grandes villes, de faire constater et enregistrer les avortons » (Rapport à l’Assemblée nationale, 1874). Son fils Jacques signale que la statistique municipale indique la durée de gestation des mort-nés depuis 1866 pour Paris et « nous voyons que, dès cette époque (et antérieurement aussi sans doute) un grand nombre de mort-nés étaient déclarés qui n’avaient que cinq mois de gestation et même moins encore » (Bertillon, 1907).
Comme l’énonce Gustave Lagneau en 1878, « la déclaration obligatoire de tous les fœtus aurait constitué une application plus étendue de l’article 56 du Code civil […] et la non-déclaration aurait entraîné la pénalité stipulée par l’article 346 du Code pénal » (Lagneau, 1878). En fait, selon lui, cette inscrip-tion s’est réalisée « très incomplètement » du fait de la volonté des femmes, explique-t-il, de cacher leurs grossesses hors mariage : « du 1er juin 1871 au 31 décembre 1873, le Bulletin de la statistique municipale indique qu’il n’y a eu à Paris que 3 déclarations de fœtus d’un mois, 6 de deux mois, 76 de trois mois, etc, ». D’autres auteurs, comme le docteur Lutaud en 1896, indiquent des motifs plus larges : la déclaration des fausses couches blesserait l’intimité des femmes et des familles, cette réticence étant comprise des médecins et sages-femmes astreints au secret médical ; en outre, elle entraînerait théoriquement l’intrusion des pompes funèbres dans les familles, puisque l’enlèvement des « produits embryonnaires » de six mois et au-dessous est réglementé par la circulaire préfectorale du 26 janvier 1882, une perspective qui heurterait la sensibilité de bien des familles (Lutaud, 1896 ; Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1902, 1903).
Même faibles pour les premiers mois qui suivent la conception, ces nombres ne font qu’accroître ceux des mort-nés. Leur proportion devient non négligeable dans les années 1880. Il est très probable que la mise en place à Paris de la constatation de naissance à domicile ait contribué à cette augmentation des mort-nés issus de grossesses peu avancées. En 1893, les dispositions de la comptabilité statistique concernant ces fausses couches changent une fois encore : à partir de cette date, on doit compter à Paris les embryons de moins de quatre mois de gestation dans la statistique des mort-nés.
L’allure de la courbe des « avortons » de moins de six mois de gestation sous la IIIe République se comprend largement à l’aune de ces évolutions admi-nistratives. On compte 11 % à 12 % d’ « avortons » de moins de six mois de gestation dans les années 1870, on n’est pas loin de la proportion calculée à partir des données fournies par le docteur Bayard pour l’année 1845 (11,3 %). À partir de là, les proportions augmentent très vite, doublant entre 1879 et 1880, puis, après une pause, s’envolant à la fin du siècle pour atteindre 45 % des mort-nés en 1893 (figure 2). D’autres villes de France appliquent la même législation : 40 % des mort-nés enregistrés à Saint-Etienne ont moins de six mois de gestation en 1887 ; à Lyon, on enregistre les embryons en distinguant le statut juridique et le sexe (Rollet, 1990).
V. Gourdon, C. rollet
714
Figure 2. Proportion des mort-nés de moins de six mois de gestation à Paris, 1872-1898 (pour 100 mort-nés)
Ined 2009
20
50
5
10
40
30
35
45
25
15
P. 100
Année1872 18881886 1896189418921890 18981874 188218781876 1880 1884
Source : Annuaire statistique de la ville de Paris.
Les limites évoquées dans le débat sur l’enregistrement et la comptabilité des fœtus sont intéressantes. L’âge de six mois renvoie à la notion de « viabilité » du Code civil. L’âge de quatre mois de gestation semble découler quant à lui des descriptions médicales qui tendent à en faire, malgré des nuances, selon les termes du docteur Ollivier en 1840, l’époque où « toutes les parties du fœtus sont très distinctes, et deviennent de plus en plus prononcées » (cité in Betta, 2006, p. 118). Mais il paraît renvoyer aussi aux débats sur l’animation du fœtus, qui ont été relancés dans la seconde moitié du XIXe siècle par les vives polémiques engageant médecins et théologiens à propos de l’avortement thérapeutique, du seuil admissible pour la césarienne post-mortem, ou encore de la reconnaissance par les autorités ecclésiastiques du baptême intra-utérin. L’enregistrement de plus en plus précoce des embryons, y compris avant quatre mois, n’est pas sans rappeler la pression grandissante des partisans de l’animation immédiate du fœtus (dès la conception) qui, même si leur position reste discutée par certains théologiens favorables à la théorie de l’animation retardée, prennent l’ascendant au sein de l’Église catholique au cours du XIXe siècle (Betta, 2006).
Néanmoins, on ne saurait trop souligner combien cette évolution vis-à-vis des mort-nés précoces tient à la volonté des autorités de police et de justice de procéder à la vérification des corps en cas de suspicion d’avortement volontaire.
Cette obsession de la dimension criminelle de la mortinatalité inspire en effet la plupart des textes produits à partir de la monarchie de Juillet. Il faut attendre les travaux de Jacques Bertillon à partir de 1884 (lors du Congrès
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
715
d’hygiène et de démographie de La Haye) pour qu’elle soit déconstruite à partir d’analyses démographiques. Bertillon utilise des exemples historiques, la famine en Finlande au cours des années 1866-1867 ou le siège de Paris, pour montrer l’influence de la « misère » (Bertillon, 1889, p. 227-229 ; 1893, p. 548 ; 1896, p. 480-484). Ses analyses très détaillées confirment le pic de 1871 (figure 1) : on observe une poussée du taux de mortinatalité à deux moments, d’une part pour les enfants nés pendant le premier siège de Paris (à partir de septembre 1870), d’autre part pour ceux qui ont été conçus non pas au début du siège mais entre décembre 1870 et janvier-février 1871 ; leur surmortinatalité devient considérable à partir du 7e mois de grossesse (Bertillon, 1896, p, 477-484). Bertillon étudie aussi la mortinatalité par durée de grossesse pour conclure à une faible influence de l’avortement volontaire. De même l’analyse de la diffé-rence légitimes/illégitimes selon que l’enfant a respiré ou non lui permet de vérifier que, pourtant plus susceptibles de se séparer volontairement de leurs enfants et donc de commettre un infanticide, les mères célibataires ne connais-sent pas une proportion de « faux mort-nés » supérieure à celle des mères mariées (Bertillon, 1893, p. 546-551).
Les périodes de pénurie, de misère et, ajouterions-nous, de stress sont donc, d’après Bertillon, favorables aux avortements spontanés, précoces ou tardifs. En cela, son analyse rejoint celles qu’avait menées quelques décennies plus tôt Duvillard à propos du chiffre élevé des « morts-nés ou avortons » de l’année 1815 dans le département de la Seine. Mais entre Duvillard et Bertillon, plus d’un demi-siècle de discours sur la mortinatalité en relation avec le « crime » ont inspiré les médecins, les administrateurs et les juristes.
Conclusion
Cette analyse des taux de mortinatalité à Paris au XIXe siècle nous a éloi-gnés des seules questions démographiques pour nous plonger dans de nombreux débats – par exemple le rôle du médecin dans la déclaration d’état civil et dans la définition des frontières de la vie, ou encore les causes criminelles de l’avor-tement – qui comportent des enjeux à la fois administratifs, juridiques, poli-tiques, scientifiques, religieux et moraux. On l’a vu, bien des thématiques sont à traiter pour cerner quelque peu le sens des données statistiques publiées à l’époque : d’abord celle de la cohérence de la législation, ensuite celle de la définition du mort-né, enfin celle de la pression des différents segments de la société, familles, statisticiens, juristes, médecins, ecclésiastiques, concernant cette catégorie de nouveau-nés.
Nous avons vu combien la législation a été pleine de contradictions : deux textes, la même année, prescrivent deux pratiques différentes. Difficile de saisir la logique du décret de juillet 1806 qui a créé la confusion par la suite ; une hypothèse pourrait être qu’à l’époque, l’administration n’avait pas les moyens, surtout à l’échelle nationale, de vérifier si l’enfant était né vivant ou mort,
V. Gourdon, C. rollet
716
puisque le Code civil de 1804 prévoyait que le père se transporte à la maison commune avec l’enfant pour faire constater la naissance. Faute de personnels affectés à cette tâche, et pour éviter que les officiers d’état civil n’outrepassent le rôle neutre d’enregistrement des déclarations, il a semblé préférable de laisser aux familles qui le souhaiteraient le soin de faire dresser un acte de notoriété faisant appel aux témoins de la naissance. La constatation des décès par des médecins, puis celle des naissances à domicile, qui s’engage localement à la fin de la monarchie de Juillet et se met en place à Paris à la fin du Second Empire, auraient pu permettre un changement de législation, laquelle cependant n’évolua pas avant le XXe siècle.
L’incertitude se perpétue dans les années 1830-1840 : des circulaires contradictoires émanent d’instances ministérielles différentes ; des cours de justice font valoir des points de vue divergents. C’est que l’unanimité est loin de se faire à propos de la définition même du mort-né. Des niveaux d’analyse, des traditions, des approches sectorielles se superposent et se télescopent.
Pour l’Église et la majorité des familles, le mort-né n’est pas une catégorie statistique mais cet exclu des bienfaits du baptême, qu’un signe de vie, même faible, voire douteux, permettrait de réintégrer dans la communauté des chré-tiens. Pour le juriste, il est celui qui peut perturber la « sûreté des familles » en matière successorale. Pour le juge, l’observateur social ou le médecin qui traquent le crime, c’est la victime supposée de l’avortement ou de l’infanticide. Mais le monde médical est aussi cet ensemble d’acteurs engagés dans un pro-cessus de professionnalisation, et, à ce titre, désireux d’imprimer la marque de leurs compétences sur les pratiques. Dans le cas présent, le bulletin de décès vérifié par le médecin, qui permet de sortir du carcan du décret de 1806 en indiquant progressivement la durée de vie, l’âge du fœtus, le sexe, le lieu d’ac-couchement, les signes de vie, bouscule les pratiques d’enregistrement de l’état civil défini par un législateur qui s’était finalement largement coulé dans le moule de la réglementation héritée de l’Ancien Régime.
Dernière strate, les statisticiens qui cherchent à établir des catégories bien définies pour observer des phénomènes démographiques et sociaux. Ceux-ci plaident pour distinguer les enfants nés morts de ceux morts avant la décla-ration de naissance, de façon à pouvoir clairement ranger les premiers parmi les décès et les autres parmi les naissances et les décès : c’est ce point de vue qui finira par triompher, mais au XXe siècle ! Dans un premier temps, les sta-tisticiens font en sorte que les mort-nés soient inscrits séparément des naissances et des décès, ce que fait la SGF dans les années 1850 en analysant rétrospec-tivement les statistiques depuis 1836. Ils cherchent aussi à faire distinguer les « enfants mort-nés » des « enfants morts avant la déclaration de naissance » (enquête rétrospective pour les années 1841-1845 faite par la SGF) et, pendant les années 1907-1910, les enfants qui ont respiré de ceux qui ne l’ont pas fait. Mais ce n’est qu’en 1920 qu’une question permet de recueillir systématiquement ce type d’information dans tous les départements français (l’enfant a respiré
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
717
ou non), et à ce moment-là aussi que les embryons de moins de six mois de gestation ne sont plus comptés dans la statistique des mort-nés (Vallin, 1973, p. 34). C’est seulement en 1993 que la France applique la recommandation de l’OMS d’enregistrer parmi les naissances vivantes tout enfant ayant manifesté un signe de vie.
À Paris, au XIXe siècle, tout converge pour que l’on enregistre les mort-nés de plus en plus tôt, puis quel que soit l’âge de la gestation. À la fin du siècle, une circulaire préfectorale enjoint d’enregistrer aussi les embryons de moins de quatre mois. La proportion des « avortons » représente alors entre le tiers et la moitié des mort-nés à Paris !
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que la proportion des mort-nés parmi les naissances n’ait cessé d’augmenter jusqu’à atteindre près d’un dixième à la fin du siècle. Une proportion bien supérieure à celle observée à la campa-gne, puisque pour l’ensemble de la France, on compte seulement 4 % à 5 % de mort-nés au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la proportion restant relativement stable jusqu’à la première guerre mondiale. Cependant, Paris n’est pas unique en la matière. La capitale illustre en réalité un phénomène propre à un certain nombre de villes françaises et de villes étrangères engagées dans l’enregistrement de tous les événements d’état civil et certainement confrontées aux mêmes questions de gestion publique. L’exemple de Vienne en Autriche est intéressant à cet égard, puisque l’on retrouve à la fin du XIXe siècle les mêmes proportions très élevées de mort-nés pour 100 naissances (10 % à la veille de la guerre de 1914-1918, Statistiches Jachbuch der Stadt Wien)(15).
Remerciements : Cette recherche a fait l’objet d’une communication lors du séminaire organisé à Madrid du 9 au 12 juin 2008 par Diego Ramiro Fariñas (International Workshop on Fetal and Neonatal Mortality). Nous remercions les organisateurs de nous avoir donné l’occasion de retravailler sur ce sujet.
(15) Nous remercions Peter Ward de nous avoir communiqué ces données.
V. Gourdon, C. rollet
718
RéféRences
arChiVes
Archives nAtionAles (An) : F20255, F20 4405, F204406, F204407, F20513, F20552, F20749
Archives de PAris : VD41, VD42, VD6619, DL1 article 3
BiBliothèque nAtionAle de FrAnce (BnF) : N,a,f, 20588, 20589
V-21601
Archives municiPAles neuilly sur seine : 5E2
sourCes imPrimées AnnAles d’hygiène publique et de médecine légAle, 1843, « De la vérification
des décès. Inhumations précipitées », Série 1, n° 29, p. 228-229 ; n° 30, p. 118-159.
AnnAles d’hygiène publique et de médecine légAle, 1897, « Non-déclaration de fœtus », série n° 3, n° 37, p. 398.
AnnAles d’hygiène publique et de médecine légAle, 1902, « De la déclaration des fœtus », série n° 3, n° 47, p. 368-369 ; 1903, n° 49, p. 364-365, p. 550-551 ; n° 50, p. 69.
AnnuAire du bureAu des longitudes, 1797 et années suivantes.
AnnuAire stAtistique de lA ville de pAris. Archives générAles de médecine, 1826, débat à l’Académie royale de médecine,
février, vol. X, p. 464-466 ; mars, vol. X, p. 630-632.
BAyArd h., 1846, Recherches sur les causes de l’exposition des fœtus et des enfants nou-veau-nés dans la ville de Paris, Paris, Baillière, 19 p., publié dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, n° 36, série 1, p. 47-65.
Bertillon J. 1889, « Démographie », in M. Rochard (dir.), Encyclopédie de l’hygiène, chapitre II, p. 119-304.
Bertillon J., 1893, « De la mortalité par âge avant la naissance », n° 15, », Revue d’hygiène et de police sanitaire, p. 538-555 ; p. 632-637.
Bertillon J., 1896, « De la mortinatalité et des naissances prématurées selon l’âge du fœtus et selon l’âge de la mère », Revue d’hygiène et de police sanitaire, n° 18, p. 476-494.
Bertillon J., 1907, « Des recensements de la population. De la nuptialité, de la natalité et de la mortalité à Paris pendant le XIXe siècle et les époques antérieures », Annuaire statistique pour la ville de Paris pour 1905, Annexe « Mortinatalité », p. 38.
Bertillon l.-A., 1876, « Mort-né », Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Deuxième série, tome dixième, p. 2-28.
Bouchut e., 1862, 1866, 1879, Hygiène de la première enfance, comprenant les lois organiques du mariage, les soins de la grossesse, l’allaitement maternel, le choix des nourrices, le sevrage, le régime, l’exercice et la mortalité de la première enfance, Paris, J.-B. Baillière et fils, 376 p.
chABrol G., 1826, Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine, Paris.
code d’instruction criminelle et code pénAl, 1910, Paris, Petite collection Dalloz, 694 p.
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
719
code civil, 1909, Paris, Petite collection Dalloz, 624 p.
dictionnAire des sciences médicAles (1812-1822), Paris, édité par Charles-Louis-Fleury Panckoucke.
discussion du conseil d’étAt et du tribunAt sur le code civil, 1841, Paris, Firmin Didot frères, vol. 2, p. 73-74.
duverGier J.-B., 1834, Collection complète des lois, décrets…, t. IV, 1791-1792, Paris, Guyot et Scribe.
lAGneAu G., 1878, « Compte-rendu démographique des séances du Congrès interna-tional de démographie de 1878 », Extrait des Annales de démographie internationale, Séance du 8 juillet, p. 125.
lecomte P., tArdieu A., 1850, « De la déclaration à l’état civil des enfants mort-nés », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Paris, tome 43, p. 397-416 ; tome 44, p. 233-235.
loir J.-n., 1846, De l’exécution de l’article 55 du Code Civil relatif à la constatation des naissances, Paris, Joubert.
lutAud dr, 1896, « Le secret médical et la déclaration obligatoire des embryons et fœtus », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, série 3, n° 35, p. 272-276 ; n° 36, p. 163-173 ; n° 37, p. 398 ; n° 38, p. 145-150.
monot c., 1872, De la mortalité excessive des enfants pendant la première année de leur existence. Ses causes et des moyens de la restreindre, Paris, Baillière, 62 p.
rApport à l’Assemblée nAtionAle fAit Au nom de lA commission chArgée d’exA-miner lA proposition de loi de m. théophile roussel relAtive à lA protection des enfAnts du premier âge, 1874, Assemblée nationale, Annexe n° 2446, séance du 9 juin, 224 p.
recueil des Actes AdministrAtifs, 1844, « Instruction sur la vérification des décès dans la ville de Paris », n° 14, 31 p.
revue d’hygiène et de police sAnitAire, 1893, n° 15, p. 538-555 ; 1896, n° 18, p. 476-494.
stAtistique générAle de lA frAnce, 1856, Mouvement de la population en 1851, 1852 et 1853, Strasbourg, Berger-Levrault, § 8, p. LX.
stAtistique générAle de lA frAnce, 1912, Statistique du mouvement de la population. Années 1907, 1908, 1909 et 1910, Nouvelle série, tome I, Paris.
stAtistiches JAchbuch der stAdt Wien, 1874-1914.tréBuchet A., 1849, « Statistiques des décès dans la ville de Paris depuis 1809 »,
Annales d’hygiène publique et de médecine légale, tome 42, p. 350-387 ; 1850, tome 43, p. 5-49 ; 1850, tome 44, juillet 1850, p. 71-123, p. 322-362 ; 1851, série 1, n° 45, p. 336-386 ; n° 46, p. 5-39.
villermé l.-r., 1826, « Rapport fait par M. Villermé, […] sur une série de tableaux relatifs au mouvement de la population dans les douze arrondissements municipaux de la ville de Paris pendant les cinq années 1817, 1818, 1819, 1820 et 1821 », Archives générales de médecine, série 1, n° 10, p. 216-247.
BiBlioGraPhie
BettA e., 2006, Animare la vita. Disciplina della nascita tra medicina e morale nell’Ot-tocento, Bologna, Il Mulino, 367 p.
Bonneuil n., 1997, Transformation of the French Demographic Landscape, 1806-1906, Oxford, Clarendon Press, 218 p.
Brière s., 1983, Infanticide du nouveau-né : définition d’une problématique et des sources à exploiter, Université de Paris I, DEA, 22 p.
V. Gourdon, C. rollet
720
cholvy G., hilAire y.-m. (dir.), 2000, Histoire religieuse de la France. Géographie XIXe-XXe siècle, Toulouse, Privat, 256 p.
dAnsette m.-d., 1985, La mortinatalité et l’infanticide dissimulé dans le canton de Milly, 1780-1872, Université de Paris I, Maîtrise d’histoire, 99 p.
duPâquier J. (dir.), 1988, Histoire de la population française, tome 3. De 1789 à 1914, Paris, Puf, 554 p.
duPâquier J., duPâquier m., 1985, Histoire de la démographie, Paris, Perrin, 462 p.
FiliPPini n., 1995, La nascita straordinaria. Tra madre e figlio, la rivoluzione del taglio cesareo (sec, XVIII-XIX), Milan, Franco Angeli, 380 p.
Gélis J., 2006, Les enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne, Paris, Audibert, 396 p.
Gourdon v., 2006, « Les pratiques de baptême à Paris et à Rome au XIXe siècle », Popolazione e Storia, 2, p. 19-60.
Gourdon v., 2009, « L’hygiénisme français et les dangers du baptême précoce. Petit parcours au sein d’un topos médical du XIXe siècle », p. 103-123, in Alfani G., Castagnetti P., Gourdon V. (dir.), Baptiser, pratique sacramentelle, pratique sociale (XVIe-XXe s.), Saint-Etienne, Publications de l’université de Saint-Etienne.
Gourdon v., GeorGes c., lABéJoF n., 2004, « L’ondoiement en paroisse à Paris au XIXe siècle », Histoire urbaine, n° 10, p. 141-179.
KuAGBenou v. K., BirABen J.-n., 1998, Introduction à l’étude de la mortalité par causes de décès à Paris dans la première moitié du XIXe siècle, Paris, Ined, Données statistiques, 80 p.
le mée r., 1999a, « La réglementation des registres paroissiaux en France », in Dénombrements, espaces et société, Cahiers des Annales de Démographie Historique, n° 1, p. 21-62.
le mée r., 1999b, « La statistique démographique officielle de 1815 à 1870 en France », in Dénombrements, espaces et société, Cahiers des Annales de Démographie Historique, n° 1, p. 69-90.
le nAour J.-y., vAlenti c., 2003, Histoire de l’avortement, XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 388 p.
lhote J., 1970, « Le mouvement naturel de la population de Metz sous le consulat et l’Empire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. XVII, juillet-septembre, p. 447-468.
mAlPhettes m.-v., 1984, La mortinatalité dans le canton de Montfort-L’Amaury de 1780 à 1872, Université de Paris I, Maîtrise d’histoire, 111 p.
morel m.-F., 2009, « Iconographie des embryons et des fœtus dans les traités d’ac-couchement et d’anatomie du XVIe au XVIIIe siècle », Histoire des sciences médicales, t. XLIII, n° 1, p. 15-26.
Perrot J.-c., 1977, L’âge d’or de la statistique régionale française (An IV-1804), Paris, Société des études robespierristes, 238 p.
reinhArd m., 1950, « La statistique de la population sous le Consulat et l’Empire », Population, n° 1, p. 103-120.
rollet c., 1990, La politique à l’égard de la petite enfance sous la IIIe République, Paris, Puf/Ined, Cahier n° 127, 593 p.
thuillier G., 1997, Le premier actuaire de France : Duvillard (1755-1832), Paris, Comité d’histoire de la Sécurité sociale, 528 p.
vAllin J., 1973, La mortalité par génération en France depuis 1899, Paris, Puf/Ined, 483 p.
les mort-nés à Paris au XiXe sièCle
721
vAllin J., meslé F., 1988, Les causes de décès en France de 1925 à 1978, Paris, Ined, Travaux et documents, 607 p.
vAllin J., meslé F., 2001, Tables de mortalité françaises pour les XIXe et XXe siècles et projections pour le XXIe siècle, Paris, Ined, Données statistiques, n° 4, 102 p.
vAn de WAlle e., 1974, The female population of France in the Nineteenth Century, Princeton, Princeton University Press, 483 p.
Woods r., 2008, « La mortinatalité : éclairage historique sur des problèmes persistants d’estimation et d’interprétation », Population, 63(4), p. 683-708.
V. Gourdon, C. rollet
722
Vincent Gourdon, Catherine rollet • Les mort-nés à Paris au XiXe siècLe : enjeuX sociauX, juridiques, et médicauX d’une catégorie statistique
Au XIXe siècle, le taux de mortinatalité de Paris dépasse celui du reste de la France, et représente près d’une naissance sur dix en fin de siècle. Ces résultats, fournis par les institutions statistiques, renvoient à la difficile appréhension de la catégorie des mort-nés, située aux frontières de la vie et de la mort, et à la superposition de différents regards sociaux. Après un retour sur la législation de l’Ancien Régime et de la Révolution, l’article montre la confusion qui a régné à partir de 1806 dans la définition des modalités d’enregistrement des mort-nés, en raison des pressions multiples des différents ministères, et qui expriment les visions contradictoires du monde judiciaire et des statisticiens. Cette confusion a longtemps empêché de distinguer les « vrais mort-nés » des « faux mort-nés ». En outre deux facteurs ont à Paris contribué à rehausser le niveau de la mortinatalité : la mise en place précoce dans la capitale de la vérification médicale à domicile des naissances et décès, qui a amélioré l’enregistrement des mort-nés ; la crainte obsessionnelle de l’avortement criminel qui a conduit à un contrôle renforcé des fausses couches et à un enregistrement comme mort-nés d’embryons d’âge gestationnel de plus en plus précoce.
VinCent Gourdon, Catherine rollet • stiLLbirths in nineteenth-century Paris: sociaL, LegaL and medicaL imPLications of a statisticaL category
In the nineteenth century, the stillbirth rate in Paris was higher than in the rest of France, representing almost one birth in ten at the end of the century. These data, provided by the statistical institutions, reflect the difficulty of defining the category of stillbirths, located at the boundary between life and death, and subject to conflicting social viewpoints. After reviewing the legislation under the Ancien Régime and the Revolution, this article shows the confusion that prevailed after 1806 in the definitions used in the recording of stillbirths due to multiple pressures exerted by the different ministries, which in turn reflected the contradictory views held by the judicial system and by statisticians. For a long time, this confusion made it impossible to distinguish between “true stillbirths” and “false stillbirths”. Moreover, two factors increased the stillbirth rate in Paris: the early introduction of medical verification of births and deaths that occurred in the home, which improved the recording of stillbirths; and an obsessive fear of criminal abortions, which led to stricter monitoring of miscarriages, and to the recording of foetuses as stillbirths at ever earlier gestational ages.
VinCent Gourdon, Catherine rollet • Los nacidos-muertos en París durante eL sigLo XiX: imPLicaciones sociaLes, jurídicas y médicas de una categoría estadística
En el siglo XIX, la tasa de mortinatalidad de París sobrepasa la del resto de Francia, y representa casi un naci-miento de cada diez a fines de siglo. Estos resultados, proporcionados por las instituciones estadísticas, remiten a la difícil aprehensión de la categoría de los nacidos-muertos, situada en la frontera que separa la vida y la muerte, así como a la superposición de diferentes puntos de vista en la sociedad. Después de un repaso de la legislación del Antiguo Régimen y de la Revolución, el artículo muestra la confusión que ha habido a partir de 1806 en la definición de las modalidades de registro de los nacidos-muertos, a causa de las presiones múltiples de diferentes ministerios, reveladoras de visiones contradictorias entre el mundo judicial y los estadísticos. Esta confusión ha impedido durante mucho tiempo distinguir entre los « verdaderos nacidos-muertos » y los « falsos nacidos-muertos ». Además, dos factores han contribuido a realzar el nivel de la mortinatalidad en Paris : el comienzo temprano en la capital de la verificación médica a domicilio de los nacimientos y de las defunciones, que ha mejorado el registro de los nacidos-muertos; el temor obsesivo del aborto criminal, que ha conducido a un control reforzado de los abortos espontáneos y a un registro como nacidos-muertos, de fetos con una duración de gestación cada vez más corta.