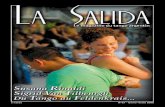V.E. Stefanaki-M.I. Stefanakis, "Le monnayage d'argent de Gortyne entre la seconde moitié du IIIe...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of V.E. Stefanaki-M.I. Stefanakis, "Le monnayage d'argent de Gortyne entre la seconde moitié du IIIe...
REVUE --------------------------------------------------- NUMISMATIQUE
Dirigée par C. Morrisson, M. Amandry, M. Bompaire, O. Picard
Secrétaires de la rédaction Fr. Duyrat, A. Hostein,
J. Jambu
ISSN 0484-8942
2013(170e volume)
SOCIété FrANçAISe De NuMISMAtIque
Diffusion : Société d’édition « Les Belles Lettres » 2013
----------------------------------------------------revue soutenue par l’Institut National des Sciences Humaines et Sociales
du Centre national de la recherche scientifique
Comité de publiCation
direCteurs
Mme Cécile Morrisson, MM. Michel Amandry, Marc Bompaire, Olivier Picard
seCrétaires de la rédaCtion
ArticlesMme Frédérique Duyrat
M. Jérôme Jambu ([email protected])
Comptes rendusM. Antony Hostein ([email protected])
Comité de leCture
Michael Alram, Jean Andreau, Philip Attwood, Gérard Aubin, François Baratte, Patrice Baubeau, Cécile Bresc, François de Callataÿ, Jean-Pierre Callu, Michel Christol, Yves Coativy, Michel Dhénin, Sylviane Estiot, Stefan Heidemann, Jérôme Jambu, Xavier Loriot, Marie-Christine Marcellesi, Jens Christian Moesgaard, Sylvia Nieto-Pelletier, Michel Pastoureau, Séléné Psoma, Andrea Saccocci, Thierry Sarmant, François Thierry, Lucia Travaini, Benedikt Zäch.
La Revue numismatique paraît annuellement. Elle est la propriété de la Société française de numis-matique qui en est l’éditeur et en assure le service à tous ses membres à jour de cotisation pour l’année concernée, lors de sa parution. La cotisation a été fixée pour 2013 à 50 € et 55 € pour les membres résidant à l’étranger.
Société française de numismatique58, rue de Richelieu F-75002 Paris
http://www.sfnum.asso.frLa Revue numismatique est également diffusée par
la Société d’édition « Les Belles Lettres » 95 Boulevard Raspail, F-75006 Paris
Tél. : 01 44 39 84 20, Fax : 01 45 44 92 88.
Les abonnements sont payables à la Société d’édition « Les Belles Lettres » Compte chèque postaux Paris 336 57 P.
Le champ couvert par la Revue numismatique comprend la numismatique et l’histoire monétaire et s’étend à l’archéologie, l’histoire économique, l’histoire de l’art ainsi qu’à l’épigraphie, la sigillographie ou la glyptique dans leurs rapports avec l’étude des monnaies, médailles et documents monétiformes.
La Revue recherche des études de haut niveau et de première main, publication de documents nouveaux ou nouvelle interprétation de documents connus. Les articles sont retenus en fonction de leur qualité scienti-fique et de l’intérêt du document présenté. Les rubriques de la Revue sont indicatives et correspondent aux divisions historiques traditionnelles : numismatique celtique, grecque, romaine, byzantine, médiévale, moderne et contemporaine, orientale, médailles et jetons, histoire de la numismatique et des collections. Des notes synthétiques faisant le point sur une question ou un débat ont leur place dans les Miscellanea ( la Société française de numismatique préférant réserver la publication des articles brefs au Bulletin de la Société française de numismatique).
Les langues admises sont, outre le français, l’allemand, l’anglais, l’espagnol et l’italien.Les manuscrits complets et conformes aux instructions aux auteurs doivent être remis au secrétariat le
1er juillet de l’année qui précède la parution. Après avoir été confiés à plusieurs rapporteurs et examinés par le comité de lecture, ils sont définitivement retenus lorsque le conseil de gestion de la Revue numismatique se réunit, en janvier, pour adopter le budget de la Revue qui paraît dans l’année.
La Revue ne rend compte que des ouvrages qui sont adressés au secrétariat avec la mention « Revue numis-matique ». Les ouvrages sont remis à des spécialistes proposés par les directeurs au Comité de lecture. La publication rapide dans le bulletin bibliographique ne doit pas nuire au caractère informatif et critique des comptes rendus et il est possible de rendre compte simultanément et synthétiquement de plusieurs ouvrages.
La Revue numismatique se réserve le droit de refuser toute publicité sans avoir à fournir de motif à sa décision.
RN 2013, p. 147-174
Vassiliki E. Stefanaki*, Manolis I. StefanakiS**
Le monnayage d’argent de Gortyne entre la seconde moitié du iiie
et le premier quart du ier siècle av. J.-C. :remarques préliminaires
Résumé – Dans l’attente d’un corpus du monnayage gortynien de l’époque hellénistique, nous essayons dans cette étude de définir l’étalon et la datation des pièces émises par Gortyne entre la seconde moitié du iiie et le premier quart du ier siècle av. J.-C. En outre, nous réexaminons les avis qui ont été présentés jusqu’à nos jours sur l’influence rhodienne sur l’étalon et les types monétaires des cités crétoises et en particulier de Gortyne au iie siècle av. J.-C.
Mots clés – Gortyne, influence rhodienne, Gorgos, drachmes « pseudo-rhodiennes », IGCH 338, étalon crétois.
Summary – In anticipation of the publication of a corpus of the coinage from Gortyn in the Hellenistic period, this paper aims at the definition of the weight system and the dating of relevant coins issued between the second half of the third and the first quarter of the first century BC. Moreover, we reassess scholarly debate about the Rhodian influence on the weight system and coin types of Cretan cities and particularly of Gortyn in the second century BC.
Keywords – Gortyn, Rhodian influence, Gorgos, “pseudo-rhodian” drachms, IGCH 338, Cretan weight standard.
Le monnayage d’argent de Gortyne en Crète du iie et du ier siècle av. J.-C. a posé des problèmes aux numismates en ce qui concerne son étalon et sa datation. À la suite de l’étude de V. E. Stefanaki sur la politique monétaire des cités crétoises1, on a jugé nécessaire de revenir sur certains points un peu obscurs et ambigus se rapportant aux émissions monétaires de la cité crétoise en question.
* Archéologue-Numismate, Musée Numismatique d’Athènes, Panepistimiou 12, GR-10671 Athènes. Courriel : [email protected].
** Professeur adjoint d’Archéologie Classique et de Numismatique, Département des Études Méditerranéennes, Université de l’Égée, 1 avenue de Democratias, GR-851 00 Rhodes. Courriel : [email protected].
1. Stefanaki 2007-2008.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS148
RN 2013, p. 147-174
A. Émissions à types locaux et pièces « pseudo-rhodiennes » (250-début du iie s.) : types, étalons, datation
Les monnaies d’argent frappées dans l’atelier gortynien entre la seconde moitié du iiie et le début du iie siècle se divisent en trois séries (I-III) (cf. catalogue).
Les pièces de la Série I comprennent deux émissions. Celles de la première portent au droit la tête laurée de Zeus à dr. ou à g. dans un cercle en grènetis et au revers, Europe sur le taureau qui nage à dr. et l’ethnique ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ, le tout dans un cercle en grènetis ou de rayons2 (figure 1).
Ces pièces, qui font partie d’un trésor trouvé à Gortyne en 1966 (IGCH 338), enfoui dans la seconde moitié du iie siècle ou dans les années 803, ont été émises après 250 av. J.-C. et probablement avant ou pendant la guerre de Lyttos (221-219 av. J.-C.). Elles sont plus légères que celles de la période avant 270 av. J.-C., frappées selon un étalon éginétique réduit (étalon crétois4). Leur poids s’échelonne entre 3,36-5,38 g. Cependant, le poids du plus grand nombre des exemplaires oscille entre 4,60-5,30 g (cf. tableau 15) et il s’agit de drachmes d’un étalon crétois réduit. Elles ont été contremarquées par Gortyne dans le dernier quart du iiie s. Les contremarques appliquées sur leur droit contiennent un taureau cornupète à dr. et parfois une tête féminine de face6, probablement celle d’Europe, et celles du revers la tête laurée d’Apollon à dr. ou celle de sa sœur Artémis à dr. portant un carquois à l’épaule7 (figures 2-3).
Les monnaies de la seconde émission portent au droit la tête laurée de Zeus à dr. et au revers un taureau cornupète à dr. et la légende ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ, le tout dans un cercle en grènetis8 (figure 4). Elles pèsent entre 2,01-2,37 g et il s’agit de trioboles d’un étalon crétois réduit.
D’après Raven9, suivi par Doyen10, les contremarques sur les drachmes de la Série I pourraient signifier que l’étalon en vigueur à Gortyne a été modifié à la fin du iiie siècle et ces monnaies étaient considérées comme des didrachmes de poids rhodien réduit.
2. Cf. SvoronoS 1890, p. 172, nos 114-118, pl. XV, nos 22-23.3. Sur la date de l’enfouissement du trésor cf. infra.4. Cf. Stefanaki 2007-2008, p. 50-51 et 60.5. Le poids des pièces gortyniennes présentées dans le tableau 1 a été établi à partir des publi-
cations, des catalogues de vente et des collections des principaux cabinets numismatiques. On voudrait également remercier Megan Campbell pour son aide précieuse dans la réalisation de cette étude métrologique. Il faut pourtant souligner que ce tableau des poids n’est pas exhaustif mais il est présenté à titre indicatif.
6. Cf. SvoronoS 1890, p. 172, no 118.7. Sur la contremarque au type d’Artémis cf. CNR, XIX.2, 1994 Second Quarter, Pennsylvania-
England, no 85 et künker, Auktion 136, 10/03/2008, Osnabrück, no 88.8. Cf. SvoronoS 1890, p. 173, no 119, pl. XV, no 24.9. Cf. JackSon 1971, p. 47, n. 1.10. Doyen 2007, p. 100-101.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 149
RN 2013, p. 147-174
Cependant, nous sommes d’un avis différent puisque l’étalon crétois réduit reste en vigueur dans les cités crétoises probablement jusque dans la première moitié du iie siècle.
Ainsi, Gortyne a remis en circulation les drachmes de la Série I pendant ou après la guerre de Lyttos11 pour des raisons inconnues (pénurie d’argent ?12) en utilisant la pratique de la contremarque, très courante dans le monde crétois, moins coûteuse et profitable pour l’État13. On rencontre également les types de ces contremarques (tête laurée d’Apollon et taureau cornupète) sur une série gorty-nienne de monnaies de bronze, émise dans le dernier quart iiie siècle av. J.-C.14, ce qui atteste une connexion entre l’émission de ces derniers et les contremarques des drachmes de la Série I.
La Série II comprend des pièces « pseudo-rhodiennes » qui portent au droit la tête de Méduse de 3/4 à dr. et au revers la rose, dans le champ à g. étoile à huit rayons, l’ethnique Ρ/Ο et le nom du monétaire ΓΟΡΓΟΣ, le tout dans un cercle en grène-tis (figure 5)15. Ces pièces datent probablement de la fin du iiie siècle-début du iie siècle av. J.-C. et font également partie du trésor IGCH 338 / Gortyne 1966 ainsi que du trésor IGCH 330 / Axos 196116, dont la date d’enfouissement se situe au début du ier siècle av. J.-C. La tête de Méduse constitue probablement un type parlant du nom du monétaire, Gorgos, dont le nom se rencontre également sur les monnaies rhodiennes officielles (didrachmes, drachmes et hémidrachmes) de la fin du iiie siècle-début du iie siècle et sur les drachmes « pseudo-rhodiennes » émises en Crète vers 200 av. J.-C. et en Grèce continentale pendant la période de la iiie Guerre de Macédoine17. Le poids de ces pièces oscille entre 3,16-4,95 g et celui du plus grand nombre des exemplaires entre 3,80-4,60 g (cf. tableau 1). Selon Ashton18, ce sont des didrachmes de poids rhodien réduit qui accompagnent les drachmes « pseudo-rhodiennes » (émissions semi-officielles et imitations) de Crète dont le poids s’échelonne entre 2 et 2,63 g. Il faut mentionner que le poids de
11. Cf. StefanakiS, traeger 2005, p. 388.12. On sait que vers 221 av. J.-C., Gortyne a également frappé des statères en or d’étalon attique.
Cette émission commémorative de son alliance avec Cnossos pendant la guerre de Lyttos, pourrait être liée à une pénurie d’argent ou plutôt à la paie des mercenaires.
13. Cf. Stefanaki 2007-2008, p. 53.14. Cf. JackSon 1971, p. 46-47, pl. 13, nos 8-16. Il faut mentionner qu’on rencontre les types de
la tête laurée d’Apollon et de celle d’Artémis portant un carquois à son épaule ainsi que du taureau cornupète sur une série de monnaies gortyniennes de bronze, émise d’après Jackson après 250 av. J.-C. et qui précède probablement les monnaies de la Série I (cf. JackSon 1971, p. 42 pl. 12, nos 5-8).
15. Cf. Price 1966, Class A, p. 136, nos 1-44 et aShton 1987, p. 29-30. Cf. également Wiemer 2002, p. 166.
16. Mis à part le didrachme de Gorgos à la tête de Méduse, le trésor contient 44 monnaies crétoises de bronze, 54 monnaies d’argent (1 tétrobole des Histiéens, 1 triobole de Corinthe, 2 trioboles de Sicyone, 43 trioboles de la Ligue Achéenne) et 6 drachmes rhodiennes et/ou « pseudo-rhodiennes » (cf. aPoStolou 1999, p. 219-221 et ead 2002, p. 153, no 89 ; StefanakiS, Stefanaki 2008, p.177, tableau 3).
17. Cf. aShton 1987, p. 30, no 2 ; id. 2002, p. 71 et 77-78.18. AShton 1987, p. 30. Cf. aussi Wiemer 2002, p. 167 et Stefanaki 2007-2008, p. 55.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS150
RN 2013, p. 147-174
SÉRIE I SÉRIE IISÉRIE IVÉmission 1Groupe A
SÉRIE IVÉmission 1Groupe B
SÉRIE IVÉmission 2
SÉRIE VÉmission 2Groupe A
SÉRIE VÉmission 2Groupe B
SÉRIE VÉmission 2Groupe C
SÉRIE V Émission 3
PRICE 1966 PRICE 1966 PRICE 1966
5,30-5,40 xx
5,20-5,30 xxxxx
5,10-5,20 xx
5,00-5,10 xxxxxxxxxxx
4,90-5,00 xxxxxxxxxxxxxx x
4,80-4,90 xxxxxxx
4,70-4,80 xxxx xx x
4,60-4,70 xxxx xx x x
4,50-4,60 x xxxx xxxxx
4,40-4,50 xxxxxxx x
4,30-4,40 xxx xxxx x xx
4,20-4,30 xxxx x x xxx
4,10-4,20 xxxx x x xxxx x
4,00-4,10 xxxx xxxxx x x xxx
3,90-4,00 x xx xx xx x xxxx
3,80-3,90 xxxxx xxxxx xxx x x xxxx x
3,70-3,80 x xxx xxxx xxxx x xxxxx x
3,60-3,70 xx x x xxx x
3,50-3,60 xx x x x x
3,40-3,50 xx xxxxx x xxxxx x x
3,30-3,40 x xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3,20-3,30 x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x
3,10-3,20 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
3,00-3,10 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2,90-3,00 xxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
2,80-2,90 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
2,70-2,80 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
2,60-2,70 x xxxxx x x
2,50-2,60 x x xx x
2,40-2,50 xxx x
2,30-2,40 x
Tableau 1 - Le poids des didrachmes « pseudo-rhodiens » et des drachmes gortyniennes entre la seconde moitié du iiie et le premier quart du ier siècle av. J.-C.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 151
RN 2013, p. 147-174
SÉRIE I SÉRIE IISÉRIE IVÉmission 1Groupe A
SÉRIE IVÉmission 1Groupe B
SÉRIE IVÉmission 2
SÉRIE VÉmission 2Groupe A
SÉRIE VÉmission 2Groupe B
SÉRIE VÉmission 2Groupe C
SÉRIE V Émission 3
PRICE 1966 PRICE 1966 PRICE 1966
5,30-5,40 xx
5,20-5,30 xxxxx
5,10-5,20 xx
5,00-5,10 xxxxxxxxxxx
4,90-5,00 xxxxxxxxxxxxxx x
4,80-4,90 xxxxxxx
4,70-4,80 xxxx xx x
4,60-4,70 xxxx xx x x
4,50-4,60 x xxxx xxxxx
4,40-4,50 xxxxxxx x
4,30-4,40 xxx xxxx x xx
4,20-4,30 xxxx x x xxx
4,10-4,20 xxxx x x xxxx x
4,00-4,10 xxxx xxxxx x x xxx
3,90-4,00 x xx xx xx x xxxx
3,80-3,90 xxxxx xxxxx xxx x x xxxx x
3,70-3,80 x xxx xxxx xxxx x xxxxx x
3,60-3,70 xx x x xxx x
3,50-3,60 xx x x x x
3,40-3,50 xx xxxxx x xxxxx x x
3,30-3,40 x xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3,20-3,30 x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x
3,10-3,20 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
3,00-3,10 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2,90-3,00 xxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
2,80-2,90 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
2,70-2,80 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
2,60-2,70 x xxxxx x x
2,50-2,60 x x xx x
2,40-2,50 xxx x
2,30-2,40 x
Tableau 1 - Le poids des didrachmes « pseudo-rhodiens » et des drachmes gortyniennes entre la seconde moitié du iiie et le premier quart du ier siècle av. J.-C.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS152
RN 2013, p. 147-174
ces dernières est réduit par rapport à celui des drachmes « pseudo-rhodiennes » émises en Grèce continentale, en Asie Mineure occidentale et dans certaines îles égéennes. Les didrachmes de Gorgos ont probablement été émis dans l’atelier de Gortyne, étant donné l’occurrence du type de la Méduse sur les pièces civiques gortyniennes de la Série III et leur présence dans le trésor IGCH 338 / Gortyne 1966. Ces pièces ont été contremarqués avec une protomé de Niké à dr., proba-blement au début du iie siècle19, par l’atelier de Gortyne20 (figure 5).
Il faut mentionner que les pièces « pseudo-rhodiennes » (didrachmes et drachmes) émises en Crète sont des émissions rhodiennes semi-officielles. Ces émissions altérées d’urgence étaient destinées à couvrir des dépenses militaires imprévues et acceptées dans certaines cités de Crète centrale et orientale où elles étaient utili-sées dans les transactions régionales21.
Ainsi, selon Barrandon et Bresson22, « les contremarques à la Niké systémati-quement apposées sur ces didrachmes « pseudo-rhodiens » pourraient donc l’avoir été en réalité sur des monnaies locales, sans doute pour leur donner une valeur légale supérieure à celle qu’on avait prévu initialement de leur donner en fonction de leur valeur en argent ». Doyen23 est d’avis que les pièces de Gorgos ont été contremarquées afin d’être acceptées comme des didrachmes d’étalon rhodien réduit étant donné leur poids réduit et leur aloi altéré. Cependant, Hackens24 pense, probablement avec raison, que les didrachmes de Gorgos ont été contremarqués afin de pouvoir passer en Crète comme des drachmes d’un étalon crétois réduit puisqu’« elles étaient trop légères pour être considérées comme telles ». Toutefois, leur poids correspond parfaitement à celui des drachmes d’un étalon crétois réduit émises par les cités crétoises, surtout en Crète occidentale, au début du iie siècle av. J.-C., dont le poids du plus grand nombre des exemplaires s’échelonne entre (3,80) 4,00 et 4,80 (4,90) g25. Il en est de même pour les drachmes « pseudo-rhodiennes » émises sur l’île dont le poids correspond à celui des hémidrachmes d’un étalon crétois réduit26. Ainsi, on pourrait se demander si cette réduction du poids des pièces « pseudo-rhodiennes » de Crète n’était pas un choix hasardeux,
19. Il apparait que les didrachmes de Gorgos n’étaient pas très usés au moment de leur contre-marque, ce qui indique que le laps de temps entre l’émission et la contremarque était court.
20. La contremarque à la Niké a été attribuée à Gortyne étant donné le grand nombre de pièces contremarquées de Gorgos trouvées sur son territoire (cf. Price 1966, p. 129). Cependant, il a été aussi formulé l’avis (cf. StefanakiS, traeger 2005, p. 390, n. 58 et StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 175) que cette contremarque à la protomé de Niké pourrait avoir été appliquée par kydonia étant donné l’occurrence du type de Niké sur son monnayage de bronze (cf. SvoronoS 1890, p. 106, nos 58, 41, pl. IX). On pourrait également supposer que le choix de la tête de Niké était symbolique et pourrait renvoyer à la fin de la mainmise de Rhodes sur les affaires crétoises.
21. Cf. Wiemer 2002, p. 168 et StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 182.22. BarranDon, BreSSon 1997, p. 152.23. Doyen 2007, p. 100-101.24. hackenS 1970, p. 45-46.25. Cf. infra StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 173, tableau 2.26. Cf. StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 173, tableau 2.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 153
RN 2013, p. 147-174
si l’on considère que les dits « didrachmes » d’un poids rhodien réduit de Gorgos correspondent à une dénomination « pseudo-rhodienne » qu’on rencontre, d’après les données actuelles, uniquement en Crète.
Les pièces gortyniennes de la Série III datées du début du iie siècle av. J.-C. reprennent à leur droit le type de la Méduse de 3/4 à dr. ou à g. des didrachmes « pseudo-rhodiens » signés de Gorgos de la Série II et au revers, l’aigle aux ailes éployées à dr. ou à g. debout sur un foudre ou combattant un serpent qu’il tient, la légende abrégée ΓΟΡΤΥΝ ou ΓΟ, le tout dans un cercle de grènetis ou de rayons (figure 6)27. Les trioboles de Gortyne de la Série III, dont certains utilisent comme flans des trioboles gortyniens de la Série I de la période précédente, sont toujours frappées selon un étalon crétois réduit. Leur poids s’échelonne entre 1,88-2,50 g.
Il est vrai que le poids des pièces civiques à la Méduse de la Série III correspond au poids des drachmes « pseudo-rhodiennes » de Crète et elles pourraient donc avoir été émises afin d’accompagner les didrachmes de Gorgos. Dans ce cas, on pourrait les considérer comme des drachmes suivant l’étalon rhodien des pièces « pseudo-rhodiennes » crétoises. En outre, l’imitation du type de la Méduse des pièces de Gorgos par l’atelier gortynien pour la frappe des pièces de la Série III pourrait signifier leur emploi local à des fins militaires28. On pourrait également supposer que la contremarque à la tête de Niké des pièces de Gorgos, appliquée probable-ment par l’atelier gortynien afin de leur donner la valeur nominale d’une drachme d’un étalon crétois réduit, ainsi que la surfrappe des trioboles de la Série I, sont contemporaines. Dans ce cas, les pièces civiques à la Méduse accompagnent les didrachmes contremarqués de Gorgos en tant que trioboles.
B. Émissions d’un étalon crétois réduit des cités de la Crète occidentale et centrale
Entre 280/270 et le premier quart du iie siècle av. J.-C., de nombreuses cités crétoises, surtout en Crète occidentale et en Crète centrale, se mettent à frapper des didrachmes, des drachmes, des trioboles et des fractions d’un étalon crétois réduit29.
En Crète occidentale, Polyrrhénia a frappé des didrachmes (9,47-9,75 g)30 après 270 av. J.-C. et des hémidrachmes (2,37 g)31 dans le premier quart du iie siècle av. J.-C.32, dont le poids correspond à celui des hémidrachmes gorty-niens des Séries I et III.
27. Cf. SvoronoS 1890, p. 174, nos 132-134, pl. XVI, nos 1-3 et Price 1966, p. 129, no 1.28. Cf. StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 182-183.29. Cf. StefanakiS 1997, p. 148-153 et 236-240.30. Cf. G. Hirsch, Auktion 199, 6-8/05/1998, München, no 127 et New York, ANS, 1984.66.12.31. Cf. SNG Cop., Argolis-Aegean Islands, pl. 11, no 537 (pour la frappe de cet hémidrachme
a été utilisé comme flan une drachme pseudo-rhodienne au nom d’Ainétor, cf. AShton 1987, p. 31, no 6A, pl. A, no 14 et id. 2001, p. 110, no 339).
32. Cf. StefanakiS, sous presse.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS154
RN 2013, p. 147-174
Kydonia a également réduit le poids de ses didrachmes (± 9,33 g) (« Diktynna » series reduced)33 entre 280/270 et 260/250 av. J.-C. Au début du iie siècle av. J.-C. elle revient à la frappe des statères34 et des hémidrachmes35 selon un étalon crétois36. Cependant le poids des drachmes émises pendant cette période est réduit (3,98-5,15 g)37 et correspond à celui des drachmes gortyniennes de la Série I38.
Les trois séries monétaires suivantes de Kydonia, dites « pseudo-incuse » series, « Pan » series et « crescent » series, émises dans le premier quart du iie siècle av. J.-C., comprennent d’après M. I. Stefanakis39, des pièces de petites dénominations frappées selon un étalon crétois réduit. La première comprend des hémidrachmes (2,18 g) et des dioboles (1,20-1,80 g), la deuxième des trihémioboles (1,16-1,49 g) et la troisième des dioboles (1,32 g) et des trihémioboles (0,71-1,15 g) d’un poids un peu plus réduit que celui des émissions précédentes, ainsi que des oboles (0,55-0,97 g) et des hémioboles (0,50 g).
Cependant, d’après Doyen40, les dioboles et les trihémioboles de deux premières séries sont des hémidrachmes d’étalon rhodien : la première suit le poids plein et la seconde le poids réduit. En outre, les monnaies identifiées comme des oboles d’un poids crétois réduit seraient des dioboles rhodiens. Il faut mentionner que kydonia a également frappé des didrachmes (8,38/9,04-9,59 g) et des drachmes (3,30/4-4,58 g) d’un étalon crétois réduit entre 189 et 184 av. J.-C.41.
tanos a frappé des trihémioboles (0,92-1,07 g) et des oboles (0,50-0,80 g) du même poids que ceux de kydonia, en utilisant également le même type des trois croissants au revers et parfois les mêmes coins de droit42. Allaria43 et kéraia44 ont également frappé des drachmes d’un poids moyen entre 4,43 et 4,47 g au début du iie siècle av. J.-C. Pendant la même période Aptéra45 a émis des didrachmes dont le poids s’échelonne entre 9,01 et 9,30 g.
En Crète centrale, les cités d’Eleutherna et de Chersonèsos ont également utilisé l’étalon crétois réduit entre 280/70 et le début du iie siècle pour la frappe de leurs didrachmes.
33. Cf. StefanakiS 1997, p. 217.34. Cf. SvoronoS 1890, p. 104, no 37, pl. IX, no 23.35. Cf. le riDer 1966, p. 266, no 4.36. Cf. StefanakiS 1997, p. 167-216.37. Cf. SvoronoS 1890, p. 104, no 38 et StefanakiS 1997, p. 218-219. Pour les raisons de
ce retour à l’étalon crétois (afflux d’argent monnayé sur l’île ?) cf. StefanakiS 1997, p. 213-216.38. Pour le monnayage de kydonia de cette période cf. StefanakiS 1997, ch. 5, « infant » series,
Group I et « incuse » series.39. StefanakiS 1997, ch. 6 et id. 2002, p. 234 et 240-242. Cf. également Seager 1924, p. 11-16.40. Cf. Doyen 2007, p. 101.41. Cf. StefanakiS 1997, ch. 6, « infant » series, Group II et SvoronoS 1890, p. 104, nos 39, 41-42,
pl. IX, nos 24-26.42. Cf. StefanakiS 2002, p. 234.43. Cf. SvoronoS 1890, p. 2, nos 1-3, pl. I, nos 1-2.44. Cf. SvoronoS 1890, p. 45, nos 1-2, pl. IV, nos 16-17 et StefanakiS, sous presse, Appendice 1Γ.45. Cf. SvoronoS 1890, p. 20, no 39, pl. II, no 1.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 155
RN 2013, p. 147-174
On connaît trois exemplaires46 de l’émission d’Eleutherna qui pèsent entre 9,49 et 9,59 g, dont l’un a été contremarqué par Aptéra47. Cependant, on ne sait pas s’ils datent de la période entre 280/70 et 260/50 av. J.-C. ou du début du iie siècle av. J.-C. Ces didrachmes étaient pourtant accompagnés de drachmes48 d’un étalon crétois et il est plus probable qu’ils datent du deuxième quart du iiie siècle.
Un didrachme de Chersonèsos, qui fait partie du trésor IGCH 109 / Charakas 1963, enfoui vers 280/70 av. J.-C., a comme types la tête d’Athéna au droit et Apollon citharède assis sur l’omphalos au revers et il pèse 8,25 g. Cependant, il est possible que cette pièce date du début du iie siècle av. J.-C.49, étant donné son poids réduit ainsi que la ressemblance de la tête d’Athéna avec celle qui figure sur les drachmes de kydonia émises selon l’étalon crétois réduit.
On remarque qu’il y a une grande proximité de poids entre drachmes « pseudo-rhodiennes » émises en Crète, hémidrachmes et dioboles d’un étalon rhodien et rhodien réduit et hémidrachmes, dioboles et trihémioboles d’un étalon crétois réduit. Les émissions crétoises du début du iie siècle sont probablement à mettre en rapport avec la frappe dans l’île de didrachmes et drachmes « pseudo-rhodiens », qui a contraint les cités à s’adapter à une situation nouvelle des échanges monétaires mais sans que cela implique l’adoption d’un étalon rhodien.
La frappe par les cités crétoises entre 280/270 et le premier quart du iie siècle de didrachmes et de drachmes d’un poids moyen autour de 9,30-9,60 g et de (4,30) 4,50-4,80 (4,90) g atteste plutôt l’emploi d’un étalon crétois réduit. En outre, la surfrappe d’hémidrachmes rhodiens de poids réduit par l’atelier de kydonia (IGCH 254=CH VII 104 / trésor de Chania 192250) et le grand nombre de contre-marques qu’on trouve sur les drachmes « pseudo-rhodiennes » émises en Crète51, probablement afin de « re-issue the coins of foreign Rhodian types as local hemi-drachms »52 et de légitimer leur utilisation et circulation, attestent surtout la réticence des Crétois à accepter les types rhodiens et non un problème d’alignement avec l’étalon rhodien53.
Ainsi, selon nous, l’influence rhodienne sur le monnayage gortynien entre la fin du iiie et le début du iie siècle se limite à l’adoption du type de la Méduse des monnaies « pseudo-rhodiennes » de Gorgos pour son émission des trioboles civiques de la Série III. En outre, il est possible que la tête ailée qui figure au droit des
46. Cf. StefanakiS 1997, p. 239, pl. 21, no 394 et Stefanaki, Stratiki 2007-2008, p. 103, no 13.47. Cf. JenkinS 1949, p. 45, no 43a, pl. VI.48. Cf. SvoronoS 1890, p. 134, no 33, pl. XII, no 2.49. Cf. Stefanaki 2007-2008, p. 56, n. 88.50. Sur le trésor cf. Seager 1924 et StefanakiS 2002.51. Cf. StefanakiS, traeger 2005, p. 389-390 ; StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 172 et 175.52. Cf. StefanakiS 1997, p. 199-200.53. Cf. StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 181.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS156
RN 2013, p. 147-174
hémidrachmes de Polyrrhénia imite également la tête de Méduse des didrachmes « pseudo-rhodiens » de Gorgos (Série II) et celle qui figure sur les hémidrachmes gortyniens de la Série III54.
C. Les pièces gortyniennes aux types de Minos (ou de Zeus) / Guerrier debout ou Apollon assis : types, étalon, datation
Les drachmes gortyniennes suivantes, dont l’étalon et la datation sont égale-ment controversés, appartiennent à deux séries (Séries IV et V) selon le type de leur revers et elles ont été divisées en quatre émissions selon la position de la tête de Minos ou de Zeus qui figure au droit (cf. Catalogue).
Les pièces de la première émission (Série IV) portent au droit une tête masculine barbue et diadémée à g., probablement celle du roi légendaire, Minos55, et au revers l’ethnique ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ, un héros guerrier, debout de face, sur un foudre ou une ligne d’exergue. De la main g. il tient une lance transversale et sa main dr. est appuyée sur un bouclier, posé à terre. Sur certains exemplaires, dans le champ à g. figure une couronne. Le tout dans un cercle de rayons ou de grènetis.
Ces pièces qui se divisent en deux groupes selon la présence (Groupe A) (figure 7) ou l’absence (Groupe B) (figure 8) du symbole de la couronne, offrent de grandes variations de poids, de (2,34) 2,50 à 4,63 g. Les pièces du Groupe A pèsent entre (3,30) 3,50 et 4,55 g et le poids du plus grand nombre des pièces du Groupe B s’échelonne entre 2,70 et 3,90 g. Cependant, on a enregistré un petit nombre de pièces appartenant au Groupe B dont le poids dépasse les 4 g56 (cf. tableau 1).
Les pièces de la deuxième émission de la Série IV portent les mêmes types que celles de la première mais elles se distinguent de celles-ci par la position de la tête de Minos à dr. En outre, les pièces de cette émission portent souvent des lettres (A, Β, Γ, Δ, Η) au droit, au-dessous de la tête de Minos et/ou au revers (A, Β, Δ, Θ) dans le champ ou à l’exergue (figures 9-10). Selon Price57, ces lettres, utilisées pour le contrôle administratif, correspondent à des années. Les poids de ces pièces vont de 2,50 à 3,60 (4,0358) g. Cependant, le poids du plus grand nombre des exemplaires s’échelonne entre 3,00 et 3,30 g (cf. tableau 1).
54. Cf. StefanakiS, sous presse.55. Cf. le riDer 1966, p. 271, n. 1 et hackenS 1970, p. 39, n. 3.56. Cf. forum Ancient Coins, E-auction (4,16 g) ; Hauck und Aufhäuser, Auktion 18, 5-6/10/2004,
München, no 119 (4,27 g) (figure 8) ; CNG, E-auction 129, 21/12/2005, no 112 (4,38 g) ; Jacquier, List 16, fall 1994, kelh am Rhein, no 85 (4,63 g).
57. Cf. Price 1966, p. 130.58. Cf. künker, Auktion 94, 27-28/09/2004, Osnabrück, no 894 (4,03 g) (fig. 10).
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 157
RN 2013, p. 147-174
Les pièces de la deuxième émission de la Série V portent au droit la tête diadémée59 de Minos à dr., comme les pièces de la deuxième émission de la Série IV, et au revers la légende ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ et Apollon nu, assis sur un rocher à g. Il porte à l’épaule le carquois et dans la main g., l’arc. La main dr. repose sur le genou. Le tout dans un cercle de grènetis. Les pièces de cette émission se divisent en trois groupes. Les pièces du Groupe A (figures 11-12) portent au droit les lettres Α, Β, Γ, Δ, Ε, F (digamma), Z, H et parfois au revers les lettres A, Β, Γ, Δ, ΔΑ, Ε, F, Ζ. À ce groupe appartiennent également des pièces qui portent au revers le nom du magistrat monétaire ΠΑΡ et dans le champ à g. les lettres ΔΑ60 (figure 13). Le plus grand nombre des exemplaires du Groupe B portent au droit les lettres Γ ou Δ et au revers le nom du magistrat monétaire Θίβος (figures 1461, 1562) et du Groupe C portent au revers la lettre B (figure 16). Les poids des pièces appartenant au Groupe A vont de 2,50 à 3,70 (4,2063) g. Cependant le poids du plus grand nombre des exemplaires de ce groupe s’éche-lonne entre 3,00 et 3,30 g. Les poids des pièces du Groupe B vont de 3,49 à 3,83 (4,0464) g et ceux du Groupe C de (3,28) 3,70 à 4,45 g (cf. tableau 1).
Les pièces de la troisième émission de la Série V portent le même type de revers que les pièces de l’émission précédente mais le cercle de grènetis a été remplacé par un cercle de rayons. En outre, elles portent au droit la tête laurée de Zeus à g. Sur sept exemplaires de cette émission, figure au droit la lettre Γ (?) et au revers, figurent parfois les lettres Γ ou Δ (figures 17-19). Le poids dispersé des pièces appartenant à cette émission s’échelonne entre 3,10 et 4,71 g65 (cf. tableau 1).
59. Il faut mentionner que sur certaines pièces le diadème ne figure pas. Cf. SvoronoS 1890, p. 178-179, nos 175-176, pl. XVI, no 20 et Price 1966, p. 139, nos 160-172, pl. XII, nos 2-3.
60. Cf. HackenS 1970, p. 41, nos 44-50 et Winterthur I, p. 212, no 2274, pl. 100 (fig. 13).61. La lettre qui apparaît au droit et probablement au revers de la pièce de Thibos qui figure dans
le catalogue de vente künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 114 (fig. 14) est difficile à identifier.
62. La pièce qui figure dans le catalogue de vente Bankhaus Aufhäuser, Auktion 11, 21-22/03/1995, München, no 53 (4,04 g) (fig. 15), appartient au Groupe B de la deuxième émission de la Série V et partage le même coin de droit que certaines pièces de Thibos. Au droit figure la lettre Γ et au revers la lettre E. Cependant le nom du magistrat est illisible.
63. Cf. Banque Populaire du Nord, Numismatique liste 26, 12/1982, Marcq-en-Barœul, no 120.64. Cf. Le riDer 1966, p. 300, n. 3 et op. cit. n. 62.65. Cf. Sternberg, Auktion XXVIII, 7-8/11/1994, Zürich, no 162 (4,64 g) (au revers, Γ) ;
kovacs, fPL 27, Spring 1994, San Mateo, no 19 (4,71 g) (sans lettre au revers) (fig. 17) ; Spink’s, NumCirc., 07-08/1977, London, no 6477 (= Glendining’s, 05/1959, London, no 2036 = SNG Lockett III, pl. XLV, no 2563) (3,10 g) (au revers, Δ) (fig. 18) ; Künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 112 (3,74 g) (au revers, Γ) (fig. 19) ; G. Hirsch, Auktion 194, 19-22/02/1997, München, no 189 (3,42 g) (au revers, Δ) ; D. Thirion, Liste d’Hiver 1993-1994, Bruxelles, no 17 (3,81 g) (au revers, lettre ?) ; HackenS 1970, p. 39, no 10, pl. I (3,29 g) (au revers, lettre ?) et Price 1966, p. 133, Cameron Coll. (4,19 g) (non vidi). Mis à part ce dernier exemplaire, il faut mentionner que toutes les autres pièces de cette émission partagent le même coin de droit.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS158
RN 2013, p. 147-174
Les pièces de la première et de la deuxième émission de la Série IV (Class D et C d’après la classification de Price)66 ainsi que celles appartenant au Groupe A de la deuxième émission (Class E d’après la classification de Price)67 et à la troi-sième émission68 de la Série V, font partie du trésor IGCH 338 / Gortyne 1966, trouvé dans un pot en bronze à Haghioi Dheka69.
Le grand nombre de pièces gortyniennes de la Série IV et V, 114 et 215 respec-tivement, contenues dans le trésor a été le point de départ à l’étude de leur datation et des étalons utilisés dans la cité aux iie et ier siècles.
a. Un étalon rhodien, attique et attique réduit
D’après Price70, les pièces du trésor de Gortyne appartenant à la première (Groupe B) et à la deuxième émission de la Série IV ainsi que celles appartenant à la deuxième émission (Groupe A) de la Série V, dont le poids se situe entre 2,50 et 3,50 g (cf. tableau 1) sont des drachmes frappées selon l’étalon rhodien, utilisé par Rhodes pour ses plinthophores, dans lequel la drachme pèse autour de 3,05 g71 ou cistophorique, dans lequel le poids théorique de la drachme serait autour de 3,15 g72.
Selon Price73, les drachmes gortyniennes de la deuxième émission de la Série IV et du Groupe A de la deuxième émission de la Série V (Class C et E d’après sa classification) auraient été frappées par l’atelier gortynien d’une manière contem-poraine, étant donné leur usure relative dans le trésor de Gortyne ce qui indiquerait une activité parallèle des graveurs de coins, puisque ces séries s’avèrent très proches l’une de l’autre par l’usage des lettres et par le style.
Cependant, comme Price l’avait déjà noté, il existe des pièces, appartenant au Groupe A de la première émission de la Série IV, dont le poids dépasse les 4 g (cf. tableau 1). Selon Price74, ces pièces sont des drachmes et correspondent aux dernières émissions de la Série IV, frappées selon l’étalon attique. En outre, certaines pièces de la Série V et spécialement celles de la deuxième (Groupes B et C) et de la troisième émission ont une séquence différente de coins et un poids
66. Cf. Price 1966 et HackenS 1970, nos 11-22.67. Cf. Price 1966 et hackenS 1970, nos 23-55.68. Cf. HackenS 1970, no 10.69. Price fit connaître 329 exemplaires qu’il avait vus à Londres et Hackens en a ajouté 56 faisant
partie de collections privées à Athènes (cf. aussi Wiemer 2002, p. 166). À ce lot de 56 pièces appartiennent probablement les sept exemplaires du trésor de Crète 1970-1971 (cf. touratSoglou 1995, p. 25) : un didrachme pseudo-rhodien de Gorgos et six drachmes gortyniennes appartenant à la première (Groupe A) et à la deuxième émission de la Série IV ainsi qu’au Groupe A de la deuxième émission de la Série V.
70. Price 1966, p. 132.71. Cf. JenkinS 1989, p. 115.72. Cf. mørkholm 1991, p. 9.73. Price 1966, p. 132.74. Cf. Price 1966, p. 133.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 159
RN 2013, p. 147-174
plus élevé. Selon Price les pièces légères de la troisième émission appartiennent au Groupe A de la deuxième émission d’un étalon rhodien et les pièces lourdes précédent les pièces des Groupes B et C de la deuxième émission d’un étalon attique réduit et attique. À cette émission appartiennent, comme on vient de le men-tionner, les émissions gortyniennes au nom de Θίβος (Groupe B), frappées selon un étalon attique réduit que Price75 date des années 83 et 82 av. J.-C., c’est-à-dire après l’émission des tétradrachmes « pseudo-athéniens » (cf. catalogue, Série VI) (figure 21), car elles sont absentes du trésor de Gortyne.
Ainsi, d’après Price, Gortyne passe à l’étalon rhodien au début du ier siècle, avant l’adoption d’un étalon attique et attique réduit. Selon lui, le trésor de Gortyne aurait été enfoui avant le changement d’étalon puisqu’il ne contient aucune mon-naie lourde76. Le changement de l’étalon daterait, selon Price, de l’année 85.
Hackens suit Price en ce qui concerne l’influence rhodienne sur l’étalon utilisé par Gortyne pour la frappe des émissions de la Série IV et de la deuxième (Groupe A) et la troisième émission de la Série V77 : « l’étalon suivi pour la frappe de ces pièces semble bien être celui de la drachme rhodienne, les sommets de fréquence se situent vers 3,20-3,30 g pour des exemplaires qui n’ont pas ou presque pas circulé dans la plupart des cas ». Il est également d’accord avec Price et Le Rider sur l’utilisation d’un étalon attique réduit et attique pour la frappe des pièces des Groupes B et C de la deuxième émission de la Série V.
Cependant, comme le souligne Hackens, en suivant Le Rider, neuf cités cré-toises (Polyrrhénia, kydonia, Axos, Cnossos, Gortyne, Arkadès, Lyttos, Latô et Hiérapytna) ont utilisé pour la frappe de leur monnayage d’argent les étalons attique et attique réduit entre 110 et 69/67 av. J.-C. et donc bien avant les années 8078.
Ainsi, on distingue deux étalons dans les monnayages à types locaux de Gortyne, Cnossos et Hiérapytna : l’étalon attique vers la fin du iie siècle av. J.-C., comme Lyttos et Arkadès, et l’étalon attique réduit pendant la première moitié du ier siècle av. J.-C., comme Polyrrhénia, kydonia, Axos et Latô79. Par la suite sept cités crétoises (Polyrrhénia, kydonia, Lappa, Cnossos, Gortyne, Priansos et Hiérapytna) reviennent à l’étalon attique vers 87/86 av. J.-C. pour la frappe des tétradrachmes « pseudo-athéniens80 » et l’étalon attique a également été employé par Métellus à Gortyne pour la frappe des tétradrachmes81.
75. Price 1966, p. 134-135.76. Cependant, comme on vient de le mentionner (cf. op. cit. n. 69), il est possible que le trésor de
Gortyne contienne une pièce lourde appartenant au Groupe A de la première émission de la Série IV.77. hackenS 1970, p. 53 et 56.78. D’après les sources épigraphiques, on sait que la plupart des cités crétoises, même avant
la frappe de leur monnayage local suivant un étalon attique et attique réduit entre 110 et 69/67 av. J.-C., utilisaient dès la seconde moitié du iie siècle av. J.-C., l’étalon attique comme système pondéral de référence (cf. Stefanaki 2007-2008, p. 60-63).
79. Cf. Stefanaki 2006, p. 305-306 ; ead 2007-2008, p. 57 et 80, tableau 3.80. Cf. le riDer 1968.81. Cf. MeteniDiS 1997.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS160
RN 2013, p. 147-174
Les drachmes de Θίβος, qui appartiennent, selon Price, aux dernières émissions de la Série V, offrent des poids réguliers entre 3,49 g et 3,83 (4,0482) g (cf. tableau 1) et elles ont été frappées selon un étalon attique réduit, comme les tétradrachmes contemporains de la première émission de la Série V (cf. catalogue) au nom de Θίβος (figure 20), dont le poids se situe entre 14,34-15,83 g.
Le poids des drachmes de Θίβος correspond à celui des drachmes d’Hiérapytna (3,06-3,70 g) frappées après 100 av. J.-C. Latô a elle aussi émis des drachmes « stéphanéphores » pendant la première moitié du ier siècle av. J.-C., aux types de la tête d’Artémis au droit et d’Hermès debout tenant un caducée au revers, qui pèsent environ 3,70 g83. Enfin, Kydonia84 et Axos85 ont émis des tétroboles dont le poids moyen est 2,30-2,40 g, tandis que Polyrrhénia a émis des hémidrachmes aux types du buste d’Artémis de face, au droit et d’Apollon debout, tenant une flèche et un arc, au revers, dont le poids oscille entre 1,15 et 2,11 g avec un poids moyen d’environ 1,63 g86. Ces monnaies ont été frappées selon un étalon attique réduit et le début de leurs émissions se situe donc après 100 av. J.-C. Il faut égale-ment mentionner deux petites pièces d’argent de Lyttos (hémidrachmes de poids attique ?), probablement frappées à la fin du iie siècle, dont l’une est peut-être surfrappée sur une monnaie de la Ligue Achéenne87.
b. La datation
À part les drachmes gortyniennes de la Série IV et V, le trésor de Gortyne contenait, comme on vient de le mentionner, trois drachmes gortyniennes contre-marquées de la Série I (Class B d’après la classification de Price) et 52 didrachmes « pseudo-rhodiens » au nom de Gorgos de la Série II (Class A d’après la classifica-tion de Price), dont le plus grand nombre est contremarqué, ainsi qu’une drachme « pseudo-rhodienne » au nom d’Ainétor88, frappée en Crète entre la fin du iiie siècle et le début du iie siècle av. J.-C.89.
Price, en étudiant le contenu du trésor, a remarqué que les pièces de la Série I étaient très usées par rapport aux autres pièces du trésor qui présentent moins d’usure. D’après lui90, le trésor de Gortyne n’était pas un trésor d’accumulation puisque « the coins of Class A, with their varying weights are not the type of money to be hoarded for their purity ». Cependant, malgré cette constatation, Price date les pièces du trésor qui appartiennent aux Séries I et II entre le iiie et le iie siècle,
82. Cf. op. cit. n. 64.83. Cf. PicarD 1990, p. 108-110 et StefanakiS 1997, p. 243, n. 2.84. Cf. StefanakiS 1997, p. 245-246 et p. 254, tableau 7.2.85. Cf. SvoronoS 1890, 40, nos 32-33, pl. III, no 10 et SiDiroPouloS 2006, 158-159.86. Cf. SvoronoS 1890, no 43, p. 282 et no 22, pl. XXVI et StefanakiS, sous presse.87. Cf. le riDer 1966, p. 302, n. 4.88. Cf. HackenS 1970, p. 37-38, no 1.89. Cf. aShton 1987, p. 31-32, Issue 6A.90. Price 1966, p. 132.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 161
RN 2013, p. 147-174
mais sans fixer la chronologie des pièces de Gorgos d’une manière explicite, tandis qu’il date celles appartenant aux Séries IV et V entre 94 et 87/86 av. J.-C. Ainsi, selon ce dernier spécialiste, le trésor de Gortyne (IGCH 338) a été enfoui vers 87-85 av. J.-C.
Hackens, suivi par Apostolou91, pense qu’il faut remonter la date d’enfouisse-ment du trésor de Gortyne, puisque le trésor ne contient aucune drachme lourde de poids attique et attique réduit92, en comparaison avec la série légère, d’étalon rhodien, qui la précède et de cette façon on raccourcit quelque peu l’écart qui sépare les pièces de Gorgos à la tête de Méduse, même contremarquées, et la pièce d’Ainétor, frappées vers 200 av. J.-C., des monnaies de Gortyne93. En outre, les monnaies de la Série IV et celles de la troisième émission de la Série V sont assez liées aux drachmes et hémidrachmes gortyniens de la Séries I et III, puisque, comme eux, ces pièces portent au revers un cercle de rayons au lieu de grènetis94. Ainsi, le laps de temps qui intervient entre la frappe des pièces de Gorgos, ainsi que des hémidrachmes gortyniens à la tête de Méduse de la Série III, émis entre la fin du iiie siècle et le début du iie siècle av. J.-C., et celle des émissions de la Série IV et de la troisième émission de la Série V serait court. En conséquence, selon Hackens, les émissions gortyniennes qui suivent un étalon rhodien datent du iie siècle av. J.-C., tandis que celles qui suivent un étalon attique et attique réduit après 110 av. J.-C. En outre, grâce aux analyses de métal sur deux exemplaires du Groupe A de la deuxième émission de la Série V, Barrandon et Bresson95 soutien-nent que ces pièces ne datent certainement pas de la fin du iie siècle ou du début du ier siècle av. J.-C. comme l’avait pensé Price, étant donné que leur pureté en argent ne paraît pas avoir différé du commun des pièces d’argent en circulation à la fin du iiie siècle et au début du iie siècle av. J.-C. Cependant, il faut souligner que le métal des pièces des Séries II et III, frappées entre la fin du iiie siècle et le début du iie siècle av. J.-C., pourrait avoir été réutilisé même un siècle plus tard pour la frappe des pièces de la Séries IV et V.
Mis à part le trésor IGCH 338 / Gortyne 1966, il faut mentionner que des pièces gortyniennes appartenant au Groupe B de la première émission de la Série IV et au Groupe A de la deuxième émission de la Série V font partie du trésor d’Hiérapytna 1933/4 (IGCH 352 = CH II 125 = CH IV 76 = CH X 185), enfoui dans les années 4096. Selon Price97, ces pièces appartenant à ses séries C et E,
91. APoStolou 2002, p. 155, no 99.92. Cependant cf. op. cit. n. 69 et 76.93. Cf. Price 1966, p. 134 et hackenS 1970, p. 55.94. Cf. hackenS 1970, p. 56.95. Cf. BarranDon, BreSSon 1997, p. 150-152.96. La date de son enfouissement se situe entre 44-42 av. J.-C. selon Raven (1938) ou entre
49-45 av. J.-C. selon Crawford (1969, p. 114, no 374) ou vers 40 av. J.-C. selon Caramessini-Oeconomidès, kleiner (1975). Cf. également N. HarDwick, dans Coin Hoards, NC, 166, 2006, p. 374, no 34.
97. Price 1966, p. 134.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS162
RN 2013, p. 147-174
« it is unlikely that their minting took place much before c. 100 BC ». Cependant, Hackens98 souligne que le terminus ante quem du trésor d’Hiérapytna est peu utile dans la datation des pièces gortyniennes, d’autant plus que nous ignorons l’état de conservation des pièces dans ce trésor. Pourtant il faut mentionner qu’à part les trois statères de Gortyne, de Priansos et de Rhaucos, datés entre le dernier quart du ive siècle et le premier quart du iiie siècle av. J.-C., la plupart des émissions locales contenues dans le trésor d’Hiérapytna99, comme celles d’Hiérapytna, de Gortyne, de Cnossos et de kydonia datent de la première moitié du ier siècle av. J.-C.
Dans un autre trésor, également trouvé à Hiérapytna en 1935 (?) (IGCH 318) et enfoui au iie siècle av. J.-C.100, parmi les douze monnaies d’argent qu’il contient, se trouve une pièce gortynienne du Groupe A de la deuxième émission de la Série V. Mis à part cette pièce gortynienne, le trésor se compose d’un triobole de kydonia surfrappé sur un triobole de Sicyone101, d’une drachme de Persée (178-168 av. J.-C.) et de neuf didrachmes de Cyrène102. Cependant, il est possible
98. hackenS 1970, p. 53.99. Le trésor d’Hiérapytna, qui contient entre 360 et 400 monnaies d’argent, constitue le trésor
le plus important jamais trouvé dans la région hiérapytnienne. Il contient précisément des monnaies de Cnossos (dix tétradrachmes locaux et un tétradrachme « pseudo-athénien »), des monnaies de Gortyne (un statère, deux drachmes, trois tétradrachmes « pseudo-athéniens » et également un tétradrachme de Métellus frappé dans son atelier), sept tétradrachmes de kydonia, des monnaies d’Hiérapytna (sept tétradrachmes, treize didrachmes, deux drachmes et également un tétradrachme « pseudo-athénien »), un statère de Priansos, un statère de Rhaucos, environ cinquante-cinq tétradrachmes athéniens du Nouveau Style, un triobole de la Ligue Achéenne, environ soixante cistophores de Pergame, d’Éphèse, de Laodicée, d’Apamée et de tralles et environ deux cents deniers romains.
100. Cf. hackenS 1970, p. 53 et id. 1971, p. 288-289 ; trifiró 2001, p. 153-154.101. Seul un petit nombre de statères de Sicyone est présent dans les trésors crétois (cf. CH IX 164 /
Crète centrale et méridionale 1991) dont la date d’enfouissement se situe entre 280 et 270 av. J.-C. et le nombre de leurs surfrappes n’est pas important (cf. le trésor IGCH 154 / archalochori-aStritSi 1936 et le riDer 1966, p. 25, nos 98-99 et p. 69, nos 29-30 et p. 127), tandis que le nombre des trioboles sicyoniens surfrappés par Praisos entre la fin du ive et le début du iiie siècle av. J.-C. est plus élevé (cf. le riDer 1966, p. 96, no 63 (drachme de Phaistos) et p. 107-108, nos 2, 3 et 4 (trioboles de Praisos) et p. 127). Cependant, il faut noter que les monnaies sicyoniennes sont très nombreuses dans les trésors crétois plus tardifs, dont la date d’enfouissement se situe vers 150 av. J.-C. comme le trésor IGCH 252 / Cnossos avant 1955, qui contient 10 trioboles de Sicyone et le trésor IGCH 253 / Crète avant 1914, qui contient 1 ou 2 oboles de Sicyone ou vers le début du ier siècle av. J.-C., comme le trésor IGCH 330 / Axos 1961, qui contient deux trioboles de Sicyone, ce qui atteste, selon M. I. Stefanakis (1997, p. 207), un second afflux des monnaies de Sicyone en Crète pendant le iie siècle av. J.-C. Ainsi, les hémidrachmes de kydonia, sufrappés sur des trioboles de Sicyone, dont un des six exemplaires connus jusqu’à aujourd’hui figure dans le trésor IGCH 318 / Hiérapytna 1935, sont datés par M. I. Stefanakis (1997, p. 207) de la première moitié du iie siècle av. J.-C.
102. Les trésors enfouis en Crète entre 280 et 270 av. J.-C. (cf. IGCH 151 / Mitropolis 1995 ; IGCH 152 / Phaistos 1953 ; IGCH 153 / Crète avant 1964 ; IGCH 154 / Archalochori-Astritsi 1936 ; CH IX 164 / Crète centrale ou méridionale 1991 et le CH IX 165 / kératokambos 1992) et les fouilles (cf. JackSon 1973, p. 105, no 134 et Price 1992, p. 328, no 102), font connaître la grande diffusion des monnaies (tétradrachmes et didrachmes) de Cyrène en Crète entre la fin du ive siècle et le début du iiie siècle av. J.-C., dont un grand nombre a été surfrappé par les cités crétoises, surtout Gortyne et Phaistos, mais aussi Polyrrhénia et Phalasarna. Cependant, selon Hackens (1971, p. 288), même
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 163
RN 2013, p. 147-174
que ce trésor soit composé de deux lots distincts, de celui trouvé à Archalochori-Astritsi (Crète centrale) en 1936 (IGCH 154)103 et de celui trouvé à Hiérapytna en 1933/1934 (IGCH 352).
Conclusion
Après avoir présenté les avis divergents des numismates sur l’étalon et la data-tion de émissions gortyniennes de la Séries IV et V et en attendant qu’une étude des coins soit effectuée dans les années à venir afin de donner des réponses plus concrètes, on voudrait formuler certaines remarques préliminaires :
En ce qui concerne les relations entre Rhodes et Gortyne pendant la période entre la fin du iiie siècle et le iie siècle av. J.-C., les sources écrites nous font défaut, tandis que dans le cas de Cnossos, d’Hiérapytna, d’Olonte et de Chersonèsos, leurs relations étroites avec Rhodes sont bien attestées104. Ainsi, selon Hackens, la probable utilisation d’un étalon rhodien par Gortyne pour la frappe de son monnayage local, alors que la plupart des cités crétoises n’ont guère adopté cet étalon (!), est un témoignage historique important de ses relations avec Rhodes.
Il est vrai que les cités crétoises étaient habituées dès le début du iie siècle à l’usage d’un étalon rhodien réduit, comme le prouvent les monnaies « pseudo-rhodiennes » (émissions rhodiennes semi-officielles et imitations crétoises) frappées en Crète. Leur circulation en Crète, ainsi que celle des drachmes et des hémidrachmes d’un étalon rhodien réduit est attestée par les trésors, les fouilles, les trouvailles isolées et les sources épigraphiques105. En outre les monnaies
si les monnaies de Cyrène circulaient en Crète plutôt dans le premier quart du iiie siècle av. J.-C., comme l’attestent les trésors, elles ne seraient évidemment pas a priori exclues d’un trésor du iie siècle av. J.-C. toutefois, en l’état actuel de notre documentation, la circulation des monnaies cyrénaïques à Hiérapytna pendant le iiie siècle reste peu importante, puisque l’argent cyrénéen arrivait surtout en Crète centrale.
103. Sur le contenu du trésor cf. également le riDer 1966, p. 11-19 et trifiró 2001, p. 143-154.104. À partir de 205/204 av. J.-C., Rhodes est en guerre ouverte contre certaines cités crétoises
qui menacent son commerce, ses intérêts maritimes et par conséquent sa position en Méditerranée orientale (Ire Guerre Crétoise). Mais grâce à sa diplomatie, Rhodes a réussi à conjurer le danger en profitant des dissensions crétoises pour s’assurer de solides points d’appui dans l’île. D’où les traités d’alliance entre Rhodes et Hiérapytna (IC, III Hierapytna, 3A ; StaatsV. III, 551 ; Syll.3, 581 et auStin 1981, p. 165-169, no 95), entre Rhodes et Olonte (StaatsV. III, 552 et van effenterre 1948, p. 230-231) et entre Rhodes et Chersonèsos (IC, I Chersonesos, 1 et chaniotiS 1991, p. 258-260). Les relations amicales entre Rhodes et Cnossos n’apparaissent pas seulement au début du iie siècle (cf. De Souza 1999, p. 81). Grâce à Diodore (XX, 88, 9), elles sont attestées dès 305 av. J.-C., lorsque les Cnossiens ont envoyé aux Rhodiens, pendant le fameux siège de Démétrios Poliorcète, une troupe de secours de 150 soldats. Rhodes a ensuite, selon Polybe (V, 53, 1), aidé les Cnossiens pendant la guerre de Lyttos. L’existence de cette amitié entre Rhodes et Cnossos est confirmée par le traité entre Rhodes et Hiérapytna. Ainsi Cnossos était une amie de Rhodes, mais aussi la rivale incontestée de Gortyne.
105. Cf. StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 176-180 et le traité d’alliance entre Hiérapytna et Rhodes, conclu entre 201 et 197 av. J.-C., IC, III Hierapytna, 3A, l. 26-29.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS164
RN 2013, p. 147-174
rhodiennes et « pseudo-rhodiennes » ont davantage circulé en Crète centrale et orientale (Axos, Gortyne, Archanès, Hiérapytna) qu’en Crète occidentale où les monnaies rhodiennes étaient surfrappées et les monnaies « pseudo-rhodiennes » contremarquées. Il faut mentionner également que la circulation des drachmes plinthophores dont l’émission a débuté dans les années 180 ou même avant d’après les recherches récentes106, est aussi bien attestée en Crète107, et les cités de Latô et d’Olonte utilisent pour leur monnayage de bronze le carré creux (plinthos) entre la fin du iie et le début du ier siècle av. J.-C.
Cependant, même si Gortyne a été influencé par les didrachmes « pseudo-rhodiens » de Gorgos pour la frappe de ses hémidrachmes à la Méduse d’un étalon crétois réduit, elle n’a pas adopté, à notre avis, l’étalon rhodien. Ainsi, il est possible qu’elle ait contremarqué les pièces de Gorgos pour leur donner une valeur légale en tant que drachmes d’un étalon crétois réduit. En outre, le poids de 2,50 à 3,60 (3,70) g de ses drachmes appartenant à la première (Groupe B) et à la deuxième émission de la Série IV ainsi qu’à la deuxième (Groupe A) et à la troisième émis-sion de la Série V, dites légères par Price et Hackens, ne correspond ni à un étalon rhodien réduit, ni à un étalon rhodien plinthophorique, ni à un étalon cistophorique. De plus, comme on vient de le mentionner, il existe des pièces appartenant à ces émissions dont le poids dépasse les 4 g (cf. tableau 1).
Ainsi, d’après nous, l’étalon utilisé par l’atelier de Gortyne pour la frappe des pièces des Séries IV, V et VI est un étalon crétois108, employé également par les autres cités crétoises entre la fin du iie siècle et le premier quart du ier siècle av. J.-C. et influencé par l’étalon attique, prépondérant pendant cette période. On remarque pourtant que le poids des drachmes gortyniennes est parfois plus élevé que celui des drachmes d’étalon attique dont le poids se situe autour de 4,25 g, mais il est vrai que le nombre des exemplaires dont le poids dépasse 4,30 g est petit (cf. tableau 1). La réduction du poids qu’on remarque sur les pièces de la première (Groupe B) et de la deuxième émission de la Série IV, ainsi que sur les pièces de la deuxième émission (Groupes A et B) de la Série V correspond à un étalon crétois réduit.
L’écart chronologique qui sépare les pièces contenues dans le trésor de Gortyne, c’est-à-dire d’une part les drachmes gortyniennes contremarquées de la Série I, les didrachmes « pseudo-rhodiens » de Gorgos de la Série II et la drachme « pseudo-rhodienne » d’Ainétor de la fin du iiie siècle et du début du iie siècle av. J.-C. et, d’autre part, les drachmes des Séries IV et V pourrait être expliqué en interprétant le trésor de Gortyne comme un trésor d’accumulation, qui comprend presque toute la production monétaire en argent de Gortyne.
106. Cf. A. MeaDowS, the Eras of Pamphylia and the Seleucid Invasions of Asia Minor, AJN, 21, 2009, p. 51-88.
107. Cf. StefanakiS, Stefanaki 2008, p. 177, tableau 3. Notons que des tétroboles de Cnossos d’un étalon attique (étalon crétois), dont le poids se situe entre 2,20-3,00 g, émis dans le premier quart du ier siècle av. J.-C., sont surfrappés sur des drachmes rhodiennes plinthophores (pour les références bibliographiques cf. Stefanaki 2007-2008, p. 58 et 80, tableau 3).
108. Cf. IC, II Axos, 35, l. 14-15 (120-70 av. J.-C.) et Stefanaki 2007-2008, p. 63-64.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 165
RN 2013, p. 147-174
Nous sommes d’opinion que les émissions appartenant aux Séries IV et V sont probablement successives, sans pourtant pouvoir exclure l’hypothèse formulée par Price109, selon laquelle la deuxième émission de la Série IV ainsi que le Groupe A de la deuxième émission de la Série V sont contemporaines et ont été frappées parallèlement par deux ateliers différents de Gortyne. toutefois la succession de la frappe des quatre émissions des drachmes gortyniennes (Séries IV et V) et donc leur datation relative restent incertaines tant qu’une étude des coins ne sera effectuée.
On pourrait supposer que la frappe des drachmes gortyniennes de la Série IV ait commencé dans le troisième quart du iie siècle av. J.-C. et celle de la Série V à la fin du siècle. Dans ce cas, les pièces lourdes de la Série V, celles de la troisième émission et/ou du Groupe C de la deuxième, pourraient être contemporaines des tétradrachmes à types locaux ou « pseudo-athéniens » d’étalon attique (étalon crétois), frappés par les cités crétoises dans la dernière décennie du iie siècle et en 87/86 av. J.-C. respectivement.
Cependant, il est possible que la frappe de la première émission de la Série IV commence dans la dernière décennie du iie siècle et donc au moment où la plu-part des cités crétoises recommencent à frapper monnaie d’argent. Dans ce cas, les émissions gortyniennes d’un poids plus élevé des Séries IV et V correspon-dent aux deux périodes pendant lesquelles les cités crétoises ont employé l’étalon attique (étalon crétois), dans la dernière décennie du iie siècle pour la frappe des tétradrachmes à types locaux et en 87/86 av. J.-C. pour la frappe des tétradrachmes « pseudo-athéniens ». Ainsi, on pourrait proposer le schéma suivant :
Série IV1re Émission (Groupe A) (3,30) 3,50-4,55 g Étalon crétois IGCH 338 (?)1re Émission (Groupe B) 2,50-3,90 (4,63) g Étalon crétois réduit IGCH 3382e Émission 2,50-3,60 (4,03) g Étalon crétois réduit IGCH 338 et 352
Série V2e Émission (Groupe A) 2,50-3,70 (4,20) g Étalon crétois réduit IGCH 338, 352 et 3182e Émission (Groupe B) 3,49-3,83 (4,04) g Étalon crétois réduit2e Émission (Groupe C) (3,28) 3,70-4,45 g Étalon crétois3e Émission 3,10-4,71 g Étalon crétois (?) IGCH 338
La réduction du poids, dans la première (Groupe B) et la deuxième émission de la Série IV ainsi que dans la deuxième émission de la Série V, avec des pièces qui pèsent moins de 3,80 g (cf. tableau 1), correspond probablement à la période intermédiaire d’un étalon attique réduit (étalon crétois réduit). Cependant, en ce qui concerne l’étalon de la troisième émission de la Série V, étant donné le petit
109. Price 1966, p. 132.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS166
RN 2013, p. 147-174
nombre d’exemplaires connus, il est difficile de savoir s’il agit d’un étalon crétois réduit ou non. Ainsi, il est possible que les pièces de la troisième émission précédent celles de la deuxième, comme l’attestent l’utilisation du cercle de rayons au revers et la composition du trésor de Gortyne.
Enfin, nous voudrions, encore une fois, souligner le caractère préliminaire de cette étude afin de montrer que les recherches scientifiques sur le monnayage des cités crétoises n’ont pas encore dit leur dernier mot et afin d’encourager les futurs chercheurs.
CAtALOGUE
Récapitulatif des émissions en argent frappées dans l’atelier gortynien entre le milieu du iiie et le premier quart du ier siècle
Après 250 av. J.-C.
Série I
1re Émission - DRACHMES (crétois réduit)Dr. tête laurée de Zeus à dr. ou à g. ; grènetis. Contremarques : taureau cornupète à dr. et tête féminine de face (Europe ?).Rev. ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ. Europe sur le taureau qui nage à dr. et se retourne.
Grènetis ou cercle de rayons. Contremarque : tête laurée d’Apollon ou tête d’Artémis à dr. portant carquois à leur épaule.
Cf. SvoronoS 1890, p. 172, nos 114-118, pl. XV, nos 22-23.Poids : 3,36-5,38 g.
2e Émission - TRIOBOLES (crétois réduit)Dr. tête laurée de Zeus à dr.Rev. ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ. Taureau cornupète à dr. ; grènetis.Cf. SvoronoS 1890, p. 173, no 119, pl. XV, no 24.Poids : 2,01-2,32 g.
Fin du iiie siècle-début du iie siècle av. J.-C.
Série II
1re ÉmissionDIDRACHMES (rhodien réduit)Dr. tête de Méduse de 3/4 à dr. Contremarque : tête de Niké à dr.Rev. ΓΟΡΓΟΣ, Ρ/Ο. Rose ; dans le champ à g. étoile à huit rayons ; grènetis.Cf. Price 1966, Class A, p. 136, nos 1-44 ; aShton 1987, p. 29, no 1.Poids : 3,16-4,95 g.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 167
RN 2013, p. 147-174
Série III
1re Émission (Groupes A-C) - TRIOBOLES (crétois réduit)GROUPE ADr. tête de Méduse de 3/4 à g.Rev. ΓΟΡΤΥΝ. Aigle aux ailes éployées à dr. sur un foudre.Cf. SvoronoS 1890, p. 174, no 132, pl. XVI, no 1.
GROUPE BDr. Même que la précédente.Rev. ΓΟ. Aigle aux ailes éployées à dr. combattant un serpent qu’il tient ;
grènetis.Cf. SvoronoS 1890, p. 174, no 133, pl. XVI, no 2.
GROUPE CDr. tête de Méduse de 3/4 à dr. ; grènetis.Rev. Γ/Ο. Aigle aux ailes éployées à g. combattant un serpent qu’il tient ; le tout
dans un cercle de rayons.Cf. SvoronoS 1890, p. 174, no 134, pl. XVI, no 3.Poids (Groupes A-C) : 1,88-2,50 g.
Fin du iie siècle – premier quart du ier siècle av. J.-C.
Série IV
1re Émission (Groupes A-B) - DRACHMESDr. tête diadémée de Minos à g.Rev. ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ. Figure virile nue (héros guerrier ?), debout de face, sur un
foudre (sur certains exemplaires) ; de la main g. il tient une lance transver-sale et sa main dr. est appuyée sur un bouclier, posé à terre ; sur certains exemplaires, dans le champ à g., couronne (Groupe A) ; le tout dans un cercle de rayons ou de grènetis.
Cf. SvoronoS 1890, p. 176, no 144, pl. XVI, no 9 (Groupe A) et p. 175, no 143, pl. XVI, no 8 (Groupe B) ; Price 1966, Class D, p. 139, nos 129-148 (Groupe B).
Poids (Groupe A) : (3,30) 3,50-4,55 g (crétois).Poids (Groupe B) : 2,50-3,90 g (4,16 g ; 4,27 g ; 4,38 g ; 4,63 g) (crétois réduit).
2e Émission - DRACHMES (crétois réduit)Dr. Tête diadémée de Minos à dr. ; au dessous, A, Β, Γ, Δ, Η.Rev. ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ. Figure virile nue (héros guerrier ?), debout de face ;
de la main g . il tient une lance transversale et sa main dr. est appuyée sur un bouclier, posé à terre ; dans le champ ou à l’exergue, A, Β, Δ, Θ ; le tout dans un cercle de rayons ou de grènetis.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS168
RN 2013, p. 147-174
Cf. SvoronoS 1890, p. 176-177, nos 145-154, pl. XVI, nos 10-12 ; Price 1966, Class C, p. 137-138, nos 17-128.
Poids : 2,50-3,60 (4,03) g.
Série V
1re Émission - TÉTRADRACHMES (crétois réduit)Dr. Tête diadémée de Minos à g. ; au dessous, Δ ; grènetis.Rev. ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ et le nom du monétaire ΘΙΒΟΣ. Athéna debout à g. portant
sur la main dr. étendue Niké ; sa main g. est appuyée sur le bouclier posé à terre et orné d’un gorgoneion ; à g. un serpent se dressant ; le tout dans une couronne de laurier.
Cf. SvoronoS 1890, p. 177, no 156, pl. XVI, no 14.Poids : 14,34-15,83 g.
2e Émission (Groupes A-C) - DRACHMESDr. Tête diadémée de Minos à dr. ; au dessous, Α, Β, Γ, Δ, Ε, F, Z, H
(Groupe A) et Γ ou Δ (Groupe B).Rev. ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ et parfois les noms des monétaires, ΠΑΡ (Groupe A)
ou ΘΙΒΟΣ (Groupe B). Apollon nu, assis sur un rocher à g. ; il porte à l’épaule le carquois et dans la main g., l’arc ; la main droite repose sur le genou ; le tout dans un cercle de grènetis ; dans le champ, A, Β, Γ, Δ, ΔΑ, Ε, F, Ζ (Groupe A), E (Groupe B) et B (Groupe C).
Cf. SvoronoS 1890, p. 177-178, nos 158-172 et 176, pl. XVI, nos 17-20 (Groupe A) ; id., p. 177, no 157, pl. XVI, no 15 (Groupe B) ; id., p. 178, no 173, pl. XVI, no 16 (Groupe C) ; Price 1966, Class Ε, p. 139-143, no 149-329 (Groupe A).
Poids (Groupe A) : 2,50-3,70 (4,12 ; 4,20) g (crétois réduit).Poids (Groupe B) : 3,49-3,83 (4,04) g (crétois réduit).Poids (Groupe C) : (3,28) 3,70-4,45 g (crétois).
3e Émission - DRACHMES (crétois ?)Dr. Tête laurée de Zeus à g. ; au dessous, Γ (?).Rev. ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ. Apollon nu, assis sur un rocher à g. ; il porte à l’épaule
le carquois et dans la main gauche, l’arc ; la main droite repose sur le genou ; sur certains exemplaires, dans le champ, Γ ou Δ ; le tout dans un cercle de rayons.
Cf. SNG Lockett III, pl. XLV no 2563.Poids : 3,10-4,71 g.
Série VI
1re Émission - TÉTRADRACHMES « PSEUDO-ATHÉNIENS » (crétois)Dr. Tête d’Athéna de profil à dr., portant un casque décoré du Pégase et de quatre
têtes ou protomés de chevaux ; devant le cou d’Athéna, lettre B ; grènetis.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 169
RN 2013, p. 147-174
Rev. ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ et parfois le nom du monétaire ΜΕΝ suivi de son patro-nyme ΑΝΤΙ. Chouette perchée sur une amphore ; devant elle, taureau cornupète à dr. ; sur l’amphore ΑΡ (monogramme) ou B, dans le champ ; le tout dans une couronne d’olivier.
Cf. SvoronoS 1890, p. 179-180, nos 181-186, pl. XVI, nos 23-25 ; le riDer 1968, p. 318-321.
Poids : 14,32-16,50 g.
Bibliographie
APoStolou 1999 : E. APoStolou, L’histoire monétaire de Rhodes à l’époque hellénistique, Université Paris IV-Sorbonne, 1999 (thèse de doctorat inédite).
APoStolou 2002 : E. APoStolou, Rhodes hellénistique, Les trésors et la circulation monétaire, Ευλιμένη, 3, 2002, p. 117-182.
AShton 1987 : R. H. J. AShton, Rhodian-type silver coinages from Crete, SM, 146, 1987, p. 29-36.
AShton 2001 : R. H. J. AShton, The coinage of Rhodes, 408-190 BC, dans Money and its uses in the Ancient Greek World., A. Meadows, k. Shipton (eds.), Oxford University Press, 2001, p. 80-115.
AShton 2002 : R. H. J. AShton, Clubs, thunderbolts, torches, Stars and Caducei : more pseudo-rhodians drachms from Mainland Greece and the Islands, NC, 162, 2002, p. 59-78.
AuStin 1981 : M. M. AuStin, The Hellenistic World from Alexander to the Roman conquest, Cambridge, 1981.
BreSSon, BarranDon 1997 : A. BreSSon, J. N. BarranDon, Imitations crétoises et monnaies rhodiennes, Analyse physique, RN, 152, 1997, p. 137-155.
CarameSSini-oeconomiDeS, kleiner 1975 : M. CarameSSini-oeconomiDeS, f. S. kleiner, the Hierapytna Hoard. A supplement, RBN, 121, 1975, p. 5-19.
ChaniotiS 1991 : A. ChaniotiS, Vier kretische Staatsverträge, Chiron, 21, 1991, p. 241-264.
CrawforD 1969: M. H. CrawforD, Roman Republican Coin Hoards, London, 1969.
De Souza 1999 : Ph. De Souza, Piracy in the Graeco-Roman World, Cambridge University Press, 1999.
Doyen 2007 : Ch. Doyen, Remarques numismatiques à propos d’un traité entre Attale I de Pergame et la cité de Malla, dans Liber Amicorum Tony Hackens, Louvain-la-Neuve, 2007, p. 95-105.
HackenS 1970 : t. HackenS, L’influence rhodienne en Crète aux iiie et iie siècle av. J.-C. et le trésor de Gortyne, 1966, RBN, 116, 1970, p. 37-58.
HackenS 1971 : t. HackenS, À propos du trésor de Gierapetra 1935, RBN, 117, 1971, p. 288-289.
IC = M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, 4 vol., Rome, 1935-1950.JackSon 1971 : A. E. JackSon, the bronze coinage of Gortyne, NC, 11, 1971,
p. 37-51.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS170
RN 2013, p. 147-174
JackSon 1973 : A. E. JackSon, the coins, dans Knossos, the Sanctuary of Demeter, N. J. Coldstream (ed.), ABSA, Suppl., 8, 1973, p. 99-113.
JenkinS 1949 : G. k. JenkinS, the Cameron Collection of Cretan Coins, NC, 9, 1949, p. 35-56.
JenkinS 1989 : G. k. JenkinS, Rhodian Plinthophoroi – a sketch, dans Numismatic studies in memory of C.M. Kraay and O. Morkholm, G. Le Rider, G. k. Jenkins, N. Waggoner, U. Westmark (eds.), Louvain-la-Neuve, 1989, p. 101-120.
Le RiDer 1966 : G. Le RiDer, Monnaies crétoises du Vème au Ier siècle av. J.-C., Études crétoises, 15, 1966.
Le RiDer 1968 : G. Le RiDer, Un groupe de monnaies crétoises à types athéniens, dans Humanisme actif, Mélanges d’art et de littérature offerts à Julien Cain, 1968, p. 313-335.
MeteniDiS 1997 : N. MeteniDiS, Artemis Ephesia: the political significance of the Metellus coins, dans Post Minoan Crete. Proceedings of the Colloquium organized by the British School at Athens and the Institute of Archaeology, University of London, November 1995, W. Cavanagh, M. Curtis (eds.), (BSA Studies Series 2), 1997, p. 117-122.
PicarD 1990 : O. PicarD, Le monnayage de Latô, dans Πεπραγμένα του ΣΤ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Chania, 24-30 Août 1986, Chania, 1990, t. A2, p. 107-113.
Price 1966 : M. J. Price, A hoard from Gortyn, RN, 7, 1966, p. 128-143.Price 1992 : M. J. Price, the Coins, dans Knossos, From Greek city to Roman
Colony, L. H. Sackett (ed.), ABSA, Suppl. 21 (Excavations at the Unexplored Mansion II), 1992, p. 323-331.
Raven 1938 : E. J. P. Raven, the Hierapytna Hoard of Greek and Roman coins, NC, 18, 1938, p. 133-158.
Seager 1924 : R. B. Seager, A Cretan coin hoard, (NNM 23), New York, 1924.SiDiroPouloS 2006 : k. SiDiroPouloS, Αργύριον αξικόν: Νομισματικές εκδόσεις
και “θησαυροί”, dans O Μυλοπόταμος από την Αρχαιότητα ως Σήμερα, t. IV : Ελεύθερνα-Αξός, E. Gavrilaki, I. Z. Tzifopoulos (eds.), Réthymnon, 2006, p. 147-165.
StaatsV. III = H. H. Schmitt, Die Staatsverträge des Altertums III : Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr., München, 1969.
StefanakiS 1997 : M. I. StefanakiS, Studies in the coinages of Crete with particular reference to Kydonia, University of London, 1997 (thèse de Doctorat inédite).
StefanakiS 2002 : M. I. StefanakiS, the ‘Chania 1922’ hoard (IGCH 254 & CH VII 104): a reassessment, Cretan Studies, 7, 2002, p. 231-244.
StefanakiS, sous presse : M. I. StefanakiS, Πολυρρήνια, Η Νομισματική Παραγωγή από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ., Ελληνική Νομισματική Εταιρεία, Athènes, sous presse.
StefanakiS, traeger 2005 : M. I. StefanakiS, B. Traeger, Counter-stamping coins in Hellenistic Crete. A first approach, dans Actes du XIIIe Congrès Numismatique, Madrid, 15-19 septembre 2003, C. Alfaro, C. Marcos, P. Otero (eds.), Madrid, 2005, t. I, p. 383-394.
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 171
RN 2013, p. 147-174
StefanakiS, Stefanaki, 2006 : Μ. Ι. StefanakiS, V. Ε. Stefanaki, Ρόδος και Κρήτη: Νομισματικές συναλλαγές, επιρροές και αντιδράσεις στις αρχές του 2ου αι., dans Το Νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους Περαία. Πρακτικά Συνεδρίου της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Cos, 30 Mai-2 Juin 2003, Οβολός, 8, Athènes, 2006, p. 165-190.
Stefanaki 2006 : V. E. Stefanaki, H οικονομική ανάπτυξη της Ιεράπυτνας στο τέλος της Ελληνιστικής εποχής: Η αρχαιολογική και νομισματική μαρτυρία, dans Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Elounda 2001, Héraclion, 2006, t. A5, p. 303-318.
Stefanaki 2007-2008 : V. E. Stefanaki, La politique monétaire des cités crétoises aux époques classique et hellénistique, Ευλιμένη, 8-9, 2007-2008, p. 47-80.
Stefanaki 2007-2008 (2) : V. E. Stefanaki, k. Stratiki, Ο θεός Απόλλωνας στα νομίσματα της Ελεύθερνας. Ερμηνευτική προσέγγιση, Ευλιμένη, 8-9, 2007-2008, p. 81-106.
SvoronoS 1890 : J.-N. SvoronoS, Numismatique de la Crète Ancienne, Maçon, 1890 (2e édition en 1972).
Syll3 = W. DittenBerger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, t. 3, Leipzig, 1960.ΤouratSoglou 1995 : I. ΤouratSoglou, Creta Numismatica: Με αφορμή το
θησαυρό Κεντρική-Νότια Κρήτη 1991, dans Disjecta Membra, Two Hellenistic Hoards from Greece, (Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Νομισματικής Εταιρείας 3), Athènes, 1995.
trifiró 2001 : M. D. trifiró, The Hoard Αρκαλοχώρι-Αστρίτσι 1936, Ευλιμένη, 2, 2001, p. 143-154.
Van Effenterre 1948 : H. Van Effenterre, La Crète et le monde grec de Platon à Polybe, Paris, 1948.
Wiemer 2002 : H.-U. Wiemer, krieg, Handel und Piraterie, Untersuchungen zur Geschicte des hellenistischen Rhodos, Klio, Beiträge zur Alten Geschichte, Neue Folge Band 6, 2002.
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS172
RN 2013, p. 147-174
figure 1 - künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 86.
figure 2 - CNR, XIX.2, 1994 Second Quarter, Pennsylvania-England, no 86.
figure 3 - künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 88.
figure 4 - künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 90.
figure 5 - Lanz, Auktion 131, Samml. Karl, 27/11/2006, München, no 808.
figure 6 - künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 105.
figure 7 - künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 107.
figure 8 - Hauck und Aufhäuser, Auktion 18, 5-6/10/2004, München, no 119.
1 2 3 4
5 6 7 8
LE MONNAyAGE D’ARGENt DE GORtyNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 173
RN 2013, p. 147-174
figure 9 - Lanz, Auktion 38, 24/11/1986, München, no 284.
figure 10 - künker, Auktion 94, Samml. Dr. Hagen Tronnier, 27-28/09/2004, Osnabrück, no 894.
figure 11 - künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 111.
Figure 12 - Gemini, Auction III, 9/01/2007, New York, no 160.
figure 13 - Winterthur I, p. 212, no 2274, pl. 100.
figure 14 - künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 114.
Figure 15 - Bankhaus Aufhäuser, Auktion 11, 21-22/03/1995, München, no 53.
figure 16 - CNR, XVIII.4, Pennsylvania-England, 1993 fourth Quarter, no 45 = CNG, Auction XXIX, 30/03/1994, no 155 = CNG, Auction 67, 22/09/2004, Quarryville PA, no 608.
9 10 11 12
13 14 15 16
V. E. StEfANAkI / M. I. StEfANAkIS174
RN 2013, p. 147-174
17 18 19
20 21
figure 17 - kovacs, fPL 27, Spring 1994, San Mateo, no 19.
figure 18 - Glendining’s, 05/1959, London, no 2036 = SNG Lockett III, pl. XLV, no 2563.
figure 19 - künker, Auktion 136, Samml. Dr. Burkhard Traeger, 10/03/2008, Osnabrück, no 112.
figure 20 - SNG Fitzwilliam IV, no 3954, pl. LXXI.
Figure 21 - The New York Sale, Auction XXVII, The Prospero Coll., 4/01/2012, New York, no 404.