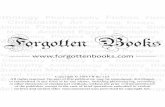Le catholicisme français à l'épreuve du vieillissement
Transcript of Le catholicisme français à l'épreuve du vieillissement
Le catholicisme français à l’épreuve du vieillissement
Céline BÉRAUD
Le 11 février 2013, le pape Benoît XVI a annoncé sa décision de renoncer au siège pontifical à la fin du mois. Àgé de 86 ans, il considère
ne plus avoir la « vigueur nécessaire » pour répondre aux différentes sollicitations liées à son ministère. Jean-Paul II avait fait lui le choix de ne pas démissionner. Pour ne pas opposer l’un à l’autre, les acteurs catholiques sollicités pour commenter l’événement ont, sans craindre la contradiction, développé à leur propos la même rhétorique du service. Si Wojtyla a servi l’Église jusqu’à sa mort, c’est pour que l’Église soit servie le mieux possible que Ratzinger, à bout de force, quitte sa fonction. Faut-il y voir une forme de sécularisation interne de la papauté ? l’expression d’importants dysfonctionnements dans la Curie ? Répondre à une telle question n’est pas l’objet de cette contribution centrée sur la problématique du vieillissement, qui se donne à voir à Rome mais également dans le catholicisme français.
L’image d’un vieillard, tant dans l’assemblée qu’à proximité de l’autel, est d’une grande banalité dans les églises françaises. En France, la population globale n’a cessé de vieillir et l’espérance de vie d’augmenter. Ainsi, en 1998, les plus de soixante ans représentaient 20 % de la population, contre 14 % en 1946. Mais le vieillissement est nettement plus marqué en ce qui concerne les individus qui se déclarent catholiques.
Dans un ouvrage qui s’interroge sur la « décomposition des chrétientés », la question du vieillissement et de ses effets semble incontournable, tout particulièrement en France où elle se pose avec une particulière acuité. En 1993 déjà, Yves Lambert considérait que dans le cadre d’un « chassé croisé
Extrait de La décomposition des chrétientés occidentales, 1950-2010, Yvon Tranvouez (dir.), Brest, CRBC-UBO, 2013.
56 LA DÉCOMPOSITION DES CHRÉTIENTÉS OCCIDENTALES
des âges, des générations et des tendances intergénérationnelles » 1, la France apparaissait l’un des pays les plus sécularisés (avec la Grande-Bretagne, le Danemark et les Pays-Bas). On se propose ici d’étudier les différentes dimensions de ce processus de vieillissement qui fait de l’Église catholique en France très largement une Église de seniors. Dans une perspective diachronique, on s’intéresse également aux ruptures générationnelles, qui s’en trouvent très largement à l’origine.
Une Église frappée par le vieillissement
Comme le rappelle souvent Danièle Hervieu-Léger, le catholicisme a longtemps été appréhendé, en externe comme en interne, à travers la problématique de la perte, dont l’une des dimensions est indéniablement le vieillissement des fidèles et de leurs prêtres.
Des fidèles âgés...
En moins de trente ans, la part des catholiques dans l’ensemble de la population habitant en France est passée, selon les données des Enquêtes sur les valeurs des Européens 2, de 70 % (en 1981) à 42 % (en 2008). La baisse globale s’est traduite chez les jeunes par « un véritable effondrement » 3, puisqu’elle tombe aux mêmes dates de 54 % à 23 % pour les 18-29 ans. Seuls 3 % des répondant-e-s de cette tranche d’âge vont à la messe au moins une fois par mois, c’est-à-dire trois fois moins que la moyenne de l’ensemble de l’échantillon.
Ainsi, plus on est âgé et plus on a de chance d’être catholique, « avec une vraie rupture entre les plus de 60 ans et leurs cadets » 4. Si 42 % des Français se déclarent catholiques en 2008, c’est le cas de 65 % des 60 ans et plus (contre 23 % des 18-29 ans ; 31 % des 30-44 ans et 41 % des 45-59 ans). Ces statistiques mettent en évidence un phénomène de « renouvellement des
1. Yves LAMBERT, « Âges, générations et christianisme en France et en Europe », Revue française de sociologie, XXXIV, 1993, p. 538 et 552.
2. On s’appuie ici sur les enquêtes sur les valeurs des Européens (European Values Surveys) effectuées par des universitaires en 1981, 1990, 1999 et en 2008. Y sont posées une trentaine de questions sur les attitudes religieuses. On peut en exploiter les données aussi bien dans le temps en comparant les résultats d’une enquête à l’autre que dans l’espace, en comparant les résultats dans les différents pays.
3. Claude DARGENT, « Déclin ou mutation de l’adhésion religieuse ? », dans Pierre BRÉCHON et Olivier GALLAND (dir.), L’individualisation des valeurs, Paris, Armand Colin, 2010, p. 215.
4. Claude DARGENT, « Assistance au culte et prière : des pratiques religieuses qui ne baissent plus », dans Pierre BRÉCHON, et Jean-François TCHERNIA (dir.), La France à travers ses valeurs, Paris, Armand Colin, 2009, p. 240.
C. BÉRAUD – Le catholicisme français à l’épreuve du vieillissement 57
générations, les générations âgées, marquées par le catholicisme, qui sont en train de disparaître étant remplacées par de jeunes générations beaucoup plus détachées des institutions religieuses » 5.
En France, les sans-religion sont souvent des anciens catholiques, du moins pour les générations les plus âgées. Selon l’enquête sur les valeurs (2008), 20 % de la population vivant en France a appartenu à un moment de son existence au catholicisme, puis l’a quitté pour devenir à 94 % sans religion. Mais une part importante des jeunes générations échappe désormais à toute forme de socialisation religieuse et ne connaît donc pas de phase d’appartenance même brève au catholicisme. Si 11 % seulement des plus de 60 ans n’ont pas le sentiment d’y appartenir (du fait de leur origine) ni d’y avoir appartenu pendant leur enfance, c’est le cas d’un jeune de 18-29 ans sur deux. On considère que quatre enfants sur dix sont baptisés. Quant à la proportion de celles et ceux qui vont au catéchisme, elle est estimée à 30 %. Cette déprise catholique chez les jeunes générations est un phénomène que nous avions pu observer lors d’une recherche conduite en 2006-2009 auprès d’adolescents de 14-16 ans. Plusieurs n’avaient jamais mis les pieds dans une église. Beaucoup ne savaient pas ce que signifient les termes « aumônerie » ou « aumônier ». Quelques-uns affirmaient même avoir entendu parler de Jésus pour la première fois dans le cadre du programme d’histoire des classes de Seconde. Bien sûr, nous avions également rencontré une minorité de jeunes catholiques pratiquants. Mais ces derniers se sentaient souvent un peu marginaux, moqués parfois 6.
Si l’on considère maintenant la pratique, les écarts entre tranches d’âge sont encore plus importants : 33 % des 60 ans et plus sont pratiquants réguliers ou irréguliers 7, contre 8 % des 18-29 ans (11 % des 30-44 ans et 18 % des 45-59 ans) 8. Ainsi, la catégorie des pratiquants est très majoritairement vieille et inactive (en retraite). On a là indéniablement davantage affaire à des différences en termes d’appartenances générationnelles qu’à un effet lié à l’âge : « Il est douteux que les jeunes catholiques d’aujourd’hui rejoignent dans quelques décennies le taux de pratique qu’on observe actuellement chez leurs coreligionnaires de plus de 60 ans ; en tous les cas, il est certain
5. Pierre BRÉCHON, « Appartenance et identité religieuse » dans Ibid., p. 230. 6. Voir Céline BÉRAUD et Jean-Paul WILLAIME (dir.), Les jeunes, l’école et la religion,
Paris, Bayard, 2009. 7. Les pratiquants réguliers assistent à un office religieux au moins une fois par mois, les
pratiquants irréguliers quelques fois dans l’année. 8. Pierre BRÉCHON, art. cit., p. 231.
58 LA DÉCOMPOSITION DES CHRÉTIENTÉS OCCIDENTALES
que ces derniers fréquentaient la messe bien plus assidûment que leurs cadets d’aujourd’hui lorsqu’ils avaient leur âge » 9.
… face à des prêtres très âgés
Le prêtre français est une personne qui appartient très souvent au quatrième âge 10. Le processus de vieillissement du clergé est lié à un phénomène de non renouvellement des générations : pour une centaine d’ordinations chaque année, on compte cinq à six cents décès. Aujourd’hui, un prêtre diocésain sur deux a plus de 75 ans. Or, il s’agit de l’âge qui correspond, au regard du droit de l’Église, à l’accès possible à une forme de retraite, même si l’on parle plus volontiers en interne de « prêtres retirés » 11. « À soixante-quinze ans accomplis, indique le Code de droit canonique, le curé est prié de présenter à l’Évêque diocésain la renonciation à son office ; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l’Évêque diocésain décidera de l’accepter ou de la différer ; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques » (Canon 538, § 3).
À l’échelle des diocèses, la pyramide des âges du clergé se trouve véritablement « sens dessus dessous » comme me le faisait déjà remarquer un jeune prêtre au début des années 2000. Dans certains diocèses, le vieillissement est particulièrement marqué. Ainsi, dans celui de Saint-Dié, plus de 70 % des prêtres incardinés ont dépassé 75 ans. Ils sont 66 % à Arras. Les évêques se doivent donc de faire face aux pathologies liées au grand âge d’une part importante de leur presbyterium, à la dépendance de certains et à la solitude de beaucoup de ces hommes célibataires et sans enfant. Depuis le milieu des années 2000, ils semblent plus sensibles à cette question, qui a pu longtemps paraître un peu tabou. Ainsi, des postes d’assistante sociale ont été créés dans plusieurs diocèses : quatorze 12 sont salariées en 2011 13 (contre six en 2001). Elles (toutes sont des femmes) consacrent beaucoup de leur temps aux prêtres les plus âgés, et certaines proposent même
9. Claude DARGENT, « Assistance au culte et prière : des pratiques religieuses qui ne baissent plus », dans Pierre BRÉCHON, et Jean-François TCHERNIA (dir.), La France à travers ses valeurs, op. cit., p. 240.
10. « La carte de France des prêtres », La Croix, 21 mai 2010.11. Remarquons que les prêtres peuvent, comme tous les actifs, faire valoir leurs droits à
la retraite auprès de la CAMIVAC dès qu’ils ont le nombre d’annuités requis. Mais ils poursuivent encore leur mission.
12. La première assistante sociale a été recrutée dans le diocèse de Grenoble en 1994. Fin 2010, il y en avait également à Aix, Annecy, Arras, Clermont, Créteil, Lyon, Marseille, Nice, Paris et Rennes.
13. Église en Ille-et-Vilaine, n° 198, 14 juin 2011.
C. BÉRAUD – Le catholicisme français à l’épreuve du vieillissement 59
des ateliers de préparation à la retraite. Dans la même perspective, des journées « santé », parfois adossées à une commission du même nom, qui s’adressent à l’ensemble des prêtres mais accordent souvent une attention particulière aux problèmes des aînés, se sont multipliées, souvent en lien avec la CAVIMAC et/ou la Mutuelle Saint-Martin 14. Plusieurs maisons de retraite diocésaines ou tenues par des religieux-ses ont fermé leurs portes car insuffisamment médicalisées pour accueillir conformément aux normes en vigueur une population dépendante. Se pose la question du logement de prêtres vieillissants mais souvent très attachés à leur indépendance dans des structures collectives. Enfin, il s’agit aussi de sensibiliser les fidèles, comme dans le diocèse de Paris où est organisée « une journée pour les prêtres âgés » le 28 avril 2013, comme cela avait été le cas l’année précédente 15. Dans ce cadre, une quête est organisée afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie matérielle.
La question du vieillissement du clergé fait également l’objet d’une réflexion au niveau national. Ainsi, le 14 décembre 2010, s’est tenue à la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris une journée d’étude intitulée « L’attention portée aux prêtres âgés ». Début 2012, un colloque fermé a été organisé par la Conférence des évêques de France sur les prêtres âgés, en présence de représentants des différents diocèses 16. En juin, le groupe de travail « Prêtres âgés » 17, rattaché au secrétariat général adjoint de la CEF, est constitué pour « informer et accompagner les diocèses » 18. Y participent Mgr Pican, évêque émérite de Bayeux-Lisieux, un membre de la mutuelle Saint-Martin, un économe diocésain, une assistante sociale, un représentant de la CAVIMAC et Joël Defontaine (professeur émérite en économie de la santé) : « Nous serons à la fois force de réflexion sur des sujets tels que le vieillissement du clergé ; les prises en charge de la dépendance ; le recours à l’allocation personnalisée d’autonomie ; le recours à l’aide sociale ; le transfert intergénérationnel entre les prêtres, détaille Joël Defontaine. Nous pourrons réaliser sur place un diagnostic et présenter des solutions » 19.
14. La CAVIMAC est la Caisse d’Assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La Mutuelle Saint-Martin est une complémentaire santé.
15. http://www.paris.catholique.fr/15-avril-2012-Journee-pour-les.html16. La Croix, 8 février 2012.17. Un premier groupe avait déjà travaillé sur ce thème quelques mois auparavant.18. http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-vie-spirituelle/vocations/
pretres-ages-offrir-des-solutions-pratiques-aux-dioceses.html19. Ibid.
60 LA DÉCOMPOSITION DES CHRÉTIENTÉS OCCIDENTALES
Il s’agit en effet d’offrir des « solutions pratiques » aux diocèses. Lors de l’Assemblée plénière de l’automne 2012, dix-huit fiches ont été proposées aux évêques, qui entendent poursuivre cette réflexion autour de l’accompagnement des prêtres âgés qui ont parfois du mal « à passer la main » et se trouvent exposés, une fois retirés, au « sentiment d’inutilité » 20. Il y a là pour les autorités catholiques un véritable défi financier, organisationnel et humain.
Parallèlement, la gestion de la main d’œuvre cléricale s’est intensifiée des deux côtés de la pyramide des âges. Ainsi, les vieux prêtres sont de plus en plus souvent « actifs » au-delà de 75 ans, lorsque leur santé le leur permet. C’est le cas d’un sur deux dans le diocèse de Montauban et de cinq sur six dans celui de Pamiers. Quant aux « jeunes » prêtres (terme dont l’usage est relativement extensif dans le catholicisme français puisqu’il peut même désigner des quinquagénaires), ils croulent très vite sous les responsabilités ecclésiales en tous genres. Ils ne connaissent plus toujours un temps d’apprentissage du métier en tant que vicaire affecté auprès d’un curé plus expérimenté. Partout, les évêques font désormais appel aux prêtres religieux ou membres d’instituts, notamment à ceux issus des « communautés nouvelles ». C’est le cas par exemple à Blois, Avignon ou encore Fréjus-Toulon. Enfin, on a recours à des clercs immigrés, dont le nombre est en croissance depuis une quinzaine d’années. Il a dépassé 1 500 en 2011. Dans le diocèse de Pontoise, où 161 prêtres au total résident, on compte 51 clercs étrangers, principalement originaires d’Afrique et de Pologne.
La contraction du corps clérical agit également sur ses membres : « Ce n’est pas la même chose, psychologiquement et spirituellement d’appartenir à un groupe social qui augmente ou de faire partie d’un groupe social qui dépérit » 21. Il n’est donc pas étonnant que soit exprimé par les prêtres le sentiment d’être un peu « les derniers des mohicans », selon une expression revenant fréquemment au cours des entretiens. Domine, chez les plus âgés, la certitude qu’ils ne seront pas remplacés, certains développant de ce fait des stratégies particulièrement volontaristes afin que les communautés de fidèles apprennent à se prendre en charge sans la présence continue d’un prêtre.
Dans les représentations collectives, le prêtre est un vieil homme. C’est ce dont témoigne ce curé, lui-même âgé de 38 ans : « L’autre fois, j’avais rendez-vous dans une entreprise. Je ne sais pas pourquoi, la secrétaire
20. Voir le dossier « Prêtres âgés, prêtres pour l’éternité », La Croix, 17-18 novembre 2012.21. Guy LESCANNE, alors supérieur du séminaire de Nancy, cité par Hippolyte SIMON, Libres
d’être prêtres, Paris, Éditions de l’Atelier / Éditions Ouvrières, 2001, p. 25.
C. BÉRAUD – Le catholicisme français à l’épreuve du vieillissement 61
pensait que j’étais médecin. Un prêtre si jeune, ça surprend Il y a une très grande surprise liée à l’âge. Dans l’inconscient collectif, s’est forgé un schéma mental selon lequel le prêtre est nécessairement vieux ».
Diacres et laïcs engagés : l’apport de « jeunes » retraités
Si le corps sacerdotal en France continue à voir ses effectifs se réduire (un peu plus de 11 000 prêtres en activité au service des diocèses fin 2011), l’Église catholique conserve par ailleurs une étonnante et remarquable capacité à susciter des engagements. Ainsi, en vingt ans, le nombre de diacres permanents a été presque multiplié par quatre pour atteindre 2 500. Quant à celui des laïcs (dont une grande majorité de femmes) qui se trouvent chargés par leur évêque d’une mission de nature spirituelle pour une durée de plusieurs années, il a également crû fortement depuis la fin des années 1980. Ces nouveaux acteurs de la division du travail religieux catholique, auxquels s’ajoutent des milliers de bénévoles sans lettre de mission, interviennent en paroisse, dans les aumôneries et dans les services diocésains. On peut considérer que cette capacité de l’Église catholique à susciter des engagements n’est pas sans lien avec la structure démographique de ses membres. Le processus de vieillissement en cours dans la population globale a conduit notamment à s’interroger sur le rôle économique et social de ceux que l’on appelle parfois les « nouveaux seniors » 22. On peut ainsi également s’interroger sur leur rôle dans le champ catholique.
Des diacres plus nombreux et plus âgés
Entre 2000 et 2010, le nombre de diacres permanents est passé de 1 499 à 2 420 23. Cela signifie que, en une dizaine d’années, il a augmenté de plus de 60 %, ce qui est particulièrement remarquable pour une institution qui a vu l’effectif de ses prêtres et celui de ses fidèles continuer à diminuer au cours de la période. Si l’on s’intéresse exclusivement aux diocèses territoriaux métropolitains 24 entre 2003 et 2011, le nombre total des diacres augmente de presque un tiers (il passe de 1 816 à 2 191). L’effectif moyen par diocèse passe de 19 à 25. Il s’agit là de moyennes, à interpréter comme telles, car les disparités locales demeurent importantes. Fin 2011, 11 diocèses comptent
22. Voir par exemple Marceline BODIER, « Les effets d’âge et de génération sur le niveau et la structure de la consommation », Économie et statistique, n° 324-325, 1999, p. 163-180.
23. Ces chiffres et la plupart des suivants proviennent de la CEF ou ont été calculés par l’auteure à partir des données de la CEF.
24. Au nombre de 93.
62 LA DÉCOMPOSITION DES CHRÉTIENTÉS OCCIDENTALES
moins de 10 diacres permanents et 13 plus de 40. Une telle hausse s’explique par le maintien à un niveau élevé des ordinations au diaconat permanent : 98 en moyenne chaque année entre 2000 et 2010, avec un pic à 121 en 2007. Si l’âge moyen des diacres n’a cessé d’augmenter pour atteindre 62 ans 25 aujourd’hui, il demeure inférieur d’environ dix ans à celui des prêtres diocésains. Leur taux de mortalité est donc bien moindre. Pour un nombre d’ordinations très proche, la population des diacres continue de s’accroître, alors que celle des prêtres incardinés poursuit sa chute.
La composition interne du clergé français s’en trouve transformée. Ainsi, alors que l’on comptait un diacre pour huit prêtres en activité au service des diocèses en 2003, le rapport est de un pour cinq en 2011. Là aussi, les différences locales sont notables. Les diocèses d’Evry et de Digne comptent un diacre pour deux prêtres. Le ratio est de un pour trois à Arras, Belfort-Montbéliard et Valence. Il se situe entre deux et trois à Lille, Verdun et Versailles. À l’opposé, il y a un diacre pour 24 prêtres à Bayonne ; un pour 13 à Fréjus-Toulon ; un pour 10 au Puy et à Blois. Notons qu’à l’échelle diocésaine, le nombre de diacres n’apparaît pas corrélé à celui des prêtres. Ainsi, des diocèses encore bien dotés en prêtres en activité peuvent avoir relativement fort peu de diacres (Bayonne) ou beaucoup (Lille).
Si le diaconat est souvent mis en avant par les évêques comme le signe d’un dynamisme catholique, il n’est pourtant pas faux de dire que « les diacres contribuent à donner eux aussi une image plutôt âgée des ministères ordonnés, ce qui inévitablement fragilise l’avenir commun de ces ministères » 26. Si l’âge moyen à l’ordination s’est un peu élevé, c’est surtout celui des diacres en activité qui a augmenté. Les hommes qui accèdent au diaconat permanent sont des personnes d’âge mûr. Au milieu des années 1980, ils avaient en moyenne 48 ans. Aujourd’hui, ils ont un peu plus de 50 ans. Selon le Code de droit canonique (can. 1031 § 1), les célibataires peuvent être ordonnés au diaconat à partir de l’âge de 25 ans révolus (la règle est la même pour le presbytérat). Les hommes mariés (état de vie qui est celui de plus de neuf diacres français sur dix) doivent eux attendre 35 ans. Surtout, ces derniers doivent témoigner d’une « expérience familiale positive » : « Lorsqu’il s’agit d’hommes mariés, il faut veiller à ce que soient promus au diaconat ceux-là seulement qui, vivant déjà depuis de nombreuses années dans le mariage, ont montré qu’ils savent diriger leur maison, dont la femme et les enfants mènent une vie vraiment chrétienne
25. Il était de 51 ans en 1978, 54 ans en 1985 et 57,5 ans en 2000. Source : CND.26. Didier GONNEAUD, « Place et enjeux du diaconat », Église et vocations, n° 119, 2005. En
ligne : http://vocations.cef.fr/egliseetvocations/spip.php?article63
C. BÉRAUD – Le catholicisme français à l’épreuve du vieillissement 63
et ont en tous points une bonne réputation » 27. L’âge moyen des diacres français, s’il reste inférieur à celui des prêtres, s’est sensiblement élevé au cours des vingt-cinq dernières années. En 1978, alors que le diaconat reste encore confidentiel dans notre pays, il est de 51 ans. Il atteint 54 ans en 1985, 57 ans en 2000 et 62 ans en 2000. Parallèlement, la proportion de retraités a augmenté. Le profil majoritaire parmi les diacres français a longtemps été celui d’un homme actif sur le marché du travail. Cela n’est plus vrai aujourd’hui. Alors que les retraités ne représentaient qu’un bon tiers de l’ensemble en 2000 (37,4 %), ils en forment la moitié aujourd’hui.
Libérés des contraintes liées à l’activité professionnelle, ils sont pour un grand nombre d’entre eux disponibles pour un investissement liturgique (et plus largement paroissial) renforcé. Le risque est alors que les diacres se trouvent moins présents au monde et davantage à l’autel pour répondre aux demandes de mise en forme rituelle des grands moments de l’existence (baptême, mariage, funérailles), qui se maintiennent bien mieux que la pratique dominicale et pour lesquels ils font d’acceptables substituts aux prêtres. Or, la ligne de l’épiscopat français a toujours consisté à privilégier la dimension missionnaire dans le ministère diaconal. Cela est constant, de 1967, où priorité était donnée « aux appels que constituent l’incroyance, la misère et le sous-développement », à l’an 2000, au cours duquel est publié un document sur la formation 28, en passant par 1970, lorsque les évêques ont clairement affirmé leur refus de voir réduire le rôle des diacres à celui de « simples animateurs liturgiques chargés seulement de présider l’assemblée chrétienne en l’absence du prêtre, d’y annoncer la parole de Dieu et de distribuer la sainte eucharistie » 29. Il se produit donc, sur le terrain, un glissement dont les évêques sont pleinement conscients, comme le montrent les propos de Mgr Brunin : « Le diacre permanent ne peut devenir systématiquement un permanent d’Église quand l’heure de la retraite sonne [...]. Le souci de l’insertion séculière qui caractérise le ministère diaconal, doit demeurer entier pour le diacre permanent à la retraite » 30.
L’évolution démographique qui semble conduire à la prégnance de la figure du diacre retraité questionne les autorités catholiques, comme le
27. Source : Congrégation pour l’éducation catholique, Congrégation pour le clergé, Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents, 1998.
28. Les évêques de France, Le diaconat permanent, normes pour la formation, Paris, Éd. du Cerf, 2000.
29. La Documentation Catholique, n° 67, 1970, p. 318.30. Diaconat aujourd’hui, n° 139, juin 2009, p. 11.
64 LA DÉCOMPOSITION DES CHRÉTIENTÉS OCCIDENTALES
montrent les documents du Comité National du Diaconat (CND) 31. On s’y refuse à faire du diaconat « l’apanage des seniors », d’où la recommandation d’éviter les ordinations au-delà de 65 ans. Il est également conseillé aux diacres de préparer leur retraite, avec leur évêque ou l’un de ses représentants, afin d’anticiper au mieux les modifications du rythme de vie que celle-ci entraîne. Il est en outre précisé que la plus grande disponibilité « peut aussi être investie dans le pôle caritatif » et non pas exclusivement dans les tâches liturgiques. Enfin, le changement de résidence qui peut amener le diacre retraité à déménager vers des zones au climat plus clément « ne peut résulter d’une simple convenance personnelle », en raison de la force du lien d’incardination qui le relie à son diocèse.
Les fidèles zélés
Gabriel Le Bras parle des fidèles « zélés » pour désigner les catholiques qui se distinguent non seulement par la régularité et l’intensité de leur pratique, mais également par le fait qu’ils se mettent au service de la paroisse et de ses œuvres. On peut reprendre cette expression en en étendant quelque peu le sens. Les seniors, hommes et surtout femmes, sont nombreux parmi ces fidèles, même si cette catégorie de militants ne se limite bien évidemment pas à eux. Ces seniors, baby-boomers ou leurs aînés de quelques années, ont accompagné le repli de la militance catholique en interne. Si ces fidèles s’investissent volontiers dans des associations caritatives confessionnelles (Secours catholique, CCFD, ACAT, etc.) 32, on a cependant assisté à un recentrement des engagements sur le travail religieux. Ce recentrement s’est effectué parallèlement au déclin du militantisme d’Action catholique, dans un contexte où l’ère des mouvements « paraît bien révolue » 33. Les seniors ne constituent pas le gros des troupes des permanents laïcs (les laïcs en mission ecclésiale comme on les appelle aujourd’hui), même s’ils y sont représentés. On les trouve surtout dans la nébuleuse bénévole, qui gravite autour. Ils sont présents dans les conseils paroissiaux (conseil économique et conseil pastoral), les équipes d’animation liturgique et les assemblées synodales qui ont été convoquées par les évêques dans les diocèses français au cours des vingt-cinq dernières années. On les trouve également dans des groupes de prières.
Ils forment une main d’œuvre d’appoint disponible, gratuite ou quasi-gratuite, plutôt formée. Ces (jeunes) retraités peuvent mettre leurs
31. Document du CND, http://www.diaconat.cef.fr/6-4.htm32. On les trouve aussi dans des associations non confessionnelles.33. Jacques LAGROYE, La Vérité dans l’Église catholique. Contestations et restauration
d’un régime d’autorité, Paris, Belin, 2006, p. 55.
C. BÉRAUD – Le catholicisme français à l’épreuve du vieillissement 65
compétences professionnelles au service de leur Église. De plus, les membres de cette génération ont souvent « bénéficié d’une formation théologique et biblique dans les mouvements d’Action catholique ou dans les organisations qui leur sont assimilables en l’occurrence (la Paroisse Universitaire, les Foyers Notre-Dame, les aumôneries étudiantes), mais aussi dans des sessions de formation, des journées d’études, et jusque dans les facultés de théologie qui leur ont été largement ouvertes » 34. Cette main d’œuvre permet à l’Église catholique de continuer à répondre à certaines demandes qui continuent à s’adresser à elle (préparation au baptême, au mariage, équipes d’accompagnement des familles en deuil, voire célébration des funérailles) et à assurer une présence dans certains espaces paroissiaux (permanence, notamment en l’absence de prêtre résident) et extra-paroissiaux.
D’un point de vue quantitatif, on ne peut guère avancer de chiffres précis. Nicolas de Brémond d’Ars évoque des centaines de milliers de bénévoles pour le catéchisme, les liturgies et leur préparation, ainsi que les services liés à la solidarité. Il souligne surtout que lorsque des évaluations sont avancées, celles-ci manquent de fiabilité du fait des moyens de collecte « trop artisanaux » avec lesquelles elles ont été produites 35. Quoi qu’il en soit, on peut avancer que parmi ces bénévoles se trouve un nombre important de seniors et l’on peut s’interroger sur la capacité de renouvellement de cette génération.
Mieux comprendre la(les) rupture(s) générationnelle(s)
Le texte de présentation du colloque évoquait les « deux générations » pendant lesquelles la décomposition des chrétientés occidentales s’est produite. Faire référence à ces deux générations est moins une façon de marquer la durée (même si l’on peut souligner la rapidité avec laquelle la déprise catholique a eu lien dans notre pays, tant en terme d’appartenance que de pratique) qu’une manière de renvoyer à un moment particulier de l’histoire du catholicisme français. Parmi les frontières qui ont contribué à bousculer même les « bastions les mieux assurés » du catholicisme, se trouvent indéniablement celle qui sépare les sexes et celle qui sépare clercs et laïcs, mais également une frontière générationnelle. Or, en France, la sociologie des religions s’est beaucoup moins intéressée à la question des générations que cela n’a été fait au Canada, comme le montre remarquablement la contribution de Solange Lefebvre dans ce volume.
34. Ibid., p. 101.35. Nicolas de BRÉMOND d’ARS, Catholicisme, zones de fracture, Paris, Bayard, 2010, p. 23.
66 LA DÉCOMPOSITION DES CHRÉTIENTÉS OCCIDENTALES
Effets d’âge, effets de génération
En bonne sociologie 36, on distingue généralement les effets d’âge et les effets de générations. Il s’agirait notamment de mieux distinguer les deux processus. Il s’est indéniablement opéré une rupture avec le catholicisme, à partir de la génération du baby-boom. Mais n’assiste-t-on, au moins chez certain-e-s à un retour à la pratique à la fin du cycle de vie ? On observe en effet à un léger renforcement de la pratique avec l’avancement en âge 37, qui pourrait être lié à une plus grande disponibilité rendue possible par la sortie de la vie active ou à une proximité croissante avec la mort.
Du point de vue des enquêtes quantitatives, on a ici très largement affaire à un « point aveugle » comme le souligne Claude Dargent, qui s’est notamment interrogé sur un éventuel lien entre l’élévation du niveau de diplômes (liée au processus de massification scolaire) et la baisse de la religiosité : « [...] les données EVS établissent que, si les jeunes sont beaucoup moins religieux que leurs aînés, ce n’est pas parce qu’ils sont davantage instruits. La dimension générationnelle de la baisse de la pratique n’est donc pas fondée sur la scolarisation : le fait que la question des origines de ce processus constitue donc aujourd’hui un point aveugle condamne à la prudence quant à l’anticipation des évolutions à venir » 38.
Yves Lambert est certainement le sociologue qui s’est le plus attaché à rendre compte, à partir de l’analyse de données quantitatives, du processus de déclin du catholicisme entamé par la génération du baby boom et qui a ensuite gagné les autres classes d’âge. En s’appuyant sur l’analyse longitudinale des sondages et l’analyse comparée de mêmes cohortes (dans le cadre des enquêtes EVS de 1981 et 1990), il s’est ainsi efforcé de distinguer les effets liés au cycle de vie (c’est-à-dire à l’avancement en âge), les effets de période (la conjoncture, des événements particuliers qui marquent l’ensemble des individus quel que soit leur âge) et les effets de génération (de cohorte) 39. Il en conclut que ce recul résulte « à la fois d’un effet de période (concernant tous les âges), amorcé dès la fin des années soixante, et d’un effet de renouvellement des générations, chaque nouvelle
36. Voir tout particulièrement Karl MANNHEIM, Le problème des générations (édition originale de 1928, traduction de l’allemand par Gérard MAUGER et Nia PERIVOLAROPOULOU), Paris, Armand Colin, 2005 ; Claudine ATTIAS-DONFUT, Générations et âges de la vie, Paris, PUF, 1991.
37. Xavier NIEL, « L’état de la pratique religieuse en France », Insee Première, n° 570, mars 1998.
38. Claude DARGENT, « Déclin ou mutation de l’adhésion religieuse ? », dans Pierre BRÉCHON et Olivier GALLAND, op. cit., p. 228.
39. Yves LAMBERT, « Âges, générations », art. cit.
C. BÉRAUD – Le catholicisme français à l’épreuve du vieillissement 67
génération étant moins religieuse que la précédente » 40. Il pointe également la « cassure due à l’effet de génération du baby-boom » 41.
Yves Lambert met en évidence un moment significatif d’inflexion lors de la seconde moitié des années 1960, avec notamment une baisse des taux de pratique. Un second moment est repérable après 1975 : le taux d’appartenance au catholicisme, qui s’était jusqu’alors plutôt bien maintenu, connaît un certain affaissement. La tendance à la baisse, tant de la pratique que de l’appartenance, s’accentue à partir de 1986. Dans une perspective comparée, la France apparaît en Europe comme « le pays où les effets de génération et les inflexions de tendance sont les plus intenses […] » 42.
Génération(s) de la rupture
Il y a pourtant beaucoup à faire pour rendre compte de manière qualitative du devenir de la génération de la « cassure ». On disposait déjà des recherches de Martine Sevegrand 43 sur les départs de prêtres entre 1945 et 1978, départs qui atteignent un pic en 1972. En ce qui concerne les laïcs, on en sait désormais davantage sur ceux qui se sont tenus « à la gauche du Christ » 44. « À partir de 1975, dans les institutions et les mouvances de la gauche chrétienne, désenchantement et épuisement militant vont de pair, logiquement, avec des départs assez nombreux, donc avec un affaissement numérique », conclut Jean-Louis Schlegel 45. Il souligne aussi le peu de connaissances que l’on a et le peu de moyens dont on dispose du point de vue des archives pour rendre compte de leur parcours croyant ultérieur : « On ne sait pas très bien ce que deviennent chez eux la foi et les convictions religieuses ». Certains se retrouvent aujourd’hui parmi les écologistes ou les altermondialistes notamment 46.
Il faudrait décrire précisément les différentes formes de sortie du catholicisme : marquée par des prises de parole ou au contraire silencieuse, sur la pointe des pieds (selon un « processus d’éloignement intérieur qui
40. Yves LAMBERT, « Des changements dans l’évolution religieuse de l’Europe et de la Russie », Revue française de sociologie, 45-2, 2004, p. 307.
41. Yves LAMBERT, « Âges, générations… », art. cit., p. 548.42. Ibid., p. 552.43. Martine SEVEGRAND, Vers une Église sans prêtres. La crise du clergé séculier
en France (1945-1978), Rennes, PUR, 2004 ; voir également Yvon TRANVOUEZ, « Abchristianisation. Écarts et départs dans le clergé breton (1960-1990) », Ethnologie française, vol. 42, n° 4, 2012, p. 761-770.
44. Denis PELLETIER et Jean-Louis SCHLEGEL (dir.), À la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, 2011.
45. Jean-Louis SCHLEGEL, « Vers la fin d’une parenthèse ? », ibid., p. 562.46. Denis PELLETIER, « Les "chrétiens de l’autre bord" », ibid., p. 7.
68 LA DÉCOMPOSITION DES CHRÉTIENTÉS OCCIDENTALES
a souvent pris la forme d’un abandon silencieux et non d’une séparation bruyante » 47) ; éventuellement suivie par des réinvestissements militants non ecclésiaux. Ainsi, on parle souvent d’un « exode des femmes » 48, consécutif à Humanae Vitae, l’encyclique de Paul VI qui en 1968 condamne les méthodes de contraception dites « non naturelles ». Mais aucune enquête, du moins en France, n’est venue directement le documenter. Quelle est alors la part des femmes qui ont quitté l’Église ? Quelle est la part de celles qui, sans partir, ne se sont plus senties tenues par ses commandements ? Pour mener à bien une telle recherche, on pourrait recueillir des récits de vie. D’un point de vue méthodologique, les choses ne sont pas simples : on peut en effet considérer que la plupart de ces ancien-ne-s catholiques « n’éprouvent spontanément, ni le besoin de revendiquer ce passé, ni la nécessité de s’en distancier, ni l’intérêt de s’en expliquer » 49.
On gagnerait aussi à s’intéresser précisément à la question de la transmission intergénérationnelle. Pourquoi les baby-boomers qui sont restés n’ont-ils, pour beaucoup d’entre eux, pas transmis à leurs enfants appartenance et pratique ? Comment expliquer que les catholiques d’identité semblent avoir mieux réussi en la matière que les catholiques d’ouverture ? Là aussi, des récits de vie pourraient être recueillis, en travaillant par exemple au sein d’une même famille auprès de représentant-e-s de différentes générations 50.
Enfin, on pourrait étudier en quoi les années 1970, celles de la « crise catholique » 51, constituent une référence repoussoir pour les générations plus jeunes qui, sans l’avoir connue directement, en font la source de la déprise catholique en France et ont un discours souvent très critique par rapport à leurs aînés. La frontière entre le « pôle de l’ouverture » et celui de « l’identité », pour parler comme Philippe Portier 52, entre le « régime des témoignages » et celui « des certitudes » pour reprendre des expressions de Jacques Lagroye 53, est en grande partie une frontière générationnelle. Si les logiques d’entre soi prévalent souvent (sur le mode d’une sociabilité
47. Yvon TRANVOUEZ, art. cit., p. 761.48. Jean-Louis SCHLEGEL, « Changer l’Église en changeant la politique », dans D. PELLETIER
et J.-L. SCHLEGEL, op. cit., p. 290.49. Yvon TRANVOUEZ, art. cit., p. 762.50. Une enquête de ce type est actuellement conduite par Guillaume Cuchet.51. Denis PELLETIER, La crise catholique. Religions, société, politique en France (1965-
1978), Paris, Payot, 2002.52. Philippe PORTIER, « Pluralité et unité dans le catholicisme français », dans Céline
BÉRAUD, Frédéric GUGELOT et Isabelle SAINT-MARTIN (dir.), Catholicisme en tensions, Paris, Éditions de l’EHESS, 2012, p. 19-36.
53. Jacques LAGROYE, op. cit.
C. BÉRAUD – Le catholicisme français à l’épreuve du vieillissement 69
affinitaire, autour de paroisses et de groupes le plus souvent liées à des communautés nouvelles) et si les conflits intra-ecclésiaux se trouvent généralement euphémisés, il ne faudrait pas sous-estimer cette frontière interne.
L’état des lieux démographique du catholicisme français peut sembler un peu rude. La situation est particulièrement critique en ce qui concerne le clergé et elle n’a aucune raison de s’améliorer prochainement. Au contraire, comme le souligne Jean-Michel Coulot, secrétaire général adjoint de la CEF, « le pic de vieillissement des prêtres est devant nous » 54. Même des diocèses particulièrement bien dotés en forces sacerdotales, comme celui de Paris, devraient en sentir les effets. C’est ce que soulignait le cardinal Vingt-Trois dans l’homélie qu’il a prononcée lors de la messe d’ordination du 30 juin 2012 : « Dans les années qui viennent, un grand nombre des plus anciens seront arrivés au bout de leurs forces. Qui viendra reprendre leur mission ? Comment l’Église pourra-t-elle nourrir et développer l’action des laïcs si les sacrements les plus nécessaires à la vie chrétienne ne sont plus célébrés que de manière épisodique et aléatoire ? »55 S’il demeure encore de jeunes catholiques pratiquants (tout comme existent également des prêtres de moins de 50 ans), ils sont au sein de leur classe d’âge très minoritaires. Le catholicisme d’identité qui est le leur heurte parfois leurs aînés. Leur âge et leur dynamisme suscitent, à chaque session des Journées Mondiales de la Jeunesse, la curiosité des médias, qui (re)découvrent alors qu’il reste encore des catholiques en France et qu’ils ne sont pas tous des seniors.
54. La Croix, 8 février 2012.55. Cité dans La Croix, 5 septembre 2012.