Le lien père-enfant à l'épreuve de l'incarcération, Mémoire M2 Sociologie
Transcript of Le lien père-enfant à l'épreuve de l'incarcération, Mémoire M2 Sociologie
Master 2 de sociologie Mention Genre, politique et sexualité
Le lien père-enfant à l’épreuve
de l’incarcération
MEMOIRE RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION DE MADAME IRENE THERY
MARINE QUENNEHEN
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2013-‐2014
2
SOMMAIRE
INTRODUCTION 6
ETAT DE LA QUESTION 10
Evolution historique de la paternité 10
Connaissances sociologiques autour de la paternité 12
Paternité, un problème sociétal ? 15
Paternité, précarité et prison 17
Problématique, Hypothèses, Plan 19
I. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE : TERRAIN, ENTRETIEN ET TRAITEMENT
DES DONNEES 22
A. L’ENTREE SUR LE TERRAIN 22
De la négociation de l’entrée à l’autorisation d’accès 22
Appréhender le milieu carcéral 23
Justifier sa présence et son sujet d’étude 26
B. LE CHOIX DE L’ENTRETIEN COMPREHENSIF REPETE 28
Le choix de cette méthodologie plutôt qu’une autre 28
Réaliser des entretiens en milieu fermé 29
La prise de note 31
Le choix des enquêtés et leurs motivations 33
C. L’ENTRETIEN, AU DELA D’UNE RECOLTE DE DONNEE, UNE RELATION
SOCIALE 35
La typification du chercheur 35
La place des émotions dans l’entretien 37
Le silence des hommes 37
La détresse des pères détenus 39
Rire, connivence, confiance 41
La prise de l’enquêté sur l’entretien 42
Contrôle biographique 42
Séduction, différenciation et emprise sur le discours 45
CONCLUSION : METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 47
II. AVANT LA PRISON : LA CONSTRUCTION DE LA PATERNITE 49
A. L’HISTOIRE FAMILIALE ET SES INFLUENCES 49
Les liens avec le père 50
3
Entre absence et violence 50
Une complicité relative 53
Les liens à la mère 55
Une mère impliquée 55
Une mère absente 57
La présence du beau père/ de la belle mère 58
Le modèle éducatif, entre reproduction et distanciation 60
Passer du fils au père 63
B. DU LIEN CONJUGAL AU LIEN FAMILIAL 64
La parole de la mère, créatrice de père 65
Une mère toute puissante 67
Un soutien nécessaire à la mise en place de la paternité 68
C. DEVENIR UN PERE 70
L’arrivée de l’enfant 71
Pas voulue mais assumée 73
Un projet murement réfléchi 75
La paternité forcée 77
Paternité différenciée 79
CONCLUSION : L’AVANT PRISON : LA CONSTRUCTION DE LA PATERNITE 82
III. ETRE PERE EN PRISON 83
A. LE REGARD SOCIAL 83
La paternité, une identité inexistante en prison ? 85
Tenir son rôle, être un père engagé 88
Une paternité en tension : entre modèle sociétal du père engagé et situation incapacitante. 90
B. UN VECU NEGATIF DE LA PATERNITE 93
Inutilité et perte de confiance en soi 93
L’Absence ou la fin d’une quotidienneté 95
Une prise de décision qui n’existe plus : se sentir irresponsable 97
Effacement de la paternité 101
C. LA PATERNITE, UN POINT D’APPUI 103
Attachement affectif, complicité et fierté 103
Soutenir financièrement : « C’est l’argent qui solidifie l’amour » 107
La paternité entre soutien mental et soutien identitaire 110
Sortir pour l’enfant et se réinsérer 112
CONCLUSION : ETRE PERE EN PRISON 114
4
IV. VECU DE LA DETENTION ET LIEN AVEC L'EXTERIEUR 116
A. LE LIEN DIRECT EN PRISON 116
Le parloir, à la rencontre de l’autre 117
Un lieu peu adapté aux relations familiales 117
Un mal pour un bien 120
Contourner les effets coercitifs de la détention 124
L’Unité de visite familiale, un espace hors du temps carcéral? 127
Les permissions, un retour furtif vers le dehors 131
B. LE LIEN INDIRECT EN DETENTION 134
Le téléphone, un rapport quotidien à l’autre 135
Les lettres 138
Les photos, les dessins : un peu d’eux à l’intérieur 140
C. LE RAPPORT A LA DETENTION 142
Entre secret de famille, tabou et mise en récit de l’incarcération 142
De la maison d’arrêt au centre de détention 146
Le vécu de la détention 151
La détention catastrophe 152
La détention passage 153
La détention tournant 156
CONCLUSION : VECU DE LA DETENTION ET LIEN AVEC L'EXTERIEUR 158
CONCLUSION 159
BIBLIOGRAPHIE 166
ANNEXES 175
REMERCIEMENTS 195
5
Liste des sigles et des abréviations
AP : Administration pénitentiaire
CD : Centre de détention
CIP : Conseiller d’insertion et de probation
CNE : Centre national d’évaluation
ILS : Infraction à la législation des stupéfiants
JAF : juge aux affaires familiales
JAP : Juge d’application des peines
MA : Maison d’arrêt
PEP : Projet d’exécution de peine
QH : Quartier des hommes
QI : Quartier d’isolement
RPS : Remise de peine
SMPR : Service médico-psychologique régional
SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation
UCSA : Unité de consultation et de soins ambulatoires
UVF : Unité de visites familiales
6
INTRODUCTION
La prison n’a rien de neutre, elle fait partie de ces lieux mystérieux qui provoquent à la
fois la fascination et l’aversion. Sujette à de nombreux récits et fantasmes, c’est une sorte de
légende urbaine qui a inspiré de nombreux écrivains et cinéastes1...
Depuis deux siècles, les fonctions de la prison ont évolué pour justifier les sanctions pénales.
Expiation, dissuasion, neutralisation et réadaptation sont les quatre modes de justification de
ces sanctions [Combessie, 20092, 15]3. Aujourd’hui, dans un pays démocratique, la privation
de liberté se justifierait dans l’amélioration du reclus. Mais peut-elle être réellement efficace
sans la coopération des individus4 et dans un contexte de surpopulation ? Les peines
s’allongent5 et force est de constater que la prison ne remplit que partiellement ses fonctions ;
elle a davantage tendance à désocialiser qu’à faciliter la réinsertion. « La prison traite ses
détenus comme la société traite ses prisons et réciproquement » [Ibid, 2009, 94]. Autrement
dit : la société met à distance les prisons, tente de les occulter et les détenus sont confinés
dans un espace censé protéger de leurs exactions ceux du dehors. Celui qui rentre laisse son
habit de citoyen pour revêtir celui de détenu, en perdant au passage, ses autres identités.
Dans cette optique, le concept Goffmanien d’institution totale est t’il toujours d’actualité ?
Définition : « On peut définir une institution totale comme un lieu de résidence et de travail
où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur
pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités
sont explicitement et minutieusement réglées » [Goffman, 1968, 41]. Dans les années 90, sous
l’impulsion de politiques d’inspirations humanistes, des logiques visant au décloisonnement
des prisons sont mises en place et augmenter le nombre d’intervenants en prison [Combessie,
1 Quelques exemples : Les valseuses (1974), Les évadés (1994), Rock (1996), Un prophète (2009), La série Prison Break (2005). 2 Les dates des ouvrages correspondent à la date de l’édition consultée. 3 L’expiation justifiait les châtiments corporels, traiter le mal par le mal, la sanction est tournée vers le passé, vers l’acte commis. La dissuasion, quant à elle, est tournée vers l’avenir, c’est une action préventive qui doit intimider. Elle se base sur la capacité de raisonnement des individus qui au vu des sanctions ne souhaiteront plus réitérer leurs méfaits. Les deux autres logiques, plus récentes, visent à empêcher le coupable de commettre de nouvelles infractions. L’exemple de la peine de mort est le plus probant. « La théorie de la neutralisation est doublement pessimiste, ou, à tout le moins doublement méfiante : elle ne fait pas confiance à l’individu, qu’il faut neutraliser » [Combessie, 2009, 17]. Et enfin, la réadaptation (ou rééducation ou réinsertion) met à la disposition du coupable des outils pour lui permettre de s’améliorer, dans le but de se réinsérer. 4 Le cas de la petite délinquance, très répétitive, avec des courtes peines, est le cas où il s’avère le plus difficile pour créer un cadre pédagogique efficace. 5 Elles durent en moyenne 10 mois. Selon les propos de Jean-Marie Delarue au colloque Liens familiaux et détention le 11/04/14 à l’institut catholique de Lyon
7
2000, 69]1. Ce décloisonnement semble positif : « l’intervenant extérieur adapte son action,
son propos, à la caractéristique de la situation très particulière dans laquelle se situe la
rencontre. Dans certains cas, l’intervention est même spécialement construite en fonction des
caractéristiques de l’enfermement » [Ibid, 2000, 85]. La logique carcérale détermine toutes les
activités qui se déroulent au sein de la prison. Le clivage perdure entre le dedans et le dehors,
conférant au reclus un rôle de dominé, dans la quasi totalité des cas (travail, formation, santé,
famille) « il se trouve en position d’infériorité par rapport à tous les acteurs sociaux avec
lesquels il est confronté en prison » [Ibid, 2000, 87]. La frontière entre la prison et l’extérieur
semble se réduire mais à peine une petite brèche s’est t‘elle ouverte que le système carcéral
s’empresse de la refermer.
Le concept de prisonniérisation2 de Clemmer qui allait de pair avec l’institution totale a
cependant décliné. La prison ne constitue apparemment plus un ensemble « homogène,
cohérent et stable, formant système et agissant sur les individus de manière contraignante ;
cette vision donnant de l’institution carcérale l’image d’un espace de pratiques et de
représentations autonomes » [Joël-Lauf, 2012, 20].
Gilles Chantraine préconise une détotalisation du regard sociologique, il souhaite différencier
les marges de manœuvres crée par la structure sécuritaire et les initiatives personnelles des
détenus. « Ce processus de réduction et de persistance simultanée de l’initiative permet de
comprendre comment la prison reste [...] une institution totale, mais également comment elle
ne dépersonnalise pas pour autant les détenus et ne fait que transposer, voire exacerber au
cœur de la détention [...] les capacités d’initiative différentielles à l’œuvre à l’extérieur de la
prison » [Chantraine, 2003, 382].
Dans la continuité des travaux de Chantraine et Joel-Lauf, ma recherche analysera les
symétries et les continuités qui existent entre le dedans et le dehors, sans pour autant « réduire
l’un à l’autre ». « Tout détenu emporte ce qui faisait, avant son incarcération son identité
sociale et sa personnalité » [Rostaing, 1997]
La prison serait une loupe grossissante de notre société, à une échelle très concentrée, elle
permettrait d’en discerner certaines normes. [Chantraine, 2004 ; Joel-Lauf, 2006, 2007, 2012]
Mon objectif sera la remise en cause de la culture carcérale et visera une meilleure
compréhension du style de vie antérieur.
1 Chapitre issu de l’ouvrage La prison en Changement sous la direction de Veil et Lhuilier 2 « Ce concept renvoie à l’idée d’une culture carcérale qui s’imposerait aux individus à leur arrivée en détention et qui prendrait trois formes successives reposant sur le changement de leurs valeurs et d’attitudes selon le temps d’incarcération : d’abord une opposition aux règles institutionnelles, puis un éloignement des valeurs du personnel pénitentiaire, et enfin un renforcement de la solidarité entre détenus [Clemmer, 1958] ». in Joël-Lauf, 2012
8
Les auteurs, sus-cités, témoignent de l’effritement des murs; le dehors passe progressivement
à travers le parloir, le téléphone, les lettres ou encore le personnel qui les franchit tous les
jours. Il existe aujourd'hui une détotalisation du milieu carcéral. Foucault affirme que la
prison est omni présente à l’extérieur, à travers l’appareil judiciaire, le système de classement,
de notation ou encore de contrôle de la société. [Foucault, 1975] d’où la difficulté d’en faire
un lieu à part.
Mon mémoire, à travers l’étude du système carcéral, s’intéressera plus
particulièrement à la paternité. Celle-ci s’inscrit dans l’institution représentée par la famille
que nous pouvons rapprocher de l’institution carcérale car comme elle, elle est composée
d’ «un ensemble d’actes et d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui
s'impose plus ou moins à eux » [Théry, 2007, 103]. Comme l’institution carcérale, la famille
ne peut être assimilée à l'immobilité ou au passé [Ibid, 2007, 99] car elle possède un caractère
dynamique et en constante évolution. Mais pourquoi s’intéresser à la paternité de personnes
supposées n’attacher aucune importance à leur famille voire même de la négliger ?
Ces jeunes pères tributaires d'un bagage personnel parfois lourd et d'histoires singulières ne se
résument pas à la seule notion de «problèmes». Malgré leurs difficultés, ils restent avant tout
« des individus qui, dans la mesure où ils disposent des ressources nécessaires peuvent
devenir des sujets, acteurs et auteurs de leur propre vie. Encore faut-il que notre vision soit
large et englobe toutes les caractéristiques de la vie de ces pères » [Devault et Al, 2003, 52].
Cette recherche dépasse la simple démonstration de la difficulté d’exercer un rôle paternel à
cause du cumul des risques. Elle s’attache à travers les histoires singulières de chaque détenu
à comprendre leurs trajectoires. Ces récits de vie relatent leur façon de concevoir, percevoir,
assumer et vivre leur paternité qui n’est pas figée mais en constante évolution « il est donc
souhaitable de ne pas sous-estimer les liens que le père peut construire avec son enfant et ceux
que l’enfant, en retour, peut construire avec lui » [Zaouche-Gaudron Chantal, 2002, 43].
L’approche de la paternité en milieu carcéral s'avère d’autant plus captivante qu’il s’agit
d’hommes coincés entre deux institutions, la famille et le système de justice pénale [Tripp,
2009, 27].
La paternité des hommes détenus a été peu traitée en France alors que la maternité des
femmes détenues a bénéficié de multiples études. Parler de ces hommes, c’est inévitablement
s’intéresser à la nature de leur délit, une variable parmi d’autres qui ne détermine pas le vécu
de la paternité. Le besoin direct des détenus est quant à lui ignoré ou négligé. Le statut
familial du détenu est écarté pour ne laisser qu’à celui d’individu incarcéré difficilement
conciliable avec ses autres identités. Il me semble crucial de recentrer l'attention sur l’individu
9
lui même et sur ses attentes vis-à-vis de la détention. Les pères constituent un groupe qui
existe, sans exister [Lemieux, 2010] car il n’est pas homogène.
Avant tout, je souhaite établir une précision terminologique sur un terme qui a ma
prédilection, en effet je préfère parler de « lien » plutôt que de « relation». Le mot “relation”
implique un rapport entre deux personnes, considérée respectivement l’une par rapport à
l’autre, un lien signifie ce qui attache et unit. Il représente une dépendance réciproque entre
les individus ; les liens sont pluriels. « Prendre en compte les liens affectifs personnels
conduit à analyser l'ensemble du réseau relationnel de l'individu comme une toile tissée à
partir de lui et constitutive de son «moi ». [Paugam, 2013, 59]. Ce « moi » découle du
« nous ». Mon étude, outre que d’analyser les rapports que les détenus entretiennent avec
leurs proches et surtout leurs enfants s’attachera à comprendre les moyens mis en place pour
maintenir ces liens physiques ou symboliques en dépit des contraintes de l’institution
carcérale [Joël, 2006]. Comprendre et étudier le lien social n’implique pas seulement
d’analyser la multiplicité des liens et leur intensité « mais aussi leurs fragilités et leurs
éventuelles ruptures » [Paugam, 2013, 79].
Cette étude est le prolongement de la pré enquête que j’ai mené lors de mon mémoire de
première année. Celui-ci portait sur la paternité en milieu carcéral, une recherche ambitieuse
que j’ai souhaité prolonger en deuxième année, me permettant d’en affiner les contours. Pour
mes enquêtes, je me suis rendue deux ans au Service médico-psychologique régional (SMPR)
de Fresnes et dans le centre pénitencier de Liancourt. J’ai réalisé 93 entretiens avec 45
détenus différents rencontrés chacun en moyenne deux fois1. Ces deux terrains m’ont permis
de me familiariser avec le milieu carcéral.
Ma recherche n’a pas pour objectif de dénoncer les conditions de vie en prison ou d’illustrer
le concept d’institution totale mais, dans la mouvance de Combessie de tenter de « refroidir sa
plume »2 et d’atteindre une impartialité scientifique. La prison détermine les relations entre
les pères et leurs enfants, ce présupposé semble erroné. Elle peut avoir une incidence sur les
relations père-enfant, en accentuant les ruptures ou en créant des rapprochements. Ma
démarche s’inscrit dans le prisme du milieu carcéral pour comprendre les enjeux qui s’y
jouent. Le point essentiel de ma recherche est d’analyser le vécu de la paternité en prison
d’hommes.
L’état de la question va permettre de rentrer progressivement dans mon sujet et faire émerger
les questions et les hypothèses qui ont guidé mon terrain. 1 Je développerai ma méthodologie dans le premier chapitre 2 COMBESSIE Ph., 1996, Prisons des villes et des campagnes, Paris, Éditions Ouvrières. In Chantraine Gilles. La sociologie carcérale : approches et débats théoriques en France. In: Déviance et société. 2000 - Vol. 24 - N°3. pp. 297-318 P312
10
ETAT DE LA QUESTION
Evolution historique de la paternité
La paternité est un concept dont le sens est multiple, aucune définition ne saurait figer
ses nombreuses représentations. Tous les auteurs s’entendront pour dire qu’il serait vain
aujourd’hui de parler de « La » paternité en pensant qu’elle représente une réalité uniforme,
identique pour tous. Il existe aujourd’hui de multiples façons d’être père qui dépendent elles
mêmes de multiples facteurs : socioculturels, familiaux, conjugaux et personnels [Queniart,
2002, 11].
Prenons quelques points historiques pour comprendre l’évolution de la figure paternelle.
La période du Moyen-âge jusqu’à la Renaissance a marqué l’aboutissement d’une longue
évolution où le père apparaît plus que jamais le garant de la stabilité de la famille et du
royaume [Delumeau, Roche, 2000, 11]. Le père est une image de Dieu sur terre, il engendre,
nourrit, éduque et instruit. L’Eglise met un point d’honneur à faire du «lien biologique, le
support nécessaire de la paternité » [Ibid, 2000, 54] et la fin du Moyen-Age marque la
primauté du sang ; le « bâtard » est sans famille, il n’a pas un père qui l’a reconnu.
Nous sommes face à un père incontestable.
Plus tard, les hommes de la Renaissance inaugurent de nouveaux rapports : « la paternité
désormais s'intériorise et y gagne une valeur symbolique. Le lien du sang se distend; le père
biologique cède la place au père éducateur et au père spirituel. » [ibid, 2000, 88]. C’est le
statut moral qui prime avant tout, le père a des devoirs envers ses enfants dès lors qu’il veut
bien les assumer. Il doit les nourrir, les éduquer, les corriger et en faire ses héritiers.
Progressivement, les pères quittent l’aspect exclusivement statutaire pour établir une relation
basée sur l’échange. Les humanistes à l’image de Montaigne et d’Erasme décrivent les joies
et les peines d’être père.
Du XVIème au XVIIIème siècle, l’image bienveillante du père et le vécu affectif des liens
s’établissent davantage. Nous pourrions penser qu’à cette époque les pères étaient peu
impliqués, sans aucune sensibilité mais notre vision serait faussée par nos stéréotypes et nos
comportements actuels. De nombreux récits décrivent « les figures du père devant la
naissance et la mort de ses enfants, du père dans la vie quotidienne, du père révélé par son
11
fils » [Ibid, 2000, 197]. Ces textes nous révèlent les sentiments et les états d’âme de ces
hommes.
La moitié du XVIIIème siècle va inscrire de nouvelles transformations du père, les sentiments
s’emmêlent, là où la tendresse et la sévérité étaient complémentaires, les références
s’estompent et les figures de pères se diversifient. Les règles vont devenir plus strictes et fixer
le père comme le personnage essentiel de cette société nouvelle, le seul titulaire des droits
énoncés par le Code. L’article IV du Préambule de la constitution de l’an III (1795) énonce
que « Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon ami, bon époux » [Ibid, 2000,
289]. L’enfant illégitime n’a aucun statut car seuls priment les liens unis par le mariage.
La révolution va marquer un nouveau tournant, la paternité se définit désormais par la volonté
d’être père, les juristes de l’époque la définiront comme un élément social, ce que
Cambacérès nomma « la paternité civile ». [Delumeau, Roche, 293]. Être père, être mère ne
dépend plus du sang.
L’idée principale est que l’enfant a autant besoin d’amour que d’éducation, « le droit
révolutionnaire se préoccupe d'abord du père vivant, du père éducateur, du père aimant », de
ce fait « la paternité est entièrement déterminée par le bonheur et le bien-être du jeune
enfant » [P300]
Mais cette « utopie révolutionnaire » comme l’appelle Mulliez [Ibid, 2000, 295] va faire place
à une régression du code civil en 1803, valorisant à nouveau la prédominance du mariage,
seul celui-ci désigne le père. L’article 312 déclare que « l’enfant conçu dans le mariage a pour
père le mari ». Ce retour à la tradition implique une autre résurrection: celle de la « puissance
paternelle» que les juristes révolutionnaires avaient tenté de détruire.
De la fin du XIXème au XXème siècle, une seconde révolution est en cours, « les mutations
de l’économie, le développement de l’urbanisation, la montée de l’industrialisation et le
triomphe du libéralisme économique » [ibid, 2000, 330] vont faire évoluer les modèles, les
représentations et les réalités. Trois phénomènes sociaux vont contribuer à la modification de
la paternité : les formes du mariage et des relations familiales, le changement du droit en
matière de filiation et les nouvelles techniques de procréation.
Le paterfamilias qui avait un droit de vie ou de mort et dominait la maisonnée n’est plus la
seule figure représentative du père, d’autres figures se profilent : le père migrant, divorcé,
absent, carrent... Ce délitement de la force paternelle n’efface pas, pour autant et d’une
manière définitive les pratiques et représentations plus traditionnelles [ibid, 2000, 334]. Il y a
un remaniement de l’image attendu du père, celle du « bon père ». La loi de 1970 qui
substitue l’autorité parentale à l’autorité paternelle tue l’image du paterfamilias. La famille
12
tend à l’indifférenciation des pratiques paternelles et maternelles, interchangeables sur un
certain nombre de points [Ibid, 2000, 381]. Du père puissant ou défaillant se superpose celle
d’un père attaché et engagé envers ses enfants ; les échanges prennent une place
prépondérante. La paternité statuaire laisse place à la fonction paternelle. Une question se
pose : comment les hommes investissent cette fonction ?
La perte progressive de puissance a produit un ensemble de représentations de la paternité à
travers les concepts de père carrent et défaillant, une « accusation généralisée de faiblesse et
d'impuissance portée à l'encontre des hommes. Ils ne sont plus à la hauteur de la grande tâche
paternelle, ils manquent d'autorité, ils sont faibles, absents ou défaillants. En bref, les pères
sont stigmatisés et « humiliés », selon le terme de Claudel » [Ibid, 2000, 385]. Cette
conception revient à dire que bon père rime avec autorité – toute puissante, unique et non
partagée -, à l’image de Dieu et du roi. Autorité qu’il a bel et bien perdue.
Ce rapide retour sur l’évolution de la paternité pointe toute la complexité de ce terme et
m’amène au développement des différentes connaissances sociologiques.
Connaissances sociologiques autour de la paternité
Le rôle du père reste une notion floue, difficile à définir, en devenir et en constante
évolution. La paternité se caractérise par de nombreux aspects : la présence physique, le
soutien financier, la transmission morale et sociale, l’éducation… Chaque individu définit sa
propre position et la façon dont il investit son rôle de père dépend de son histoire personnelle.
Les auteurs contemporains ont pour la plupart dépassé l’idée du pater familias, ou du simple
géniteur pour analyser les différentes logiques qui se jouent dans ce rôle.
Ce qui est certain, c’est que les transformations d’aujourd’hui ne concernent pas seulement les
pères, c’est plus largement la famille et ses composantes qui sont remises en cause.
[Delumeau, 200, 483] Analyser la paternité c’est la replacer dans un ensemble bien plus vaste.
Le paterfamilias, terme issu de la civilisation romaine a hanté les esprits comme une
référence incontournable de la paternité. Progressivement l’Etat a canalisé les comportements
paternels avec des lois : en 1792, les enfants majeurs ne sont plus soumis à la puissance
paternelle, en 1889 est instaurée la déchéance paternelle, les lois de 1898 et de 1935
interdisent les mauvais traitements et la correction paternelle et enfin la loi sur l’autorité
parentale de 1970. Ces différentes lois ont transformé radicalement l’institution du père
[Hustel, 1996, 6] et ont conduit à son morcellement. Nous sommes face à une multiplication
13
des hommes pour jouer le rôle de père : le géniteur, le père légal, le nourricier, l’éducateur
[ibid, 1996]. Cette évolution va conduire certains auteurs comme Hustel à s’interroger :
Signons-nous la « mort du père » ou nous dirigeons nous vers un « nouveau père » ? Cette
dichotomie a comme conséquence de figer le rôle du père, il n’existerait aucune ou peu
d’alternatives, soit il est un « père-exclu » soit un « papa-poule ». Le terme de père carrent va
être au centre des écrits entre 1942 et 1968 et il a largement influencé la représentation des
pères par eux-mêmes. Le « père carrent » se dit d'un homme considéré comme «manquant
absolument » à sa paternité, à son rôle paternel ou encore « qui ne laisse rien à ses enfants (ni
biens spirituels, ni biens matériels). La notion de carence est un constat de type juridique, un
statut possible et particulier du père qui en dénonce l’incapacité relative ou totale. » [Hustel,
1996, 112]. Cette notion met au banc des accusés les hommes, établissant une nouvelle fois
une distinction entre bon père et mauvais père.
Depuis quelques années, la pression s'intensifie dans nos sociétés, les hommes sont soumis à
l’injonction de s’impliquer plus activement dans les soins et la relation affective à l'enfant.
Cette pression sociétale découle de quatre facteurs : « la reconnaissance par la communauté
scientifique de l'impact du père sur le développement de l'enfant ; un souci d'équité à l'égard
des femmes; la revendication paternelle pour une réappropriation de l'intimité avec leurs
enfants et la proportion importante de divorces dans nos sociétés. » [Turcotte et Al, 2001].
La notion d’engagement paternel va être développée par de nombreux sociologues
comme un indicateur de l’implication paternelle. Ce concept comprend trois dimensions: « la
responsabilité assumée par le père dans le soin et l’éducation des enfants; le temps consacré
par le père aux interactions directes avec l’enfant, de nature ludique, affective ou sociale et au
cours des taches parentales; la disponibilité du père envers l’enfant. » [Allard, Binet, 2002,11]
Ce terme a comme avantage de situer la position des individus étudiés mais reste néanmoins
réducteur. Ce modèle ne prend pas en compte l’histoire familiale du père. Pourtant, avant de
devenir un père il a d’abord été un fils.
Les individus sont pris dans des biographies personnelles qui influencent leur propre vécu de
la paternité, d’où l’idée d’héritage. Savoir qu’on est le fils de... permet d’accéder à ses
racines, à une histoire antérieure. Le manque de ces éléments crée indubitablement une
difficulté dans leur rapport à la vie. Aujourd’hui « un nouvel interdit s'érige: l'interdit
d'oublier. » [Sellenet, 2007, 59]. Cette notion d’héritage définit comment l’individu investit sa
paternité selon le modèle qu’il a reçu ou en s’en distanciant.
Ce sont des relations interpersonnelles qui s’entrecroisent et des interconnections entre le
passé, le présent et le futur qui définissent la paternité.
14
La paternité peut-elle être traitée indépendamment de la maternité ? Aujourd’hui nous
attribuons encore la fonction de soin à la mère et la fonction d’autorité au père, amenant
chacun des acteurs à incarner ces rôles parfois même inconsciemment. Ce qui provoque une
segmentation des tâches et des pratiques selon la différence des sexes. Le biologique continue
d’être prépondérant et la culture lui est annexée [Neyrand, et Al, 2013]. Le biologique induit
mais ne détermine pas ; les structures sociales s’y conforment et établissent des attitudes et
des comportements délimitant ce qui est légitime et ce qui ne l’est pas. Ce schéma semble
universel, mais si la fonction d'autorité et la fonction de consolation nécessitent d’être
maintenues pour le bien de l'enfant, rien n'oblige à ce que la fonction d'autorité soit masculine
et la fonction consolante féminine. Dans d'autres sociétés, l'inverse prévaut, sans que les
enfants n’en souffrent [Sellenet, 2007, 13]. Dans ce modèle, le père se trouve quelque peu
évincé car si la société attribue encore les soins et l’éducation à la mère et relie toujours
« amour » à « maternel », la possibilité pour le père de promouvoir ce sentiment est niée.
Neyrand parle de « l’idée de la naturelle universalité de l’amour maternel [comme] le fruit
d’un procès historique qui va s’imposer comme une évidence » [Neyrand, 2000, 121].
L’amour, le soin, l’éducation des enfants représentent le terrain où se joue le plus cette
artificialité culturelle (Delaisi, Lallemand, 1980, 114)1 qui repose sur une socialisation
intériorisée au fil des années.
La notion de parentalité ou travail parental introduit une nouvelle logique pour penser
les fonctions parentales non pas indépendantes du biologique mais moins déterminées. Ces
fonctions qui apparaissaient clairement différenciées autrefois ne le sont plus aujourd’hui. Les
femmes s’investissent dans une activité professionnelle tout autant que les hommes ; elles
sont enclines à faire preuve d’autorité là où les hommes font preuve de tendresse à l’égard de
leurs enfants. Mais l’attachement aux représentations est encore fort, certains répugnent à
investir « une position traditionnellement considérée comme propre à l'autre sexe », une
culpabilité latente est toujours présente [Neyrand et Al, 2013, 32]. Nous sommes
constamment confrontés aux questions : Suis-je un bon père ou une bonne mère ? Suis-je en
mesure d’assurer cette tâche ? Sommes nous capables, aujourd’hui, d’accepter que la
distribution des rôles ne soit pas prédéterminée par le sexe ? [Huerre, 2011, 123] En rendant
une certaine neutralité aux tâches et aux attitudes autrefois associées à la maternité, nous
permettons aux hommes de les investir [Martial, 2009, 96]. Le but n’est pas de chercher une
égalité parfaite car la vie quotidienne ne se divise pas en deux, mais de laisser assez de place
aux acteurs pour investir leur environnement, avec une plus grande liberté. 1 In Neyrand, 2011, 408
15
Certes les hommes acquièrent une certaine flexibilité dans leurs tâches mais la paternité ne
pourra se concevoir indépendamment du lien entretenu avec la mère. En matière de filiation,
il existera toujours une asymétrie des corps, les femmes accouchent, les hommes non. Le
désir de paternité de l'homme est interdépendant de la volonté de la femme. La contraception,
le droit à l’avortement et les nouvelles technologies de procréation ont de plus accentué ces
dissymétries [Castelain-Meunier, 1997, 53]. Le regard social se pose différemment selon qu’il
s’agisse d’un homme ou d’une femme. Comme l'écrit Yvonne Knibiehler, « l'identité
masculine n’a jamais été réduite à la fonction paternelle, alors que l'identité féminine a
longtemps été confondue avec la fonction maternelle» (Knibiehler, 2001, 23)1.
Paternité, un problème sociétal ?
L’évolution rapide de la famille a entrainé de nouveaux questionnements sur la place
du père dans cette constellation (divorce, monoparentalité, pluri parentalité, procréation
médicalement assistée...). Leclerc disait que « la question du père est une question de place
disponible » [Neyrand, 2000], quelle place va-t-il prendre quand le couple n’est plus ? Si la
place du père est complexe au sein du couple, elle ne l’est que davantage en cas de divorce et
de séparation. Agnès Martial a conduit de nombreuses études qui montrent que la situation
conjugale a de nombreux effets sur la relation père-enfant. En 2005, 40% des enfants de
moins de vingt-cinq ans ne voient que rarement ou jamais leur père (Chardon, Daguet et
Vivas, 2008)2. La séparation a d’autant plus d’impact sur la relation selon le milieu
d’appartenance (modeste ou défavorisé). La stabilité d’un homme se construit selon trois
niveaux : le logement, le travail et la famille constituée de la compagne et des enfants
(Bertaux, 1997, 104)3. L’instabilité d’un de ces niveaux peut conduire à des situations
d’exclusions et de vulnérabilités plus fortes pour les hommes que pour les femmes. Les
difficultés qui apparaissent lors d’une séparation ou d’un divorce sont l’organisation
asymétrique de l’espace et du temps ; la résidence quotidienne est encore très souvent
attribuée à la mère. Le père, quant à lui, bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement
classiquement fixé à une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires [Martial,
2013, 39]. Dans cette situation, l’idéal serait de séparer la relation conjugale de la relation
1 In Gross, 2012, 290 2 Martial, 2013, 37 3 Segalen et Martial, 2013, 127
16
parentale. « Certains pères se vivent comme des « parents de second ordre », réduits au rôle
d’« oncle en visite », ou de « parent éloigné » (Arrendel, 1995 ; Queniard, 1999)1, la mère
occupe le rôle principal. » Le degré de conflit et de coparentalité sera déterminant à la
poursuite des relations, le duo parental doit survivre au couple [Théry, 1993 ; Collier et
Sheldon, 2008]. Comprendre la paternité c’est la replacer dans un environnement en
mouvement où elle ne peut être étudiée indépendamment de d’autres variables. Si l’on peut
dire que la paternité est un problème sociétal c’est que l’intérêt supérieur de l’enfant est
largement prôné, la présence du père participerait à son développement et son bien être.
La vulgarisation de la paternité participe au problème sociétal auquel nous sommes
confrontés. Les médias édictent des normes restrictives correspondant à un modèle unique de
la paternité où la singularité des individus ne peut s’actualiser. Les parents se voient dicter des
« bonnes attitudes » qui bloquent leur propre réflexion du « faire famille ».
« Les représentations dominantes dans la parentalité constituent un cadre de référence, des
sortes de cahiers des charges de ce que seraient, ou devraient être, un père, une mère. »
[Neyrand et Al, 2013, 9]. Les problématiques inhérentes aux individus ne trouvent plus leur
place dans ce contexte, un décalage apparait entre leur modèle familial, celui qui est proposé
par la société et celui auquel ils aspirent. Ils interrogent leur situation à travers des normes qui
ne peuvent être généralisables. Ce que l’ouvrage de Neyrand, Wilpert et Tort montre est que
si les familles, les parents changent, les normes n’évoluent pas au même rythme.
Prenons l’exemple des pères immigrés ou fils d’immigrés, à quel modèle vont-ils se
référencer ? Il y a une mise en tension entre le modèle que la société projette et le modèle
qu’ils ont eu. Le « bon père » n’est pas toujours le même que celui du pays d’accueil. En Ile-
de-France, 10 % des communes rassemblent le tiers des immigrés d'origine non européenne,
pour l'essentiel maghrébins, turcs et subsahariens [Lagrange, 2010, 114]. Ces cités sont
devenues des pôles de regroupement où la diversité sociale n’est pas représentée. Les
conceptions de paternité vont découler de ces influences culturelles. Dans la culture orientale
ce terme se définit essentiellement à travers la capacité matérielle à subvenir aux besoins de
l’enfant. « Le père joue un rôle important et occupe un statut particulier en tant que
pourvoyeur et pilier de la maison, c’est par lui que les valeurs socioculturelles transitent et
pénètrent dans le foyer » [Sellenet, 2007, 152]. L’engagement affectif, s’il est présent, n’est
pas constitutif de l’identité paternelle alors qu’il est survalorisé par notre société. A cela
1 in Martial, , 2012, 105.
17
s’ajoute l’importance de procréer en Afrique ; cet acte est décrit comme sacré, indispensable
et essentiel [ibid, 2007, 153]. Notre société attend de ces pères qu’ils assument des rôles
auxquels ils ne sont pas familiarisés. La stigmatisation peut devenir forte. Surtout quand leur
rôle principal, celui de pourvoyeur, n’est plus d’actualité. Le contexte économique dans
lequel nous évoluons complexifie les rapports.
Paternité, précarité et prison
Qu’est ce que la précarité ? « La précarité n'est pas un état mais un « processus» dans
la mesure où elle affecte des individus touchés par la précarisation » [ibid, 2007, 20]. Sellenet
nous explique que le terme de précarité à un caractère polémique, il faut le saisir dans une
approche multidimensionnelle; ce n’est pas juste une mesure économique ; d’autres notions
entrent en jeu : la fragilité, l’instabilité, l’insécurité et la marginalité.
Dans ce contexte comment se proclamer « chef de famille » quand on est un père sans moyen
financier ? La décrédibilisation de son rôle lui fait souvent perdre tout moyen d’actions et de
contrôle. De plus à un revenu insuffisant s’ajoute souvent à un faible degré de scolarité; le
rôle de pédagogue devient nul (Jain et al, 1996)1 , un propos à nuancer car aucune affirmation
n’est possible sans connaitre le contexte de vie de ces pères [Devault et al, 2003].
La précarité professionnelle joue autant un rôle comme « déclencheur d'une crise familiale
que comme organisateur du décrochage des pères après le divorce. » [Neyrand, 2000, 229]
La pauvreté ne suffit pas pour comprendre la paternité en milieu précaire ; c’est généralement
un phénomène plus large d’exclusion sociale qui entraine la détérioration des liens sociaux.
Castel parle du lien entre zone de vulnérabilité (travail précaire et fragilité des soutiens
relationnels) et zone de marginalité, qu’il appelle aussi zone de désaffiliation, marquant
l'ampleur du double décrochage: absence de travail et isolement relationnel [Castel, 1994, 13].
Ces différents facteurs incapacitants sont à prendre en compte dans l’étude de la paternité.
Vivre en contexte de précarité peut conduire à la marginalité et celle-ci accroit les chances
d’incarcération.
Peu de sociologues ont traité la paternité en milieu carcéral ; nous pouvons parler d’un vide
sociologique2. Les études réalisées portent davantage sur le maintien des liens familiaux.
1 TAMIS-LEMONDA, D.S. et N. CABRERA (1999). « Perspectives on Father Involvement : Research and Policy. Social
Policy Report», Society for Research in Child Development, no 2, 1-32. In Devault et Al, 2003, 45. 2 Terme emprunté à JOËL-LAUF , 2012.
18
Ricordeau et Bouchard font le constat que l’incarcération d’un proche produit une précarité
familiale (économique, sociale, morale, affective et sexuelle) ainsi qu’une forte stigmatisation
de la part de l’entourage. La notion de maintien familial est développée pour décrire un
processus qui permet aux détenus de garder un lien avec le dehors pour préparer au mieux
l’après carcéral. La plupart des études posent la question de la réinsertion et de la lutte contre
la récidive par la famille [Ricordeau, 2008, Bouchard, 2007]. Ce processus n’a rien d’évident;
à ce titre, Ricordeau, dans une démarche plutôt militante, interroge les fonctions du système
pénal et carcéral en s’appuyant sur trois variables : l’isolement du délinquant (qui menace de
briser les liens naturels d’affections et de solidarité), la punition et la rééducation. Sa position
radicale due à la dimension autobiographique de sa thèse, décrit une prison qui détermine les
actions des individus. L’auteure exacerbe les dysfonctionnements du milieu carcéral et met en
évidence les deux préjugés contradictoires de père et détenu, rien ne permettant d’affirmer
qu’il y a une congruence entre délinquance et incompétence parentale.
Ces deux ouvrages prennent racine dans la valorisation du maintien des liens et la critique
matérielle dans la mise en place de celui-ci. Ce positionnement est légitime. Bouchard a fait le
choix de réaliser son enquête dans les maisons d’accueil des familles tandis que Ricordeau a
largement mis, trop peut-être, l’accent sur les dysfonctionnements. Nous perdons le sens
donné par les individus aux liens familiaux. Comment sont ils vécus ? Et s’ils sont rompus
peut-on juger cette rupture du seul point de vue misérabiliste ?
Quelques études statistiques ont vu le jour dans les années 2000 ; elles avaient comme
objectifs de décrire l’histoire familiale des hommes détenus [Cassan, Toulemon, 2000 ;
Cassan, 2000] la nature de leurs liens [Desesquelles, Kensey, 2006], le bouleversement de la
vie des familles après l’incarcération d’un proche [Dubéchot, Fonteau, Le Quéau, 2000] et
l’intimité du détenu et de ses proches en droit comparé [Herzog-Evans, 2000]. Ils dressent le
portrait type de détenus issus, pour la majorité d’entre eux, des classes populaires et dont la
moitié environ a moins de trente ans. Ils viennent principalement de familles nombreuses
quittées très tôt et s’inscrivent dans une conjugalité plutôt instable. On apprend que moins de
la moitié d’entre eux vivent en couple et ont autant d’enfant que ceux du dehors. Il y aurait un
cas sur dix de rupture d’union dès le premier mois d’incarcération et à peine la moitié des
détenus en couple voient leurs conjoints au moins une fois par mois. Quant aux enfants, un
tiers seulement d’entre eux, voient leur parent au moins une fois par mois. Six détenus sur dix
ont un proche qui vient au moins une fois par mois leur rendre visite mais un sur dix n’a
aucun contact avec l’extérieur. Le risque de rupture, qu’elle soit conjugale ou familiale, est
augmenté du fait de l’incarcération.
19
Tous ces textes mettent en lumière les contextes familiaux dans les prisons françaises. Le
choix de ces auteurs d’enquêter auprès des détenus et des familles révèle les conséquences et
le vécu de l’incarcération au quotidien aussi bien par l’incarcéré que par son entourage. La
nature du lien ne remet pas toujours en cause les relations entretenues ; des logiques
matérielles sont également à l’origine des ruptures (éloignement, coût, stigmatisation…).
Concernant ma recherche, mon intention n’est pas de dénoncer les dysfonctionnements et la
rupture des liens mais d’étudier la nature de ces liens présents ou non en les recontextualisant
dans les trajectoires personnelles des détenus, leurs représentations et la perception qu’ils ont
de leurs pratiques.
Problématique, Hypothèses, Plan
Ma recherche m’a révélé l’impossibilité d’appréhender la paternité des détenus hors de
leur histoire parentale, de leur relation conjugale, de leur entrée dans la paternité, du sens
donné aux liens entretenus avec leurs enfants et de leur vécu de l’incarcération. Le passé est
relié au présent, la personnalité du détenu avant la prison influence l’évolution de l’individu
dans les murs.
La paternité demeure incompréhensible sans une approche relationnelle [Théry, 2007].
Comme elle s’inscrit dans une multitude de relations, j’ai totalement abandonné une vision
essentialiste de l’individu où il deviendrait père indépendamment des autres. L’idée du filet de
Norbert Elias est révélatrice (Elias, 1939). La paternité est perçue comme un filet composé de
multiples fils reliés entre eux. Dès lors, il est impossible d’expliquer ce réseau à partir d’un
seul fil ; c’est l’association de tous ces fils et leurs connexions qui en donne le sens et la
définition. « Cette relation crée un champ de forces dont l'ordre se communique à chacun des
fils, et se communique de façon plus ou moins différente selon la position et la fonction de
chaque fil dans l'ensemble du filet. » [Paugam, 2009, 57]. Etre père et se considérer comme
tel ne découle pas uniquement d’une volonté de l’être mais de sa propre histoire familiale et
conjugale. Prendre en compte les liens affectifs personnels conduit à analyser l'ensemble du
réseau relationnel de l'individu comme une toile tissée à partir de lui et constitutive de son
«moi ». [Paugam, 2009, 59]. Au début de ma recherche je croyais que les pères tendaient à
ressembler aux mères, qu’ils souhaitaient autant d’implication qu’elles. C’était une grosse
erreur car ils ne réfléchissent pas en termes d’égalité ou de partage des tâches. Ils souhaitent
20
modestement « « avoir un rôle » dans la vie de l'enfant [...] d'où leur sentiment sincère d'être
pleinement investis dans leur rôle paternel, malgré la faiblesse objective de leur participation
aux tâches domestiques » [Bedin, Fournier, 2013], éducatives... Entre paternité et maternité
aucune comparaison n’est possible. Les logiques d’engagement et d’identités se distinguent.
D’où, la raison de donner la parole à ces hommes à travers une démarche compréhensive en
considérant les enquêtés comme des acteurs sociaux et analyser comment « ils se définissent
mutuellement et définissent leur environnement » [Becker, 1985,40].
Plusieurs interrogations sont au fondement de cette enquête : Qu’est qu’être père en
prison ? Quel sens donne-t-on au lien père-enfant ? Que devient ce lien à l’épreuve de
l’incarcération ? Comment évolue-t’il ? Qu’est-ce qui lie le père à son enfant ? Quels sont les
sentiments des pères à l’égard de ce lien ? Quels sont le ou les facteur(s) explicatif(s)
principal(aux) qui détermine(nt) le type de lien entretenu? Les détenus subissent-ils ou sont-
ils maîtres des liens qui les unissent à leurs enfants? Quelle place prend leur trajectoire
personnelle dans le vécu du lien père-enfant ? Comment passent-ils du statut de fils à celui de
pères ? Existe-t-il une homogénéité des représentations et des pratiques de la paternité?
Je pose l’hypothèse que le vécu de l’incarcération dépend directement des liens entretenus
avec les proches et plus particulièrement avec le ou les enfants. La plupart des détenus
souhaitent entretenir des rapports réguliers avec leurs enfants malgré la douleur susceptible
d’être provoquée. L’absence de liens représente souvent la source d’un mal-être. Les liens
entre les détenus et leurs enfants se dégradent ou se renforcent du fait de l’incarcération. Les
liens ne sont donc pas donnés dès le départ mais ils se construisent au fil des interactions, au
gré des circonstances et fluctuent avec le temps.
Le délit n’est pas en corrélation avec la capacité parentale mais influence la pérennité des
liens. La survalorisation et l’idéalisation de la paternité constituent des moyens de « gommer
» le stigmate carcéral et de se distinguer des autres détenus.
Mon mémoire comporte quatre parties que je présenterai brièvement.
La première partie concerne la méthodologie de l’enquête. La réflexion porte à la fois sur le
déroulement de l’enquête elle-même et sur la place de chercheur en milieu carcéral. Ce
passage est essentiel ; il oblige le chercheur à réfléchir sur ce qu’il est, à son empreinte sur le
terrain et au fonctionnent de l’univers qu’il étudie. La compréhension du milieu carcéral est
primordiale ; des logiques et des fonctionnements lui sont propres. Etre chercheuse dans un
milieu d’homme n’a pas été sans influence sur les récits de mes enquêtés. La relation
d’enquête n’est plus une simple récolte de données mais une relation sociale où les émotions
sont omniprésentes.
21
La deuxième partie sera consacrée aux parcours biographiques des détenus avant
l’incarcération. L’étude de l’histoire familiale et conjugale nous permettra d’entrevoir le
contexte dans lequel ces hommes ont endossé leur paternité.
La troisième partie « Etre père en prison » constitue le cœur du mémoire, elle rend compte de
la façon dont les hommes vivent et perçoivent leur paternité par delà les murs. Dans cette
optique, je questionnerai le regard social de l’institution porté sur ces pères, comment un vécu
négatif de la paternité s’instaure ou au contraire se révèle positif et apparaît comme un point
d’appui dans l’institution carcérale.
Dans ma dernière partie « vivre la détention », j’analyserai les liens concrets à travers la mise
en contact du dehors et du dedans (parloir, unité de visite familiale, permission, téléphone,
lettres, objets). Je montrerai comment le vécu de la détention découle du parcours de vie des
détenus et détermine la manière d’être père en prison.
22
I. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE : TERRAIN,
ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES DONNEES
L’enquête présentée dans ce mémoire constitue le prolongement de mon étude réalisée
l’année dernière. Ma recherche de master 1 avait déjà pour ambition de traiter de la paternité
en milieu carcéral mais les quatre mois de terrain à raison d’un jour par semaine étaient
insuffisants pour réaliser une étude en profondeur. C’est pourquoi je choisis de continuer ce
sujet trop peu traité dans les études de sociologie. Cette recherche vise à élargir le champ des
connaissances relativement restreint sur les pères détenus.
A. L’ENTREE SUR LE TERRAIN
De la négociation de l’entrée à l’autorisation d’accès
En travaillant sur le milieu carcéral, je me doutais que ma difficulté première serait
d’entrer sur le terrain, les autorisations sont longues à obtenir. Mais mon année de M1 m’a
permis de mettre un premier pied en prison. Par le biais d’interconnaissance j’ai eu accès à la
maison d’arrêt (MA) de Fresnes par les services médico-psychologiques régionaux (SMPR).
Mon oncle avait pour amie Jacqueline Zinetti, une psychiatre qui a travaillé six ans au sein de
ce service. Elle s’est rendue disponible pour m’aider dans mes démarches et m’a ainsi mise en
relation avec la chef du pôle, le docteur Bodon Bruzel. J’ai effectué un stage de quatre mois à
raison d’un jour par semaine sous la direction de Monique Jung. Malgré la contrainte que
représente une stagiaire et malgré l'inadaptation de mon cursus à une fonction
médicale/psychiatrique, elle a accepté ma présence. A la fin du stage, je lui parlais de mon
désir de continuer mon second mémoire à Fresnes. Elle même, partant à la retraite en
décembre 2013, il s’agissait de trouver un autre psychiatre pour m’encadrer. En acceptant de
continuer cet encadrement, Michelle Lipowczyck a assuré le prolongement de mon enquête.
La convention de stage signée, je me suis rendue une fois par semaine à Fresnes de janvier à
avril.
23
Mon intention était de multiplier les lieux d’incarcérations et de me rendre également
en centre de détention (CD) pour rencontrer des détenus avec des profils pénaux différents et
purgeant de longues peines. A partir d’octobre, j’ai envoyé directement mes demandes aux
prisons de Meaux, Melun, Val-de-Reuil, Argentan, Liancourt, Joux-la-Ville et Châteaudun.
Les deux premières citées m’ont rapidement envoyé une lettre de refus avec ou sans raison.
Meaux s’est justifiée par une incapacité à prendre en charge ce type de recherche. Val-de
Reuil, Argentan, Liancourt et Joux-la-Ville m’ont signifiée qu’ils transmettaient mon dossier
à la Direction interrégionale des services pénitentiaires car les directeurs n’étaient pas en
mesure de prendre seuls une telle décision. Val-de-Reuil refusa finalement mon projet. Dans
l’urgence, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) prit contact avec moi pour
m’expliquer l’impossibilité de s’adresser en direct aux directions des prisons et la nécessité de
passer par un circuit bien défini. Mon interlocuteur, Emmanuel Brillet, chargé du service de
recherche, m’a priée de lui transmettre mon projet de recherche: sujet, objectifs et méthode et
d’établir une liste de prisons susceptibles de m’intéresser. Mon choix se porta sur Liancourt et
Châteaudun malgré l’intérêt d’Argentan et de Joux-la-Ville pour ma recherche mais la
situation géographique de ces prisons (à une trentaine de kilomètres de la gare) rendait leur
accès difficile.
Entre le dépôt de mon dossier en novembre et l’autorisation de la DAP, trois mois et demi
s’écoulèrent. Le 6 mars, enfin, un rendez vous est fixé avec la directrice adjointe du CD de
Liancourt, Madame Lafond et le chef du personnel des surveillants pour présenter mon projet.
A l’issu de l’entretien, j’obtiens l’autorisation d’effectuer ma recherche sur une période de
deux mois et demi. Quant à Châteaudun, malgré l’engouement suscité auprès la directrice
pour mon mémoire, les impératifs de mon calendrier universitaire et un dossier urgent qu’elle
devait traiter ont rendu caduque ma demande.
Effectuer une étude en milieu carcéral c’est être soumis à des contraintes
administratives temporelles et sécuritaires. Il faut de la détermination et mettre en place une
batterie de stratégies.
Appréhender le milieu carcéral
Entrer en prison, n’est pas une chose qui va de soi et malgré mon désir de ne pas
m’attacher à toute la fantasmagorie qui existe autour de ce lieu, c’est avec une émotion
certaine que j’y pénétrais. L’avantage d’étudier un milieu aussi différent du sien tend à rendre
24
cette situation d’apprentissage, un moteur de la recherche. C’est un regard neuf que j’ai porté
sur les codes qui régissent ce lieu. Je ne craignais pas de questionner mes différents
interlocuteurs sur leurs pratiques, leurs points de vue, telle une sociologue candide. Ma
socialisation au monde carcéral a commencé au SMPR. Il convient « de rappeler les deux
orientations principales de ces structures : dispenser aux détenus des soins d’une qualité
équivalente à ceux prodigués à la population générale ; favoriser l’accès aux soins pour
certains détenus qui ont habituellement, en milieu libre, peu ou pas recours au dispositif de
soins psychiatriques. »1
L’avantage de cette organisation est d’être rattachée à un établissement hospitalier avec une
équipe pluridisciplinaire qui dépend du budget hospitalier et jouit de ce fait d’une certaine
indépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire. J’ai réussi à nouer des relations
privilégiées avec les professionnels du SMPR permettant d’ « approcher », d’« apprivoiser »
le terrain mais aussi les populations stigmatisées. [Boumaza, Campana, 2007, 7] J’ai profité
de mon jeune âge et de mon inexpérience au début de ma recherche pour recueillir la
bienveillance de mes interlocuteurs favorisant l’acquisition rapide d’automatismes. A Fresnes,
j’évoluais comme une professionnelle de la santé, obligée de connaître la logique de
rangement des dossiers patients, le fonctionnement des bons (dits aussi « caramels ») pour
accéder aux détenus, savoir comment les tamponner et les remettre à qui de droit2.
La complexité de certains terrains découle des différents codes qu’il faut acquérir. Pénétrer un
terrain inconnu c’est s’éloigner de « l’excellence académique » et « rentrer en contact, voire
en conflit, avec d’éventuels ou de potentiels enquêtés, mais aussi des codes culturels que l’on
n’a pas toujours intériorisés. » [Ibid, 2007, 9]
Cette deuxième année fut d’autant plus enrichissante que je connaissais déjà certains
surveillants et professionnels. Les rouages m’étaient familiers ; cela a facilité mon retour sur
le terrain.
Concernant la prison de Liancourt, les conditions étaient différentes. Le premier jour, un
surveillant m’a guidée et introduite auprès de la responsable des conseillers d’insertion et de
probation (CIP). Après une longue discussion autour du choix des enquêtés et d’un document
de présentation pour qu’ils prennent connaissance de ma recherche, le surveillant m’a conduit
1 http://penitentiaire.free.fr 2 Cela me renvoie directement à mon deuxième jour en prison où la psychiatre me demanda de déposer son bon au surveillant. J’avais réussi à le faire tamponner et j’attendais avec mon bon, imaginant que quelqu’un allait venir à ma rencontre. Comme rien ne se passait, je me risquais à demander à l’un d’eux si c’était à lui que je devais le donner, il me répondît agressivement « non, je suis pas le « rez-de-chau » ». Je compris ainsi qu’un gradé ne pouvait effectuer ce genre de tâche. Pour autant je n’étais pas plus avancée sur la personne à qui le remettre et ce ne fut que cinq minutes plus tard qu’il arriva et prit mon bon. L’agacement du gradé n’a fait que souligner mon ignorance des codes.
25
dans le bureau qui gère les unités de visites familiales (UVF) où j’ai réalisé des entretiens
avec les surveillants s’occupant des parloirs et des UVF. Lors de ma recherche, je n’ai pas eu
accès aux coursives1 ; je suis restée cantonnée à la nef. Je conduisais mes entretiens dans les
parloirs avocats et contrairement à Fresnes, je n’étais pas directement confrontée au milieu
carcéral. Cet espace au mur bétonné évoquait un lieu entre parenthèses, j’étais en détention
sans y être. Il y régnait souvent un silence inhabituel en prison.
Ma liste de détenus en poche, je m’entretenais avec le « rez-de-chau »2 et m’installais dans un
parloir prête à commencer les entretiens. Ce lieu « neutre » de la détention me préservait de la
pesanteur carcérale (bruit, passage des innombrables portes de sécurité, blocage...) mais me
confinait dans un espace qui limitait les interactions entre les différents acteurs et offrait peu
de possibilités d’observations. L’administration n’a t’elle pas fait le choix de m’éloigner de ce
que j’aurai été susceptible de critiquer (conditions de vie des détenus, altercations avec le
personnel...) ? A Fresnes, parce que placée au cœur de la détention, un événement m’a
particulièrement marquée :
« Ma journée se termine, je discute avec un surveillant, quand un détenu qui venait de sa cellule effectue un déplacement pour se rendre à une activité. Un autre surveillant lui ordonne d’aller dans la salle d’attente. Alors que le détenu semble s’y rendre, le surveillant prit d’une impatience l’agrippe par le bras pour le faire avancer plus vite, il le pousse. Le détenu impulsif lui dit « Me touche pas, on me doit le respect » et commence à se débattre. Le surveillant crie et le pousse violemment dans la salle. Le détenu résiste et bloque la porte. Un second surveillant arrive et pousse la porte avec le premier. Le détenu commence à frapper de toutes ses forces contre la porte. Rapidement d’autres surveillants arrivent en renfort. Celui avec lequel je parlais me regarde, souffle et me dit « mais à quoi il joue » en parlant du surveillant. »[Extrait du journal de terrain]3
Cet extrait, montre les rapports parfois tendus entretenus entre les surveillants et les détenus.
Ces relations influencent les perceptions réciproques des protagonistes et modifient la
manière dont la prison est vécue.
A Fresnes je menais des entretiens mais ma place s’inscrivait au cœur de la
quotidienneté des acteurs carcéraux. A Liancourt, les interactions moins nombreuses, une
relative tranquillité ont encouragé de plus longues discussions avec le personnel, chose
impossible dans une coursive où les mouvements sont continuels. L’environnement plus
serein permettait de mener mes entretiens en toute quiétude. A la différence de Fresnes où j’ai
1 Longue gallérie de circulation qui donne sur les cellules, les salles d’activités, les bureaux du personnel... 2 C’est un surveillant en charge des déplacements des détenus. Il a pour mission d’appeler les différents bâtiments et transmettre les rendez vous des détenus aux surveillants concernés. 3 Après cette altercation, le détenu a eu un rapport de l’administration pénitentiaire, mais il a ensuite été court-circuité par l’intervention d’une psychiatre. En prenant sa défense, elle a annulé la possible perte de remise de peine, de note dans son dossier ou dans le pire des cas un séjour au quartier d’isolement. Nous percevons les différents enjeux et les relations qu’ils entretiennent chacun des acteurs.
26
évolué en première division1 pendant mon M1 puis en troisième en M2, à Liancourt j’avais
accès aux détenus indépendamment de leur bâtiment.
L’observation, rare et ponctuelle représentait un point mort de ma recherche. Nous pouvons
nous interroger sur la caractère approximatif de l’appréhension des pratiques [Joël, 2007, 26].
Enquêter en prison c’est prendre en compte les spécificités de chacun des lieux et surtout
négocier sa présence.
Justifier sa présence et son sujet d’étude
Sans comparer systématiquement mon terrain de Fresnes et celui de Liancourt, je note
cependant des différences. A Fresnes, mon rôle de stagiaire du SMPR, sans être clairement
défini, était compréhensible par les surveillants. Parfois, ils m’interrogeaient sur ma fonction
mais c’était rare, le temps leur manquait. Réaliser mes entretiens dans les bureaux attitrés du
SMPR suffisait à justifier ma présence comme tout autre professionnel même si mon statut et
mon travail de sociologue restaient vagues.
La reconnaissance symbolique de la sociologie n’est pas innée et se trouve exacerbée en
milieu carcéral [Joël, 2007]. Les acteurs rencontrés n’ont qu’une vague idée de ce qu’est la
sociologie. Les psychiatres ne comprennent pas le fait de rester deux heures avec un détenu
pour « simplement parler ». La sociologie ne soigne pas alors à quoi sert-elle ?
A Liancourt, une surveillante, sollicitée d’appeler deux détenus pour mes entretiens
m’interrogea sur ma fonction, ma réponse fut sociologue. Regard interloqué, elle prend son
talkie walkie et appelle le surveillant de bâtiment « tu peux m’appeler X, y a sa sociologue qui
l’attend ». Deux choses m’ont marquée : sa difficulté à prononcer ce mot comme si elle ne
l’avait jamais rencontré et l’ironie qu’elle mit dans sa voix. Si je jouissais du statut de
l’intellectuel valorisant à certains égards, il y avait une méconnaissance du statut de chercheur
en sociologie. Ce flou dans l’espace carcéral me collait une autre étiquette, celle de
l’étudiante.
Une autre anecdote montre l’imbrication entre mon flou statuaire et une certaine illégitimité
de mon sujet.
1 Si chaque division à Fresnes semblait avoir une logique, elle demeurait floue avec la surpopulation carcérale. la 1re division nord accueille principalement les détenus qui travaillent en ateliers, ainsi que le quartier arrivant. La 1re division sud accueille principalement les détenus en mandat de dépôt correctionnel et le QI (au fond du rez-de-chaussée). La 2e division accueille principalement les détenus qui viennent du CNE (Centre national d’évaluation) et ceux qui sont en attente de transfert vers d’autres maisons d'arrêt ou établissements pour peine. La 3e division accueille principalement des détenus inscrits au centre scolaire (souvent jeunes), les détenus étrangers et les détenus transsexuels (premier étage sud).
27
« Je discute avec le chef de poste quand un surveillant entre le bureau « Tiens je te présente une étudiante en sociologie, elle fait son étude sur la paternité des détenus, elle me pose des questions, si tu veux lui parler » il me regarde puis répond « qu’est-ce qu’il y a dire sur la paternité ? Ils ne devraient pas être père, ils tuent leurs enfants, les violent, les prostituent ou les vendent » [Extrait de mon journal de terrain]
Cette provocation révèle l’incompréhension de mon interlocuteur vis-à-vis de ma recherche.
Comme l’explique Joël, une suspicion pèse sur l’universitaire ; travailler en prison, implique
d’être catalogué dans le camp des prodétenus [Joël, 2007]. Certains surveillants estiment
d’ailleurs qu’on ne s’intéresse pas assez à eux. Dans la mesure du possible, j’ai essayé
d’instaurer un dialogue et de les inclure dans ma recherche en interrogeant leur point de vue.
Dans cette optique il était nécessaire d’amoindrir mon statut « d’étrangère étudiante », « Il
s’agit [pour le chercheur] à la fois de valider ses intentions, de prouver sa neutralité dont il se
revendique, mais aussi de faire montre de sa capacité à investir le terrain » [Boumaza,
Campana, 2007, 13].
Indépendamment du statut de mon interlocuteur je recevais fréquemment des critiques sur
mon sujet.
La condition si ne qua non pour rencontrer les détenus était de soumettre au Docteur Jung, à
sa demande, une grille d’entretien précise.
« Je lui présente ma grille d’entretien, qu’elle lit soigneusement, entrecoupé de pouffements, et de sourires, elle pose les feuilles et me regarde « Marine, tu sais les détenus ils n’en ont rien à faire de leurs enfants, c’est purement utilitaire, ils vont te dire qu’ils sont de pauvres détenus qui ont besoin de leurs enfants, mais ils ne peuvent pas penser à autre chose qu’à eux, sinon tu penses qu’ils seraient ici. » Elle pense clairement que mon questionnaire va tomber à l’eau et que je suis une grande utopiste. » [Extrait de mon journal de terrain]
Son propos me fait prendre conscience d’une réalité : toute recherche n’a pas le même degré
de légitimité. Etre père et détenu semble à priori contradictoire. Mais recontextualisons la
réaction de la psychiatre : elle approchait de la retraite ; certains détenus suivis par elle,
effectuaient des allers et retours entre le dedans et le dehors en ayant pourtant des enfants.
Elle s’imaginait sans doute, que moi, jeune étudiante, j’arrivais avec mes idéaux et mes
espoirs de réinsertion.
Il est indispensable, néanmoins, de nuancer mon propos ; parfois confrontée à
l’incompréhension de ma recherche et de mon statut par certains, d’autres adoptaient une
attitude d’ignorance à mon égard et d’autres encore, d’une grande curiosité. Mon principal
atout ou attrait : être une femme jeune dans un milieu d’hommes. A de nombreuses reprises,
les surveillants m’ont suggérée de passer le concours de l’administration pénitentiaire ; il n’y
a pas assez de femmes en prison et mon niveau d’étude me permettrait de gravir rapidement
28
les échelons. D’autres membres du personnel profitaient de mon sujet pour me confier leur
propre vécu de leur paternité.
Ma présence était, de ce fait, valorisée par les différents professionnels. L’espace d’échanges
proposé aux détenus répondait à leur fragilité et leur permettait de s’épancher plus
longuement sur leurs difficultés. Les professionnels, quant à eux, surchargés par le nombre
important de prises en charge ne leur offraient pas cette opportunité. Prenons un autre
exemple : un détenu qui demande à voir la psychiatre. Elle, ne désirant pas cet entretien,
m’annonce « Tiens, ça tombe bien, tu vas pouvoir faire un entretien avec lui, il pourra te
raconter ses malheurs »1. Cet exemple a été exceptionnel dans ma recherche et j’ai bénéficié
de nombreux feedbacks des professionnels, me confirmant la surprise et la satisfaction des
détenus qui participaient à ma recherche ; « ça leur faisait du bien » ! « La situation d'enquête
peut être définie comme la rencontre entre une « offre de parole » et une disposition à parler»
[Mauger, 1991].
Ma connaissance du milieu carcéral et de certains codes m’a permit d’affirmer ma
place et de quitter celle de la jeune étudiante en recherche de sensation forte.
Si « Les représentations que se font les individus appartenant à l’organisation étudiée de ces
caractéristiques du métier de chercheur [...] modèlent pour partie les relations entre le
chercheur et ces acteurs » (Cliquennois, 2006) 2 elles sont à même d’évoluer.
B. LE CHOIX DE L’ENTRETIEN COMPREHENSIF REPETE
Le choix de cette méthodologie plutôt qu’une autre
Le recours à la méthodologie qualitative s’est imposé très rapidement ; dans une
perspective compréhensive, il s’agit de laisser de la place aux acteurs pour s’exprimer sur
leurs représentations, leurs pratiques et de ce fait les modèles sociaux intériorisés. L’entretien
compréhensif a l’avantage d’être riche en information et d’introduire de l’humanité, de
l’émotion au recueil de données [Kaufman, 2011, 48].
1 Ce premier entretien ne s’est pas déroulé comme je l’aurai souhaité. Le détenu qui s’attendait à voir la psychiatre pour négocier des médicaments (anxiolytique ou somnifère), ne s’est pas ouvert à la conversation. Il mettait en avant son caractère dépressif pour obtenir ce que je ne pouvais lui donner. Cet entretien fut également perturbé par la conseillère de réinsertion qui avait besoin d’un bureau. L’homme profita de cette opportunité pour « s’enfuir ». Je le croisais un peu plus tard dans les couloirs, il fit mine de ne pas me voir. 2 In Joël, 2007, 37
29
Les thèmes abordés étaient délicats: leur enfance, les rapports entretenus avec leurs parents,
la séparation avec les enfants, la rupture avec la partenaire... Ce type d’entretien s’adapte le
mieux à ces problématiques. Mon objectif: susciter la parole en me centrant sur la personne
interviewée pour rendre compte « des fragments de son existence, de pans de son expérience,
de moments de son parcours, d’éléments de sa situation» [Demazière, 2008, 16]. J’ai répété
ces entretiens dans le temps favorisant ainsi, l’introduction de nombreuses dimensions. Dans
un premier temps, mes questions portaient sur le rapport à l’enfant hors détention, la
grossesse, l’accouchement et/ou les premiers moments de la naissance, l’investissement ou
non dans la relation avec l’enfant et les spécificités du rôle de père. Je désirais également
connaître les rapports que ces hommes entretenaient avec la mère et avec leurs parents. Dans
un deuxième temps, la grille pointait l’imbrication du rôle de père avec la détention. Dans
cette partie, j’incluais les relations en détention par le biais du parloir, des unités de visites
familiales (UVF), des permissions, du téléphone, et des lettres. Mes questions portaient sur les
changements perçus ou non dans la relation depuis l’incarcération. Si la détention avait eu un
impact sur leur rôle de père, que ce soit par une rupture, une distension des liens ou au
contraire, une prise de conscience. Je me suis également intéressée aux relations entre détenus
et personnel pénitentiaire. Ces thèmes étaient interchangeables et s’adaptaient au gré de
l’entretien. En m’intéressant à l’avant carcéral en début d’entretien, je donne à l’enquêté le
gage que je ne focalise pas sur son seul statut de détenu ; la prison ne constitue qu’une partie
de ce qu’il représente à mes yeux.
Revoir régulièrement un détenu n’a pas montré l’évolution de l’individu dans son rapport
familial et pénal, le temps de mon enquête était trop court mais a instauré un plus grand climat
de confiance. Mon objectif est « d’interroger les univers culturels des acteurs, les
représentations qui dominent au sein d’un groupe d’acteurs, et enfin de se pencher sur les
acteurs eux-mêmes, leurs pratiques et les motivations qui les sous-tendent » [Boumaza,
Campana, 2007, 22].
L’entretien compréhensif s’est révélé l’outil qui répondait le mieux à mes attentes, donnant à
voir le cadre perceptif du sujet.
Réaliser des entretiens en milieu fermé
Réaliser des entretiens en prison oblige le chercheur et les détenus à subir les
contraintes de la détention. Parmi celles ci, l’adaptation à la routine carcérale et à la
30
configuration de l’espace où je menais les entretiens arrivaient en tête. J’arrivais à 9 heures, à
11h30 les repas sont distribués, à midi s’effectue le changement des surveillants ou leur pause
déjeuner ; il s’avère difficile de continuer les entretiens après cette heure. A treize heures c’est
l’appel, commencer avant 13h30 est un vrai challenge. Dès lors, des mouvements incessants
débutent : promenade, activité, parloir1 jusqu’à 17h30, heure de nouvelle distribution des
gamelles. Le temps d’attente pour accéder aux détenus est important d’où un temps
d’entretien forcément restreint. J’ai ainsi attendu de trente minutes à plus d’une heure avant
certaines rencontres. L’accès aux détenus dépend également du bon vouloir des surveillants
en charge de les appeler. Les entretiens oscillaient entre une durée de trente minutes et trois
heures. A ces temps d’attente s’ajoutent parfois d’autres incidents inhérents à la prison: les
blocages, les alertes... autant d’obstacles supplémentaires au bon déroulement des entretiens.
Je réalisais mes entretiens dans trois types de lieu : le parloir avocat ou un bureau du SMPR
dans la coursive ou le parloir avocat ou médiatisé dans la nef. Fréquents, le bruit et le passage
de surveillants ou même de détenus; interrompaient souvent les entretiens. La porte en verre
ou le hublot permettait aux personnes extérieures de m’entrevoir. Contrairement à Fresnes, à
Liancourt, l’intimité est davantage préservée. Il faut savoir que « L'espace géographique de
l'entretien reprend alors, pour le rejouer, l'espace social et symbolique des positions des
interlocuteurs» [Chamboredon et Al, 1994, 126]. Dans ce cas, la prison met en évidence le
rapport non pas entre dominant/dominé mais entre celui qui est dedans et celui qui est dehors.
D’une certaine manière, nous pourrions parler d’un discours «carcéralisé» soumis à des
contraintes qui découlent des conditions dans lequel il a été produit. Etre dans les conditions
de la détention et voir interagir les différents acteurs pendant l’entretien est une grande
richesse. L’intrusion d’un surveillant permet en l’occurrence de rebondir facilement sur les
relations entretenues de part et d’autre.
Voici un exemple d’entretien interrompu par un enquêté qui passait par là et souhaitait me
saluer pour mon dernier jour.
« C’était mon dernier entretien, je me suis rendue auprès du surveillant pour lui remettre mon bon et j’ai discuté avec lui en attendant que mon enquêté descende. Quand il est arrivé, nous avons intégré le bureau et commencé l’entretien. Soudain au autre enquêté est passé devant la porte vitrée et m’a fait un signe de la main. Je me suis excusée et suis sortie pour le saluer un instant. Je lui ai donné mon adresse mail car il a exprimé le souhait de lire mon mémoire. A mon retour j’ai constaté que mon enquêté « boudait » ; il m’a expliqué qu’il était jaloux et qu’il espérait être unique, qu’il n’appréciait pas mes relations avec les autres et pensait avoir un rapport privilégié avec moi. Il me raconte d’ailleurs que le surveillant lui avait dit que je devais aller voir l’autre à la fin de mon entretien. Il rétorque « il a pas le droit de te draguer, je vais lui dire qu’il a pas le droit ». [Extrait de mon journal de terrain]
1 j’ai eu la chance de me rendre à Liancourt le lundi, le seul jour où il n’y a pas de parloir, ce qui facilite l’accès aux détenus.
31
Nous notons l’incompréhension de l’enquêté qui imagine avoir une relation privilégiée avec
l’enquêteur. Cette situation montre les enjeux possibles de l’entretien ; dans ce cas c’est la
séduction et l’accaparement du chercheur à des fins personnelles.
J’ai abordé la question de l’emploi du temps rigide de la prison auquel les détenus se
conforment également. Organiser leur temps est une manière pour eux de le maitriser. A
Fresnes, mes entretiens étaient rarement prévus à l’avance ; quand j’appelais les détenus, ils
étaient parfois en pleine activité ; les surveillants n’hésitaient pas à les interrompre et les faire
quitter le travail pour se rendre à l’entretien. Ils se pointaient sans connaître le motif de cette
interruption ; j’étais souvent extrêmement mal à l’aise et l’entretien démarrait parfois sur de
mauvaises bases1. A Liancourt, les détenus connaissaient le jour et l’heure de nos rencontres ;
ils étaient en mesure de procéder à une organisation temporelle.
J’avoue, disposer d’une population captive a également certains « avantages ». Tous mes
enquêtés sont concentrés dans un même lieu et leur manque de distraction joue directement en
ma faveur. Je multiplie les entretiens dans un temps restreint mais cet enchainement est
psychiquement et physiquement éprouvant. Passer d’une personnalité à une autre, demande
une gymnastique cérébrale pour se rappeler les particularités de chacun.
La prise de note
Le choix de la prise de note s’est rapidement imposé car l’usage du dictaphone en
détention implique d’obtenir de nouvelles autorisations. La praticité de cette technique a fini
par me convaincre, en commençant par le gain de temps. L’article de Geneviève Pruvost, La
production d’un récit maitrisé : les effets de la prise en note des entretiens et de la
socialisation professionnelle. Le cas d’une enquête dans la police a largement influencé ma
méthodologie. J’ai multiplié les entretiens en limitant mon temps de retranscription. Mon
matériau était brut mais facile à annoter.
Pendant les entretiens, souvent absorbée par la prise de note, j’ai regretté ne pas pouvoir
relever davantage certaines phrases de mes interlocuteurs. Mes relances étaient de ce fait
limitées mais ma concentration en retranscrivant leurs paroles a donné à mes enquêtés un
temps de réflexion supplémentaire. La difficulté de tenir le silence, les entrainait
inconsciemment à continuer de parler et à poursuivre leur raisonnement. Le dictaphone, au
contraire, implique des relances plus rapides et limite la pensée. « La prise de note est de fait
1 J’ai essuyé un certain nombre de refus de détenus, les surveillants leur disaient que le SMPR voulaient les voir. Certains avaient de mauvaises expériences et ne souhaitaient pas se déplacer. Quand je les revoyais et que je leur demandais le motif de leur refus, ils m’expliquaient qu’ils n’avaient pas compris que l’entretien se déroulerait avec moi.
32
une activité éminemment visible pour mon interlocuteur qui voit bien que je suis attablée avec
un cahier, que je privilégie l’activité d’écriture à l’élaboration d’une connivence yeux dans les
yeux [...] Les [détenus] ont compris que la structure de l’échange, sans être un soliloque,
n’était pas dialogique, puisque mes relances étaient assez brèves. [...] la technique de la prise
de note a contribué à produire du récit de vie. » [Pruvost, 2008, 75]
L’avantage de cette technique est que ce support semble avoir une moindre légitimité et ils
sont directement face à la production de ma recherche. Les acteurs stigmatisés ou évoluant au
sein d’institutions fermées font parfois preuve de suspicion envers le chercheur ; il lui faut
donner des « gages ». Le mien, fut de les rassurer sur l’utilisation des données et de leur
garantir l’anonymat. Le papier n’a pas la même valeur qu’une bande. Certains de mes
enquêtés en attente de jugement auraient pu craindre qu’un enregistrement s’ajoute aux pièces
déjà accumulées contre eux. De plus, les sujets abordés lors des entretiens comme le business
souterrain de drogue en détention, le trafic de portables et leur utilisation leur faisaient
redouter des sanctions de l’administration pénitentiaire. Pour eux, le papier n’a pas le même
impact. L’enregistrement n’aurait peut être pas empêché le récit de ces informations mais la
prise de notes a incontestablement favorisé certaines révélations. Prenons le cas de ce détenu
qui me parle de l’utilisation du téléphone.
« Et tu lui écris à ta fille ? Non, je lui écrivais mais ça doit faire deux mois que je lui écris plus. Je l’appelle, c’est un risque que je prends aussi. Tout le monde a son téléphone, y a des corrompus ici c’est pour ça qu’on en a. C’est mieux, la cabine on est écouté et le soir on skype, on se voit, y a tout. Tout ce qu’on trouve dehors on le trouve dedans. Qu’est ce qui te motive à prendre ce risque ? Avoir ses enfants le soir, le matin, à la sortie de l’école. [...] Bref c’est pour parler le soir, ça la rassure et ca me rassure, après y a pas qu’elle, y a la famille, y a les proches, c’est une bonne façon de s’évader. Mais là y a eu les gendarmes et je vais peut être prendre trois mois de plus. C’est un des risques. D’après les articles de lois c’est pas l’acquisition d’un portable le problème c’est le recel. En soit c’est pas interdit un tel mais ils ont peur des évasions et de pleins de choses. Bientôt ce sera en vente libre. Elle t’appelle d’elle même ? Oui elle m’appelle. On m’a pris mon tel samedi à 13h et à 14h30 j’en avais un autre. » [Romain, 26 ans, séparé, 1 enfant, 4 ans]1
Les risques de subir une peine supplémentaire sont bien présents, même si ce détenu ne les
prend pas en compte. La confiance que m’ont portée certains des détenus découle très
certainement des conditions de l’entretien, la prise de note en fait partie.
Mais les inconvénients de cette technique sont réels : ma capacité à noter est parfois limitée et
la perte d’informations non négligeable. Je suis obligée d’effectuer des choix dans mes
retranscriptions avec à la clé la frustration de ne pas avoir l’exactitude de tous les propos,
d’où une analyse du discours moins fine.
1 4 ans correspond au temps qu’il a déjà effectué au moment du premier entretien. Je garderai cette logique tout au long du mémoire.
33
Comme pour Geneviève Pruvost, lors de l’utilisation de mes données, « les formules
employées et la syntaxe ont été autant que possible retranscrites fidèlement (abréviations
aidant), surtout lorsqu’il s’agissait d’expressions argotiques ou de tournures de phrases
singulières. J’ai été confrontée à un lissage du discours. Le temps court entre mes questions et
mes relances m’obligeait à les supprimer ou les réduire au maximum sur mes feuilles, une
perte que je devais reconstruire après coup. L’analyse des expressions, des non-dits, des
émotions représente un outil supplémentaire, surtout face à une population masculine qui a
parfois des difficultés à mettre en mots des souffrances, où le dicible et l’indicible se mêlent.
Les émotions sont les véhicules des ruptures et des discontinuités : « ces mimiques et ces
gestes font signes [...] c’est pourquoi la souffrance sociale se déploie autant sur le versant
narratif des possibles que sur le versant du silence qui murmure. Lorsqu’une part « du soi »
est en abime » [Laé, 2002]. Le para-verbal a prouvé qu’il est tout autant une présentation de
soi que le discours mais la prise de note ne m’a malheureusement pas permis d’analyser
comme je l’aurais souhaité ces émotions.
Un dernier inconvénient apparaît également avec l’usage de cette technique : le regard des
enquêtés sur les manuscrits. La taille des lieux où je mène mes entretiens favorise la
proximité. Je ne citerais que deux entretiens pour en témoigner, mais ils sont nombreux.
« Je suis un escroc, je fais du mal à personne, je veux m’en sortir. J’ai détourné entre cinq à dix millions d’euros (regarde ma feuille) vous allez pas écrire ça, c’est entre nous. » [Walid, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 15 mois]
« Il regarde sans arrêt ma feuille, il penche même le tête pour réussir à lire, en rigolant je dis : Vous aimez bien lire ce que j’écris ! Oui et puis c’est mon droit (le dit d’une manière agressive), c’est comme les feuilles de constats faut toujours lire avant de signer. » [François, 47 ans, en couple, 1 enfant, 3 ans]
Dans une institution où le droit des détenus est limité, leur emprise sur l’entretien leur donne
un certain pouvoir. La crainte et la méfiance font partie intégrante de ma recherche, il existe
un discours conventionnel et une hiérarchie qui influencent ce qui est révélé à l’enquêteur.
Mais «toutes ses étapes convergent vers un même résultat: le récit n’est pas labyrinthique, il
est de bonne tenue. Il est écrit.» [Pruvost, 2008, 77]
Le choix des enquêtés et leurs motivations
Dans la plupart des cas, la prise de contact avec mes enquêtés n’a pas été de mon
ressort mais celui des psychiatres, psychologues, infirmiers (Fresnes) et des CIP (Liancourt)
qui s’octroyaient un droit de regard sur mon enquête.
34
Lors de leurs entretiens avec les détenus, les professionnels de la santé, si un bon contact
s’établissait entre eux et que le patient a des enfants, lui proposaient de participer à ma
recherche. Munie d’une liste de noms, je les faisais appeler et leur exposais mes intentions.
L’entretien pouvait immédiatement débuter, être reporté ou refusé. A de nombreuses reprises
les détenus ne possédaient aucune information sur ma recherche lors de la première rencontre.
Quant aux CIP, à qui la responsable a parlé de ma recherche, ils ont proposé également
quelques détenus pères susceptibles d’être « intéressants » et d’accepter de participer à la
recherche. Chaque détenu de cette liste composée de 17 noms a reçu une lettre de ma part
présentant ma recherche. Ceux qui ne désiraient pas participer aux entretiens devaient en
référer au CIP. Deux ont décliné ma proposition suivi par deux autres qui se sont désistés au
cours de la recherche.
Cette sélection a forcément été une limite, à prendre en compte, pour ma recherche ; une des
psychiatres m’expliquait que son choix a porté sur des individus calmes. La responsable,
quant à elle, ne souhaitait pas me faire rencontrer des pères incestueux, qui selon elle,
n’auraient de toute évidence aucun lien avec leurs enfants1. Ces choix représentaient des
moyens pour me protéger mais aussi pour éviter d’éventuels problèmes. Mon panel cependant
se composait d’une grande diversité de détenus et des délits commis.
Parmi les motivations diverses et variées, j’en recenserai quatre principales. L’ennui
représente le premier argument : notre entretien apparaît comme un moyen de quitter la
cellule et de rencontrer une « nouvelle tête » ; dans cette optique mon jeune âge et mon sexe
jouent considérablement en ma faveur. Je casse la routine carcérale.
Dans un deuxième temps, l’entretien représente un moyen de se confier. Les détenus sont
nombreux à témoigner leur satisfaction de me parler, disposant rarement d’une oreille
attentive à qui s’adresser ; les relations avec les surveillants et les codétenus sont souvent
superficielles ou peu propices à la confidence.
D’autres détenus cherchent à instrumentaliser l’entretien, pour se faire bien voir et espèrent
même obtenir des remises de peines2 ou encore visent à dénoncer les conditions de détention.
L’entretien représente, enfin, un moyen de se différencier, ma recherche leur confère un
certain prestige ; le chercheur revalorise le statut de détenu en lui donnant un sens et fait de
l’enquêté un individu à part entière le séparant de la masse carcérale dans laquelle il tend à se
1 Si un individu commet un inceste ou tue l’autre parent, il est déchu de ses droits parentaux, il n’a donc à priori aucune visite de sa victime. 2 Un détenu que je rencontrais pour la deuxième fois me dit « Tu peux me faire une attestation pour ça, là je vais passer en commission le 4 juin, ce serait bien dans mon dossier. La juge est sévère mais qui ne tente rien n’a rien, c’est donnant donnant ils aiment bien les démarches comme ça. Tu as fais la recherche avec moi pour ça ? Non je ne l’ai pas fait pour ça, pour t’aider et j’avais rien à faire mais ça ferait bien dans mon dossier. [Romain, 26 ans, 1 enfant, séparé, 4 ans]
35
fondre. « Dès lors l’enquêté se sent donc digne d’intérêt non seulement en tant que personne
mais également en tant que détenu, et ceci est particulièrement important pour des personnes
qui tentent parfois de rejeter ce statut de toutes leurs forces et qui ont fortement intériorisé le
stigmate touchant les populations incarcérées. » [Joel-Lauf, 2007, 42]
L’aspect éphémère de ma présence en prison a permis de garder une certaine distance par
rapport à l’impact des confidences.
C. L’ENTRETIEN, AU DELA D’UNE RECOLTE DE DONNEE, UNE
RELATION SOCIALE
Cette réflexion sur la place du chercheur dans son enquête apparaît a priori comme une
auto légitimation ou une tendance nombriliste [Don Kulick, 2011] mais elle permet de saisir
la spécificité de l’expérience. « Un être humain particulier qui rencontre d’autres êtres
humains particuliers, à un moment historique particulier, et qui a des intérêts particuliers dans
cette interaction » (Kondo, 1990, 24)1. Ces considérations incarnent et activent la théorie.
Appréhender la production de données c’est questionner les représentations et les pratiques
des acteurs. La situation d’enquête est tout sauf naturelle, elle place l’enquêteur dans une
relation sociale à la fois artificielle et inédite [Beaud, Weber, 2010, 83].
La typification du chercheur
« Pour Peter Berger et Thomas Luckmann, toute personne en situation de relation
sociale est conduite à typifier son interlocuteur, c’est-à-dire à le classer dans une catégorie et à
définir ses attentes, son comportement et son langage pour s’adapter à lui : c’est ce qu’ils
nomment la « typification réciproque ». (Berger, Luckman, 2003) 2
Les détenus m’ont attribuée naturellement quatre rôles assez distincts les uns des autres : la
conseillère, l’étrangère, la copine et l’intellectuelle3. Ces rôles différents influence chacun à sa
manière le discours du détenu, le dernier, par exemple, était susceptible de bloquer la parole.
1 In Don Kulick, 2011 2 in Joël, 2007, 35 3 Ces deux dernières typifications se retrouvent aussi dans l’enquête de M2 de Joël, 2007.
36
Ces assignations de place varient au cours des entretiens et représentent un phénomène central
dans l’enquête, qu’il s’agit d’objectiver. [Beaud, Weber, 2010, 220]
La première typification me place en position de « connaisseur », c’est-à-dire sachant mieux
que l’enquêté comment faire des démarches administratives, judiciaires... Cette position me
mettait souvent dans une situation délicate de partie à prendre, de questions à esquiver ou de
procédures que je faisais mine d’ignorer. Elle s’applique à une position thérapeutique où
l’enquêté témoigne de ses souffrances et de ses malheurs dans l’espoir d’une aide de ma part.
« Mon but c’est de m’en sortir, j’ai payé mes méfaits. Je suis courageux et naïf je me suis rendu. Vous savez avec tout cet argent, j’ai fait n’importe quoi, première overdose à 18 ans, l’argent ça fait des dégâts, on fait n’importe quoi et j’ai fumé ma vie comme une cigarette, elle est partie en cendre. Vous pourriez pas appeler ma femme pour l’aider, pour essayer de lui trouver un appartement, en discuter avec elle savoir comment elle va, et elle vous parlera de moi, de qui je suis. Je suis désolée je n’en ai pas les compétences. Ah d’accord, je pensais que...
1 Vous savez je suis suivi par l’éducatrice, mais elle manque
d’expérience elle est pas réglée comme une montre suisse, mais elle me file un coup de main pour mes démarches. » [Walid, 37 ans, en couple, 4 enfants]
« Tes problèmes tu peux en parler à quelqu’un ? Non y a que à toi, depuis que je travaille, je vois plus personne. Je n’écris même pas, c’est comme pisser dans un violon et puis y a pas de suivi. La psy elle est con elle se prend pour le chef » [Laurent, 38 ans, marié, 2 enfants, 8 mois]
La seconde typification est plus complexe, elle me donne une extériorité au contexte carcéral,
n’étant ni psy, ni liée à l’Administration pénitentiaire. Ce statut m’était souvent dévolu par
des détenus plus âgés ayant des enfants proches de mon âge. A travers le récit de leur histoire,
ils tentent de me préserver et de me faire comprendre le pourquoi du comment de leurs
erreurs. Je me sentais libre de poser les questions même les plus délicates au risque de
conduire à un blocage et de jouer de mon « ignorance » pour saisir le sens de leurs actions.
Le statut de « copine » est légèrement différent de celui de l’étrangère, il favorise un certain
pied d’égalité avec le détenu et atténue le décalage chercheur-enquêté et détenu-non détenue.
L’échange verbal devient d’autant plus facile qu’il s’effectue sur un mode de familiarité mais
il glisse parfois sur la pente de la séduction…
La typification de l’intellectuelle est plus délicate car elle crée une dissymétrie sociale2 qui
n’encourage pas le dialogue.
Sans être une typification, j’ai joué de mon identité féminine à laquelle sont reliés des
stéréotypes communs : la douceur, la compréhension... « Les représentations attachées à
chaque sexe et les normes de comportement sont encore sous-tendus par une vision binaire
sexuelle naturalisée » [Joël, 2007, 39].
1 Les points de suspensions dans les entretiens représentent de court silence. 2 Notion utilisée par Bourdieu dans son chapitre Comprendre de la misère du monde où il montre les places différenciées de l’enquêteur et l’enquêté qui dépendent du capital est notamment culturel.
37
« Franchement c’est beaucoup plus facile de parler à une femme, tu aurais été un homme je ne sais pas si je me serais dévoilé autant, c’est plus facile de parler à une femme, tu sais qu’elle te comprend mieux, elle n’a pas le même point de vue. Alors qu’un homme je sais comment il pense, il n’a pas la même sensibilité. Ma psy c’est une femme et j’apprécie de lui parler, ça aurait été un homme ça n’aurait pas été très loin. » [Achour, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
La place des émotions dans l’entretien
La prise de parole du détenu est un travail d’explicitation à la fois gratifiant et
douloureux. Les sujets abordés comme les rapports avec les parents, le passé... représentent
des souvenirs difficiles à partager et mon intrusion dans l’intime élève des barrières parfois
infranchissables. Par respect, ma conscience me dicte de ne pas outrepasser ces barrières.
«Enfoncer le couteau»1 là où ça fait mal était aisé, en sachant qu’après l’entretien, je rentrais
chez moi alors que les détenus eux, restaient avec leurs états d’âme et leurs douleurs, enfermés
dans une cellule de 9m2. La question de la déontologie de la recherche se pose. La hantise de
l’intrusion [Laé, 2002, 248] est toujours présente dans mon esprit. J’ai toujours essayé d’aller
le plus loin possible sans pour autant « forcer le passage ». Si « certains terrains se révèlent en
effet particulièrement durs, dans le sens où les révélations recueillies interrogent, horrifient,
révulsent. S’intéresser aux émotions n’est pas anodin. En effet, non seulement la culture du
chercheur et, plus largement, ses dispositions sociales forment un prisme à travers lequel il
tente de comprendre son terrain, mais les émotions qui le saisissent peuvent influer sur la
perception du terrain et, partant, la construction de l’objet. Le partage d’émotions avec les
enquêtés, que ce soit lors du recueil de récits de vie souvent entrecoupes d’épisodes
dramatiques ou dans le quotidien d’un terrain dangereux, créé une proximité. » [Boumaza,
Campana, 2007].
« Vous avez atteint des points sensibles aujourd’hui, on va s’arrêter là. Ça remue, c’est dur de raconter tout ça. » [Angelo, 36 ans, séparé, 1 enfant, 28 mois]
Le silence des hommes
Que signifie le silence des détenus ? Il est difficile de le faire apparaitre dans mes
retranscriptions bien que je l’ai souvent perçu. Les réponses par des phrases courtes en sont
également l’expression. Le silence ne se compose pas seulement de souffrance sociale mais
1 Cette expression est le fruit d’un de mes enquêtés, après avoir évoquer les rapports qu’il entretenait avec son père. «Tu veux bien enfoncer le couteau » [Ludovic, 27 ans, séparé, 1 enfant, 3 mois]
38
celle ci est largement représentée. Je peux affirmer que les hommes parlent moins que les
femmes et lorsqu’ils expriment leurs sentiments, ils ne le font pas de la même manière.
Comment interpréter ces émotions ? Quelle posture adopter face aux enquêtés quand les mots
se font rares et que le silence s’installe ?
Etudions le cas de Nadim ; la mise en mots de son histoire nous a mis à rude épreuve tous les
deux. J’étais sans cesse obligée de le relancer et les silences pesaient de plus en plus.
« C’était un projet d’avoir des enfants ou c’est arrivé sans le prévoir? Oui c’était un projet, j’ai du mal à m’exprimer... je ne sais pas pourquoi j’ai du mal à m’exprimer, c’est avec tout le monde. Comment c’était la grossesse ? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus, j’étais dingue le premier jour puis ça a été la routine. Ça a changé quelque chose à ton quotidien ? Ça a changé quelque chose... un petit peu. Ça a changé quoi ? Bonne question, ça a changé que... je sais mal m’exprimer, j’ai du mal. Tu ne veux pas en parler ? Non, ce n’est pas un problème Quelque chose te gène ? Non tu peux continuer à écrire, ce qui a changé c’est avoir un gosse, c’est vrai que tout le monde ne le vit pas pareil. Quand on a eu le gosse ça a changé, elle n’était plus pareille, elle a changé de mentalité. Ça a duré encore un an et après je ne sais pas. C’est elle qui a changé, dès qu’elle a eu un gosse, déjà le premier mais alors le deuxième, c’était plus pareil mais je ne sais pas ce qui a changé. Tu étais content d’avoir des enfants ? Oui Ça t’a apporté quoi ? Bah d’avoir des gosses. » [Nadim, 34 ans, séparé, 2 enfants, 6 ans]
Tout au long de l’entretien, Nadim expose ses difficultés d’expression. Comment interpréter
son incapacité ? Est-ce véritablement une difficulté de mise en récit, une paternité peu
investie ou encore un problème pour établir un lien entre l’avant carcéral et l’incarcération ?
L’oubli signifie à la fois une stratégie pour avancer et une discontinuité de la biographie de
l’individu entre plusieurs évènements successifs.
Les mots et les silences sont deux modes de production de la souffrance liée à l’histoire
individuelle [Laé, 2002, 249]. Le retour réflexif sur des souvenirs est une épreuve en soi dont
les acteurs n’ont pas toujours le mode d’emploi.
« Tu étais là pour les échographies ? Oui... Ça représentait quoi pour toi d’y assister ? ça faisait drôle, c’était impressionnant, c’était la première fois que je voyais ça... Tu t’aies senti comment ? Bah content, oui j’étais content... Tu t’aies senti père à ce moment là ? Un peu oui, un peu, c’est après quand je l’ai vu que voilà. [...] C’est difficile pour toi de parler de ça ? Non c’est normal, non après je ne sais pas quoi te dire. Je suis content d’en avoir un, qu’il fasse des progrès mais je ne suis pas beaucoup avec lui, je ne le vois pas souvent alors je ne sais pas trop comment il est exactement, comment il se comporte, j’attend de voir par la suite. » [André, 38 ans, séparé, 1 enfant, 9 ans]
Ce silence peut être interprété comme une mise à distance d’événements qu’André ne maitrise
pas. La prison apparaît comme une coupure biographique symbolisée par des silences.
Finalement le seul moyen de justifier ces trous est qu’ils seront comblés plus tard, mais à cet
instant t ils cantonnent l’individu à ses interrogations. La faible implication d’André dans la
paternité apparaît dans ces blancs sans pour autant qu’un choix personnel n’en soit à l’origine.
Comme beaucoup d’entre eux, il souffre de la détresse des pères détenus.
39
La détresse des pères détenus
Parler de soi est une interaction sociale qui découle d’une mise en scène de sa
personne vers l’autre. De fait, la maitrise du récit de soi se partage inégalement et dépend à la
fois d’une mobilité géographique et sociale [Berger, 2006].
Certains individus, en situation de crise, perçoivent la détention comme une catastrophe,
[Chantraine, 2004]. L’incarcération est vécue comme un choc traumatisant. La parole devient
une épreuve supplémentaire et s’imprègne de douleur. Les individus diffèrent les uns des
autres dans leur capacité à mettre en mots. Les hommes sont d’emblée moins aptes à se
confier que les femmes et le contexte englobant de la prison ne favorise pas le délitement des
langues. « L’impossible familiarisation avec le temps, l’espace, les objets et les autres acteurs
nourrit le sentiment d’une irréductible étrangeté les conduisant à des attitudes de repli sur soi,
d’intransigeance et de résistance.» (Foucart, 2003)1
L’entretien ci dessous démontre l’importance du lieu sur la production du discours.
« Je me demande parfois si ma vie mérite d’être écrite, j’ai vécu des choses inexplicables et tristes et des choses bien, c’était bien. Y a eu des malheurs, des tristesses, je ne pensais pas traverser tout ça, c’est... moi je me vois, je me dis je suis trop jeune pour avoir vécu ces trucs chelou. Chelou dans quel sens, tu as un exemple ? (du temps passe avant qu’il ne réponde, il fuit mon regard) Je ne vais pas te mentir, c’est des choses que tu passes dans ta vie, tu ne sais pas si tu vas vivre ou mourir. C’était des choses très tristes. Un jour si je te vois dehors je te dirais. Ici je ne peux pas te raconter, c’est beaucoup... c’est des choses vécues qui font trop mal. » [Patrick, 32 ans, séparé, 1 enfant ou 5 enfants
2, 6 mois]
Cet extrait explique deux choses : l’auto dévalorisation expérimentée par certains détenus et
l’impact du lieu capable de bloquer le discours. Il existe une séparation indéniable entre le
dedans/le dehors, c’est une manière de se protéger. Notons les stratégies qu’il met en place
pour dissimuler sa faiblesse. Dévoiler ses sentiments ou non repose sur un véritable calcul du
coût et des bénéfices qui en découlent. L’acteur réduit au maximum l’épanchement
émotionnel et sentimental pour réussir à « faire sa peine ». L’injonction d’être un homme fort
dépourvu de faiblesses est d’autant plus prégnante en détention.
L’entretien sociologique peut, dès lors, devenir un lieu de confidences où « émerge la parole
intime » [Pruvost, 2008, 83] une petite fenêtre dans la quotidienneté. Pourtant, la confidence
définie comme une parole sur « l’intime », au caractère « réservé » est généralement vouée au
1 In Joel, 2012 2 Le problème avec le nombre d’enfant c’est qu’il est évolutif, prend t-on en considération seul les enfants légitimes et reconnus comme tel ou prend t-on aussi en compte ceux qui sont hypothétiques, ce dont l’homme n’est pas sûr d’être le père, dont il ne s’occupe pas.
40
secret et fondée sur la non-publication des révélations. « La confidence c'est le fait de dévoiler
une recherche de vérité, tant pour soi-même parfois que pour les autres » [Bidard, 2007] La confidence est à priori un dialogue entre deux personnes [Rabatel, 2005] ce qui n’a pas été
le cas lors des entretiens. Sur le plan relationnel, elle est, de ce fait, dissymétrique : je suis le
réceptacle de leurs paroles mais eux ne reçoivent pas les miennes en retour. Les échanges
entre les détenus et moi sont fondés sur un pacte de confidentialité encore renforcé par
l’anonymat.
Les entretiens autorisent et encouragent l’expression d’une souffrance mais peuvent
également la susciter. Cet entretien illustre la détresse produite par le récit de vie
sociologique.
« Je ne me familiarise pas beaucoup, je ne vais pas en promenade, je parle que avec mon codétenu, par habitude, l’habitude d’être seul. C’est à cause de la prison ? C’est une habitude, on dit que l’habitude devient une seconde nature. Avec tout ce que j’ai vécu, je parle moins. J’ai dit à la psychiatre que la première entrevue que j’ai eu avec toi, ça m’a marqué. C’est la première fois qu’en deux séances quelqu’un me connaisse mieux que mes amis qui sont dehors. C’est la forme de la rencontre qui fait ça C’est parce que tu t’intéresses à moi (s’arrête, les larmes emplissent ses yeux) excuse moi (se cache le visage, essuie ses larmes) je suis désolé (regarde le plafond, prend sa respiration, plusieurs minutes passent) comment on fait pour être simple. Comment les gens ils font pour rencontrer des gens, moi j’ai envie. J’espère que ça va aller, mais quand tu as pas eu beaucoup de choses... croire en l’avenir, j’ai tellement perdu confiance en moi. Je ne suis pas du genre à m’apitoyer sur mon sort, j’ai envie d’un peu de simplicité, je ne suis pas exigeant.... je verrais de toute façon... » [Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois]
Le parti pris de rencontrer mes enquêtés à plusieurs reprises a favorisé leur accoutumance à
ma présence ainsi qu’à la technique de l’entretien. La relation instaurée entre le détenu et moi
oscillait dans un sens ou dans un autre selon que j’étais familière ou étrangère. Comme
l’exprime le sociologue : le connu et l’autre totalement diffèrent de soi [Filloux, 2005] Ces rencontres égoïstement tournées vers la réalisation de mon enquête prenaient parfois des
tournures auxquelles je n’étais pas préparée. Des deux cotés, des attentes différentes ont
convergé vers une satisfaction partagée.
L’entretien répété m’a offert la possibilité de reprendre un récit et de l’appréhender sous un
angle nouveau. Je pose l’hypothèse que l’origine des émotions révélées par Eliot est
directement reliée à notre deuxième rencontre. Nous nous inscrivons dans une dimension
émotionnelle où «raconter, décrire, exposer des impressions, c’est avant tout actualiser
délibérément la dramatisation des perceptions. « Mettre en vue » des émotions, c’est une
façon immédiate d’exposer des intensités » [Laé, 2002]. Une question se pose : comment
prendre en charge cette dramatisation des perceptions dans mon enquête ?
L’entretien compréhensif est appréhendé comme un retour réflexif tant pour le chercheur que
ses enquêtés.
41
Rire, connivence, confiance
(Un surveillant ouvre la porte puis la referme, on parle un peu de la fouille puis je lui demande ce qu’il pense des surveillantes femmes)
« Y en a une elle a fait l’appel dans la douche et comment elle a regardé c’était chaud. Franchement j’aurais l’occasion bien sur que je la prends, moi dire non, je peux pas, même la fille de 36 ans je lui aurais fait sa fête. Après si elle fait cent cinquante kilos c’est pas la peine. Pareil pour toi, tu vois un beau gosse en soirée, tu fais quoi, voilà quoi » (il se met à rigoler et on part dans un fou rire) [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
Le tête à tête avec les détenus a été propice à des discussions plus légères. Leur âge
proche du mien et nos multiples rencontres ont favorisé une forme de familiarité entre nous.
La dynamique de l’entretien amoindrit de toute évidence les frontières. Malgré la légèreté des
propos de Quentin, ses représentations de la sexualité et des femmes sont significatives.
Durant le premier entretien, il a tenu à me montrer quel type de père « responsable » il est
alors ; que le deuxième entretien a mis en lumière un comportement plutôt adolescent, une
sexualité un peu frénétique. La mère de ses enfants apparaît comme une conquête parmi tant
d’autres et l’arrivée de ses enfants est dans la continuité de son parcours insouciant. Quentin
navigue dans ses propos, entre sa représentation de la paternité et sa vie sexuelle d’homme.
L’anecdote relatée semble sans importance pour l’enquêté – qui ne craint pas d’enfreindre la
bienséance sociale – et place l’entretien du côté des pratiques sociales [Beaud, 1996, 242].
Elle nous révèle des pratiques sous-jacentes.
La durée de l’entretien joue sur les confidences. Plus nous avons de temps et plus la confiance
s’installe.
« Je ne veux pas vous prendre trop de temps, je ne me suis jamais confié autant qu’à vous, c’est fou. Je ressens plus rien, j’ai plus de boule au ventre. Ce que je ressens c’est que ça me fout la haine et ça me fait de la peine. J’ai ouvert les yeux sur ma vie. [...] j’en peux plus je vais me pendre mais j’arrive pas à m’ouvrir les veines, j’ai pris des cachetons et j’ai essayé de me pendre. Si je le fais je ne veux pas me rater. Si je le fais j’irai jusqu’au bout, je ne suis pas un flûteur. [...] je suis désolé je suis entrain de vous saouler, je vais dans tous les sens mais là je n’en peux plus, la prison ça me rend fou. » [Achour, 34 ans, concubinage, 3 enfants, 4 ans]
« Je suis choqué de t’avoir raconté tout ça, de t’avoir raconter ma vie. Y a quelques mois ça aurait été impossible, mais depuis janvier j’ai vu un psy, ça m’a fait du bien et je me demande si je ne veux pas avoir un suivi, je suis finalement quelqu’un de très réservé. » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
Le récit de vie « repose sur une introspection rétrospective, permettant de s’épancher sur des
évènements passés, de les faire resurgir à la surface sous une forme plus élaborée et plus libre
que lorsque l’événement est en cours » [Pruvost, 2008, 83]. Les enquêtés effectuent un
cheminement au travers des entretiens en libérant leur parole.
42
L’entretien m’a incitée à relier leur situation présente et passée, le pré-carcéral et
l’incarcération. Les détenus ont l’impression que je m’intéresse à eux, au delà du délit qu’ils
ont commis ; ils sont en mesure de révéler leur individualité [ibid, 2008, 83].
L’entretien sociologique tient une place singulière pour les personnes interrogées par rapport
à d’autres échanges. Le récit d’Achour est significatif ; alors que le suicide est l’événement le
plus redouté par le système pénitentiaire, il n’hésite pas un seul instant à m’en parler quitte à
prendre le risque d’être signalé à l’administration et de subir une surveillance accrue. Il a
clairement effectué une distinction entre les différents professionnels et types d’entretiens
pour déterminer ce qui est dicible ou non. Bien évidemment tous les enquêtés ne sont pas
disposés à se confier ! Néanmoins, cette construction narrative de l’intime, quand elle existe,
permet véritablement au chercheur d’avoir accès au « sens élaboré par les individus et les
mises en ordre du monde qu’ils élaborent » (Demazière & Dubar 1997b)1.
Malheureusement complicité et confidence conduisent parfois à des rapports plus complexes
comme la séduction et la prise de l’enquêté sur l’entretien.
La prise de l’enquêté sur l’entretien
Contrôle biographique
Etudions comment s’instaure l’instrumentalisation de l’entretien par les acteurs eux-
mêmes. L’entretien se définit comme un espace stratégique où l’on mobilise sa mémoire par
un « acte réitéré d’interprétation » (Bergson, 1896)2. Au fur et à mesure que nous nous
remémorons notre passé, nous le reconstruisons en fonction de nos idées à un instant T selon
le degré d’importance des évènements. Cette « perception sélective » [Berger, 2006] donne
au passé un aspect malléable. C’est autant de vies que de points de vue qui nous sont
présentés. Nous rectifions le passé là où il nous semble nécessaire de le faire, ce qu’appelle
Berger la « réversibilité autobiographique ».
En conduisant mon enquête en milieu carcéral, j’ai rencontré des individus en contexte de
crise ; l’enfermement a conditionné la manière dont ils se perçoivent. L’idée qu’il ne faut pas
perdre la face est prégnante ; pour cette raison, l’entretien apparaît comme le moyen de
répéter son histoire, la rendre la plus dicible possible, « la révélation d’aujourd’hui devient la
« rationalisation » de demain [Ibid, 2006, 96].
1 In Pruvost, 2008, 84 2 In Berger, 2006, 93
43
« Construire une intrigue, (...) c’est introduire les éléments consécutifs du récit comme autant
de pièces à conviction dans un procès (...), c’est transformer une suite chronologique (de
séquences, d’actants...) en une argumentation logique » (Demazière & Dubar 1997a: 122)1.
Quelles sont les stratégies mises en place par les acteurs pour raconter leurs histoires et
qu’advient-il du contrôle biographique ?
J’ai souvent noté de la part de mes enquêtés, un lissage de leur discours pour le rendre
acceptable et parfois même constaté l’élaboration d’un nouveau récit pour remplacer « la
vérité»2.
Voici le récit d’un détenu qui va revenir sur son affaire à deux reprises au cours de l’entretien
« Moi ce qui me tue c’est d’être éloigné de mes enfants, savoir qu’il y a du temps qui passe, que ça va durer, que je rate beaucoup de choses, qu’ils grandissent sans moi et ma femme qui subit la détention, ça fait quatre ans que je suis là et qu’elle vient avec mes enfants. Ça y est je vais vous dire pourquoi je suis là, j’étais bourré, je me suis masturbé, j’ai honte, ça bloque, c’est honteux. Je me suis masturbé dans la rue et j’ai dirigé vers une personne, et elle a profité de dire que je l’avais violé, elle a utilisé l’ADN. Je n’ai pas le profil, je n’ai pas été éduqué comme ça ni dans le quartier. C’est le destin on ne sait pas ce qu’il nous réserve, ça peut être bien comme ça peut être mal. [...]
Je vous donne la raison. On m’a dit que j’avais violé la fille mais je me suis masturbé, je regrette j’ai honte. Il était 6h du mat, j’étais allé voir mon frère c’était Noël, il a pas voulu venir chez nous et donc j’y suis allé. Ma fille Sofia de 11 ans elle m’a dit de ne pas y aller, elle a senti et je lui ai dit que tonton pleurait et j’avais acheté des cadeaux, même si on est musulmans je le faisais pour mes enfants. Mon père il ne le faisait pas pour moi, on fêtait pas mon anniversaire, pas Noël, mon père c’était strict, sérieux, marche droit, fais pas de connerie, pareil que ma mère, ils sont pas comme moi fumette, alcool... »[Achour, 34 ans, concubinage, 3 enfants, 4 ans]
Après seulement cinq minutes d’entretien, ce détenu m’explique les raisons de son
incarcération. N’ayant pas accès aux dossiers, je ne connais la nature des délits3 de mes
enquêtés qu’à travers leurs récits. L’intérêt de cet extrait réside dans le fait que le détenu
commence par expliquer ses difficultés d’être père en prison, ce qui lui manque... etc, et
brusquement, il ressent le besoin urgent de justifier le motif de son incarcération. « ça y est je
vais vous dire pourquoi », cette formule ressemble à une confidence, elle m’accorde une
importance certaine en m’incluant dans le récit. La cohérence de son récit tend à
l’acceptabilité de celui-ci. En ajoutant qu’il n’a « pas été éduqué comme ça », il cherche par la
persuasion à défendre ses valeurs, produire compassion et compréhension [Charaudeau,
Maingueneau et al, 2002]. Nous constatons de quelle manière il fait appel à la fonction
1 in Pruvost, 2008, 78 2 Je met entre parenthèse le terme de vérité, il est évident qu’elle n’existe pas, mais le récit s’éloignait des faits pour lesquels l’individu est incarcéré. 3 A Fresnes, j’avais accès à tous les dossiers par le biais du SMPR et j’aurais pu connaître tous les détails de leur inculpation. J’ai fait le choix de ne m’y référencer qu’à la fin des entretiens pour éviter d’être influencée. J’ai été agréablement surprise en découvrant le peu de décalage entre leurs récits et leurs dossiers. La gravité des délits était moindre cependant.
44
émotionnelle [Grinschpoun, 2012], la honte. La mise en contexte de son délit et la répétition
des faits montrent l’importance de l’enjeu : me faire adhérer à son discours.
L’essentiel n’est pas de savoir si son récit est vrai ou faux mais que celui-ci donne
l’impression d’un récit rodé comme s’il était une répétition de son procès. En détention, les
auteurs d’actes sexuels sont au plus bas de la hiérarchie carcérale, les stigmates des stigmates.
Ils subissent souvent les violences des autres détenus. Achour n’est pas qu’un simple détenu,
il a également la position la moins valorisante en détention.
Le fait que mon sujet porte sur la paternité, que je sois une femme, a influencé la production
d’un récit dicible auquel il souhaite me faire adhérer. Le but est de « capter la bienveillance
du sociologue » [Pruvost, 2008, 79] tout en minorant ce qui est répréhensible.
Le contrôle biographique est à l’œuvre dans l’entretien avec Achour mais il est encore plus
marqué dans cet extrait :
« Il [son fils] a plus d’importance du fait que tu es ici? Je pense, mais je pense plus que c’est parce qu’on est en prison et qu’on ne voit pas la naissance, on ne peut pas faire tout ça avec eux et là on ressent encore plus l’amour. J’ai déjà fait de la prison et on réagit pas pareil en prison on va dire je t’aime, dehors non, si c’est la routine... mes ex me le disaient, en prison je suis plus sincère, c’est peut être le fait que je sois en prison. Tu ressens plus le besoin que si tu étais dehors ? Oui, j’avais une copine en prison qui m’a trompé, je l’ai mal pris. En prison, je me suis rendu compte de mes sentiments, j’ai vu que je tenais à la personne, ça s’est arrêté là malheureusement, c’est un peu à cause de ca que je suis ici, j’ai été violent, quand je suis sorti elle m’a dit qu’elle m’aimait encore, j’ai cherché la personne avec qui elle était... Tu l’as tué ? Y a eu un mort oui, je ne voulais pas rentrer dans les détails, donc à cause d’une fille je suis parti en vrille, j’avais bu j’étais pas moi même, ça gambergeait dans ma tête, un jour ça a éclaté et voilà homicide involontaire. » [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
Demander de but en blanc « tu l’as tué ? » apparaît comme un manque de délicatesse mais il
s’agit de recontextualiser l’entretien. Timur purge une très longue peine ; nous nous voyons
pour la deuxième fois quand il m’avoue avoir commis un homicide ; pourtant la version de
son discours ne colle pas à la réalité. En cherchant sur internet et en discutant avec sa
conseillère de réinsertion (CIP), j’apprends qu’il est incarcéré pour homicide involontaire sur
mineur. Il a frappé à de nombreuses reprises son enfant avant qu’elle ne meure de ses
blessures. Son ex compagne a elle aussi été incarcérée pour non secours à personne en danger.
Par la suite, il a conçu un enfant en parloir, le seul enfant dont il me parlera. Il a
volontairement passé sous silence un élément pourtant essentiel pour comprendre son
parcours de vie.
Ce contrôle biographique découle de plusieurs raisons : les confidences sont à haut risque et
certains actes sont répréhensibles. L’enquêté anticipe une éventuelle réception négative de son
récit [Ibid, 2008, 78]. Mon sujet est accès sur la paternité, l’infanticide apparaît a priori
incompatible.
45
Son discours sur les sentiments, la sincérité, la prise d’alcool rend son récit cohérent. Ces
éléments explicatifs tendent à minorer les effets de son acte. Le contrôle et la maitrise du
discours sont régis par la connaissance de normes acceptables. On appelle ça le « principe de
discrétion», l’intériorisation de ce qui peut être dit ou non. Ce contrôle biographique ou
« mythomanie restauratrice » [Marchetti, 2000] est une manière de tenir, de limiter son
échec ; ma présence justifiait son besoin de remodeler son image selon l'être idéal qu'il
aimerait être. « On sait bien que chacun cherche toujours la confirmation de son être à travers
le miroir infidèle mais irremplaçable de l'autre » [Dufoucq-Chappaz, 2011, 37]
Séduction, différenciation et emprise sur le discours
L’instrumentalisation de l’entretien apparaît non seulement dans le lissage des récits
mais aussi dans la recherche d’une singularité. Pruvost met en évidence ce principe avec « la
procédure d’héroïsation ». J’ai été confrontée à certains détenus dont le délit (trafic de
stupéfiants) montre quel type d’hommes ils sont. D’autres, au contraire mettent en avant leurs
différences pour éviter d’être assimilés à la masse carcérale, se valoriser ou susciter mon
intérêt.
Etudions ces deux extraits :
« Personne ne te parlera de paternité, on met un coup au parloir, les relations c’est « je t’aime, tu as besoin de quelque chose ? Je t’envoie de l’argent, tes études ça marche ? Oui, non ». Ce n’est pas comme être à la maison, c’est tout à distance, c’est ça les relations qu’on a. De toute manière c’est que des conneries ce qu’on va te raconter, la prison ça a changé y a que des gens qui sont pas fiables. Eux ils en ont rien à foutre, enfin ça dépend des générations, c’est ce que je pense, la génération d’aujourd’hui elle est pourrie. [...] tu peux revenir si tu veux en savoir plus, c’est dommage pour toi que ton étude se termine. Mais quand on a envie, si ça t’intéresse vraiment tu reviendras, si ça t’intéresse pas tu ne reviendras pas. En sept ans d’incarcération, j’en ai fais des choses, j’ai passé beaucoup de temps au QD, l’affaire est intéressante, j’ai plus de choses à dire que les autres. » [Djamel, 41 ans, séparé, 3 enfants, 7 ans]
« Parfois j’entends des choses, des mecs et je me dis que moi j’ai eu quelque chose de mieux, quand certains disent qu’ils veulent éduquer les femmes (à comprendre dans le sens de les battre). Tu te sens diffèrent des autres ? Je voulais dire quelque chose, j’ai honte... en sachant que je suis quelqu’un de diffèrent... mes idées, mon point de vue, mon caractère, ma façon de voir la femme, de l’aimer, de la savourer... » [Angelo, 36 ans, séparé, 1 enfant, 28 mois]
Nous notons deux types de stratégies, le premier extrait est plus direct, le détenu fait miroiter
l’originalité du discours qu’il me fournirait si je revenais le voir, « si ça m’intéresse vraiment
». Si personne ne veut me parler de paternité, lui le fera mais l’obtention de sa parole est
soumise à condition. Il s’appuie sur la comparaison de la jeune génération et la sienne, il a
tout vu, il a tout vécu, il sera par conséquent plus intéressant pour ma recherche. Le deuxième
46
extrait est emprunt de pudeur «j’ai honte», la stratégie change. Il tente de se distinguer des
autres dans un but probable d’auto-valorisation sans m’inclure directement dans son discours.
En parlant du traitement des femmes, il cherche ma reconnaissance puisque je suis moi même
une femme. Je placerai cette tentative dans une recherche identitaire plutôt qu’un processus de
séduction. Le principe d’héroïsation est moins évident en détention, la prison concède dans
tous les cas aux détenus un statut peu valorisant.
Une autre stratégie se dégage également : la prise de l’enquêté sur l’entretien est
directement liée à une volonté de séduction. Mon âge, mon sexe et mon physique favorisent
ce type de relation en entretien. En prison, la difficulté d’actualiser leur identité masculine
pousse les hommes à trouver le moyen de se sentir séduisants. « Il ne s’agit pas tant d’une
sexualité à consommer, mais davantage d’« une confrontation avec le genre opposé »
[Gaillard, 2009]. Ma présence les confronte au regard d’autrui sur eux-mêmes.
« Comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va comme le temps, des fois il fait chaud, des fois il fait froid et la famille ? Ça va tes parents ? Tu vis toujours avec eux ? Et ton copain (rire) j’espère qu’il va bien. Aujourd’hui c’est moi qui pose les questions. Tu habites où ? à Paris ? J’espère qu’on va se rencontrer dehors. [Samba, Marié, 3 enfants, 9 mois]
« Tu as un copain ? Tu vois quelqu’un ? (Mouvement négatif de la tête de ma part) Je me concentre sur d’autres choses. C’est bien de se concentrer sur les études, si j’étais lui, je ne te lache pas, faut pas faire le con. Si je le vois, je lui dis de ne pas faire le con « sinon je prend ta place poto ». » [Patrick, 32 ans, séparé,1 ou 5 enfants, 5 mois]
« Tu sais que tu m’intéresses, j’en ai pas vu depuis longtemps [des femmes], si tu me fais voir quelque chose, si tu me montres quelque chose ça va durer toute la journée, avec toi je m’imagine plein de choses [regarde ma poitrine] C’est donnant donnant. Tu me donnes ton numéro, on se voit en Visio, ce serait excitant, tu peux avoir du plaisir de loin. Même de loin je peux prendre du plaisir, ce serait malheureux autrement. [...] Si je te raconte les détails de mon affaire tu auras 20 sur 20. Donnes moi ton numéro, ça fait sept ans que j’ai pas vu quelqu’un d’aussi bien, j’ai quelqu’un d’attirant, je regarde c’est pas ma faute si tu as des belles formes. Prends le comme un compliment. [Djamel, 41 ans, séparé, 3 enfants, 7 ans]
Ces exemples sont intéressants, ils révèlent une manière pour l’enquêté de mettre à son tour sa
marque sur l’entretien, d’être à l’initiative de celui-ci ; l’enquêteur n’est plus, dans ce cas, le
seul décideur. L’entretien devient un moyen de mettre en jeu leur virilité et leurs capacités à
agir. Le retournement de situation pendant l’entretien montre que celui ci ne représente pas
une simple collecte d’informations, qu’il n’est jamais réductible à une simple situation de
communication mais qu’il s’y joue des rapports de pouvoir bien plus complexes.
Djamel a clairement identifié mon intérêt pour son histoire (il a réussi à sortir illégalement du
sperme de prison pour qu’une de ses amies bénéficie d’une procréation médicalement
assistée). Par le jeu de la manipulation et du chantage, il tente de négocier sa parole contre la
mienne et plus si affinités. Evidemment, ce cas est extrême mais il questionne sur les places
de chacun et sur ce que l’on peut dire de soi ou non. « L’interviewer est toujours confronté à
des tentatives d’enrôlement ou de captation, d’intensité variable et d’orientation diverse, qui
47
l’obligent à sortir du cadre de l’entretien de recherche pour pouvoir en rappeler les règles, et
ce faisant le réaffirmer » [Demazière, 2008]. L’entretien sociologique n’est pas un dialogue
avec une relation de réciprocité mais le concept de don contre-don est bien présent.
CONCLUSION : METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 1
« La prison, finalement, pour moi, comme la guerre pour les reporters, c'est pas loin d'être une drogue. Certains jours, je sens que je vais craquer et que je risque l'overdose si je continue. Mais quand je reviens d'un trip, que j'essaie de me réinsérer petit à petit dans mon univers de chercheuse parisienne, la vie me paraît parfois d'un gris! Alors quand, aux infos, j'entends: « Fresnes» ou «Fleury »... « grève des surveillants» ou « évasion aux Baumettes », c’est toujours la même excitation. Si je m'écoutais, hop! sur-le-champ, je ferais mon paquetage et je retournerais au front! »[Marchetti, 2001, 194]
Cet état de manque dont parle Marchetti n’est surement pas propre au milieu carcéral
mais je m’y suis reconnue. Est-ce l’excitation du jeune chercheur, la confrontation de deux
univers – celui du dehors et du dedans –, une distance difficile à prendre avec son terrain ? Je
n’ai toujours pas la réponse. Nous constatons néanmoins que le milieu carcéral est un lieu qui
a indéniablement une prise sur l’individu, « même à l’extérieur, les murs continuent de vous
cerner, le bruit des clés vous obsède » [Rostaing, 1997, 20]. Jamais je ne pourrai oublier les
individus rencontrés en prison ni cesser d’imaginer ce qu’ils sont devenus. Tant de rêves
d’avenir hors les murs et pourtant ils les retrouvent régulièrement, réaspirés par le milieu
comme un aimant.
J’ai souvent eu le sentiment de me mettre entre parenthèse lors des entretiens [Marchetti,
2001] de m’oublier un moment pour essayer de donner de l’espace aux mots. Dans ce
chapitre, en analysant les pratiques de l’enquête j’ai surtout éclairé les pratiques de mes
enquêtés. Les interactions riches et imprévisibles m’obligeaient à une remise en
question permanente pour comprendre quelle est ma place et quels enjeux en découlent.
S’intéresser à la situation d’enquête c’est chercher à expliciter comment celle-ci est comprise,
perçue et quels comportements les enquêtés engagent dans l’interaction. Finalement comment
le chercheur se positionne par rapport à tous ces paramètres et contraintes [Demazière, 2008].
Prendre de la distance s’avère nécessaire et se plier à cet exercice de distanciation telle une
gymnastique devient la condition pour réussir « à saisir le monde d’un point de vue
sociologique » [Lemieux, 2010, 11]
1 En annexe se trouve une fiche synthétique de chaque enquêté. Elle n’est pas exhaustive, n’ayant commencé à collecter ces données que lors de ma seconde année de recherche.
49
II. AVANT LA PRISON : LA CONSTRUCTION DE LA
PATERNITE
L’individu est pris dans un monde mouvant qu’il va s’approprier en s’ajustant à lui et
y imprimant la trace sur lui-même. L’environnement de son histoire passée, le présent qu’il
est entrain de vivre et son orientation vers le futur s’inscrivent en lui [Descombes, 2013].
L’individu se meut dans un espace codifié qui a du sens, il ne se réduit pas à un simple
réceptacle inconscient mais interagit avec son environnement. L’objectif de cette partie :
analyser comment l’individu, pris dans différentes sphères se construit en partie à travers ces
expériences. Si d’autres facteurs sont également déterminants, elles influencent la personne
qu’il sera ou aspire d’être. Il se forme à leurs contacts.
Jean-Claude Passeron récense un certain nombre de termes : l’ “âges de la vie", "cursus",
"cycle de vie", "cheminement", "parcours", "trajet", "biographie", "itinéraire", "carrière",
"trajectoire", qui désignent des situations et des contextes différents. Sans chercher à définir
chaque terme, leur nombre et leur diversité révèlent la complexité des parcours biographiques.
L'étude des pratiques éducatives familiales s’avère essentielle pour comprendre l’articulation
du temps familial, conjugal et parental et la façon dont ils interagissent. [Blöss, 1997]
A. L’HISTOIRE FAMILIALE ET SES INFLUENCES
« Et avec tes parents c’était comment ? Depuis l’âge de 18 ans je leur parle plus. Le jour de mon anniversaire ils m’ont jeté à la rue et j’ai plus de nouvelles et je m’en fous je suis sans pitié, c’est tout. Y a rien à dire, ma mère elle est alcoolique, elle vit avec un clochard et mon père il vit dans l’Aisne. C’est tout, même mes frères et sœurs je ne leur parle pas. J’ai trois frères et une sœur. Comment ça ils t’ont jeté ? Je leur ramenais plus d’argent, y a plus d’alloc, quand j’étais en alternance je rapportais de l’argent mais après je rapportais plus rien, mais je suis pas le seul mon frère aussi ils l’ont jeté et ma sœur est partie à seize ans, elle était enceinte, elle n’était pas bête. Tu partageais des choses avec eux ? Non rien de compatible, c’était chacun pour soi, on travaillait beaucoup, on faisait l’herbe pour les lapins, le jardin. Pour quelles raisons faire des enfants et pas s’en occuper ? Juste pour les sous, si y a plus d’argent on te fout dehors. Ma mère c’était pour l’alcool, pour s’acheter son pinard. Mon père travaillait, il n’était pas strict mais mon père c’était… Je ne me rappelle plus trop de mon enfance j’ai tout zappé. Tu as voulu t’éloigner de ce monde ? J’ai essayé de m’éloigner, j’ai bien dit essayer, je dis pas que je suis un mauvais père mais je veux prendre la vie en main, j’ai pas été un père irréprochable et ça c’est dû à l’alcool. » [Thierry, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
A la lumière de Norbert Elias, j’ai évité de traiter ces pères indépendamment de ce qui
les entourent. Pour comprendre ce que représente leur paternité, j’ai questionné le réseau dans
50
lequel ils évoluaient. Sans tomber dans un déterminisme social qui fait du sujet le produit de
son environnement, la famille n’en reste pas moins le premier agent socialisant. Le lien qui
unit ces pères à leur enfant découle d’une histoire personnelle qui soit sert de modèle ou à
l’inverse d’exemple à ne pas suivre. L’entretien de Thierry éclaire ce passé familial
douloureux dont il voudrait s’éloigner mais qui conserve une emprise sur lui.
« L'identité paternelle, le devenir père trouve ses racines dans le passé, dans la lignée et la
famille d'origine par l'insertion dans l'ordre des générations et par la transmission du nom de
la famille. » [Hustel, 1996, 157]. Le problème est de concilier sa propre identité avec son
« expérience humaine de la dépendance sociale » [Descombes, 2013, 40].
Les liens avec le père
Entre absence et violence
« Et avec votre père, ça se passait comment ? Mettez un gros point d’interrogation. Je ne sais pas s’il est mort ou pas. » [Alain, 59 ans, 2 enfants, séparé, 5 ans]
Père absent ou père despotique, sont deux modèles récurrents dans les histoires des
détenus rencontrés avec un passé affectif souvent douloureux. Kafka dans Lettre au père,
explique combien son appréciation de lui-même dépendait de celle renvoyé par son père.
« Ce sentiment de nullité qui s'empare si souvent de moi tient pour beaucoup à ton influence.
Il m'aurait fallu un peu d'encouragement, un peu de gentillesse, j'aurais eu besoin qu'on
dégageât un peu mon chemin, au lieu de quoi tu me le bouches » [Kafka, 2002]. Plus la place
de père est vacante ou décevante, plus l’intégration dans une fonction parentale sera
difficilement métabolisable. Ce sont « des pères pauvres de leurs propres pères » [Lafortune
et Al, 2004] ils méconnaissent tout lien affectif paternel. Confrontés à cette absence paternelle
dont ils ont du mal à parler, ils sont pourtant conscients du poids de cette absence dans leur
construction identitaire. Evoluant dans un environnement familial en situation de crise, ils
n’ont qu’une vague idée des notions de tendresse ou d’attention à l’autre.
« Mon père revenait de l’usine « Salope qu’est-ce qu’il y a à bouffer », il battait ma mère. Il gardait l’argent pour lui, il ne lui donnait rien. Elle me disait « regarde le voisin, il a dix poulets » et j’allais en voler, j’ai grandit avec ça. Mon enfance, j’en ai pas eu, je ne sais pas ce que ça veut dire entre parenthèses , je ne sais pas ce qu’est l’éducation, c’est pour ça que je voulais être un père. Mais aujourd’hui je suis père pour les murs. » [Andreja, 32 ans, séparé, 3 enfants, 6 mois]
51
Andreja, lui même incarcéré pour violence conjugale décrit la paternité comme un bricolage
instinctif en l’absence d’un modèle paternel. Etre père revient à prendre une revanche sur leur
propre filiation en partant à la conquête d’un re-père [Marchand, 2009].
L’autorité paternelle devient irrecevable dès lors où le père n’est pas suffisamment présent et
ne correspond pas à l’image du modèle idéalisé du père.
« Qu’est ce qui s’est passé avec ton père ? Il a divorcé j’avais 13-14 ans, il a pris ses cliques et ses claques sans donner de news, il est spécial. Il était irrattrapable entre la drogue et l’alcool et sa façon d’être très violent, il s’est fait bouffer par ses problèmes, je vois aujourd’hui pourquoi il s’est barré et comme je t’ai expliqué j’ai bossé pour combler le vide. Tu peux me parler des problèmes de ton père ? Ou lala, il y en a pour longtemps, tu veux bien enfoncer le couteau. Excuse moi si tu ne veux pas en parler je comprends. Il avait des problèmes de jeux, il a fait la fête, il est devenu teuffeur, il a tout changé même sa manière de s’habiller. Il prenait des champi, un truc de ouf c’était l’escalade de la drogue. Quand il a perdu son job à la pizzeria il était au bar toute la journée, il s’est fait une ardoise. Il s’est crée des dettes partout et puis ça a été une descente en enfer. Ma mère m’a dit qu’il l’avait fait cocue et maintenant je la crois. Je me suis battu avec lui, ma mère pleurait, je voulais la protéger. Il me mettait des claques. Parfois je protégeais mes frères et sœurs je lui disais de me frapper moi plutôt qu’eux, de s’attaquer à sa taille. Après je lui tenais tête, c’était conflit sur conflit. Je fuguais 3 jours, il m’attendait avec la ceinture, je prenais un caillou et je lui ai dit que s’il essayait il était mort. On se battait. Il a fait des tentatives pour revenir, toujours des promesses qu’il n’a jamais tenues. Il nous disait de prendre nos billets pour aller le voir, mais il ne nous donnait pas d’argent. Il mentait sans arrêt. C’est un univers paranormal. » [Ludovic, 27 ans, séparé, 1 enfant, 3 mois]
L’idée du père carrent, manquant et indigne est prégnante ; par son absence, il perd toute
possibilité de contrôle et « d'action éducative, directive, effective et efficace sur les enfants »
[Sellenet, 2007, 157]. Cet entretien met en exergue la violence des relations qui annule le
rapport père-enfant pour le remplacer par un rapport d’homme à homme. La perte de
légitimité du père ; trop de promesses jamais tenues, trop de coups qu’il est prêt à rendre
pousse l’enfant à ne plus le considérer comme tel. La brutalité d’abord et ensuite l’absence
conduisent peu à peu à un effacement de la figure paternelle. Il a beau tenter de revenir dans
la course il ne parvient pas à saisir sa chance.
L’absence du père contraint, dans certains cas, son propre fils à investir la place laissée
vacante auprès de sa mère et de sa fratrie.
« Mon père est pas forcement un exemple, tu sais c’était la figure du chef de famille un peu autoritaire mais qui laisse parfois passer des choses. Jusqu’au divorce, c’était quelqu’un de bien et puis y a eu des petits problèmes d’alcool, c’est quand je devais avoir 14-15 ans qu’il a sombré dans l’alcool et la drogue, d’où le divorce et c’est à partir de là qu’il est parti. [...] Quand mon père est parti, je me suis senti le père de la maison, j’étais au bout de la table, j’ai dû mettre mes 15 ans entre parenthèses. Et puis je me suis éloigné, j’ai pris mon indépendance, je me suis cassé de la maison, et du coup je voyais moins mes frères et sœurs. J’étais trop protecteur et c’est cette partie de moi qui a pris le dessus, je gérais trop de trucs pour mon âge. Ma mère me racontait tous ses problèmes, je la voyais pleurer, je ne comprenais pas tout, je ne savais pas quoi faire. Ça t’a pesé ? Ah si, c’est à partir de là que je suis devenu ce que je suis. J’étais pourtant super bien parti, je faisais un diplôme pour devenir graphiste, j’avais que des 15-16, j’étais assez bon et puis j’ai abandonné » [Ludovic, 27 ans, séparé, 1 enfant, 3 mois]
« Je m’occupais de mes frères, on est orphelin, j’avais sept ans quand ma mère est morte. Quand j’ai signé pour mon premier travail, j’ai repris le terrain du papa. J’ai construit, on n’avait pas de maison, on était éparpillé chez la famille, les oncles, j’ai construit la maison et on s’est retrouvé après vingt ans de séparation. ça m’a responsabilisé, j’étais le seul à gagner de l’argent. J’ai fais venir mon frère de Genève
52
et ma sœur, le dernier je lui ai payé ses études, il a eu son BTS. Je payais la bouffe. Avant l’album, je louais une chambre, je dormais avec le dernier né et ma sœur qui avait des problèmes de locations. Elle est venue, on était trois plus son enfant. Je me suis responsabilisé très jeune, c’est ce qui fait ma réussite, je peux dire ça. [...] On ne pouvait pas rester avec mon père car sa femme ne voulait pas les cinq enfants. Dans la vie le mari reste pour le bien de ses enfants. Je ne peux pas être comme mon père, j’ai travaillé, lui il faisait des petits métiers. » [Nestor, 40 ans, concubinage, 2 enfants, 28 mois]
L’absence du père entraine des conséquences parfois brutales sur l’individu, obligé d’assumer
des responsabilités qui ne sont pas les siennes pour assurer la pérennité du foyer. Cette
charge imprévue implique une remise en question de leur adolescence et de leur avenir
professionnel. Il ne s’agit plus de penser à leur propre bien-être mais en premier lieu à celui
de leur famille, un rôle difficile à assumer à ce jeune âge.
Ces contextes familiaux de pères carrents provoquent des situations si difficiles que le fils n’a
souvent d’autre choix que de précipiter son départ du foyer parental ne supportant plus ni la
violence paternelle ni la charge qui lui incombe. Dans le cas des familles populaires
précarisées, trois hommes sur quatre décohabitent avant l’âge de vingt-deux ans. Le lien père-
fils est déterminant dans les causes de départ de ce dernier. Le décès, le remariage...
accentuent d’autant plus les problèmes liés au départ : famille devenue peu accueillante ou
mésentente insupportable. [Blöss, 1997]
Malgré la souffrance et la rancœur vécues par certains de mes enquêtés vis-à-vis de
leur père cet illustre inconnu, leurs désirs de le connaître et de le retrouver restent palpables.
La disparition du père ne produit pas forcément le désintérêt de son fils, bien au contraire, il
aura souvent d’autant plus à cœur de percer le mystère de son identité et comprendre qui il
est.
« Le daron (père) de mon frère ce n’est pas mon père mais c’est lui qui m’a élevé donc c’est mon père. J’ai une vision de mon daron, ma mère elle ment je sais que c’est pas mon père, je pète un câble je crois que c’est pour ça qu’on s’est engueulé la deuxième fois « tu veux pas me dire qui est mon daron ». Et puis elle m’a dit qu’il l’avait mise enceinte et que c’était un haïtien. [...] On a dû vivre deux ans ensemble avec mon vrai père, il venait me chercher, me prendre le week-end et puis ma mère me l’a caché, elle pensait que je n’avais pas une vision. Je lui ai dit « je ne suis pas ton fils » à ma daronne, j’étais énervé et je lui ai dit « tu ne m’aimes pas » puis c’est là qu’elle m’a expliqué le fait qu’il soit parti. Je veux le voir juste voir sa tête, voir c’est qui mon père. Il manque quelque chose ? Oui un peu je ne veux pas ça avec mes enfants, c’est comme si mon fils il appelle quelqu’un d’autre papa. » [Nolan, 26 ans, couple, 3 enfants]
« Je ne veux pas être trop indiscrète mais pourquoi ton père n’était pas là ? C’est une éternelle question, à plusieurs étapes de ma vie j’ai voulu faire le nécessaire, comprendre pourquoi il avait agit de cette façon là et encore aujourd’hui. J’aimerais bien le connaître. Peut être que sous certaines manières, certains traits je lui ressemble ? Comprendre pourquoi je suis comme ça, si ça ne vient pas de lui que j’ai fait des fautes dans ma vie. » [Laurent, marié, deux enfants, 8 mois]
Les individus dont le père est inconnu nourrissent un sentiment d’injustice face à la question
de l’identité de leur géniteur. Ils se questionnent « A qui dois-je d’être né ? ». L’absence de
53
réponse, l’impossibilité de dresser une biographie complète de leur géniteur les conduit à « se
nier [eux] mêmes » [Théry, 2011, 27]. Savoir qu’on est le fils de... permet d’accéder à ses
racines, à son histoire antérieure ; le vide quant à lui crée une difficulté supplémentaire dans
leur rapport à la vie. Aujourd’hui « un nouvel interdit s'érige : l'interdit d'oublier. » [Sellenet,
2007, 59].
Pour savoir qui nous sommes, nous voulons savoir d’où nous venons. L’entretien avec
Laurent illustre bien ce besoin de savoir : il imagine que la source des ses erreurs pourrait
découler de ce père inconnu.
Cette méconnaissance du père est accentuée par la dissimulation d’informations de la mère.
Le secret, constitué de mot tus, d’images et d’émotions inexprimables [Tisseron, 2011, 20]
empêche la réalisation de certaines expériences physiques et psychiques. A l’instar des
souvenirs, il perdure tout au long de la vie et aboutit parfois à des traumatismes.
L’absence de père ou sa présence en dilettante ont souvent été décrit par mes enquêtés comme
les sources de leur incarcération. Ils imaginent bien volontiers que cette présence paternelle
leur aurait évité la prison et qu’érigé en modèle d’intégrité, l’expérimentation du milieu de la
délinquance aurait été évitée. Le manque de père n’est évidemment pas le seul facteur de la
délinquance mais il occupe une large place dans les croyances et démontre l’importance de la
figure paternelle. L’absence tend finalement à accentuer l’image fantasmée de celui qui n’est
pas là.
Une complicité relative
La nature du lien père / enfant s’inscrit dans le contexte familial, social et culturel. Les
origines culturelles d’une grande partie de ma population issue de l’immigration influencent
la description du père. Il a une stature traditionnelle et statuaire instaurée par des relations
liées au travail ou à des jeux typiquement masculins (foot) plus que par l’affection. Dans ces
familles la répartition des tâches reste rigide et s’appuie sur la valence différenciée des sexes.
Les femmes consacrent davantage de temps à leurs enfants que les hommes, moins préparés
et conditionnés à subvenir aux besoins de la famille. Cette différence joue un rôle sur la
division du travail dans la famille et confère aux femmes le statut d’experts en matière de
soins [Turcotte et al, 2001]. L’implication des pères est influencée, les relations ne sont pas
continues mais se construisent par périodes, par « cycles de rattrapage : indisponibles à
certaines périodes, plus disponibles à d'autres. » [Quéniart, 2002]
54
« Ta relation avec ton père était comment ? On n’a pas passé de vacances ensemble, on parlait pas mal avec ma mère mais lui il faisait des travaux dans la maison. On a une grosse différence d’âge donc ce n’était pas évident. Mais quand il avait des clients il me prenait souvent, j’ai travaillé tôt avec lui au marché. Mon père était intransigeant avec l’école surtout il fallait avoir des bonnes notes. Il était gentil mais l’école changeait son visage. » [Larbi, 40 ans, marié, 4 enfants, 11 mois]
« Ça se passait comment avec ton père? Il s’est séparé de ma mère, j’avais 5 ans. Tu le revoyais ? J’allais chez lui de temps en temps. Je travaillais avec lui pour avoir un peu de sous. Je n’aime pas rester sans sous. Il s’est occupé de vous (ses frères et sœurs et lui) ? Pas directement, après des années. Çà fait presque 20 ans qu’ils sont séparés et de l’âge de 5 à 9 ans je ne l’ai pas revu. Il m’a acheté un vélo, on s’est revu à partir de là, oui c’est ça, c’est à partir de là qu’on s’est revu, et ce fut régulier jusqu’à maintenant. J’étais avec lui dans les travaux, il m’a appris...Et à 9 ans, ça se passait comment ? Il venait me chercher pour les vacances, puis pour l’école je rentrais chez maman. Tu l’as trouvée comment ta relation avec ton père ? J’étais très fâché avec lui car il me donnait pas toujours ce que je voulais, j’étais tout le temps fâché. Tu voulais quoi ? De l’argent. Ça a changé avec le temps ? Ça a changé à partir de 15 ans pour les vacances, j’allais travailler chez lui et il me donnait de l’argent. » [Bamba, 26 ans, en couple, 5 enfants, 6 ans]
Le modèle paternel dessiné par ces deux témoignages est plutôt traditionnel avec un père
travaillant, distant, strict et exigeant. Le fils est uni à son père par le lien du travail. Une
paternité statutaire où l’attachement au travail des hommes reste un facteur important de leur
identité [Gregory, Milner, 2004] y compris de leur identité paternelle [Boyer, Céroux, 2010].
Plus le père investit de temps et d’énergie dans son travail moins il s’implique activement
dans la vie de ses enfants [Turcotte et al, 2001, 28]. « Les résultats de Feldman et al.(1983)
indiquent qu'un père est d'autant moins impliqué dans les soins à l'enfant et les activités
ludiques avec celui-ci que le travail occupe une place centrale dans sa vie » [Ibid, 2001].
D’autres chercheurs cependant, nuancent cette affirmation et assurent au contraire, que
l’investissement dans le travail n’aurait aucune influence sur l’implication des pères
(Grossman et al, 1988)1.
Le rôle de père a néanmoins une fonction éducative, ils désirent transmettre un métier à leur
fils. Education et autorité, des attributs essentiels de la fonction paternelle (Hurstel 1996).
Dans une logique d’homosociabilité [Welzer-Lang, 2002], la transmission père-fils s’appuie
généralement sur l’acquisition de valeurs masculines comme la force, le courage, la capacité à
se battre, la pratique d’un sport, la mécanique, le travail...
« Comment ça se passait avec ton père ? Assez bien, on partageait pleins de choses. On avait le foot, on le regardait ensemble, on parlait voiture, ça dépendait en fait, avant je le voyais pas tellement, il travaillait beaucoup mais j’étais tous le temps avec lui, il jouait au handball, il était affectueux mais je lui parlais pas trop, je suis plus renfermé. Je suis comme ça. Il était gentil, une éducation normale, il voulait que je travaille, il voulait que je m’en sorte. » [André, 38 ans, séparé, 1 enfant, 9 ans]
« Vous avez fais du business ensemble ? Oui bien sur, on fumait ensemble, je le fais fumer, il me fait fumer. Il fait pousser de la beuh, moi aussi et on compare. Je m’entends bien avec lui, que ce soit la moto, la mécanique. Il t’a posé des limites ? Non j’avoue que non. Tu penses quoi de lui ? C’est un bon père malgré qu’il était absent, même s’ils étaient séparés je le voyais tous les jours. Ça a changé quoi la séparation ? C’est là que j’ai commencé à partir en vrille. S’ils étaient restés ensemble ce serait peut être pas arrivé. C’était plus pareil. Le soir il était pas là, c’est pas pareil, y avait quand même un manque,
1 In Turcotte et Al, 2001, 28
55
malgré que je le voyais tous les jours. Tu ne voulais pas vivre avec lui ? Si je voulais, je voulais mais ça ne voulait pas, j’en ai fait des cinémas, ça voulait pas. Je fuguais, il me ramenait chez ma mère, je lui en ai voulu. Il ne voulait pas m’avoir 24h/24. Il s’est dit que j’allais lui faire vivre un enfer. » [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
Ces deux entretiens montrent l’existence d’activités partagées (sport, mécanique ou encore
culture de plantes illicites) malgré tout une certaine distance et une communication limitée
restent de mise. Il est difficile d’affirmer que ces relations sont superficielles. Quentin qui
nourrit des relations conflictuelles avec sa mère souhaiterait vivre avec son père mais le refus
de ce dernier questionne l’implication à plein temps des pères. L’intériorisation des
organisations résidentielles encore très prégnante justifie t’elle la garde de l’enfant par la
mère ? [Martial, 2013, 40]. Cette organisation place les mères dans une position centrale,
dotées d’importantes prérogatives et d’une lourde charge éducative (Cadolle, 2000). La
résidence des enfants au domicile paternel ne concerne que 8 % des enfants mineurs au
moment des divorces (Chaussebourg, Carrasco et Lermenier, 2009)1. Pourtant ce dernier
chiffre augmente sensiblement dans les années qui suivent le divorce passant à 33 % tandis
que 10,5 % des mineurs sont en résidence alternée et que seules 56% des mères conservent la
résidence principale (Boisson et Wisnia-Weill, 2012)2. Ces chiffres ne font pas de distinction
entre les milieux sociaux même si je pense que ce facteur devrait être pris en compte.
Malgré l’affection de ces pères pour leurs fils et leurs efforts pour établir un lien, une certaine
pudeur persiste dans la mise en mots de leurs sentiments réciproques.
« Avec mon père je ne faisais pas grand chose, on est issu de l’immigration, il avait pas trop le temps de nous emmener au parc Eurodisney, c’est le boulot, le boulot, il dormait quand il bossait pas, il a fait ça toute sa vie. Il est honnête il a pas triché contrairement à moi. [...] On s’aime sans se le dire sans se le prouver. » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
Les liens à la mère
Une mère impliquée
Dans ma volonté de valoriser la place du père, j’ai minimisé l’importance du rôle de la
mère dans le devenir de son fils, un peu par négligence mais surtout par manque de temps. Je
tenterai ici de développer malgré tout, quelques points.
1 In Martial, 2013, 41 2 Ces chiffres sont issus d’une enquête de 2010. In Martial, 2013, 41
56
A travers mes entretiens, les pères ne donnent guère de conseils à leurs fils sur comment
devenir eux-mêmes des pères ; c’est différent pour les mères. Les pères transmettent les
ficelles du métier et les mères inculquent le savoir faire parental.
« Quand je me suis mis avec ma compagne c’était plus compliqué, elle était traditionnelle. Quand elle a su que j’étais avec une bretonne... mais quand j’ai eu mon enfant elle est devenue grand-mère donc elle était contente. C’était le premier et puis je n’ai pas de frère. Ça m’a beaucoup rapproché d’elle. Je n’étais jamais avec elle avant la naissance. Et quand ma fille est née elle venait souvent, elle regardait comment je faisais, elle faisait les petits plats, c’était énervant, je lui disais laisse moi tranquille, elle me disait de pas faire comme ça. Ça m’énervait mais j’écoutais elle avait plus d’expérience. C’était énervant mais quand elle tombait malade elle m’aidait, moi je ne savais pas. » [Lahcen, 47 ans, séparé, 1 enfant, 5 mois]
« Ta femme fait quoi à la maison ? Ma mère fait tout, ma femme l’aide pour la nourriture. Ma mère on peut pas trop lui parler, elle est trop stricte mais super gentille, elle est fragile faut pas trop lui parler. Elle me donne des conseils « reste calme, occupe toi de tes enfants », la routine. Et ta mère s’entend bien avec ta femme ? Elles se rapprochent, elles se considèrent comme mère fille. Au départ il y a eu des hauts et des bas. Fallait s’habituer au modèle familial. » [Djalil, 23 ans, marié, 2 enfants, 1 mois]
La grand-mère devient une figure essentielle dans l’éducation des enfants, c’est elle qui donne
des conseils et explique comment s’y prendre. Lahcen qui avait la garde de sa fille, explique
qu’il était parfois démuni et éprouvait un soulagement de pouvoir appeler sa mère et sa sœur.
Cette présence a un coût, être jugé sur son comportement et ses capacités de père. C’est une
mise en concurrence entre deux générations comme dans le deuxième entretien où la mère et
la belle-fille s’accordent difficilement sur le modèle familial. Djalil habite avec sa femme
dans le pavillon de ses parents, une situation susceptible de créer une rivalité importante entre
les deux femmes. Dans cette famille, les hommes travaillent pendant que les femmes restent
au foyer pour s’occuper des enfants et préparer les repas. Le modèle patriarcal est largement
respecté.
Au delà des conseils, la grand mère se substitue dans certains cas à la mère manquante.
Prenons deux exemples.
« Ma mère s’occupe de mon fils parce que depuis tout petit mon fils il est avec moi, il est pas avec la mère. Il sait qui est sa mère mais il me connaît plus. Comment ça se fait qu’il n’est pas avec sa mère ? Parce qu’il ne veut pas. Il veut aller au collège français. Et à St Martin y a deux parties, celle anglaise et françaises et elle est de l’autre côté. Et c’est moi qui lui dis d’aller voir sa mère, avant il ne voulait pas, maintenant il y va de temps en temps. [...] Mon père c’était un batard, excuse moi parce que c’est ma mère qui a tout fait. Elle était homme, femme, mère, grand-mère. A dix-sept ans j’étais déjà parti de la maison et je suis resté deux ans dans la rue. Le logement où j’étais a brulé, je n’avais pas de maison, je ne pouvais pas retourner chez ma mère. J’ai dû trouver comment vivre. » [Patrick, 32 ans, séparé, 1 ou 5 enfants, 5 mois]
« Tu as des nouvelles de Sami? Oui il me de donne des nouvelles au téléphone, il me parle de temps en temps. Il me demande où je suis, je lui ai dit que je suis en France. Je ne peux pas lui donner d’argent c’est ma mère qui paye mais je la rembourserai. Et Samia ? Elle était avec ma mère, quand j’ai été incarcéré, sa mère l’a cherché sans que ma mère soit au courant, c’était y a trois mois. Pourquoi ta mère avait les deux ? Quand elle a accouché de Samia, au bout de 3 mois, j’étais incarcéré, elle était toute seule sans ses parents, ma mère a voulu l’aider, elle a pris Sami en 2007 puis Samia car elle ne pouvait pas s’en occuper puis quand elle l’a vu grandir, elle l’a repris. Et comment ça se fait qu’elle a pris Samia et pas
57
Sami ? Elle avait l’habitude de Samia beaucoup moins de Sami. Mais elle passe à la maison le voir. » [Bamba, 26 ans, séparé, 2 enfants, 6 ans]
Ces deux enquêtés sont tous deux antillais d’où une organisation familiale essentiellement
matrifocale - celle-ci a tendance à exclure le père en destituant l’homme -. Si la mère n’est pas
en mesure de s’occuper des enfants c’est généralement la grand-mère maternelle qui s’en
charge et dans ce cas, c’est la grand-mère paternelle. Elle va assurer toutes les fonctions,
devenir pourvoyeuse des biens pour la survie de toute la descendance. Finalement ces femmes
ne quittent jamais leur statut de mère et assument les responsabilités liées au petit dernier.
Nous notons l'existence ininterrompue de relations et d'échanges entre ascendants et
descendants [Blöss, 1997]. Le rôle de grand-mère est intimement lié à celui de mère. Cette
mise en valeur de l’investissement maternel place leur enfant au centre d’une relation
intergénérationnelle.
Une mère absente
Si la présence de la mère revêt plus d’importance que celle du père chez mes enquêtés,
son absence entraine indubitablement un manque d’amour. Plusieurs détenus parmi mes
enquêtés ont vécu très jeunes en foyer, à la DASS ou ont été recueillis par une grand-mère ou
une tante. Ils nourrissent vis à vis de l’absence de leur mère une rancœur nettement plus
importante que celle inspirée par l’absence de leur père.
« Mon père a disparu quand j’avais cinq ans, je ne suis pas souvent resté avec ma mère j’étais placé mais elle a toujours été là. Elle m’envoyait des lettres puis elle me téléphonait et elle venait me voir. [...] Le fait d’avoir été, de ne pas avoir connu mes parents, pour moi quand j’étais petit je la prenais pour ma sœur, j’appelais toujours ma grand-mère quand j’avais besoin d’aide, par exemple à ma circoncision j’ai pas appelé ma mère.[...] elle m’a toujours donné de l’argent. Je lui ai demandé une voiture téléguidée puis une guitare, une Paul Busher je me rappelle puis je voulais un vélo. A 14-15 ans elle m’a acheté une mobylette, j’avais toujours de l’argent. Mais ça m’est arrivé de pleurer, parce qu’à Noël elle n’était pas là, surtout à l’âge de 10-11 ans. Vous lui en voulez ? C’est une question qu’elle m’a posée, au fond de moi je ne peux pas dire du mal de quelqu’un qui est mort. Je ne peux pas lui reprocher, elle ne devait pas pouvoir faire autrement. Sinon elle m’aurait gardé… si on ment je dirais que oui elle est méchante mais la pauvre j’étais pas à sa place. Elle a tout fait pour que je sois bien, j’ai essayé de lui reprocher des choses mais je lui ai menti. Je lui dois le respect, ça s’arrête là je veux pas de conflit, je veux garder une bonne image. » [Mouloud, 69 ans, marié, 2 enfants, 2 ans]
« Moi je n’ai jamais vécu avec mes parents. Mon père je l’ai vu à quelques reprises, transparent, aucune emprise sur moi comme ma mère. C’est ma grand mère qui m’a élevé, si j’étais resté chez ma mère ça aurait été plus hard. C’était une famille de Truand, le gang de Marseille, la famille X. Mais par contre chez ma grand-mère, j’étais à la campagne, c’était immense, ça n’a duré que neuf ans. Et après ? Ma mère m’a repris donc elle m’a remis dans le milieu à Marseille, c’est pour ça que je ne me précipite pas pour retourner les voir. Mais là ça me donne envie, je n’ai pas vu mes sœurs, mes tantes depuis très longtemps. Vous aviez quelle relation avec votre mère ? Très mauvaise, ma mère elle m’a laissé pendant neuf ans, quelle relation on peut avoir. Le jour de mes neuf ans, j’étais son fils, elle a fait le bordel, ma grand-mère a essayé de me garder. Je pars au quart de tour grâce à ma mère. Et après ? Ça a été
58
dramatique, le seul souvenir c’est que j’avais envie de tout bruler, la faire cramer voilà le souvenir. » [Alain, 59 ans, séparé, 2 enfants, 5 ans]
Cette substitution de la mère par la grand-mère témoigne de l’incapacité de certaines femmes
à materner au même titre que les hommes – ce qui remet en question l’idée d’instinct
maternel. Les places vacantes sont investies par un tiers. Logiquement, les personnes
s’ajoutent mais ne se remplacent pas d’où des situations d’incompréhension très mal vécues.
Malgré des vécus très différents, la souffrance de mes deux enquêtés, liée à leur abandon est
similaire. Si l’un cherche à préserver la mémoire de sa mère, l’autre a mis le feu à
l’appartement parental et a manqué de la tuer. « L’abandon peut générer des désarrois
humains parmi les plus violents qui puissent se concevoir » [Théry, Leroyer, 2014, 246]. Une
mère présente qui ne s’occupe pas de sa progéniture est sans doute une situation plus
douloureuse pour l’enfant que de ne pas avoir de mère du tout, l’incompréhension semble
plus profonde. Oublier une mère décédée est plus facile que pardonner une mère carrente.
La présence du beau père/ de la belle mère
J’aborderai rapidement la question de la beau-parentalité, une notion importante que je
n’ai malheureusement pas développée. « Selon l’INSEE, un enfant mineur sur dix vit
aujourd’hui dans une famille recomposée en France métropolitaine, soit 1,5 million d’enfants
de moins de 18 ans [...]. La majorité de ces beaux-enfants (79%) vivent principalement avec
leur mère et leur beau-père, et 21% avec leur père et leur belle-mère » [Théry, Leroyer, 2014,
275]. Seul un de mes enquêtés à vécu avec sa belle mère car la garde des enfants revient
généralement à la mère. Mon enquêté décrit sa belle-mère avec tous les stéréotypes qui sont
associés à la marâtre…
« Avec mes parents je suis en guerre. C’est ma belle-mère qui est là. Je n’ai pas vu ma mère depuis douze ans. Elle est en Turquie, je n’ai pas trop envie d’y penser. Elle me manque, j’ai envie de la voir. Elle est diabétique et les soins là bas c’est pas pareil, j’aimerai bien m’occuper d’elle [...]. Ma belle-mère m’a fait pleins de problème, à la base je suis bien avec mon père mais ma belle-mère, elle a fait la merde. Quand mon père m’a arraché de ma mère je ne voulais pas, je ne peux pas oublier. Donc jusqu’à vingt ans j’étais avec eux, on allait en voyage en Turquie et fallait que j’aille la voir en cachette. J’ai eu des problèmes, j’ai dû partir de chez mes parents et j’ai dû me démerder tout seul dans la drogue. [...] Quand je travaillais, elle était bien vu que je lui donnais de l’argent et quand je ne travaillais pas, elle ne lavait pas mon linge, elle me coupait l’eau. Je suis tombé dans la drogue, je suis tombé et ainsi de suite [...]. Je lui en veux à ma belle-mère, c’est un film vous voyez comment elles sont. On rentrait de l’école elle nous battait. On n’a pas eu une enfance facile et que j’avais peur de mon père on ne pouvait pas le dire, il l’aurait battue. Et je suis parti, il allait me savater. J’avais envie de la tuer mais je ne suis pas allé jusque là. » [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
59
« Ce qu’une marâtre aime le moins, ce sont les enfants de son mari. Plus elle est folle de son
mari, plus elle est marâtre » (La Bruyère) [Ibid, 2014, 278]. Cette phrase de La Bruyère
résume plutôt bien la perception qu’a Timur de sa belle-mère, cette dernière apparaît comme
la seconde épouse, cette « mère dénaturée [Ibid, 2014, 278] du XVIIIème siècle. Finalement
cette femme efface la première en se substituant à elle et cette situation invivable pousse
Timur à quitter le foyer et à entamer sa descente dans l’enfer de la drogue. Le soutien familial
devient inexistant.
La présence notable du beau-père découle de sa capacité à prendre un rôle de
pourvoyeur et d’apporter un second revenu au foyer [Sellenet, 2007, 38]
« Mes parents ont divorcé, ma mère s’est retrouvée seule, au chômage avec mes frères et sœurs à gérer, j’ai du bosser et l’aider un petit peu financièrement, mais j’en gardais aussi pour profiter de ma jeunesse. Puis le beau père est arrivé et a repris les rennes, mais moi à 15 ans je pouvais plus encaisser une nouvelle autorité » [Ludovic, 27 ans séparé, 1 enfant, 3 mois]
Cet entretien est intéressant pour deux raisons, d’une part il montre comment l’arrivée du
beau-père a donné un second souffle financièrement à la famille et d’autre part la difficulté
d’accepter une « nouvelle autorité ».
L'adolescence arrive à un moment charnière où « les beaux-enfants ne supportent plus qu'un
beau-père veuille exercer la moindre autorité sur eux. Ils n'obéissent pas parce qu’ils n’ont
aucune envie de lui faire plaisir. Leur parent est à leurs yeux le seul détenteur légitime de
l'autorité, même s'il ne l'exerce guère. » [Ibid, 2007, 39]
La place du beau-père dépend beaucoup de la place du père, du lien qui s’est construit entre
son enfant et lui mais aussi des conditions de la séparation. La relation du beau-père et de
l’enfant s’inscrit dans un ensemble plus large de relations entre les membres d’une famille
élargie - que celles de la famille nucléaire - [Ibid, 2007, 31].
« ça se passait comment avec ton beau-père ? Au début ça allait pas, j’ai été élevé à l’ancienne. Avant si je demandais une Playstation je devais travailler pour l’avoir puis ce n’était pas évident. On se disputait beaucoup. Avec ma mère on parlait pas plus de cinq minutes et quand je suis rentré je l’ai prise dans mes bras et je lui ai dit je t’aime. J’ai eu le temps de réfléchir. J’ai été élevé à la dure et ma petite sœur et mon frère ce sont les enfants de mon beau-père et eux ils avaient tout. [...] Quand est ce que ton beau-père est arrivé ? C’est mon voisin, ils se côtoyaient quand j’avais cinq six ans et ils se sont mis ensemble quand j’avais huit ans, j’en ai trente et un maintenant. Et quand il est arrivé...C’était pas un choc, mon père c’était un voyou, les flics à la maison... c’est mon souvenir avec mon père, j’avais l’habitude c’est pas comme mon beau-père qui était à l’opposé de ça. » [Maxime, 31 ans, 2 enfants, 3 ans]
La relation qu’entretient Maxime avec son beau-père est au départ conflictuelle, il faut non
seulement accepter une nouvelle figure mais surtout renoncer à son propre père. La présence
du beau-père le confronte quotidiennement à l’incapacité de son propre père à remplir son
rôle. La comparaison qu’il établit entre les deux figures est intéressante car elle révèle
60
l’opposition entre les deux, l’un est un « voyou », l’autre est son contraire. Le refus du beau-
père découle aussi de l’opposition des deux modèles éducatifs, l’un étant strict pour lui,
l’autre plus permissif pour son frère et sa sœur, d’où un sentiment d’injustice.
Pour finir prenons deux exemples qui s’opposent sur l’appellation du beau père.
« Et avec ton beau-père ça se passait comment ? J’ai fait beaucoup de bêtises, j’ai tout fait, fugue... ma daronne n’en pouvait plus et à chaque fois elle l’appelait, il me tapait, c’est des cons ça fait mal et après ça passe et après voilà ça a rien changé. Il est venu au jugement celui que j’appelle papa, il savait que je faisais des bêtises mais pas à ce niveau là. » [Nolan, 26 ans, couple, 3 enfants, 1 an]
« Jacko je ne l’ai jamais appelé papa. ça ne lui aurait pas plu de toute manière et moi je ne voulais pas donc on était d’accord. Puis ça s’est tassé. » [Laurent, marié, deux enfants, 8 mois]
« Des jeunes parlent de leur beau-père comme de leur vrai père, le plus souvent, leur parent
biologique avait alors laissé se distendre le lien avec eux, et le beau-parent s'est substitué à un
parent absent ou carrent. Le jeune âge de l'enfant au moment de la séparation joue en faveur
de l'engagement du beau-père dans un rôle parental, sans pour autant empêcher les rejets
affectifs à l'adolescence. » [Ibid, 2007, 35] Le cas de Nolan illustre bien cette situation : il
connaît l’existence de son père mais l’ayant très peu côtoyé, il appelle son beau-père « Papa »
; un bel hommage à celui qui s’est chargé de son éducation et l’a reconnu alors qu’il n’était
pas son enfant biologique. Au contraire, Laurent refuse de faire l’amalgame alors qu’il n’a
pourtant connu que son beau-père. Il serait intéressant d’aller plus loin pour comprendre les
raisons de ces logiques différentes.
La fonction du beau-père n’est pas de se substituer au géniteur mais d’ajouter une strate dans
la pyramide familiale sans gommer les liens antérieurs. « Le beau parent est désormais
désigné non plus comme « second parent » mais comme « ni parent, ni pair » » [Meulders-
Klein, Théry, 1993, 160], il acquiert une place particulière. Des questions se posent : « Quel
rôle joue le beau parent dans l’éducation du bel-enfant et comment ce rôle influe-t-il sur les
relations familiales ? Comment trouve t’il sa place sans usurper les liens du père absent qui
reste engagé ? Son autorité est-elle ressentie comme légitime par ses beaux-enfants? [Sellenet,
2007, 30]
Le modèle éducatif, entre reproduction et distanciation
61
J’ai évoqué l’histoire familiale des hommes qui ont jalonné ma recherche pour
comprendre dans quelle mesure ils reproduisent un modèle connu ou si inversement ils s’en
éloignent.
Beaucoup d’entre eux ont vécu des histoires familiales difficiles et inscrivent leur paternité
dans un contexte similaire. Ils ont, pour la plupart construit une image paternelle à partir de
leur propre vécu, de leurs actions, de leurs réflexions et de leur expériences avec parfois un
modèle de référence défaillant d’un père qui les a mal aimés, blessés ou battus [Lafortune et
Al, 2004]... Le cocon familial quitté précocement, ils connaissent généralement une entrée
dans la paternité très jeunes et sans emploi. «Ces jeunes pères sous-scolarisés, sans emploi
stable ou faiblement rémunérateur ils possèdent une double vulnérabilité: 1) celle d’être
exclus des circuits dominants de l’intégration sociale; 2) celle d’avoir un enfant au moment
d’une phase importante de leur individuation. » [Ouellet et Al, 2006, 158]
Il est plus facile d’assumer sa paternité quand on sait ce qu’est un père et d’être en mesure de
s’investir dans sa relation avec son enfant grâce au processus d’identification.
N’oublions pas la capacité d’empowerment (Chamberland, Lessard, 2003 : 282)1 de l’individu
: les relations difficiles avec son propre père le pousse à ne pas reproduire un tel vécu et
l’éloigne du modèle familial. « Il essayera de ce fait d’adopter des conduites parentales qui se
situeront à l’opposé de celles de son propre père ». [Turcotte et Al, 2001]
Par « reproduction » je me réfère à la conception Bourdieusienne qui sous-tend le maintien
des individus dans la classe sociale de leurs parents par la transmission des trois capitaux,
économique – social et culturel. La famille joue un rôle primordial dans la transmission de ces
capitaux. Par l’intériorisation de l’héritage familial, nous reproduisons un modèle connu, en
supposant qu’il existe une forme de déterminisme. Un seul des mes enquêtés a réellement
évoqué ce désir de reproduction, sans doute parce qu’il est difficile de prendre conscience de
l’intériorisation du modèle vécu et requiert une vraie réflexion sur soi même. De surcroit,
assumer une ressemblance avec ses parents est rarement facile. La tendance est davantage à la
singularisation même si dans la pratique l’inverse se vérifie.
L’enquêté en question a reproduit le schémas familial, non pas dans son rapport père/fils ou
l’éducation divulguée à son enfant mais à travers la violence manifestée envers son ex
compagne. Dans ce témoignage, le détenu exprime une distanciation dans la reproduction.
1 « L’empowerment est le processus par lequel une personne acquiert le sentiment qu’elle peut exercer un plus grand contrôle sur sa réalité par des actions concrètes dans des conditions de vie incapacitantes ; le résultat d’un tel processus est l’augmentation des sentiments d’estime de soi, d’efficacité, de contrôle ou de pouvoir sur le plan individuel, organisationnel et communautaire » in JOËL-LAUF, 2012 90
62
« Tu as l’impression de suivre le modèle que vous avez eu ? J’ai reproduit la violence qu’il avait avec ma mère. Et ma mère m’a dit que je ressemblais beaucoup à mon père mais en plus modéré et en plus clairvoyant. Le 30 décembre quand j’ai cassé la maison c’est un truc qu’il a fait en 95, le jugement avait dit qu’il devait quitter la maison. Quand j’ai dit que j’allais tout casser à ma mère… parce que ma compagne l’a appelée, elle m’a dit de ne pas y aller, et elle a dit « tu fais des trucs comme ton père ». La seule différence c’est qu’il ne rendait pas de comptes sur ses actes, il les posait et on devait se démerder avec. Après il n’a pas eu la chance que j’ai eue. Ma mère me montrait le droit chemin. Il a eu une mère qui l’ensorcelait, elle avait une grosse emprise sur lui. [...] aujourd’hui je me vois et je me dis qu’il n’a pas eu ma chance. Il n’a pas été incarcéré comme moi, ma mère n’a pas porté plainte. J’ai été témoin de grosses violences, je vais vous dire quelque chose de choquant. Adolescent, j’étais en plein dans la violence, il a été jusqu’à la défigurer. J’avais seize ans et mon frère dix-huit ans, ça a été la fois de trop et on a mis une rouste à mon père. » [Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois]
Incarcéré pour violence conjugale, Eliot, contrairement à son père qui le battait régulièrement
n’a jamais touché à son fils. Il cherche de cette manière à se distancier de son modèle mais
reconnaît la reproduction des violences faites à sa mère par son père.
Même si la majorité des détenus nie avoir suivi un modèle familial, des ressemblances
évidentes subsistent dans leurs choix de vie. Maxime et Ludovic, cités précédemment (Pages
59-60) à l’exemple de leurs pères alcooliques et drogués, ont développé exactement les
mêmes addictions. Leurs modèles ont-ils influencé leurs pratiques ? Pouvons nous
véritablement parler de reproduction ? Une recherche plus approfondie serait nécessaire pour
appréhender dans quelle mesure a lieu cette reproduction et quelle prise de conscience en ont
les détenus. La distanciation est plus compréhensible que l’identification, notamment par le
désir du détenu de rompre avec un modèle qui l’a fait souffrir.
« Les témoignages des pères sont révélateurs de leur désir de changer le cours de leur propre
histoire. Ils veulent éviter de reproduire ce qu’ils ont vécu dans leur enfance ou leur
adolescence, ce qui implique d’être présent, disponible, aimant, ou bien de ne pas être trop
sévère, de ne pas utiliser la violence. Dans tous les cas, ils sont conscients qu’il leur faut
inventer leur propre rôle de père, car ils n’ont pas véritablement de figure de référence en ce
domaine. » [Ouellet et Al, 2006, 165]
La plupart des détenus craignent de reproduire le modèle de paternité qu’ils ont connu.
L’arrivée de leur enfant les encourage à une réflexion propice à la construction de leur propre
destinée de père, « plutôt que de se voir condamnés à reproduire la pauvreté du modèle
paternel reçu en héritage », [Ibid, 2006] ils vont chercher à fabriquer le leur.
« Moi j’ai pas connu mon père il travaillait tout le temps, j’ai commencé à le connaître à vingt ans. Je le voyais jamais, j’ai pas de souvenir, il est pas venu me voir à un match, il venait pas à l’école ou me faire un bisou le soir. C’est l’ancienne génération, ma mère pareil. Ils travaillaient tout le temps. Et qu’est-ce que ça t’a fait ? On n’y pense pas puis après j’ai appris à le connaître. Mais je n’ai pas voulu reproduire. Je l’aime, il a beaucoup travaillé mais faire des choses avec mon père… Maintenant avec les enfants… je me rappelle pas être monté sur son dos c’est pas des trucs qu’on devrait oublier. Tu as essayé de te dégager de ce modèle ? Oui complètement même s’il m’a jamais frappé. Après j’ai eu mes enfants tard
63
j’ai eu le temps de penser. Avoir des enfants trop tôt est-ce qu’on peut s’en occuper par rapport à la situation professionnelle ? » [Franck, 44 ans, divorcé, 3 enfants, 1 an]
« Tu penses que le modèle éducatif a eu une influence sur ta paternité ? J’en ai souffert donc quand j’ai eu des enfants, je ne voulais pas qu’ils subissent, donner du bonheur comme je n’ai pas eu et utiliser mon expérience pour que ça leur soit bénéfique. Tout ça c’est douloureux, je suis passé à côté, j’ai voulu apporter du bien et là incident de parcours, c’est un gros dérapage, c’est pas bon pour leur équilibre, je l’ai mauvaise, j’ai les boules, ça fait du mal pour mon cœur, j’ai loupé mon truc, ce qui a de plus cher à mes yeux, l’éducation de mes enfants. » [Laurent, marié, deux enfants, 8 mois]
Prendre en compte le bagage personnel, l’histoire de l’individu et sa socialisation permet de
comprendre qu’il ne se résume pas au seul modèle familial. Malgré les difficultés « ces
parents sont avant tout des individus qui, dans la mesure où ils disposent des ressources
nécessaires peuvent devenir des sujets, acteurs et auteurs de leur propre vie.” [Devault, et Al,
2003]
Passer du fils au père
Devenir père c’est sortir de la dimension de fils, quitter l’emprise paternelle et s’ériger
sur un pied d’égalité. A travers la paternité, ces hommes composent une redéfinition de leur
propre identité, ils dépassent leur rôle de fils pour accéder à celui de père. Ce processus de
changement réactualise parfois des conflits, des douleurs, des secrets de famille qui peuvent
entraver la construction d’un nouveau rôle [Cacialli, 2013, 19]
« Le début de ma paternité était dur, mon père venait de mourir et je devais apprendre à être père. J’avais tellement une grosse souffrance. Je n’arrivais pas à concilier être père sans avoir de père. Y avait de la joie et de la douleur, ça a été brutal. A un moment j’ai eu ce sentiment, quand mon fils est né je me suis dis que mon père allait revivre et quelque part je me suis dis que par rapport à mon histoire je pourrais dire que si je n’avais pas d’enfants, toutes mes joies et mes peines elles n’auraient pas de sens, c’était un miroir qui me permettrait de changer le cours des choses. En terme d’enseignement mon père m’a rien appris, même s’il était proche, rien à voir avec l’alcool et la violence. Il m’a donné de l’amour mais il n’a pas su me donner de leçon de vie. A travers mon fils ce que j’ai compris c’est que je vais transmettre, ça donne un sens à ce que j’ai vécu et l’analyse de ma vie. Ce que je comprends de la vie c’est bien le partage avec mon fils. Mon père ne me demandait pas mon avis sur ses actes à lui mais mon fils il me demande, je dois lui donner un sens. Mon père c’était la dictature, on devait se démerder avec ses actes. Je ne peux pas supprimer mes actes mais je dois lui donner un sens et travailler à ne pas reproduire les mêmes actes. Comprendre c’est minimiser la récidive. » [Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois]
Eliot construit les bases de sa paternité dans la douleur, il devient père au moment où le sien
disparait. A cette souffrance, s’ajoute un lourd bagage familial à assumer. Dans ce contexte,
son fils apparaît comme le moyen pour donner du sens à son vécu et à ses actes en essayant
d’agir différemment et mieux pour le bien de son enfant. La paternité devient un moyen de se
sentir entier face à son propre père. L’enfant représente une partie-création de son père et
permettant d’obtenir un égo plus valorisant. « De cette confrontation osée va émerger la
pensée possible, pour le fils, d'une communauté masculine des pères, communauté qui restait
64
masquée par l'aveuglant décalage de génération entre père et fils. Tant qu’il n’est pas père, un
homme est un fils, démuni et en dette devant son père, quelque exploit qu'il accomplisse par
ailleurs. » [Le Roy, 1996, 141]
En l’absence de père, difficile d’être soi-même un père nous explique sans détour, Alain :
« (Quand on n’a pas de parent) On n’a pas la fibre parentale, on n’apprend rien donc on ne peut pas donner ça à ses enfants. Ça s’apprend, ce qu’on reçoit de ses parents on le transmet à ses enfants. C’est mon vécu je le vois comme ça. Vous y avez réfléchi ? Non je l’ai vécu, je l’ai ressenti, on ne se pose pas les questions. Il vous arrive tout dans la figure, les questions, les réponses. Quand on n’a pas appris on doit faire avec. » [Alain, 59 ans, séparé, 2 enfants, 5 ans]
Cette immaturité se transmet de père en fils, créant une détérioration du lien filial de
génération en génération. « Le scelte future, la personalità e l’identità dell’individuo, le
relazioni che ricercherà ed il modo in cui le utilizzerà sono frutto del mito familiare che
ognuno di noi si porta dietro, dei miti individuali, del processo di separazione/individuazione
ed appartenenza al sistema familiare. »1 [Cacialli, 2013, 19]
Sans devenir leur propre père, être bien armés pour affronter leur paternité facilite un chemin
de vie déjà semé d’embuches. Mes enquêtés portent souvent de lourdes chaines à leur pied.
B. DU LIEN CONJUGAL AU LIEN FAMILIAL
Les liens familiaux parentaux sont compliqués à tisser, il en va de même pour les liens
conjugaux, souvent instables et précoces. A l’image de leurs conjoints détenus, les femmes
déplorent également un passé conjugal et familial complexe. Ces mères, comme ces pères
connaissent généralement les mêmes trajectoires, une paternité jeune dans un contexte social
peu aisé. C’est « dans l’adolescence ou peu après que la plupart ont rencontré une femme,
laquelle devint enceinte assez rapidement après la rencontre. Les futures mères avaient elles-
mêmes souvent connu un parcours difficile ou étaient dans certains cas aux prises avec des
problèmes de toxicomanie ou de santé mentale ». [Ouellet et Al, 2006, 163].
Si dans l’idéal du couple formé, l’enfant vient confirmer cette alliance, c’est l’opposé qui se
produit généralement pour mes enquêtés. L’enfant institue le couple et le maintient mais cette
logique révèle souvent des fondations conjugales instables. A ce point de ma recherche, mon
objectif est de replacer la mère dans les connaissances sociologiques et dans les témoignages
de ces hommes. Une difficulté majeure se présente car le rapport lié entre le détenu et la mère
1 Les choix futurs, la personnalité et l’identité de l’individu, les relations qu’il cherchera et la manière dont il les utilisera sont le fruit de l’histoire familiale que chacun de nous porte derrière soi, de l’histoire individuelle, au processus de séparation/d’individualisation et d’appartenance au système familial. Traduction par Marine Quennehen
65
de son enfant est intiment imbriqué dans le vécu carcéral, la prison jalonne leur parcours de
vie et de parents.
Il est intéressant de constater que même si le modèle traditionnel du chef de famille apporte
aux hommes, l’autorité ; l’existence de l’enfant donne toute son ampleur à la place de la mère.
Le lien à l’enfant ne s’exprime jamais sans elle1 et les pères dépendent de son bon vouloir.
La parole de la mère, créatrice de père
Serge Lebovici affirme : « L’enfant fait la mère. Le père est d’abord dans la tête de la
mère. La mère nomme le père et celui-ci va reconnaître l’enfant pour l’inscrire dans sa lignée.
» [Marchand, 2012]. La mère institue en quelque sorte la fonction paternelle par sa parole, ce
qui fait d’elle la propriétaire du nom du père. Ne pas le nommer équivaut à avoir un enfant
sans préciser qui est le père [Le Roy, 1996, 118]. This parle du « primat du langage » comme
constitution de l’être père, mais aussi du fils ou de la fille. Nous n’existons comme sujet qu’en
étant « représentés par un signifiant » [Neyrand, 2011, 246]
Ce détenu résume parfaitement cette idée.
« Je suis pressé d’aller m’occuper de mes enfants, pour moi j’avais trois enfants. Une des mères m’a dit quand je suis tombé, elle m’a dit que c’était ma fille, je lui ai donné 80 000 euros (regard étonné de ma part) c’est la mère qui dit qui est le vrai père. Y a des pères qui éduquent l’enfant mais c’est pas le géniteur. Quand il y a six enfants parfois y en a que deux qui sont à toi, elle dira jamais, c’est très fréquent. » [Nestor, 40 ans, concubinage, 3 enfants, 28 mois]
La mère est la détentrice de la fonction paternelle, sa parole seule, compte, indépendamment
des liens biologiques. Bien qu’ils soient prégnants en France – la justice est parfois saisie pour
effectuer des tests de paternité – ils n’ont pas la même importance dans d’autre pays.
Lorsqu’un enfant est attribué à un homme, celui-ci doit se reconnaître comme père et
assumer la charge qui lui incombe [Le Roy, 1996, 118]. Il ne faut, cependant, confondre
patronyme et "nom-du-père", ce n'est pas seulement la nomination qui importe mais les effets
de la référence maternelle à celui qui se dit coresponsable de l'enfant. [Neyrand, 2011, 208]
La parole de la mère est indispensable pour attribuer la paternité et la crainte des hommes de
ne pas être le père, omniprésente ; le doute de la paternité pèse comme une épée de Damoclès
au dessus de leur tête :
« Quand elle était enceinte de ma deuxième, Emilie, elle m’a dit qu’elle avait été enceinte de trois enfants de trois pères différents et je lui ai dis « Pourquoi Emilie est pas de moi ? » Et en fait c’était la mienne mais c’est pour ça que je ne l’ai pas reconnue, ma vie est compliquée et aujourd’hui je suis entrain de la
1 Certains enfants sont placés et les deux parents sont soumis aux décisions judiciaires mais ce n’est pas la majorité d’entre eux.
66
reconnaître. [...] Emilie c’est maman maman, quand y a papa c’est papa. Quand y a les deux c’est papa, si on mange elle viendra plus sur mes genoux, elle ne m’a pas connu, c’est sa mère qui l’a élevé, ça se voit qu’il lui a manqué son papa. Elle a toujours été avec maman il lui a manqué une présence masculine. Elle disait « c’est qui mon papa ? Il est où papa ? », ça se sent. Elle était chez maman quand je suis rentré, elle m’a sauté dans les bras, maman ne comptait plus. Inès c’est différent elle a pas été délaissée alors que Emilie c’est que par maman, je lui ai jamais donné le biberon, ou changé les couches. Je l’ai abandonné complètement, y a que à un an et demi que je l’ai reconnue, je l’ai rejetée, je pensais que c’était pas ma fille. Je me suis remis en question pour la reconnaissance. » [Thierry, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
Cette histoire met en évidence les effets du passage sous silence du père. Celui disparaît tout
simplement et ne permet pas à l’enfant de se constituer une généalogie. Le vide crée le besoin
de connaître cet autre qui a contribué à sa naissance. La mère détient, seule, le pouvoir
d’instituer ou de renier le père dans son rôle de géniteur, d’instaurer un doute ou non.
« Chaque père doute, mais sa certitude de paternité se fonde sur l'affirmation énoncée par la
mère: « c'est toi ». Cette affirmation lève, nie le doute. » [Rancher, 1989, 75]
Cette petite fille, Emilie, aura déjà neuf ans avant d’être certaine de l’identité de son père …
Quels seront les impacts de cette certitude révélée sur sa construction identitaire ? Comment
combler le temps de l’ignorance et de l’absence du père ?
Quand Thierry déclare « pour Emilie, c’est maman maman » et « il lui a manqué une
présence masculine » il confirme le rôle de la fonction paternelle dans la structuration du
sujet enfant. Lacan précise que cette reconnaissance du père autorise la « coupure symbolique
du lien primordial unissant l'enfant à sa mère ». Grâce à cette coupure, l’enfant se construit en
tant que sujet, la fonction paternelle prend alors toute son importance [Hustel, 1996, 169]
Sans prétendre élaborer des considérations psychologiques – mes connaissances restent
limitées dans ce domaine –, je suppose que cette insistance sur la triangulation oedipienne a
un impact notable sur la fonction paternelle. Elle surjoue la prévalence de la mère dans le
rapport à l’enfant et cantonne le père « dans une fonction particulière, celle d'incarner, ou
d'être le support, d'un ordre symbolique » [Neyrand, 2010, 68]
L’ambiguïté de la théorie lacanienne qui met en évidence l’importance du « nom du père »
fixe l’homme dans un nom institué par la mère sans avoir lui même aucune emprise sur son
rôle. Si nous choisissons de privilégier la parentalité (pratiques parentales et aspect relationnel
à l’enfant), la reconnaissance du statut du père perdra de son importance.
Margaret Mead, nous explique que le sens donné aux liens unissant « d'une part, une femme
et l'enfant qu'elle a mis au monde et d'autre part, un homme et l'enfant mis au monde par une
femme avec laquelle il a eu des rapports sexuels est conditionnée par des facteurs culturels »
[Ibid, 2010, 72]
67
Une mère toute puissante
Nous reconnaissons aisément à la mère son instinct maternel, seule raison qui légitime
qu’elle soit chargée « d’office » de l’éducation des enfants. L’homme ne semble, au contraire
pas porté naturellement sur la paternité. Le père est père par la seule volonté de la mère
puisqu’elle maitrise sa propre contraception. Curieusement l’enfant est associé au seul corps
féminin ; même dans un projet parental le père est obligé de demander un enfant à sa femme.
« Par son pouvoir la femme contemporaine accorde la vie ou la mort au père, jamais la
dimension paternelle n'a autant dépendu de l'autre, dans une sorte d'ironie de l'histoire de
notre espèce par laquelle la femme instaure désormais une société matriarcale » [Le Roy,
1996, 118].
Dans l’ouvrage Masculinités, état des lieux, les auteurs inventent le terme de « matrivirilité »
pour désigner des pouvoirs démesurés longtemps réservés aux pères et acquis injustement pas
les femmes. Ils se posent la question : « Comment les hommes peuvent-ils, dans ces
conditions, ne pas se sentir dépossédés de leur paternité, et de ce fait profondément fragilisés?
[Welzer-lang et Al, 2011, 77]. Appréhender le rôle du père selon une vision misérabiliste ne
contribue pas à le faire évoluer. Ce positionnement de la mère toute puissante n’est pas
valorisant car il cantonne toujours la femme à son rôle de mère.
La mère ne doit pas être considérée comme objet principal du lien. Le comportement
d’attachement n’est pas uniquement dirigé vers elle mais vers le père également (Bowlby
[1969], 1996, 251)1. Ce lien est susceptible d’exister avec plusieurs personnes, sans pour
autant amoindrir l’importance de celui avec la mère. Même l’auteur des best seller, Laurence
Pernoud, fait perdurer « l'idée reçue non seulement du primat mais du quasi-monopole de la
mère sur le bébé » [Neyrand, 2010, 131]. « La mère est essentielle la première année, il
semble que l'enfant ait assez d'une personne pour vivre heureux; si son père l'ignore, il n'en
souffre pas vraiment» (Pernoud [1965], 1998, 62)2. Ce type de discours constitue un véritable
handicap dans la constitution de la paternité et la future relation entre le père et son enfant.
Cette toute puissance prend encore plus d’ampleur quand le couple explose.
Observons, à travers deux extraits, si dans ce contexte, le père parvient à conserver sa place :
« Vous faisiez quels types de taches ? Quand je rentrais je m’en occupais, c’est moi qui voulais lui faire prendre son bain, lui donner à manger, le changer, le mettre au lit mais j’aimais pas quand il pleurait ça me stressait. Je le prenais dans mes bras et je n’arrivais pas à comprendre, je ne savais pas ce qu’il voulait. C’est la mère qui me disait laisse le, change le, donne lui à manger, je ne savais pas, on ne peut pas savoir. [...] Et quand vous vous êtes séparés ça s’est passé comment ? Après je l’ai plus revu à ce
1 In Neyrand, 2010, 60 2 in Neyrand, 2010, 131
68
moment là, j’ai essayé de le voir, de le prendre le week-end mais la mère ne voulait pas trop, je ne sais pas pourquoi. [...] Avant l’incarcération, je ne le voyais pas, c’était impossible de le voir. Elle ne répondait pas au téléphone, ni au courrier, elle changeait de numéro. Elle ne me disait pas où elle habitait et quand je trouvais elle ne m’ouvrait pas la porte, elle m’en empêchait. Elle ne m’a jamais donné de motif. » [André, 38 ans, séparé, 1 enfant, 9 ans]
« A l’annonce de la séparation, ne plus voir mes enfants... j’aurai plus mon rôle de père comme avant. Quand j’ai demandé la garde alternée, elle a dit que c’était hors de question, elle veut me faire passer pour un mauvais père, tout le monde veut me faire des attestations. Elle veut me trainer devant le juge et avec mes antécédents je pense que j’aurais rien, elle veut me faire passer pour un mauvais père. Ce n’est pas tant la séparation, je n’étais pas heureux avec elle, j’étais là pour les enfants. Quand je vois le père des filles (ses belles filles) qui les voit pendant les vacances et elle voudrait que je les vois tous les 15 jours moi je ne le conçois pas. » [Franck, 44 ans, divorcé, 3 enfants, 1 an]
Ces témoignages sont explicites : la séparation avec la compagne entraine des effets
incontestables sur l’exercice de la paternité. Quand le couple tombe en faillite ce n’est pas
seulement la relation conjugale qui se rompt mais tout ce qui est relié. Le degré de conflit et
de coparentalité sera déterminant dans la poursuite des relations pour que le duo parental
survive au couple [Théry, 1993 ; Collier et Sheldon, 2008]. L’utilisation du terme « mauvais
père » montre la catégorisation possible de certains hommes à l’issue d’une séparation et
légitime l’accaparement des enfants par la mère. Une tentative d’élimination du père survient
alors que sans sa contribution ni mère, ni enfant ne sauraient exister : nous assistons à la
négation de la complémentarité des deux sexes [Le Roy, 1996, 116] « Les ruptures
conjugales ont alors pour effet de creuser les asymétries entre paternité et maternité »
[Martial, 2009, 40].
Pour annuler cette image de mère toute puissance, il faudrait cesser de comparer la
maternité et la paternité [Hustel, 1996] mais les lier l’un à l’autre, pour qu’ils s’éclairent
mutuellement.
Un soutien nécessaire à la mise en place de la paternité
Ne diabolisons pas la mère car elle représente le soutien de la paternité. Père et mère
devraient œuvrer ensemble à la fusion, à la différenciation des taches et à l’enrichissement de
leurs pratiques. La femme permet à l’homme de devenir père en lui prodiguant des conseils ;
le niveau d’implication du père auprès de ses enfants dépend directement de la valorisation de
son rôle par la mère et comment elle va lui permettre de l’investir.
« Elle comprend que le père de ses enfants est quelqu’un de sérieux, on me prend au sérieux, j’ai des contacts. Elle me donne un grand coup de main, elle me donne toute ma place de père, elle a toujours dit que je m’occupais de mes enfants. » [Nestor, 40 ans, concubinage, 3 enfants, 28 mois]
« Papa c’est papa elle parle pas en mal, la différence c’est que les problèmes d’adultes elle les met à part, elle les dit pas aux enfants. Elle ne parle pas de moi en mal. Quand on se retrouve avec Ilies c’est comme
69
son fils (Il est issu d’une précédente union), elle parle avec lui. Je sais qu’elle parle pas mal, elle dit que du bien à mes filles. » [Amed, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 3 ans]
La valorisation du père par la mère lui permet de conserver sa place et surtout de la reprendre
à tout moment – surtout dans le cas de l’incarcération, car il sera absent physiquement
pendant une certaine durée –. La solution la plus pertinente : agir et apprendre ensemble sans
trop s’attacher pour autant à un idéal égalitaire.
« Tu avais besoin d’elle pour te sentir père ? On s’est appris mutuellement, c’était une première pour nous, je n’irai pas dire que j’avais besoin d’elle, tout en étant honnête qu’elle en faisait plus. Mes taches à moi... je n’avais pas grand-chose à faire. Je changeais la couche, je préparais parfois le repas, des petites attentions » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
En dépit de certaines évolutions, nos représentations et nos comportements restent imprégnés
par le genre, comme dans le cas de Sofiane. « Le couple va ainsi être le lieu de rencontre de
deux façons de penser et d'agir le masculin et le féminin, et des différences de représentations
et de comportements peuvent exister entre les partenaires. Les enjeux liés au genre dans le
couple vont de fait participer à l'évolution de la relation conjugale » [Welzer-lang et Al, 2011,
77] et familiale.
Pour certains hommes, être père n’est pas légitime indépendamment de la volonté de la mère.
Ils ne ressentiront pas le droit « d’être » sans l’aval de la mère. Ce modèle est remis en cause
par l’étude de la paternité gay. « Explorer le cheminement vers la paternité gay, c'est éclairer
plus généralement la paternité, en tant que devenir père, sans que ce devenir soit
nécessairement articulé au désir d'une femme» [Gross, 2012, 59]. Ces idées reçues des pères
qui n’existent que grâce à la médiation de la mère n’ont plus lieu d’être. Et l’étude de Gross
démontre les capacités développées par les hommes pour répondre à tous les besoins de leurs
enfants. L’auteure montre que malgré l’absence de mère, ces hommes appréhendent « toutes
les dimensions de la parentalité tant celles habituellement perçues comme masculines que
celles qualifiées d'ordinaire de « féminines ». Ce type de double paternité interroge la
spécificité de la relation mère/enfant. » [Ibid, 2012, 51] Le couple gay mise sur le « faire
famille » et met en évidence les qualités des pères et des mères en déconstruisant les
stéréotypes qui enferment les individus dans des taches prédéfinies. Leur capacité
d’adaptation et d’apprentissage sans qu’une féminisation ne s’établisse est notoire. La
paternité gay ouvre un nouvel univers du possible où chacun se réapproprie les tâches
autrefois réservées principalement aux femmes. Une question se pose : Sommes nous
capables, aujourd’hui d’accepter que la distribution des rôles ne soit pas prédéterminée par le
sexe ? [Huerre, 2011, 123]
70
L’idéal serait de fonder une nouvelle normativité qui permettrait de s’individualiser comme
sujet sexué avec ces spécificités et assumer pleinement un rôle de père, de mère, de femme,
d’homme...
C. DEVENIR UN PERE
Aujourd’hui, la société s’inscrit dans une dimension existentialiste où le modèle
promu est un individu qui fait ses propres expériences, se détache d’un contexte familial pour
réussir à devenir lui-même grâce à ses propres choix et non par une imposition extérieure. Il
s’agit de créer et d’inventer une différence. A travers mon enquête, j’ai constaté que la notion
de choix n’est pas également repartie. Beaucoup de détenus ont des vies morcelées, engluées
dans la violence. Ils forment des couples pas ou peu construits et ont des pratiques
répréhensibles. Ils se laissent emporter par le flot d’une vie non maitrisée ou par un
événement qui va modifier leur trajectoire.
Pour appréhender le parcours d’un père détenu, il s’agit de comprendre comment il a vécu son
entrée dans la paternité ? Comment fait-il le lien entre son histoire, son couple et l’enfant à
venir. Quelle place va occuper ce petit être dans sa vie ? Va t’il l’inclure ou l’exclure ? Cet
épisode ne marque pas obligatoirement de changements décisifs dans la vie d’un homme mais
il ne pourra nier son existence. Il nécessite un retour réflexif sur leur biographie personnelle.
Le désir d’enfant questionne la nature du couple, ses fondements, ses forces et ses limites. Il
met en évidence les priorités de chacun, « les réticences d’un conjoint à s’engager conduisent
à questionner la nature de la relation, jusqu’à la mise en jeu du couple» [Bessin, Levilain,
2012].
Devenir père est un long processus, qui évolue au quotidien. L’entrée dans la paternité, sans
être déterminante pour la relation future avec l’enfant n’en n’est pas moins significative et
représente un point de départ pour ma réflexion.
Si le lien familial et conjugal tend à l’instabilité, le lien filial par contre se renforce et
s’affirme davantage et de plus en plus [Martial, 2005, 2009, 2012, 2013]
Quel que soit le niveau d’implication des pères, ils n’oublient jamais complètement
l’existence d’un enfant issu de leur chair et de leur sang. Ils ne le connaissent pas forcément
mais le fantasment toujours et les regrets souvent nombreux accompagnent leur prise de
conscience.
71
L’arrivée de l’enfant
L’arrivée d’un enfant, peu importe le contexte dans lequel il s’inscrit, est rarement
sans effet sur l’individu. Les contextes non ou peu favorables sont légion : paternité précoce,
non désirée, instabilité du couple, incarcération, toxicomanie… Certains pères avouent
spontanément leur sentiment d’inaptitude à s’occuper d’un enfant, justifié par l’incapacité
qu’ils ressentent à prendre soin d’eux-mêmes. En devenant père, le jeune adulte passe sans
réelle transition entre sa famille d’origine et celle qu’il va former [Quéniart, 2002 ; Ourellet,
et Al, 2006, 158]. Cette transformation met parfois l’individu face à des conflits internes non
résolus.
Certains pères sont désorientés à l’annonce de l’enfant alors que la mère est davantage
préparée et socialisée.
Ils ne se rendent pas nécessairement compte de l’enjeu d’un tel processus et ne vivent pas la
grossesse comme un événement majeur ; c’est véritablement la naissance de l’enfant qui va
déclencher en eux une prise de conscience, de responsabilité. [Ourellet et Al, 2006]. Quand
l’enfant est là, concrètement, en chair et en os, « l’enfant existe en dehors de la mère et
devient ainsi accessible au père, lequel peut maintenant jouer son rôle. » [Ibid, 2006, 165] La
mère sent l’enfant dans son ventre, elle vit son développement à travers ses changements
physiologiques. De nombreux pères attendent, quant à eux la délivrance pour voir, sentir,
appréhender et prendre conscience de leur enfant.
La paternité gay apporte un nouvel éclairage à notre sujet. En effet, les pères gays
s’approprient l’enfant plus tôt en le mentalisant avant même sa conception et se préoccupent
davantage de la manière dont elle va survenir. « Un homme hétéro n'a pas besoin de se
soucier de la conception. Enfin, il peut s'en soucier une fois et puis complètement l'oublier et
redécouvrir qu'il est père neuf mois plus tard. Là, quand on est homo et qu'on veut être père,
je pense qu'il faut en plus se soucier de la conception, entre autres en GPA. Même s'il y a une
mère qui porte l'enfant, il y a quand même tout un accompagnement énorme à faire qu'on ne
retrouve pas du tout chez le père hétéro. » [Extrait d’entretien, Gross, 2012, 50] Le désir de
devenir père gay n’est pas réellement différent de celui d’un père hétéro mais le coût
psychologique, l’attente, la peur de l’échec sont importants. La notion de choix est
indissociable de la paternité gay et remet véritablement en cause le désir d’enfant du seul fait
de la mère. Le père acquiert une place centrale. Il n’est pas dans une logique statutaire mais
dans un engagement plus profond.
72
Pour la plupart de mes enquêtés, l’effet de surprise à la naissance est le révélateur d’une prise
de conscience tardive et relative à la « matérialisation » de l’enfant.
« Tu t’ai senti père avant qu’il arrive ? Déjà un peu avant qu’il arrive mais quand il était là ça s’est concrétisé. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
« Tu te sentais père avant qu’il arrive ? Non c’est vraiment quand il est arrivé. Avant limite je me disais c’est du bluff, neuf mois c’est trop long. Et quand il était là on se rend compte qu’on est plus seul » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
« Vous vous sentiez père avant qu’il arrive ? Je pense pas qu’on se sent père avant, j’ai pris conscience à l’accouchement, c’est là où je me suis dis… y a quelqu’un de plus à la maison, va falloir mettre les bouchés doubles, quand j’ai mis les couches, donner le bain… j’ai eu une formation par la sage femme mais j’étais pas inquiet, j’ai des neveux et des nièces, ça m’a pas inquiété, j’ai pris ça à la normale, j’ai pris ça en tant que père responsable. Donc je me suis dis oui je vais avoir des inconvénients, on pense au début, mais ils étaient supers, j’ai pas eu de problème. » [Cyril, 45 ans, séparé, 2 enfants, 3 ans]
Les exemples de ce type sont nombreux et la remarque de Cyril significative. Il n’était pas
envisageable pour lui de se sentir père avant la naissance. Ce sentiment d’extériorité montre
comment les pères hétéros se perçoivent eux mêmes dans le processus. La paternité est
conçue comme un travail de construction et d’affirmation à la manière de l’acteur, « le père
doit improviser son rôle presque au jour le jour » [Le Roy, 1996, 79]. Ce rôle sera ensuite
remis en question au fur et à mesure que l’enfant grandit. C’est une construction perpétuelle.
Comment l’homme entre-t’il dans la paternité sans l’avoir vécue directement dans son corps ?
[Ibid, 1996]. Par un cheminement, une progression. Comme Cyril, c’est à la naissance que la
plupart des pères se rendent véritablement compte du changement, la prise de conscience va
crescendo et les gestes s’apprennent au quotidien.
Ces entretiens confirment ces observations :
«Même si tu es jeune, ça te change les idées, automatiquement ça change d’avoir un enfant même si tu aimais faire d’autre chose, ça change. Même si tes amis te proposent de sortir, tu peux plus être avec les gens qui n’ont pas d’enfants ils ne comprennent pas. Même si lui il a trouvé 100€ il peut le gaspiller mais pas moi, je dois le mettre de côté. Faut savoir vivre. [Bamba, 26 ans, en couple, 5 enfants, 6 ans]
« [Devenir père] C’est assumer son rôle pleinement, affectueusement, matériellement et sa capacité éducative, c’est un père, pareil pour une mère. Après y a beaucoup d’hommes qui sont pères mais qui ne savent pas comment faire, pas par rejet mais parce qu’ils ont pas eu de modèle ou malheureusement, ils sont trop centrés sur eux même ou certains ne sont pas prêts. Ils sont pères du fait de la génétique, de la nature mais ils ne sont pas prêts mais y en a pour qui il y a l’envie mais l’envie ça ne suffit pas. Faut être prêt. Pour revenir à mon cas, j’ai été père à l’âge de 28 ans, c’est comme une carrière, c’est au fur et à mesure des épreuves, des douleurs qu’on se forge, je ne suis pas le même père qu’au début. Des erreurs, j’en commettrais encore mais il faut apprendre, va y avoir l’adolescence, ce sera encore une autre étape de mon rôle de père. Faudra lui expliquer les femmes, va y avoir des rapports de force. Notre relation en sera plus la même. Tout comme il va devenir un adversaire avec sa mère. Et le mien est très proche. Quand il sera au courant, je me suis promis de lui faire comprendre ce que j’ai fait à sa mère, pas pour m’excuser mais pour qu’il se fasse son jugement mais aujourd’hui je ne planifie pas, les choses se font au fur et à mesure. Il a huit ans, on ne va pas bruler les étapes. Aussi bien que je pense à lui ici, il doit penser à moi dehors, à sa manière. Le manque que je ressens ici, il doit le ressentir à sa manière. » [Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois]
73
La paternité est un apprentissage, il faut perdre ses habitudes d’antan et ne plus penser qu’à
soi. On peut véritablement parler d’un travail paternel, Eliot utilise d’ailleurs le terme de
carrière. En sociologie, le mot « carrière » est défini comme un « processus diachronique qui
se centre sur la manière dont les acteurs anticipent les changements, les préparent, font face
aux difficultés, interprètent leurs échecs ou réussites. Everett Hughes écrit: « Subjectivement,
une carrière est une perspective en évolution au cours de laquelle une personne voit sa vie
comme un ensemble et interprète ses attributs, ses actions et les choses qui lui arrivent. »
[Paugam, 2012, 49]. Cette définition coïncide avec les propos d’Eliot, « des erreurs, j’en
commettrais encore mais il faut apprendre », sans brûler les nombreuses étapes à passer.
L’arrivée d’un enfant est toujours un bouleversement dans les vies des hommes mais selon
l’inscription de l’enfant dans leur biographie différentes formes de paternités vont se mettre
en place.
Pas voulue mais assumée
Au cours de mon enquête, la plupart des pères rencontrés étaient jeunes et souvent
issus de familles immigrées. Parmi les quarante-cinq détenus interviewés, vingt-neuf étaient
d’origine Maghrébine, Africaine, de l’Europe de l’Est ou des Antilles françaises1. Malgré le
fait d’avoir vécu la majeure partie de leur vie en France, l’éducation de mes enquêtés a été
influencée par le lieu d’appartenance des parents. Proportionnellement il n’est pas surprenant
qu’ils soient représentatifs de ce type de paternité. Si mon échantillon avait été plus équilibré
une telle différence n’aurait pas été notable.
Selon l’étude de Cassan sur la Précocité et instabilité familiale des hommes détenus réalisée
en 2002, les détenus pères ont leur premier enfant en moyenne à 25 ans. J’ai eu un résultat
similaire en faisant la moyenne de l’âge de mes enquêtés à leur premier enfant alors que l’âge
moyen des pères au niveau national est de 33,2 [Insee, 2012]. Une différence non négligeable
qui pose beaucoup de question : Comment s’est déroulé leur entrée dans la sexualité ? Quel
rapport avaient-ils à la sexualité ? Dans quelle mesure parlaient-ils de sexualité avec leurs
parents ? Dans quelles conditions s’est déroulée leur première fois2 ? Utilisent-ils un moyen
de contraception ou est-ce une affaire de femmes ?
1 Si j’ai choisi d’inclure, les Antilles françaises, c’est que je considère qu’il existe tout de même des différences culturelles notables (ex : matricentralité) 2 Selon Le Van et Le Gall « Les circonstances de la rencontre, l’évolution des sentiments, les possibilités de se retrouver, d’avoir des moments d’intimité, de planifier ou non ce premier rapport plus ou moins clandestin et de convenir d’un lieu » [Le Van, Le Gall, 2010] sont autant de facteurs qui influencent la première fois. La nature des liens avec les parents peut
74
Ces questions importantes je les ai posées assez peu pendant mon terrain, j’ai parfois
interrogés l’un ou l’autre détenu sur l’usage du préservatif pour éviter les grossesses
multiples. Il apparait que ce mode contraceptif n’est guère apprécié et que la contraception, en
général, est considérée comme une affaire de femmes.
Qu’est ce que signifie une paternité « pas voulue mais assumée » ? Cette paternité a lieu dans
un contexte où le projet d’enfant n’était pas planifié et l’annonce de la grossesse est
généralement abrupte. Celle-ci arrive parfois à l’entrée dans la sexualité ; les futurs parents
sont alors relativement jeunes et vivent encore souvent chez leurs propres parents. Le couple
est souvent récent et n’utilise pas de contraception.
A la découverte de la grossesse, la majorité des pères interrogés pensent à l’avortement mais
rares sont ceux qui franchissent le pas.
Dans la Revue française des affaires sociales de 2011, un dossier est spécialement dédié à
l’interruption volontaire de grossesse. Selon des données démographiques, les femmes
étrangères jeunes ou âgées ont moins tendance à interrompre leurs grossesses que les femmes
nées en France [Rossier, 2011]. Les obstacles administratifs se révèlent souvent lourds pour
les groupes les plus vulnérables comme les femmes mineures pour lesquelles une autorisation
parentale est requise et les étrangères, moins familiarisées avec le système de soins [Rossier,
2011, 495]. L’avortement s’inscrit dans la culpabilité et la conjointe décide souvent pour le
couple de garder l’enfant.
Voici deux entretiens qui confirment que la grossesse était un accident et que les jeunes
parents n’étaient pas du tout préparés.
« Raconte moi un peu quand elle est tombée enceinte, tu l’as vécu comment ? C’était y a longtemps, en 2006, c’était un accident, puis on a fait avec, elle voulait avorter et finalement on l’a gardé, ses parents ne voulaient pas mais on a assumé. Elle était jeune, elle avait 19-20 ans. Comment c’était la première grossesse, tu l’as vécu comment ? La première grossesse ça s’est bien passé, j’avais pas le choix, j’étais obligé, y a pas eu de problème. [...] j’étais pas prêt même aujourd’hui je pense que je suis pas prêt, je m’efforce le mieux que je peux. » [Ryam, 31 ans, marié, 3 enfants, 8 mois]
« Comment ça s’est passé ? On était jeunes, dix-neuf ans, on avait décidé de le garder, on a discuté on était ensemble depuis trois ans donc ça allait bien. Ça s’est déroulé comment ? Echographie et tout, je l’ai suivi, elle ne voulait pas avorter. C’est passé trop vite, je ne me souviens pas des détails, elle était déterminée à le garder donc j’ai dit ok, j’avais pas le choix. Au moment où elle te l’a dit tu as pensé quoi ? Je lui ai dis qu’est-ce qu’on fait, elle voulait le garder, on était pas sûr direct, y avait la culpabilité d’avorter à l’époque. Avec les médecins au final on l’a gardé. […] Et à l’accouchement c’était comment ? J’y étais mais pas dans la salle, c’était sa mère. Pour quelles raisons ? Elle se sentait plus à l’aise, j’avais peur des cris, je voulais au début et puis je lui ai dit d’appeler sa mère. Elles sont complices, surtout qu’elle a l’habitude, elle a accouché toute seule en 77 donc c’est mieux qu’une infirmière. Vous pouviez être trois ? J’étais jeune tu voulais que je sois choqué. Et après ? Je suis rentré dans la chambre, il était tout petit, j’avais peur, imagine toi, j’avais pas l’habitude, je lui ai fait un petit bisou. J’avais peur de lui faire du mal. Les infirmières l’ont allongé dans un truc en verre, un berceau on va dire. J’étais content.
aussi jouer sur les discussions autour de la contraception et de la prise de risque. Le caractère clandestin de la sexualité peut aboutir à une plus grande prise de risque.
75
J’avais dit non mais j’étais content, après, c’est surtout après, avant ça faisait bizarre, on réalise pas vraiment. Et après comment c’était ? J’étais jeune, j’étais un gamin. Qu’est ce que ça a changé dans ta vie, dans ta manière d’être ? J’étais père quoi je ne peux pas le définir. Ma vie continuait mais j’étais père. On réalise pas sur le coup, c’est fait il est né, il est arrivé, après on est un peu fier avec la famille, les amis, après tout se passe normalement, tout se passe bien. » [Kalim, 35 ans, divorcé, 2 enfants, 3 ans]
Ryam et Kalim avaient respectivement vingt-trois et vingt-deux ans à la première grossesse,
la décision n’a pas été de leur ressort, la phrase « j’avais pas le choix » est présente dans les
deux entretiens. C’est finalement la compagne qui a tranché sur la question ; c’est son corps,
c’est son choix. Tous deux appartiennent à des familles maghrébines, leurs origines ont sans
doute influencé la décision finale car l’avortement est à l’opposé du modèle promu par les
parents.
Les deux détenus insistent également sur leur immaturité « j’étais pas prêt », « j’étais jeune,
j’étais un gamin ». Ils ont une perception peu claire de leur rôle de père, même s’ils
souhaitent aimer leurs enfants et faire les bonnes choses pour eux, ils ne savent pas toujours
comment s’y prendre [Allard, Binet, 2002, 21]. Assumer sa paternité signifie pour ces pères,
rester avec la mère de l’enfant et essayer dans la mesure du possible de subvenir aux besoins
de la famille.
Un projet murement réfléchi
Prévoir de faire des enfants semble être la norme pour entrer dans la parentalité. Le
modèle sociétal proposé est axé sur l’enfant comme aboutissement du couple. L’enfant donne
une nouvelle dimension au couple et l’ancre dans un engagement sur le long terme. Il faut
réussir à intégrer ce futur enfant dans l’histoire du couple. « Il s’y opère aussi un travail
biographique - de coordination avec soi-même - qui convoquant son histoire passé, ses
engagements et désirs, son évaluation de la situation, va amener chaque individu à décider de
s’engager pour assurer la continuité de soi ou, au contraire, assumer une rupture par rapport à
des expériences négatives » [Bessin, Levilain, 2012, 81].
Sur mon terrain, peu d’enquêtés ont choisit d’être pères, bien loin de la majorité d’entre eux.
Les raisons qui les y ont poussés sont diverses mais découlent souvent d’une revanche à
prendre sur leur histoire personnelle. Ces hommes ayant vécu une enfance instable et violente
désirent se différencier de leur père ou combler un vide paternel (Absence, décès). « Devenir
un bon père semble être le projet auquel ils se raccrochent, préoccupation qui va de pair avec
celle de s’insérer dans la société » [Allard, Binet, 2002, 10]. L’enfant donne un sens à leur
vie.
76
« La naissance était voulue par les parents, moi je vais sur ma trente sixième année, elle a trente et un an, on s’est connu vachement tôt en 2001, elle voulait tomber enceinte, elle a dû se faire avorter à l’époque, elle vivait chez ses parents même si j’étais déjà dans le milieu professionnel, ça faisait trois ans que j’étais dans l’armée mais on estimait que notre couple n’était pas assez mature. L’avortement n’a pas été facile, j’ai vu à travers elle, la douleur, on n’a décidé de faire plus attention. En 2006, il est arrivé, il était voulu, il était désiré, très désiré des deux et la grossesse était facile. » [Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois]
Dans le cas d’Eliot, l’avortement a été douloureux mais il était inconcevable pour lui, d’avoir
un enfant si le couple n’est pas stable. Son fils s’inscrit dans la maturité du couple et
symbolise le prolongement de leur histoire. Avoir réfléchi à sa paternité lui a permis de mieux
l’aborder. Dans un extrait précédent, Eliot évoquait la violence de son père et concluait ainsi :
« A travers mon fils ce que j’ai compris ce que je vais transmettre, ça donne un sens à ce que
j’ai vécu et l’analyse de ma vie. Ce que je comprends de la vie c’est bien le partage avec mon
fils. » Décider la naissance d’un enfant permet de changer sa propre histoire, la réparer et
d’inventer un nouveau rôle en dépit du manque de figure de référence. Construire sa propre
famille figure un appel à la responsabilité avec le sentiment que l’enfant dépend de soi pour
vivre. L’enfant a un effet compensatoire.
« C’était un projet ton fils ou c’est arrivé comme ça ? Oui c’était un projet, je n’ai pas eu d’enfance, j’essaye d’avoir cette affection que je n’ai pas eu, avoir une richesse, un soutien, un ami, c’est ce que je veux faire pour lui même si en ce moment c’est difficile mais avec sa mère je ne pense pas qu’on va se réconcilier, si je dis « je t’aime » elle répond « moi non plus [...] Tu sais on a essayé plusieurs fois avant de l’avoir, moi j’en veux pas dix mais un à qui donner de l’affection, de l’éducation, ce que je n’ai pas eu.[...] « Je ne sais pas comment ça s’appelle, on se sent quelqu’un d’accompli, on a quelque chose en nous qui se réveille. J’ai crié fort quand je l’ai eu dans mes bras mais les gens me disaient doucement (doigt sur la bouche). Quand je l’ai pris dans mes bras, je voulais lui faire un bisou mais je ne savais pas, il était petit, j’avais peur de le casser. ça fait du bien en tout cas d’être parent (silence), je ne sais pas si vous êtes mère ou pas (non de la tête), vous n’avez pas encore compris comment on peut être heureux d’avoir une petite poupée dans ses mains et dire « c’est ça ma chance, mon futur » et pour nous les hommes se dire c’est un gamin, vous vous sentez comme un roi. Je voulais vraiment vraiment être papa. Mais plus tard même si je trouve que cette vie est injuste, même si ça fait partie du destin, peut être que l’on a vécu pour plus tard, on peut s’en servir, tiré quelque chose de cette mauvaise expérience pour pouvoir continuer par la suite, pour accomplir quelque chose après. Même quand il n’était pas encore venu au monde, on sentait déjà quelque chose. » [Angelo, 36 ans, séparé, 1 enfant, 28 mois]
Comme Eliot, Angelo appartient aux pères pauvres de leur propre père qui cherchent les
moyens d’établir un lien de filiation avec leur enfant. « Ils veulent construire leur paternité à
partir d’eux-mêmes, de l’amour reçu, de leurs actions, de leurs réflexions, en puisant la
matière première dans leur environnement. La construction d’un modèle de référence semble
toutefois plus difficile pour les pères qui, dans leur enfance, ont été peu aimés ou ont été
doublement, voire triplement blessés » [Ibid, 2012]. Notons avec quelle passion Angelo parle
de son fils, il affirme avec fierté qu’être parent permet de se sentir complet, une notion
incompréhensible pour moi puisque je ne suis pas mère, moi même. Avoir un enfant pousse à
77
renouer avec son enfance et à se projeter vers l’espérance [Petit, 2004, 20] La boucle est
bouclée comme le dit le dicton.
« Ta fille c’était un projet ou c’est arrivé sans que ça soit prévu ? Oui c’était un projet, c’est la plus belle chose qu’on a dans la vie, j’ai perdu mon père à quatorze ans, j’étais jeune mais je voulais être un père. Donc même si j’avais vingt ans on a décidé ensemble de faire un enfant. Tu étais là durant la grossesse ? J’ai assisté aux échos, j’ai coupé le cordon, je changeais les couches, je me suis investi dans mon rôle de père, je faisais tout comme sa mère. Elle avait déjà des enfants, j’ai appris à lui donner à manger, à donner le bain. Qu’est ce que ça t’a fait de devenir père ? C’était le plus beau jour de ma vie, c’est acquérir des responsabilités que de le devenir. » [Romain, 26 ans, séparé, 1 enfant, 4 ans]
L’entrée dans la paternité est vécue pour ceux qui l’ont choisie comme le moment le plus
important de leur vie, ils ont crée quelque chose à partir d’eux mêmes. L’enfant perpétue la
famille et le nom en assurant la filiation et la transmission de valeurs. Line ira jusqu’à dire
que les enfants sont « mandatés pour compenser nos failles, ils nous permettent de réparer
notre enfance, de la rejouer avec de nouveaux dès. Le transfert des espérances sur les enfants
est [...] une voie excellente pour rendre supportables les complexes insatisfaits» [Ibid, 2004,
21].
Etre père c’est l’obligation d’assumer de nouvelles responsabilités et se métamorphoser en
adulte entier et presque accompli.
La paternité forcée
Qu’est-ce que la paternité forcée ? Dans quelle mesure peut-elle être considérée ainsi ?
L’homme n’est-il pas responsable des conséquences d’un rapport non protégé ? Ne doit-il pas
assumer ses actes ?
Parler de paternité forcée ou non désirée se heurte au sens moral. Les femmes se sont battues
pour leur liberté de choix, la contraception et l’avortement ; alors comment concéder aux
hommes un droit de regard sur leurs corps ?
Ma première rencontre avec un homme victime d’une paternité forcée m’a fait prendre
conscience de sa place totalement inexistante dans le projet d’enfant. Ma recherche porte sur
la paternité et eux m’avouent l’avoir refusée, quelle ironie !
Aujourd’hui, grâce à l’usage des tests ADN les hommes perdent ou gagnent leur paternité
mais sont dans l’obligation de l’assumer quand elle est avérée. Il n’existe pas de droit
d’abandon ou d’interruption filiative, la loi dicte l’obligation d’être pères. Pour comprendre la
paternité forcée, j’ai cherché à me documenter mais il n’existe aucun ouvrage ou article
78
sociologique sur ce thème ; le sujet est tabou. Seule Mary Plard a publié un ouvrage sur son
expérience d’avocate qui retrace l’histoire de plusieurs hommes forcés dans leur paternité1.
Au final, les hommes ne choisissent pas d’être pères ou de ne pas l’être. Ils n’ont qu’une seule
solution : l’abstinence [Plard, 2013, 12]. La femme fera un enfant avec un compagnon de
fortune sans que ce soit élaboré une relation mature entre les partenaires [Le Roy, 1996]. Elle
a la tout puissance de son ventre, son corps devient un endroit sacré, où le père n’est en fait
qu’un simple géniteur, un donneur de sperme, il n’est qu’un homme. Le mot paternité ne fait
pas sens dans cette histoire. « Il ne veut pas de cet enfant avec cette femme [...] leur rencontre
n’est ni du rêve, ni un projet, ni de l’égarement, seulement du « rien » quelque chose dont il
faut se débarrasser » [Plard, 2013, 44].
Dans les deux entretiens suivants, Ludovic et Alain expliquent comment l’absence de
relations avec leur enfant découle du contexte de sa naissance. En couple tous les deux, le
premier ressent cette grossesse comme une trahison, le second la considère comme un désir
de femme qui ne le concerne pas.
« Je joue ce rôle parce que je le dois mais j’avais rien demandé, je n’étais pas préparé à ça. C’était un choc tout de même. Et puis pour moi c’était super important d’être bien avec la mère, il aurait fallu que le couple soit construit avant d’y penser. Mais ça pas été le cas. J’ai eu l’impression de plus m’occuper de la petite que de mon couple, vu qu’on ne s’était pas retrouvé avant la grossesse, c’était trop dur. On n’a même vu un psy ensemble, il disait n’importe quoi. Soit disant j’avais reporté mon amour sur ma fille, je me suis senti piégé, le coup des quatre mois (elle aurait fait un déni de grossesse et mit 4 mois avant de s’en rendre compte) ça reste en travers, c’est là qu’on se dit « merde » mais c’est déjà trop tard… c’est trop tard. Mes parents ils m’ont dis « tu assumes ou pas […] je ne l’ai pas reconnue juste médicalement. Je suis juste le géniteur mais pas à la mairie. Elle a le document pour le médical une greffe ou autre chose mais je ne suis pas sur le livret. Comment ça se fait ? On s’est séparé quand elle est née puis on s’est remis ensemble mais je ne voyais pas l’intérêt. Ça s’est passé, ce n’était pas important, je ne pensais pas... pourquoi elle aurait porté mon nom. Quand on se sépare de la mère on s’imagine qu’elle va grandir de son côté. Sa mère a décidé de s’en occuper et je ne sais pas si tu te rappelles mais je ne la voulais pas, elle n’était pas désirée. J’avais l’impression qu’elle voulait me garder avec le bébé et puis j’étais pas à jour au niveau des papiers, sécu, impôts, c’était une mauvaise période de ma vie. Tu ne me l’avais pas dit. Elle a pris son nom, pour qu’elle prenne mon nom faudrait que je m’en occupe et je ne me sentais pas…c’est pleins de petites circonstances qui ont fait que j’ai pris cette décision. Si j’allais à la mairie elle deviendrait à ma charge, j’ai quand même pris mon rôle de père je savais que quand on s’est séparé elle allait repartir. […] Et aujourd’hui la reconnaître ? Je ne sais pas. C’est une question difficile, faut y réfléchir, voir comment ça évolue. Elle a un mec, je la vois une fois par mois depuis deux ans, si elle veut voir son père d’accord mais qu’elle porte mon nom, ça veut dire ce que ça veut dire c’est la famille. Je ne serai que le père génétique, ça s’arrête après, vu la tournure que ça prend... le père biologique et ça s’arrête après si les gosses ils veulent connaître le père... » [Ludovic, 27 ans, séparé, 1 enfant, 3 mois]
« Audrey doit avoir 31 ans si je la rencontrais je la reconnaitrais pas, je pourrais juste voir à qui elle ressemble, mais je ne pense pas que j’aurai pu lui apporter quelque chose.A l’époque j’ai prévenu sa mère, qu’elle ne me reverrait plus, elle avait un an et Audrey l’a senti, elle s’est mise à pleurer, ça on ressent ça fait quelque chose. Sa mère elle est responsable, elle la voulait, pas moi. Ce n’est pas à trente ans qu’on cherche un père. La logique veut que ce ne soit jamais trop tard mais quand c’est tard c’est tard. Je ne sais pas si je suis un bon spécimen à voir. Si votre histoire m’intéresse. Vous auriez pu la chercher si vous le souhaitiez ? C’est elle qui a voulu l’enfant, c’est elle qui lui a donné son nom. Elle aurait pu lui dire, je lui ai dit qu’elle pourrait me chercher. [...] Et à la maternité quand elle est née vous étiez là? Oui
1 Dans mon cas aucun père n’a eu recours à la justice pour dénoncer leur paternité forcée mais aucune mère n’a demandé à ce qu’ils assument financièrement, elles prenaient complètement en charge l’enfant et ils donnaient ce qu’ils voulaient.
79
bien sur. Ça vous a fait quoi ? Rien, ça m’a rien fait, bah voilà c’est qu’un môme (il grimace), imaginez vous on vous met un paquet dans les mains, ok bon voilà. Ma fille n’a jamais manqué de rien, elle était toujours bien entourée.[...] J’adore ma fille, j’ai toujours le regret de ne pas avoir vécu avec elle, c’est l’égoïsme de sa mère, c’est à cause d’elle que je l’ai perdue. » [Alain, 59 ans, 2 enfants, séparé, 5 ans]
Les mots utilisés par Ludovic sont évocateurs : n’ayant pas choisi cette paternité, il se
considère comme un simple géniteur, aucune autre fonction ne lui est assignée. Il fait une
distinction entre le père biologique et celui qui s’occupe de l’enfant. Le port de son nom
inclurait cet enfant dans sa lignée et l’engagerait dans un projet qu’il n’a pas souhaité.
Comme Ludovic, Alain explique la distance prise avec sa fille ; il n’a rien ressenti à sa
naissance. Le désengagement est à la fois physique et mental. La mère est diabolisée et
apparait comme l’unique responsable et la seule coupable.
La paternité forcée de mes deux enquêtés justifie leur absence et leur désengagement vis-à-vis
de l’enfant. Si certains hommes tentent d’oublier leur paternité, celle ci n’est jamais neutre et
laisse des traces ou des regrets : « ça fait quelque chose ». Ces deux pères forcés ont pourtant
une position ambivalente : ils ne souhaitaient pas cet enfant et ne désirent pas s’en occuper
mais supputent qu’à tout moment il pourra les rechercher. Malgré le « piège », chacun
concède un espace à son enfant s’il décidait de retrouver son papa.
Ces hommes se sentent abusés dans leurs fonctions procréatives [Plard, 2013, 131]. Les
entretiens montrent comment ils ont détachés leur vie sexuelle et leur fonction procréative
comme si elles ne paraissaient pas liées [ibid, 2013, 119].
Cherchent-ils à se dérober devant les conséquences de leurs actes ? N’est-il pas dans l’intérêt
de l’enfant de lui donner un père, lui qui n’a pas décidé de naitre ? Le droit laisse aujourd’hui
un vide et les pères se trouvent démunis face à des situations non choisies et non désirées.
Paternité différenciée
Dans la continuité de la paternité forcée, la paternité différenciée met en exergue deux
manières de vivre sa paternité. Selon l’histoire du couple et la nature du projet,
l’investissement avec les enfants est différent. Deux entretiens illustrent ce propos :
« Des fois tu as des soucis, on te coupe. D’un coup tu sais pas, ça arrive, je ne sais pas expliquer... parce que tu es avec une nana puis avec une autre. J’ai jamais été avec une seule femme, j’ai toujours été avec plusieurs, maintenant je trouve que c’est pas cool parce que quand il y a la grossesse, c’est des soucis, tu es pas en couple avec la femme, tu vas pas voir grandir l’enfant, c’est le soucis de ne pas être stable. Tu veux des enfants ? Oui mais un peu plus tard. Les français c’est toujours plus tard moi je l’ai eu à dix-huit ans, c’est celui que j’ai reconnu. [...] Tu penses avoir combien d’enfants ? Bah au moins six ou cinq enfants, avant de rentrer en prison j’étais avec ma femme, elle était en grossesse mais je suis au courant de rien. Je suis en France, je n’ai pas de nouvelles d’elle. Avant que je ne parte elle n’avait pas ses règles,
80
je ne sais pas ce qu’il se passait. Et pour le premier tu étais au courant ? On n’était pas vraiment ensemble, on est resté deux ans ensemble. Quand elle est tombée enceinte elle était avec moi. On était ensemble et je suis resté deux ans pour la grossesse puis on s’est séparé mais on est resté amis. [...] Mais c’était génial, c’était le plus beau bonheur de ma vie, c’était génial de voir mon fils, c’était bien, y a pas d’explication. Je l’adore tellement et maintenant il va à l’école, il fait bien, il rentre en 3ème, il fait bien à l’école. Je l’adore c’est bien. [...] Pour moi le reste n’existe pas parce que je ne les vois pas, par moment y a que lui qui compte beaucoup. Et tu ne pensais pas à te protéger pour éviter d’avoir des enfants ? La capote, je n’aime pas trop, tu ne sais pas trop bien. C’est bien que je sois tombé parce que je vais pouvoir refaire ma vie. Je m’inquiétais, j’avais peur d’être malade [...] Dans ce cas pour quelles raisons prendre des risques ? De tout mon respect, j’aime bien sentir, ce n’est pas mon truc la capote, j’aime bien sentir le mouvement, je ne veux pas aller trop loin, j’ai du respect pour toi. Ça reste comme ça Marine. » [Patrick, 32 ans, séparé, 1 ou 5 enfants, 5 mois]
« Alexandra était prévue ? Non, je t ‘explique, c’était une amourette de vacances en Guyane, c’est la connerie d’un mec qui retourne au bled et qui a une copine au pays. Elle voulait un enfant de moi, elle a percé la capote, puis quand elle m’a dit « voilà je l’ai eu, je le voulais de toi ». Au départ j’ai assumé, mais l’argent elle le bouffait donc ça m’a gonflé. Je l’ai vu jusqu’à l’âge de 6-7 ans, elle prend le tel et elle m’appelle. Elle sait qui est son père mais je lui laisse le temps de grandir. Sa mère est bizarre, je dirais pas protectrice mais quand elle a eu son nouveau mec, ça a changé, ça a failli partir en couille, c’était chaud quoi. Et puis ils ont déménagé et je ne connais pas leur nouvelle adresse, elle ne me l’a pas donnée. J’ai cherché avec le nom de famille. Tu sais, les pubs à la télé qui te proposent de retrouver la personne, bah j’ai essayé, mais ça n’a pas marché, c’est de la merde. Je pouvais encore la reconnaître mais j’avais plein de problèmes dans ma vie à régler, et maintenant avec mon fils c’est différent, j’étais avec elle de A à Z. Il va savoir qui je suis, je veux pas qu’il m’oublie. [...]Tu étais présent à l’accouchement ? Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas que je sois à l’accouchement, et en même temps elle voulait que j’assume. Avec sa mère et tout… Et puis sa mère, elle savait que c’était un truc de vacances, elle sentait l’entourloupe de sa fille, elle connaît sa fille. Je pense que ça n’aurait pas trop collé avec la mère et la famille. Et donc c’était différent pour la naissance d’Alexandra et Marvin ? Ouais, Nadia je sais pas elle voulait rester entre filles alors qu’avec Minouche c’est différent, je voulais être là et elle l’a bien senti (rires). Je sais qu’ils y a des mecs qui disent qu’ils vont être présents et au final ils se dégonflent mais moi je suis têtu, je voulais même voir la péridurale. Ça fout les boules de voir sa femme souffrir, du coup vu que je suis protecteur alors je surveillais ce que faisait le médecin, fallait qu’il fasse attention, heureusement que c’était une femme. [...] Pourquoi tu ne l’as pas reconnue dès le départ ? J‘étais vénère ça faisait des années qu’elle me disait qu’elle voulait un enfant de moi et elle m’a piégé et puis sans vous mentir je ne sais pas si l’enfant est vraiment de moi. C’est une fille, moi un mec, on est tous égaux moi j’étais là 3 semaines, 1 mois. Alors si je la reconnais c’est Amour, gloire et beauté, elle aurait pu se remettre avec le vrai père après. Pourquoi ne pas avoir fait un test ? J’y ai pensé et puis je suis un mec qui baisse les bras dès qu’il faut faire des papiers, ça me gonfle les démarches. Si elle me ment c’est que je me suis trompé et si c’est le cas je pense qu’il faut qu’elle se soigne. Sinon faut qu’elle se trouve un mec friqué et dire « excuse moi j’étais en ovulation c’est toi le père » On regarde trop de films maintenant on connaît les failles. » [Kyllian, 30 ans, en couple, 2 enfants, 4 mois]
Patrick exprime son bonheur d’avoir eu son premier fils même s’il n’était pas prévu et même
si le couple était instable lors de la grossesse. Il l’a reconnu et lui voue beaucoup d’amour. Il a
essayé de faire perdurer la relation pendant deux ans tout en passant d’une femme à une autre.
Son refus du préservatif entraine de multiples naissances sans qu’il puisse les chiffrer. Seul
son premier fils existe, les autres sont perdus dans le flou de ses conquêtes parce qu’il n’a
aucune garantie que ce sont les siens. Il m’a confié par la suite que les tests de paternité
coûtent trop chers pour en valoir la peine.
Nous retrouvons des similitudes avec l’histoire de Killian bien que sa fille, Alexandra n’ait
pas été reconnue au contraire de Marvin. Sa première paternité a été imposée mais il s’était
engagé financièrement dans un premier temps avant de renoncer. Marvin, au contraire, est né
81
d’un projet de couple. Son père le désirait, a suivi la grossesse et a même assisté à sa
naissance. Il l’a parfaitement intégré à sa biographie personnelle.
Le point commun entre ces deux hommes est leurs origines antillaises. Aux Antilles, les
chiffres indiquent que 50% des naissances sont illégitimes. Les femmes y sont très attachées à
la maternité et souhaitent constituer au plus vite une descendance.
C’est en devenant mère que la femme s’autonomise. Etre mère est davantage valorisé qu’être
fille [Le Roy, 1996, 92]. Ce qui explique que Nadia ait percé la capote ou que les conquêtes
de Patrick n’utilisent pas davantage de contraception. Dans la plupart des cas, la vie conjugale
se solde par un rejet du compagnon qui disparait ou voit ses enfants de manière sporadique.
La femme retourne généralement chez sa mère pour trouver de l’aide. « Le nombre réduit de
mariages écarte péremptoirement une reconnaissance « officielle du père » » [Ibid, 1996, 92]
Dans ce cas, la mère assume tous les besoins de l’enfant. Elle en a souvent plusieurs de pères
différents, ce qui dénote le peu d’intérêt accordé au géniteur. Ce mode de vie pourrait nous
paraître déviant, il ne l’est pourtant pas et perdure de génération en génération. Les hommes
sont souvent dépeints par les mères comme inconstants, violents et fainéants. Cette image
dévalorisée du père, porteur de tous les maux sera présentée aux enfants. « Le père n'existe
plus comme père dans le désir de la mère alors qu'il a eu une place en tant qu'homme » [Ibid,
1996]. Si la pluralité des conquêtes féminines successives valorise les hommes ; la maternité
quant à elle, glorifie la femme en lui accordant le statut d’individu accompli.
Ces deux logiques créent des attentes différentes.
« Les pires c’est les antillais, c’est les pires mais ce n’est pas de leur faute. Avant leurs enfants, c’était les enfants des blancs. La paternité n’existait pas, y a un trou dans l’histoire. Là-bas la mère est propriétaire. Les pères eux sont des enfants. Tu vois une différence entre les antillais de là bas et les antillais d’ici. [...] C’étaient des géniteurs, ils pondaient et ils étaient niés. Mais le rôle de la femme commence à changer. Les antillais c’est compliqué et je ne rentre pas dans leur vie. On a l’impression qu’ils s’en foutent mais la mère aussi s’en fout. [...] Le père quand il veut être ce n’est pas évident non plus. Pour les antillais faut voir où ils ont vécu, là bas les hommes ne sont pas considérés, ils sont dans l’ensemble des coqs mais très déprimés. La mère paye tout, c’est elle qui gère tout, ils sont déconsidérés dans le système social, il n’y a pas de lèg comme en France où tu privilégies l’héritage. Ils n’ont rien à léguer. J’ai été sensible à cette question, il faut chercher la place symbolique aux Antilles. J’ai commencé à penser à cette place du père qui n’est pas. Ce sont des pondeurs. » [Evelyne, 60 ans, Psychiatre, 15 ans d’expérience]
Le point de vue de la psychiatre rejoint mes observations, aux Antilles, l’homme ne transmet
rien, c’est la femme qui a le monopole sur sa descendance. Le terme de pondeur semble fort
il est pourtant révélateur de la réalité témoignée par ces pères.
Evidemment, la paternité différenciée n’existe pas seulement aux Antilles mais la
matricentralité y est typique. Ce type de paternité nous montre que le lien à l’enfant et sa
place dans la biographie du père dépend très largement du rapport entretenu avec la mère et
82
l’histoire familiale. Les changements familiaux peuvent également être les facteurs d’une
paternité différenciée, comme chez les familles recomposées. Les pères qui forment une
nouvelle union ne vivent pas toujours avec les enfants issus du premier lit, l’implication au
quotidien varie et modifie les liens.
CONCLUSION : L’AVANT PRISON : LA CONSTRUCTION DE LA
PATERNITE
L’étude des différentes formes de paternité nous apprend qu’elle ne se construit pas
seulement par rapport à l’enfant mais qu’elle est prise dans des relations plus larges et plus
complexes.
La relation père/enfant n'a d'existence et de sens que dans un cadre global, dans le contexte
des activités familiales. Elle se conjugue à plusieurs personnes et à tous les temps.
« A travers ce que ces pères disent de leur propre père et de la place qu'ils occupaient dans le
couple parental, on peut mieux saisir celle que la paternité occupe dans leur imaginaire. De là
dépendra la façon dont ils se situeront par rapport à leurs propres enfants dans « leur métier de
père» où l'imaginaire est au travail » [Dufoucq-Chappaz 2011]. Force est de constater que ces
hommes deviennent souvent pères dans des contextes compliqués, de familles morcelées et/ou
de couples chancelants. La paternité n’est pas constante dans le temps et l’espace, elle est
prise dans l’un et dans l’autre (Deschamps, 2012 : 98)1. Dans cette perspective, il existe non
pas une paternité mais bien des paternités plurielles. La troisième partie de mon mémoire
analysera les différentes formes de paternité vécues dans un contexte d’incarcération et
l’incidence du poids carcéral sur la relation affective.
1 In Joël-Lauf, 2012, 45
83
III. ETRE PERE EN PRISON
Comment est vécue la paternité en prison ? Elle se vit comme une expérience
individuelle, celle de l’un ne correspond pas à celle de l’autre. Idem pour l’engagement :
chacun s’investit à sa manière avec son enfant. Aujourd’hui, en France, la paternité se
« redéfinit comme une relation intersubjective, caractérisée par une forme particulière
d’échange entre père et enfant, une « intimité » nouvelle faite de proximité physique,
d’attachement affectif et de complicité (Dermott, 2008), l’idéal de la paternité contemporaine
inclut ainsi une véritable « éthique du care » [Martial, 2012].
La difficulté pour ces pères est de trouver leur place dans « ce nouvel agencement des
relations et des statuts, tant du point de vue de la division des droits et des devoirs parentaux,
que de la prise en charge des tâches relatives à l’éducation des enfants » [Ibid, 2012 ; 106].
Il serait aisé de définir ces pères détenus comme des pères carrents, ils ont, en effet peu
d’emprise sur leurs enfants et leur évolution. Le lien se joue souvent à distance, entrecoupé
d’absence et de présence.
Le but de ma recherche n’est pas de donner une définition de ce qu’est un bon père ou un
mauvais père mais plutôt d’analyser comment certains composent avec les attentes liées à leur
rôle et les logiques d’actions qu’ils mettent en place pour donner sens à leur paternité. Les
difficultés pour ces pères sont grandes ; l'effet conjugué des variables économiques,
financières et socioculturelles contribuant à diminuer, voire à annihiler l'influence du père sur
les enfants, au point de mettre en péril tout le processus identité-identification [Sellenet, 2007,
158].
A. LE REGARD SOCIAL
« Au tribunal ils m’ont fait dire une phrase, la juge m’a dit « A travers vos actes vous pensez être un bon père » et là j’étais tellement démuni j’ai dit que je m’étais pensé un bon père et qu’avec ça j’étais plus un bon père. Mais je pense aujourd’hui qu’avec les armes que j’avais.... y a pas de bon ou de mauvais père, je suis un père, on est trop vite jugé. » [Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois]
84
Comme nous l’avons vu, la paternité dans notre société, n’est pas perçue comme
constitutive de l’identité masculine. Celle-ci est d’autant moins légitime quand ces hommes
sont incarcérés. Jean-Marie Petitclerc établit que « l'absence ou la dévalorisation de l'image
du père est source de conduites asociales et de mésadaptations. De même, la crise de
crédibilité du père en tant que porteur d'autorité s'expliquerait surtout par le fait qu’aux yeux
des jeunes et des enfants, l’autorité n’est recevable que si le porteur en est crédible,
bienveillant, juste et vertueux » [Ibid, 2007, 158]. Malgré les évolutions législatives, les pères
sont toujours davantage que les mères, assimilés au représentant de la loi, de l’autorité.
Incarcérés et ayant outrepassés la loi, dans quelle mesure sont-ils légitimes auprès de leurs
enfants, notamment quand ils essayent de leur inculquer le bien et le mal ?
Eliot raconte comment son rôle de père a été évoqué dans la plaidoirie pour distinguer le bon
du mauvais père. L’acte commis détermine le père qu’il est, sans que sa relation avec son fils
soit réellement prise en compte. Il existe pour la justice une coexistence de la culpabilité
pénale et de la mise en œuvre de la parentalité1.
Cardi dans sa thèse La déviance des femmes explique que dans « les articles de journaux parus
entre 1981 et 2006 à propos des prisons de femmes, [...] un très grand nombre concerne la
question des mères détenues avec leur enfant, ou plus exactement celle des enfants détenus
avec leur mère, nés ou pas derrière les barreaux » [Cardi, 2008, 116]. Qu’en est-il pour les
hommes ? Après une rapide recherche sur les différents quotidiens, la paternité est
uniquement évoquée dans le cas d’inceste. « Derrière la catégorie impersonnelle de « détenue
», se cache une femme, mais surtout une mère » [Ibid, 2008, 118]. Il existe une protection
accordée aux femmes par la justice pénale ; la maternité peut fonctionner comme « un
bénéfice secondaire » [Ibid, 2008, 120], ce qui n’est nullement le cas pour les hommes.
Quel regard est porté sur la paternité en milieu carcéral ? A travers les quelques
entretiens réalisés auprès des professionnels, j’aborderai leurs visions spécifiques2. Mon
analyse sera une ouverture du sujet.
Ma recherche a révélé la richesse de la perception des différents acteurs et l’investissement de
leur travail auprès des détenus. Ce groupe de professionnels est loin d’être homogène alors
qu’il évolue dans un cadre de travail très rigide. Chacun a des missions bien différentes qui
varient selon leur poste, leur fonction, le rapport à l’autorité [Rostaing, 1997, 169]. Malgré la
mission de réinsertion, la plus valorisée et valorisante dans la pratique, peu de temps est
accordé au personnel pour « faire du social » [Rostaing, 1997, 170]. Dans cette logique, la
1 Colloque Liens familiaux et détention, Université catholique de Lyon, 11/04/14 2 Sans prétendre à l’exhaustivité de mon analyse
85
paternité des hommes détenus ne les distingue pas de la masse carcérale.
La paternité, une identité inexistante en prison ?
Selon une note du 17 novembre 2000, les services pénitentiaires doivent permettre au
détenu un exercice concret de son autorité parentale. Dans ce cadre, il a le droit de signer les
différents documents concernant l’enfant - autorisation de sortie de territoire, interventions
chirurgicales - et d’accéder au livret scolaire. Théoriquement, il peut aussi cantiner des jouets
pour son enfant et les lui remettre en parloir. Ces possibilités restent cependant peu
appliquées. « Une enquête réalisée par une association de familles de détenus démontre que
dans 41 % des établissements pénitentiaires, aucune mesure n’a été prise » [Saulier, 2009] ; à
Liancourt et à Fresnes c’était d’ailleurs impossible.
Entrer en prison signifie souvent perdre son identité paternelle, cela « segna l’inizio della
perdita del sé determinata in primis dalla rescissione dei legami affettivi, familiari e sociali:
l’istituzione totale innalza una barriera tra l’internato e il mondo sociale esterno »(Goffman,
1968)1. L’identité déviante prend le pas sur toutes les autres identifications. Ces hommes
subissent ce qu’on appelle le phénomène de disqualification sociale qui entraine une image
négative. Cette construction sociale collective va se généraliser et leur coller à la peau
[Paugam, 2009, 172]. L’identité de détenu devient plus prégnante que celle paternelle. On
établit alors une correspondance entre délinquance et incapacité paternelle.
« Ils en parlent pas forcément de leur paternité, ils vont plus parler de pourquoi ils sont là, c’est plus ça qu’ils valorisent, après ils s’inventent des vies [...] on est pas là pour être le confident ou l’assistante sociale et on ne cherche pas à le devenir non plus. » [Etienne, gradé, 6 ans d’expérience]
« Ici j’ai plus des petites peines, ils font des enfants comme ça, ils sont pas... les délinquants sociaux ont des enfants jeunes, ils n’ont pas les compétences pour... je ne dis pas que ça ne leur fait rien, que ça ne rappelle pas quelque chose... la peine les interroge mais dire qu’ils feront plus en sortant, je ne sais pas. » [Evelyne, psychiatre, 15 ans d’expérience]
Ces deux entretiens illustrent une paternité secondaire, elle ne représente pas le sujet principal
des détenus et ne détermine pas leur trajectoire carcérale. Je pose l’hypothèse : la paternité
n’est pas un sujet abordé car elle constitue le domaine du sensible. L’espace intime des
détenus ne concerne pas les surveillants, ils ne mobilisent pas leur paternité dans leurs
1 Cela marque le début de la perte du soi déterminée par la résiliation des liens affectifs, familiers et sociaux: l'institution totale élève une barrière entre l'interné et le monde extérieur social in Cacialli, 2013, 24
86
échanges. Au contraire des prisons de femmes où l’entre soi féminin1 – détenues et
surveillantes – favorise les discussions, l’entre soi masculin ne produit pas le même effet. La
souffrance exprimée par les détenues est prise en charge par les professionnels à une échelle
individuelle. Dans ce cadre rapproché, il est d’autant plus difficile pour les surveillantes de ne
pas s’impliquer émotionnellement et de « cloisonner leur vie privée et leur vie
professionnelle, en établissant des barrières nettes, ce qui peut constituer un réel danger de
déstabilisation identitaire » (Guionnet, Neveu, 2004)2.
Faire le lien entre prison de femmes et prison d’hommes pointe des logiques singulières qui
existent au sein de ces établissements. L’identité maternelle existe, ce n’est clairement pas le
cas pour l’identité paternelle. « Le lien mère-enfant prime donc sur l’image de la « mauvaise
mère » délinquante et néfaste au mineur. Quelle que soit la mère, il vaut mieux une mère que
pas du tout » [Cardi, 2008, 151]. L’identité de reclus pour les hommes tend à gommer les
autres identités : pères, époux, fils... Les représentations liées au masculin sont fortes en
prison, ce qui les cantonne à « un masculin viril » [Ibid, 2008] Cette perception des hommes
les dissocie de la question familiale ; pourtant en 2002, 54% des détenus étaient pères
[Cassan, 2002].
La question familiale reste marginale pour les hommes contrairement aux femmes détenues
qui sont avant tout des figures maternelles [Cardi, 2008, 213].
La vision de certains surveillants est largement emprunte par ces représentations.
« Vous pensez qu’on peut être père et détenu ? Bien sur que non, sinon on se retrouve pas ici, et puis on fait pas de bébé en prison non plus. Pour moi un père déjà n’est pas en prison, derrière les barreaux. Ça doit être le père parfait, attentionné comme dans les films (rire) Il doit être là pour son enfant, qu’il le voit grandir pour le voir dans ses déceptions amoureuses [...] de temps en temps ils me parlent de leurs enfants, quand ils veulent téléphoner parce que leur fils est malade ou que c’est leur anniversaire, ils ne rentrent pas dans les détails et ils me demandent l’autorisation pour appeler leur enfant et je vais lui donner. Pour téléphoner, il doit faire un courrier c’est long donc moi au rez de chau je peux lui permettre, le détenu doit être correct car ça se fait sans l’autorisation du chef [...] mais personnellement la question de la paternité sans être méchant j’arrive pas à me soucier de leur vie de famille. C’est une forme de détachement ? Voilà, exactement, moi personnellement, y a des questions que j’évite sur la famille et tout. On peut être pris de pitié et réagir autrement. Un détenu qui va venir, qui va pleurer avec des problèmes de famille, qui va me demander plus je vais lui dire non. Des fois ils mettent en avant ça mais c’est une excuse, il va te dire que l’enfant va mal et il veut une douche, c’est quoi le rapport ?» [Joseph, surveillant, 3 ans d’expérience]
1 Joël utilise le terme d’entre-soi féminin pour décrire un lieu où il existe trois groupes présents dans cet espace: le groupe des détenues, le groupe des agents pénitentiaires affectés au quartier et enfin le groupe formé par l’ensemble des individus qui évoluent quotidiennement ensemble, composé exclusivement de femmes. Les seuls hommes évoluant dans cet espace sont des surveillants gradés et les autres professionnels (santé, sociaux, scolaire...). Certaines femmes signifient explicitement aux hommes leur position d’intrus en adoptant à leur égard des attitudes sexualisées. [Joël-Lauf, 2012] 2 in Joel-Lauf, 2012, 60
87
« La prison peut leur permettre d’assumer leur paternité ? Après vingt ans de carrière on y croit plus, vaut mieux poser ça à un jeune. Celui qui croit à ce discours ils ne sont pas en bleu. Y en a certainement mais c’est très très faible... la prison est fait comme elle est aujourd’hui, elle sert à rien, ça sert juste à enlever des gens de la société point. La seule personne qui arrive a apporter quelque chose à sa détention c’est qu’elle le veut et qu’elle est soutenue par sa famille, j’en ai vu trois quatre. Nous on arrive en bout de course, ils ont déjà des accusations, les parents ont échoué, la justice a échoué donc ils arrivent chez nous ils ont déjà un gros parcours. Les primaires, il n’y en a pas beaucoup. Quand on regarde le quartier arrivant c’est que des récidivistes. » [Eric, gradé, 20 ans d’expérience]
Ces deux surveillants considèrent l’incompatibilité de l'identité parternelle et l'identité
carcérale. Pour Joseph, la paternité est en premier lieu une question de présence physique
auprès des ses enfants. Quand certains détenus lui confient leurs problèmes, il tente d’y
répondre par de petits avantages tout en signifiant que son rôle n'est pas d'épancher leur peine.
Au final il ne se soucie guère de leurs états d'âme. Cette forme de détachement semble
légitime dans une logique statutaire [Rostaing, 1997]. Nous la retrouvons également avec
Eric. Le cadre sécuritaire passe avant tout et aucun ne se fait d’illusions sur la fonction de la
peine. Les détenus semblent appartenir à un autre monde où l’obéissance prime [Ibid, 1997].
L’expérience d’Eric témoigne d’un réalisme accru de la situation carcérale. Finalement la
paternité n’a qu'un faible impact dans le parcours des détenus. Seuls leurs propres choix
comptent pour appréhender l’après carcéral et leur réinsertion mais rares ceux qui y
parviennent.
« Les agents et les institutions chargés de faire respecter les lois tendent à avoir une vision
pessimiste de la nature humaine [...] Ils sont sceptiques à l'égard des tentatives pour amender
les délinquants. Le point de vue sceptique et pessimiste de ces agents est évidemment
renforcé par leur expérience quotidienne. Ils voient, au cours de leur travail, les preuves que le
problème persiste. Ils voient les délinquants récidiver continuellement, et se meurent ainsi
sans ambiguïté en dehors de la collectivité » [Becker, 1985, 181].
« Quand vous parlez de paternité vous parlez côté détenu ou côté administration, ici on s’en branle de la parentèle. On est loin de chez nous, ils en ont rien à foutre. Ça pèse dans la façon de travailler et financièrement. Les pères ici j’en pense rien, je m’occupe de mes enfants avant de m’occuper de la manière dont ils s’occupent des leurs. Y a une forme de mépris, je vais être sincère, la personne incarcérée à 90% elle est responsable donc elle a payé, c’est une des conséquences de son acte et souvent ils brisent leurs liens. J’ai toujours du mal à voir leurs enfants dans leur bras quand ils ont commis des choses. Mon code de déontologie m’interdit toute forme de jugement mais ma façon de penser citoyenne ne valide pas ce qu’ils font. Quand il y a des UVF ou il a violé son enfant et il le voit, je trouve ça ignoble, c’est ma façon de penser. Donc quand on est en prison on ne peut pas être père ? Je pense qu’on ne devrait plus être autorisé à être père avec certains actes, parfois ce n’est pas vu pas pris. Quand il y a viol et tout on devrait plus avoir le droit d’enfanter, je pense aux victimes qui ont eu des actes difficiles, ce que je viens de dire ça doit aller à l’encontre de ce que pense la société. A partir du moment où il est incarcéré il n’est plus père ? Grosso modo celui qui fait un cas minime ok mais bon il a toujours quelque chose. Mais pourquoi il aurait le droit au bonheur de la paternité, avoir l’innocence en face alors qu’ils ont fait les pires saloperies. Vous imaginez vous avez des gens qui arrivent pas à avoir des enfants et eux qui arrivent à vous raconter ça. Moi mon plus grand bonheur c’est ma fille donc je ne vois pas pourquoi
88
ils ont le droit à ce bonheur. Ça se mérite d’être père c’est une récompense. » [Louis, surveillant, 6 ans d’expérience]
Louis explique que son statut de père est bafoué par l’institution carcérale avec des conditions
de travail qui nient autant la paternité des surveillants que celle des détenus. D’après lui, la
distance qui sépare la prison de son foyer et ses horaires de travail ne sont pas en adéquation
avec une vie familiale. Il en résulte une baisse de qualité de vie qui joue sur sa motivation et
la qualité de son travail Etre un homme en prison, quel que soit le côté du mur, c'est nier une
partie de soi-même. Louis mêle à la fois son expérience professionnelle et citoyenne, il
affirme que la paternité est une récompense en référence au bonheur vécu avec la naissance
de sa fille. Le droit à la paternité découlerait d’un ordre de valeur, celui qui est pauvre ou en
échec social serait évincé de l’existence humaine [Paugam, 2009, 16]. Les marginaux, les
délinquants sont discrédités par les échecs jalonnés le long de leur existence, ces individus
« en marge » endurent quotidiennement l’épreuve de la réprobation sociale [Goffman, 1970].
Tenir son rôle, être un père engagé
« J’essaye de le devenir au quotidien, que papa redevienne Papa, que si les filles ont besoin y a pas que Maman. C’est pas un jour, je suis papa et le lendemain non. » [Thierry, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
Malgré l’invisibilité de l’identité paternelle, un impératif sociétal pèse au dessus de la
tête des détenus comme un refrain lancinant : la paternité est un engagement. Avoir un enfant
c’est se lier et qui dit lien, dit engagement. Le père doit à l’enfant cet engagement à la fois
moral et institutionnel. L’engagement dans la sphère privée contient l’idée de promesse et de
confiance. S’engager par le biais d’un contrat dans un cadre institutionnel ne possède pas la
même valeur que s’engager à une personne [Gaudet, 2001]. Ce sont des liens
d’interdépendances qui établissent le respect, la sensibilité aux besoins des uns et des autres,
de leurs attentes etc... « L’engagement envers autrui est une forme de réponse à l’appel de
l’autre, tel que le symbolisait Levinas » [Ibid, 2001, 78]
Le rôle paternel est souvent nié en prison, il n’y a pas d’injonction à l’être, au contraire, pour
une femme incarcérée, ne pas se soucier de ces enfants apparaît comme illégitime. Les
professionnels émettent des jugements positifs sur la paternité en détention mais seulement au
niveau du discours car la mise en place d’aide concrète est relative.
89
« Le maintien des liens c’est important il va sortir c’est évident, c’est primordial s’il faut le réinsérer. Certains ont besoin... Y en a beaucoup qui sortent ils ont plus rien ils ont plus leur place ou il ont du mal à retrouver une place. Certains ont eu des enfants qu’ils n’ont pas connus. Et ils peuvent être responsables ? Tant qu’ils sont en prison ils n’ont aucune responsabilité mais il faut qu’ils trouvent une place. Tant qu’ils sont ici c’est compliqué après y a les UVF pour maintenir des liens ou le parloir. » [Thibault, surveillant, 2 ans et demi d’expérience]
« Ils peuvent être père et détenu selon vous ? Quand on les voit en visites, certains ont plus d’autorité que la mère, ça me paraît compatible, je vois qu’ils s’en sortent un peu. Y en a qui sont apaisés depuis qu’ils sont pères. [...] par les parloirs ils passent beaucoup de choses qui leur permettent le maintien. Par exemple les documents qui passent, les dessins, les bulletins, c’est les seuls documents qu’on autorise, ça leur permet d’avoir un œil sur l’éducation. Quand ils sont au parloir avec les enfants ils ne se comportent pas mal. [...] souvent ils sont affectueux, j’ai jamais vu un détenu mal se comporter avec son enfant c’est plus avec leur femme, les enfants jamais. Ou sinon c’est plus pour les recadrer, si le gamin dit « ta gueule » à sa mère il va se prendre une claque, normal. » [Etienne, gradé, 6 ans d’expérience]
« Je rencontre le chef de troisième division, celui-ci ne m’a jamais vue, pour cette raison il me demande quelle est ma fonction dans la prison. Je lui parle de mon sujet et il me dit que mon étude est fondamentale, que d’ailleurs il organise avec le relais enfant-parent la fête des pères et Noël, mais il considère qu’il n’y a pas suffisamment de choses faites pour les pères incarcérés. [...] Il me dit que le lieu a une influence sur les relations, les parloirs ne sont pas adaptés. On voit ce que fait le voisin et on ne peut pas toujours empêcher les relations sexuelles. Le parloir est un lieu sacré. Je lui demande ce qu’il faudrait faire. A cela il me répond qu’il faudrait changer la structure, faire davantage de parloir famille. Faire des UVF. Il ajoute que les pères sont des oubliés et encore plus quand ils sont détenus. Pour lui le vécu de l’incarcération peut dépendre de ce lien. Le maintien des liens est pour lui essentiel à la réinsertion. Il finit par me dire qu’il faut penser à ce qu’ils étaient dehors. » [Extrait du journal de terrain]
La paternité est perçue comme un gage de réinsertion, elle permet de lier le dedans/le dehors
et d’établir un pont entre les deux. On retrouve dans ces trois entretiens l’importance des lieux
de rencontre : UVF et parloirs, ce sont des lieux sacrés.
Les dispositifs mis en place pour perpétuer des instants familiaux sont nécessaires à
l’élaboration d’une conscience familiale et permettent de « faire le point sur la pérennité des
liens qui unissent les proches et le détenu » [Bouchard, 2007, 61]. Ils introduisent la notion de
routinisation des rapports, élément indispensable pour la reprise de la paternité à la sortie.
« La relation entretenue avec le détenu ne vise pas tant à vivre une « vie de famille » » [Ibid]
que de préparer au mieux la sortie.
Les actions envers les pères sont généralement faibles ; l’administration pénitentiaire n’a ni
les moyens ni le temps de mettre en place des stratégies du maintien des liens. Seuls les CIP,
les éducateurs interviennent mais toujours dans une logique de réinsertion. Le relais enfant-
parent aide les personnes incarcérées à investir leur fonction parentale en ciblant leur travail
sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
« On intervient pour le bien des enfants pas pour le bien des adultes, c’est pas pour le parcours d’exécution de peine du détenu, le PEP, nous on s’en fiche un peu, autant le SPIP intervient avec une mission bien précise qui est de maintenir les liens familiaux parce que ça représente un ancrage supplémentaire dans le parcours de réinsertion et qu’il ne faut pas rater celui-ci, il est important le parcours de réinsertion. Autant nous on le fait pour le devenir des enfants, on le fait pas pour le devenir du détenu, qu’il réussisse ou pas sa réinsertion, bon on préfère qu’il l’a réussisse, qu’il soit présent pour ses enfants mais notre objectif premier du relais enfant parent, n’est pas de sauver l’enfant de ce parent mais de lui donner un espace. Notre ambition c’est de donner à l’enfant un espace où il va rencontrer son
90
parent tel qu’il est, avec ses compétences et ses incompétences. On ne prétend pas dire à l’enfant que son parent est génial d’ailleurs personne ne le prétend mais nous c’est vraiment ce qui nous mène. Ce qu’on veut dire à l’enfant c’est vraiment que « tu vas avoir un espace dans lequel tu vas pouvoir te rendre compte de qui est ton parent et nous on t’aidera dans les moments compliqués et on aidera ton parent dans les moments compliqués. Parce que tes questions seront parfois compliquées pour lui et parce que ses réactions seront compliquées pour toi. » » [Emmanuel Gallaud, Coordinateur du relais enfant parent]
Etre père est avant tout une question de volonté de l’individu, les aides sont limitées et
c’est à lui de se prendre en main. Comme le dit Emmanuel Gallaud, les parents incarcérés ont
des compétences et des incompétences ! Gardons à l’esprit que leur vécu familial ne leur
donne pas tous les outils pour faire front à cette incarcération ; à cela s’ajoute les éléments
extérieurs sur lesquels ils n’ont pas ou peu de prise (séparation, divorce, éloignement
familial...).
Nous sommes passés d’un modèle rigide autoritaire à un père moderne qui encourage
l’intimité. Il est supposé percevoir les besoins et les désirs de ses enfants [Cusano, 2007] et
faire preuve de sensibilité. Malheureusement, la prison ne favorise pas l'expression des
émotions. La responsabilité1 d’un père n’est pas seulement le fait de prendre un engagement
mais surtout de le respecter (Ricoeur, 1995)2. Dans quelle mesure cet engagement est t’il
respecté en prison ? « Les processus d’engagement dépendent de valeurs qui varient selon
l’histoire, les cultures, les âges, les sexes, etc. (Becker, 1960). Les formes d’engagement se
font à travers l’apprentissage au sein de l’éducation, de la famille et des liens
intergénérationnels, voire de la socialisation. » [Gaudet, 2001, 78]. Si cette éducation n’a pas
été réalisée avant l’incarcération il semble difficile de l’acquérir par la suite. La prison est-elle
un lieu possible pour faire cet apprentissage ?
Le regard souvent sévère porté sur ces hommes « en marge » va certainement se répercuter
sur leur capacité à investir des rôles : mari, fils, père... Si impératif il y a à assumer sa
paternité dehors3, en détention il cesse d’exister.
Une paternité en tension : entre modèle sociétal du père engagé et situation incapacitante.
« (Il me raconte la vidéo conférence qu’il a eu avec le procurer ou le juge avant son jugement en appel) On dirait que quand tu as des enfants ils veulent rien te donner, j’ai le droit à une chance, à me réinsérer. Je ne leur ai pas laissé la possibilité de parler mais j’en ai marre d’être ici. J’ai travaillé ici, j’ai fait plein
1 La notion de responsabilité sera plus largement développée dans cette partie. 2 In Gaudet, 2001, 78 3 Référence au développement sur la paternité forcée.
91
de choses. Elle m’a dit que j’ai eu des déclassements1 mais j’en ai eu qu’un. Je me suis énervé, c’est ce qu’ils cherchaient. On dirait que quand tu as des enfants ils te laissent là alors qu’il y en a qui avaient pas d’enfant, ils sont retournés dans leurs cités avec les mêmes projets. On croirait qu’ils veulent te briser, que tu sortes sans rien. J’ai remarqué ça. Je suis parti avec plusieurs mecs pour l’aménagement, on parle, le mec il n’a pas d’enfant, il retourne dans sa cité où il a eu des problèmes et il sort et moi non. Quand je regarde la télé et que tu entends les procureurs qui disent favoriser les familles, rien du tout. Si tu es blanc, tu sors direct. En plus c’est la première fois que je suis en prison, ils devraient me laisser ma chance. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
Cet entretien, peu objectif, illustre néanmoins un puissant sentiment d’injustice qui
anime certains détenus. Jawad a l’impression que ses efforts pour conserver son rôle de père
sont volontairement réduits à néant par l’institution carcérale. Il existe, selon lui une
incohérence du système, qui punit pour mieux réinsérer mais qui, au final, le prive de ses
droits. L’image dévalorisante que la société porte sur ces hommes n’atteint pas Jawad et ce
sentiment d’échec que lui impose l’institution le laisse relativement indemne. « L’individu
stigmatisé peut éprouver au plus profond de lui même le sentiment d’être « une personne
normale », une personne qui mérite sa chance et un peu de répit. Il peut fort bien percevoir,
que quoi qu’ils professent les autres ne l’acceptent pas vraiment et ne sont pas disposés à
prendre contact avec lui sur un pied d’égalité » [Chantraine, 2004, 53]. L’individu en marge
ne se sent pas forcément comme tel. « Il se peut qu'il n'accepte pas la norme selon laquelle on
le juge ou qu'il dénie à ceux qui le jugent la compétence ou la légitimité pour le faire. Il en
découle un deuxième sens du terme: le transgresseur peut estimer que ses juges sont étrangers
à son univers » [Becker, 1985, 25]
Les pères incarcérés portent sur eux une étiquette dévalorisante, ils sont jugés selon des
normes qu’ils n’ont pas élaborées et qui leur sont imposées de force [Ibid, 1985, 40]. La
tension découle des hautes attentes du rôle de père et de l’incapacité d’y répondre en
détention.
« La délinquance n’est pas un statut. Pour moi un père toxico a autant de droit à être parent, c’est pareil pour les délinquants, tu peux être un très bon père et faire du business. Y a des gros consommateurs dans la pub avec la coke on les laisse à côté, ils vont pas en prison. ça dépend de la dépendance, c’est toujours la même chose. Dire « non tu es toxico, tu ne peux pas voir ton fils » moi je dis non. Y en a qui sont en carence mais ils sont supers intelligents. [...] Dans la toxicomanie, quand il prend conscience, qu’il en a marre, tu ne peux pas annuler quinze ans de conso. Ils rechutent mais c’est pas grave, ils vont se mettre en relation, faut pas être pressé. Faut aller à un rythme. » [Emma, Educatrice, 7 ans d’expérience]
« Les petits jeunes, les délinquants récidivistes, ils friment mais après... A 35 ans c’est un âge critique. Avant 35 ans, les enfants qu’ils ont par intermittence, c’est la mère qui s’en occupe. A un moment quand ils vont décider d’arrêter, les liens se refont ou avec une nouvelle famille, tu vois, ils ne sont pas tous mauvais. Je pense qu’ils y pensent mais c’est trop tard, ils sont en position de faiblesse, la mère les a disqualifiés. Faut avoir du courage pour reprendre les liens. [...] En consultation externe, je les vois, ils sont dehors et ils ont du mal à reprendre les liens, même s’ils ne les ont pas touchés (les enfants, en référence aux pères incestueux). J’en ai connu des pères. Y en a un, il a eu deux condamnations pour viol
1 A la suite d’un incident, le détenu accuse parfois comme sanction la perte de son travail au sein de la détention.
92
sur femme majeur, je l’ai suivi et il était transfiguré à sa sortie mais bien, après deux ou trois ans il a repris contact avec sa fille de 30 ans. Y en a un autre qui n’avait pas revu ses enfants en sortant, mais il ne désespérait pas malgré le blocus de la mère. Je ferais surement pareil (que la mère), c’est la peur. Je ne parle pas de père incestueux, c’est le bordel. Mais y a une différence entre père incestueux et pédophiles mais les deux ne perdent pas espoir, ils ont des obligations de soins. [...] y en avait un, il a connu la violence dans l’enfance, des maltraitances dans la famille, du sexe. Il a payé cher pour comprendre que la femme n’était pas un bout de viande mais il a connu que ça dans sa famille. Y a quelque chose, y a un manque, y a quelque chose d’inachevé, quelque chose de raté. » [Evelyne, psychiatre, 15 ans d’expérience]
La fragilité de ces hommes correspond selon Paugam à l’apprentissage de la
disqualification sociale. Ces pères se rendent compte de la distance qui les sépare de la grande
majorité de la population. Ce sentiment d’échec est un réel handicap et ils intériorisent
l’infériorité de leur statut [Paugam, 2009, 6] mais rien n’interdit progressivement un
changement. La prise de conscience de cette disqualification sociale est peut-être un premier
pas pour pouvoir s’en distancier. A travers les deux entretiens, nous percevons la possibilité
de négocier la disqualification sociale, « en d'autres termes, l'existence d'une marge
d'autonomie à l'intérieur de laquelle les acteurs sociaux peuvent jouer. Ils peuvent participer à
la revalorisation de leur identité personnelle - en réinterprétant par exemple les traits négatifs
de leur statut social - au contact des institutions avec lesquelles ils sont en relation et du reste
de la société » [Ibid, 2008, 51].
Admettre leur incompétence au regard de leur famille et de la société s'avère compliqué ;
néanmoins un changement positif, une amélioration est toujours possible ; une aide semble
nécessaire (avec des psychiatres, éducateurs...). Ce statut dévalorisant limite leur identité
paternelle. Rien ne prouve que le nombre de pères incompétents soit plus important en prison
que dehors ; pourtant le stigmate leur colle à la peau [Chantraine, 2004]. Les difficultés
semblent insurmontables mais les liens, s’ils se défont peuvent aussi se reconstituer.
« Pour moi, ils vont être pères mais ils ne vont pas le vivre au quotidien, ils ne vont pas remplir leur tâche ou partiellement, c’est leur choix mais c’est pas au quotidien. Pour moi être père c’est être là au quotidien, c’est l’apprentissage de la vie, le sport, les aider à l’école, les assister pour les problèmes de santé. Contribuer à leur instruction. Ils ne sont pères que partiellement [...] certains vont réussir à murir, ils savent qu’ils ont des enfants qui les attendent, savoir qu’il y a quelqu’un ça peut éviter de faire des bêtises. [...] Quand ils parlent de leurs enfants, c’est toujours avec émotions et fierté, c’est quelque chose qui va.... c’est le plus cher, leur enfant. C’est vrai c’est pas une idéalisation, c’est pas du semblant. Pour eux, ils en parlent avec fierté, c’est quelque chose de vrai. Il est fier de son enfant mais il n’est pas fier d’être incarcéré, de ne pas pouvoir le voir grandir au quotidien. » [Clément, gradé, 10 ans d’expérience]
Cet entretien illustre véritablement cette mise en tension, entre l’incapacité d’être un père à
plein temps et l’amour incommensurable qu’il éprouve pour son enfant. Ce dernier est
quelque chose de vrai, quelque chose de plus que le reste. Ce qui se joue dans cette mise en
tension c’est l’articulation entre l’identité biographique « pour autrui » et l’identité
93
biographique « pour soi », entre l’identité héritée et l’identité visée [Dubar, 98, 77]. Un fossé
existe entre ce que les autres renvoient de lui, ce que l’individu souhaiterait pour lui même et
sa propre manière de se percevoir. Selon Dubar, le terme d’identité est lié à un type d’espace
particulier où l’individu s’investit lui même et « d’une forme de temporalité considérée
comme structurante d’un cycle de vie ». Son identité subjective - sa propre représentation de
lui-même- et les « cadres sociaux de l’identification » -l’image d’autrui sur lui-, mettent en
jeu les catégories utilisées pour l’identifier dans un espace social donné [Ibid, 98]. Dans
quelle mesure les détenus parviennent t’ils à se délivrer de l’identité dévalorisée de détenu
pour investir de plain pied leur paternité, si tel est leur désir ? Leur capacité d’empowerment
sera-elle assez forte pour échapper au contrôle carcéral ? Comment gèrent-ils cette tension
entre la situation incapacitante et leur désir d’assumer leur paternité ?1
Ces questions nous conduisent au vécu de la paternité en milieu carcéral. Selon les
théories interactionnistes, j’ai prêté attention à la manière dont « les acteurs sociaux se
définissent mutuellement et définissent leur environnement » [Becker, 1985, 229].
La question des relations familiales des hommes détenus reste une préoccupation tardive des
politiques pénitentiaires alors qu’elle est pourtant fondamentale.
« La plupart ils l’étaient avant (père), ils le vivent très mal, certains pour eux c’est un échappatoire (d’avoir des enfants). Y en a un en cellule qui tous les matins emmenait ses enfants à l’école et maintenant le matin en cellule il parle comme si y avait ses enfants, c’est le choc carcéral. » [Entretien collectif, surveillants]
B. UN VECU NEGATIF DE LA PATERNITE
Inutilité et perte de confiance en soi
« Je ne suis pas un père, je ne suis jamais là, je ne peux pas faire mon rôle de père, je suis un père en carton, je ne suis pas un père. Je suis un père toutes les trois semaines quand ils viennent au parloir. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
L’arrivée en prison malmène les rôles anciennement joués par les détenus qui ne sont
plus en mesure de participer pleinement « aux rites fondamentaux de la vie collective »
[Chantraine, 2004, 236]. Lorsque des évènements se produisent – naissance, anniversaire,
maladies... – ils n’ont aucune prise dessus. L’expression de « père en carton » en témoigne ;
1 Nous essayerons d’y répondre dans le second et troisième point de ce chapitre.
94
incarcéré, le père « ne sert plus à rien » ou tout du moins ne remplit pas les fonctions
attendues. L’expression « faire son rôle de père» pour parler de la paternité montre que ce
sont essentiellement les actes qui définissent le père. Cette définition met en opposition la
paternité statutaire et la paternité dans la pratique. Sans véritable mot en français, les anglais
utilisent Parenting et Parenthood. Le premier terme signifie être parent par ses pratiques, par
la prise en charge et les responsabilités relatives à l’enfant et le second désigne une condition
de parent, un statut attribué par la naissance même de l’enfant.
A travers cet entretien, le détenu annonce que le statut ne suffit pas pour faire de lui un père.
Il ne l’est que toutes les trois semaines par le biais du parloir, c’est la présence de ses enfants
qui lui réattribue son rôle. Une forme d’impuissance carcérale s’installe insidieusement chez
les détenus les privant des capacités à remplir leurs rôles sociaux.
« Qu’est-ce que tu penses de ton rôle de père ? Dehors oui je l’avais, dehors je suis proche d’eux, mais ici je ne me sens pas père, mais bon...je fais rien, je les vois en parloir, on ne peut pas dire qu’on a le mérite de faire...de faire le rôle de père. » [Larbi, 40 ans, marié, 4 enfants, 11 mois]
« Tu te sens plus père ou père détenu ? Je suis à moitié père parce que je ne remplis pas mon rôle de père, je ne fais rien du tout de père, père c’est beaucoup de responsabilités. Je sers à rien c’est vrai je ne sers à rien. Même si je sais que dehors y en a qui servent à rien, faut que je sois dehors. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
Ces deux entretiens renvoient au premier extrait avec l’utilisation répétée du verbe faire. Des
distinctions se dessinent entre être en prison, ne pas être à l’extérieur, être dehors et la
capacité à être père. Etre dehors devient la condition si ne qua non pour se sentir père et l'être
réellement. Les difficultés se surperposent : s’adapter à l’intérieur, accepter le quotidien et
lier ces deux espaces – dedans, dehors –.
Parler de paternité en étant incarcéré se transforme en épreuve. Dans ces conditions, le
manque de responsabilités prive ces pères de leur statut : « nessun luogo, istituzione, legge
potrà levargli mai: l’essere padre. Il detenuto è in grado di fare il genitore ma alcune volte gli
viene negato quel processo dinamico attraverso il quale può imparare ad esserlo e a saper
rispondere in maniera 1 » [Cacialli, 2013, 31].
Rappelons qu’en prison « les risques de fragilisation et d'appauvrissement des liens familiaux
pendant l'incarcération sont fréquents, dus par différents obstacles matériels rencontrés.
L’absence d’une quotidienneté, ou même de rencontre altère ces liens. La situation est
d'autant plus difficile que le père vivait avec les siens avant le temps carcéral » [Dufoucq-
Chappaz, 2011, 146].
1 Aucun lieu, aucune institution, aucune loi ne pourrait jamais enlever l’être père. Le détenu est capable d’être le géniteur mais quelques fois le processus dynamique à travers lequel il apprend à être père tout en sachant répondre à ce rôle lui est nié. Traduction de Marine Quennehen
95
« Je suis un père indigne, un père en prison excusez moi mais c’est le mot le plus approprié pour ça. C’est temporaire... moi je ne pense pas comme ça, un père n’a pas à être en prison, c’est comme ça. Faut choisir avant de faire des enfants. Soit être une bonne personne, vivre modestement avec ça, faire des enfants ou ne pas en faire et faire des bêtises. Faut choisir on ne peut pas avoir les deux. Ce n’est pas possible d’être père ici, pourquoi faire des enfants dans ce cas, comment ils vont vivre, excusez moi c’est… » [Chafik, 28 ans, marié, 2 enfants, 5 mois]
Un père utile, c’est un père présent. Chafik porte un regard très critique sur la paternité en
détention ; pour lui, il faut choisir entre les deux. Etre en prison c’est renoncer à ce rôle. Cette
situation incapacitante conduit les pères détenus à se sentir impuissants et inutiles. La perte de
confiance en soi se lit à demi mot dans ces entretiens ; ils n’acceptent pas leur vulnérabilité et
font preuve de pessimisme sur leur situation. La confiance dans leur rôle découle de leur
capacité à répondre positivement aux besoins de l’enfant. Dans leur cas, ils ne se sentent pas
en mesure d’y répondre. Ce sentiment d’inutilité est intimement lié à l’absence et au manque
de quotidienneté.
L’Absence ou la fin d’une quotidienneté
« Avec Ali, j’ai pas trop de souvenirs, il a marché le jour où je me suis fait interpeller, ça fait mal de manquer ça. [...] Sami, il a 13 ans et depuis qu’il a sept ans je suis en prison, c’est presque la moitié de sa vie. Ce que je leur ai offert quand j’avais de la thune ils ne s’en rappellent pas. Je leur ai acheté une petite moto à 1000 euros alors qu’ils ne savaient pas faire du vélo, est-ce qu’ils s’en rappellent ? Ils veulent que je sois dehors. Je ne le voyais pas comme ça avant, c’est les expériences de la vie, faut avancer. Tu ne peux pas faire que de la prison et de la merde. » [Bilal, 33 ans, concubinage, 4 enfants, 34 mois]
La difficulté de vivre sa paternité en détention est qu’elle instaure une relation
parentale discontinue, intermittente. Martial, en parlant des pères divorcés, explique que
l’alternance entre présence et absence peut devenir un motif de « décrochage ». Les pères
laissent se dégrader les liens avec leurs enfants [Martial, 2009], la situation les place dans une
incapacité à poursuivre la relation. Ce contexte ébranle à la fois « l’évidence, la spontanéité et
l’intimité des relations paternelles, désormais contenues tout entières dans les « visites » de
l’enfant qu’il faut à tout prix réussir » [Ibid, 2009]. D’où l’importance du parloir où il faut
optimiser ce temps pour rattraper tous les moments manqués. La notion de temps renvoie au
flux continu d’événements dont font partie les hommes [Elias, 1997, 80], mais le temps, en
prison prend une toute autre dimension. La perception des évènements est moins nette, plus
96
diluée puisqu’ils évoluent « hors du monde »1. La cohérence des rythmes est rompue et la
dimension spatiale n’est plus en adéquation avec celle du dehors. Il y a une évolution de la
temporalité, « rythmée par des phases d’accélération, des ruptures ou des ralentissements qui
génèrent des interactions, des conflits et des contradictions » [Di Méo, Buléon, 2005, 19].
Les temps dédiés à la relation parentale sont brefs, courts et trop peu fréquents pour permettre
un sens de la continuité dans le travail éducatif du père [Cacialli, 2013, 49]. La paternité « au
jour le jour » conduit à une définition parfois traditionnelle des tâches et des rôles du père.
Dans « un nouveau contexte organisationnel, » [Martial, 2009] la mère va assumer la grande
partie du travail parental cantonnant le père dans un rôle statutaire.
« Je suis loin de ma famille, je ne les vois pas grandir, je peux m’en prendre qu’à moi même mais ils pourraient me rapprocher de ma famille. Ça détruit les liens ? Oui surtout que ma fille me reconnaît quand elle me voit mais pas mon fils. Des fois on reste un mois un mois et demi sans se voir, c’est normal qu’il ne me reconnaisse pas. J’essaye de leur parler au téléphone pour qu’ils entendent ma voix. Comment elle te reconnaît ? Elle sourit, elle est contente elle ouvre automatiquement les bras, mon fils est très proche de ma femme, y a qu’elle qui compte, quand je le prends il se met tout de suite à pleurer. » [Chafik, 28 ans, marié, 2 enfants, 5 mois]
Ce qui compte, pour être père, ce sont les gestes, l'observation de l’évolution de l'enfant, avoir
le sentiment de participer à une vie familiale ; en dépit de l'humiliation d'avoir commis une
erreur et d’être puni. Le sentiment et l’identité paternelle ne se limitent pas à la simple
présence physique ; elle ne suffit pas pour être un vrai père [Cacialli, 2013,32]. L’auteure
considère que la présence ne détermine pas la capacité à être père mais que l’identité
paternelle tend à disparaître avec l’absence. Je nuancerai cette approche : ce n’est pas tant
l’absence ou la présence ou encore les fonctions réelles du père auprès de l’enfant qui
importent mais plutôt comment chacun des acteurs vit cette présence, cette absence et ces
rôles. L’acteur donne du sens à ses actions. [Delumeau, Roche, 28].
A travers l’entretien de Chafik, nous constatons les effets produits : son fils ne le reconnaît
pas. « L’enfant quand il répond, quand il réagit positivement ou négativement aux demandes
paternelles, oriente nécessairement la façon dont le père se sent père » [Zaouche-Gaudron,
2002,42].
« Vous vous sentez père ? Non qu’un petit peu, je ne joue pas mon rôle, je ne suis pas là. Un papa ça s’occupe de ses enfants. Faut parler avec eux, faire les devoirs. On ne connaît pas les conneries qu’ils font. Je ne m’occupe pas d’eux comme il faut. C’est quoi être père pour vous ? Faut être présent, faire tout ce qu’il faut, s’en occuper c’est ça être un bon père, c’est quelqu’un qui s’en occupe. De quelle manière ? Que ce soit matériel, éducatif et tout. Faut vraiment être présent, c’est ça qui compte. » [Omar, 48 ans, séparé, 2 enfants, 2 ans et demi]
1 J’entend par hors du monde, non pas une conception qui ferait de la prison un isolat social mais plutôt dans le sens d’un espace temps différent de celui du dehors.
97
Le sentiment paternel, s’il n’est pas déterminé uniquement par la présence, en dépend
néanmoins fortement. Se sentir père découle d’un nombre de facteurs souvent absents en
détention. Malgré les parloirs, les UVF ou même des permissions, c’est un temps hors du
temps, un temps trop court pour renforcer la relation. Ces évènements ponctuels sont « autant
d’occasions de leurrer sa propre perception du temps carcéral » [Chantraine, 2004, 168]. Ce
temps « évidé » ne parvient pas réellement à s’inscrire dans la biographie de l’individu. A ce
temps suspendu s’ajoute un espace spatialement déterminé dans lequel il est difficile de se
mouvoir. J’émets l’hypothèse que la prison a un effet structurant qui délimite la capacité
d’action de l’individu. « Ne s’identifiant par corporellement et affectivement [au lieu], il le
regarde avec plus de distance [...]. Les décisions qu’il prend, les actions qu’il conduit n’ont
pas forcément d’impact direct » [Di Méo, Buléon, 2005, 33] sur son propre cadre de vie ni sur
le cadre familial à l’extérieur. L’individu incarcéré assume effectivement une activité (la
détention) dont les implications symboliques sont souvent incompatibles avec la conception
qu’il a de lui même [Goffman, 1961, 64]. La prison dépossède les détenus du temps et de
l’espace.
Dans les témoignages de ces hommes, l’idée du temps perdu revient constamment, ce qu’ils
ratent et ce qui leur manque est prégnant ; la paternité en prison est une suite de ratés et de
pertes.
« Comment vous vous sentez ? le 25 c’est l’anniversaire de mon fils, ça me marque de plus en plus, ça fait trois ans que je suis là. Ça me manque de ne pas le toucher, de ne pas le sentir. Et je ne peux pas, il a bientôt trois ans et quand je vais récupérer ce temps ? Le temps est perdu. A six ans il va aller à l’école. Il va grandir même si ça reste mon fils. Je vous dis la vérité. La dernière fois je me suis senti mal, je pense à lui de plus en plus, c’est mon fils, je l’aime. Je voulais un enfant pour profiter de son amour et lui donner ce que je n’ai pas eu. Et y a cette histoire, vous voyez comment la justice brise des vies. » [Angelo, 36 ans, séparé, 1 enfant, 28 mois]
Une prise de décision qui n’existe plus : se sentir irresponsable
L’incarcération marque une prise en charge administrative de l’individu [Rostaing,
1997, 134] qui le dépossède malgré lui de sa propre vie. Dépossédé de son moi antérieur, le
détenu devient vulnérable et dépendant de l’institution carcérale. La réduction de l’autonomie,
l’assujettissement dont il fait l’objet le prive de sa capacité à définir ses propres besoins.
Prendre en charge les besoins de ceux qui sont dehors devient alors malaisé. Il se produit un
phénomène d’infantilisation [Ibid, 1997].
« L’acteur est sommé de se responsabiliser, alors que, simultanément, il est dépossédé de
98
toute autonomie et toute indépendance, en même temps que différentes techniques de
mortification et la mise en place d’une surveillance intime mettent à l’épreuve son
autocontrôle et menacent son expressivité. » [Chantraine, 2003, 374].
L’incarcération a une prise totale sur le détenu et transforme toute démarche en un parcours
du combattant. Il devient difficile de se projeter dans la durée et d’endosser son rôle de parent
[Le Queau et Al, 2000]. Dans ces conditions, comment un détenu conserve t’il une prise sur
l’extérieur et sur ses enfants?
Le fonctionnement de l’institution carcérale ne favorise pas de suivi. Les appels téléphoniques
sont limités par des horaires, de 8h à 17h à Liancourt et durant le temps de promenade à
Fresnes de 9h à 11h et de 14h à 16h. Un temps qui n’est pas en adéquation avec une journée
d’école ou de travail. Aucun appel ne peut être émis de l’extérieur vers l’intérieur - sauf par le
biais d’un tiers : standard, CIP... mais la transmission de l’information ne sera pas immédiate
- s’il survient un incident. De même pour les parloirs qui ne sont pas quotidiens et qui ne
permettent pas de répondre à une décision immédiate.
« Quand Linda prend des décisions elle t’en parle ? Non je crois qu’elle prend ses décisions depuis le temps que je suis là, je suis au courant de presque rien, ça y est c’est comme si je servais à rien, j’ai pas le choix, je vais pas la forcer, je ne sers à rien, je suis un boulet un peu. Vous en parliez ensemble ? Y a pas trop de communication bizarrement. Avant on parlait un peu plus, je ne sais pas. Avant je faisais ma vie j’étais jeune. Tu ne te sentais pas trop jeune pour avoir des enfants ? Pour moi j’étais prêt mais en vérité j’étais pas prêt, normalement pour être prêt faut avoir stoppé les trucs illégaux, j’étais encore dans mon délire. Tu aimerais les prendre ces décisions ? Bah oui j’aimerais, elle les prend après elle me dit, elle me dit pas. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
Jawad est toujours en couple mais la durée de sa peine lui a progressivement enlevé toute
prise de décision. La prison n’est sans doute pas le seul facteur, il avait vingt-cinq ans à la
naissance de son premier enfant, ce qui est relativement jeune et était dans le trafic de
stupéfiants jusqu’au cou. Il n’était pas vraiment prêt pour avoir des enfants et ne participait
probablement pas davantage aux décisions à cette époque. La prison a simplement contribué à
renforcer cet état de fait. Son manque d’implication passé et présent accentue son sentiment
d’inutilité et d’irresponsabilité. En se prenant pour un « boulet », il estime être une charge
supplémentaire pour celui qui est dehors.
La récurrence du terme de responsabilité dans les entretiens met en évidence le lien qui existe
entre paternité et responsabilité, ces deux termes vont de pair.
Etre incarcéré conduit à un effritement des capacités parentales. Dans ce contexte, la mère
assume l’essentiel de l’éducation de l’enfant, elle prend en charge le rôle du père. « Les
changements de rôles que connaissent les femmes quand leur partenaire est incarcéré révèlent
souvent des capacités inexploitées » [Tourault, 2009, 87] et s’avèrent positifs dans
99
l’autonomisation des femmes en dépit des pères qui perdent leur légitimité.
Il en va différemment pour les femmes détenues : « Les femmes sont plus conscientes de leur
perte que les hommes car jusqu’à leur incarcération, elles prenaient très souvent les décisions
de façon unilatérale malgré un exercice conjoint de l’autorité parentale » [Douris, Roman,
2014]. Rappelons qu’un quart des détenus ne connait pas les décisions prises par les mères à
l’extérieur1.
« On me tient au courant, je donne mon opinion mais les décisions quand on est incarcéré... Faut vraiment que la mère de tes enfants, t’aime. A Fresnes, elle le faisait, maintenant elle ne respecte plus vraiment mes décisions. J’ai peur qu’il y ait quelqu’un dans sa vie, je l’aime. » [Achour, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
Comme Jawad, Achour voit progressivement son rôle s’amoindrir, introduisant par la même
occasion, le doute dans sa relation. « La détention devient le cadre d’un imaginaire sur les
motivations, actions, pratiques, ressentiments éventuels des proches. L’incapacité à « savoir »
ce qu’il font, disent et pensent est récurrente à travers les discours » [Chantraine, 2004, 236].
Dans la deuxième partie de mon mémoire, j’ai analysé comment la relation conjugale
s’imbrique dans la relation familiale, une imbrication encore plus visible en détention. Le
détenu a peu de recours, de prise sur le dehors ; il est totalement dépendant du bon vouloir de
la mère pour maintenir des liens avec ses enfants. Quand les parents sont séparés, la prise de
décisions paternelle est presque toujours amputée ; le conflit du couple se répercute sur la
relation parentale.
« On ne se parle pas, elle ne répond pas à mes lettres, elle ne répond pas grand chose, je ne peux rien savoir. Elle prend toutes les décisions ? Oui elle les prend sans moi et je ne peux rien dire. C’est chiant par rapport à ça, je suis le père, j’aimerais donner mon avis mais elle ne préfère pas, elle ne veut surtout pas. Elle ne me pose même pas la question [...] je ne vais pas la critiquer mais j’ai plein de questions mais j’ai pas de réponse. Je ne peux rien savoir mais quand je serais dehors c’est sûr que j’aurai les réponses. Sa mère lui parle de vous? Elle n’en parle pas, je ne sais pas ce qu’elle dit, elle n’en parle pas tellement, j’ai posé la question à mon fils, elle ne parle pas de moi. Ça c’est compliqué pour qu’il prenne confiance en moi, il faudrait qu’elle parle de moi, un peu plus, qu’il voit que je suis son père, que je suis là, qu’il peut s’ouvrir à moi. J’ai l’impression qu’elle ne l’aide pas beaucoup qu’elle a du mal avec, c’est pour ça que j’attends de le revoir et d’en parler bien, petit à petit, qu’on s’ouvre. » [André, 38 ans, séparé, 1 enfant, 9 ans]
Derrière les barreaux, impuissant, André doit subir cette situation. Le conflit avec la mère lui
laisse craindre la disparition de son rôle. Comment être père si personne ne parle de lui ?
Quelle légitimité peut-il avoir auprès de l’enfant ? Il est totalement démuni face à cette
absence de dialogue et n’a pas d’autre choix qu’espérer des réponses lors d’une hypothétique
1 Chiffre donné lors du Colloque Liens familiaux et détention, à l’institut catholique de Lyon, le 11/04/14
100
prochaine rencontre avec son fils1.
« Et les décisions à prendre tu es au courant ? Je ne suis pas au courant, elle décide sans moi, des fois je me dis si y a un accident… je me demande si on va me prévenir. C’est mes enfants j’aimerais être au courant même si je suis incarcéré, c’est dur pour moi… Une fois, j’ai écrit à l’école et j’ai entendu dire qu’elle la mettait pas souvent à l’école donc j’ai écrit à la directrice pour avoir toutes les absences injustifiées comme ça j’ai une preuve pour les tribunaux, j’ai tout. » [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
L’incarcération représente un motif supplémentaire pour couper toute discussion, le détenu
n’ayant pas les moyens ni de se défendre, ni de faire pression sur la mère car il méconnait
généralement ses droits. Pour cette raison, Quentin conserve toutes les pièces dans le but
d’incriminer le comportement « négligent » de la mère. Ce manque de communication est
source d’une souffrance supplémentaire. Sera t-il informé s’il arrive quelque chose ?
« Vous prenez les décisions ensemble en ce qui concerne les enfants ? C’est vraiment dur, on ne discute pas, j’ai essayé mais elle a une certaine... je ne sais pas... une certaine haine, elle est obligée de crier. Ce n’est pas une personne normale, je ne peux pas la défendre, ce n’est pas toujours de ma faute, ce n’est pas pardonnable, le dialogue ce n’est pas possible, c’est vraiment dur. Et puis, par intermédiaire ça ne passe pas non plus. J’essaye de lui dire qu’on est grand, les enfants sont grands. Après je ne sais pas ce qui lui prend, c’est comme si c’était toujours un reproche envers moi, une jalousie alors que dans la réalité ce n’est pas moi qui suis allé voir ailleurs [...] c’est dommage, c’est ce qui a beaucoup gâché ma relation avec ma fille. » [Amed, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 3 ans]
A travers ces trois entretiens, nous percevons la difficulté de séparer le vécu du couple, du
lien familial. L’enfant devient un objet de négociation, de pression et le cœur du conflit.
Si le portrait de la mère parait parfois négatif, soyons conscients du coût psychique et
physique, de l’effort important qu’il faut pour maintenir les liens avec un père incarcéré. Il est
déjà difficile de préserver le dialogue en milieu ouvert ; alors, supporter la pesanteur carcérale
se révèle être un handicap supplémentaire.
Cette rupture de dialogue témoigne t-elle du peu de reconnaissance du rôle joué par le père
auprès de ses enfants ? Existe-t'elle pour préserver leurs enfants du milieu carcéral ? Désirent-
elles garder leur toute puissance maternelle ? Est-ce un moyen pour renverser la domination
masculine ? Ou une manière de se venger de la relation passée ? Quelles sont leurs
motivations pour rompre les liens? Des questions qui restent pour le moment sans réponse.
Une personne responsable est une personne qui a la charge de prendre des décisions.2
Le titre de cette sous partie laisse supposer que les détenus, privés de la possibilité de décider
se sentent souvent irresponsables et sont perçus comme tels par la société.
« L’istituzione carceraria dovrebbe avere il compito di ricondurre il soggetto sul proprio
percorso che gli permetta di realizzare la propria unicità. Il grande ostacolo è che il carcere è
1 Au jour de notre rencontre, il n’a pas vu son fils depuis cinq mois. 2 Définition du Larousse
101
un luogo che denuda l’individuo di tutto ciò che lo responsabilizza, come la capacità di fare
scelte da persone adulte1 » [Cacialli, 2013, 25].
Aujourd’hui, il existe une injonction à prendre des décisions ; les choix qui découlaient avant
des institutions reviennent désormais à l’individu mais cette faculté à choisir n’est pas
équitable.
L’instabilité de la vie de la plupart des détenus entraine des difficultés certaines à pratiquer
une responsabilité vis à vis des autres. Cette responsabilité à l’égard d’autrui, intimement liée
à la réflexivité et à la construction de l’identité personnelle, ne dépend pas uniquement des
capacités de chacun, elle est également soumise à des facteurs extérieurs.
A travers mes entretiens, un vécu négatif de la paternité s’est dégagé, provoqué par
l’impossibilité de la vivre pleinement et de répondre aux besoins des enfants.
Ce sentiment dominant d’incompétence, génère une souffrance dont le ressenti conduit les
détenus à effacer leur paternité pour surmonter leur détention.
Effacement de la paternité
« J’essaye de ne pas penser à dehors, je ne pense qu’à la prison, j’attends que ça passe. En fait la prison faut oublier l’extérieur, enfin pas totalement mais ça ne sert à rien, même entre nous en promenade on parle d’abord de l’intérieur puis après de l’extérieur, « tu as mangé quoi ? Une pizza, un gâteau ? ». C’est un moyen de survivre, de ne pas se faire du mal. La dernière fois en promenade, on était trois trafiquants de stups qui font des go fast en Espagne et on se disait par où on passe, comment on travaille, chacun à sa manière de faire [...] les hommes en général, ils parlent pas trop de leur famille. J’ai des enfants basta, surtout entre homme on parle de tout et de rien mais pas de nos familles » [Bilal, 33 ans, concubinage, 4 enfants, 34 mois]
Au début de mon étude, j’avais émis l’hypothèse que la paternité représente une
identité valorisante, mise en avant par les détenus pour se distinguer des autres. Je les
imaginais parlant de leur vécu de père pour fuir leur identité stigmatisée de détenu. Bien sûr,
j’avais conscience des souffrances que cette évocation peut engendrer mais j’ignorais que
certains pères utilisent des stratagèmes pour éviter d’y penser. Ma conception de la paternité
était avant tout positive.
Au contraire, sur le terrain, elle apparaît comme une faiblesse dans cet entre soi masculin où
la force et la virilité sont valorisées au détriment de l’émotion, de la douceur et de la
sensibilité.
1 Traduction de Marine Quennehen : l’institution carcérale devrait considérer comme son devoir de conduire l’individu incarcéré sur la bonne voie pour se réaliser dans sa propre singularité mais le fonctionnement de l’institution carcéral contrairement à sa vocation prive le détenu de ses responsabilités et ne lui permet pas d’opérer des choix adultes.
102
« Tu cherches à ne pas y penser ? Pour avancer, pour pas être déçu pour pas… je sais pas comment expliquer. C’est pour pas être déprimé que je me mets en mode prison sinon tu commences à réfléchir c’est pas bon. Tu cherches à oublier que tu es père ? Oui il faut que je me dise que je suis un détenu ou un prisonnier je me dis pas que je suis père, ici on est juste un numéro, on est pareil. Tu peux pas valoriser le faut d’être père ? Non ça sert à rien de le valoriser, on est tous pareils sinon la juge, la prison ils nous différencieraient et je serais déjà dehors. Je suis conditionnable, ils savent que j’ai des enfants, dès que je pose une demande, ils me refusent, ils en ont rien à foutre, que j’ai des enfants, que ce soit la première fois. Ici avec cette prison, ils ne te laissent aucune chance. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
« Quand on a des soucis on peut pas vraiment en parler. Sincèrement j’essaye de ne pas y penser quand j’en parle, c’est là que tout dérive, on essaye de ne pas y penser au maximum, c’est pour ça quand on dit que l’homme oublie, c’est nous qui effaçons, on essaye de pas se rappeler par où on est passé. On essaye de s’endurcir, mais là je ne vois pas l’intérêt, c’est une perte de temps. » [Chafik, 28 ans, marié, 2 enfants, 5 mois]
Pour supporter la détention, il est nécessaire de se concentrer exclusivement sur celle-ci, se
mettre en « mode prison » comme le dit Jawad. C’est une manière de s’endurcir pour survivre
face aux autres. L’objectif est de ne pas dévoiler ses faiblesses afin qu’elles ne se retournent
pas contre soi. Dans ces deux entretiens, les détenus font le choix délibéré de mettre à
distance leur paternité. Il y a un calcul des coûts et des bénéfices, en détention.
Dans les milieux populaires, les hommes traversent parfois des phases d’homosociabilité1 ;
leur intérêt réside essentiellement dans l’étalage de leur virilité. Cette construction identitaire
rejette tout aspect féminin « c’est-à-dire ceux qui sont pénétrés lors du rapport sexuel (les «
pédés », les « lopettes »...) et ceux qui sont trop faibles, trop peureux, trop sensibles...
«Devenir un homme, c’est donc apprendre à rejeter et à dévaloriser ce qui relève du féminin,
parfois par la violence» [Chabot, 2013]. La paternité n’est pas semble t’il constitutive de
l’identité masculine prônée dans les milieux populaires surreprésentés en détention.
A la différence des hommes issus des milieux favorisés dans la hiérarchie sociale qui « ont le
sentiment de ne plus avoir besoin d’affirmer leur virilité ou leur féminité, à part dans les jeux
de séduction » [Ibid, 2013]
Peut-être le faible niveau scolaire des détenus les pousse-t-il à penser que la paternité ne
représente pas un facteur de valorisation contrairement au travail qui permet une
reconnaissance sociale.
En multipliant les occupations au sein de la détention, ils tentent de tenir à distance leur
paternité pour ne pas y penser.
« Avec le temps disponible en prison, tu ne fais pas que penser à dehors? Non avec le travail on n’y pense pas, on voit la sortie se rapprocher, j’évite d’y penser. C’est vrai que quand on y pense c’est embêtant. Moi j’y pense pas, je peux pas savoir si ça gène ou pas. Je pense à autre chose. Quand je travaille je pense au travail et ce que je dois faire. Quand je suis en cellule je regarde la télé, je joue au
1 Nous pouvons rapprocher ce terme à celui d’entre soi masculin. Les hommes se retrouvent dans des espaces qui leur sont réservés et ils vont mutuellement s’apprendre les codes typiquement masculins : force, courage, virilité...
103
jeu, je fais plein de choses, j’essaye de ne pas y penser. Moins j’y pense, mieux je me sens. C’est vrai qu’on y pense en restant enfermé mais après on ne se sent pas bien. Tu essayes d’effacer ta paternité pour te sentir mieux ? Un petit peu mais pas trop. Tu te dis pas tous les jours que tu es père, je suis père mais voilà, mais j’y pense pas tous les jours [...] Ne pas avoir de nouvelles ça joue beaucoup. Y a pas grand chose à dire, je pense pas à grand chose, j’évite de trop y penser en ce moment. Je préfère vivre au jour le jour plutôt que penser trop à ça, ça nous met mal à l’aise par rapport à la prison, si on pense de trop on faiblit. On se renferme sur nous même. Après on nous met de côté, les détenus vont plus rigoler avec toi, faut éviter de trop penser. Effacer pour avancer ? Voilà. [André, 38 ans, 1 enfant, séparé, 9 ans]
« En ce moment je me recentre sur le sport pour ne pas y penser. En faisant du sport, j’y pense moins, je fais des abdos, des pompes...travailler le corps » [Angelo, 36 ans, séparé, 1 enfant, 28 mois]
Le sport, le travail, les activités représentent des moyens efficaces pour combler le vide creusé
par l’absence de leurs enfants ou d’oublier qu’ils ne sont pas les pères qu’ils souhaiteraient
être. Etre célibataire et sans enfant s’avère un statut plus favorable en prison et contribue à
amoindrir la longueur de la peine.
« C’est valorisant en prison d’être père? Au contraire vaut mieux être célibataire. C’est eux qui subissent le moins, c’est un manque d’être père, je ne sais pas comment pensent les autres mais pour moi faut que je fasse avec et je dois me remettre en question par rapport à eux, je sais qu’ils vont vouloir me poser des questions. » [Thierry, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
« Parfois tu préfères ne pas penser à tout ça? Quand je me lève, je pense, quand je dors je pense. On ne peut pas. Ceux qui n’ont pas d’enfants c’est facile, ils pleurent pour leur copine. Si je n’avais pas d’enfant je ferais quarante ans de prison, c’est pas grave la prison. ça devient une routine, on s’habitue. Là ça fait quatre ans, il me reste trois ans, je vais les faire, c’est horrible de dire ça mais je m’en fou, si je cherche à sortir c’est pour ma fille. » [Romain, 26 ans, séparé, 1 enfant, 4 ans]
Etre père, implique ne pas juste penser à soi même, égoïstement. La prison vue par Romain
est une routine à laquelle on s’habitue et qui n’est réellement insupportable qu’en ayant des
attaches à l’extérieur. L’effacement de la paternité s’avère une stratégie incontournable pour
supporter plus facilement la prison. Appréhendé sous cet angle, le côté négatif de la paternité
ressort, en détention ; pourtant par d’autres aspects, celle ci apparaît également comme un
point d’appui ou d’ancrage essentiel.
C. LA PATERNITE, UN POINT D’APPUI
Attachement affectif, complicité et fierté
« Je me sens père même si je ne suis pas là 24 heures sur 24 avec eux mais je suis toujours là mais ils ne pourront pas dire que je les ai abandonnés. Comment vous définiriez un père ? Je pense que c’est la plus belle chose de ma vie et je dirai que ça nous rend un peu plus réfléchis, responsables malgré qu’on soit en prison… oui responsables. Et puis moi c’est dans la continuité de ma famille aussi, une fierté oui c’est vraiment une fierté d’être père. C’est la plus belle chose qu’on puisse accomplir d’être père. » [Cyril, 45 ans, séparé, 2 enfants, 3 ans]
104
A travers mes entretiens, la paternité apparaît, avant tout, comme une démarche
personnelle [Castellain, 1997, 68] Les liens affectifs ne sont pas garantis au départ mais se
construisent au fil des interactions, « au gré des circonstances de la vie, dans un processus de
« coconstruction » » [Bedin, Fournier, 2013, 187]
Malgré les histoires douloureuses, les séparations et les incarcérations qui jalonnent une vie
fragmentée, les enfants des détenus occupent une place prépondérante dans leur vie. Ils en
parlent toujours avec émotion et en dépit de leur absence, ils pensent à eux. Ils se préoccupent
de leur santé et de leur devenir. « Ils sont attentifs à leur personnalité, à leurs façons de se
comporter dans telles ou telles situations. Ils en sont fiers et les admirent » [Ouellet, 2006,
165].
La situation d’enquête les a autorisés à verbaliser ce qu’ils éprouvent à la pensée ou au
contact de leurs enfants. Leurs discours sont étayés « de gestes, d’évènements, d’activités et
d’opinions laissant supposer une présence d’ordre relationnel, faite d’attention et d’écoute à
l’enfant, de soins, d’activités ludiques et éducatives, un intérêt pour la transmission de valeurs
et de connaissances » [Ibid, 2006, 168].
« Quand est ce que tu te sentais le plus père ? Je vais dire à tout moment parce que mes préoccupations étaient tournées vers mon fils. Quand je recevais ma paye, la première des choses c’était la pension alimentaire, c’est la première chose que je paye. Si je le reçois vendredi, le samedi elle l’avait entre ses mains. Quand il venait le week-end je me rappelle on mangeait tous les deux, j’avais fait des frites, des haricots et une entrecôte. Il en avait une plus petite. Il m’a demandé encore de la viande et je lui ai coupé la mienne et quand il a le ventre plein je me sens plein. Quand il vient tout est prêt pour lui. Et pour le relationnel j’aime savoir ce qu’il pense, j’aime pas le forcer. Je me rappelle, je l’emmenais à la piscine, il n’aimait pas mettre la tête sous l’eau et jamais je l’ai forcé. Je voulais minimiser les traumatismes. C’est dur à expliquer, y a des choses avec mon fils qui coule de source, c’est naturel, je vis ma paternité comme un devoir, c’est un fait, c’est mon fils. Comment tu définirais ta relation avec lui ? Fusionnelle, on est très affectif, on m’a qualifié de papa poule, je lui accorde de la liberté, il a tout ce qu’il mérite. Je suis très câlin, je ne lui dis pas juste bonjour, je lui fais un bisou. Quand je conduis, on converse jusqu'à ce qu’il s’endorme. Je le chambre, il n’a pas du mal... quand on joue, il saute sur moi, je ne sens pas un sentiment de réticence vis-à-vis de moi, il n’hésite pas à venir vers moi malgré ce que j’ai vécu avec sa mère. Quand je le ramène le week-end il reste longtemps à me dire au revoir et il m’appelle avant de dormir, il pleure car je lui manque. Chaque fois que je faisais un petit achat, il venait avec moi. Quand on marche, il me prend la main. Je me suis dit si un enfant il a peur il ne vient pas vers toi. C’est pas pour me rassurer mais je pense qu’il est épanoui et c’est pour ça que sa mère favorisera pas la rupture, ce serait pas que dur pour moi mais aussi pour lui. » [Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois]
A travers les souvenirs du repas et de la piscine, nous percevons l’importance du partage et du
bien être prioritaire de l’enfant. Etre père c’est s’engager et répondre aux besoins de l’autre,
en étant à son écoute. La paternité engendre la notion de devoir. Quand Eliot explique que
cela « coule de source, que c’est naturel », il évoque l’idée d’instinct naturel alors que ce
sentiment de compétence se développe progressivement grâce à des actions directes. « Le
105
plaisir ressenti au contact de l’enfant et le sentiment de réciprocité [...] contribuent au
développement de l’attachement autant que le sentiment de compétence [Allard, Binet, 2002,
42].
L’entretien offre également un moyen pour ce père de mettre une distance entre violence
conjugale et désamour filial. Il marque la différence entre le comportement agressif dirigé
contre son ex femme et sa capacité à écouter, prendre soin et aimer son fils. Les termes
« affectif » « fusionnelle » relèvent d’une volonté et d’une aptitude à exprimer les sentiments
ressentis à l’égard de son enfant. Cyril et Eliot sont fiers d’être pères et imaginent que
l’accomplissement de leur vie dépend de leur paternité.
Le parloir, les UVF, les permissions permettent de remobiliser l’affection et la complicité.
Ces lieux offrent la possibilité de refaire le « plein » d’affection.
« La première fois où j’ai vu mes enfants au parloir, je les ai pris direct dans mes bras, la deuxième fois j’ai pas pleuré et ma fille me l’a fait remarquer car à Noel, ça faisait deux mois, j’ai craqué et eux aussi, c’était émotionnellement très fort. On a parlé de tout, de leur école, du copain de ma fille, hé oui elle a un copain, c’est la première fois, elle a beaucoup de pudeur, c’est un cas unique par rapport à sa génération, elle n’est pas olé olé, elle est très pudique, très sélective, elle ne prend pas le premier venu, elle est très rigide. Ça a commencé à Noël, il est dans sa classe et ses parents sont dans le domaine juridique, père juge et mère au ministère. Enfin voilà, j’ai des enfants bien éduqués avec des principes alors tout va bien. [...] j’avais peur qu’elle m’en veuille surtout après la promesse de 2010 et dès la première lettre elle m’a dit qu’elle me soutenait, qu’elle était là et je lui ai dit que j’étais soulagé qu’elle m’écrive, qu’elle ne soit pas en colère. Au départ on communiquait par écrit et elle m’a répondu qu’elle ne pouvait pas être en colère car j’étais son papa, qu’elle était fière de son papa, que j’étais le meilleur. [...] mon absence a changé le quotidien de mon fils, j’étais plus présent que sa mère, on allait au tennis, j’étais toujours avec lui quand je ne travaillais pas, je ne faisais pas de trafic. Mon temps libre, il était pour mes enfants donc voilà. [...] j’ai vraiment de magnifiques souvenirs avec eux. Je me rappelle on était en Turquie, on faisait du parachute ascensionnel. On était en l’air et je lui avais lancé une blague par rapport aux gens en dessous. Je peux pas le dire c’était entre nous, c’était exceptionnel son expression ! Il était joyeux, c’était à voir, son expression de joie, heureux comme un gamin, heureux de vivre et je pense souvent à ce passage là et je me demande pourquoi je suis ici. [...] je pense à tous ces moments quand je suis seul dans ma cellule et c’est dur de penser à tout, de savoir qu’on est là comme un con. » [Laurent, 38 ans, marié, 2 enfants, 8 mois]
« Le dernier parloir enfant que j’ai eu je suis descendu avec des mars et tout et j’ai tout caché. Il y a des poufs, y’a pas de barrière1, on s’est embrassé on s’est fait des petites caresses, on courait dans la pièce et il me disait papa Yahoo. Et quand je pars je l’entends pleurer, j’avais les boules, j’ai essayé de faire demi-tour mais je ne pouvais pas. [...] j’ai envie de sortir de le voir avec sa casquette, ses lunettes. J’ai envie de l’amener à la foire, aller à l’aquarium. C’est des trucs que je n’ai jamais fait avec mes parents. Les vacances c’était, ils nous envoyaient dans la savane alors l’aquarium, le zoo, voir mickey... […] Putain ça fait quatre mois que j’ai pas pu marcher avec, j’ai envie de manger des glaces, l’emmener à la piscine, à la mer. Je l’ai emmené à la piscine la dernière fois pffff, je vais lui mettre des trucs au bras et son bonnet...Avec sa touffe (il bouge sur sa chaise, ne tient plus en place, il est excité) elle (sa compagne) sait pas quoi faire avec ses cheveux. Roh, il aura deux ans le 7 septembre. » [Kyllian, 30 ans, en couple, 2 enfants, 4 mois]
Le parloir, lieu communicationnel par excellence, s’avère un lieu chargé émotionnellement où
1 Les parloirs de Fresnes font approximativement 2m2 et sont coupés en deux par un muret – ce qui est aujourd’hui interdit par la loi – au contraire les parloirs enfants sont plus grands et permettent de se toucher sans difficulté.
106
l’on passe du rire aux larmes. La confrontation permet la reprise de la relation et des contacts
physiques et souligne l’importance du toucher à travers les bisous, les caresses ou les
accolades. Les entretiens révèlent ce manque criant de contact « peau contre peau » et la
réappropriation par les détenus des gestes simples et démonstratifs de leur affection au cours
de ces interactions. Le contact physique symbolise la figure d’attachement et encourage la
formation, la reconstruction ou la restructuration de l’identité paternelle, [Airaldi, 2007, 11].
Ces retrouvailles marquent une consolidation des liens affectifs et renseignent les détenus sur
la place conservée auprès de leurs enfants.
Malgré sa pudeur, la fille de Pascal profite de ce moment suspendu dans le temps pour lui
confier sa première relation amoureuse. Cette confidence figure un des « eventi di forte
intensità emotiva legati ai grandi passaggi dell’esistenza 1» [Ibid, 2007, 12] vécu comme
parent. Il légitime le rôle du père qui est d’« accompagner son enfant, dans son chemin de vie
où se mêlent angoisse et désir de grandir, souffrance et plaisir » [Le Roy, 1996, 11].
Ces deux entretiens évoquent des souvenirs de parloir et retranscrivent la façon dont les flux
émotionnels provoqués par ces retrouvailles dérivent sur des souvenirs pré-carcéraux. Kyllian
exprime à la fois l’excitation et le plaisir de retrouver son fils mais également la profonde
tristesse de perdre un temps précieux en prison. Le parloir concentre une palette de sentiments
contradictoires, il marque dans le même temps le plaisir des retrouvailles et le ressenti de tout
ce qui manque aux détenus.
« Pour moi la première chose pour être père c’est être responsable, déjà de soi même, je ne le suis qu’à moitié, alors je suis responsable d’eux mais bon. Et après j’essaye de trouver des réponses à leurs questions mais c’est dur. Il faut vraiment que je sois responsable. J’aime être présent pour eux, être à leur écoute, je n’ai jamais négligé leur parole, j’ai toujours été à l’écoute de mes enfants. Cela fait partie de ma responsabilité. J’ai envie de les accompagner partout, être présent quand ils font du sport, pouvoir les aider dans leurs études et les démarches qu’ils devront faire. J’aime être présent pour eux, leur faire des câlins. Pour moi, être père ça veut dire tellement de trucs mais c’est avant tout être responsable, si tu n’es pas responsable, tu n’es rien. En repensant à tout ça, tu apprends des choses, tu te rends compte.... tu te rends compte que tu aurais dû faire comme si comme ça. » [Amed, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 3 ans]
« Je les aime bien petits, pas que je les aime pas grands mais je suis paternel, j’aime changer les couches, donner le biberon. Plus grands, c’est pas pareil, je les aime petits. Quand ma concubine donnait le sein j’étais malheureux, j’adorais me lever la nuit et ça a toujours été comme ça, je suis peut être un peu fou. Même si c’est vrai que Charline, je m’en suis pas occupé, même ma dernière, pas le premier mois, elle était trop petite mais après c’était moi qui donnait le bain, c’est des poupons et puis après tu entends les premiers mots et après ça fout le bordel. Ça me dérangeait pas de faire ma journée de travail et me lever en pleine nuit. [...] C’est quoi ton meilleur souvenir? Le jour où mes enfants m’ont appelé papa. La première, on chahutait sur le tapis de sol et ma concubine elle disait maman maman maman et moi je disais papa et elle a dit papa, c’est moi qui a gagné. C’est le plus beau souvenir quand les enfants se mettent à parler. Et puis quand mon fils est né et j’ai vu que c’était un garçon. » [Thierry, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
1 Évènements de forte intensité émotive liés aux grands passages de l’existence, Traduction de Marine Quennehen
107
Etre père ne se limite pas à un simple rôle, c’est la somme de très nombreuses activités, de
prises en charge et d’une capacité quotidienne à se représenter comme tel [Bedin, Fournier,
2013, 109].
Le terme de « travail parental » définit le rôle de parent à travers des pratiques (occupation
matérielle) et une charge mentale (préoccupation, disponibilité) [Verjus, Vogel, 2009].
Le désir de ces pères de s’investir auprès de leurs enfants et d’essayer de bien faire est bien
réel. La volonté de Thierry à prendre en charge la petite enfance ne relève pas d’une
féminisation de sa part mais d’un profond désir de paterner avec ses propres spécificités
[Neyrand et Al, 2013]. « C’est paterner qui les rend pères » [Gross, 2013]. L’épisode du
premier mot, pointe l’importance d’être reconnu par son enfant et la fierté d’être le premier à
l’être.
La notion de responsabilité, récurrente dans les extraits de Thierry et d’Amed, démontre
l’importance de la prise en charge du bien-être de l’enfant. Comme dans l’étude de Devault,
ces pères remettent en question leurs propres actes avec le souci de fournir un meilleur
modèle à leurs enfants. Rien ne permet de suivre l’évolution de leur motivation dans le temps
mais « ces résultats appellent à la prudence vis-à-vis des jugements hâtifs et négatifs dont sont
l’objet de nombreux pères » [Devault, 2005, 63].
Malgré leur absence au quotidien, les enfants représentent beaucoup pour leurs pères détenus
qu’ils s’en occupaient ou pas dehors. Dans un contexte compliqué, « les enfants constituent
souvent la seule richesse possible et certainement : un des supports privilégiés de la
réalisation de soi » [Paugam, 2009, 187].
Soutenir financièrement : « C’est l’argent qui solidifie l’amour »
L’argent est « le nerf de la guerre » comme l’affirme Nestor ! Au cours des entretiens
le sujet est, en effet, récurent : avoir de l’argent pour ses enfants, trafiquer pour subvenir à
leurs besoins ou subir la honte de ne pas les soutenir financièrement. Certains détenus
parviennent à envoyer de l’argent à leur famille malgré leur détention et ressentent un
sentiment de fierté qui minimise leur « inutilité ». Être un soutien financier fait toujours partie
des représentations bien ancrées de la paternité. Sans cette contribution, ils perdent leur statut
paternel et le respect.
« Selon Zaouche-Gaudron (2006), le modèle de père engagé (non seulement nourricier, mais
108
aussi éducateur, disponible et sensible), qui remplit une fonction similaire à celle de la mère,
serait celui des milieux favorisés et il pourrait mettre à mal la population des pères
défavorisés pour lesquels "faire vivre sa famille" est une dimension constitutive de l’identité
paternelle fortement marquée » [Chabot, 2013]. La division sexuée traditionnelle semble plus
marquée dans les milieux populaires.
« Aujourd’hui mon devoir… malgré la prison, je fais en sorte qu’ils manquent de rien. Je lui envoie une pension alimentaire. Je leur envoie trois cents euros, depuis vingt huit mois, mais dehors aussi j’ai envoyé plus de 2500€. [...]Quand je sors en permission je les vois, on va au Mac Do et on va acheter des jouets. Pour quelles raisons vous leur en achetez à chaque fois ? Ils demandent, un enfant qui n’a pas de jouet dans son enfance, il n’a pas une bonne enfance. Moi je n’ai pas connu les jouets, les anniversaires. A sept ans j’étais orphelin, si aujourd’hui je peux donner, c’est la moindre des choses.[...] Quand je vais acheter un jouet je ne demande pas son avis, ils savent ce qu’ils veulent. Je lui ai pris une Playstation avant l’incarcération. C’était nécessaire ? Oui il avait besoin d’un truc pour savoir que c’est papa qui lui a acheté ça. Il va pas l’oublier, il ne peut pas oublier mais si c’est des vêtements, y a des choses que les enfants oublient pas, c’est important. Il oublie pas la voiture, il ne va pas oublier la poupée, il sait que quand son papa a de l’argent il lui achète et quand j’en ai pas ils comprennent. J’ai su gérer la relation avec mes enfants. Quand il m’a dit « papa tu ne m’achètes rien » et du coup j’ai dû lui acheter des trucs. Par exemple, le casque, le jeu. J’ai gardé les reçus pour montrer à la juge que je m’occupe de ma famille malgré que je suis en prison alors si demain mon fils me dit que j’achète rien il est ingrat. [...] L’argent c’est important pour toi ? On ne peut pas vivre sans argent. C’est l’argent qui solidifie l’amour, il le rend plus sucré. Si je ne pouvais pas faire tout ça, c’est sûr que la mère de mes enfants aurait quelqu’un d’autre, je m’occupe d’elle, elle a du respect. L’argent ça me rend aimable et estimable. Avant mon jugement, j’avais plus d’argent et elle m’a lâché. Ça signifie quoi d’être père sans argent ? On ne peut pas, l’argent c’est le nerf de la guerre, c’est l’argent qui fait tout dans la vie. Avec l’argent on devient beau. Pour les élever, il faut de l’argent sinon ils mangent au resto du cœur, comment tu payes les factures, comment ils font s’il y a pas d’argent, ils vont voler. Sans argent, ils ne s’en sortent pas. On a la sécurité, ça fait que l’enfant vous respecte, il vous écoute. Si l’enfant te dit « tu n’es pas gentil, tu ne m’achètes rien » il te dira « laisse moi tranquille ». Tu gagnes ton pass de père grâce à ça. Son papa c’est quelqu’un. » [Nestor, 40 ans, concubinage, 3 enfants, 28 mois]
« Nous ne pouvons vivre sans argent » rien de nouveau dans cette affirmation ! Pour
Nestor, l’argent qu’il donne, les jouets qu’il offre sont constitutifs de son droit à être père.
L’argent permet d’obtenir amour et respect. En achetant des présents à ses enfants, il gagne
son pass de père. L’argent compense-t-il son absence ou représente-t-il un moyen d’acheter
l’amour de ses enfants ? Les jouets achetés sont supposés marquer les esprits des enfants et
jouer un rôle de souvenir. Cette position de Nestor face au pouvoir de l’argent est sans doute
influencée par son vécu au Cameroun où assurer le soutien financier de sa famille est à la base
de l’existence.
Bloss ajoute : « plus les parents ont des ressources matérielles et culturelles plus ils veulent et
peuvent maintenir les relations avec leurs enfants. La capacité de jouer son rôle de parent,
surtout chez les hommes, est liée à la capacité de subvenir aux besoins matériels de l’enfant
après la rupture du couple » ou malgré la prison [Bloss, 1997].
L’argent solidifie-t-il vraiment l’amour ? Rend-t-il Nestor plus aimable et agréable à l’égard
de sa femme et de ses enfants ? La valeur de l’argent aux yeux du détenu est
109
vraisemblablement d’autant plus importante qu’issu d’une famille de cinq enfants il a connu
le manque de moyens dans sa propre enfance.
« Tu te sens plus responsable depuis que tu as un enfant ? Je me dis qu’elle est seule avec l’enfant, que je me dois de travailler et j’essaye de lui envoyer des mandats même si elle n’a pas besoin, pour qu’il ait des petits cadeaux, je ne veux pas qu’il soit en galère. [...] Je dirais que je suis un père câlin, généreux car franchement je lui envoie beaucoup, je ne dépense pas beaucoup pour moi, je suis fier de moi, si je sais qu’il manque, je me sens plus mal que si c’est moi qui suis dans la galère. Je suis un père, je suis là, oui je l’aime. Je lui donnerai ma vie mais j’aimerais travailler, ramener de l’argent, je sais que c’est dur, je connais des familles qui ont du mal à finir les fins de mois. Elle a une paye au début du mois et moi je complète la fin. J’essaye de faire mon rôle de père même si je ne suis pas là et que je ne sers pas à grand chose. » [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
« Malgré les transformations récentes de la paternité, le fait d’être pourvoyeur demeure une
des dimensions socialement valorisées de la paternité (Dulac, 1993) » [Allard, Binet, 2002, 8]
Timur valorise également cet aspect, il préfère se priver plutôt que de laisser son fils manquer
de quoi que ce soit. Il culpabilise de ne pas travailler et de ne pas subvenir suffisamment aux
besoins de son enfant. Il se rassure en complétant les fins de mois. A titre d’information, un
salaire à l’atelier de la prison oscille entre cent cinquante et deux cents cinquante euros… En
amputant une partie de sa paie, il diminue d’autant son confort en détention et se prive (tabac,
hygiène, denrée alimentaire, téléphone...)
Certains détenus justifient la pérennité de leur trafic en détention pour subvenir aux besoins
de leurs enfants :
« Quand j’avais trois parloirs par semaine, je faisais rentrer deux téléphones par semaine, je les vendais minimum deux cents euros donc j’avais à peu près 1600 euros par mois, tu enlèves 240 euros donc à peu près 1350 euros par mois. Maintenant, j’ai plus que quatre parloirs par mois donc ça va me faire un petit billet de 800-900 euros par mois. Ça me fait mes mandats pour ma femme et mes enfants, comme ça je ne sers pas à rien, ça l’aide un peu. Y a des mecs qui ont rien et qui en plus demandent à leur femme. Donc je m’en sors bien, je suis un vrai commercial. » [Bilal, 33 ans, concubinage, 4 enfants, 34 mois]
« C’est pas parce que je suis en prison que je ne fais pas de fric. Je fais des blocs et je sors 500 euros par semaine, y en a que je paye avec ça. Même en prison tu fais de l’argent, cent euros les dix grammes, tu te fais plus que le surveillant, y en a beaucoup ils mangent la gamelle ici. [...] Tu lui donnes de l’argent ? C’est obligé, c’est pour qu’elle vive, pour qu’elle grandisse. C’est important c’est obligé, tu peux tu peux pas mais si tu as pas c’est que tu es un crevard, ça fait chien de la casse, y en a qui payent pas de pension moi je lui donne huit cents euros par mois. » [Romain, 26 ans, séparé, 1 enfant, 4 ans]
Bilal et Romain sont tous deux multirécidivistes dans le trafic de stupéfiants. Malgré
l’annonce de leur souhait de se ranger, ils prennent toujours autant de risques. Avoir de
l’argent est tellement ancré dans leur schéma de pensée qu’il paraît inimaginable d’arrêter
leurs trafics même en prison. Ils justifient leur business par le don pour aider femmes et
enfants. Soutenir financièrement est obligatoire : la famille est par excellence le lieu de
sociabilité fondé sur la dette [Cermet, 1994].
Une meilleure accessibilité au travail et la réévaluation des salaires en détention
110
permettraient à davantage de pères d’être utiles en participant aux besoins de la famille.
Cette position de pourvoyeur, bien plus que d’autres fonctions, apparaît comme essentielle
dans la constitution de leur identité paternelle.
La paternité entre soutien mental et soutien identitaire
« Tu te sens plus père ou père détenu ? Plus père parce que père c’est pour la vie c’est pas quelque chose de voulu, tu te dis pas « demain tu vas être détenu ». Détenu c’est tu vas payer ta dette, alors que père c’est toi qui l’a choisi. Tu peux avoir des enfants et pas être père, si tu ne t’en occupes pas. Père c’est une responsabilité, une lourde responsabilité, avoir des enfants c’est donné à tout le monde. Des relations sexuelles, pas de préservatif, tu lâches la purée et voilà. » [Bilal, 33 ans, concubinage, 4 enfants, 34 mois]
« Tu te sens plus père ou père détenu ? Père parce que la prison c’est temporaire, on va dire que c’est un entracte négatif dans mon rôle de père mais pas définitif, c’est temporaire. Y a des moments où c’est dur pour moi, c’est quelque chose que j’ai jamais connu, de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas savoir comment ça se passe. Je suis un père détenu mais je suis un père tout court. » [Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois]
La paternité transcende-t-elle le statut de détenu ? Les autres identités – mari, fils,
frère... – ont-elles le même impact ? Engagent-elles autant ? Probablement pas. La paternité
par son fort engagement domine toutes les autres positions.
L’extrait d’entretien de Bilal pointe la différence entre détenu et père, la temporalité du
premier s’oppose à l’engagement à vie du deuxième. Il distingue également le père géniteur et
le père engagé, parenting and parenthood. Les deux détenus sont pères avant tout et rien, ni la
prison ne pourra le leur enlever même si elle les contraint à une distance avec le dehors et à
une diminution de leurs capacités parentales.
« Quand est-ce que tu regardes les photos ? Tous les jours quand je n’ai pas travail, le soir je fais une bise à lui et à sa mère, à ma mère depuis que j’ai appris la nouvelle. C’est le rituel le matin, le soir, je leur dis bonjour, comment vous avez dormi, comment vous vous êtes réveillés ? Je leur parle même quand je passe à table, je leur dis merci comme s’ils m’avaient dit bon appétit. C’est une présence ? Oui c’est pour savoir qu’ils sont présents, j’ai besoin de ça. Avoir des photos ça sert à rien de juste les regarder, j’ai besoin de leur parler, même si je suis conscient et réaliste. Je lui dis je t’aime même si je suis conscient qu’elle a refait sa vie. On ne tourne pas la page comme ça. Je lui parle tout le temps, je lui dis qu’il me manque que je l’aime et elle aussi je lui pose des questions pour savoir où est la femme que j’ai rencontrée. Ça peut vous paraître bizarre. Je veux garder un lien avec eux même s’ils ne sont pas là. Les photos c’est un lien. J’en entends beaucoup qui disent que les photos ça fait mal parce que je ne suis pas à côté mais si j’avais pas les photos avec, je ne sais pas...sans les photos je me sentirai plus mal » [Angelo, 36 ans, séparé, 1 enfant, 28 mois]
« Et comment tu fais pour ne pas déprimer ? Je joue à la Play, je regarde la télé ou je parle avec des potes. Ici je connais personne ils sont tous d’à côté. Je parle avec eux j’ai pas le choix sinon je parle avec le mur mais en cellule ça m’arrive de parler aux photos, à mon fils, je lui dis « attend papa, papa arrive, il va sortir ». C’est une présence ? Oui franchement oui. Tu te dis qu’il peut t’entendre ? C’est probable, peut être qu’il ressent l’amour d’un père. Quand il est né je ne le lâchais pas, j’étais toujours avec lui. J’avais
111
30 ans quand je l’ai eu, j’y ai réfléchi je trouvais ça presque trop tard, normalement tu commences à 26 ans, 30-40 ans c’est trop tard. » [Riad, 34 ans, séparé, 1 enfant, 3 ans]
La souffrance engendrée par la séparation conduit certains détenus à mettre en œuvre des
stratégies pour combler l’absence de leur famille. Parler aux photos fait partie des pratiques
qui procurent un soutien psychologique. Les images donnent un sentiment de présence.
Comme une prière, les paroles prononcées communiquent des émotions contenues. Les
échanges ne sont plus physiques mais se développent dans l’imaginaire. La déconnexion du
réel et l’absence de contacts physiques privent le détenu de son histoire familiale, il
n’appréhende plus l’évolution de ses enfants et continue de parler d’eux comme s’ils
n’avaient pas changé depuis son arrestation [Caciali, 2013].
« C’est un soutien de les avoir, ça me permet de ne pas me sentir abandonné, si c’était le contraire je me sentirai abandonné. Je suis bien content que ça se passe comme ça, je connais des cas complètement différents où les mecs se tapent la tête contre le mur. » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
La paternité constitue parfois une ressource pour mieux supporter l’incarcération.
Normalement, le rôle d’un parent consiste à soutenir son enfant dans les épreuves de la vie
mais avec la détention les rôles s’inversent et l’enfant devient le soutien de son père. La
différence entre valorisation et survalorisation de l’enfant est ténue. Certains pères
instrumentalisent leurs enfants qui représentent une de leurs rares ressources pour adoucir la
détention. Ils s’inventent des souvenirs rassurants, peu réalistes, parfois exagérés pour s’offrir
quelques espaces de liberté. Un enfant signifie, dans le même temps, une raison d’espérer et
un objectif pour garder espoir. Malheureusement certains détenus comptent sur leurs enfants
et ceux ci comptent pour eux tant qu’ils sont en détention mais dés lors qu’ils sont libres, ils
agissent comme s’ils n’existaient plus. [Weissegerber, 2005, 3]
« Ça a changé quoi la prison ? Je resterai plus avec mes enfants et les écouterai davantage. Je crois que je les aime encore plus qu’avant, je me dis qu’il faut que je me batte pour eux. Depuis que je suis ici, j’ai pas changé je suis resté le même mais dans ma tête ça a changé, faut que je sois plus posé. Ma femme elle faisait tout, je l’aidais, on était compatibles. Là, ce qui a changé c’est que je dois plus être un gamin, faut que je sois un homme, ce n’est pas de la rigolade la vie. C’est bien à un moment mais là c’est plus possible, faut que je me calme, la prison m’a mis une bonne baffe. » [Andreja, 32 ans, séparé, 3 enfants, 6 mois]
« Le besoin de reconnaissance sociale et d'affirmation de soi existe chez tout être humain,
mais il est sans doute plus visible encore, et donc plus facilement saisissable pour le
sociologue » [Paugam, 2009, 193]. La paternité permet aux détenus de résister au sentiment
d’échec social que leur renvoie l’incarcération. La situation d’enquête a également valorisé ce
statut et par là, encouragé une parole positive. En faisant miroiter une certaine réussite
112
éducative, dans un contexte précaire et chaotique, ils espèrent obtenir une reconnaissance
extérieure [Le Pape, 2009]. Andreja, par exemple, est motivé pour changer sa vie pour le bien
de ses enfants. Le rôle de père favorise l'accès aux responsabilités et le devenir adulte
« comme si la paternité suffisait à fournir un rôle social en tant qu’adulte » [Allard, Binet,
2002, 46].
En dépit de leur implication paternelle réelle, savoir que leur identité de détenu ne constitue
pas leur seule identité, leur procurent une vision positive de la sortie.
« Pour certains, ce souci identitaire impliquera un désir de [reprendre] des habitudes
parentales. » Ils chercheront à combler le vide creusé par la prison en mettant à profit le temps
disponible pour la réflexion et pour réaffirmer leur place auprès de l’enfant [Marchetti, 2001,
295].
Sortir pour l’enfant et se réinsérer
« Vous êtes confiant pour le futur ? Assez, il va falloir gérer mon fils et être là quand il aura besoin. Ça vous fait tenir votre fils ? Oui le fait qu’il est là, qu’il m’attend dehors. Ça me fait tenir, tenir, à ce niveau là je sais qu’il m’attend, qu’il est pressé de me voir, que je sois dehors. » [André, 38 ans, séparé, 1 enfant, 9 ans]
Que cette paternité soit désirée ou pas, investie ou non, s’accrocher au dehors (par le
biais de l’enfant), c’est penser qu’il existe quelque chose par delà les murs qui en vaut la
peine. L’enfant apparaît comme un projet suprême pour lequel les détenus désirent se battre.
« Pour reprendre les termes de Gaulejac (1999/11) : L’individu est le produit d’une histoire
dont il cherche à devenir le sujet. Quant à la notion de projet, elle relève, selon Boutinet
(1989) autant du sens que de l’action. Permettant d’aller de l’avant, en traçant une direction,
le projet mobilise la personne vers une réalisation éventuelle engendrée par sa propre histoire
(René et al, 1999). » [Allard, Binet, 2002, 10]. Avoir un projet c’est se donner un but à
atteindre, une raison d’être. La paternité devient pour eux essentielle. Elle leur permet de
s’éloigner du modèle familial vécu et donner à l’enfant tout ce qu’ils n’ont pas eu.
S’accrocher au dehors c’est imaginer l’après prison, le futur possible, la personne que l’on
désire être et éviter de commettre les mêmes erreurs. Etre sans famille, sans lien avec
l’extérieur est une épreuve supplémentaire en détention difficile à surmonter qui limite
d’autant les possibilités de réinsertion. « Lorsque le sujet est profondément disqualifié,
l’accroche à la qualification de parent peut devenir massive » [Marchand, 2012].
113
« J’ai vraiment envie de raccrocher, quitter ce monde vicieux. J’espère que je ne dis pas ça parce que je suis ici. Mais je le sens vraiment en moi d’arrêter de risquer la vie de ma femme et mes enfants. Enfin pas directement mais des enfants qui grandissent sans père c’est difficile, c’est pas terrible, eux ils ont rien demandé. Avoir des enfants ça te motive à arrêter ? ça m’a motivé à ne plus prendre de gros risques mais toujours à flirter avec le danger. Ça a été un coup de frein mais je n’ai pas été aussi radical que maintenant. J’avais forcément mes enfants en tête mais je prenais les risques. On sait ce qu’on peut perdre mais le gout du risque ou l’argent peuvent vous mettre un voile sur tout ça [...] Je sais que j’ai encore une carte à jouer dehors, j’ai quand même un pas d’avance, j’ai ma famille, maintenant faut pas que je me mélange et surtout pas de récidive dans des histoires qui en valent pas le coup. Y a une prise de conscience ? J’ai l’impression, enfin ce n’est pas le système de la prison ou d’avoir peur, c’est une prise de conscience sur le simple fait de vouloir réussir sa vie et leur donner un avenir, une vie normale. Et la normalité, c’est grandir ensemble et pas eux dehors et moi ici, le jeu il est là. Mais la prison c’est tellement une routine, les jours c’est tellement les mêmes, je confonds les jours, ça passe vite. C’est la routine qui me fait dire ça. Je me suis levé à 7 heures et j’ai l’impression qu’il est 11h (il est 17h). j’ai fait un gros progrès pour pas sentir la prison, quand je suis à 18h dans la cellule je me couche maxi à 22h et le matin j’essaye de meubler ma journée, faire du sport et je travaille. Après faut pas se mentir quand on est dedans on pense au dehors et ça nous fait chier. » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
« A chaque fois que je le vois pour moi il change, il change trop vite, j’ai des photos de lui, il change beaucoup plus vite. A chaque fois au parloir, je me dis qu’il a grossit, il a grandi. Depuis qu’il est né, il y a dix-neuf mois et je ne vois pas passer le temps, ça passe trop vite. L’incarcération passe plus vite ? Je fais en sorte que ça passe plus vite mais c’est long surtout depuis que j’ai mon fils, c’est plus long. J’ai la pêche je sais que j’ai un garçon et une femme qui m’attendent mais c’est plus dur, on se fait beaucoup de soucis pour les gens qui sont dehors. On se pose beaucoup de questions [...] je prépare tout doucement la sortie [...] c’est facile d’imaginer en prison son futur mais faut que ça se réalise, je suis un bon cuistot, j’aimerais bien ouvrir mon resto, je suis d’origine turque, j’avais un Kebab. Mon but c’est de les rendre heureux car le temps que j’ai passé ici, elle a été là pour moi, je veux les emmener en vacances, qu’ils ne se plaignent de rien, qu’ils ne manquent de rien. Je veux sortir avec un travail et pendant que je m’occuperai de mon resto, je pourrai être présent. Fini de trainer et guetter la cage (prison). Je suis arrivé à 27 ans, j’ai 34 ans, je vais sortir à 37 ans, c’est fini tout ça, ça va être ma famille avant tout. » [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
Avoir un enfant semble un atout pour se projeter dans leur futur mais instaure également des
craintes supplémentaires. L’infantilisation vécue en prison, l’incapacité de prendre des
décisions, l’impossibilité de vivre avec eux au quotidien, sont autant d’épreuves à surmonter.
Les pères détenus prennent conscience de l’impossibilité de continuer leur vie d’antan, ils
doivent prendre en compte les besoins de leurs proches. Sortir de prison signifie une nouvelle
chance de se racheter, de faire mieux qu’avant, de donner un avenir à leurs enfants et enfin
trouver un équilibre, une normalité qu’ils n’ont jamais vraiment connue. La routine carcérale
à laquelle certains s’habituent (comme Sofiane), les coupe temporairement des situations de
désœuvrement parfois vécues par leurs enfants du fait de leur absence. La paternité qui
s’inscrit dans un temps continu les ramène à la réalité et leur permet de prendre conscience de
la réalité du dehors. Le temps long de l’incarcération est contre balancé par le temps du
dehors qui file rapidement perçu à travers l’évolution de leur progéniture : « il change trop
vite ». Chaque incarcération doit être la dernière pour le détenu mais surtout pour les êtres
chers laissés dehors.
Les témoignages sur les difficultés à vivre sa paternité en prison sont nombreux mais
114
n’éliminent pas la possibilité de « refaire des bêtises », un vieux démon toujours présent.
L’habitude de vivre avec opulence, de gagner de l’argent facilement est toujours ancrée, dans
un coin de leur tête.
« Et quand tu sors ? Je vais essayer d’ouvrir une boite de chauffeur livreur avec un pote. J’ai un pote qui veut acheter un magasin de marques. J’ai un autre pote qui a ouvert un show room, il vend en gros. Tu veux te ranger ? Inch allah ouais je vais me ranger, après on sait jamais après on voit les billets on a la tête qui tourne. Les enfants ça ne motive pas pour arrêter ? Bah oui ça motive, j’ai pas envie de le faire, je l’ai dis en 2006 et en 2013 je suis là quoi. Moi j’ai envie d’arrêter et Inch allah que tout se passe bien. En tout cas sûr ce ne sera pas dans la drogue. J’ai envie d’arrêter après... Si y a un problème, qu’on est à la rue c’est sûr je ne vais pas mendier. « [Larbi, 40 ans, marié, 4 enfants, 11 mois]
Nombreux sont les détenus qui souhaitent mettre fin à leur délinquance et se ranger ; leur
motivation principale réside dans leur désir d’être présents auprès de leurs enfants. Les
modalités de leur réinsertion restent la plupart du temps floues et les préoccupation futures
sont reportées jusqu’à la sortie. « J’y penserai quand je sortirai. Ici on ne va pas y penser tous
les jours, y a pas de motif. Si c’est pour ressentir le mal être, ça sert à rien, on est enfermé
c’est tout, il faut attendre. »1
Le temps carcéral a souvent raison des projets pas toujours réalistes et dont beaucoup sont
irréalisables.
Il serait intéressant de faire un parallèle avec les motivations des détenus sans enfant, ni
compagne pour déterminer leur perception du futur et comprendre les logiques des différents
acteurs. Marchetti souligne que les détenus les plus végétatifs, les plus isolés, valorisent
« d’autant plus le passé qu'ils n'arrivent pas à donner de goût au présent et à s'y investir »
[Marchetti, 2001, 303]. La longueur des peines et le temps qui reste à tirer jouent également
sur la perception de leur futur.
Même si les discours ne sont pas les pratiques, croire à quelque chose les raccroche au dehors
et les incite à gérer leur vie différemment. De nombreux détenus me décrivent leur
incarcération comme un tournant2 dans leur existence, une prise de conscience que la prison
n’est pas une vie, la vie c’est dehors avec leurs enfants. Ils réalisent que leur rôle de père est
difficilement conciliable avec la détention.
CONCLUSION : ETRE PERE EN PRISON
Cette partie a démontré l’hétérogénéité de la population étudiée au niveau des réalités
1 [Nicolas, 59 ans, séparé, 1 enfant, 6 ans] 2 Terme que je développerai dans le chapitre quatre
115
partagées ; être père est la seule réalité qui rassemble ces hommes1. La paternité, ce bien
qu’ils partagent peut autant se révéler un lourd fardeau qu’un point d’appui inégalable.
L’infantilisation subie en détention invalide leur position d’adulte et aggrave leurs sentiments
d’illégitimité et de crédibilité. De nombreux détenus ne se sentent plus complètement pères.
L’identité paternelle s’avère peu valorisée par les différents professionnels de la prison,
pourtant, la pression sociétale continue de s’exercer sur les individus. L’impératif n’est pas
simplement d’être un père mais un père idéal [Weissegerber, 2005, 3].
En dépit des conditions difficiles, la paternité reste « una risorsa socializzante eccezionale per
il genitore che si trova in carcere: un figlio può essere fonte di nuove risorse affettive, di
disponibilità al cambiamento e all’assunzione di responsabilità2 » [Cusano, 2007].
Les détenus témoignent tous de la complexité à conserver leur rôle mais décrivent toujours
leurs enfants avec fierté. Ils s’enorgueillissent de leur « état » de paternité ; leur progéniture
leur confère un statut social « chargé de sens pour eux, celui de père de famille. En ce sens, la
paternité est vécue comme un mode d'intégration sociale : en devenant père, ils ont le
sentiment de «devenir quelqu'un» simultanément pour eux et pour les autres. » [Quéniart,
2002, 12].
La quatrième partie nous permettra d’appréhender et de comprendre le vécu concret des liens
de mes enquêtés avec leurs enfants et leur compagne à travers les différents dispositifs mis à
leur disposition en détention. Dans un second temps, nous étudierons la manière dont les
détenus ressentent leur incarcération à travers le prisme de leurs relations filiales maintenues
ou non.
1 Colloque Liens familiaux et détention à l’université catholique de Lyon du 11/04/14 2 Une ressource socialisante exceptionnelle pour le parent qui se trouve en prison : un enfant peut être une source de nouvelles capacités affectives, d’aptitude au changement et à la responsabilisation.
116
IV. VECU DE LA DETENTION ET LIEN AVEC
L'EXTERIEUR
A. LE LIEN DIRECT EN PRISON
L’institution carcérale se présentait à la fin du XVIIIème siècle comme une
« alternative aux supplices et châtiments corporels » [Veil, Lhuilier, 2000, 10]. Aujourd’hui
sa vocation est tournée vers la rééducation dans l’hypothèse de l’existence d’un lien entre
prison et société. Toutes les réformes tentent de « réduire la coupure entre la vie au-dehors et
la vie en détention » [Ibid, 2000, 12].
Le parloir, les UVF, les permissions, les cabines téléphoniques composent les dispositifs qui
tentent de palier aux affres de la détention et donc de la séparation.
Etudier ces dispositifs souligne l’interconnexion entre temps, espace et acteurs. Selon une
lecture géographique des sociétés, Di Méo et Buléon expliquent les logiques d’action propres
à chaque espace social. Ils révèlent l’imbrication des « rapports sociaux (de production ou de
travail, de parenté ou d’amitié, de loisirs et d’échanges, etc ; rapports consensuels ou
conflictuels, spontanés et inventifs ou soumis à des conventions, etc) et des rapports spatiaux
(d’usage ou d’appropriation des lieux, affectifs ou stratégiques, respectueux ou modificateurs
des structures de l’espace) qui, de fait interfèrent constamment entre eux » [Di Méo, Buléonn
2007, 11]. L’appropriation, le rejet, la négociation, le contrôle d’un espace... découle à la fois
de la perception que les individus ont d’eux même et celle qu’ils ont du lieu; l’usage qu’ils en
feront en sera modifié [Ibid, 2007, 6].
Analyser les vécus des acteurs s’avère complexe car étroitement liés aux espaces dans
lesquels ils évoluent. Une recherche en milieu carcéral est indissociable de l’étude de
l’espace-temps dont découlent les pratiques et les représentations des individus incarcérés.
Le rapport qu’ils entretiennent avec ces espaces restreints, à la fois spatialement et
temporellement impacte les relations, les interactions ou encore les dynamiques et les
mouvements qui s’y jouent [Ibid, 2007, 9].
L’investissement qu’ils vont mettre dans ces lieux résulte du contexte social dans lequel ils
s’inscrivent.
117
Le parloir, à la rencontre de l’autre
Les difficultés pour maintenir les liens sont importantes, seulement « près de la moitié
(43 %) des détenus en couple voient leur conjoint au moins une fois par semaine, 10 % au
moins une fois par mois et 7 % plusieurs fois par an. Les relations avec les enfants sont
souvent très distendues : la moitié des détenus les voient au plus une fois par an. 16 % les
voient au moins une fois par semaine, 17 % une fois par mois. » [Désesquelles, Kensey, 2006,
59]
Le parloir apparaît comme une soupape, « offrant la possibilité d’une continuité et d’une
pérennisation relative des rôles que tenait le détenu avant d’être incarcéré » [Chantraine,
2004, 229]. La visite est la seule occasion pour le détenu et le visiteur de reconstituer « une
quotidienneté1 », « il s’agit de « tout vivre » et de « tout dire », sans pouvoir vraiment choisir
le moment adéquat, puisque le temps imparti est réduit » [Ufframag, 2013, 23]. A travers ces
instants, les individus tentent de construire des ponts symboliques pour extrapoler les
difficultés engendrées par la sortie [Ibid, 2013,15]. Le lien père-enfant dans ce contexte,
perdure grâce à un important réseau familial où la mère tient souvent le rôle central.
Un lieu peu adapté aux relations familiales
« Tout ce que l'administration pénitentiaire fait pour maintenir les liens avec nos familles c'est de nous donner une heure de visite par semaine, 60 minutes mouvement compris; et il n'y aura pas une minute de plus. On trouvera l'excuse d'un trop petit local, d'un manque de personnel. Pas de gâteries pour l'enfant, pas de boissons, rien qui nous fasse oublier pendant une heure que nous sommes en prison. Le règlement ne prévoit pas les effusions entre époux, [...], 144 heures d'attente pour une heure ! » [Campioli, De Coninck, 1977, 228]
Enfermés, ces pères ne savent rien ou si peu de l’extérieur, que ce qu'on leur en dit ou
leur écrit. Le parloir représente un fragment de temps où est crée le lien entre le dedans et le
dehors. « Les proches présentent la régularité des visites comme essentielle pour le détenu,
car elle permet de lui signifier la force de leur soutien. Les visites permettent également
d’éviter une trop forte socialisation carcérale (les visites doivent limiter les risques de
prisonization). [...] L’assiduité aux parloirs procure au détenu des repères temporels qui
rythment le temps vide de la détention. » [Touraut, 2009] Le coût temporel et financier
1 Tout en sachant, que le parloir est un instant t, limité dans le temps et l’espace éloigné de la réalité.
118
fragilise les relations sociales et familiales, « seuls 70 % des établissements pénitentiaires sont
desservis par des transports en commun les jours de parloir : « la distance à parcourir de la
gare SNCF ou de la gare routière jusqu’à l’établissement est de plus de 5 km pour 35 % des
personnes interrogées. Elle atteint 13 à 20 km pour 8 % et est supérieure à 20 km pour 8 %
des personnes » (UFRAMA, 2006)1.
La distance des établissements pénitentiaires s’explique par la combinaison de deux facteurs :
le désintérêt des pouvoirs publics pour ces institutions et, selon Combessie, la volonté de
reléguer « les bâtiments pénitentiaires dans des lieux de moindre visibilité sociale »
(Combessie, 1996)2
« C’est horrible pour ma femme. Se lever tôt le matin, attendre ¾ d’heure puis encore après. C’est très dur pour une femme de faire ça une fois par semaine, c’est pas évident pour elle à l’extérieur pourtant je lui ai dit de ne venir qu’une fois par mois. Elle a décidé autrement pour qu’il y ait un suivi. La plupart du temps elle vient au parloir avec les gosses mais quand on doit discuter sérieux, elle vient seule. » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
Les temps de trajet et d’attente sont pénibles et anxiogènes pour le détenu et comme pour le
visiteur. La présence d’enfants en bas âge complique les déplacements. A cela s’ajoute des
horaires et des jours de parloirs fixés par l’établissement qui « ne sont pas adaptés aux
contraintes scolaires des enfants »3. Aller au parloir requiert une organisation astreignante.
Sofiane était prêt à renoncer aux quatre visites mensuelles pour décharger sa femme au risque
que sa paternité en pâtisse.
D’autres choisissent d’effectuer leur peine sans parloir, une manière d’épargner son conjoint
mais aussi de s’auto punir de leurs fautes.
« Elle me manque, j’ai envie de la voir mais c’est vrai la prison c’est pas bon pour les enfants, mais un peu quand même. Pareil pour la dernière, je ne veux pas qu’elle me voit ici [...] elle est née quand j’étais en prison, elle est venue petite. Je pense que ça leur fait plus de mal que de bien de venir et moi ça me fait mal, enfin ça fait aussi du bien mais les voir partir c’est dur. C’est un peu à contre cœur, c’est un choix que sa mère aussi a décidé. Vu qu’ils sont petits on ne peut pas leur demander leur avis. Et puis la galère des parloirs, j’en ai eu des parloirs et j’ai voulu faire cette peine sans parloir donc je ne vois personne, pas d’ami, pas de copine, même pas ma sœur… ça fait trois ans. » [Amed, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 3 ans]
A la « galère des parloirs », à savoir les difficultés liées au temps de trajet et aux horaires
s’ajoute également une topographie des lieux particulièrement exigüe (en moyenne deux
1 UFRAMA, « Les liens à l’épreuve de la prison », Actes de colloque, Saintes, 2006. L’UFRAMA est une fédération d’associations d’accueil de familles de détenus in [Touraut, 2009] 2 Philippe COMBESSIE, Prisons des villes et des campagnes. Étude d’écologie sociale, Paris, Les éditions de l’Atelier, 1996 in Touraut, 2009 3 Groupe de travail « Intérêt supérieur de l’enfant » Rapport « le maintien de liens à l’épreuve de l’incarcération » Octobre 2013 [P28]
119
mètres carré). L’étroitesse de la cabine/boxe autorise peu de mouvements. Le lieu n’est pas
adapté aux enfants, aucun support ne permet d’agrémenter la rencontre et de gommer le
malaise du face à face... (jeux, matériel de dessin...). On imagine aisément la difficulté de
contenir un jeune enfant dans un tel espace. De plus, le temps très court du parloir ne favorise
pas les relations même si un temps plus long pourrait s’avérer pesant dans le dénuement de ce
lieu.
« Comment tu trouves ta relation avec eux en parloir ? Franchement ça va, c’est vrai y a pas de jouet, de crayon. Quand j’ai eu le double parloir de deux heures c’est long, au bout d’un moment ils en peuvent plus. Le parloir d’une heure c’est suffisant après ils tiennent plus en place. » [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
Quentin souhaiterait voir ses enfants plus longuement mais la notion de temps pour un adulte
n’est pas en adéquation avec celle d’un enfant. Quand le père aimerait jouer ou discuter le
petit souhaiterait dormir ou être seul ; le temps du dehors est confronté au temps du dedans,
un temps sous « contrôle » [Ricordeau, 2008]. Le parloir comme la prison est un lieu régis par
un espace temps particulier qui ne se reproduira jamais à l’extérieur. S’il reste le moyen
privilégié de nouer un « réel » lien avec l’extérieur, « le temps du parloir n’échappe pas à
l’emprise carcérale » [Ibid, 2008, 80] et produit un sentiment de frustration.
Visiteur et visité sont soumis au contrôle de l’institution: détecteur de métaux, fouille et
intimité réduite où la parole libre n’existe pas. Chacun des partis se plie à l’injonction
règlementaire et certains pères préfèrent renoncer au parloir plutôt que subir l’infantilisation
et la fouille à nu par les surveillants.
« Rester père c’est compliqué dans ces conditions, faudrait quoi ? Plus de jeux, plus de temps moins de coupures quand tu as des doubles, pouvoir descendre des gâteaux et tu es obligé de les cacher. Y en a qui te les laissent, d’autres te les prennent, avant y avait des jouets maintenant y’a plus rien c’est plus gai faudrait mettre des mini toboggans, c’est glauque tu sens que c’est l’administration… c’est pas pour les enfants ces grilles sombres [...] moi je voulais pas au départ (que son fils vienne) mais mon père m’a vu blasé et lui a dit de l’emmener. Elle (sa compagne) avait peur de ma réaction mais finalement ça me fait du bien. Mais c’est la galère [...] parfois elle pète les plombs, elle pouvait pas rentrer dans le bus donc, elle préfère le premier tour (de parloir). » [Kyllian, 30 ans, en couple, 2 enfants, 4 mois]
« Ma fille est revenue en février avec mon fils, tous les deux en même temps à ma grande surprise générale. Et puis ma fille est plus revenue, mon fils aussi, ils ont dit à leur mère qu’ils ne voulaient plus venir. C’était trop dur ? Oui. Pour quelles raisons ? C’est le contexte, l’ambiance, c’est me voir impuissant, ils savent que je ne suis pas bien, je peux pas montrer que je suis joyeux. Le contexte, l’endroit, c’est lugubre, crado, ce n’est pas le top. Tu vois en 20101 les parloirs étaient comme ce bureau,
y avait pas de séparation, à Fresnes c’est pas ça. Ça fait 2m2
, y a un muret avec un petit comptoir c’est pas... ça craint. » [Laurent, marié, deux enfants, 8 mois]
« Les parloirs ce n’est pas trop difficile ? Des fois ça va, des fois ça prend la tête. La fouille, le surveillant, c’est humiliant. Quand vous voyez votre famille ça va mais les surveillants ne sont pas gentils, ils vous parlent mal, ça fait partie de la prison. On est dans une cage, ils sont horribles, à la fin du parloir. C’est 45 minutes de bonheur et 20 min utes de malheur. J’aime pas comment ils font les choses
1 En 2010 il était incarcéré à Fleury-Mérogis, le bureau dans lequel nous réalisions l’entretien fait approximativement 6m2
120
Après 45 minutes, ils vous font mettre en salle d’attente, puis la fouille, tu es à poil, ils fouillent tes vêtements. Ils vous demandent de vous baisser, de tousser. Y a quatre surveillants qui vous voit, mais on voit pas les autres détenus. C’est quatre cabines sans portes et les surveillants se promènent. » [Omar, 48 ans, séparé, 2 enfants, 2 ans et demi]
« Tu aimerais les voir plus ? ça fait longtemps que je suis là, au départ je voulais tout le temps, tu te rends pas compte que c’est galère et puis maintenant tu te contentes de ça. [...]Tu peux me raconter un parloir ? ça se passe bien, la petite avant elle était plus jeune, au début elle ne me sautait pas dessus et maintenant elle le fait. Et ton fils ? Il est calme on discute de sa vie, il me pose des questions sur la prison, il me fait des petits câlins. [...] Je préfère qu’ils viennent d’eux mêmes. Je ne veux pas les forcer, je ne vais pas leur poser la question de quand ils viennent. Ça me soule pas de les voir mais ca les soule la prison, ca fait longtemps qu’ils viennent. » [Kalim, 35ans, divorcé, 2 enfants, 3 ans]
En multipliant les extraits d’entretiens, chacun apportant son éclairage spécifique m’a permis
d’appréhender les différentes perceptions du parloir pour ces pères. Parfois, le poids de
l’institution conduit ces enfants à renoncer à rendre visite à leur père et non une question
d’amour. Etre un enfant et venir en prison semble antinomique. La prison pèse autant sur les
deux partis et quand les détenus y passent de nombreuses années, la peine carcérale est
partagée. Aller en parloir induit pour l’enfant de se confronter à la dure réalité : son père est
dedans et il est impuissant. Se référer aux représentations paternelles du père détenteur de
l’autorité et de la loi, rend insupportable la constatation qu’il est à l’inverse de ce modèle.
Le parloir, ce lieu de rencontre du dehors et du dedans est un monde complexe où se
côtoient satisfaction et frustration. Le père tente de maintenir une relation à peu près «
normale » avec son enfant, sans avoir jamais la possibilité d’être seul avec lui1. Cette présence
d’un tiers a une influence certaine sur la relation ; les échanges entre le père et son enfant sont
toujours soumis au regard de l’autre ou à celui de l’institution. Comment réussir à investir son
rôle de père dans un lieu où il est impossible de s’identifier ? [Di méo, Buléon, 2007, 49].
Un mal pour un bien
« Quand ils viennent en parloir ils sont heureux. C’est ma petite bouffée d’oxygène, ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. [...] C’est douloureux de les voir ? Si ça fait un bout de temps qu’on ne s’est pas vu, à la fois ça fait plaisir, à la fois ça fait mal. Les faire venir en parloir c’est difficile pour moi c’est un grand pas. Y a beaucoup d’enfants qui ont des parents en prison et les détenus veulent pas les voir, c’est pesant. A Fresnes, c’est dans une cave, ici ça va à la rigueur. Ils ne sont pas fiers que leur père soit en prison, après comme je vous ai dit, une fois que je serai libéré, les questions vont fuser mais on ne peut pas préparer les réponses à l’avance. » [Cyril, 45 ans, séparé, 2 enfants, 3 ans]
1 Un enfant mineur ne peut se rendre seul en prison, lors du parloir il y a alors toujours la mère, un grand parent, un frère... Quand l’enfant est amené par un médiateur du Relais Enfant-Parent, ce dernier reste tout au long de l’interaction.
121
Le parloir se révèle malgré tout un lieu essentiel à la mise en place de la paternité,
c’est « l'occasion d'une tentative de réinscription de la temporalité de l'extérieur à l'intérieur
de la prison » [Ibid, 2000]. Il n’existe aucun autre lieu en détention qui autorise une rencontre
direct entre deux mondes, ce « télescopage de deux mondes » [Chantraine, 2000, 227]. Il
représente la seule ouverture entre le dedans et le dehors : une « véritable intrusion dans
l’institution totale » [Ibid, 2000] et le seul moyen de réactualiser les rôles tenus dehors et
d’écarter, pour un temps, l’effet de « prisionnierisation » et d’intégration des normes
carcérales.
L’expression de Cyril, une « bouffée d’oxygène » témoigne de la valeur de cet instant partagé
qui ravive également certaines souffrances en confrontant l’identité paternelle à celle de
détenu. Finalement, les détenus préfèrent encore mettre en péril leur image paternelle plutôt
que renoncer au parloir.
L’aptitude des détenus à naviguer entre plusieurs identités et à les relier est déterminante dans
les interactions avec leurs enfants. Ils parviennent tant bien que mal à se centrer sur leur
progéniture et se décentrer d’eux mêmes [Ouellet, Milcent, Devault, 2006]. La motivation et
la capacité nécessaires pour conserver le sens de la parenté et assumer les obligations envers
leurs enfants, en dépit des circonstances, deviennent des forces solides. [Hairston, 2002, 52].
« ça se passe comment le parloir avec ton fils ? (il sourit avant de parler) ça se passe bien, on joue, parfois elle me dit que je la calcule pas (sa compagne). Je lui dis que les enfants ça passe avant, elle peut en profiter avec lui. Il me donne des petites claques, on fait des guilis et puis il commence à parler, on court. Il fait des allers et retours, il est mort de rire, il aime bien. » [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
« En parloir je m’amuse beaucoup avec eux, j’essaye de rire et puis je parle avec leur mère, on rigole ensemble. C’est un moment ensemble. On essaye de rendre la misère agréable. [...] Vous laissez de la place au couple au parloir ? Sans se le dire on a mis une abstraction sur le couple parce que voilà, à part des mots qu’on peut se glisser, c’est assez spécial le parloir, c’est très complexe. Tu préférais ne pas les voir ? Je n’irais pas jusqu’à dire ça, à chaque fois que je les vois, c’est une dose d’énergie positive, c’est vraiment réel. Et quand on sort du parloir que y a quelque chose qui s’est passé, on les a pris dans ces bras, il se dégage quelque chose [...] c’est un peu ma colonne vertébrale. » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
Voir ses enfants en parloir créé une réserve de moments de bonheurs, rares et chers.
Les détenus ayant pour la plupart des enfants en bas âge1, vont axer le parloir sur
l’amusement et la légèreté. Le jeu constitue le moyen privilégié de renouer le lien et de faire
accepter leur condition. Ils adaptent leurs pratiques au temps court de la visite (entre trente
minutes en Maison d’arrêt et quarante-cinq minutes en Centre de détention). La relation avec
les enfants reste prioritaire et laisse peu de place au couple. Evidemment, le faible espace
1 D’après le colloque Liens familiaux et détention à l’Institut Catholique de Lyon le 11/04/14 77,8% des enfants se situeraient dans la tranche d’âge de 3-14 ans.
122
limite l’effusion des sentiments et les contraint à adapter leurs choix. N’oublions pas que les
détenus condamnés1 n’ont droit qu’à un seul parloir par semaine dont ils ne profiteront pas
toujours puisque la distance entre le foyer familial et la prison limite parfois les déplacements.
Dans ces deux entretiens, mes enquêtés placent leur couple entre parenthèse, les enfants
passent en premiers. Sofiane pointe la complexité du parloir ; cependant, en dépit de toutes les
difficultés, l’énergie positive qui s’en dégage est bien réelle.
Les détenus tentent, à travers le parloir d’instaurer un moment « comme avant » et de
retrouver des sensations qui ne soient pas subordonnées à leur vie en détention.
Malheureusement, au fil du temps, les (mauvaises) conditions du parloir finissent par primer
sur l’échange [Joel, 2006, 79]. Une autre difficulté s’ajoute encore, celle de trouver des choses
à se raconter car la routine carcérale empêche l’actualisation/la production de nouveaux récits.
« Avec ma femme, on ne parle pas de ça (l’incarcération et les conflits du couple) avec les enfants, on joue, c’est que quarante-cinq minutes et je ne sais même pas quoi leur dire. Quand tu sors de cellule que tu rentres entre quatre murs tu fais des pompes, tu zappes, tu peux qu’improviser, je suis bon en ça, je fais que ça d’écrire, sinon je deviens fou. Quand ils viennent j’improvise c’est selon l’humeur, je leur demande ce qu’ils ont fait la semaine, je suis curieux, je leur pose beaucoup de questions mais pour leur raconter des choses, c’est stupide je suis obligé de faire le mariol pour les faire sourire. Je leur dis que je tiens le coup, que je pense à eux. Ma femme me dit que je ne la comprends pas sur tout ce qu’elle subit mais moi je lui dis « comment je peux te montrer ma compassion, je suis ici », je peux pas pendant 45 minutes la remercier, embrasser ses pieds, non j’essaye de profiter, faire des câlins, trouver des blagues. Parfois à la télé je vois des trucs drôles par exemple le pub Pepsi avec le bébé qui danse et les parents qui ne parlent que du Pepsi… y a pas grand chose à dire, « (en prison) y a des gens comme ça. Il se passe ça, je ne peux pas leur raconter ce que je fais ici. » [Achour, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
Nous percevons « la mécanique implacable du temps vide [qui rend] difficile pour le visité la
constitution d’un stock d’anecdotes à raconter » [Chantraine, 2004, 231]. Les détenus sont
obligés de faire preuve d’inventivité et certains vont même jusqu’à écrire des idées de
conversation pour le prochain parloir. Les pères considèrent que la réalité carcérale est
indicible pour les enfants. Ils désirent partager un bon moment avec eux. Parfois à l’encontre
de leur rôle attendu, ils se sentent incapables d’exercer la moindre autorité tant leur souhait
d’être aimés prime.
« On dirait qu’en prison mes enfants sont mes enfants mais que je suis mort en prison, que je peux rien faire pour eux, que je peux que parler avec eux mais que ça sert à rien un mort qui parle. Par exemple même ma femme me demande de l’engueuler moi je lui dis je peux pas je suis en prison, je le vois jamais, une fois par semaine et encore je peux pas l’engueuler moi je lui dis que je ne peux pas je suis en prison, je le vois jamais, une fois par semaine et encore, je peux pas m’engueuler avec lui. Tu vois une différence avec ce qu’il y avait avant la prison et maintenant ? Y a aucune autorité en prison, on ne peut pas engueuler son fils alors qu’on le voit jamais, seulement trente minutes dans la semaine. Tu ne te sens pas légitime avec l’autorité ? Rien à voir avec ça, c’est plus de la pitié. Ils sont mal parce que tu es en prison,
1 Les prévenus ont le droit à trois visites par semaine.
123
tu veux profiter. Ce n’est pas parce que je suis en prison (que j’ai moins d’autorité) car il ne sait pas pourquoi je suis là, il dit que je suis à la police. [Bilal, 33 ans, concubinage, 4 enfants, 34 mois]
Les pères détenus ressentent fréquemment une illégitimité qui les empêche d’investir le rôle
de celui qui gronde. Ils sont dépendants des réactions de l’enfant qui, du jour au lendemain
peut interrompre ses visites. Ils s’auto censurent pour donner une image favorable d’eux-
mêmes. Bilal signale l’impossibilité d’accéder à la demande de sa femme, le temps trop court
de la visite ne lui laisse aucune chance d’investir cette part de son rôle. Quel souvenir son
enfant conservera t-il de lui ?
Rencontrer son enfant au parloir, implique de surcroit une confrontation avec ses propres
émotions. Bilal parle de la pitié qu’il éprouve : ce sentiment négatif apparaît également dans
ces deux entretiens :
« J’ai vu mes filles ça s’est bien passé, elles ont pleuré. Elles sont arrivées stressées, elles avaient peur de rentrer et elles ont pleuré, elles étaient émues. La première a voulu comprendre pourquoi j’étais parti de prison puis revenu. Donc je lui ai expliqué pour l’enquête, le jugement et que Papa pour le moment purgeait ses quatre ans. C’est vraiment la première qui voulait comprendre, la deuxième voulait jouer. Et après ? On a parlé de l’école, je leur ai dit que papa allait aussi à l’école puis on a joué et le temps était écoulé, c’était dur les au revoir. Et donc, je les vois le 28 mai et le 9 juillet, j’aurai un double parloir. Mes filles sont suivies, c’est la justice qui fait le planning mais c’est bien déjà je les vois. Ça remonte le moral, voir que des adultes ici… là les enfants ça remonte le moral, tu sais qu’il y a quelque chose qui t’attend dehors. » [Thierry, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
« Ma fille, elle souffre plus de la séparation, lui (son fils) il s’en fout il dit « à plus tard papa », même pas un bisou, ma petite elle me fait des câlins. Mon petit, c’est sa mère, tout le temps maman, il aime sa mère comme ma fille aime son père mais ils sont petits ça va changer. Ma petite depuis le début elle sait, « les policiers t’ont pris dans la voiture, ils t’ont jeté ». Ma fille dès qu’elle voyait des flics elle disait « vous êtes des méchants, vous avez pris mon papa », ça l’a marquée. Pareil en 2010, elle était petite, ça l’a pas trop marqué, mais y avait un petit manque paternel, mais là ma fille elle est mal, comme hier, elle m’a dit dans mon oreille « je vais pleurer parce que je vais partir » ça fait mal mais je lui ai dit « ne t’inquiète pas on se voit dans trois semaines. » Et toi quand tu la quittes ça te fait quoi ? ça fait mal, des fois elle me met les larmes aux yeux, j’ai un cœur... » [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
Voir son père par intermittence et le savoir enfermé est souvent synonyme de crainte, de
stress et de tristesse. L’incarcération est perçue comme un abandon. Les filles de Thierry
cherchent à comprendre son absence, source d’inquiétude pour elles d’où la nécessité
compliquée de trouver les mots pour expliquer la situation.
Dans ce contexte, les pères détenus doivent être capables « d’exprimer leur affection à leur
enfant, exister en tant que parent pour lui, surmonter leur sentiment de perte de légitimité, leur
culpabilité, leur honte et conserver leur estime d’eux-mêmes, en tant que parents. »1 Le
challenge est immense au vu des situations familiales difficiles qu’ils ont vécues.
1 Groupe de travail « Intérêt supérieur de l’enfant » Rapport « le maintien de liens à l’épreuve de l’incarcération » Octobre 2013
124
Le parloir malgré toutes ces difficultés s’avère une incartade généralement positive dans la
pesanteur carcérale. Lorsque la fille de Quentin dit : « je vais pleurer parce que je vais
partir » elle exprime toute l’intensité d’émotions produites dans ce laps de temps réduit. La
fin du parloir marque souvent une rupture brutale et le retour en cellule devient une épreuve.
Contourner les effets coercitifs de la détention
Le parloir est dicté par des règles strictes qui limitent certes les possibilités d’actions
des détenus. Pourtant sans êtres réduits à de simples victimes du milieu carcéral, ils sont aussi
des « acteur[s] capable[s] de prendre [leurs] distances par rapport aux rôles, aux institutions,
et de se constituer une identité propre » [Rostaing, 1997]. Mon rôle de chercheur me pousse à
détecter toutes les marges de manœuvres de mes enquêtés, aussi infimes soient-elles en
réalisant que cette « autonomie ne signifie pas qu’ils soient totalement maitres du jeu ».
En parloir il est strictement interdit d’échanger des objets, de la nourriture, des documents ou
d’avoir des relations sexuelles. Cependant, l’agencement des visites dans certaines prisons -
les parloirs individuels – concède une petite marge de manœuvre pour les comportements
illicites. « Les modalités discontinues de surveillance (la ronde) rendant ainsi leurs conduites
imprévisibles et forçant les surveillant(e)s à leur concéder une certaine liberté » [Joël-Lauf,
2012, 38].
Le passage de substances illicites témoigne de la « porosité de l’institution » [Chantraine,
2004, 245]. Elles rentrent essentiellement par les parloirs et permettent de palier à « des
besoins ou de réaliser des désirs non pris en charge directement par l’établissement1 » [Ibid,
2004]. La drogue constitue une véritable monnaie d’échange, ce que Chantraine appellera
« une ressource « en or ». Le haschisch circule majoritairement en détention mais les drogues
dures et les traitements de substitution sont bien plus rentables. Sans parler du trafic de
téléphones2 dont les prix sont décuplés par rapport à ceux extra-muros.
Pour ces passeurs, le parloir prend tout son sens s’il est optimisé au maximum :
« Elle sait comment ça se passe, donc pas de parloir fantôme et qu’elle vienne pas les mains vides, quelqu’un qui vient en prison, vient pas avec les mains vides. Ça passe comment les trucs à ton avis, tout le monde ramène, tout passe par les parloirs. Je ne pensais pas que ta femme t’apportait de la beuh. Elle sait que je la fais pas tomber du ciel, si elle a rien je suis énervé, passer des semaines ici sans rien, tu crises et y a des suicides. S’ils disent plus rien (les surveillants) c’est que ça évite des problèmes [...] ici je
1 En détention, les ressources légales sont sous forme de mandat (les personnes dehors versent un pécule sur le compte du détenu) pour qu’il puisse cantiner de la nourriture, du tabac, des produits d’hygiène, des vêtements, de la hifi... mais certains biens ne sont pas accessibles, d’autres moyens sont nécessaires pour se les procurer. 2 Voir les témoignages de Romain et de Bilal (Chap 3 : Soutenir financièrement)
125
fume 15 fois plus que dehors mais je bois plus que je fume dehors. » » [Kyllian, 30 ans, en couple, 2 enfants, 4 mois]
« Je fais de l’argent en prison alors dehors ce sera facile. J’aime faire de l’argent, je sais que je suis là, je ne suis pas mort, ça m’occupe. Quand je vais en parloir et que j’ai rien je suis dégouté, j’ai l’impression de m’être fait arnaquer. Ça sert à rien c’est comme si j’avais eu parloir pour rien. Je ne passe pas à la douane sans rien. Quand ma mère vient le samedi, j’ai rien alors en salle d’attente je propose aux mecs de faire passer et on me paye cinquante euros. Je suis payé cinquante euros la minute. Ça ne dérange pas ta femme de passer ? Bah ça l’arrange, c’est elle qui récupère l’argent. » [Bilal, 33 ans, concubinage, 4 enfants, 34 mois]
Kyllian et Bilal rodés aux rouages de la détention ont bien intégré les mécanismes illégaux.
Le passage de biens illicites modifie les conditions d’incarcération et influence le vécu de la
peine en améliorant le confort. Disposer d’argent marque une différence avec celui qui en est
dépourvu. Je n’ai les pas davantage interrogés sur le sens de leurs actes (pourquoi ils
trafiquent, qu’est ce que ça leur procurent) mais il est possible que cet échange apporte une
« nouvelle dimension du rythme carcéral » [Ibid, 2004, 246], structurant la détention entre le
parloir et l’échange rapide que nécessite ce type de produit. L’enjeu de ces transgressions
englobe la fierté de contourner le règlement et surtout la satisfaction de gagner plus que les
surveillants1. Le statut de père à finalement peu d’influence sur ce type de comportement.
« Y a moyen de faire des transactions, c’est encore plus facile en prison, tu sais j’ai toujours été dans business pourtant je suis incarcéré pour conduite sans permis. J’ai jamais été attrapé pour de l’herbe. Et tu passes en parloir malgré la présence de tes enfants ? Sérieux ils ne voient pas. Je sais qu’à Compiègne quand ma femme me donnait quelque chose ma petite fille voyait direct et elle disait « papa tu as quoi dans la main » et il fallait que je sorte une disquette (un mensonge). [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
Le trafic met en évidence l’instrumentalisation du parloir à des fins diverses ; les visites
contribuent autant au maintien du lien social qu’à la transmission de biens matériels, des
atouts considérables en détention.
Le parloir, lieu de rencontre des altérités, favorise le contact physique et constitue pour
les détenus une interaction indispensable au maintien identitaire. Dans ce contexte, la
sexualité, plus qu’un moyen d’obtenir du plaisir est perçue comme une preuve « « de leur
capacité de séduction et de la force du lien conjugal les unissant à leur partenaire » (Mossuz
Lavau, 2002)2. L’obligation contemporaine diffuse et implicite selon laquelle il est nécessaire
de poursuivre l’activité sexuelle au cours de la vie (Bozon, 2004) entraine ces acteurs vers une
resexualisation de l’expérience carcérale. Le temps passé en prison ne doit pas signifier une
mise en suspension de l’activité sexuelle conjugale mais par la continuité de celle-ci. » [Joël-
Lauf, 2012, 136]
1 Voir l’extrait d’entretien de Romain (Chap 3 : Soutenir financièrement P103) 2 In Joël-Lauf, 2012, 130
126
Le caractère répréhensible de la sexualité en détention la confine au secret « vouant ainsi ses
protagonistes à transgresser les règles et à dissimuler leurs pratiques sous peine d’encourir des
sanctions parfois sévères» [Ibid, 2012, 36]. L’auteure qualifie cette sexualité de
« clandestine » ; le besoin et le désir sexuel dépasse la crainte d’outrepasser les règles.
« Elle flippe, mais ils passent vite fait, ça permet une petite relation, tu te vides les couilles. Tu n’as pas peur de perdre les parloirs ?1 Ma parole je me dis que si je me fais chopper en train de niquer et que je passe devant la commission, je leur dirai que j’ai des envies, normal quoi et que déjà on nous prive de tout alors ça non... Après ils vont nous dire qu’il y a les UVF mais vu que je suis permissionnable j’en ai plus et attendre tous les trois mois... Ici c’est plus souvent mou que dur. Je sais que je pourrai perdre les parloirs avec mes enfants mais même elle, elle a des envies. Des fois je lui dis de se mettre en robe. La semaine prochaine je la vois toute seule d’ailleurs... » [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
Un détenu surpris en pleines relations sexuelles prend le risque de perdre ses parloirs ou les
UVF s’il en bénéficie. Dans un établissement qui bénéficie d’UVF, les actes sexuels sont
d’autant plus réprimés que les détenus disposent d’un lieu à l’abri des regards pour s’adonner
à ce type de pratiques. Quentin, lui, n’en bénéficie plus et détourne sans états d’âme, la règle.
Par des techniques d’adaptation secondaire2 [Goffman, 1968], il va contourner les interdits
pour maximiser les possibilités du parloir individuel et mettre en œuvre une sexualité
incertaine. La description de Quentin, axée en premier lieu sur son propre assouvissement,
laisse apparaitre un double enjeu : répondre à ses besoins mais aussi à ceux de sa compagne.
La vie sexuelle maintient la vie du couple. Elle rassure également les détenus sur la fidélité de
leur compagne, qui aura, de ce fait, moins envie d’aller voir ailleurs.
De ces relations sexuelles, naissent parfois des « bébés parloirs », rarement programmés3 mais
dont les pères considèrent la légitimité car ils donnent un sens au couple :
« Mon premier fils c’était un projet, Samy, c’était un accident. C’était surtout ma femme qui voulait, elle avait.... c’était en 2010, elle avait 22 ans, elle me prenait la tête, elle me disait « j’ai pas de vie, tu es en prison » donc on a fait un bébé parloir. Samy ce n’était pas voulu, je fais que des garçons. Elle voulait un enfant, elle ne voulait pas attendre. » [Bilal, 33 ans, concubinage, 4 enfants, 34 mois]
« Ça t’a fait quoi de faire un enfant en prison ? Au départ je ne voulais pas le faire mais elle est tombée enceinte, je crois qu’elle le voulait. Tu l’as vécu comme un piège ? Non parce que moi.... non c’était pas un piège. De toute façon fallait bien qu’elle s’occupe pour qu’elle m’attende, je ne sais pas. Tu penses que les enfants renforcent les liens ? Oui je crois qu’avec une longue peine comme ça... C’est pas comme si
1 Un détenu surpris à pratiquer des relations intimes et signalé à la direction prend le risque d’être privé de visites pendant une période déterminée.
2 « L’adaptation secondaire renvoie quant à elle à la disposition permettant à l’individu d’utiliser des moyens défendus ou de parvenir à des fins illicites (ou les deux à la fois), et de tourner ainsi les prétentions de l’organisation relatives à ce qu’il devrait faire ou recevoir, et partant à ce qu’il devrait être [Goffman, 1968]. In Joël-Lauf, 2012 3 L’extrait d’entretien de Kyllian illustre sa perception des bébés parloirs : « Les bébés parloirs ce n’est pas que tu appelles ta meuf et elle te dit « je suis en période d’ovulation ». Tu ne peux pas passer de capote, même si c’est pas ta meuf, tu jouis en elle, après, elle le garde ou pas. Pour moi les bébés parloirs, c’est des accidents. 99% des cas c’est des accidents pour moi, sinon faut trop prévoir. » [Kyllian, 30 ans, en couple, 2 enfants, 4 mois]
127
j’avais pris quatre mois. Tu avais des doutes sur sa fidélité ? C’est obligé en prison on sait pas ce qu’il se passe, y a pas de confiance à 100%. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
L’arrivée d’un enfant pendant la détention apparait pour certains comme le moyen de tenir le
couple en consolidant les liens. Occupées par leur enfant, pour quelles raisons leurs
compagnes s’engageraient-elles dans une autre relation ? Ce bébé partage une partie des
gènes de son père détenu et donne parfois à la mère l’impression de continuer à vivre avec lui
au quotidien malgré son absence. C’est une illusion qui permet de croire que la famille survit
à la prison et continue de se développer indépendamment de l’incarcération.
Le parloir, malgré ses multiples règles, laisse entrevoir une infime marge de liberté saisie au
vol, par certains détenus. Souvent, ceux qui passent des objets, sont aussi les téméraires qui
poursuivent une vie sexuelle en parloir. Ils connaissent tous les rouages pour contourner les
effets coercitifs de la détention !
L’Unité de visite familiale, un espace hors du temps carcéral?
En 2003, les unités de visite familiale apparaissent dans l’enceinte de la détention, ce
sont de petits appartements « réservés aux détenus condamnés1 qui ne bénéficient pas de
permission de sortir ou d’autre aménagement de peine garantissant le maintien des liens
familiaux et aux visiteurs qui justifient d’un lien juridique et/ou affectif avec la personne
détenue » [Rambourg, 2006, 9]. Les visites sont autorisées une fois par trimestre pour une
durée progressive : six heures pour la première demande puis vingt-quatre heure et quarante-
huit heures selon l’accord du chef d’établissement voire une fois par an, soixante-douze
heures2.
Ce dispositif diffère des autres structures de la détention. Contrairement au vécu du parloir
considéré comme un lieu de contraintes et limité à un boxe minuscule, l’unité de vie familiale
permet de disposer d’une relative liberté de mouvement3.
Ce lieu de vie partagée donne aux détenus l’impression d’échapper à la détention et à ses
effets coercitifs. « Ce nouvel espace détermine donc la possibilité d’un autre mode de vie,
plus proche du monde extérieur. Et ce rapprochement perceptible avec l’extérieur est d’autant
1 A Liancourt, peu importe le délit commis par le détenu, il peut bénéficier d’une UVF. 2 Voir règlement intérieur en Annexe 3 Le contrôle des surveillants est limité à un passage avant midi et un en fin d’après-midi.
128
plus prégnant qu’en plus de l’espace, l’organisation du temps aux UVF est laissée à
l’initiative de la personne détenue et de ses visiteurs. Ici encore la rupture avec la détention
est marquante et remarquée » [Ibid, 2006, 40].
Les UVF réintroduisent une intimité, du privé, là où la détention impose la visibilité. Les
détenus vont développer un « autre mode d’interaction et mettre au jour et à jour leurs
relations » [Ibid, 2006, 41]. Par la reconstruction d’un espace intime, elles encouragent le
réinvestissement des rôles, particulièrement limités, en parloir. Les détenus ont le sentiment
de redécouvrir la vie telle qu’elle existe à l’extérieur. Les UVF sont de véritables « «
catalyseurs de projet » (Rambourg, 2009) qui donneraient la possibilité de se projeter vers un
avenir matérialisé par les liens tissés dans ces unités » [Lancelée, 2007,108].
« Les UVF ça va de mieux en mieux. Au début il ne marchait pas, je lui changeais la couche, je le lavais, maintenant il marche. Le dernier UVF, il commençait à marcher, et il va partout, il joue avec son père, avec sa mère. Et il est content. Il est excité. Dès qu’il me voit, il est excité, sa mère lui parle beaucoup de moi, on fait des photos dans l’UVF. Ça se passe bien, j’attends la prochaine avec impatience. Y a une commission le 16 avril, je devrais l’avoir à la fin du mois. Au moins je peux manger avec lui, dans le parloir on ne peut pas manger, on ne peut pas ramener de bonbon, ils nous prennent la tête pour rien. [...] les UVF ça soude la famille, on prend conscience de qui on aime vraiment, dehors on fait pas attention à tout ça. [...] la première UVF j’ai eu 6 heures avec ma femme, elle était enceinte puis on a eu 24 heures, elle l’était encore et après mon fils est né on a du reprendre 6 heures car c’était une nouvelle demande, fallait voir comment ça se passe avec le nouveau né. Il était tout bébé, c’était magnifique. Tous les trois mois mon fils changeait. On prenait des photos, ça fait des souvenirs, on n’en a pas dehors. [...] les UVF ça rapproche beaucoup, il s’habitue à moi alors qu’il est plus avec sa mère. On peut acheter des cadeaux, on peut cuisiner, on peut dormir avec lui. Quand il pleure, c’est moi qui cours pour le chercher, ça me fait plaisir. Pareil pour ma copine, tous les trois mois on parle de la prochaine UVF. Le temps passe plus vite, on ne pense qu’à ça. On fait rien en parloir pour ne pas le perdre (référence aux relations sexuelles). [...] tu fais quoi comme activités avec lui ? Les activités, alors vu que je suis sportif, je fais mon sport, il essaye de faire pareil que moi, donc on s’amuse à courir. On joue à cachecache, il est mort de rire. On joue aux voitures, j’en profite pour le laver. Je fais le rôle du père et de la mère vu que j’ai pas beaucoup l’occasion de m’occuper de lui. Je vais le voir quand il pleure. On va sur le balcon, même quand je fume. On regarde des films. Il aime bien que je lui chante « ainsi font font font les petites marionnettes » « frère jacques », il danse, il claque des mains, il est content. » [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
Goffman, dans Asiles, étudie les particularités de la « vie recluse », comment elle brise
les frontières qui séparent ordinairement les champs d’activités – dormir, se distraire et
travailler – les personnes détenues effectuent « tous les aspects de l’existence dans le même
cadre » [Goffman, 1968]. L’institution fonctionne dans un cadre spatial et temporel unique :
dans cet univers « la temporalité de l’institution totale est monolithique, c’est le temps
institutionnel qui gouverne la vie des reclus » [Guilbaud, 2009].
L’UVF par l’instauration d’une certaine marge de manœuvre – choisir le moment pour se
laver, manger, se distraire, dormir – introduit une nouvelle dimension temporelle.
Timur dont l’enfant est né pendant sa détention, appréhende son rôle de père par le biais de ce
dispositif. Il construit une quotidienneté qu’il n’a jamais vécue et qu’il expérimente au fil des
retrouvailles en UVF. Il passe de la paternité à la parentalité en prenant conscience des
129
implications de son statut. Ce moment privilégié lui permet d’acquérir un savoir-faire et de
multiplier des souvenirs irremplaçables. Ces instants partagés composent une parenthèse
enchantée, dont la fin inéluctable le projette d’emblée à la suivante.
« Aux UVF les détenus reçoivent une série de messages à caractère positif
(responsabilisation, capacité d’agir et de faire, accès aux statuts de parent, conjoint, etc.) qui
favorisent le processus de construction d’une identité positive » [Rambourg, 2006, 54].
« J’ai pris six heures d’UVF avec ma femme et mes enfants et elle m’a trouvé trop calme, pour elle j’ai trop changé, j’étais pas comme ça avant, je rigolais, j’avais toujours un truc à dire, même on me disait que je saoulais et donc pour les UVF j’ai cantiné pour faire des crêpes, du Nutella, je les ai gâtés, on a regardé des DVD, franchement je connaissais pas mais c’était bien, même si ça fait aussi du mal. Pendant six heures tu les vois et tu dois attendre sept jours pour les revoir pendant 45 minutes, depuis que je suis ici je les vois qu’une fois par semaine. Trois fois par semaine c’est trop cher, elle paye soixante euros juste l’aller avec les enfants donc 120 euros1 plus les cochonneries qu’elle doit acheter s’ils ont faim ou soif. [...] Et alors tu as fais quoi pendant l’UVF ? On a fait des crêpes, franchement je vous mens pas, pendant six heures j’étais bloqué, ça faisait depuis que j’étais en prison j’en avais jamais eu, je connaissais pas et quand je suis arrivé et qu’on m’en a parlé j’arrivais pas à le croire. Et pendant ces six heures j’étais tellement heureux, on vous met en premier dedans, vous attendez quinze-vingt minutes pendant que la famille arrive et j’avais envie de pleurer, je peux pas en cellule et là je me mettais des tartes pour ne pas pleurer, six heures d’un coup puis j’ai eu 24 heures, en 6 heures on a fait que s’amuser, on a mis de la musique, on a dansé, je lui ai mis Spiderman, j’ai fait des crêpes, je jouais avec elles, je faisais l’idiot, je les faisais tourner sur la terrasse chacun leur tour… six heures ça passe vite, vingt quatre heures j’ai kiffé, y avait la journée, de 15 heures jusqu’au soir et j’ai tapé la nuit blanche avec ma femme, j’arrivais pas à dormir. Elle avait une hernie et le jour des UVF elle était bloquée, elle avait mal donc on n’a pas pu ... mais elle voulait pas rentrer, j’ai demandé un doliprane mais ils avaient pas et comme par hasard quand elle est rentrée elle avait plus mal, j’ai pris du bon temps, ça m’a fait plaisir de les voir sourire, de bonne humeur. Avec moi ils sont biens, ils me préfèrent, je n’ai jamais levé la main sur mes enfants, j’ai jamais crié. » [Achour, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
Partager des activités : manger des crêpes, regarder un DVD… offre un contexte de
convivialité propice aux échanges et introduit une notion de responsabilisation : choisir et
réserver un DVD, cantiner pour les repas, initier des jeux… « anticiper, décider de
l’organisation de la visite et la prendre en charge financièrement. En ce sens, l’UVF augmente
considérablement leur champ d’autonomie et d’initiative personnelle. Dotés d’un pouvoir de
décision sur une partie de leur vie, et qui plus est de leur vie avec les autres, les détenus se
sentent de nouveau en situation de contrôle de leur existence » [Ibid, 2006, 53].
Dans cet espace, le corps se libère, il se meut et « redevient récepteur et producteur de sens »
[Ibid, 2006, 44]. L’image fantasmée de l’autre redevient une réalité.
Malheureusement, si les UVF permettent à certains de se réapproprier des habitudes perdues
elles sont parfois susceptibles également de mettre en lumière la pauvreté des rapports.
« Les UVF ça change quoi ? Quand on est ensemble tout est bien mais quand elle est dehors elle fait sa vie. Ça fait quatre ans que je suis là, j’ai dû en avoir douze ou treize (uvf). Vous faites quoi pendant les
1 Plutôt que dépenser l’argent pour les parloirs, certaines familles limitent leur déplacement et favorisent les UVF
130
UVF ? Ils viennent, on fait à manger, je joue avec lui, à la Play (Playstation), on parle, on mange le soir, ils vont dormir et puis nous on reste ensemble. [...] ils arrivent le matin, je leur mets la Play, on regarde la télé et après ils vont au lit et voilà tranquille. Vous faites des jeux de sociétés ensemble ? Pas trop ils sont petits, ils arrivent et direct je leur mets la play. Ils ne sont pas un peu jeunes pour jouer à la Play ? Ils jouent un peu comme ils peuvent. C’est juste histoire qu’ils ne deviennent pas fous, ils sont enfermés, ils courent partout, y a juste une mini cour, ils sont excités, ils veulent tout casser, ils sautent partout, ils crient, tu es obligé de leur donner la Play. Y a pas d’autres jeux ? Si des vieux trucs, des legos, des crayons de couleurs, eux ils sont là, ils jettent tout par terre. Après faut que tu récupères tout et ils jettent sous le canapé, tu marches dessus, c’est relou, mais tu es obligé de faire des enfants, si tu attends quarante-cinq, laisse tomber. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
L’entretien de Jawad contraste avec les deux précédents ; son discours porte moins sur le
plaisir des activités partagées que sur le maintien d’une certaine tranquillité. Trop agités pour
faire des jeux, seule la Playstation semble pouvoir contenir l’énergie de ses enfants de trois et
cinq ans ! Rappelons que l’ainé avait deux ans quand il a été incarcéré et que le cadet est né
pendant sa détention. La distance crée ou accentuée par la séparation a visiblement écorné son
autorité paternelle. Malgré ses nombreux effets positifs, l’UVF ne parvient pas
systématiquement à palier l’absence de quotidienneté.
Le nombre restreint de détenus qui en bénéficient à Liancourt (cinq sur seize !) rend difficile
voire impossible de tirer des conclusions sur ces pratiques. De plus, en se rapportant aux
statistiques, nous notons une présence assez faible d’enfants. Par exemple : en décembre 2013
sur 43 UVF, il y a eu 60 visiteurs composés de 40 épouses, 15 enfants et 5 membres de la
famille. Visiblement, les détenus semblent privilégier les visites conjugales1. Une recherche
plus approfondie est nécessaire pour analyser les différents mécanismes qui se jouent en UVF
et les ressentis des différents acteurs. Ce lieu trouve sa légitimité dans le maintien des liens
familiaux sous couverts desquels se cache un autre enjeu : la sexualité consommée en prison.
« Celui qui « va aux UVF » doit donc fréquemment se protéger de ceux (détenus ou
surveillants) qui tentent de réduire la visite à une stricte consommation sexuelle » [Lancelée,
2007]2.
1 Il est impossible de différencier les anciennes unions avec enfants et les nouvelles unions sans enfant. Un de mes enquêtés voyait sa nouvelle copine en UVF mais pas ces deux enfants issus d’une autre union. Il aurait fallu que le grand-père les accompagne mais l’accès est limité à quatre personnes. Il préfère voir ses enfants en parloir et profiter de sa copine dans un espace plus intime. 2 « Tu vas en UVF ? Non y a certaines choses que j’ai pas envie de faire, par principe. En parloir il se passe des choses entre les femmes et les hommes. Bien sûr, je la prends dans mes bras mais c’est plus par respect pour elle, pas à cause des interdits, comme je t’ai dit j’en ai pas peur mais c’est plus par respect pour elle et moi. C’est de l’ordre de l’intime, on est trop visibles et l’UVF c’est pareil, j’ai pas envie d’emmener ma femme pour passer la nuit, voilà quoi, je préfère une permission et que la juge l’accepte » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]. Sofiane a fait le choix de renoncer aux UVF, il ne désire pas instaurer une intimité avec sa femme au sein de la détention. Est-ce une manière de ne pas cautionner le système pénitentiaire ? L’importance qu’il accorde à la religion musulmane influence t-elle ce qu’il s’autorise à faire dans un espace public ? L’usage ou non des UVF met en lumière les représentations et les pratiques des différents acteurs.
131
Les permissions, un retour furtif vers le dehors
« Quand on sort faut rattraper le temps perdu, ce qu’on a pas eu le temps de faire avec eux. Les journées passent vite avec eux. J’ai trop de choses et ils demandent beaucoup, faut essayer de faire le plus utile pour eux mais ça passe trop vite. C’était comment la première fois ? La première fois, y avait un terrain de jeux près de chez ma sœur et le midi on a décidé de faire un pic nique en forêt près d’un lac. La liberté, la forêt à eux, ils sont partis super contents. Là, j’ai une perm en avril, on va aller au zoo, y a Vincennes qui a ouvert. Il faut faire plaisir aux enfants, c’est surtout pour eux. Qu’ils disent : « ok mon père est en prison mais il m’a amené au zoo », qu’ils aient des souvenirs. [...] Je suis sorti en permission et je regardais ma montre toutes les heures, vu qu’on a un temps limité pourtant j’avais trois jours. Mais c’est une habitude qui va se perdre au fil du temps. En Bretagne on n’a pas de montre. Et comment c’est une permission ? C’était bien, les permissions ça se passe toujours bien, c’est un moment privilégié, on a le temps de les voir, de parler avec eux. Quand je les vois, c’est plus des piles électriques, plutôt que de rester avec moi, je les laisse faire. Ils ont huit et sept ans, on va jouer au foot, puis au basket, on fait du vélo, ils veulent faire beaucoup de choses vu que je ne suis pas là 24h/24. Ils prennent tout à la fois mais c’est plaisant ça leur fait plaisir et moi aussi. Quand je vais en perm je vais à Franconville chez ma sœur, je fais un courrier à mon ex femme et je lui dis l’heure. Y a un rendez vous et là je les ai eu pendant une demi journée et ils étaient contents [...]. Pour quelles raisons c’était aussi court ? Elle avait décidé autre chose avec les enfants, je n’allais pas me mettre en porte à faux avec elle, ce sera la prochaine perm mais bon c’est dans trois mois. Ici les perms, ce n’est pas tous les jours, ni tous les week-end. [...] Le temps passe vite, c’est pour ça qu’on regarde sa montre, la journée passe pas ou plutôt elle passe trop vite. Ça permet de voir des gens, de penser à autre chose. Et comment se passe le retour ? Bon, bah, c’est obligatoire, chacun est conscient, y a quand même un pincement au cœur mais on est obligé de rentrer, moi ça ne me pose pas de problèmes. [...] Je choisis mes jours par rapport à eux, j’ai pris le week-end de Pâcques, quand c’est les vacances c’est plus facile pour eux que s’ils sont à l’école. » [Cyril, 45 ans, séparé, 2 enfants, 3 ans]
Les permissions surviennent dans deux cas de figure1. Dans le premier, une
permission est autorisée ponctuellement pour un événement bien précis (décès d’un proche,
maladie nécessitant un traitement spécifique, changement d’état civil : mariage, divorce,
naissance...). Cette permission s’obtient à tout moment et se limite à une seule sortie. Dans le
deuxième cas, elle est accordée à un moment particulier de la peine (si une libération
conditionnelle est envisagée) et peut l’être à plusieurs reprises. Elle constitue souvent une
première étape avant la sortie définitive pour la préparer en douceur et mieux appréhender le
choc qu’elle engendre. Même si le détenu est libre de ses mouvements, le but de la permission
n’est pas récréatif, d’autres objectifs sont visés : le maintien des liens familiaux, la rencontre
d’un éventuel employeur ou la régularisation de documents administratifs (papiers d’identité,
titre de séjour…).
Les permissions surpassent les UVF par leur petit goût de liberté « ! L’espace de
rencontre ne dépend plus de l’établissent pénitencier bien qu’il en contrôle toujours la durée.
Ce temps extrêmement limité, a une place prépondérante dans les descriptions de la
permission faites par les détenus. Ils établissent une distinction très nette entre le temps lent
1 « Par ici les sorties » : focus sur le principe des permissions de sortie et des congés pénitentiaires Marie-Sophie Devresse, le 27 août 2013 http://www.justice-en-ligne.be/article580.html
132
de la détention et le temps fugace du dehors. Plus il est court, plus il s’accélère. Tandis qu’en
prison « l’impossibilité ressentie de construire des temps vécus ouvre devant l’individu le
vide de l’existence, plus précisément l’inexistence du temps [Guilbaud, 2009].
En revanche, la trop courte durée de cette petite incartade confère une existence savoureuse à
chaque instant vécu.
Elias, dans son essai sur le temps explique : « Beaucoup ne peuvent ainsi s'empêcher d'avoir
l'impression que c'est le temps lui-même qui passe, alors qu'en réalité le sentiment du passage
porte sur le cours de leur vie et peut-être aussi sur les transformations de la nature et de la
société » [Elias, 1997, 28]
Les évènements vécus et la perception de notre propre vie détermine symboliquement la
façon dont nous appréhendons et mesurons la fuite du temps. Ce continuum est évolutif et
socialement construit [Ibid, 1997, 55].
L’importance accordée par les détenus à certains moments privilégiés façonne leurs analyses
temporelles et les inscrits dans une nouvelle temporalité.
Rattraper « le temps perdu » marque la prise de conscience du temps qui s’échappe et des
évènements manqués. Les détenus savent trop bien que rien ne fera revenir le temps ; profiter
de chaque moment passé avec leurs enfants pour constituer une réserve de souvenirs est
essentiel.
Cyril axe la permission sur le jeu et le divertissement, il cherche avant tout à leur faire plaisir
et optimise la rencontre. Cet instant, en rupture avec le temps de la détention figure une
parenthèse déconnectée de leur réalité quotidienne.
« C’était rapide, j’étais content, j’ai pu profiter de mes enfants, j’ai passé deux heures dans un parc à courir, c’était deux heures de plaisir. On a mangé mais sur la perm y a pas grand chose à raconter, j’ai réussi à faire mes papiers, ce qui était galère. Et je ne pensais pas avoir le temps de manger avec mes enfants et finalement j’ai pu manger avec eux. Ils ont grandis de fou, ça grandit vite. Par contre par rapport à moi ils étaient plus réservés, un peu de timidité. J’ai pas eu assez de temps pour parler avec eux, on a plus pensé à s’amuser, on a parlé vite fait de l’école, « tu as fais du sport, de la danse ? ». J’en ai profité pour leur faire des câlins. La grande un peu moins, c’est pas pareil mais les petits je me suis vengé dessus. Elle est grande, 13-14 ans, c’est une petite jeune dame, quand je la vois comme ça on peut plus s’amuser comme on s’amusait avant. Je pense qu’elle avait sa petite timidité, elle était un peu choquée. La première demi heure c’était dur, enfin fallait la faire venir. L’avant dernière c’était la plus enjouée, elle a dit à sa mère que j’allais revenir. C’était marrant. Et donc les premières trente minutes.... C’est parce qu’on s’est pas vu depuis longtemps, ils ont beaucoup grandis et c’est passé. Le temps qu’on parte au parc c’était... c’était trois ans en arrière comme si y avait pas eu de trou. Je sais qu’au fond d’eux... j’avais peur de les voir aussi, j’avais peur de les avoir perdus. J’avais peur de ne pas leur donner assez de temps et de les perturber mais ça va finalement. C’est dur d’un coup, ça faisait mal de pas les voir ici mais d’un côté c’est mieux, de ne pas leur avoir fait la misère du parloir. Pour des familles, ça choque de galérer tout le temps déjà pour des adultes alors des enfants. Tu regrettes ta décision ? Non, j’avais des remords mais pas des regrets. Et quand tu les as quittés ? Je les ai accompagnés à l’école à 13h30. On a mangé et je les ai déposés à l’école et je leur ai dit que j’allais revenir. La petite, elle ne le montrait pas mais le soir, le lendemain, sa sœur m’a dit qu’elle me cherchait partout, elle pensait que j’allais lui refaire une surprise et
133
j’ai dû lui expliquer que pour son anniversaire, j’essayerai de venir. Il est possible que j’ai une autre perm, elle m’a demandé y a combien de 20 avant que je revienne, elle est née le 20 juin, je lui ai dit qu’il en restait 2. [...] et le retour en détention c’était comment ? Moi j’étais perdu, ça te met un coup sur la tête, t’imagines au bout de 3 ans... j’étais perdu mais bon, j’essaye de rester concentré sur cette historie de papiers. Déjà que c’est une galère alors j’ai pas le droit à l’erreur. Alors la perm c’était tellement court, si j’avais pas vu mes enfants j’aurai eu l’impression de pas être sorti. » [Amed, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 3 ans]
La permission de Cyril visait avant tout le maintien des liens familiaux. Pour Amed, actualiser
ses documents d’identités était prioritaire d’où des retrouvailles avec ses enfants trop rapides,
presque brutales. Cyril rencontre régulièrement ses fils en parloir alors qu’Amed les a quitté
trois ans plus tôt. La difficulté de reprendre un rapport père-enfant est angoissante : « j’avais
peur de les voir aussi, j’avais peur de les avoir perdu ». La permission a bien entendu des
effets très positifs mais lorsqu’elle est brusque et mal préparée, elle est aussi perturbante,
comme dans le cas d’Amed. Ses deux dernières filles ne connaissent pas le motif de son
absence, elles imaginent une réalité très différente, il s’avère très compliqué pour le père de
leur donner le change.
Les enfants sont généralement les piliers des permissions, celles ci cependant
permettent également une libre reprise d’activités interdites en prison. Le cas de Quentin est
explicite :
« Comment s’est passée la perm ? ça s’est bien passé, j’ai vu mes petits le matin, on est parti au parc puis j’ai fais quelques courses, c’est passé vite surtout que je les ai eu que la matinée. C’est passé vite. Et puis fallait que je vois un peu ma copine et j’ai vu vite fait les copains. [...] Tu as pris des drogues pendant la perm ? Non, enfin juste du shit et de l’alcool. J’ai commencé à 12h jusqu’à dix-huit heures, toute l’aprèm. C’était bien, j’ai passé une bonne journée mais ça passe trop vite, je voyais que le temps passait vite, déjà la matinée est passée vite, puis on est allé à l’hôtel avec ma copine et après les potes j’ai tisé (bu), j’ai fumé et je suis reparti, c’était déjà fini. [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
Quentin, pour optimiser sa journée la divise en trois : enfant, copine, copains soit paternité,
conjugalité et sociabilité. Il retrouve son mode de vie antérieure avec consommation de
drogue et d’alcool. « La liberté est permise » [Marchetti, 1997, 292], c’est un premier pas vers
la sortie.
La majorité des récits relatés par les détenus décrivent des moments agréables. La durée
relativement courte de leur peine ne les a pas totalement « carcéralisés ». Ils ont maintenus
des liens avec des proches qui les attendent, c’est pourquoi l’extérieur ne semble pas
menaçant. Dans l’ouvrage Perpétuités : le temps infini des longues peines, Marchetti décrit
les aptitudes de certains détenus à considérer les us et coutumes carcérales de manière
totalement irréelles et leurs difficultés à s’y replonger à l'issue des permissions. Contrairement
134
à d’autres qui, pour se protéger, cultivent une vision irréelle de leur passé extérieur en
considérant leur présent carcéral comme leur seule réalité concrète [Ibid, 1997, 394].
Le retour en détention nécessite obligatoirement une rupture avec le dehors et demande le
recours à certaines stratégies pour s’y réhabituer. L’extrait de Jawad illustre parfaitement cette
situation :
« Raconte moi comment c’était ta perm en mars ? C’est passé trop vite ; bien mais trop vite. On est venu me chercher, on est allé à l’école chercher les petits, on a mangé, je suis allé chez mes parents, j’ai acheté deux trois affaires et je suis revenu chez mes gosses et au bout de trente minutes il fallait repartir. Ils m’ont accompagnés. Ça leur a fait quoi de te voir ? C’était une surprise, ils étaient contents mais voilà ils croyaient que c’était pour de bon, je leur ai dit que je devais repartir. On a joué à la console vite fait, la wii, après rien c’est passé trop vite, trop vite. C’est différent du temps en prison... Rien à voir. Tu regardais ta montre ? Oui ça défilait. Et quand tu es rentré c’était comment la reprise ? Normal, j’essaye de me remettre en mode prisonnier, en mode détenu. C’est le mode « tu es un détenu tu es tout seul tu es comme un animal ». On est là on est enfermé, faut essayer d’oublier que tu as une famille, que tu as des gosses, faut oublier. Ici faut être comme tout le monde, faut faire le mec, y a pas de sentiment et j’ai besoin de rien. » [Jawad, 30 ans, concubinage, 2 enfants, 3 ans]
B. LE LIEN INDIRECT EN DETENTION
La précédente partie analysait les représentations des différents lieux de vie par les
détenus1. Le lien indirect composé par le téléphone, les lettres et les biens en possession –
lettre, dessin, objet, photos requiert également notre attention... L’étude de ces éléments sera
plus succincte car guidée par la notion de parentalité, j’ai privilégié les actes et les rencontres
en face à face car elles ancrent plus profondément les émotions qui seront mieux restituées en
entretien. Sans vouloir hiérarchiser lien direct et lien indirect car les deux sont
complémentaires, j’ai pris le parti de centrer mon sujet sur les rapports père/enfant.
Je pensais à priori que les détenus ne bénéficiant d’aucune visite compensaient ce
manque avec le téléphone ou les lettres. Comme nous l’avons vu le parloir représente une
source de contraintes : horaires décalés, distance du foyer, coût des transports, fouilles et
manque d’intimité s’avèrent rédhibitoires pour certaines familles... L’étude de Désesquelles et
Kensey sur les liens familiaux confirme une corrélation entre rencontres physiques et contacts
indirects « la fréquence des visites et l’intensité des échanges téléphoniques et épistolaires
vont de pair ; autrement dit, il n’existe pas de phénomène de « compensation », bien au
contraire. Les détenus qui ont au moins un visiteur par semaine ou par mois sont aussi plus
1 J’entends par lieu de vie, ces espaces temps institués par les établissements carcéraux pour permettre aux individus de se rencontrer et d’interagir.
135
souvent en contact téléphonique ou épistolaire avec une personne de leur famille à un rythme
hebdomadaire » » [Désesquelles, Kensey, 2006, 66].
Le même phénomène se produit pour mes enquêtés, ceux qui passent le plus de coups de
téléphone sont aussi ceux qui entretiennent le plus de rapports avec leurs enfants et
notamment en parloir.
Le téléphone, un rapport quotidien à l’autre
Le téléphone, après le parloir, représente le second moyen de communication des
détenus, il est fondamental puisqu’il favorise l’instauration d’une routinisation des rapports.
Appeler son enfant après l’école pour connaître les détails de sa journée, discuter de ses
problèmes quotidiens, être écouté et écouter l’autre comble la distance. Mes entretiens
confirment un changement important du vécu carcéral grâce au téléphone, il facilite
indéniablement le maintien des relations avec l’extérieur.
Tardivement, en 2009, le téléphone est enfin généralisé dans les maisons d’arrêts ; en centre
de détention son usage y est plus ancien. La loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - Article
39 donne le droit aux détenus de téléphoner aux membres de leurs familles ainsi qu’à des
personnes susceptibles de favoriser leur réinsertion. En dépit de cette amélioration du
système, le détenu devra obtenir une autorisation judiciaire pour chaque interlocuteur. «
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du
bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les
prévenus, aux nécessités de l'information.» 1 L’intérêt du téléphone réside moins dans le
contenu de la conversation que le principe de la présence de l’autre au bout du fil. Ce contact
crée l’espoir… l’espoir d’un retour à la « normale » à la sortie.
Les appels en cabine engendre certains inconvénients : le prix, l’attente d’une cabine libre, la
mise sur écoute auxquels s’ajoutent des horaires contraignantes. La plupart de mes enquêtés
possèdent ou ont possédé un téléphone portable. Leur confiscation conduit certains d’entre
eux à renoncer carrément à l’usage légal de la cabine ou illégal du cellulaire.
« Tu leur téléphones ? Non jamais, quand j’étais incarcéré avant, j’avais un portable mais ici c’est trop risqué, je n’ai pas de cachettes, elles sont trop connues, je ne veux pas me reprendre une peine, je veux sortir. J’ai eu un tél, je les appelais tous les soirs pendant seize mois, ici je ne les appelle pas. Et la cabine ? J’y vais très rarement mais c’est pour ma copine, même mes parents je ne les appelle pas. Si j’appelle mes enfants je tombe sur la mère, y a déjà ça… Et les horaires…C’est vrai que quand j’appelais mes
1 http://www.legifrance.gouv.fr/ Section 4 : de la vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur
136
enfants c’était le soir avant de dormir pour souhaiter une bonne nuit. [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
« A Beauvais, j’avais un téléphone, ici ça craint. A Beauvais, on se parlait, on s’écrivait. Tous les jours, tous les soirs, je l’appelais jusqu’à 4-5h du matin, je m’inquiétais, comme ça je pouvais la réconforter, la soutenir. Elle arrêtait pas de se plaindre c’était dur. [...] La cabine c’est pas pareil, ça dure 10-15 minutes, c’est nous qui rechargeons, ça va vite surtout que j’appelle sur un portable, ça me coute cher et en ce moment j’ai pas beaucoup de travail [...] je dois attendre ma paye et ça m’arrive d’être en galère, parfois je vais voir un copain et je lui demande son tel, je reste cinq minute mais y a pas un jour où je les appelle pas.» [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
Ces inconvénients de la cabine poussent un grand nombre de détenus à prendre des risques.
L’utilisation de téléphones portables est réellement avantageuse, le prix de la communication
est moindre (même si introduire un téléphone est couteux), les horaires sont libres et la mise
sur écoute inexistante. En effet, pour assurer la sécurité et le bon ordre des établissements
pénitentiaires, la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 97 autorise l’écoute et
l’enregistrement des communications téléphoniques des personnes détenues. Cette intrusion
de l’administration pénitentiaire, difficile à accepter, renforce l’autocensure : les confidences
sont réduites dans l’attente du parloir pour les exprimer ou des techniques de communication
sont instaurées.
« Tu sais on fait même entrer des téléphones, ils sont tout petits. Moi j’ai besoin d’entendre ma femme, ça soulage et on n’a pas envie qu’ils nous entendent. Quand on est écouté on parle en argot, en langue de feu, on parle a ̀ l’envers. On sait qui est au contrôle, ils ont 40-50 piges, par exemple penave tu sais ce que ça veut dire ? Non. Ça veut dire parler, les matons on les appelle SS, les avocats, les baveux. Le soir c’est pour parler à la famille, aux enfants ou des exécutions. » [Kyllian, 30 ans, en couple, 2 enfants, 4 mois]
La découverte de la possession de téléphones portables entraine des conséquences lourdes
mais ces sanctions1 n’empêchent pas pour autant la récidive tant la communication
téléphonique joue un rôle important dans le maintien des liens avec l’extérieur.
Selon Chantraine « le déplacement d’une sociologie de la prison vers une sociologie de
l’expérience carcérale laisse entrevoir un affinement possible du concept Goffmanien.
L’institution totale, c’est celle qui tend, infiniment plus que les autres mais sans y parvenir
jamais complètement, à réduire l’initiative à la marge de manœuvre [Chantraine, 2003, 382].
L’usage illicite du téléphone portable démontre une volonté pour ces hommes de contourner
les règles pour créer une certaine forme d’autonomie.
« Et tu as un portable ? Oui j’en ai toujours eu un dans mes peines, les enfants à dix-sept heures ils sont à l’école et ça coûte bonbon, tu as déjà pas de fric pour bouffer et puis y en a partout. Je ne croirais pas quelqu’un qui me dit qu’il ne téléphone pas. Ça revient moins cher qu’une cabine. Dix euros, c’est cinq minutes, c’est plus cher qu’un taxiphone dehors. Et les risques ne t’en dissuadent pas ? Oui j’y pense
1 Toute découverte d’un téléphone portable entraine sa confiscation, le détenu peut, de surcroit, être déclassé dans son travail et au pire relégué au quartier d’isolement. Il perd par la même occasion ses remises de peines, des peines susceptibles d’être augmentées en cas de récidive.
137
dans cette prison c’est plus dur, d’ailleurs j’effectue une peine de téléphone je me suis fais prendre à Nanterre mais la peur, non, juste le fait de téléphoner le soir pour dire bonne nuit, savoir s’il est malade. C’est mieux, la lettre c’est beau mais il en a marre d’écrire tout le temps. Le téléphone tu peux faire pleins de choses, tu peux être présent, même pour l’école. J’avais des contacts avec la directrice, ça fait que pour moi tu t’intéresses à ce qu’ils font et puis pour tes enfants ils peuvent t’appeler à tout moment, où t’envoyer un message. En moyenne tu les as combien de fois ? Vingt fois par jour facile et sans compter les textos. Avant qu’ils partent à l’école, à midi, avant qu’ils se couchent. C’est eux qui me racontent leur journée. On fait les devoirs ensemble par téléphone surtout les maths puis on se raconte nos histoires, et puis j’ai la visio donc on se voit. Tu les vois grandir ? Pas les voir grandir car je ne les vois pas tous les jours mais ils se prennent en photo mais pour moi je les vois pas grandir. Je les ai pas vus même s’il y a le tél je ne suis pas avec eux H24. Les voir grandir, c’est ça. Les anniversaires, Noël j’ai manqué la moitié mais heureusement qu’il y a le tél. » [Amed, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 3 ans]
« La prison ça a changé quoi sur ton vécu de père ? L’éloignement, le manque d’amour des enfants et surtout la séparation. Avant j’avais un portable en cellule, je les appelais le soir, c’était bien. Et en septembre, c’était chaud, je m’en suis débarrassé. Et je suis resté deux mois sans appeler et c’est ça qui a fait que ça c’est dégradé. Moi je voulais appeler à 8h pour les avoir avant l’école, et la cabine s’arrêtait à 18h et c’est à cette heure là que mes enfants rentrent. C’est la galère ici, le surveillant m’a dit qu’il n’y avait pas de tél le dimanche. J’ai fait appeler le chef. Mais moi je connais la prison. Mais en plus ici on a qu’une cabine pour tous les travailleurs et y en a qui abusent et toi tu attends. Tout le monde a le téléphone en cellule. Tu les appelles combien de fois ? Trois-quatre fois surtout le week-end, je les ai appelés hier vu qu’ils sont en vacances. Tu leur dis quoi ? Qu’est-ce qu’ils font et ils me demande ce que je fais, « qu’est-ce que tu manges papa ? » Ils me racontaient qu’ils avaient des devoirs pendant les vacances. Mais ne pas leur dire bonne nuit le soir... on s’y habituait à tout ça... » [Franck, 44 ans, divorcé, 3 enfants, 1 an]
Pour Amed, le téléphone réintroduit une quotidienneté dans les rapports. Malgré une
organisation spatio-temporelle contraignante, il réinvente sa paternité privée de contacts
directs avec d’autres types de pratiques : visio, photos. Il est en mesure de partager des petits
moments qui lui confèrent une place au sein de la vie familiale. Les lettres, sont quant à elles
beaucoup plus contraignantes pour l’enfant, elles ne s’inscrivent pas dans l’immédiateté.
Pour Franck, la perte de son téléphone portable a provoqué un impact négatif sur ses relations
avec ses enfants. Cette perte combinée à l’absence de parloirs, a contribué au délitement de
son rôle de père.
Sans communication téléphonique, les familles sont confrontées à une rupture de
contact, difficile à combler. Le détenu doit surmonter de nombreuses inquiétudes et un
isolement démoralisant. Sans contact régulier et ignorant ce qui se passe hors les murs, il perd
progressivement la place qu’il occupait dans la parentalité. Pour éviter cette perte de
légitimité, « malgré la surveillance, les familles tiennent à maximiser l’utilisation de
l’ensemble de ces moyens de communication » [Bouchard, 2007, 78], d’où la prise de risques
d’introduire illégalement des téléphones. Des conversations régulières permettent au détenu
d’imaginer leur famille invincible : elle peut résister au poids de l’incarcération. Peu importe
les mots échangés, seul prime l’acte de paroles.
138
Les lettres
Les détenus sont autorisés à correspondre par écrit avec toute personne de leur choix
sans limitation mais sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas. Comme les
conversations téléphoniques, le courrier adressé ou reçu est susceptible d’être soumis au
contrôle de l’administration pénitentiaire. « Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les
correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités
administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et
les aumôniers agréés auprès de l'établissement. Lorsque l'administration pénitentiaire décide
de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. »1
Par manque de temps, j’ai survolé la question de la correspondance écrite mais l’impression
qui se dégage de mon enquête est que cette pratique tend globalement à se marginaliser. J’en
déduis (je ne pense pas me tromper) que sa fréquence d’utilisation a diminué avec
l’instauration généralisée du téléphone en prison. Les enquêtes de terrain de Chantraine et
Joël-Lauf, en 2000 et 2010 mesuraient une plus grande importance de l’écriture à l’époque.
Le premier auteur évoquait une « petite évasion » démontrant la porosité des murs et le
télescopage intra/extra-muros. Le courrier, à l’inverse du parloir, permet de matérialiser une
parole fugace, vouée à disparaître avec le temps au profit de mots qui perdurent. « La « petite
évasion », c'est la part concrète et matérielle de l'extérieur - mots de liberté, de soutien et de
lien social - introduite en cellule. » [Chantraine, 2000]. Mon enquête, comme celle de Myriam
Joël-Lauf2, a révélé les difficultés de l’expression écrite, la première étant l’illettrisme. De
nombreux détenus ont un niveau scolaire assez bas et considèrent ce moyen de
communication peu adapté et contraignant. J’entretenais d’ailleurs une correspondance avec
un de mes enquêtés qui m’a très vite demandé mon numéro de téléphone, estimant l’exercice
trop fastidieux (la construction bancale de ses phrases et les nombreuses fautes d’orthographe
témoignent de ses difficultés). Les lettres, pour lui, ne rendent pas suffisamment compte des
idées qu’il souhaite exprimer ; l’écrit risque toujours d’être mal interprété alors que le son
d’une voix ou un face-à-face favorisent une meilleure compréhension. L’usage de la lettre est
plus conséquent au début de l’incarcération tant que les demandes de visites ou d’appels
téléphoniques n’ont pas été acceptées par le juge. Un autre inconvénient majeur existe : les
enfants des détenus sont souvent trop jeunes et incapables de répondre aux lettres de leur père.
1 http://www.legifrance.gouv.fr/ Section 4 : de la vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur, Loi n°2009- 1436 du 24 novembre 2009 - Article 40 2 Les résultats semblent tout de même différents du fait que sa population carcérale est féminine.
139
« Un détenu sur deux incarcéré depuis six mois ou plus correspond ainsi avec une personne de
sa famille proche au moins une fois par semaine. En revanche, 18 % des détenus n’ont aucun
contact de ce type. » [Désesquelles, Kensey, 2006, 66]. Le courrier n’est assurément pas le
meilleur moyen pour communiquer avec son enfant, les entretiens démontrent que les lettres
s’adressent davantage aux compagnes, aux parents ou aux amis.
« J’ai envoyé une carte le 11 avril mais je n’ai pas de nouvelles. Je ne sais pas s’il a reçu mais ça me fait me sentir mieux, je ne peux pas dire que c’est un devoir de père mais bon. » [Franck, 44 ans, divorcé, 3 enfants, 1 an]
« Tu leur écris quoi ? Je leur demande pour l’école, je leur demande ce qu’ils font, que je les aime et qu’ils me manquent je prends essentiellement des cartes postales c’est plus marrant pour ma petite. » [Kalim, 35 ans, divorcé, 2 enfants, 3 ans]
« J’ai une manière de parler, je veux pas qu’on lise mon courrier. Il est lu ? Oui parfois je le fais sortir par le parloir mais entre s’exprimer en face et par lettre, parfois juste le regard, tu exprimes mais dans une lettre la personne va exprimer quelque chose mais pas de la même manière que ce qu’elle voulait vraiment dire. » [Maxime, 31 ans, 2 enfants, 3 ans]
L’écriture représente de nos jours (de plus en plus), un exercice obsolète avec
notamment l’appariation des nouvelles technologies favorisant un contact instantané avec des
messages rapides et courts. « Si les femmes « s’y sont mises » par la force des choses, les
hommes semblent avoir un peu plus de réticence à prendre la plume. La majorité d’entre eux
écrit, mais de façon épisodique. » [Joël-Lauf, 2006] Ecrire à son enfant suppose également de
pouvoir le localiser. J’ai rencontré des pères qui souhaitaient envoyer une carte d’anniversaire
mais qui ne disposaient même pas de l’adresse postale ! A ces difficultés, s’ajoute le fait que
certains pères n’ont pas révélé leur mise en détention rendant impossible toute
correspondance.
Christian Carlier et Laurence Cirba1 soulignent que la maitrise de l’écrit est en prison une
ressource essentielle pour maintenir des liens avec l’extérieur mais le risque de livrer son
intimité au regard de l’administration contribue à tuer l’envie d’écrire. Certains tentent de
faire passer leurs lettres par le parloir pour y échapper.
Les lettres apportent généralement un grand réconfort aux détenus et une source de joies car
recevoir du courrier signifie ne pas tomber dans l’oubli. Dans les moments difficiles, elles
sont lues et relues.
1 CARLIER Christian, CIRBA Laurence [1988] La lutte contre l'illettrisme en prison : enquête exploratoire conduite dans cinq établissements, Paris, Direction de l'administration pénitentiaire, Service des études et de l'organisation in Joël-Lauf, 2006, 74
140
Les photos, les dessins : un peu d’eux à l’intérieur
« Vous avez des photos ? J’en ai plein, j’ai un cahier photos avec les dates, les lieux. On est obligé d’avoir des photos, c’est pour penser à eux tous les jours. Même si on est en prison on souhaite toujours du bien pour ses enfants. Quand ils sont malades, on craint toujours les accidents pour eux. Avoir des photos c’est avoir toujours un œil sur eux même s’ils ne sont pas là. A quel moment vous les regardez ? Y a pas un jour où je ne les regarde pas, je les ai en face de moi, à côté, je les ai en permanence et j’ai le cahier, je mange avec eux. Mais pour moi c’est un moment… c’est comme une évasion, on se dit « tient c’est mercredi, il fait beau qu’est ce que j’aurais fait avec eux, je les aurais emmenés au foot. » Moi ils sont en permanence en face de moi, pour moi c’est une présence. » [Cyril, 45 ans, séparé, 2 enfants, 3 ans]
« Pour Serge Tisseron, les objets ont deux fonctions principales : ils nourrissent les
représentations que nous nous constituons des évènements, en soutenant une « mémoire
vivante » et invitent à ne pas oublier (la « mémoire cachée »). Les photos, sont les supports
privilégiés des détenus pour réactiver cette mémoire, elles font partie, selon Blandine
Mortain, du « prototype des objets sans valeur marchande, mais chargés de valeur affective et
mémorielle » » [Joel, 2006, 90].
En accrochant des photos dans leur cellule, les détenus cultivent le sentiment de vivre
symboliquement avec leurs proches. Le terme d’évasion utilisé par Cyril prend toute sa
dimension en détention où l’espace de liberté est tellement réduit. En composant un support
pour l’imaginaire et la rêverie, une photo établit un pont symbolique entre le dehors et le
dedans.
A travers ces images, les détenus prennent conscience de l’évolution de leur enfant avec un
double effet : se rendre compte des moments manqués et dépasser cette frustration en
actualisent la perception de leur enfant. Ils « ont parfaitement conscience du caractère fictif de
cette sensation face aux changements qu’[ils] n’ont pas vu se faire de manière progressive. »
[Joël-Lauf, 2006]
« Et les lettres tu les relis ? Elles sont toutes gardées dans un gros sac. Je les relis, je les ai même numérotées, j’en suis à 162. A quel moment tu les regardes ? Moments de déprime, quand tu veux te remonter le moral, voir leur écriture, les « je t’aime », les dessins, ça fait du bien. J’ai des dessins accrochés au mur, ça me fait du bien. Ça te fait mal aussi ? Quelques fois quand je vais mal je ne regarde pas, ça fait toujours un peu de mal. Donc faut que je sois pas trop mal, ça peut me saper après encore plus le moral. [...] Ça fait du bien d’en parler à quelqu’un d’autre qu’à la psy. Tu sais, je leur fais des dessins, un mickey même si je sais pas bien mais j’ai un bon dessinateur avec moi en prison. (Regarde mes doigts bleus à cause du stylo qui fuit) Et j’aime bien mettre du bleu sur la main et mettre la main sur une feuille, ils font pareil et là tu vois le changement de taille. Et parfois les photos, je vois aussi Assia qui arrive à l’épaule de sa mère et je lui ai dit d’arrêter de grandir, de m’en laisser un peu et elle me répond « tu as qu’à être là ». Je flippe de me retrouver dehors, de me retrouver avec mes enfants, le premier contact. J’ai les boules, le changement, comment je vais le vivre, moi je suis relou, je suis trop câlin et ils voudront plus et puis je flippe, c’est pas de la peur, c’est de l’angoisse, la boule au ventre. Comment on va gérer ça ? Par exemple, Assia, qui ne savait pas faire de multiplications et maintenant elle sait tout, tu es sur le cul. Tu es pas là, y avait des choses que j’aimais bien faire et non tous ces trucs là… t’y pense à ça mais quand tu dresses le bilan, tu vois l’école, les devoirs, les trucs où tu aurais pu l’aider… mais ça reste rattrapable on peut pas rattraper le temps perdu. [...] Oui tu te sens fier, voilà ma fille, mon fils mais
141
j’évite de trop en parler, plus tu en parles et plus tu te rends compte que tu n’es pas là pour ça, pour si…Tu te dis, ma fille, elle fait du karaté mais tu n’es pas là. Enfin, c’est nourrissant de revoir le courrier, les photos… tout ce qu’est famille, contact, c’est un manque mais ça donne la pêche. Tu regardes bien les traits, les yeux… si tu as pas de photos, la tarte que tu te mangerais si tu vois rien pendant cinq ans. Tu te prends un gros choc. Heureusement qu’il y a tous ces petits trucs là. C’est mieux avec le téléphone, heureusement qu’il est là. » [Amed, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 3 ans]
En détention, chaque pratique qui permet de maintenir un lien avec l’extérieur produit des
effets ambivalents comme explicités dans l’entretien d’Amed : c’est tour à tour, douloureux,
angoissant, rassurant, agréable...
Amed décrit le bonheur procuré par la contemplation des dessins de ses filles, la lecture des
« je t’aime » sur les lettres, la découverte des photos où il les voit grandir ; des satisfactions
bien réelles malheureusement contre balancées par les regrets de rater des choses. Les détenus
n’ont de cesse d’obtenir régulièrement des photos récentes pour pouvoir suivre l’évolution de
leurs enfants.
La plupart de mes enquêtés disposent de photos de leurs enfants mais pour chacun d’eux, leur
usage diffère. Certains, les accrochent au regard de tous, ils désirent les côtoyer en
permanence et bénéficier de leur réconfort quotidiennement. Elles leur permettent également
de s’approprier leur cellule ; en la décorant, ils aménagent un espace plus convivial, plus
humain et donc plus acceptable. Un lien s’établit entre décorer et se remémorer.
« Tes photos elles sont où ? Elles sont sur les murs, les surveillants les voient mais je m’en fous ils sont chez eux, ça me dérange pas après y en a des bâtards. J’ai un pote, il a eu une fouille, on lui a tout vidé, sa cantine, ses affaires par terre et ses photos qu’on lui a déchiré, c’est des trucs… On me fait ça je pète les plombs. Et les voir ça te fait quoi ? Ça me pèse pas, ça décore la cellule, ça me permet de la voir. Je me lève avec, je me couche avec, elle est dans ma tête en permanence. Tu ne peux pas ne pas y penser, si j’avais pas d’enfant, je pourrais faire ma peine tranquillement. Si tu ne veux pas y aller, tu vas bosser à Carrefour. Y a beaucoup de papas ici. Ils sont cons d’être là comme moi, nous ça nous fait du mal sur le coup mais ceux qui souffrent vraiment c’est ceux qui sont dehors. Si fallait payer 100 000 euros pour sortir, je les payerais mais dehors on n’y pense pas. » [Romain, 26 ans, séparé, 1 enfant, 4 ans]
Les photos, dessins, objets sont des biens précieux qu’il faut protéger, préserver… C’est
pourquoi certains détenus préfèrent les ranger pour les soustraire au regard d’autrui et
choisissent les bons moments pour les regarder. Tout regard extérieur est perçu comme une
intrusion dans leur vie privée [Ibid, 2006, 86], une violation de leur intimité qui dérange
notamment Kalim :
« Tu as des photos dans ta cellule ? Oui j’en ai plein. Elles sont accrochées au mur ? Non, tu es malade ou quoi, tu connais pas les surveillants, je les ai dans un album ou dans des enveloppes. Quand tu es plusieurs en cellule, tu vas pas laisser des photos comme ça, du coup, j’ai un album. [...] Tu regardes souvent des photos ? Oui, de mes enfants, il me faut d’autres photos des plus récentes, elles ont un an et il y a eu du changement, ils sont grands maintenant... Ça te fait quoi de les regarder ? Ça dépend comment je suis et à quel moment, ça dépend du moment. Si tu te sens seul vaut mieux pas les regarder, il faut les
142
regarder le matin quand tu sais que tu as des activités ou que tu vois le SMPR, sinon ça fait de la peine, mais c’est bien de les regarder, ils sont mignons, il faut être fier d’eux. » [Kalim, 35 ans, divorcé, 2 enfants, 3 ans]
Ces liens indirects introduisent le dehors dans le dedans et permettent de s’évader
psychiquement, « de se projeter dans un univers hors de portée mais fortement désiré. » [Ibid,
2006].
Plusieurs détenus m’ont expliqué l’importance, pour eux, de réaliser des dessins ou même des
objets pour, à leur tour, introduire une petite part d’eux-mêmes dans leur foyer et rappeler leur
existence. Malheureusement, rares sont les prisons qui autorisent la sortie d’objets par les
parloirs. Ce don contribuerait à compenser une communication parfois maladroite de ces
pères. « Cet objet cadeau, mettrait en avant la personne du donataire, le père, et celui qui
reçoit, l'enfant. Il crée ou renforce un lien affectif entre les deux, car quelque chose de soi
passe dans la chose donnée. Polysémique cet objet parle aussi de celui qui a fait le choix de le
produire » [Dufoucq-Chappaz, 2011, 87].
« Tu te sens mis à l’écart ? Des fois, j’ai peur que mes enfants me repoussent ou qu’ils se sentent rejetés. (silence). Quand tu ne les vois pas tu leur écris des lettres ? Non je leur fais des dessins, ma fille elle aime bien Dora, mon fils, c’est Spiderman, la voiture cars. Je gravais des miroirs aussi mais ici on n’a pas le droit. Je faisais ça à Compiègne, je cantinais un miroir et avec une pointe de fourchette je grattais et on peut mettre de la peinture. Là bas, on pouvait les cantiner, j’ai fait une maquette en allumettes et je leur ai fait une guitare et j’ai mis une photo au milieu et je l’ai sorti au parloir. Ça représentait quoi pour toi ? Comme ça ils voient que je ne les oublie pas, même si je ne suis pas là. » [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
C. LE RAPPORT A LA DETENTION
Entre secret de famille, tabou et mise en récit de l’incarcération
« J’arrive à communiquer avec elles mais elles ne savent pas pour la prison, elles pensent que je travaille mais je vais leur dire. Alicia, elle a huit ans, elle me pose des questions, elle est pas bête, je sais qu’elle a eu le déclic, elle a pensé hôpital. On leur demande d’être sincères avec nous donc nous on devrait. A deux trois reprises, j’ai failli au moins le dire à Alicia, elle commence à avoir un comportement dur et quand elle fait des bêtises je peux pas lui dire qu’elle va finir comme moi. Tu comprends, leur dire que tu es en prison et qu’en plus tu n’es pas là... La pauvre mère subit trop. Je sais qu’elle sait, c’est pour éviter l’explication par téléphone, les deux (filles) sont collées, si tu dis à l’une l’autre saura. Surtout Amina c’est dur. J’ai peur qu’elle en parle à l’école « mon père est en prison », ça reste quelque chose sur eux. Savoir que ton père est en prison... les enfants n’arrivent pas à le garder pour eux, je sais comment… comment ça va être perçu. Mais comment je vais lui expliquer dehors, je ne sais pas. Je préfère être là pour leur expliquer. Ça fait peur l’école aujourd’hui, c’est dur dur. Je sais pas comment ils peuvent l’interpréter à l’école, son père en prison c’est très mal vu même si aujourd’hui c’est devenu une mode…Tu as honte ? Oui c’est un peu une honte de leur expliquer et si on leur ment pas, faut dire pourquoi. T’imagines « Papa il était avec une prostituée, il était plus avec maman donc il était avec une
143
prostituée qui lui a volé trois cents euros et papa l’a tapée » tu vois le truc ? » [Amed, 37 ans, concubinage, 4 enfants, 3 ans]
Dire ou ne pas dire, telle est la question. Certains détenus ne révèlent pas leur
incarcération à leurs enfants. Ne pas faire porter le stigmate carcéral sur leur famille constitue
une des premières motivations. Ils craignent le regard ou le jugement que pourraient porter les
personnes extérieures. « Avoir un proche en prison jette un discrédit sur la famille en raison
de la représentation historique et sociale du prisonnier et, par effet de ricochet, de celle de sa
famille. Le prisonnier, perçu comme un paria sans valeur morale, ne peut pour la plupart des
gens qu’être issu d’une famille à cette image » [Bouchard, 2007, 67]
Amed, lui aussi, redoute les comportements accusateurs à l’égard de ses filles dans la mesure
où son incarcération serait connue au sein de leur établissement scolaire. Avec sa femme, ils
ont pris conjointement la décision de maintenir le secret1, pour lui épargner une possible
discrimination. C’est elle qui subirait par ricochet le poids de cette révélation, en ayant à
justifier une situation qui pourrait nuire à ses filles dans leur entourage.
Cette mesure essentielle évite d’ajouter à la douleur de sa famille déjà suffisamment meurtrie
par son absence une charge supplémentaire.
Le jeune âge de ses filles conforte son choix, elles sont trop petites pour comprendre et ne
sauraient garder le secret. La nature délicate de son délit n’est pas décemment dicible. Amed
en choisissant de cacher sa détention, renonce du même coup aux visites de parloir.
Comme lui, d’autres détenus choisissent ne pas rencontrer leurs enfants en parloir pour leur
éviter une effrayante et parfois cruelle confrontation avec le monde carcéral. Ce choix met en
exergue « the duality of jail and home. These two social locations accounted for their
conflicting identities of inmate and father2 » [Tripp, 2009, 40] Ces détenus privilégient le
maintien de leur identité de pères en mettant de côté leur identité carcérale.
D’autres réussissent à conserver leur secret sans renoncer au parloir et mettent en œuvre de
nouvelles stratégies.
« Le plus grand, il comprend pas la chose, je lui dis que je suis au travail, que je travaille dans une équipe de foot, il est fan et j’ai pas trouvé plus intelligent. Il pense, enfin c’est un grand mot, je pense qu’il me fait croire qu’il croit à mon mensonge mais le fait que je sois plus là... tu ne préférerais pas lui dire ? J’ai souvent réfléchi, c’est clair que je vais lui dire mais je prendrais le temps de lui dire. Et lui dire de la manière la plus simple, avec des mots d’enfant. Que j’ai fait des bêtises et que j’ai été puni, une sorte de prison qui a des liens avec le football. J’ai même essayé de l’écrire sur un papier. Et ton deuxième fils, tu vas lui dire ? Il ne pose pas trop de questions mais c’est surtout à sa mère, il lui demande où je suis. Le premier ne me pose pas trop de questions, c’est ça qui me fait penser qu’il sait qu’il y a un problème. J’ai
1 « un secret survient chaque fois que quelque chose est caché et il est interdit de savoir de quoi il s’agit, voire même de pouvoir penser que quelque chose est caché » [Tisseron, 2011, 8] 2 « La dualité de la prison et de la maison. Ces deux lieux sociaux représentent les identités contradictoires de détenu et de père. » Traduction par Marine Quennehen
144
l’impression que je lui raconte des conneries vu que je lui dis pour le foot. Mais je préfère être dehors et lui en parler clairement parce qu’il a très hâte que je sois à ses côtés. A chaque fois qu’il vient il me demande quand est-ce que je rentre. Lui, il compte en jours, il me dit comme ça (montre sa main), il compte sur les doigts et je lui dis encore un petit peu. » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
Les détenus dans le même cas, repoussent systématiquement l’échéance des explications sur
leur incarcération à leur sortie. Ils ont beau se retrouver entre quatre murs, ils ne veulent ni en
parler, ni même l’évoquer à demi mots. Les termes « prison », « incarcération »,
« détention »... sont des mots bannis de leur langage. Ils s’imaginent capables de maintenir
un secret, alors qu’il ne se réduit pas seulement à un non dit : « des actes de symbolisation
passent par des gestes, des attitudes, des mimiques » [Ibid, 2011, 13]. Malgré l’ignorance
dans laquelle sont confinés les enfants, beaucoup perçoivent la part de mensonge dans les
récits de leurs pères. Un enfant même très intuitif « n’a jamais la possibilité de savoir
précisément si ce qu’il imagine est vrai ou pas. Rien n’échappe à un enfant porté par le désir
de comprendre ce qu’on cherche à lui cacher » [Tisseron, 2011]
Dans ces conditions, comment établir une relation de confiance avec son enfant si son père
supposé représenter l’autorité trahit la vérité ?
Les détenus n’ont guère d’autres ressources que de se décrire comme des « travailleurs
permanents » [Douris, Roman, 2014] persuadés que s’ils disent la vérité elle entrainerait
inévitablement la perte de leur autorité parternelle.
« Mon fils ne sait pas encore vraiment la cause, il tomberait du haut de l’armoire. Moi qui lui parle de valeurs et tout, qui fait du sport, il tomberait des nues. Tu as peur que ça impacte ton autorité ? Oui je pense, je perdrais pas mal de crédibilité et il serait déçu, je pense que voilà je suis son papa avant tout. Il m’idolâtre, il est fier de moi, il prend exemple sur moi, ça le décevrait beaucoup. Et tu feras comment ? Je l’évoquerai, je vais attendre qu’il soit plus mature, quand le moment sera venu. Je ne vais pas précipiter les choses. Je vais pas me dire il faut que je lui dise, je lui dirais quand le moment sera venu mais pas tout de suite. » [Laurent, 38 ans, marié, 2 enfants, 8 mois]
La peur d’être considérés comme des « mauvais pères » et être confrontés à la
décrédibilisation de leur d'autorité les pousse à évoquer leur incarcération par petites touches.
« Il faut cultiver la nuance : révéler la vérité en fardant le détail troublant, pécher par
omission, négocier le mensonge » [Rambourg, 2006, 57]. Le fils de Laurent, dans l’extrait
d’entretien ci dessus, sait que son père est en prison mais le motif de sa peine est
soigneusement maquillé. Ces non dits, qui masquent la vérité, n’ont d’autres motifs d’exister
que pour préserver l’image que son enfant se fait de lui.
L’incarcération engendre chez ces pères des sentiments de honte et de faute, cette
culpabilisation va influencer l’investissement engagé dans l’éducation de leurs enfants. Une
145
inversion des rôles se produit, le père est responsable de ses propres erreurs et doit être
pardonné par ses enfants [Cacialli, 2013, 54].
« Ils savent pour la prison ? Ils le savent mais ils ne le croient pas mais ils n’ont plus autant de nouvelles de moi. En maison d’arrêt, j’avais le tel, ici, je veux pas prendre le risque. Je vais pas vous mentir ceux qui ont des enfants ont un portable mais j’ai une longue peine, je veux pas me ramasser trois mois six mois en plus, c’est déjà beaucoup ce que j’ai. J’ai menti à ma fille, je lui ai jamais dit que j’avais pris onze ans, je lui ai dit un an, deux ans pour pas qu’elle s’inquiète mais mon frère dit tout le temps des conneries, il lui a mis un coup de pression alors qu’il s’occupe pas d’elle, déjà qu’il s’occupe pas des siens et là, il lui a dit « papa a pris onze ans, papa a violé une fille », comme s’il me crachait à la gueule, pourtant parmi les trois (frères) je suis le plus sérieux. Tes autres enfants savent ? Le petit ne comprend pas, je lui disais que Papa travaillait mais je disais que ce n’était pas un travail comme maman, que je devais rester ici, je ne voulais pas qu’il s’inquiète, il est innocent. Ma fille a 10-11-12-13 ans tout allait bien mais à quatorze ans, elle en peut plus. La petite en peut plus, le petit aussi, je le ressens. Ma grande fille a dit que j’avais fait une erreur, c’est dur de lui dire d’une manière enfantine, sans trop lui dire que je suis là. Moi j’avais pas voulu que mes enfants connaissent la prison, c’est ma femme qui a dit qu’ils en pouvaient plus, qu’ils arrêtaient pas de pleurer et elle les a ramenés, c’est mieux mais c’est pas bon, ça leur fait plus de mal. » [Achour, 41 ans, concubinage, 4 enfants, 22 mois]
Achour comme Laurent a édulcoré la vérité mais ses enfants ne sont pas égaux dans leur
connaissance de son incarcération. Et, il arrive fréquemment, que, si le détenu père reste
vague sur le motif de sa peine, quelqu’un d’autre dans son entourage familial, se charge de
dénoncer « le pots aux roses » ; la « vérité » éclate soudainement et fait encore plus de dégâts.
Sans doute serait t’il plus judicieux, pour éviter toute révélation intempestive, de dire la vérité
avec ses propres mots ?
Mais, « Comment éviter que l’évocation d’un secret ne fasse plus de mal que de bien ? »
[Tisseron, 2011, 4]
« Vous leur avez dit pour la prison ? Ça leur a été expliqué, je leur ai expliqué. Le premier, au début, c’était difficile, rentrer en détention, les bruits de clés, les bleus… mais ça l’a pas perturbé pour autant. La prison, il m’a dit « c’est comme ma maitresse qui me met au coin mais y a pas de barreaux ». Ils n’ont pas de difficultés à venir, c’est plus quand ils sortent. Ça les perturbent pas, ils travaillent bien à l’école, y a pas de passages à vide. Comment leur as tu expliqué ? C’est un travail fait par le psy. Je leur disais « quand on a fait une bêtise on est puni on va en prison alors que toi tu vas au coin ». Et les détails de l’incarcération ? Non, ils sont trop petits. Vous leur direz? Je m’attends très bien aux questions qu’ils me poseront. Ce n’est pas le moment de développer. L’enfant a le temps de grandir et de se faire une opinion de son père. Pour eux, les questions ce sera pour plus tard mais en tant que père je m’y attends. Déjà la première c’est « quand est-ce que tu sors ? » J’espère bientôt. » [Cyril, 45 ans, séparé, 2 enfants, 3 ans]
D’après le rapport Liens familiaux et détention : « assumer la réalité de son incarcération
représente pour l’individu détenu le degré de responsabilisation le plus aigu de ses actes à
l’égard d’autrui. » [Douris, Roman, 2014, 93] En prenant la responsabilité d’assumer ses actes
le détenu renforce sa parentalité subjective au lieu de l’affaiblir ; l’enfant cesse de fantasmer
et de s’inquiéter en permanence pour son parent. Mais incorporer la prison à l’organisation
familiale est très difficile et certains préfèrent y renoncer.
146
Cyril, en réalisant un travail avec le psychologue semble être en accord avec lui même.
Assumer son incarcération lui permet de poser les bases d’une relation de confiance et de
mieux vivre sa détention. Ces enfants ne donnent pas l’impression d’être troublés par leur
expérience carcérale.
L’enfant a tendance à calquer ses émotions sur celles de ses parents [Tisseron, 2011]. Les
cachoteries du père risquent d’engendrer inconsciemment un mal-être chez l’enfant qui sent
confusément que la vérité est dissimulée. Au contraire, l’enfant à qui le père a raconté le récit
détaillé ou non de son incarcération sera plus en mesure de se construire psychiquement, sans
faux semblant.
L’individu incarcéré n’est pas toujours l’unique responsable de distanciation entre prison et
maison, des proches, victimes du « stigmate par contagion » nourrissent inconsciemment ou
non la crainte de devenir infréquentables [Feltesse et Al, 2013, 16]. Ils vont d’eux mêmes
pousser à l’exil forcé le détenu pour minimiser ce stigmate.
« Et votre fils le prend comment ? Lui il le prend très mal par rapport à ses copains. Vous lui avez expliqué les raisons de votre incarcération ? Oui, il sait, il ne pense pas à moi, il pense à lui et les répercussions que cela peut avoir. Il m’a dit de fermer ma bouche ici. Il m’a briffé, il ne veut vraiment pas que ses copains sachent. Ses copains parlent beaucoup. Certains connaissent la prison ? Y en a plein qui la connaissent, y en a trois qui vivent dans la cité et qui sont rentrés à Fresnes. Il ne veut pas du coup venir me voir. Quel est le problème ? Il ne veut pas, il aime pas se faire embêter sur ça » ton père est en prison nanana ». Il faut toujours que je les gens bavent, même s’ils oublient après. Ils cherchent tout le temps à se foutre de la gueule de l’autre, à lui faire la honte. » [Mouloud, 69 ans, marié, 2 enfants, 2 ans]
Mouloud, issu d’une cité a de fortes probabilités durant son incarcération de retrouver des
habitants voire des voisins, incarcérés, eux-mêmes ou de les croiser en parloir. Ses enfants,
pour éviter toute rencontre inopinée et être ensuite décriés sur leur lieu de vie, ne souhaitent
pas rendre visite à leur père. L’incarcération, puissant stigmate, marque souvent d’une trace
indélébile le détenu et ses proches.
De la maison d’arrêt au centre de détention
« Il m’ont changé de cellule pour me mettre au quatrième, c’est noir, y a des puces, des fenêtres cassées, pas de porte au WC, elle tient avec du scotch. Je vais m’énerver et ça va finir au mitard. Tout est sale, il y a des puces partout, il fait froid la nuit [...] on doit marcher avec des chaussures tellement c’est crade, j’ai écrit pour parler de toute ça, personne me répond [...] ils nous prennent pour des moins que rien, neuf mois que je suis là, c’est la première fois que je ressens autant ma peine. Ils nous ont changé de place parce qu’on travaille maintenant, mais dans ces conditions je fais plus rien, je préfère arrêter et aller en détention normale. Le travail, c’était pour me changer la tête et ça me créé des problèmes pour rien. J’assume ce que j’ai fait, c’est déjà dur. Faut que je fasse quelque chose franchement, c’est dur. Ici on vit quelque chose de dur et c’est pire encore maintenant, là c’est plus pareil. J’arrive plus à parler en cellule, je ne peux pas, je ne peux plus. Tout est concentré à la prison, tout va vers la prison, j’oublie ce qu’il y a dehors, c’est plus possible. C’est trop. Trois douches par semaine, ils veulent des moutons, faut marcher
147
droit, y a pas le choix, ils veulent des gens qui parlent pas, qui demandent rien. Ils ouvrent la porte, ils la referment. » [Malik, 28 ans, célibataire, sans enfant, 9 mois]1
Mes enquêtes réalisées dans les prisons de Fresnes et de Liancourt, ne peuvent
témoigner que du fonctionnement observé dans ces deux établissements. Il est impossible de
généraliser les disfonctionnements à d’autres établissements. Mes lectures ainsi que les
témoignages recueillis montrent des différences très nettes entre maisons d’arrêt et centres de
détention.
« Les maisons d’arrêt sont généralement des prisons où sont détenus des prévenus en attente
de jugement, des condamnés en attente d’affectation dans un établissement ad hoc (centre de
détention ou maison centrale) ou dont la peine restant à courir est inférieure à une certaine
période (1 an en France). »2 Le régime carcéral se distingue des autres prisons, il doit
s’adapter au statut contraignant des prévenus soumis à une restriction et une surveillance des
communications extérieures – ces restrictions s’appliquent, dans la pratique, à tous les détenus
même les condamnés.
« Le paradoxe de la Maison d’arrêt de Fresnes (prévenus et courtes peines) est qu’elle est
aussi d'une certaine façon la plus grande centrale de France (longues peines), ce qui explique
l’aspect sécuritaire de la détention. »3 La présence du centre national d’évaluation (CNE)4 au
bout de la première division provoque le transit de détenus qui purgent de longues peines et
qui vont attendre leur transfert pendant des mois, voire des années, dans un environnement (la
2e division) où sont également incarcérés des prévenus, deux populations au profil
complètement différent.
Les maisons d’arrêt sont les établissements pénitenciers qui ont la pire réputation :
surpopulation, vétusté, hygiène déplorable, inactivité et promiscuité. Le témoignage de Malik
illustre parfaitement ces mauvaises conditions. Cet état de faits vient « renforcer le constat
selon lequel la peine carcérale reste avant tout une peine corporelle », nous sommes bien loin
des prisons quatre étoiles [Chantraine, 2004, 120].
1 Je n’ai pas inclus Malik à mon échantillon, c’est le seul détenu qui n’avait pas d’enfant. Au début de ma recherche, je souhaitais interroger des non pères, en âge de l’être mais par manque de temps je n’ai pas poursuivi cette voie même s’il serait intéressant d’obtenir d’autres points de vue. J’ai rencontré Malik deux fois et le second entretien a été caduque tant ses problèmes de cellule l’obsédaient. 2 Wikipédia 3 Ibid 4 Appelé jusqu'en 2010 « centre national d'observation », le CNO, situé au-delà de la re division, est un établissement où sont « observés » pendant six semaines des détenus considérés comme difficiles et condamnés généralement à de lourdes peines (reliquat de 10 ans minimum) afin de les orienter vers des établissements correspondant à leurs profils de peines. Ces longues peines sont ensuite affectées, en attente de transfert, en 2ème Division où ils peuvent rester deux ans en attente et dont l’effectif total peut être de 100 détenus. Wikipedia
148
Pour donner un ordre d’idée : Fresnes dispose de 1404 places mais 2368 personnes y sont
écrouées en juillet 2014, une occupation à 168%1 ! Cette surpopulation conduit à des
disfonctionnements généralisés : les informations ne sont pas communiquées et
l’accompagnement est très insuffisant. « L’impossibilité d’apporter aux détenus des réponses
concrètes sur le délai prévisible du transfert [ou de la sortie] constitue une difficulté
importante dans la gestion de la détention »2 et rend toute projection dans le futur, impossible.
« Le fait de n’être que de « passage », même si ce passage risque de s’éterniser, rend difficiles
l’élaboration et la mise en œuvre de projets, si petits soient-ils » [Marchetti, 2000, 33]
Le jugement survient comme un déclencheur pour se projeter dans le futur.
« Ça fait quatre ans qu’on était ensemble, je l’ai fait patientée trois ans avant de la voir et quand le jugement est tombé, elle a accepté de rester [...] on ne parlait qu’au tél, au départ, je ne voulais pas qu’elle vienne, je voulais qu’on attende le jugement pour qu’elle sache ma peine et qu’elle choisisse. Elle est venue au jugement. Franchement, je ne pensais pas ça d’elle, qu’elle m’attende. Je lui ai dit que j’allais gâcher sa vie, je lui ai dit « fais ta vie, moi j’ai gâché la mienne ». Et elle m’a dit « non je t’attendrai » et elle est encore là. [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
Tous les détenus non jugés sont dans l’attente de leur procès. Tant que leur jugement n’a pas
été prononcé, ils sont dans l’impossibilité de se projeter dans le futur. Les projets dépendent
directement de la longueur de l’incarcération, qui, détermine également l’organisation
familiale. En fonction de la durée de la détention à accomplir, les proches vont-ils l’attendre,
vont-ils venir le visiter ? Combien de temps vont-ils tenir ?
Les maisons d’arrêt partagent de nombreuses similitudes avec des salles d’attentes : le
temps y est perdu, le temps inutile y perdure. Les détenus s’inscrivent aux formations, aux
activités3... même en sachant qu’elles ne serviront pas pour leur future réinsertion, dans le seul
but de sortir de cellule, [Chantraine, 2004, 121]. Chaque occasion est bonne à prendre pour
casser le rythme carcéral. « Le temps de la journée carcérale, écrit-il, fort de son expérience
de détenu, ne se déploie pas vers un horizon, mais il bée. Béance d’abime qu’il faut combler
n’importe comment, à n’importe quel prix, sous peine, croit-on, de sombrer. Ainsi tue t-on le
temps qui bée » (Lucas, 1995, 457). [...] Lucas parle du rituel carcéral (promenades, repas,
douches) qui « morcelle la journée de telle façon qu’il est difficile de se consacrer à une tâche
personnelle sans être interrompu, sauf à manquer l’une des promenades quotidiennes »
[Marchetti, 2000, 35].
1 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_juillet_2014.pdf 2 http://www.syndicat-magistrature.org/Compte-rendu-de-la-visite-de-la.html 3 Les entretiens avec moi constituent également une occasion supplémentaire pour sortir de cellule et casser la routine carcérale.
149
Le seul avantage pour un détenu d’effectuer sa peine dans une maison d’arrêt, comme
Fresnes, est de sortir plus rapidement.
« Je préférai faire mon aménagement ici car on sort plus vite mais c’est une autre vie le CD c’est comme si j’étais en liberté, tu as plus d’espace, tu vois plus loin. Ici, je ne vois pas à plus de cinquante mètres. Le grand terrain doit faire cent mètres mais c’est que du béton. » [Kalim, 35 ans, divorcé, 2 enfants, 3 ans]
« J’étais à Nanterre, j’ai fait Fleury, Villepinte. Ici ils comprennent pas comment on fait pour avoir les téléphones, les tablettes tactiles, ici y a des balances, des gens bizarres, des surveillants bons et des cons, y a un peu de confort mais niveau aménagement, ça sort pas. Même pour un transfert, ils ne veulent pas. Je veux me faire dégager d’ici, c’est une prison de cas soc. Moi, je connais que Fresnes et ça semble mieux ici, et puis les détenus ne sont pas forcément intéressés par la bagarre. Fresnes, c’est vieux c’est sale mais c’est comme Fleury, c’est normal, tu sors, tu as des aménagements facilement, même si Fresnes c’est strict. Moi, j’aurais été à Fresnes, j’aurais bien aimé vous parler, je préfère parler avec vous, les surveillants, ils évitent avec moi, ils savent qui titiller ou pas, je fais pas de cadeau, des transferts disciplinaires j’en ai fait, le surveillant, c’est comme un enfant il teste. Il gagne son pain, il m’arrange, je l’arrange, il fait son boulot et ça s’arrête là. [Romain, 26 ans, séparé, 1 enfant, 4 ans]
Les détenus au lourd passé carcéral « peuvent évaluer et comparer les conditions de détention
d’une prison à l’autre selon le statut de l’établissement, son degré de coercition et de violence,
la tradition locale qui guide le comportement des surveillants, l’optique générale de tel ou tel
directeur, la nature des activités » etc [Chantraine, 2004, 119].
La MA apparaît comme un lieu où il est préférable de tenir à l’écart tout ce qui peut rappeler
la vie à l’extérieur. Le transfert en centre de détention est souhaitable, il donne un second
souffle à la peine. C’est un moyen d’en finir avec « ce temps de l’incertitude et de
l’émiettement » [Marchetti, 2001, 37].
« Quand j’étais en maison d’arrêt j’essayais de ne pas penser à eux et de faire abstraction, à chaque fois que j’y pensais ça me bouffait, je me concentrais sur ma peine. [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
Le « centre de détention accueille les condamnés de deux ans et plus considérés
comme présentant les perspectives de réinsertion les meilleures. À ce titre, les CD ont un
régime de détention principalement orienté vers la resocialisation des détenus. »1
En CD, les détenus ont plus d’autonomie2 mais la routine y est toujours bien présente.
1 Wikipédia
2 Le centre pénitencier de Liancourt est composé d’un CD, d’une MA et d’un quartier pour mineurs. L’architecture a été plutôt mal pensée car les établissements communiquent les uns avec les autres, ne permettant pas aux détenus du CD de se déplacer librement entre le socio (activité socio-culturel, formation, école), le médical... et la détention. Ils sont soumis au contrôle continu d’un lieu à un autre, ce qui n’est pas le cas dans d’autres CD. Sofiane raconte : « C’est un centre pénitencier, c’est une MA améliorée, une cellule géante dans laquelle on peut naviguer et dans cette cellule on a chacun la sienne mais on sort jamais de cette cellule géante donc c’est pour ça que je met un bémol. »[Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
150
« Le temps, il passe vite quand tu fumes (des joints) mais ça peut être long. C’est une routine, tous les matins : 8H15, musculation jusqu’à 9h, après 10h activités, pingpong, babyfoot.., 11H30 cellule, 12h gamelle, 13H c’est l’appel, 13h45 activités, rebelote jusqu’à 14h30 puis tu es en cellule jusqu’à 16h30. 16h50-18h10 y a une promenade ou activités jusqu’à 18H, après, tu es en cellule. A 7h du matin, ils ouvrent la cellule pour voir si tu n’es pas mort. Ici, tu ne peux pas dormir, ils regardent à l’œilleton. » [Quentin, 25 ans, concubinage, 2 enfants, 21 mois]
L’entretien de Quentin explique comment le temps est découpé, en CD, « ces dérivatifs ont
comme fonction de passionner et d’absorber suffisamment pour faire sortir le détenu de lui
même et lui faire oublier pour un temps sa situation réelle [...] L’existence du détenu est
administrée par la prison qui dicte des rythmes et produit des séquences, toute activité vient
prendre sa place avant et après une autre, le temps institutionnel de la prison ne laisse pas de
hasard. » Anne-Marie Marchetti, dans son livre sur les longues peines, décrit le rythme de
base : « C’est un fait : ce sont les portes qui donnent le la à une journée carcérale. Leur
ouverture accompagne les grands moments de la vie en détention : les “mouvements” divers
(terme qui en dit long sur l’immobilité inhérente à la réclusion) lors du départ pour les
ateliers, les promenades, les cours, etc., mais aussi les repas ou les passages des cantines. »
(2001, pp. 167-168). » [Guilbaud, 2009, 775-776]
« Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer en détention ? Y a pleins de choses qu’on pourrait changer mais je sais que la parole d’un détenu n’est pas trop prise en considération donc tout ce que tu veux ça sera pas réalisé et c’est pour ça que je veux que rien ne change. C’est à moi de changer si je ne veux pas revenir. La prison, ça reste la prison même si t’ajoutes des trucs. Ce qu’on t’a troqué contre le crime c’est ta liberté. On peut améliorer tout ce que tu veux mais ça reste la détention, tu vas mettre des activités, des babyfoot, des TV mais qui bénéficie de tout ça ? c’est le pénitencier. Ça va occuper le mec pendant sa détention mais c’est plus d’un point de vue psychologique. C’est clairement du foutage de gueule. Pendant que tout le monde est occupé, les surveillants se tournent les pousses, ils sont là, ils sont relax. J’ai pas dit qu’ils foutaient rien mais c’est le système qui fait que. C’est pas en jouant au babyfoot qu’on va apprendre à un mec que dealer c’est pas bien. Y a trop de choses à changer. Ils devraient prendre exemple sur nos pays voisins entre autre les scandinaves qui ont des projets de réinsertion pour ceux qui sont récupérables. En France, des mecs qui penchent un peu, on ne leur donne pas leur chance, ils sont voués à eux-mêmes. [...] C’est mon regard un peu vicieux de la justice, je suis un anti système. » [Sofiane, 32 ans, marié, 2 enfants, 20 mois]
Sofiane analyse finement l’aspect coercitif de la détention pour mieux calmer et contrôler.
Contrairement au temps inutile en MA, où les activités sont rares, le CD met en place des
activités dans le but de faire passer le temps. Les possibilités de se projeter dans le futur et de
réaliser des formations pour se réinsérer sont plus nombreuses. L’argent demeure le nerf de la
guerre dans le milieu carcéral comme ailleurs et les moyens manquent...
151
Le vécu de la détention
Eliot : une peine en évolution
Eliot, 35 ans, est français d’origine Camerounaise et travaillait dans la marine. Il est incarcéré pour violence conjugale depuis trois mois. Je l’ai rencontré trois fois à un mois d’intervalle. Au cours du premier entretien, il m’a décrit l’amour qu’il voue à son fils, à travers de nombreux souvenirs. Il vit son incarcération comme un tournant dans une vie chaotique ponctuée de violence, de trahison, d’alcool et de solitude. Il a conscience de sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés et réalise un constat amer de ses pertes professionnelles, parentales... Il conserve pourtant l’espoir d’un meilleur futur et pense sortir rapidement. Lors du second entretien, il est très abattu et déclare : « je ne te cache pas que je vais baisser les bras [...] Je suis au bout, Marine et je te dis ça au bout de trois mois d’incarcération alors que je sais qu’il m’attend beaucoup plus. » Ses espoirs d’une sortie rapide s’amenuisent, il n’en peut plus... Il a demandé à sa mère de contacter son fils pour le voir. Il n’a toujours aucune réponse à ses lettres. Avant de réaliser notre dernier entretien, j’apprends qu’il est passé en commission, que son ex compagne a porté plainte pour viol, que d’une procédure correctionnelle, il passe en procédure criminelle, ce qui renvoie son dossier aux Assises et risque d’allonger considérablement sa peine. L’entretien est difficile, il explique avoir tenté de mettre fin à ses jours… « on pense que seule la prison peut me faire comprendre mais ça me fait juste enlever tous les sentiments d’humanité qu’il y a en moi. [....] Je ne veux plus penser à l’avenir, dès que je regarde la vie de manière positive ça se retourne contre moi, dès que j’ai un espoir, ça se casse la gueule. Je ne veux plus m’accrocher à rien. » Il n’a plus envie de se battre pour voir son fils et conserver ses droits. Sa détention est vécue comme une catastrophe qui anéantit toutes ses espérances.
Le rapport à la détention est évolutif et ne se résume pas seulement à une rupture dans
la vie de l’individu. En s’appuyant sur la recherche de Myriam Joël-Lauf [Joël-Lauf, 2012]
apparaissent trois types de rapport à la détention. L’auteure s’appuie sur « les concepts
d’incarcéré et décarcéré de Corinne Rostaing d’une part [Rostaing, 1997] et sur les
adaptations primaires et secondaires d’Erving Goffman, d’autre part [Goffman, 1968], pour
distinguer ces trois types de rapport à la détention. Chacun d’entre eux reprend six
caractéristiques déclinées en six rapports : rapports à l’incarcération, rapports à l’infraction,
rapport à la prison dès avant l’incarcération, rapport à la vie carcérale, rapport aux autres
détenues et rapport aux surveillantes »1 [Joël-Lauf, 2012]. Les modèles établis sont d’une
1 « Les détenues ayant une identité incarcérée ont du mal à sortir des murs pour revendiquer une autre identité que celle de détenue ; tandis que celles ayant une identité désincarcérée cherchent à négocier et à rappeler leur identité féminine, que ce soit dans leur rapport à l’esthétique, leur statut conjugal, leur maternité ou encore leur statut de femme active » [Rostaing, 1997].
« L’adaptation primaire consiste en la collaboration de l’individu à l’organisation, au travers de sa participation à une activité demandée dans les conditions requises, sous l’impulsion de motivations courantes telles que la recherche du bien-être, l’énergie que procurent les stimulants et la crainte de sanctions prévues. Il se transforme alors en collaborateur et devient un membre normal, programmé ou incorporé. L’adaptation secondaire renvoie quant à elle à la disposition permettant à l’individu d’utiliser des moyens défendus ou de parvenir à des fins illicites (ou les deux à la fois), et de tourner ainsi les
152
grande richesse et révèlent le caractère dynamique et évolutif du vécu de la détention. Les
détenus adoptent l’un ou l’autre au fil de leur expérience carcérale [Ibid, 2012, 48].
L’exemple d’Eliot illustre l’évolution du vécu de sa peine en fonction de son moral. Son
incarcération a interrompu un cycle de violences dont il fait le point en remettant en question
ses erreurs passées. A mesure que le temps passe, assumer la responsabilité de ses actes ne
suffit plus pour supporter une détention intenable et mortifère. Seule lui reste, l’étiquette de
détenu qui lui renvoie continuellement une image dévalorisante d’agresseur.
La détention catastrophe
« Ils ont détruit ma femme et mon fils, j’ai pas de maison, pas de vie, pas de femme, pas d’enfant, je suis un SDF. Pourquoi ? Dites moi… Vous ne connaissez pas la réponse. Faut en parler de notre malheur, pourquoi on met les gens en prison, pourquoi après tout le monde s’en fiche, comme d’un colis. « Ta gueule toi, tu ne parles plus » je suis juste un petit roumain. » [Angelo, 36 ans, séparé, 1 enfant, 28 mois]
« L’incarcération est vécue comme un choc et une épreuve mortificatoire qui enferme
les détenues dans une identité incarcérée car la prison constitue, malgré leurs efforts pour s’en
détacher, une sorte d’univers spécifique qui tend à les envelopper » (Goffman, 1968) [Ibid,
2012, 49]. Les détenus cherchent à passer pour des victimes de l’institution judiciaire, ils
insistent sur leur douleur, leur souffrance et leur sentiment d’abandon. Ils ont l’impression de
n’être plus rien au regard de la société. Angelo fait le parallèle avec un colis qui n’intéresse
plus personne. Etre incarcéré est vécu comme une perte de droit et une perte d’humanité.
Certains détenus réfutent leur culpabilité, clament leur innocence et tentent d’obtenir de la
compassion [Ibid, 2012, 49].
« L’incarcération est évoquée comme une chute, l’emploi de ce terme renvoyant à l’absence
de ressources protectrices contre les violences de la prison et les ruptures qu’elle
représente (Chantraine, 2004) » [Ibid, 2012, 49].
« Ça fait cinq mois que je suis là, c’est la première fois que c’est aussi long. La plus longue peine c’était 2 mois et 10 jours et là c’est vraiment dur surtout quand vous avez des enfants en plein éveil. Ma fille a 17 ans et demi, elle est très mature. Cette aventure l’a renforcée et elle veut pas se laisser abattre malgré l’épreuve qu’elle traverse mais ce serait mieux sans… (réfléchit) dans sa tête et son équilibre ça aurait été plus intéressant pour elle et plus éducatif mais bon… mon fils a 13 ans et demi, bientôt 14, j’aimerais être là pour son anniversaire, je vais tout faire pour être là. C’est dur pour lui car j’ai toujours été la pour lui, à faire la morale et faire des activités comme le tennis. Des activités qu’il ne faisait pas avec sa mère à la maison. Hors contexte quotidien, il ne partageait pas beaucoup avec elle. J’étais plus disponible qu’elle, j’avais plus de créneaux, j’étais plus accessible, c’était tout bénef et là être sans son papa, c’est dur, il fait moins de choses, moins de tennis, plus de ciné. Avec sa sœur, on allait au parc, à la piscine, j’étais très
prétentions de l’organisation relatives à ce qu’il devrait faire ou recevoir, et partant à ce qu’il devrait être [Goffman, 1968]. » [Joel-Lauf, 2012]
153
proche. Quand je ne travaillais pas, enfin tu vois la raison pour laquelle je suis là, c’est pour trafic de stupéfiants et c’était pendant le travail, ils ne savaient pas que je faisais ça. Quand j’étais en repos, je ne faisais pas de trafic. Je ne me déplaçais pas, c’était que dans le biais de mon travail, vu que j’étais dans un bar c’était facile. Je faisais que réceptionner et donner, je ne vendais pas. » [Laurent, 38 ans, marié, 2 enfants, 8 mois]
Laurent fait le compte de toutes les pertes causées par son incarcération et effectue une
distinction entre le trafic et son rôle de père. Par ce procédé, il cherche à minimiser le délit
commis. Au final que faisait-il ? Seulement « réceptionner » la drogue. La sentence est
évidemment trop lourde par rapport aux faits reprochés.
Une incarcération pas assumée et mal acceptée conduit certains détenus à se replier sur eux-
mêmes. Ils ne souhaitent pas participer à la vie quotidienne en détention, ne sortent pas de
leur cellule ou très peu, limitent au maximum leurs rapports avec les autres détenus qu’ils
considèrent parfois, socialement inférieurs et tentent « de se distinguer en exploitant la
moindre caractéristique susceptible de rappeler leur différence » [Ibid, 2012, 49]
« J’ai plus envie de sortir en promenade. Au lieu de parler de la vie, ils me parlent du business, des trucs bidon, ce n’est pas des conversations. Je préfère qu’on me parle d’autres choses surtout à moi, un ancien braqueur, assassin. » [Maxime, 31 ans, 2 enfants, 3 ans]
« L’impossible familiarisation avec le temps, l’espace, les objets et les autres acteurs nourrit
le sentiment d’une irréductible étrangeté » (Foucart, 2003)1. Contrairement à ce que nous
pourrions penser la détention catastrophe n’est pas réservée qu’aux primaires, ce rapport à la
détention concerne aussi des récidivistes comme Maxime qui connait tous les rouages de
l’institution carcérale mais ne la supporte plus.
Ces détenus restent à distance de l’institution par le conflit, le refus ou le repli sur soi.
La détention passage
« La détention passage renvoie à l’idée d’une incarcération appréhendée comme un
passage dans l’existence, généralement douloureux mais vécue dans certains cas de manière
récréative ou tout du moins comme une pause bénéfique, voire nécessaire, dans une vie
mouvementée » [Ibid, 2012, 50]. Il s’agit la plupart du temps de détenus qui connaissent bien
la prison, qui entretiennent un rapport de familiarité avec le milieu institutionnel et qui
naviguent avec aisance entre leur différents statuts, conjugal, paternel, professionnel [Ibid,
2012, 50].
1 In Joël-Lauf, 2012, 49
154
« On va essayer de redémarrer une nouvelle vie. Je ne vais pas te mentir, la prison c’est club med (surprise de ma part) non enfin on ne peut pas comparer mais c’est une colo, je dis un peu des conneries. C’est un centre de loisirs on croirait que les mecs ont 20 ans et les surveillants ils se prennent pour je sais pas qui, tu as envie de leur dire « vous êtes pas des policiers, pourquoi vous réagissez comme ça » Ils savent pas à qui ils parlent, on connaît leurs plannings, leurs noms, tout se sait, on peut envoyez des potes leur faire peur sans problème. Y a des surveillants ok ils font leur travail mais y en a ils te parlent comme si tu es une merde. Des fois, on prend sur soi. Sinon, si tu pètes un câble, tu retournes au Sud avec les chacals. Ici c’est cool, c’est les travailleurs, les surveillants sont cool. » [Kyllian, 30 ans, en couple, 2 enfants, 4 mois]
L’entretien de Kyllian illustre la légèreté avec laquelle il dépeint le milieu carcéral ; sans pour
autant l’apprécier, il sait en tirer tous les avantages possibles. Les détenus qui entretiennent ce
rapport à la détention s’investissent en participant aux différentes activités avec « une forte
sociabilité carcérale » [Ibid, 2012, 50]. Ils connaissent les surveillants avec qui ils établissent
des relations dans une visée utilitariste1. Ils « participent ainsi à la fois d’une adaptation
primaire et d’une adaptation secondaire intégrée, puisqu’elles procèdent à des arrangements et
à des adaptations officieuses animés par la recherche de leur gain personnel et se livrent à un
« dosage opportuniste » [Goffman, 1968] en exploitant les aspects positifs de la détention à
leur avantage et en en minimisant les inconvénients » [Ibid, 2012, 50].
La prison, pour ces détenus aguerris, représente une partie intégrante de leur monde social,
une trajectoire presque « normale » puisqu’ils ont baigné depuis toujours dans ce milieu.
« J’étais doué pour ça, on ne faisait du mal à personne, ça marchait bien. Les gens avec qui je passais la soirée, le lendemain ils étaient sur le trottoir, criblés de balles (Me montre les marques de couteaux et de balles sur son corps) Vous n’avez jamais voulu quitter le milieu ? On ne peut pas et puis ici je suis pas là pour la réinsertion, on change de cap, moi je sors, je hume la liberté. Je me dirige vers la bonne odeur, ça sert à rien les projets, je laisse ça aux autres. [...] Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Je ne sais pas, j’ai encore à voir une juge d’instruction, mais elle enquête sur du vent. J’ai eu un avocat commis d’office, j’ai dis que j’étais SDF, ils pouvaient rien perquisitionner et puis j’ai eu un mandat de dépôt de quatre jours. Je suis là pour tentative de vol en réunion. Je rigole parce que là j’ai rien fait mais si j’avais été attrapé pour le reste il m’aurait fallu plusieurs vies pour rembourser la société. Là, je coûte de l’argent pour rien foutre, quand vous pensez que j’ai été dans des affaires aux Assises pour attaque à main armé. » [Alain, 59 ans, 2 enfants, séparé, 5 ans]
Alain, par des traits d’ironie et d’humour, explique comment il s’est joué de la justice en
n’effectuant une moindre part des peines qu’il aurait normalement dû effectuer.
Dans le contexte carcéral, sans toujours y croire vraiment, les détenus s’accrochent à leur
espoir de réussir à changer, pour parvenir à vivre ou à survivre, avec les autres, avec eux-
1 « Moi je suis un auxi donc on parle plus, on a des avantages, moi je rigole avec eux (les surveillants), on se casse pas les couilles. Ils savent très bien qu’on a les yeux à l’envers. On connaît l’heure à laquelle ils passent, y en a des cool et le reste c’est des surveillants ce sont des bleus on sait pas ce qu’ils foutent et pour nous c’est des clés. Ils s’embrouillent devant nous alors bon… il y a des clans, ceux des Antilles nous on les contrôle. On les entend discuter, parler de leur orgie, de leur soirée, tu les vois explosés et ils puent l’alcool. Tu leur dis « tu as bu une bière ce soir » ce sont des oufs. Ils te tutoient, et y a des équipes… tu fais le suce boules, tu fais le mec… » [Kyllian, 30 ans, en couple, 2 enfants, 4 mois] Certains détenus partagent les mêmes origines que les surveillants, cela crée des affinités, à l’exemple de Kyllian (loin d’être un cas isolé) qui s’entend très bien avec les surveillants antillais.
155
mêmes. « Accepter sa culpabilité, négocier sa part de responsabilité, oublier pour certains,
vivre avec les remords, pour d’autres » [Rostaing, 1997, 12] sont autant de manières de
subsister.
« Je mens pas j’étais censé tout arrêter, au stade où j’en étais, j’étais chez moi. Je faisais plus tout ce que je faisais avant, j’étais calé. J’ai voulu me poser et au moment où j’ai dit que j’allais tout arrêter, là ils m’ont pris. Ils me prennent de la thune, je dors pas sur mes lauriers, faut payer l’avocat, le loyer, plus cantiner et mes enfants, faut que j’assume dehors, je sais qu’il a pas besoin d’argent mais d’amour, de présence mais je suis au placard, je fais le minimum que je peux, on fait avec. Pour mon ancienne peine j’étais cool, là je sens plus cette peine, elle me fait du mal, je grandis, la vie ne s’arrête pas. [...] Tu as peur pour ton fils ? Ouais je ne veux pas qu’il fasse tout ce que j’ai fait. Faut que tu sois dehors ? Oui faut que je sorte mais même dehors quand tu as fait des bêtises lui il comprend tout. Il m’écoute quand je suis avec des potes, il met mes bijoux, il aime les motos, c’est ma photocopie. Faut faire attention pour les enfants, qu’ils ne prennent pas ce chemin. [...] Je veux pas ça pour mes petits, je l’ai toujours dit, c’est pas parce que j’ai fait de la prison que je vais pas être un père. Je suis un gamin, je suis gavé de la prison. Tu vois quoi pour ton fils ? Prof ce serait bien, je veux pas qu’il soit dans la violence, la délinquance moi je suis dedans je vais pas dire que je suis pas sauvable mais c’est un peu ça. Je veux un putain d’appart en Martinique, je suis bien, j’ai des voitures, de l’argent mais être en prison voilà quoi... je sors de prison et je reste une pige ou deux sans rien faire et après...Recommencer ? Pas vraiment, y a des jours, je me dis je vais arrêter. Quand je me suis fais arrêter je voulais arrêter. Quand ils m’ont pris j’étais chez moi, l’argent rentrait, je galérais, je faisais les magasins. Les gens travaillaient pour moi, je faisais plus tout ce que je faisais. J’ai dit j’arrête, les gens me ramenaient... j’étais en semi, mon pote me ramenait le fric, je faisais que ca mais avant je faisais tout ça tout seul mais là... Tu vas te calmer ? Je comptais arrêter à 30 ans mais ils m’ont déjà pris du temps donc faut que je rattrape, je suis déjà trop vieux pour tout ça, y a des gosses. Tu trouves que c’est compatible ton activité et tes enfants ? Non mais tu crois que je le fais pourquoi, j’ai eu une enfance difficile, je mangeais du pain avec de l’huile, je ne veux pas ça pour mes enfants, ils ont tout mes enfants, moi je n’ai pas besoin de les taper. Je suis un pourri gâté, un papa gâteau, j’aime les câlins. La mère de Nathan quand elle le retrouvait il avait grossi, il avait des coupes de cheveux, tout le temps dehors. Dehors je cuisine pas, y a que ici. Tu sais, quand ils m’ont pris la première fois, j’avais plus rien dehors, j’ai travaillé après la prison, j’ai fait trois cents euros par mois, ça me rendait ouf. Ici, je connaissais rien, t’imagine 390 euros avec le pass navigo, je vivais chez ma belle-sœur. Ici il faut un minimum, entre le pass (de métro), la bouffe, Nathan, j’avais pas de fric alors au bout de quatre mois, je veux bien travailler mais (je souris) j’ai continué à travailler et après je faisais ma deuxième journée de travail que je kiffais plus car je gagnais dix fois le loyer. Je sortais de trois ans de prison, essaye de comprendre, je travaillais de 8h à 17h c’était pas possible. » [Nolan, 26 ans, en couple, 3 enfants, 1 an]
Cet entretien très riche aborde la question de la culpabilité, du rapport au délit et du lien entre
paternité et délinquance.
Avec sa franchise un peu déstabilisante, Nolan explique qu’il n’était pratiquement plus investi
dans son trafic (que représente pour lui la notion d’investissement ?) mais qu’il continuait à
en récolter les fruits. Il exprime également son désir de récupérer le temps perdu en détention.
Il ne se sent pas coupable mais considère que ceux qui lui ont pris sa « thune » le sont. Il ne
manifeste aucun remord et ne semble tirer aucune leçon du passé. La seule raison qui le
pousse à envisager le trafic comme une mauvaise chose est la crainte que ses enfants puissent
emprunter le même chemin. Subvenir à leurs besoins même de façon illégale transcende le
risque d’être pris et par conséquent, d’être séparé d’eux. Il a beau affirmer que l’important
n’est pas l’argent mais l’amour, ses pratiques contredisent ses paroles. Il doute d’être «
sauvable », néologisme sur un état d’esprit partagé par certain nombres de détenus.
156
« Victimes » d’un mode de vie qui les conduit inexorablement vers l’incarcération, ils
n’envisagent pas vraiment d’autres alternatives possibles à leur délinquance.
La détention tournant
« Avant de rentrer en détention j’étais toxico, je prenais de l’héro, du shit, de la coke, vu que j’étais dealer je commençais facilement. Je faisais 65 kg en prison et maintenant j’en fais 80, j’ai tout arrêté, je fume un paquet par semaine. Au moins la prison m’a permis une chose... de changer de vie. Je vendais la mort, j’ai des regrets. J’espère qu’il ne fera pas les mêmes erreurs que moi, qu’il ait une vie heureuse et qu’il ne prenne pas la même direction que moi. » [Timur, 34 ans, concubinage, 1 enfant, 7 ans]
« L’incarcération est considérée comme une rupture avec un mode de vie précarcéral
difficile, précaire et ponctué d’évènements traumatisants, évoquant ainsi les « incarcérations
break » et « protectrices » signalées par Gilles Chantraine [Chantraine, 2004b], dans le cadre
desquelles les personnes rompent avec un mode de vie désorganisé et/ou violent. » [Joël-Lauf,
2012, 51]
La détention représente un moment de réflexion où l’individu prend conscience de ses choix
et de ses actes. Elle permet de s’affranchir d’une existence chaotique et de décider de changer.
Les toxicomanes ou les alcooliques profitent souvent de ce sevrage forcé pour retrouver une
hygiène de vie et réinvestir des rôles notamment familiaux qu’ils n’étaient plus en mesure
d’endosser. L’étude de Tripp sur les pères en prison a montré que les possibilités offertes par
le temps libre, la séparation de la drogue et l’éloignement du milieu présentent une réelle
opportunité pour les détenus avec des problèmes de dépendance. Les participants confirment
que l'incarcération est belle et bien une occasion de «se réveiller» parce que leur esprit est
« clair », et non pas « assombri par la drogue ».1
Ils réfléchissent à la manière d’être de meilleurs parents dans le futur en imaginant les
évènements positifs qui surviendront après leur libération. L’incarcération représente un choc
bénéfique à leur recentrement personnel.
« La prison a modifié ton image de père? J’ai beaucoup changé. Je fais attention à qui je parle, qui je fréquente par rapport à ce que je faisais dehors, j’étais qu’avec des alcooliques divorcés, ils n’assumaient pas, ils faisaient que boire et raconter des conneries. Quand j’y pense maintenant, je me demande ce que je foutais là au lieu de m’occuper de ma femme et de mon fils, je m’en occupais sauf la soirée quand j’étais bourré mais y a en a d’autres ici ils s’en occupaient pas du tout. J’arrivais à assumer mon rôle de père, à part quand je rentrais trop éméché. » [François, 47 ans, en couple, 1 enfant, 3 ans]
1 « Along with the opportunities provided by inmates’ free time, the separation from drugs and associates within drug circles also presented an opportunity for inmates with drug problems to experience turning points. Participants remarked that incarceration is an opportunity to “wake up” because their mind is “clear” or not “clouded by drugs.” [Tripp, 2009, 45] Traduction ci-dessus de Marine Quennehen.
157
François n’accepte pas mieux son incarcération que d’autres détenus mais il réussit à tirer les
enseignements nécessaires pour améliorer ses relations avec son fils. Son sevrage lui a permis
de se rapprocher de son enfant.1
Il existe un réel dégoût de ces hommes pour leurs expériences et leurs identités de détenus,
d’où leur désir que cette incarcération soit la dernière.
« Quand je sors je serais comme un lion en liberté, j’aurai la rage dans le bon sens pour réintégrer le bon chemin et essayer de gagner ma vie mieux qu’avant et sainement et que mes enfants soient fiers sur le long terme et qu’on change sur le quotidien au niveau des valeurs. Donc la prison a eu un effet ? Ah oui, je vais en tirer des enseignements enrichissants dans le bon sens et que dans les 20 prochaines années j’arrive à un but final [...] si j’avais pas eu la prison je me serais peut être contenté et cantonné dans un système de facilités, j’aurai stagné. Peut-être que le temps que je perds je vais peut être réussir plus rapidement finalement même si j’ai eu deux ans de perdu. Et donc grâce à cette épreuve entre guillemet... je ne trouve pas le bon mot... mais bon maintenant c’est le but, c’est atteindre le plus vite des choses que j’aurais pas faites si j’étais resté barman basique et que je m’étais contenté d’un petit salaire, plus le black et le salaire d’appoint frauduleux. C’est peut être un mal pour un bien, je me suis fais interpellé avec pas grand chose mais finalement je me suis fait dépasser par les évènements et peut-être qu’avec le temps j’aurais fait pire avec une plus grosse quantité et j’aurais pris cher. Donc que ce soit définitif et que je tourne la page. » [Laurent, 38 ans, marié, 2 enfants, 8 mois]
L’entretien de Laurent montre le cheminement parcouru grâce à son incarcération, la
libération sera pour lui une nouvelle chance, un nouveau départ qui lui permettra de construire
des fondations plus stables. La détention souvent considérée comme une épreuve inutile
permet, dans certains cas, à l’individu, de murir et de prendre conscience que cette manière de
vivre n’est plus souhaitable ; cette peine doit être et sera sans doute, la dernière. Tripp, dans
l’article Fathers in Jails souligne que cette notion de dernière fois est régulièrement associée à
l’identité paternelle. [Tripp, 2009, 44]. Il est vital que la détention soit la dernière, pour soi
mais surtout pour ceux laissés dehors et qui en souffrent.
Pour certains détenus familiers avec l’institution carcérale, l’âge devient un moteur pour
rompre un mode de vie qui n’est plus en adéquation avec leurs responsabilités notamment
familiale. Laurent l’exprime plutôt bien : il s’est laissé dépassé par les évènements et sa
chance a été d’être pris à ce stade ; plus tard il aurait peut-être risqué une plus grosse peine
s’il avait été pris avec une plus grosse quantité. Etre incarcéré est un mal pour un bien, une
occasion en or pour stopper la spirale de la délinquance et éviter le pire comme les détenues
de l’étude de Joël et Lauf.
« Leur identité est à la fois incarcérée et désincarcérée, dans la mesure où leurs valeurs de
référence se situent à l’extérieur de la prison mais où elles considèrent leur détention comme
1 Comment ça se passe au parloir ? Ça se passe bien, on est plus ouvert l’un à l’autre. Pour quelle raison ? Avant y avait l’alcool, les cachoteries. [François, 47 ans, en couple, 1 enfant, 3 ans]
158
une période décisive et structurante pour un avenir espéré meilleur. Toute leur expérience
carcérale est articulée autour d’une logique de souci de soi, ce qui les conduit à prendre du
recul par rapport à leur environnement et à exploiter au maximum leur détention pour
s’assurer le contrôle présent et futur de leur existence » [Joël-Lauf, 2012, 51].
CONCLUSION : VECU DE LA DETENTION ET LIEN AVEC L'EXTERIEUR
Cette partie a démontré l’influence du vécu de la détention sur de l’usage des
différents lieux et dispositifs qui lient le dedans/ le dehors. Les liens directs et indirects
montrent qu’une meilleure appropriation des lieux optimise l’utilisation qu’ils en font. Le
rapport à la prison dépend du niveau d’acceptation de la peine et détermine l’expérience
quotidienne des détenus, leur façon de passer le temps et de penser à l’après [Rostaing, 1997,
48]. Le poids du contexte coercitif est déterminant mais ne prive pas, pour autant, les
individus incarcérés, de leurs capacités de projets et de stratégies [Joël-Lauf, 2012]. Ils ne
sont pas les simples pantins de l’institution. Vivre sa paternité en milieu carcéral dépend
principalement de la capacité du détenu à s’adapter aux contraintes mais aussi de la nature des
liens pré carcéraux qui influenceront la relation future.
« L’éloignement ne signifie pas pour autant une séparation, les relations et les contacts
peuvent demeurer (parloirs, téléphone, courrier), mais les relations s’installent et s’éprouvent
sur un registre imaginaire. » [Rambourg, 2006, 43] D’un côté ou de l’autre du mur, les réalités
différent, celui qui est dedans projette sur celui qui est dehors une perception idéalisée ou
terrifiante. L’ouverture de la prison et sa porosité favorisent l’entrée du dehors dans le dedans
mais ce pont entre deux mondes révèle le décalage du temps et de l’espace vécus par chacun
des acteurs. La routine carcérale est difficilement transposable à la routine familiale.
Le détenu, pour effectuer au mieux sa peine, doit se soumettre au temps de la prison, le seul
qu’il puisse maitriser, saisir et ressentir ; le futur, dehors, ce temps lointain et incertain reste
insaisissable. Le paradoxe carcéral tient dans le fait que le détenu est tenu de se projeter dans
le futur alors que la durée de sa peine rend toute projection illusoire. Etre père en détention
représente dans le même temps une source de frustrations et d’espoirs.
159
CONCLUSION
Les quelques études sur la paternité en détention se limitent pour la plupart à deux
aspects : l’intérêt pour l’enfant de connaître son père afin de permettre une constitution
psychique équilibrée et l’importance du maintien des liens dans le but de favoriser la
réinsertion. Pour être en mesure de considérer l’évolution des liens, l’analyse doit
nécessairement étudier l’antériorité des liens qui constituent chaque paternité. Cette notion de
maintien ne permet pas de distinguer la fonction parentale des autres relations familiales
[Douris, Roman, 2014, 134].
Cette enquête a donné la parole à des hommes trop souvent réduits au silence pour rendre
compte avec le plus d’objectivité de leurs représentations et de leurs pratiques. Le cœur de ma
recherche repose sur le principe qu’avant d’étudier la signification du « rester père » en
détention il est nécessaire d’appréhender ce qu’est « être père ».
La prison d’hommes apparaît tel un puissant relai du modèle contemporain de la
paternité : un statut qui, après une mise en couple hétérosexuelle, conclue l’union par le projet
d’un enfant. Etre père, c’est la capacité de répondre aux besoins matériels, psychiques et
affectifs de l’enfant1. Ce modèle de paternité domine dans les représentations des pères
détenus mais se retrouve réduit par les logiques d’enfermements qui limitent leurs capacités
d’action. En s’éloignant de ce modèle de paternité ils se retrouvent en crise par rapport à leur
rôle. Ils se sentent pères sans l’être complètement. Leur statut ne suffit pas pour ancrer leur
sentiment paternel, seule la pratique leur donne un sentiment de compétences.
La prison d’hommes conforte et remet en question les modèles de conduites
traditionnellement assignés aux pères - et plus généralement aux hommes. La non
homogénéité des pères détenus souligne les différences de représentations et de pratiques au
sein de la détention. Quatre logiques se dégagent : la paternité comme point d’appui, son vécu
négatif, la valorisation – parfois excessive – de l’enfant et l’abstraction de la paternité grâce à
différentes stratégies.
1 Il s’agit d’un engagement paternel qui repose essentiellement sur la présence physique et la prise en charge de tâches et de responsabilités relatives à l’enfant, d’un soutien affectif, des interactions père-enfant significatives et d’une contribution financière et matérielle. (Lamb et al, 1987) in [Ouellet et Al, 2006]
160
De prime abord, émerge l’idée que ces hommes sont dans l’incapacité d’être pères par
le fait même de leur incarcération, ils sont néanmoins nombreux à manifester un réel
attachement à leurs enfants et à souhaiter des contacts et du dialogue. « Ils témoignent d'un
vécu, riche et sensible, de leur paternité, lorsqu'ils ont l'occasion de s'exprimer » [Delumeau,
Roche, 2000].
Ils énoncent pour beaucoup un désir sincère de changement dans leur style de vie (arrêt de la
drogue et de la délinquance) et d’une prise de recul par rapport aux modèles familiaux vécus
sans, malheureusement disposer des ressources nécessaires pour y arriver. Certains
découvrent leur rôle de père en prison, essayent d’assumer leurs responsabilités et entament
une réflexion sur eux-mêmes avec une remise en question délicate sur leur passé. D’autres au
contraire, subissent une situation qu’ils n’ont pas toujours choisie et laissent, impuissants, les
liens avec leurs enfants se dégrader1. Ces pères partagent avec leurs homologues en liberté
des compétences ou des incompétences identiques.
Interrogés sur cette question, ils accordent beaucoup d’importance à leurs enfants alors que
les faits démontrent parfois l’inverse avec des relations peu suivies et des liens déjà distendus
avant leur incarcération. Evoquer leur paternité, leur fait prendre conscience que dehors ils
disposent d’un support affectif leur permettant de constituer un projet.
Leur incarcération a, cependant, tendance à nourrir un sentiment d’échec dans l’exercice de
leur parentalité. Les liens père-enfant se manifestent essentiellement par les pratiques (Parloir,
UVF, téléphone, lettres...) mais celles ci sont si limitées que leurs droits bafoués ne diffèrent
guère de ceux des détenus sans enfant. Idem pour leurs difficultés à établir leur filiation2 ce
qui constitue une privation de leurs droits3.
Mon hypothèse de départ : avoir des enfants influence le vécu de l’incarcération. Elle est en
partie vraie mais c’est surtout la présence ou l’absence de proches qui sera, globalement
déterminante. Le manque de soutien représente un lourd handicap pour l’après carcéral et
l’absence de liens, une source de mal-être. De plus, l’incertitude institutionnalisée (date de
sortie, transfert, permission, annulation d’une activité, d’un parloir) subie par les détenus
réduit leur capacité à se projeter sur le court, le moyen ou le long terme. Le temps carcéral et
1 Un cas fréquent : celui de pères qui à l’issue d’une séparation ou d’un divorce perdent le contact avec leurs enfants ou voient leurs relations avec eux se dégrader petit à petit. 2 « L'article 316 du Code civil dispose que « lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance ».[…] La reconnaissance est un acte purement personnel réalisé exclusivement par la personne concernée. Aucun représentant ne peut se substituer au père incarcéré pour reconnaître son enfant. Le détenu est contraint d’effectuer une démarche auprès du greffe et de fournir les pièces nécessaires pour que l'officier d'état civil de la commune dont dépend la prison se rende au sein de l’établissement. Le temps d’attente est souvent long, car l’officier attend généralement plusieurs demandes de pères dans cette situation pour faire le déplacement. 3 Quelques détenus ont évoqué leurs difficultés administratives et leurs désirs que leur enfant porte leurs noms.
161
le temps familial sont difficilement conciliables. Les pères sont écartelés entre deux
institutions qui exercent sur eux des pressions continuelles (responsabilité, autorité,
contraintes, hiérarchie...)
La prison n’ayant aucune valeur spécifique, elle ne peut être dissociée du reste de la société,
et être considérée comme un isolat social. La paternité subit des transformations perpétuelles
sans être forcément conditionnée par le milieu dans lequel elle s’exprime. La rupture des liens
n’est pas une fatalité, les changements opérés relèvent d’une adaptation et « dans une certaine
mesure de la pénétration consentie du milieu » [Joël, 2007, 188]. Les propos tenus par
Welzer-Lang, Mathieu, Faure sur la sexualité des détenus concernent également la paternité :
« La prison ne modifie pas d’elle-même, par l’effet exclusif de l’incarcération, la façon dont
les individus vivent et se représentent la sexualité [la paternité], mais elle offre plutôt à celle-
ci des conditions spécifiques d’actualisation qui contribuent à lui donner ses caractéristiques
propres » (Welzer-Lang et Al, 1996)1. Les effets du lieu ont une influence incontestable mais
leur attribuer une trop grande prépondérance laisse supposer une passivité des individus et
leur nier la possibilité d’agir. Nous savons que l’impact de l’incarcération est variable d’un
individu à l’autre.
« En dépit des contraintes carcérales et de la force de la coercition, il est donc apparu que les
détenus ne subissent pas passivement la domination qui leur est imposée. Leurs actions
renvoient à des logiques différenciées leur permettant de s’aménager une marge de manœuvre
plus ou moins étendue » [Joël, 2007, 189]
Selon Gilles Chantraine, les détenus ne subissent pas de véritable dépersonnalisation et
adoptent des logiques d’action qui « épousent, contournent, remodèlent, et, parfois,
transcendent ces contraintes. » [Chantraine, 2003].
La prison devient un laboratoire privilégié d'analyse du social (Faugeron, 1996)2 pour
appréhender les normes qui régissent plus globalement notre société.
L'ambivalence face au temps qui passe est un thème récurrent et ambivalent : « une année de
plus dans sa vie, c'est aussi une année soustraite à la peine » [Marchetti, 2001, 178].
L’ambivalence apparaît également avec le temps long de l’incarcération a contrario du temps
rapide du dehors, conduisant à une difficile actualisation des évènements. L’évolution des
pratiques et des représentations, nécessite de prendre en compte la période précarcérale et
carcérale. La paternité n’est pas figée et se meut au gré des événements de la vie.
1 In Joël, 2007, 188 2 In Combessie, 2009
162
Au temps, s’associe l’espace. Les pratiques et les représentations des acteurs diffèrent selon
les espaces dans lesquels ils évoluent.
L’espace carcéral se caractérise selon Foucault par la mise en œuvre d’une discipline
[Foucault, 1993] qu’il définit comme «un type de pouvoir, une modalité pour l’exercer,
comportant tout un ensemble d’instruments, de techniques, de procédés, de niveaux
d’application, de cibles ; elle est une ‘physique’ ou une ‘anatomie’ du pouvoir, une
technologie » [Ibid, 1993]. La prison serait le lieu par excellence de la discipline. Il faut
cependant, distinguer le contrôle disciplinaire carcéral et le contrôle auquel se soumettent les
individus eux mêmes. Par exemple, certains détenus limitent l’usage du parloir pour ne pas
confronter leur identité incarcérée et celle de père, d’autres encore renoncent aux UVF pour
ne pas réduire la rencontre avec leur compagne à un assouvissement de leur désir sexuel ; ces
individus agissent et s’auto contrôlent selon une grille de valeurs établies par delà
l’institution.
« Relativiser le surdéterminisme de la structure carcérale ne signifie pas méconnaître le poids
des contraintes, mais invite à ouvrir l’analyse à d’autres facteurs prépondérants dont l’effet se
donne moins facilement à voir, à l’instar des normes sociales. L’approche en termes d’acteurs
carcéraux pris dans le social s’est révélée heuristique, car elle a permis de signaler entre autres
le caractère complexe et multiforme des processus de contrôle » [Joël-Lauf, 2012, 409].
Cette position permet de quitter « le registre ‘chaud’ de la révolte, de la dénonciation ou de
l’indignation » (Pollak, 2000, 182)1 et d’adopter une vision plus nuancée.
L’analyse de l’espace-temps se révèle d’une grande richesse pour comprendre le rapport
qu’entretiennent les individus avec leur détention et leur logique d’action. Donner la parole
aux acteurs eux-mêmes est le seul moyen de respecter au plus près ce qu’ils vivent, ressentent
et pensent.
Mon mémoire a ses limites et de nombreux points mériteraient d’êtres approfondis ; en
proposant une étude globale de la paternité en milieu carcéral, j’ai privilégié une vision
générale et l’étude des liens entre le pré-carcéral et le carcéral.
Mes quelques entretiens informels avec des professionnels pénitenciers n’ont donné qu’une
vision très partielle de leurs relations aux détenus, entre eux-mêmes et du rapport entretenu
avec leur profession. Il serait intéressant d’approfondir pour étudier les effets de hiérarchie et
les similarités ou les différences des représentations au sein d’un même lieu. Mettre en
perspective les multitudes de relations qui existent en détention, renvoie à l’idée de capillarité
1 In Joël-Lauf, 2012, 409
163
de Foucault où « des fils innombrables, aux mille canaux, aux fibres infinies » (Jackson,
1975)1 s’entrecroisent.
Réaliser une enquête en détention nécessite de surmonter de nombreux obstacles et de
respecter une méthodologie qui ne réduit pas les entretiens à une simple récolte de données. Il
faut également souligner la difficulté de travailler sur les ressentis et les émotions. Les sujets
évoqués au cours des entretiens rappellent des évènements douloureux : le matériau produit
est délicat et fugace. Parler de soi, cet exercice difficile implique de se confronter à une réalité
souvent impossible à assumer. « La palette des sentiments est infinie et complexe, il faut se
raisonner, rester le plus objectif possible pour retranscrire le plus fidèlement la teneur des
discours et il ne faut pas oublier que la réalité est bien plus complexe que la présentation
schématique que nous en faisons. » [Joël, 2007, 1993].
L’enquêté est un sujet agissant et pensant qui, en donnant de lui même, espère capter un peu
du chercheur. La relation enquêteur/enquêté, empreinte d’attentes divergentes aboutit à une
co-construction de la recherche.
La question de la fiabilité du matériau récolté est toujours présente et le doute subsiste sur la
véracité des discours, étant donné l’impossibilité de procéder à une véritable observation. La
situation d’enquête repose sur la confiance mais nécessite une prise de recul de la part du
chercheur. La vérité émane davantage de la construction personnelle de l’individu que de son
propos, l’important « n’est pas tant de démêler le vrai du faux, mais la façon dont l’individu
se met en scène, se représente et se pense » [Rebreyend, 2003]2
La prison ne laisse aucun acteur indifférent et produit en chacun des émotions ambivalentes.
A travers l’analyse du pré carcéral, la paternité apparait comme un long travail de
construction en constante évolution et régit par une succession d’étapes : le rapport à ses
propres parents, la conjugalité et le contexte dans lequel arrive l’enfant. Ces étapes sont
appréhendées de manières différentes, selon les individus et permettent de noter les
différences ou les ressemblances avec les modèles qu’ils ont connus.
Pour approfondir cette étude, il faudrait élargir le réseau familial car « la paternité s’inscrit
dans une amplitude relationnelle lisible tant dans les usages sociaux de la parenté, qui
permettent de la replacer dans un cercle familial étendu, que du point de vue de la
transmission d’une identité familiale » [Martial, 2012, 131]. Je n’ai pas abordé les relations
fraternelles alors qu’elles revêtent une importance primordiale, en terme de solidarité ; dans
les familles où le père est absent, un frère représente la présence masculine et fait office de
1 in Chantraine, 2000 2 In Joël, 2007, 190
164
guide1. Les sœurs, quant à elles, tiennent parfois la place de « seconde mère » en prodiguant
soins et conseils à leur neveux et nièces. L’arrivée d’un enfant dans une famille souligne
l’existence ou non des liens intergénérationnels. Il est fréquent que la mise en couple du fils
hors du modèle familial soit source de conflit et ne favorise pas sa « légitimité » à devenir
père. Les discordes mettent en lumière les modèles de référence de chacun des conjoints et les
possibles tensions qui émanent de ces choix. L’enfant, permet, aussi, parfois de rassembler et
de réunir là où le lien c’était distendu2. La paternité du fils donne une nouvelle dimension à la
famille.
Certains enquêtés plus âgés sont devenus grands-parents et l’entrée dans la parentalité de
leurs propres enfants a une influence certaine sur la perception de leur propre paternité. La
grand-parentalité instaure des nouveaux sentiments, voir une réactualisation de la paternité3
qu’il serait également intéressant d’étudier.
Parallèlement, un suivi longitudinal postcarcéral, permettrait de « mesurer la portée des
évolutions survenues au cours de l’incarcération et voir si celles-ci survivent à la déprise du
milieu carcéral » [Joël, 2012, 408]. L’expérience carcérale est susceptible d’induire une
transformation des représentations et des pratiques attachées à la paternité qui vont influencer
le postcarcéral. Malheureusement peu d’études sur le postcarcéral existent à ce jour.
Pour saisir la paternité dans sa globalité, il semble également indispensable d’axer la
recherche sur la sexualité et la masculinité. L’entrée dans la sexualité apporte t-elle un
éclairage pertinent sur l’entrée dans la paternité ? Quel rapport entretiennent-ils à la sexualité,
au corps de la femme ?
« Comment ces hommes perçoivent-ils, entre paternité et masculinité, leur statut et leur
identité sexuée ? » [Martial 2009, 98] Aujourd’hui, la définition « conventionnelle » de la
masculinité associée à la virilité, la force physique et l’hétérosexualité semble érodée [Ibid,
2009, 99]. En est-t-il de même en prison, dans ce monde essentiellement masculin ? Le
modèle de la masculinité conventionnelle s’oppose-t-il à la paternité, axée sur l’affection, le
1 Eliot exprime l’espoir que son frère soit présent pour son fils en son absence, il est profondément déçu qu’il n’en n’est rien « J’aurai voulu qu’il ait une présence d’homme, ça aurait dû être mon frère, il aurait dû le faire de lui même, au moins le voir une fois tous les deux mois. »[Eliot, 35 ans, séparé, 1 enfant, 2 mois] 2 L’arrivée de la fille de Lahcen lui permet de tisser une nouvelle relation avec sa propre mère : « Et votre mère avec votre fille comment ça se passe ? ça se passe bien. Quand je me suis mis avec ma compagne c’était plus compliqué, elle était traditionnelle. Quand elle a su que j’étais avec une bretonne ça a été le conflit mais quand j’ai eu mon enfant elle est devenue grand-mère donc elle était contente. C’était le premier et puis je n’ai pas de frère. Ça m’a beaucoup rapproché d’elle. Je n’étais jamais avec elle avant la naissance. Et quand ma fille est née elle venait souvent » [Lahcen, 47 ans, séparé, 1 enfant, 5 mois] 3 « Qu’est-ce ça fait sur votre rôle de père de devenir grand-père ? On a tout oublié, c’est loin tout ça pour moi alors quand on a ses petits enfants on se rappelle. Ma fille j’étais pas beaucoup là donc du coup, j’ai abusé avec mes petits-enfants, j’étais tout le temps présent pour ma petite fille. Ma femme avait vraiment découvert ce qu’est être parent moi beaucoup moins. Vous me donnez le sourire d’en parler. » [Mouloud, 69 ans, marié, 2 enfants, 2 ans]
165
discours ? Peut-on parler d’une transgression des normes de genre ? La prison redéfinit-t-elle
l’identité masculine ? Cette redéfinition apporte-t-elle davantage de légitimité au rôle de père
au sein d’une institution où encore peu de place lui est accordée ?
Dans ce cadre, une « comparaison entre les prisons de femmes et les prisons d’hommes [est]
une piste de recherche intéressante à explorer, à la condition que la démarche comparative ne
renvoie pas cette fois à un questionnement en creux mais bien à une mise en relation éclairée
des analyses présentées dans l’ensemble des études portant sur le sujet. » [Joël-Lauf, 2012,
405].
Les sujets de recherche en milieu carcéral sont multiples et passionnants.
La paternité pose les problématiques de parenté et de parentalité voire même d’un
ensemble plus large de liens à la fois « verticaux et horizontaux noués entre des personnes
appartenant ou se sentant appartenir à une famille : ascendants, descendants, collatéraux, [...]
Ainsi, les parentés biologiques, sociales ou symboliques désignent des places que chacun est
libre ou non d’occuper dans le cours de la vie réelle. » [Mehl, 2009,101]
La richesse de nos sociétés contribue à laisser une plus grande place aux individus dans la
cosmologie familiale. Faire famille devient un choix individuel et collectif. La filiation
contemporaine est différente des autres liens qui perdurent tout au long de la vie. Des liens
forts entre ascendants et descendants se conjuguent à tous les temps; une mémoire se
constitue pour ceux qui ne sont plus et pour ceux qui ne sont pas encore. D’autres liens sont
alors possibles, des liens électifs qui tiennent de l’affection. 1
1 Inspiré du Discours d’ouverture d’Irène Théry sur le rapport Filiation, origines, parentalité le 9 avril 2014.
166
BIBLIOGRAPHIE AIRALDI Chiara, Gli « affetti incarcerati »: il detenuto della Casa di Reclusione di Saluzzo e le sue relazioni affettive, mémoire d’éducation professionnelle sous la direction de Parola Alberto, Università degli studi di Torino, Torino, 2007. ALLARD Francine et BINET Lise, Comment des pères en situation de pauvreté s’engagent-ils envers leur jeune enfant?: étude exploratoire qualitative, Beauport, Régie régionale de la santé et des services de Québec, Direction de santé publique, 2002. BAJOS Nathalie, BOHET Aline, GUEN Mireille LE et MOREAU Caroline, « La contraception en France : nouveau contexte, nouvelles pratiques ? », Numéro 492, sept. 2012. BEAUD Michel, GRAVIER Magali et TOLEDO Alain de, L’art de la thèse : Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net, Édition : édition revue et corrigée, Paris, Editions La Découverte, 2006, 202 p. BEAUD Stéphane, « L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’«entretien ethnographique» », Politix, 1996, vol. 9, no 35, p. 226-257. BEAUD Stéphane et WEBER Florence, Guide de l’enquête de terrain : Produire et analyser des données ethnographiques, Édition : 4e édition, Paris, Editions La Découverte, 2010, 331 p. BECKER Howard, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales, Paris, La Découverte, 2002, 352 p. BECKER Howard S., Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 247 p. BEDARD Denise et INKEL Carole, « Paternité et adolescence », Service social, 1988, vol. 37, no 1-2, p. 158. BEDIN Véronique et FOURNIER Martine, La parenté en question(s), Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2013, 235 p. BERGER Peter, MERLLIE Dominique et MERLLIE-YOUNG Christine, Invitation à la sociologie, Paris, Editions La Découverte, 2006, 249 p. BIDART Claire, « Parler de l’intime: les relations de confidence », Mana, 1997, vol. 3, p. 19-55. BLÖSS Thierry, Les liens de famille: sociologie des rapports entre générations, Paris, Presses universitaires de France, 1997, 176 p. BOUCHARD Géraldine, Vivre avec la prison : Des familles face à l’incarcération d’un proche, Paris, L’Harmattan, 2007, 108 p.
167
BOUMAZA Magali et CAMPANA Aurélie, « Enquêter en milieu « difficile »: Introduction », Revue française de science politique, 2007, vol. 57, no 1, p. 5. BOURDIEU Pierre, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, vol. 62, no 1, p. 69-72. BOUREGBA Alain, « De la rupture au maintien des liens », Hors collection, 2002, p. 7-13. BOYER Danielle et CEROUX Benoît, « Les limites des politiques publiques de soutien à la paternité », Travail, genre et sociétés, 2010, vol. 24, no 2, p. 47. CACIALLI Livia, La relazione incarcerata: rimanere padri dentro e oltre il carcere, tesi di laurea in psicologia dinamico-clinica nell’infanzia, nell’adolescenza e nella famiglia sous la direction de Silvia Mazzoni, La Sapienza, Rome, 2013, 97 p. CALIFANO Nina, Sexualité Incarcérée Rapport a Soi et Rapport a l’Autre Dans l’Enfermement, Paris, L’Harmattan, 2012, 208 p. CAMPIOLI G. et CONINCK G. DE, « Paroles de détenus », Déviance et société, 1977, vol. 1, no 2, p. 219-237. CARDI Coline, La déviance des femmes. Délinquantes et mauvaises mères : entre prison, justice et travail social, Thèse de sociologie sous la direction de Numa Murard, Denis Diderot Paris 7, Paris, 2008, 613 p. CARDON Carole, « Relations conjugales en situation carcérale », Ethnologie française, 2002, vol. 89, no 1, p. 81. CASSAN Francine, « Précocité et instabilité familiale des hommes détenus », Insee N° 828, Février 2002. CASSAN Francine et TOULEMON Laurent, « L’histoire familiale des hommes détenu », Insee N° 706, 2000. CASTEL Robert, « La dynamique des processus de marginalisation : de la vulnérabilité à la désaffiliation », Cahiers de recherche sociologique, 1994, no 22, p. 11. CASTELAIN MEUNIER Christine, « Tensions et contradictions dans la répartition des places et des rôles autour de l’enfant », Dialogue, 2004, vol. 165, no 3, p. 33. CASTELAIN-MEUNIER Christine, La Paternité, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, Que sais-je ?, 1997. CHAMBOREDON Hélène, PAVIS Fabienne, SURDEZ Muriel et WILLEMEZ Laurent, « S’imposer aux imposants. A propos de quelques obstacles rencontrés par des sociologues débutants dans la pratique et l’usage de l’entretien », Genèses, 1994, vol. 16, no 1, p. 114-132. CHANTRAINE Gilles, « La prison post-disciplinaire », Déviance et société, 2006, vol. 30, no 3, p. 273-288.
168
CHANTRAINE Gilles, Par-delà les murs : Expériences et trajectoires en maison d’arrêt, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 2004, 320 p. CHANTRAINE Gilles, « Prison, désaffiliation, stigmates: L’engrenage carcéral de l’« inutile au monde » contemporain », Déviance et Société, 2003, vol. 27, no 4, p. 363. CHANTRAINE Gilles, « La sociologie carcérale: approches et débats théoriques en France », Déviance et société, 2000, vol. 24, no 3, p. 297-318. CHATOT Myriam, Père au foyer un métier comme les autres, Mémoire de sociologie sous la direction de Marc Bessin, , EHESS, 2013. CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique (sous la direction), Dictionnaire d’analyse du discours, Édition : Editions du Seuil., Paris, Seuil, 2002, 661 p. COMBESSIE Philippe, Sociologie de la prison, Édition : 3e édition, Paris, Editions La Découverte, 2009. CONINCK G. DE, « La famille du détenu: de la suspicion à l’idéalisation », Déviance et société, 1982, vol. 6, no 1, p. 83-103 CUSANO Anna, « Carcere e Paternita’ » Voci di padri dal Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, s.l., 2007. DECHAUX Jean-Hugues, « Travail parental et parenté: parlons-nous de la même chose? », Informations sociales, 2009, no 4, p. 14-20. DELUMEAU Jean et ROCHE Daniel, Histoire des pères et de la paternité, Larousse., s.l, (coll. « In extenso »), 2000. DEMAZIERE Didier, « À qui peut-on se fier ? Les sociologues et la parole des interviewés », Langage et société, 2007, vol. 121-122, no 3, p. 85. DEMAZIERE Didier et GLADY Marc, Pratiques de l’entretien, Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 2008. DESCOMBES Vincent, Les embarras de l’identité, Paris, Gallimard, 2013, 304 p. DESESQUELLES Aline et KENSEY Annie, « Les détenus et leur famille: des liens presque toujours maintenus mais parfois très distendus », Données sociales, La société française, 2006, p. 59-67. DEVAULT Annie, LACHARITE Carl, OUELLET Francine et FORGET Gilles, « Les pères en situation d’exclusion économique et sociale : les rejoindre, les soutenir adéquatement », Nouvelles pratiques sociales, 2003, vol. 16, no 1, p. 45. DEVAULT Annie, MILCENT Marie-Pierre et OUELLET Francine, « Le sens de la paternité chez de jeunes hommes en contexte de précarité », Empan, 2005, vol. 60, no 4, p. 58.
169
DI MEO Guy et BULEON Pascal, L’espace social:Lecture géographique des sociétés, s.l, Armand Colin, 2005, 303 p. DORMOY Odile, « L’enfant et la prison », Enfance, 1992, vol. 45, no 3, p. 251-263. DOURIS Marie et ROMAN Pascal, Liens familiaux et détention - 1ère partie : Comment être parent en prison ?, Rapport de recherche, Ucly/Isf (Lyon-France)/UNIL/Psychologie (Lausanne-Suisse), 2014. DUBAR Claude, « Trajectoires sociales et formes identitaires. Clarifications conceptuelles et méthodologiques », Sociétés contemporaines, 1998, vol. 29, no 1, p. 73-85. DUBECHOT Patrick, FRONTEAU Anne et QUEAU Pierre LE, « La prison bouleverse la vie des familles de détenus », Crédoc–Consommation et Modes de Vie, 2000, no 143. DUFOURCQ-CHAPPAZ Christiane, Etre père malgré tout : Univers carcéral et parentalité, Lyon, Chronique Sociale, 2011, 192 p. ELIAS Norbert, Du temps, Édition : Fayard., Paris, Fayard, 1997, 223 p. FAUGERON Claude, Approches de la prison, Bruxelles; Montréal; Ottawa, De Boeck, 1996, 368 p. FELTESSE Hugues et AL, Intérêt supérieur de l’enfant et maintien des liens familiaux à l’épreuve de l’incarcération, s.l., Défenseur des droits Groupe de travail « Intérêt supérieur de l’enfant », 2013. FILLOUX Jean-Claude, Analyse d’un récit de vie : L’histoire d’Annabelle, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 2005, 169 p. FINNEY HAIRSTON Creasie, « Prisoners and Families: Parenting Issues During Incarceration », s.l., U.S. Department of Health and Human Services, 2002. FOUCAULT Michel, Surveiller et punir: Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1993. GAILLARD Arnaud, Sexualité et prison - Désert affectif et désirs sous contrainte, Paris, Max Milo, 2009, 352 p. LE-GALL Didier et POPPER Haydée, « Éditorial. Les familles recomposées à l’heure des parentés plurielles », Dialogue, 2013, vol. 201, no 3, p. 7. GAUDET Stéphanie, « La responsabilité dans les débuts de l’âge adulte », Lien social et Politiques, 2001, no 46, p. 71. GLADY Marc, « Destination(s) de la connaissance dans l’entretien de recherche : l’inégale appropriation des offres de sens », Langage et société, 2008, vol. 123, no 1, p. 53. GLASER Barney G. et STRAUSS Anselm L., « La production de la théorie à partir des données », Enquête. Archives de la revue Enquête, 1995, no 1, p. 183-195.
170
GOFFMAN Erving, Asiles - études sur les conditions sociales des malades mentaux et autres reclus, Les éditions de minuit, s.l, 1970. GRINSCHPOUN Marie-France, L’analyse de discours - Donner du sens aux dires, s.l, Enrick B. Editions, 2012, 84 p. GROSS Martine, Choisir la paternité gay, Toulouse, ERES, 2012, 290 p. GUILBAUD Fabrice, « Le travail pénitentiaire: sens et articulation des temps vécus des travailleurs incarcérés », Revue française de sociologie, 2009, vol. 49, no 4, p. 763-791. HERZOG-EVANS Martine, L’intimité du détenu et de ses proches en droit comparé, s.l, Editions L’Harmattan, 2000, 139 p. HUERRE Patrice, « Les pères sont-ils des mères comme les autres ? », Enfances & Psy, 2011, vol. 50, no 1, p. 119. HURSTEL Françoise, « Fractures dans la paternité : leurs enjeux pour le rôle et la fonction des pères contemporains », Le Coq-héron, 2004, vol. 179, no 4. HURSTEL Françoise, La déchirure paternelle, s.l, Presses Universitaires de France - PUF, 1996, 224 p. INSEE, Âge moyen du père à la naissance de l’enfant de 1990 à 2012, s.l, Insee. JOËL Myriam, Les liens affectifs et familiaux des femmes détenues, Mémoire de sociologie sous la direction de Philippe Combessie et Eric Letonturier, Université René Descartes – Paris V, Paris, 2006, 189 p. JOËL Myriam, La féminité incarcérée, Mémoire de sociologie sous la direction de Philippe Combessie, Paris Nanterre, 2007. JOËL-LAUF Myriam, « L’intimité des femmes incarcérées: Une expérience de terrain », Ethnologie française, 2009, vol. 39, no 3, p. 547. JOËL-LAUF Myriam, La sexualité en prison de femmes,Université de Nanterre, s.l., 2012, 437 p. KAFKA Franz, Lettre au père, Paris, Folio, 2002. KULICK Don, « La vie sexuelle des anthropologues : subjectivité érotique et travail ethnographique », Genre, sexualité & société, traduit par Frédéric Haon, 1 décembre 2011, no 6. LAE Jean-François, « Émotion et connaissance: L’emprise du sensible dans l’enquête sociologique », Sociétés & Représentations, 2002, vol. 13, no 1, p. 247. LAFORTUNE D., BARRETTE M., DUBEAU D., BELLEMARE D., BRUNELLE N., PLOURDE C. et CUSSON J. F., « Un père incarcéré: facteur de risque ou de protection pour ses enfants? », Psychiatrie & Violence, 2004, vol. 4, no 2.
171
LAGRANGE Hugues, Le déni des cultures, Paris, Seuil, 2010, 350 p. LANCELEVEE Camille, Intimité sexuelle en prison, Master Recherche de Sciences Po sous la direction de Michel Bozon, paris, s.l, 2007. LANCELEVEE Camille, « Une sexualité à l’étroit. Les unités de visite familiale et la réorganisation carcérale de l’intime », Sociétés contemporaines, 2011, vol. 83, no 3, p. 107. LAURENS Sylvain, « “Pourquoi” et “comment” poser les questions qui fâchent? », Genèses, 2007, no 4, p. 112-127. LEGAVRE Jean-Baptiste, « La «neutralité» dans l’entretien de recherche. Retour personnel sur une évidence », Politix, 1996, vol. 9, no 35, p. 207-225. LEMIEUX Cyril, La sociologie sur le vif, Paris, Presses de l’Ecole des mines, 2010, 326 p. LE ROY Pierre (sous la direction), Le père dans la périnatalité, Ramonville Saint-Agne (France), Eres, 1996, 180 p. MARCHAND-LAGIER Christèle, « De la connaissance a la reconnaissance: la retranscription d’entretien comme marqueur social », Social Science Information, 1 décembre 2009, vol. 48, no 4, p. 647-665. MARCHETTI Anne-Marie, Perpétuités : le temps infini des longues peines, Paris, Plon, 2000, 525 p. MARTIAL Agnès, « Des pères «absents» aux pères «quotidiens»: représentations et discours sur la paternité dans l’après-divorce », Informations sociales, 2013, no 2, p. 36-43. MARTIAL Agnès, « Une paternité réinventée? Le vécu parental des pères isolés », Informations sociales, 2013, no 2, p. 62-69. MARTIAL Agnès, « Paternités contemporaines et nouvelles trajectoires familiales », Ethnologie française, 2012, vol. 42, no 1, p. 105. MARTIAL Agnès, « Le travail parental: du côté des pères séparés et divorcés », Informations sociales, 2009, no 4, p. 96-104. MARTIAL Agnès, « L’anthropologie de la parenté face aux transitions familiales contemporaines : des interrogations en suspens », Travail, genre et sociétés, 2005, No 14, no 2, p. 158. MAUGER Gérard, « Enquêter en milieu populaire », Genèses, 1991, vol. 6, no 1, p. 125-143. MEO Guy Di, L’espace social:Lecture géographique des sociétés, s.l., Armand Colin, 2005, 303 p. MELH Dominique, « La famille contemporaine au prisme des procréations médicalement assistées », Cliniques méditerranéennes, 2011/1 n° 83, p. 95-108
172
MEULDERS-KLEIN Marie-Thérèse et THERY Irène, Les recompositions familiales aujourd’hui, Paris, Nathan, 1993, 350 p. MILLY Bruno, Soigner en prison, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 2001, 250 p. MOREAU Caroline, DESFRERES Julie et BAJOS Nathalie, « Circonstances des échecs et prescription contraceptive post-IVG: analyse des trajectoires contraceptives autour de l’IVG », Revue française des affaires sociales, 2011, no 1, p. 148-161. NEUBURGER Robert, Les territoires de l’intime, Paris, Odile Jacob, 2000, 237 p. NEYRAND Gérard, L’enfant, la mère et la question du père, Édition : 3e édition., Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 2011, 408 p. NEYRAND Gérard, WILPERT Marie-Dominique, TORT Michel et KHOURY Diane, Père, mère, des fonctions incertaines : Les parents changent, les normes restent ?, Toulouse, Erès, 2013. OUELLET Francine, MILCENT Marie-Pierre et DEVAULT Annie, « Jeunes pères vulnérables: Trajectoires de vie et paternité », Nouvelles pratiques sociales, 2006, vol. 18, no 2, p. 156. PAUGAM Serge, Le lien social, Édition : 3e édition, Paris, Presses universitaires de france - PUF, 2013. PAUGAM Serge, Les 100 mots de la sociologie: « Que sais-je ? » n° 3870, Édition : 1., s.l., Presses Universitaires de France, 2012, 128 p. PAUGAM Serge, La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté, Édition : édition, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 2009, 288 p. PENEFF, La Méthode biographique : De l’École de Chicago à l’histoire orale, Paris, Armand Colin, 1997, 144 p. PETIT Line, « Désir d’enfant », Spirale, 1 novembre 004, no 32, no 4, p. 19-26. PLARD Mary, Paternités Imposées, Paris, Les liens qui libèrent, 2013, 290 p. PROTEAU Laurence et PRUVOST Geneviève, « Se distinguer dans les métiers d’ordre: (armée, police, prison, sécurité privée) », Sociétés contemporaines, 2008, vol. 72, no 4, p. 7. QUENIART Anne, La paternité sous observation: des changements, des résistances mais aussi des incertitudes, s.l., J.-M. Tremblay, 2008. QUENIART Anne, « Présence et affection : l’expérience de la paternité chez les jeunes », Nouvelles pratiques sociales, 2003, vol. 16, no 1, p. 59. RABATEL Alain, « Analyse énonciative et interactionnelle de la confidence », Poétique, 1 février 2005, n° 141, no 1, p. 93-93. RAMBOURG Cécile, « Les unités de visites familiales », (Nouvelles pratiques, nouveaux liens », CIRAP-ENAP, Dossiers thématiques, 2006
173
RANCHER B, Actes du colloque : enfances du père, G.R.E.C., s.l, 1989. RICORDEAU Gwénola, « Sexualités féminines en prison : pratiques, discours et représentations », Genre, sexualité & société, 29 juin 2009, no 1. RICORDEAU Gwénola, Les détenus et leurs proches : Solidarités et sentiments à l’ombre des murs, Paris, Editions Autrement, 2008, 265 p. ROSTAING Corinne, La relation carcérale, s.l, Presses Universitaires de France, 1997. SAULIER Maïté, La vie familiale du détenu, Mémoire de droit sous la direction d’Anne-Marie Leroyer, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 2009. SCHIESS Christian, La construction sociale du masculin, mémoire sous la direction de Franz Schultheis, Université de Genève, s.l, 2005. SEGALEN Martine, « Être parents, être pères aujourd’hui », Ethnologie française, 2012, vol. 42, no 1. SEGALEN Martine et MARTIAL Agnès, Sociologie de la famille, Édition : 8e édition revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2013, 352 p. SELLENET Catherine et COLLECTIF, Les pères en débat, Ramonville Saint-Agne, Erès, 2007, 187 p. SIRET Rémy, « Être femme en prison... ? », Adolescence, 2005, vol. 54, no 4, p. 993. THERY Iréne, Distinction de sexe, Odile Jacob, 2007, 676 p. THERY Irène, Des humains comme les autres : Bioéthique, anonymat et genre du don, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2010, 309 p. THERY Irène, « Le nom, entre préséance et préférence », Travail, genre et sociétés, 2002, vol. 7, no 1, p. 189. THERY Irène et LEROYER Anne-Marie, Filiation, origines, parentalité Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, s.l., Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère délégué chargé de la famille, 2014. TISSERON Serge, Les secrets de famille, Édition : 1., Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 2011. TOURAUT Caroline, « Entre détenu figé et proches en mouvement. «L’expérience carcérale élargie»: une épreuve de mobilité », Recherches familiales, 2009, no 1, p. 81-88. TRIPP Brad, « Fathers in Jail: Managing Dual Identities. », Applied Psychology in Criminal Justice, 2009, vol. 5, no 1.
174
TRUC Gérôme, « La paternité en Maternité: Une étude par observation », Ethnologie française, 2006, vol. 36, no 2, p. 341. TURCOTTE Geneviève, DUBEAU Diane, BOLTE Chrisine et PAQUETTE Daniel, « Pourquoi certains pères sont-ils plus engagés que d’autres auprès de leurs enfants? Une revue des déterminants de l’engagement paternel », Revue canadienne de psycho-éducation, 2001, vol. 30, no 1, p. 65-91. VAN Charlotte LE et GALL Didier LE, « La « première fois » : l’influence des parents », Ethnologie française, 2010, vol. 40, no 1, p. 85. VEIL et LHUILIER, La prison en changement, Ramonville-Saint-Agne, Eres, 2000, 303 p. VERJUS Anne et VOGEL Marie, « Le travail parental: un travail comme un autre? », Informations sociales, 2009, no 4, p. 4-6. VILAIN Annick, « Les femmes ayant recours à l’IVG: diversité des profils des femmes et des modalités de prise en charge », Revue française des affaires sociales, 2011, no 1, p. 116-147. WELZER-LANG Daniel, « Virilité et virilisme dans les quartiers populaires en France », VEI enjeux, 2002, vol. 128, p. 10-32. WELZER-LANG Daniel, GAUDRON Chantal Zaouche et COLLECTIF, Masculinités : état des lieux, Toulouse, Erès, 2011, 270 p. WHITE, Identité et contrôle: Une théorie de l’émergence des formations sociales,, EHESS., Paris, 2007. ZAOUCHE-GAUDRON Chantal, « La séparation au risque de la rupture », Hors collection, 2002, p. 37-52.
175
ANNEXES
Jawad a 30 ans, d’origine Magrébine, incarcéré pour ILS depuis 3 ans. C’est un récidiviste. Il
a deux enfants (5 ans et demi et 3ans), d’une mère avec qui il vit en concubinage. Il a eu son
premier enfant à 25 ans. Il a un enfant qui est né pendant son incarcération. Il a des parloirs à
peu près trois fois par semaine avec ses enfants, sa compagne et ses parents. Il leur téléphone
au moins une fois par semaine et bénéficie d’UVF avec sa femme et ses enfants. La prison se
situe à plus de 50km de leur foyer.
Nolan a 26 ans, d’origine martiniquaise, incarcéré pour ILS depuis 1 an. C’est un récidiviste.
Il était sans emploi. Il ne connaît pas son père et a vécu avec son beau-père. Sa mère était
femme au foyer. Il a trois enfants (7 ans -2ans - 1mois) de trois mères différentes. Il est
engagé dans une nouvelle union. Il a eu son premier enfant à 19 ans. Deux enfants sont nés ou
ont été conçu pendant sa détention. Il est issu d’une famille nombreuse. Il a des parloirs avec
nouvelle copine, une fois par semaine. Il appelle ces deux premiers enfants et sa copine.
Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Nadim a 34 ans, d’origine marocaine, incarcéré pour braquage depuis 6 ans. C’est un
récidiviste. Il était sans emploi. Son père était artisan et sa mère était femme au foyer. Il a
deux enfants (10-5 ans) d’une mère. Il est séparé. Il a eu son premier enfant à 24 ans. Il est
issu d’une famille nombreuse (7). Il a des parloirs avec ses enfants et son ex compagne, une
fois par mois. Il appelle ces enfants tous les jours. Pas d’UVF. Sa famille habite a plus de
50km.
Ryam 31 ans, d’origine marocaine, incarcéré pour ILS depuis 8 mois, récidiviste Mère : au
foyer, enfants : 3 (8-6-4) d’une mère. Il est marié. Il a eu son premier enfant à 23 ans, 1 enfant
eu pendant sa détention ou conçu en parloir. Famille nombreuse. Parloir : Enfant et
compagne, 2 fois par mois. Pas d’éloignement géographique. Prison sans UVF
Aziz 27 ans, d’origine marocaine, Tentative d’homicide, Déjà incarcéré pour un autre délit.
Enfant : 1 (3 ans). Il est marié. Il a eu son premier enfant à 24 ans et l’a conçu en détention.
176
Parloir : Enfant et compagne. Téléphone : Enfant et compagne. Il bénéficie d’UVF
Djamel 41 ans, d’origine algérienne, Incarcéré pour ILS depuis 7 ans, récidiviste. Sans emploi
avant l’incarcération. Enfants : 3 (3-1 ans) de deux mères différentes conçus tous en
détention. Il est séparé. Parloir : 1 enfant et la mère. Téléphone : Enfants, mère des enfants, il
les a au moins une fois par semaine. Prison sans UVF
Achour, 34 ans, d’origine algérienne, Incarcéré pour Mœurs depuis 4 ans. C’est la première
incarcération. Il était employé. Mère : au foyer. Enfants : 3 (14-11-4ans) d’une mère. Il vit en
concubinage. Il a eu son premier enfant à 20 ans. Parloir : Enfants et compagne, 1 fois par
semaine. Téléphone : Enfants, compagne, rarement. Il envoie des lettres et bénéficie
d’UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Samir, 27 ans, d’origine Magrébine, incarcéré pour Alcool au volant depuis 2 mois,
récidiviste, sans emploi. Il a vécu avec une Famille adoptive. Enfants : 2 (4-2ans) d’une mère.
Il vit en concubinage. Il a eu son premier enfant à 23 ans. Issu d’une Famille nombreuse.
Parloir : Enfants et compagne. Prison sans UVF. Pas d’éloignement géographique.
Cyril, 45 ans, française, incarcéré pour mœurs depuis 3 ans. 1er détention. Il était chauffeur,
son père employé, sa mère femme de ménage. Enfants : 2 (8 ans et 7 ans) de la même mère. Il
est séparé. Il a eu son premier enfant à 37 ans. Parloir médiatisé enfant 1 fois par mois.
Téléphone : refus de la mère. Lettre : 2/3 fois par mois. Pas d’UVF. Sa famille habite a plus
de 50km.
Timur, 34 ans, d’origine Turque, incarcéré pour homicide involontaire depuis 7ans, Déjà
incarcéré pour un autre délit. Il était employé. Père : artisan, mère : femme de ménage.
Enfant :1 (19 mois). Il est en concubinage. Il a eu son premier enfant à 33 ans et l’a conçu en
détention. Deux frères et sœurs. Parloir : Enfant et compagne (parfois son père et sa belle-
mère) 3 fois par semaine. Téléphone : Enfants, compagne, tous les jours.
Lettres : Compagne, occasionnel. UVF : Enfant et compagne. Pas d’éloignement
géographique.
Riad, 34 ans, d’origine magrébine, incarcéré pour moeurs depuis 3 ans. Déjà incarcéré pour
un autre délit. Il était employé. Père : décédé jeune, mère au foyer. Enfant :1 (4 ans et demi).
177
Il est séparé et ne voit plus son enfant. Il a eu son premier enfant à 30 ans. 10 frères et sœurs.
Parloirs : sœurs, nièces, 2 fois par mois. Téléphone : mère, 3 fois par semaine. Pas d’UVF
Simon, 67 ans, d’origine française, incarcéré pour ILS, récidiviste. Sans emploi. Enfants : 4
(25- 20- 8 et 6 ans) de 2 mères. Il est divorcé. Il a eu son premier enfant à 42 ans . 2 Frères et
sœurs. Parloir :1Fils, sœur et nièce, au moins une fois par mois. Téléphone :1 Fils, sœur, frère,
nièce, au moins une fois par semaine. Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Djalil, 23 ans, d’origine Magrébine. Incarcéré pour ILS depuis 1 mois. 1ère incarcération. Il
était Employé. Père : Profession indépendante. Mère au foyer. Enfants : 2 (5, 1 et demi) de la
même mère. Il est marié. Il a eu son premier enfant à 18 ans. 2 Frères. Parloir : Compagne,
mère et Frère, 3 fois par semaine. Téléphone : Enfants, compagne, mère, frère au moins une
fois par semaine. Prison sans UVF. Pas d’éloignement géographique.
Eliot, 35 ans, d’origine Camerounaise. Incarcéré pour violence depuis 3 mois. 1ère
incarcération. Il était dans l’armée. Père : Auto entrepreneur, mère au foyer. Enfant :1 (7
ans). Il est séparé. Il a eu son premier enfant à 28 ans. 2 frères et sœurs. Parloir : Mère, frère,
ami, 2 fois par semaine. Téléphone : Mère, frère, ami. Lettre : Ami, fils, frère, mère, 1 fois par
semaine. Prison sans UVF. Pas d’éloignement géographique.
Kalim, 35 ans, d’origine algérienne. Incarcéré pour Vol depuis 3 ans, récidiviste. Il était sans
emploi . Enfants : 2 (13-7) de la même mère. Il est divorcé. Il a eu son premier enfant à 22
ans. 7 Frères et sœurs. Parloir : Enfants, sa mère, frère, au moins une fois par mois.
Téléphone : Enfants, mère, frère, une fois par semaine. Prison sans UVF. Pas d’éloignement
géographique.
Samba, 33 ans , d’origine Gabonaise. Incarcéré pour ILS depuis 9 mois, récidiviste. Il était
Employé au black. Mère au foyer. Enfants : 3 (6-4-2 ans) de la même mère. Il est Marié. Il a
eu son premier enfant à 27 ans. Famille nombreuse. Pas de parloir, téléphone, lettre. Prison
sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Walid, 37 ans, d’origine magrébine. Incarcéré pour Escroquerie depuis 15 mois, récidiviste. Il
était sans emploi. Enfants : 4 (7-5-3-2ans) de la même mère dont un est né pendant
178
l’incarcération. Il est marié. Il a eu son premier enfant à 30 ans. Parloir :enfants et compagne,
au moins une fois par mois. Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Franck, 44 ans , d’origine française. Incarcéré pour Vol depuis 1 ans, récidiviste. Il était sans
emploi. Mère au foyer. Enfants : 3 (6 ans) de deux mères différentes (jumeaux plus un enfant
né en même temps). Une sœur. Il est séparé. Il a eu son premier enfant à 38 ans. Pas de
parloir. Téléphone : enfants, sœur au moins une fois par semaine. Prison sans UVF. Sa
famille habite a plus de 50km.
Angelo , 36 ans, d’origine roumaine. Incarcéré pour homicide depuis 28 mois. Déjà incarcéré
pour un autre délit. Il était employé au black. Mère foyer. Enfant : 1 (2 ans et demi). Il est
séparé. Il a eu son premier enfant à 34 ans. Pas de parloir, rarement le téléphone et il n’a pas
de réponse à ses lettres. Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Quentin, 25 ans, d’origine Espagnole/ française. Incarcéré pour conduite sans permis depuis
21 mois, récidiviste. Il faisait du travail au black. Père et mère : employés. Enfants : 2 ( 5 ans
et 3 ans). Il est dans une nouvelle union. Il a eu son premier enfant à 20 ans. Parloir : Enfants,
copine et père, 1 fois par semaine. Téléphone : Copine et parent, au moins une fois par
semaine. UVF : Copine. Sa famille habite a plus de 50km.
Lahcen, 47 ans, d’origine magrébine. Incarcéré pour vol depuis 5 mois, récidiviste. Il était
employé. Enfant : 1 (11ans). Il est séparé. Il a eu son premier enfant à 36 ans. Pas de parloir.
Téléphone : Fille et sœur, tous les jours. Lettre : fille, toutes les semaines. Prison sans UVF.
Pas d’éloignement géographique.
Chafik, 28 ans, d’origine magrébine. Incarcéré pour blanchiment d’argent depuis 5 mois,
récidiviste. Il était employé. Enfants : 2 (8 mois). Il est marié. Il a eu son premier enfant à 27
ans. Parloir : Enfants, compagne, mère ; au moins une fois par mois. Téléphone : Enfants,
compagne, mère, au moins une fois par semaine. Prison sans UVF . Sa famille habite a plus de
50km.
Larbi, 40 ans, d’origine Algérienne. Incarcéré pour ILS depuis 11 mois, récidiviste. Père :
employé, mère au foyer. Enfants : 4 (14-7-4-5mois) de trois mères différentes. Il est marié. Il
a eu son premier enfant à 26 ans. Deux enfants sont nés pendant l’incarcération. Issu d’une
179
famille nombreuse. Parloir : Enfants, compagne, mère, frère et sœur, 3 fois par semaine.
Téléphone : Enfants, compagne, mère, frère et sœur, tous les jours. Prison sans UVF. Sa
famille habite a plus de 50km.
Mouloud, 69 ans, d’origine Algérienne. Incarcéré pour Mœurs depuis 2 ans. 1ère incarcération.
Il était Chauffeur. Père et mère : employés. Enfants : 2 (29-25) de la même mère. Il est marié.
Il a eu son premier enfant à 40 ans. Il est fils unique. Aucun parloir. Téléphone : Enfants,
compagne, au moins une fois par mois. Pas de lettre. Prison sans UVF. Pas d’éloignement
géographique.
François, 47 ans, d’origine française. Incarcéré pour mœurs depuis 3 ans, 1ère incarcération. Il
était employé. Père : employé et mère au foyer. Enfant : 1 (6 ans). Il est marié. Il a eu son
premier enfant à 41 ans. 1 sœur. Parloir : Enfant et compagne, une fois par semaine.
Téléphone : Enfants, compagne, au moins une fois par semaine. Prison sans UVF. Pas
d’éloignement géographique.
Bamba, 26 ans, d’origine martiniquaise. Incarcéré pour ILS depuis 6 ans, récidiviste. Il était
employé au black. Mère au foyer. Enfants : 2 (9-7 ans) de la même mère. Il est séparé. Il a eu
son premier enfant à 17 ans. Issu d’une famille nombreuse. Pas de parloir, très rarement le
téléphone. Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Laurent, 38 ans, d’origine française. Incarcéré pour ILS depuis 8 mois, récidiviste. Il était
auto entrepreneur. Père inconnu, présence du beau-père, mère : employé. Enfants :2 (17-
14ans) de la même mère. Il est marié. Il a eu son premier enfant à 21 ans. 1 sœur. Parloir :
Enfants et compagne, au moins une fois par semaine (que sa compagne). Téléphone : Enfants,
compagne, mère, sœur, au moins une fois par semaine. Lettre : au moins une fois par mois.
Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Kylian, 30 ans, d’origine martiniquaise. Incarcéré pour violence depuis 4 mois. Déjà incarcéré
pour un autre délit. Il était employé. Père et mère profession intermédiaire. Enfants : 2
(14-2 ans) de deux mères différentes. Il vit en concubinage . Il a eu son premier enfant à 16
ans. 2 frères et sœurs. Parloir : Enfant, compagne, mère, frère, 3 fois par semaine. Téléphone :
Enfant, compagne, mère, frère, tous les jours. Lettre : Enfant, femme, de temps en temps.
Prison sans UVF. Pas d’éloignement géographique.
180
Nestor, 40 ans, d’origine Camerounaise. Incarcéré pour mœurs depuis 28 mois. 1ère
incarcération. Il avait une profession libérale. Père : sans emploi, mère au foyer (décédée
jeune. Enfants : 2 (10-8ans) de la même mère. Il est en concubinage. Il a eu son premier
enfant à 30 ans. 4 frères et sœurs. Parloir : Ami, refus de l'administration pénitentiaire pour la
famille. Téléphone : Enfants, compagne, tous les jours. Lettre : Compagne, au moins une fois
par semaine. Pas d’UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Bilal, 33 ans, d’origine algérienne. Incarcéré pour ILS depuis 34 mois, récidiviste. Il avait
une profession libérale. Père : profession libérale, mère : Profession intermédiaire. Enfants :4
(14 – 12 - 8- 3 ans) de deux mères différentes, un enfant a été conçu en parloir. Il est marié. Il
a eu son premier enfant à 19 ans. Il a 2 frères. Parloir : Enfants, compagne, mère, frère et
sœur, 1 fois par semaine. Téléphone : Enfant, compagne, mère, frère sœur, tous les jours.
Lettre : rarement. Prison sans UVF. Pas d’éloignement géographique.
Sofiane, 32 ans, d’origine Algérienne. Incarcéré pour ILS depuis 20 mois, récidiviste. Il était
sans emploi. Enfants : 2 ( 5 ans et 3 ans) de la même mère. Il est marié. Il a eu son premier
enfant à 27 ans. 3 frères et sœurs. Parloirs : Enfants et compagne, 1 fois par semaine.
Téléphone : Enfants, compagne, famille élargie. Pas d’UVF. Sa famille habite a plus de
50km.
Romain, 26 ans, d’origine française. Incarcéré pour ILS depuis 4 ans, récidiviste. Il était
employé au black. Père : Cadre supérieur, mère au foyer. Enfant : 1 (6 ans et demi). Il est
séparé. Il a eu son premier enfant à 20 ans. 1 sœur. Parloir médiatisé : Enfant, 1 fois par
mois. Téléphone : Enfant, ex compagne, mère et sœur. Plusieurs fois par semaine. Lettre :
Enfant Au moins une fois par semaine. Pas d’UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Oscar, 48 ans, d’origine malienne. Incarcéré pour ILS depuis 2 ans et demi, récidiviste. Il était
sans emploi. Père : employé et Mère au foyer. Enfants : 2 (9-8ans) de la même mère. Il est
séparé. Il a eu son premier enfant à 39 ans. Issu d’une famille nombreuse. Pas de parloir.
Téléphone : enfants, au moins une fois par semaine. Prison sans UVF. Sa famille habite a plus
de 50km.
181
André, 38 ans, d’origine française. Incarcéré depuis 9 ans, délit inconnu. 1ère incarcération. Il
était employé. Père : Artisan et mère : employé. Enfant : 1 (11 ans). Il est séparé . Il a eu son
premier enfant à 27 ans. Pas de frère et sœur. Parloir médiatisé : interrompu avec l’enfant.
Téléphone : enfant ex compagne, parents, au moins une fois par semaine. Lettre :
Enfant, occasionnel, Pas d’UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Maxime, 31 ans, d’origine française. Incarcéré pour homicide depuis 3 ans. Déjà incarcéré
pour un autre délit. Il était sans emploi. Père en prison et mère au foyer. Enfants : 2 (14-9 ans)
de deux mères différentes. Il est dans une nouvelle union. Il a eu son premier enfant à 17 ans.
2 frères et sœurs. Parloir : Aucun. Téléphone : Mère. Lettre : Mère et fils (sans réponse) au
moins une fois par mois. Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Loic, 37 ans, d’origine française. Incarcéré pour Alcool volant depuis 5 mois. 1ère
incarcération. Il était au chômage. Enfant : 1 (2 ans). Il est séparé. Il a eu son premier enfant à
35 ans. Parloir : Parents, au moins une fois par mois. Prison sans UVF. Sa famille habite a
plus de 50km.
Alain, 59 ans, d’origine française. Incarcéré pour ILS depuis 5 ans, récidiviste. Il était sans
emploi. Père inconnu, mère : travail illégal (stup, vol). Enfants : 2 (tout deux 33 ans) de deux
mères différentes. Il est divorcé. Il a eu son premier enfant à 26 ans. Pas de parloir, ni
téléphone, ni courrier. Prison sans UVF. Pas d’éloignement géographique.
Patrick, 32 ans, d’origine antillaise. Incarcéré pour ILS depuis 5 mois, récidiviste. Il était
employé au black. Père méconnu et mère au foyer. Enfant : 1 (14 ans) ou 5-6 enfants (pas
reconnus ni voulus), 1 ou 5 -6 mères. Il est séparé. Il a eu son premier enfant à 18 ans. Il est
issu d’une famille nombreuse. Il n’a pas de parloir, n’appelle pratiquement jamais car il n’a
pas d’argent et n’écris que rarement des lettres. Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de
50km.
Nicolas, 59 ans, d’origine française. Incarcéré pour mœurs (?) depuis 6 ans. 1ère incarcération.
Il était employé. Père : employé et mère au foyer. Enfant : 1 (25 ans). Il est séparé et n’a pas
de nouvelles. Il a eu son premier enfant à 34 ans. Pas de parloir, pas de téléphone, pas de
lettre, pas d’UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
182
Andreja, 32 ans, d’origine serbe. Incarcéré pour violence conjugal depuis 6 mois. Déjà
incarcéré pour un autre délit. Il était employé. Père : sans emploi et mère au foyer. Enfants :3
(11-7-3 ans ) de la même mère. Il est séparé. Il a eu son premier enfant à 21 ans. Il est issu
d’une famille nombreuse. Il n’a pas de parloir. Téléphone : enfants, 1 fois par semaine ;
Lettre : Enfants, régulièrement. Prison sans UVF. Pas d’éloignement géographique.
Thierry, 41 ans, d’origine française. Incarcéré pour violence depuis 22 mois. 1ère
incarcération. Il était sans emploi. Père : artisan et mère au foyer. Enfants : 4 (14-9 ans) et (7-
3ans) de deux mères différentes. Il est en instance de divorce. Il a eu son premier enfant à
27 ans. 4 frères et sœurs. Parloirs : il voit ses 2 premiers enfants, ex compagne, 1 fois par
mois. Téléphone : Aucun. Lettre : ses deux premiers enfants, ex compagne, au moins une fois
par semaine. Pas d’UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Ludovic, 27 ans, d’origine française/ Sud Africaine. Incarcéré pour ILS depuis 3 mois,
récidiviste. Il était employé. Père et mère : employés. Enfant : 1 (3 ans). Il est engagé dans
une nouvelle union. Il a eu son premier enfant à 24 ans. 6 frères et sœurs. Parloir : Copine, 3
fois par semaine. Téléphone : pas d'autorisation. Courrier : au moins une fois par semaine à sa
compagne. Prison sans UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
Amed, 37 ans, d’origine marocaine. Incarcéré pour violence depuis 3 ans, récidiviste. Il était
employé. Père : employé, mère : non renseigné. Enfants : 4 (17-13 ans) et (8-6 ans) de deux
mères différentes. Il est en concubinage. Il a eu son premier enfant à 20 ans. 4 frères et sœurs.
Parloir : aucun . Téléphone : Enfants, compagne, sœur, très souvent (20 fois par jour). Lettre :
enfants, au moins une fois par semaine. Pas d’UVF. Sa famille habite a plus de 50km.
195
REMERCIEMENTS
Ma présente étude n’aurait pu exister sans l’aide de nombreuses personnes, c’est pourquoi je souhaiterai leur témoigner ma plus grande gratitude. En premier lieu j’aimerai remercier L’école des hautes études en sciences sociales qui par ses enseignants et la diversité de ses cours a su me stimuler intellectuellement et élargir mes centres d’intérêts. Elle m’a aussi permis de rencontrer ma tutrice Irène Théry, qui a su tout au long de ma recherche trouver des mots rassurants dans les moments de doutes et d’élaboration du sujet ainsi que me prodiguer de judicieux conseils tout en me laissant une autonomie stimulante. Je remercie Cyril Lemieux d’avoir accepté d’être le rapporteur de mon mémoire. Ma gratitude va également à Jacqueline Zinetti qui m’a initié au milieu carcéral et me mit en contact avec le Docteur Bodon Bruzel qui accepta ma présence au Service medico-psychologique régional (SMPR) de Fresnes. J’eu le privilège d’avoir comme tutrice le Docteur Jung et Michelle Lipowczyck, qui ont su me conseiller, m’écouter, répondant à mes nombreuses questions tout en me laissant une grande marge de manœuvre. Le SMPR fut un lieu stimulant où j’eu la chance de rencontrer de nombreux professionnels du milieu pénitencier disposés à me communiquer leur expérience pour m’éclairer et satisfaire ma soif de connaissance. Ce fut deux années pleines d’émotions. Sans l’accord du centre pénitencier de Liancourt, cette étude n’aurait pu voir le jour. L’équipe du CIP a été d’une aide précieuse pour la mise en place de mon terrain, les conditions d’enquête ont été optimales. C’est sans oublier la foule d’anonymes cités dans ce texte : détenus, surveillants, gradés, travailleurs sociaux, soignants qui me donnèrent de leur temps et surtout leur confiance, me témoignant d’évènements intimes et douloureux qui contribuèrent à l’élaboration de ce mémoire. Je souhaite aussi remercier mes proches, ma mère pour sa patience et son amour des mots qui la poussèrent à trouver la parole juste pour donner davantage de légèreté à mon écriture. Mon père qui su trouver les mots pour apaiser mes craintes et son soutien sans faille. Mon oncle Joël qui a su mettre a profit ses relations pour que mon projet aboutisse et à toujours fait preuve d’une grande gentillesse. Vincent, quant à lui, a eu le courage de traquer les fautes, les coquilles, je lui dois toute ma reconnaissance. Je remercie également Gueda, qui a toujours été là pour me conseiller et me pousser dans mes retranchements pour me stimuler. Myriam qui par son magnifique travail de thèse et nos nombreux échanges me donna envie de persévérer sur le milieu carcéral. Mais aussi Hélène, Joséphine, Emilie, Barbara, qui ont vécu conjointement la dur expérience d’un travail de terrain et la rédaction d’un mémoire. Ainsi que mes compagnons d’athlétisme (Florent, JP, Corinne, Alexis, Corinne, Elsa) qui écoutèrent mes plaintes tout en me permettant de m’évader autrement que sociologiquement.








































































































































































































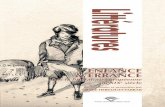





![[Article] Soins et lien social : à propos du Patchwork des Noms](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314f5a83ed465f0570b5e93/article-soins-et-lien-social-a-propos-du-patchwork-des-noms.jpg)









