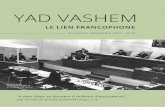La Memoria de la Shoá en la Construcción de la Identidad Nacional Israelí
« Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles » La...
Transcript of « Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles » La...
INTRODUCTION
La langue de Cervantes possède un mot magique par son pouvoir évocateur,
convivencia, placé au cœur de ces IVe Rencontres Internationales du Moyen
Age de Nájera. María Moliner le définit comme acción de convivir, avant
d’apporter ces deux nuances: convivencia désigne la relación entre los que
conviven et, en particulier, el hecho de vivir en buena armonía unas personas
con otras. Les dictionnaires bilingues rendent le terme par vie en commun,
cohabitation, coexistence ou, encore, par convivialité, termes ou expressions
qui ne possèdent pas la même force suggestive que convivencia: la périphrase
‘vie en commun’ renvoie à l’idée de vie en société, de vie en communauté, de
vivre ensemble, mais son emploi n’est guère commode ni élégant. Coexistence
et cohabitation ont acquis, dans la seconde moitié du XXe siècle, une
connotation politique forte: la coexistence, l’existence simultanée de deux
entités, est associée à l’adjectif pacifique et à la guerre froide; la cohabitation,
la situation de personnes vivant ensemble, renvoie à la France de la Ve
République lorsque Président et gouvernement relèvent de groupes
parlementaires différents. Quant à convivialité, le terme, dégagé de son signifié
premier lié à de joyeux banquets, s’est mis à désigner, avec Ivan Illich,
229Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
Lieux de convivialité etformes du lien socialdans la Cordoue desXe-XIe siècles
Christine Mazzoli-GuintardUniversité de Nantes
“l’ensemble des rapports entre personnes au sein de la société ou entre les
personnes et leur environnement social, considérés comme ‘autonomes et
créateurs’1”. Si ce dernier terme semble traduire au plus près convivencia, deux
autres mots sont présents dans l’historiographie française pour renvoyer à des
concepts voisins, sociabilité d’abord, lien social ensuite. La sociabilité, ou
principe des relations entre personnes formant les éléments les plus simples de
la réalité sociale, ne signifie pas seulement gérer le rapport aux autres sur un
fonds de civilité, mais veut dire aller vers l’autre et créer un lien réel2; le
concept a souvent permis, depuis une trentaine d’années, d’analyser les
relations qu’entretenaient les individus tant au village qu’à la ville au Moyen
Âge3. Enfin, le lien social, notion en vogue depuis une quinzaine d’années, part
de l’idée que l’homme a toujours vécu en groupe et a toujours été inséré dans
un réseau de relations sociales; par conséquent, “tout contact avec un tiers […]
aboutit à mettre en place une relation, un fil de trame ou de chaîne et ainsi se
constitue progressivement le tissu social, le lien social4” qui couvre aussi bien
les liens pseudo-naturels, liens familiaux ou conjugaux, que les liens choisis, la
profession ou la religion par exemple.
Qu’elle soit traduite par convivialité, sociabilité ou lien social, la convivencia
s’exprime par excellence, au Moyen Âge, dans le monde urbain, car la ville
médiévale est d’abord une société foisonnante, composée d’hommes et de
femmes exerçant de multiples activités, qui font de la ville le lieu du ‘vivre
ensemble’. Si la convivencia dispose de lieux privilégiés dans l’espace urbain,
comme la fontaine ou le marché, elle revêt aussi des formes différentes:
comme l’argumentaire du colloque le suggère si bien, la convivencia peut être
perturbée et fortement troublée, par un vol, par une agression. Pour s’attacher
230 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
1. Sur toutes ces définitions: ROBERT, P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 2e éd.
revue par A. REY, Paris, 1992.
2. LEMÉNOREL, A. “Rue, ville et sociabilité à l’époque contemporaine. Histoire et perspective”. La rue, lieu de
sociabilité? Actes du colloque de Rouen 16-19 nov. 1994. Rouen, 1997, pp. 425-442.
3. Citons, par exemple: “Plazas” et sociabilité en Europe et Amérique latine, Colloque des 8 et 9 mai 1979. Paris,
De Boccard, 1982; BOURIN, M., Villages médiévaux en Bas-Languedoc: genèse d’une sociabilité (Xe-XIVe siècle).
Paris, l’Harmattan, 1987. La sociabilité approchée dans la longue durée a été placée, en 1982, au cœur des études
du Groupe de Recherche d’Histoire de l’Université de Rouen; parmi les colloques organisés sur ce thème:
Sociabilité, pouvoirs et société. Actes du colloque de Rouen (24-26 nov. 1983). Rouen, 1987.
4. HESSE, P.-J. “Jalons pour une histoire de la notion de lien social”. Regards croisés sur le lien social. Journée de
la Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin (Nantes, 2003). Paris, 2005, pp. 17-26. Le lien social est le thème
fédérateur des projets de recherche de la M.S.H. Ange-Guépin.
à la convivencia dans les villes médiévales, il convient donc d’examiner
l’imaginaire de la convivencia, convivialité idéale de rencontres et d’échanges
constructifs, mais aussi les expériences quotidiennes d’une convivencia dont
les liens sociaux se tendent parfois jusqu’à se rompre. Enfin, pour évoquer les
lieux et les formes du vivre ensemble dans les villes d’al-Andalus, il m’a semblé
préférable de s’en tenir à un seul cas, particulièrement bien documenté, la
Cordoue des Xe-XIe siècles qui, riche de ses sources narratives et juridiques,
s’est naturellement imposée. Comme capitale des Omeyyades, elle est le
protagoniste des chroniques de `Arıb, d’Ibn .Hayyan ou encore d’Ibn `I -dar ı qui
évoquent parfois, en filigrane derrière les faits et gestes du prince, les lieux de
la convivialité urbaine. Le souvenir de la capitale du califat reste si tenace que
les géographes ou les poètes qui décrivent la belle riveraine du Guadalquivir
après 1031 continuent à l’évoquer au sommet de sa gloire, glissant parfois dans
leur discours quelques-uns des lieux de la sociabilité cordouane. Enfin, le juriste
andalou Ibn Sahl, en poste à Cordoue dans les années 1060, nous a laissé bien
des données sur les liens sociaux tissés par les Cordouans des Xe et XIe siècles5.
Questionner ces sources écrites sur les lieux et les formes de la convivencia
dans la Cordoue des Xe-XIe siècles risque bien de mener à une vision
fragmentaire de la convivialité cordouane. L’archéologie permettra, fort
heureusement, d’apporter au puzzle d’intéressantes pièces complémentaires,
dans une fructueuse confrontation du texte et du terrain. Précisons, enfin, que
le sens consacré de convivencia, celui de la coexistence entre musulmans et
tributaires juifs et chrétiens, a volontairement été écarté de l’approche, tant
l’historiographie sur cette thématique est riche6. Il est temps, désormais,
d’apporter quelques éléments de réponse à la question suivante: où et
comment vit-on ensemble dans l’espace urbain cordouan?
231Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
5. Son recueil juridique, partiellement édité par M.ˇHallaf, a suscité divers travaux ces dernières années, dont
l’analyse du système judiciaire cordouan (MÜLLER, C. Gerichtspraxis im Stadtstaat Córdoba, Zum Recht der
Gesellschaft in einer malikitisch-islamischen Rechtstradition des 5./11. Jahrhunderts. Leiden-Boston-Köln, Brill,
1999). Aux publications autour de l’œuvre rassemblées dans MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue au Moyen
Âge. Solidarités citadines en terre d’Islam (Xe-XIe s.). Rennes, P.U.R., 2003, ajoutons VAN STAËVEL, J.-P. “Prévoir,
juguler, bâtir: droit de la construction et institutions judiciaires à Cordoue durant le 4e/Xe siècle”. Cuadernos de
Madınat al-Zahra’, 5, 2004, pp. 31-51.
6. Parmi les travaux récents: Tolerancia y convivencia étnico-religiosa en la Península Ibérica durante la Edad
Media. III Jornadas de cultura islámica. Huelva, 2003; Espiritualidad y convivencia en al-Andalus. IV Jornadas
islámicas. Huelva, 2006.
1. LES LIEUX DE LA CONVIVIALITE
Il convient, dans un premier temps, de planter le décor de la convivencia, car
“l’analyse des espaces de la sociabilité urbaine permet de mieux comprendre
comment s’affirme, au cœur du système de relations médiéval, une nouvelle
manière de vivre ensemble7”. Les lieux du ‘vivre ensemble’ sont multiples et
divers: la cour de la maison, la rue, la mosquée de quartier, la fontaine
publique, les boutiques du marché, la grande-mosquée, etc. constituent autant
de lieux de convivialité, visités plus ou moins fréquemment. Les lieux de la
convivialité quotidienne, situés dans l’intimité du quartier, se différencient des
lieux de la convivialité occasionnelle, éléments du bien commun, répartis dans
l’espace urbain.
1.1. LE QUARTIER: LES LIEUX DE LA CONVIVIALITÉ QUOTIDIENNE
Dans la ville médiévale, “la sociabilité s’enracinait d’abord dans le voisinage; le
quartier avait ses limites bien connues des habitants, des frontières parfois
lourdes de sens […]; il s’organisait autour de la rue […] centre de la vie
collective pour tout un ensemble humain. Le quartier avait ses centres de
ralliement8”. La Cordoue des Xe-XIe siècles n’échappe pas à ce trait, mais son
inscription dans le monde de l’Islam confère à la convivencia quotidienne
développée au sein du quartier une tonalité particulière.
1.1.1. LES CADRES DE LA SOCIABILITÉ DE VOISINAGE
Des quartiers qui se partageaient l’espace urbain de Cordoue, le nombre et les
limites restent aujourd’hui totalement inconnus. Le quartier existe, cela est
certain: au XIe siècle, il est appelé .hawma, terme qui dérive de .hawama,
‘tourner autour’; pourvu d’un point central qui lui donne son unité, le quartier
trouve ses limites là où il rencontre l’attraction du quartier voisin9. Le quartier
porte un nom, celui d’une mosquée, qui permet de situer les individus et les
232 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
7. BOUCHERON, P. et D. MENJOT, D. “La ville médiévale”. PINOL, J.-L. (éd.) Histoire de l’Europe urbaine. I. De
l’Antiquité au XVIIIe siècle. Paris, Seuil, 2003, p. 461.
8. ROSSIAUD, J. “Crises et consolidations 1330-1350”. LE GOFF, J. (éd.) La ville médiévale des Carolingiens à la
Renaissance. Paris, Seuil, 1980, p. 524.
9. MAZZOLI-GUINTARD, C. “Mosquées, territoire et communauté de quartier en al-Andalus: le cas de Cordoue
aux Xe-XIe siècles”. Iglesias y Fronteras, Congreso-Homenaje a José Rodríguez Molina. Jaén, 2005, pp. 465-480.
biens dans l’espace urbain: un tel fait partie des ‘gens de telle mosquée’, telle
maison est sise ‘dans le quartier de telle mosquée’. L’appartenance au quartier
a une importance juridique, puisque la valeur d’un témoignage en dépend: à
propos d’un litige de voisinage, les juristes distinguent ainsi le témoignage des
gens du quartier de ceux qui ne sont pas du quartier10.
Le quartier a un point de ralliement fondamental, la mosquée. Il s’agit d’un
modeste édifice, comme l’indiquent les vestiges conservés de quelques
mosquées de quartier, dont les minarets constituent aujourd’hui les clochers
des églises San Juan, Santiago et Santa Clara. La mosquée de Fontanar, mise
au jour dans la zone d’expansion occidentale de Cordoue, donne une bonne
idée de ce que devait être la mosquée de quartier: un rectangle d’environ 45
x 20 m. est partagé en deux espaces, la salle de prières, à trois nefs, et une
cour, un peu plus vaste que la partie couverte11. Si la mosquée de quartier est
le lieu possible et souhaitable des prières quotidiennes, l’édifice et ses abords
déterminent l’espace où les ahl al-masgid se réunissent pour discuter des
affaires de leur quartier: faut-il déplacer la porte de la salle aux ablutions de
l’oratoire? La question se pose, dans le premier quart du Xe siècle, à propos de
la mosquée de `Agab: la porte, qui donnait sur la rue, a été déplacée et
s’ouvre dorénavant sur la cour de la mosquée, traversée par des individus qui
ne devraient pas s’y trouver. Parmi les habitants du quartier, certains
souhaitent revenir à la configuration ancienne des lieux12. Et comment
empêcher le muezzin de prier à voix haute, dès l’aube, depuis le toit de la
mosquée? Le problème a agité, dans les années 1030, les habitants d’un
quartier de Cordoue, exaspérés par le réveil matinal auquel ils étaient
soumis13. La mosquée de quartier constitue parfois, et de manière
exceptionnelle, le prolongement de la rue: la réouverture d’une porte dans la
mosquée du cimetière de la Tour, dans le premier quart du Xe siècle, pourrait
avoir cette conséquence désastreuse, cette porte ouvrant un raccourci à travers
le bâtiment14.
233Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
10. MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., pp. 123-124.
11. LUNA OSUNA, D. y ZAMORANO ARENAS, A. M. “La mezquita de la antigua finca ‘El Fontanar’ (Córdoba)”.
Cuadernos de Madınat al-Zahra’, 4, 1999, pp. 145-170.
12. MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., pp. 113-114 et 224.
13. MARÍN, M. “Law and piety: a Cordovan Fatwa”. British Society for Middle Eastern Studies, 17, 1990, pp. 129-136.
14. MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., pp. 115-116 et 226.
1.1.2. LES LIEUX DE LA SOCIABILITÉ DE VOISINAGE
Si la mosquée constitue le pôle de la sociabilité du quartier, où celle-ci
s’épanouit-elle? Dans le fina’, espace non bâti qui jouxte la mosquée15: cet
espace, qui peut prendre les dimensions d’une placette, accueille boutiques et
étals temporaires et les habitants du quartier le considèrent comme un espace
semi-privé, possédé collectivement. Ainsi, au début du Xe siècle, le fina’ de la
mosquée d’al-Sifa’, situé au sud du bâtiment, sert-il à parquer les brebis pour
la traite; les éventaires de la mosquée permettent l’approvisionnement en
produits d’usage courant, céréales, légumes et bois de chauffage. Parfois, de
véritables échoppes sont adossées au mur de la mosquée, comme la boutique
érigée en habou et appuyée sur la mosquée du cimetière de la Tour16. Ces
boutiques situées auprès des mosquées de quartier devaient être de modestes
dimensions, à l’image des petites cellules distribuées autour d’une cour, mises
au jour dans la zone d’expansion occidentale de Cordoue et interprétées
comme étant un petit marché de quartier17.
Enfin, les ruelles et les impasses du quartier constituent d’autres lieux de
sociabilité pour les ahl al-masgid: les rues qui donnent accès aux maisons,
qu’elles soient ouvertes à leurs deux extrémités ou qu’il s’agisse d’impasses,
sont essentiellement fréquentées par leurs riverains, par ceux dont les
demeures s’ouvrent sur ces rues. Appelées zuqaq ou zanqa dans l’œuvre d’Ibn
Sahl, elles sont aussi désignées par darb dans d’autres sources arabes18. Les
individus s’y croisent et discutent de problèmes posés par la voirie: considérée
comme appartenant en co-propriété aux riverains, ceux-ci doivent se mettre
d’accord sur son entretien, mais aussi sur les modifications à lui apporter19.
L’ouverture d’une porte dans une ruelle peut ainsi susciter de vives
discussions avec le voisin, qui proteste contre l’indiscrétion visuelle dont il est
234 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
15. Pour une bonne définition du fina’: RAYMOND, A. “Espaces publics et espaces privés dans les villes arabes
traditionnelles”. Maghreb-Machrek, 123, 1989, pp. 194-201.
16. Sur ces exemples: MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., pp. 123-124, 223 et 226.
17. FUERTES SANTOS, Mª del C. “Aproximación al urbanismo y la arquitectura doméstica de época califal del
Yacimiento de Cercadilla”. Arqueología y Territorio Medieval, 9, 2002, pp. 105-126.
18. Les recueils biobibliographiques et les sources narratives ont conservé quelques noms de ruelles: LÉVI-
PROVENÇAL, É. L’Espagne musulmane au Xe siècle. Paris, Larose, 1932, p. 209; TORRES BALBÁS, L. Ciudades
hispanomusulmanas. Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 19852, pp. 371-372.
19. BRUNSCHVIG, R. “Urbanisme médiéval et droit musulman”. Revue des Etudes Islamiques, 15, 1947, pp. 127-155.
victime20; la réparation d’une venelle, qui repose sur la concertation du
voisinage, suppose des échanges courtois entre riverains, ainsi qu’une
explication plus vive avec les récalcitrants qu’il faut contraindre à participer
aux travaux21.
1.1.3. LA MAISON, LIEU DE LA SOCIABILITÉ FAMILIALE
Les fouilles menées dans l’expansion occidentale de Cordoue ont mis au jour
des structures d’habitat aux dimensions variables, de 75 m2 à 160 m2 22; elles
suivent le modèle de la maison urbaine apparu sur d’autres sites andalusíes,
maison à cour centrale, introvertie, dont les murs qui donnent sur la rue ne
comportent pas d’autre ouverture que la porte. Dans ce type de maison, la cour
est le noyau central de l’habitat, puisque les pièces ne communiquent entre
elles que par cette cour et qu’il faut l’emprunter pour entrer ou pour sortir de
n’importe quelle pièce de la maison23: espace essentiel de la sociabilité
familiale, la cour doit donc en même temps protéger soigneusement l’intimité
du foyer, en le préservant de toute indiscrétion visuelle et en tenant à l’écart
les étrangers au cercle familial24. “El ideal social de segregación por géneros”,
sur lequel repose la société, implique l’exclusion de la femme respectable de
la convivencia publique, la maison constituant dès lors, pour celle-ci, le seul
espace de convivialité25.
235Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
20. Comme l’atteste une fatwa compilée par Ibn Sahl et rendue à Cordoue par un juriste mort en 872: IBN SAHL.
Wa-ta’iq fı su’un al-`umran fı l-Andalus: al-masagid wa l-dur. M.ˇHallaf éd., Le Caire, Tawzı` al-Markaz al-`Arabı
al-Dawlı li-l-I`lam, 1983, p. 109.
21. D’après une fatwa émise à Cordoue au Xe siècle et conservée par al-Wansar ıs ı (LAGARDÈRE, V. Histoire et
société en Occident musulman au Moyen Âge, Analyse du Mi`yar d’al-Wansarısı. Madrid, Casa de Velázquez-
C.S.I.C., 1995, p. 172).
22. Sur ces maisons mises au jour à Cordoue, voir les bilans des interventions archéologiques publiés dans les
Anuarios Arqueológicos de Andalucía, ainsi que ARJONA CASTRO, A. Urbanismo de la Córdoba califal. Córdoba,
Ayuntamiento de Córdoba, 1997 p. 119; ACIÉN ALMANSA, M. y VALLEJO TRIANO, A. “Urbanismo y Estado
islámico: de Corduba a Qur.tuba-Madınat al-Zahra’”. Genèse de la ville islamique. Madrid, 1998, p. 128; FUERTES
SANTOS, Mª del C., op. cit.
23. Ce concept d’une cour-couloir est bien exposé dans DÍEZ JORGE, E. (ed.). La Alhambra y el Generalife. Guía
histórico-artística. Granada, Universidad de Granada, 2006, p. 47.
24. Une anecdote relative à Saragosse rapporte comment un colporteur parvient à entrer dans une maison (fatwa
du XIe siècle: LAGARDÈRE, V. op. cit., p. 61). Sur l’indiscrétion visuelle et la protection de la vie familiale:
BRUNSCHVIG, R., op. cit., pp. 138-140; KHIARA, Y. “Propos sur l’urbanisme dans la jurisprudence musulmane”.
Arqueología Medieval, 3, 1994, pp. 33-46.
25. MARÍN, M. Mujeres en al-Ándalus. Madrid, C.S.I.C., p. 219. Ainsi, la femme respectable ne peut-elle
fréquenter qu’exceptionnellement le bain public: DE LA PUENTE GONZÁLEZ, C. “Mujeres andalusíes y baños
públicos”. Baños árabes en Toledo. Toledo, 2006, pp. 49-57.
La maison offre cependant des occasions d’échanges au-delà du cercle familial,
autour du mur qui sépare des fonds voisins: ces échanges peuvent se faire sur
le ton de la courtoisie, lorsqu’un propriétaire fait don de son mur à son voisin
pour que celui-ci puisse exhausser sa maison ou lorsqu’il accepte que son
voisin puisse enfoncer une poutre dans ce mur. Parfois, ces échanges se font
sur un mode moins aimable et débouchent sur une action en justice: dans les
années 1060, un couple porte plainte contre sa voisine qui, pour accéder à une
chambre haute de sa demeure, a appuyé un escalier contre la maison du
couple26. Une dizaine d’années plus tard, deux frères portent plainte contre leur
voisine qui, depuis la terrasse de sa maison située dans le quartier de la grande-
mosquée, peut observer non seulement une chambre haute de la demeure des
deux frères, mais aussi la cour de celle-ci27.
Ainsi, en bien des espaces du quartier, les Cordouans des Xe-XIe siècles vivent
ensemble au quotidien, qu’il s’agisse de la mosquée et de ses afniya avec ses
éventaires et ses boutiques, ou des ruelles et des impasses qui donnent accès
aux maisons: à ces lieux de la convivialité quotidienne, s’ajoutent les éléments
du bien commun, espaces d’une convivialité plus occasionnelle.
1.2. LE BIEN COMMUN: LES LIEUX DE LA CONVIVIALITÉOCCASIONNELLE
Par espaces d’une convivialité plus occasionnelle, il faut comprendre les lieux de
la ville irrégulièrement fréquentés, la muraille mise en état de défense lors d’un
siège, la promenade qui longe le palais et où le prince distribue des aumônes,
ou bien encore le marché aux objets précieux. Tous ces lieux sont aux mains du
prince qui les utilise pour affirmer son autorité sur la ville et pour tenir celle-ci
en mains; ces espaces, enfin, constituent le bien commun des musulmans,
comme le rappellent les chroniqueurs lorsqu’ils mentionnent les interventions
califales sur la voirie cordouane, réalisées au nom de l’intérêt général28, ou
236 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
26. Ibn Sahl rapporte que les extrémités de deux marches, ainsi que les bases de la chambre haute, ont été
enfoncées dans le plafond de la salle des plaignants: MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., pp. 164-
165 et 229.
27. Ibid., pp. 168-169 et 236.
28. En 972, le calife fait élargir la rue principale du marché, “pour le bien commun des musulmans et pour veiller
aux intérêts de ceux-ci” (Anales palatinos del califa de Córdoba Al- .Hakam II, por `-Isa ibn A.hmad al-Razı. Trad.
E. García Gómez, Madrid, 1967, Sociedad de Estudios y Publicaciones, p. 93).
comme l’affirment les juristes à propos des murailles, bien public des musul-
mans29.
1.2.1. AFFIRMER LA PUISSANCE DU PRINCE: LES LIEUX DE LA
SOCIABILITÉ CONTRAINTE
Les lieux du pouvoir apparaissent comme des espaces d’une sociabilité forcée
pour une partie des Cordouans: la grande-mosquée, lieu où le cadi rend la
justice, est un espace d’échanges contraints entre un plaignant et un
défenseur30 et les citadins sont tenus de la fréquenter pour prêter la bay`a,
entendre laˇhu.tba ou apprendre la levée d’un impôt ou le départ d’une
campagne militaire31. Certes, la grande-mosquée permet aussi l’expression
d’une sociabilité voulue par les ulémas: ils s’y réunissent, s’y asseyant en cercle
pour discuter de questions d’ordre religieux; cette pratique, attestée au début
du Xe siècle, l’est encore dans la seconde moitié du XIe siècle, au grand dam
d’Ibn Sahl, qui souhaite ne l’autoriser qu’autour de la présence d’un savant
distingué32.
Autour des fortifications urbaines, se tissent aussi des liens d’une sociabilité
imposée, sous la forme de levées fiscales ou de travaux d’entretien: en 1010-
1011, le calife Hisam II convoque marchands et artisans dans son palais et leur
demande à nouveau une aide pécuniaire pour aider à la défense de la ville,
assiégée par les Berbères33. Aux portes ouvertes dans l’enceinte, se tiennent des
percepteurs de taxes qui inspectent les chargements afin de voir quelles
marchandises sont introduites dans la ville; dans la seconde moitié du XIe
siècle, une inspection tourne à l’altercation et entraîne les protagonistes de
l’affaire devant le juge34. Par ailleurs, les habitants des zones jouxtant la
237Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
29. MARÍN, M. “Documentos jurídicos y fortificaciones”. I Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus
(Algeciras, nov.-dic. 1996). Algeciras, 1998, pp. 79-87: aswar al-muslimın min ma.sali.hi-him.
30. Sur les juges cordouans, cf. VIGUERA MOLINS, Ma J. “Los jueces de Córdoba en la primera mitad del siglo
XI (análisis de datos)”. Al-Qan.tara, V, 1984, pp. 123-145.
31. Sur toutes ces fonctions de la grande-mosquée, cf. J. MARTOS QUESADA, J. “Los espacios de culto en las fuentes
jurídicas andalusíes”. Espaces d’échanges en Méditerranée, Antiquité et Moyen Âge. Rennes, 2006, pp. 202-203.
32. MARÍN, M. “Learning at Mosques in al-Andalus”. Islamic Legal Interpretation. Muftis and their Fatwas.
Cambridge-London, 1996, pp. 47-54.
33. Ils refusent, prétextant qu’ils ont déjà plusieurs fois versé des contributions (IBN `I -D-AR-I. La caída del califato
de Córdoba y los Reyes de taifas. Trad. F. Maíllo Salgado, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, p. 96).
34. Affaire rapportée par Ibn Sahl: MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., p. 211.
muraille sont chargés de la réparation de celle-ci, sans qu’il soit possible de
préciser à quand remonte cet usage et quels sont les riverains concernés. Lors
de la levée du ta`tıb, en 1126, le chroniqueur rapporte que “les gens de
Cordoue se chargèrent de réparer leurs murailles selon la coutume, de telle
sorte que les habitants de chaque quartier (litt. ‘ceux de chaque mosquée’)
décidaient ce qui leur revenait et le travail fut achevé sans désordre ni
imposition35”. Il est fort probable que les individus alors chargés de remettre en
état l’enceinte soient uniquement des membres de la umma: la muraille, d’une
part, leur appartient collectivement; d’autre part, il n’est pas impossible que la
venue des Almoravides en ait terminé avec la mixité des quartiers, dont
l’existence est attestée dans la Cordoue des années 103036.
1.2.2. FACILITER LA CIRCULATION DES INDIVIDUS ET DES BIENS:
LES LIEUX DE LA SOCIABILITÉ DE PASSAGE
Pour tenir en main une ville peuplée et étendue, il faut empêcher la rumeur
d’y gronder; pour cela, le souverain omeyyade doit réunir les conditions
permettant un ravitaillement satisfaisant de la ville, ce qui signifie, entre autres,
lutter contre tout ce qui peut gêner le déplacement des hommes et des biens
dans l’espace urbain. Dans les villes de l’Occident chrétien, comme le rappelle
B. Arízaga Bolumburu, “los estatutos comunales regulan […] los puntos de
contacto entre el espacio público y las construcciones privadas37”; dans la
Cordoue islamique, les agents du prince s’efforcent également d’empêcher les
empiétements sur le bien public: ils peuvent compter sur des “elementos
reguladores de la vida social, desarrollados a partir del derecho islámico, así
238 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
35. IBN `I -D-AR-I. Kitab al-Bayan al-Mu
.grib. Ed. I. `Abbas, Beyrouth, Dar al--Taqafa, 1980, p. 74; Nuevos fragmentos
almorávides y almohades. Trad. A. Huici Miranda, Valencia, Anubar, 1963 (Textos Medievales, 8), pp. 170-172.
36. Sur l’attitude sévère des Almoravides vis-à-vis des -dimmı: VIGUERA MOLINS, Mª J. “Cristianos, judíos y
musulmanes en al-Andalus”. Cristianos, musulmanes y judíos en la España medieval. De la aceptación al
rechazo. Valladolid, 2004, pp. 43-69. Sur la mixité confessionnelle des quartiers: MAZZOLI-GUINTARD, C.
“Espacios de convivencia en las ciudades de al-Andalus”. Espiritualidad y convivencia en al-Andalus, op. cit.,
pp. 73-89. La participation de tributaires aux travaux de réfection ou de construction de l’enceinte est attestée,
pour une époque tardive, dans le cas de prisonniers: BARRERA MATURANA, J. I. “Participación de cautivos
cristianos en la construcción de la muralla nazarí del Albayzín (Granada): sus graffiti”. Arqueología y Territorio
Medieval, 11-1, 2004, pp. 125-158.
37. ARÍZAGA BOLUMBURU, B. Urbanística medieval (Guipúzcoa). Donostia, Kriselu, 1990, p. 173.
como otros mecanismos de carácter administrativo creados para el gobierno de
la ciudad en sus diferentes ámbitos”38.
La voirie cordouane s’articule autour d’un axe principal, de direction nord-sud,
qui traverse la ville depuis sa porte septentrionale jusqu’à la Porte du Pont et
passe entre la grande-mosquée et le palais: sur cette grand’rue, al-ma.hagga al-
`u.zma, s’ouvrent quelques axes importants, qui mènent vers les portes de la
ville, comme la rue qui débouche dans la sikka al-`u.zma, l’antique Via
Augusta, au niveau de la Porte de Tolède. Cette dernière est victime d’une
tentative d’usurpation, de la part du .ha gib de l’émir, Ibn al-Sal ım (m. 914), qui
s’empare d’une partie de cette voie publique (ma.haggat al-muslimın) et
l’incorpore à son jardin, en entourant d’un mur l’espace ainsi gagné sur la rue39.
Il faut situer l’affaire entre 888, année au cours de laquelle Ibn al-Sal ım prend
ses fonctions, et 907, année de la mort de deux des juristes consultés sur cette
affaire, qui concerne le bras droit de l’émir40. Le jardin d’Ibn al-Sal ım se trouve
au nord-est de l’Ajerquía, vers l’actuel quartier de San Lorenzo, dans un
faubourg qui n’est pas encore totalement urbanisé; la rue qui borde la propriété
se prolonge, au-delà de la Porte de Tolède, par le grand axe est-ouest de la
ville, dans sa partie septentrionale. Si les juristes émettent des avis
contradictoires sur l’accaparement du .hagib, reflet du pluralisme d’opinions qui
existe au sein de l’école malékite, la plupart se prononce contre l’empiétement
et le .hagib est condamné à devoir détruire le mur qui matérialise son
accaparement de la voie publique41; les intérêts des proches de l’émir ne
bénéficient d’aucun traitement de faveur, car se trouve en jeu un élément vital
de la voirie, bien public des musulmans, comme le rappellent les juristes.
239Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
38. PINILLA MELGUIZO, R. “Saneamiento urbano y medio ambiente en la Córdoba islámica (siglos VIII-XIII)”.
BERBEL J. y PORCEL, Ó. (éds.) Las ordenanzas de limpieza de Córdoba (1498) y su proyección. Córdoba,
Universidad de Córdoba, 1999, pp. 39-54.
39. L’affaire est rapportée par Ibn Sahl: MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., pp. 142-144 et 217;
“‘Que nul n’empiète sur la rue qui appartient à tous!’: à propos d’une tentative d’accaparement de la voie
publique à Cordoue au début du Xe siècle”. Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales, IX, 2007, à
paraître.
40. Sur le personnage: MÉOUAK, M. “Histoire de la .higaba et des .huggab en al-Andalus omeyyade (2e/VIIIe-4e/Xe
siècles)”. Orientalia Suecana, XLIII-XLIV, 1994/95, pp. 155-164.
41. Exceptionnellement, Ibn Sahl a consigné l’issue du procès, alors qu’il se contente d’ordinaire de compiler les
opinions des muftis. Certains malékites acceptent l’empiétement sur la voie publique, dès lors que la liberté de
circuler demeure: NEJMEDDINE, N. “La rue dans la ville de l’Occident musulman médiéval d’après les sources
juridiques malikites”. Arabica, L, 2003, pp. 273-305.
Quelques années plus tard, Ibn `Abd al-Ra’uf stipule dans son traité de .hisba
qu’“on doit interdire, à ceux qui le veulent, d’utiliser les fondations pieuses dans
leur propre intérêt […]. Il en sera ainsi des chemins (.turuq), des cours (afniya),
des grandes routes (ma.hagg) et des terres constitués en habous42”. La
préoccupation que manifestent les autorités vis-à-vis des conditions de circulation
transparaît également dans cette anecdote relative au quartier Furn Burriel de
l’Ajerquía43: en janvier 972, traversant ce quartier avec son cortège, le calife
constate l’étroitesse d’une rue qui longe un fossé44; il fait acheter, puis détruire les
boutiques qui bordent cette rue pour élargir l’espace destiné à la circulation.
Le ra.sıf, chaussée maçonnée qui endigue le Guadalquivir devant le palais et
dont des vestiges ont été mis au jour dans les années 1990, constitue une
autre voie très passante de Cordoue45: il permet de gagner l’oratoire en plein
air, la mu.sara, où la foule se presse en procession pour demander la pluie46,
et il donne accès aux moulins posés sur le barrage du fleuve. Au niveau de la
porte principale du palais, la Porte de la Azuda, le ra.sıf rassemble parfois les
Cordouans pour des annonces publiques: il est surplombé par une terrasse que
le souverain utilise pour s’adresser à la foule. En juin 975, le calife et son fils y
président une distribution d’aumônes aux pauvres de la ville, rassemblés là à
cet effet47. En février 1009, assiégé dans son palais, le calife Hisam s’adresse à
la plèbe massée sur le ra.sıf: encadré de deux serviteurs portant chacun un
exemplaire du Coran, le calife réclame le retour au calme48. Le ra.sıf est parfois
le théâtre d’une sociabilité bien macabre: lieu de punition de Cordoue, les
cadavres des rebelles y sont exposés aux yeux des badauds49. Le pont, point
240 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
42. Il est nommé vizir en 931: ARIÉ, R. “Traduction annotée et commentée des traités de .hisba d’Ibn `Abd al-
Ra’uf et de `Umar al-Garsıf ı”. Hespéris-Tamuda, 1, 1960, p. 33.
43. Anales palatinos, op. cit., pp. 89-90.
44. Identifié avec le cours du ruisseau de San Lorenzo par ARJONA CASTRO, A. “Los Banu-l-`Abbas de Córdoba
y los arrabales orientales de Córdoba islámica”. Qur.tuba, 6, 2001, pp. 302-314.
45. Coupe n° 3 de l’intervention archéologique en appui à la restauration de l’Alcázar (1993-1994): MONTEJO
CÓRDOBA, A. J. y GARRIGUET MATA, J. A. “El Alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión y
nuevas hipótesis”. Fortificaciones en al-Andalus, op. cit., pp. 302-332.
46. `AR-IB. La crónica de `Arıb sobre al-Andalus. Trad. J. Castilla Brazales. Granada, Memoria del Sur, 1992, p.
154: au printemps 915, pour remédier à la sécheresse, l’imam conduit cinq processions vers l’oratoire.
47. Anales palatinos, op. cit., pp. 275-276.
48. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., p. 61.
49. MAZZOLI-GUINTARD, C. “Le sang dans les villes d’al-Andalus: sang caché, sang exposé”. Le sang au Moyen
Age, IVe colloque international du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Société et l’Imaginaire au Moyen
Age. Montpellier, 1999, pp. 127-143.
de passage obligé pour gagner la rive gauche du Guadalquivir et la route
menant vers l’Andalousie méridionale, apparaît aussi comme un lieu de
convivialité où Cordouans et étrangers se croisent; l’accès en est sévèrement
réglementé, l’émir interdisant à quiconque de le franchir lorsqu’il se trouve
lui-même en train de chasser de l’autre côté du fleuve. En septembre 910,
des proches de l’émir, dont ses fils, sont arrêtés pour avoir passé outre
l’interdiction50.
1.2.3. GARANTIR LE BON APPROVISIONNEMENT D’UNE VILLE SAINE:
LES LIEUX INCONTOURNABLES DE LA SOCIABILITÉ
Le souk et la qay.sariyya, entrepôt des marchandises de luxe, constituent
d’évidents espaces de convivialité pour les plus fortunés des Cordouans: des
conversations s’y engagent entre vendeurs et acheteurs, ou entre acheteurs
eux-mêmes, comme ce notable et cet uléma se disputant l’acquisition d’un
livre51, mais aussi entre artisans, lorsque le mu.htasib qui administre le marché
des cordonniers dénonce les malfaçons des fabricants52. Mais le souk résonne
aussi parfois d’accents religieux et de formules liturgiques: répondant à l’appel
de l’un des leurs, des musulmans y prient et désertent les mosquées voisines,
au grand dam du mufti53. La fontaine installée devant l’une des portes du palais
par `Abd al-Ra.hman III, pourvue de trois vasques pour faciliter la prise d’eau,
représente sans doute un autre lieu du vivre ensemble de la Cordoue
omeyyade et une “claire affirmation architecturale de l’idéologie du bien
commun54”, mais les sources restent muettes quant à la noria des cruches qui
venaient s’y remplir55: l’accès en était-il libre pour tous les Cordouans? Les
porteurs d’eau y avaient-ils un droit d’usage privilégié?
241Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
50. `AR-IB, La crónica, op. cit., pp. 105-106.
51. L’anecdote figure chez AL-MAQQAR-I. The History of the Mohammedan dynaties in Spain. Trad. P. de
Gayangos. London-New York, Routledge Curzon, 20022, t. I, p. 140.
52. MAZZOLI-GUINTARD, C. “L’artisan, le mu.htasib et le juge: naissance et solution d’un conflit à Cordoue dans
la seconde moitié du XIe siècle”. La résolution des conflits au Moyen Âge. XXXIe Congrès de la S.H.M.E.S.P. Paris,
2001, pp. 189-200.
53. La question sur la prière dans les souks, rapportée par Ibn Sahl, concerne la Cordoue du second XIe siècle:
MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., p. 220.
54. BOUCHERON, P. et D. MENJOT, D. “La ville médiévale”, op. cit., p. 484.
55. Les chroniqueurs se bornent à signaler que l’émir a fait installer, en 919, une fontaine devant la Porte de la
Justice: `AR-IB, La crónica, op. cit., p. 154; Crónica anónima de `Abd al-Ra.hman III al-Na.s¯ır. Ed. y trad. É. Lévi-
Provençal y E. García Gómez. Madrid-Granada, Instituto Miguel Asín-C.S.I.C., 1950, p. 126.
Parmi les autres lieux de la ville où les Cordouans sont amenés à se rencontrer,
se trouvent les cimetières: certes, les remarques acerbes d’un Ibn `Abdun à
propos des cimetières de la Séville du début du XIIe siècle, où des individus
s’installent sur des tombes pour boire du vin et se livrer à la débauche et où
des vendeurs circulent dans les allées56, concernent un autre temps et un autre
espace que ceux de la Cordoue omeyyade. En ce qui concerne cette dernière,
les données relatives à une forme de sociabilité se manifestant dans l’espace
du cimetière sont plus allusives: au début du Xe siècle, un échange de vues
entre parents de défunts met en scène des musulmans qui s’offusquent du
passage entre leurs sépultures de chrétiens transportant leurs cercueils entre
leurs tombes57; en juin 975, de nombreux Cordouans assistent à l’enterrement
d’un pieux ascète dans le cimetière de Qurays58. En revanche, lorsqu’Ibn
`Abdun dénonce l’aménagement de latrines et de cloaques à ciel ouvert dont
le contenu se déverse au-dessus des morts, cette situation rappelle celle du
cimetière cordouan de `-Amir au début du Xe siècle, où les eaux de canalisations
de plusieurs maisons et de bains se déversent, puis stagnent, dans des
tranchées creusées dans le cimetière59. C’est aux autorités urbaines qu’il
incombe de maintenir les cimetières en bon état: en 972, constatant que le
cimetière d’Umm Salama, situé au nord de Cordoue, est devenu trop exigu, le
calife décide de le faire agrandir, en ordonnant l’achat et la démolition de
maisons60. Par des mesures d’hygiène et de salubrité indispensables à
l’existence même de la ville, le pouvoir maintient ainsi en bon état les lieux de
la sociabilité urbaine.
Il reste, enfin, deux grands absents parmi ces lieux de convivialité, le bain et
le four: les sources attestent l’existence de fours chez des particuliers, dont les
fumées gênent le voisinage61, comme elles attestent la présence de bains62, mais
242 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
56. IBN `ABD -UN. Séville musulmane au début du XIIe siècle. Le traité d’Ibn `Abdun sur la vie urbaine et les corps
de métiers. Trad. É. Lévi-Provençal. Paris, Maisonneuve, 1947, pp. 57 et 59.
57. Affaire rapportée par Ibn Sahl: MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., p. 207.
58. Anales palatinos, op. cit., p. 271.
59. MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., p. 213.
60. Anales palatinos, op. cit., pp. 115-116.
61. Affaire rapportée par Ibn Sahl: MAZZOLI-GUINTARD, C. Vivre à Cordoue, op. cit., p. 235.
62. Les données figurant dans MUÑOZ VÁZQUEZ, M. “Los baños árabes de Córdoba”. Al-Mulk, Anuario de Estudios
Arabistas, 1961-62, 2, pp. 53-117 mériteraient d’être reprises à la lumière de travaux récents, comme celui de
MARFIL RUIZ, P. “Intervención arqueológica en el baño de S. Pedro (Córdoba)”. Qur.tuba, 2, 1997, pp. 335-336.
le manque de données relatives à la fréquentation de ces espaces ne permet
pas de les évoquer en termes de lieux du vivre ensemble63. Au total, la Cordoue
des Xe-XIe siècles peut aisément être évoquée comme un ensemble de lieux de
sociabilité, où les individus sont amenés à vivre ensemble, depuis le cercle
étroit de la vie familiale jusqu’aux espaces ouverts du marché et des grands
axes de circulation, où une partie des Cordouans rencontre des étrangers à la
ville. Mais ainsi décrite, Cordoue demeure immobile; or, ces lieux de rencontre
doivent s’animer, au travers des formes revêtues par le lien social dans ces
espaces urbains.
2. LES FORMES DU LIEN SOCIAL
2.1. UNE HARMONIEUSE COHABITATION SOUS LA MAIN DE FERDU PRINCE
2.1.1. UNE SI PARFAITE HARMONIE SOCIALE…
Les sources narratives donnent de la Cordoue califale l’image d’une ville
paisible et sereine, où les individus vivent ensemble dans la plus parfaite
harmonie: entre la révolte de 818 et la Révolution de 1009, aucun mouvement
de foule ne trouble la capitale. Certes, cherté du grain et disette touchent
parfois les Cordouans. Qu’importe! Ils se rendent sagement en procession vers
l’oratoire du faubourg, derrière leur imam, pour réclamer la pluie: au
printemps 915, à la suite d’une sécheresse prolongée et généralisée, les
marchés sont mal approvisionnés et les prix augmentent; à cinq reprises, les
Cordouans s’en vont réciter des prières pour la pluie64. En vain. Un peu plus
tard, le 1er mai 915, les Cordouans partent de nouveau en procession prier pour
la pluie; le crachin qui tombe alors ne permet de sauver qu’une infime partie
des récoltes. Et le chroniqueur de conclure: “la sécheresse fut générale et
s’étendit à toutes les régions d’al-Andalus et à ses frontières, ce qui entraîna
une hausse des prix dans tout le pays”.
243Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
63. Il n’existe pas de données semblables à celles qui figurent dans les fueros du XIIIe siècle et qui visent à ce
que hommes et femmes ne se rencontrent pas au bain, tout comme chrétiens, juifs et musulmans restent à l’écart
les uns des autres: RUCQUOI, A. “Lieux de rencontre et sociabilité urbaine en Castille (XIVe-XVe siècles)”.
Sociabilité, pouvoirs et société, op. cit., pp. 131-141.
64. `AR-IB, La crónica, op. cit., pp. 135-136.
Parfois aussi, les Cordouans affluent dans l’espace public de la ville, en
particulier autour du palais, pour assister à des cérémonies. Les parades
militaires se tiennent devant la Porte de la Azuda: c’est là que sont accueillis
les BanuˇHazar en septembre 971, par des contingents nourris de l’armée et
“des gens des faubourgs de Cordoue, parfaitement armés, qui occupent tous
les espaces libres et se pressent sur les esplanades et les placettes65”. En juin
972, les troupes qui s’apprêtent à partir en campagne passent la Porte des
Jardins de l’Alcázar et se dirigent vers la mu.sara; “tant de gens, parmi les
notables et la plèbe, sortent pour les voir que seul le Créateur pourrait les
compter!”, note le chroniqueur66. En mars 975, le calife et son cortège quittent
Madınat al-Zahra’ pour Cordoue: pour atteindre le palais, ils traversent le souq
où ils sont accueillis par les agents du prince, puis par “les riches Cordouans
et par les principaux commerçants, sans compter d’autres personnes qui les
saluèrent67”.
Les réceptions solennelles, parfaitement organisées, où se déploient luxe et
magnificence pour la venue d’un ambassadeur, le retour d’un général
victorieux ou les deux grandes fêtes de l’islam, sont destinées à l’élite
cordouane; leurs descriptions, tout en beaux défilés et en déplacements
réglés et codifiés, laissent l’image d’un tissu social idéal, dans lequel chacun
occupe la place qui lui revient68. Les cortèges qui accompagnent ces
réceptions suscitent l’admiration des Cordouans: ils parlent longtemps de la
solennité déployée autour du général.Galib, qui revient du Maghreb, en
septembre 97469. Toutes ces occasions de vivre ensemble mettent en scène
une convivialité idéale, pacifique et paisible; dans un décor de théâtre, des
acteurs jouent une scène empreinte de liens sociaux idylliques, dont il faut
chercher les origines dans les codes de représentation utilisés par les
chroniqueurs, mais aussi dans l’omniprésence du prince et de ses agents,
garants de l’ordre public.
244 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
65. Anales palatinos, op. cit., p. 65. Les BanuˇHazar, Zénètes du Maghreb, sont alliés au calife.
66. Anales palatinos, op. cit., p. 102.
67. Anales palatinos, op. cit., p. 253.
68. Sur l’analyse du cérémonial, cf. BARCELÓ, M. “El califa patente: el ceremonial omeya de Córdoba o la
escenificación del poder”. El sol que salió por Occidente. Estudios sobre el estado omeya en al-Andalus. Jaén,
Universidad de Jaén, 1997, pp. 137-162.
69. Anales palatinos, op. cit., p. 242.
2.1.2. …SOUS LA HOULETTE DU PRINCE…
La paix urbaine est assurée par les agents du prince: le .sa .hib al-madına est
chargé, parmi ses multiples responsabilités, de faire appliquer strictement la loi
lorsque la sécurité de l’Etat ou l’ordre public sont menacés; il intervient dans
des affaires mêlant hérésie et opposition aux Omeyyades ou mettant en cause
des notables, membres de la famille princière ou de l’élite cultivée de la
capitale70. Le .sa.hib al-sur.ta, chargé de réprimer les délits portant atteinte à
l’individu ou à l’intérêt public, combine une force de police aux missions
préventives et répressives avec la fonction judiciaire d’un tribunal; tous les
groupes sociaux de la Cordoue omeyyade sont concernés, les trois catégories
de la sur.ta ayant été interprétées comme s’appliquant à autant de classes
sociales71: la haute sur.ta s’occuperait des délits de l’élite, la basse sur.ta de ceux
de la plèbe et la moyenne sur.ta, instaurée par le calife en 929, exercerait sa
juridiction sur la classe moyenne, intermédiaire entre les deux précédentes72.
Ces magistrats peuvent prononcer la peine capitale et ils se trouvent parfois à
l’origine de ces macabres spectacles du ra.sıf où les cadavres des condamnés
restent exposés à la vindicte populaire, afin de rappeler “qu’il ne fallait pas
faire bon marché de l’autorité du souverain ni de celle de ses magistrats73”.
Le maintien de l’ordre public est également assuré par le .sa.hib al-suq:
responsable de la bonne tenue de la ville, il supervise les métiers, les
fabrications et les transactions, il surveille les marginaux et il s’occupe des
problèmes d’urbanisme, s’assurant que les constructions ne gênent pas la
circulation ou que les rues sont vidées de leurs immondices74. A côté de ces
magistrats chargés, au nom du prince, de maintenir la paix urbaine, d’autres
245Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
70. VALLVÉ BERMEJO, J. “El zalmedina de Córdoba”. Al-Qan.tara, II, 1981, pp. 277-318: il rapporte les
interventions du magistrat quand des parents de l’émir passent outre les ordres de ce dernier, quand des poètes
sont insolents contre al- .Hakam II ou lorsqu’un missionnaire chiite fomente contre ce dernier. Voir aussi MÉOUAK,
M. “ Considérations sur les fonctionnaires de la magistrature de la sûreté urbaine (.s¯a .hib al-madına/wilayat al-
madına) dans l’Espagne umayyade”. Orientalia Suecana, XLVIII, 1999, pp. 75-86.
71. Sur cette interprétation: LÉVI-PROVENÇAL, É. Histoire de l’Espagne musulmane. III. Le siècle du califat de
Cordoue. Paris, Maisonneuve et Larose, 1953, pp. 153-158.
72. Cette magistrature reste entourée de zones d’ombre, en particulier cette structure en police à trois niveaux:
ˇHALL-AF, M. “.Sa.hib al-sur.ta f ı l-Andalus”. Awraq, III, 1980, pp. 72-83.
73. LÉVI-PROVENÇAL, É. Histoire de l’Espagne musulmane, op. cit., p. 162.
74. Il prendra le titre de mu.htasib à l’époque almoravide: CHALMETA GENDRÓN, P. El “señor del zoco” en
España: edades media y moderna. Madrid, Instituto Hispano-Árabe de cultura, 1973.
acteurs interviennent pour permettre au plus grand nombre de vivre ensemble
au quotidien.
2.1.3. …ET L’AUTORITÉ DES RESPONSABLES DE GROUPEMENTS
La régulation des liens sociaux est assurée au niveau de divers groupements
d’individus, souvent désignés par ahl al-, les gens de-, dénomination à mettre
en relation avec un droit musulman qui ne connaît que des individus
indifférenciés et n’accorde pas de statut spécifique à un groupe de citadins75.
Les gens des marchés apparaissent comme les responsables des artisans et
commerçants de la ville: convoqués par le calife au moment du siège de
Cordoue par les Berbères en 1010-1011 et sollicités au sujet d’une aide
pécuniaire, ils refusent de la fournir76. Sur les groupements professionnels
organisant l’artisanat cordouan, les données restent peu nombreuses et ne
permettent guère d’aller au-delà de l’affirmation de leur existence77: tantôt, les
sources narratives livrent le nom du responsable d’un métier, Ibn `Uqba, `arıf
des tailleurs, chargé de fixer les bannières sur les lances avant le départ de la
campagne de 97178; tantôt, les sources juridiques fournissent quelques données
sur les actions menées par un chef de métier. Dit mu.htasib dans le recueil d’Ibn
Sahl, le personnage sait dépister les malfaçons des artisans qui dépendent de
lui; lorsque ceux-ci refusent de se plier aux règles du métier, il les dénonce
devant le juge du marché, comme cela se produit dans les années 1060 pour
les cordonniers et les fabricants de sandaraque, vernis de finition utilisé par les
artisans du textile ou du cuir79: ces derniers doivent utiliser de l’argent et non
de l’étain dans leur préparation; les cordonniers doivent fabriquer des
chaussures de bonne qualité, bien résistantes. Rien ne transparaît sur les
246 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
75. Pour l’époque ottomane, A. Raymond désigne ces groupements par ‘institutions populaires’ pour les distinguer
des institutions municipales (RAYMOND, A. Grandes villes arabes à l’époque ottomane. Paris, Sindbad, 1985, p. 129).
76. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., p. 96.
77. Que C. Cahen ne niait pas, s’interrogeant sur la nature de l’organisation, “étatique ou autonome, c’est-à-dire
du type romain ou communal européen” (CAHEN, C. L’Islam des origines au début de l’Empire ottoman. Paris,
Hachette, 1997 (rééd.), pp. 196-201).
78. Anales palatinos, op. cit., p. 49. `Arıf désigne le chef d’un métier non seulement en Orient, comme l’indique
l’article de l’EI2, mais aussi en Occident. Sur le `arıf des charpentiers, à la tête du corps d’ingénieurs de l’armée:
BARCELÓ, C. “Las inscripciones omeyas de la alcazaba de Mérida”. Arqueología y Territorio Medieval, II-1, 2004,
p. 71.
79. MAZZOLI-GUINTARD, C. “De l’étain dans la préparation du vernis: une innovation blâmable à Cordoue au
XIe siècle?”. Château et innovation, Actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire en Périgord. Bordeaux, 2000,
pp. 11-22; “L’artisan, le mu.htasib et le juge”, op. cit.; Vivre à Cordoue, op. cit., pp. 38-39, 128-133 et 208-209.
modalités de nomination de ce responsable du métier: il devait recevoir
l’assentiment de ses semblables, comme le montre l’action collective des
cordonniers qui veulent se débarrasser d’un mu.htasib trop autoritaire à leurs
yeux, en lui interdisant l’accès à leur marché; mais le responsable du métier
peut compter, pour rester à la tête de la profession, sur l’aide du système
judiciaire, les ulémas réprouvant l’attitude des artisans.
Les gens de chaque mosquée de quartier interviennent dans l’urbanisme de
leur lieu de culte et des bâtiments qui le jouxte, salle aux ablutions ou
boutiques habous; les discussions nées de ces interventions contribuent à tisser
des relations entre les habitants du quartier. C’est au niveau du quartier,
également, que les modifications à apporter aux ouvertures des maisons
devaient être discutées, tout comme les conditions de l’entretien de la voirie,
domaines sur lesquels, pour la Cordoue omeyyade, les renseignements sont
lacunaires. Mais les injonctions qui figurent dans le manuel de .hisba d’Ibn `Abd
al-Ra’uf ne peuvent guère être suivies d’effet que si elles trouvent, au niveau
des quartiers, des relais: dans les années 930, le .sa.hib al-suq doit empêcher “les
gens de jeter les ordures, les cadavres d’animaux et autres choses du même
genre sur les routes car cela entraîne des inconvénients pour les demeures des
particuliers. Quant aux détritus, ils engendrent la malpropreté, surtout lorsqu’il
pleut. Les gens doivent se charger de transporter tout cela hors de la ville. On
inspectera soigneusement les mosquées, les parvis et tout ce qui se rattache
aux mosquées; on empêchera les gens de jeter les ordures et les matières
souillées dans leurs cours80”. Rappelons aussi que la médina cordouane est
divisée en deux zones, pourvues chacune d’un `arıf, sans doute responsable
du contrôle fiscal et du maintien de l’ordre81.
Aux groupements autour d’un métier ou d’une mosquée de quartier, il convient
d’ajouter les communautés confessionnelles, les ahl al- -dimma disposant d’une
organisation propre, dont les personnages essentiels sont les responsables des
communautés, le nası’ pour les juifs, le comes pour les chrétiens, et les juges
chargés de trancher les litiges internes à chaque groupe.
247Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
80. ARIÉ, R., op. cit., p. 360.
81. LÉVI-PROVENÇAL, É. Histoire de l’Espagne musulmane, op. cit., p. 374, d’après Ibn al-ˇHa.t ıb.
2.2. UNE VILLE SI TRANQUILLE?
La main de fer du prince ne parvient pas à conserver intacte la paix urbaine,
que des troubles viennent parfois ébranler: ceux-ci revêtent des formes diverses,
de l’altercation au meurtre ou à la révolte; ils naissent d’un individu ou d’un
groupe et si les troubles se développent la plupart du temps dans les espaces
publics de la ville, l’intimité de l’espace familial n’est pas à l’abri de la violence.
2.2.1. LA PAIX URBAINE TROUBLÉE PAR LA PAROLE ET LE CRI
Dans une formule efficace, J.-P. Leguay a résumé cette forme d’agitation: “la
rue est d’abord l’endroit où chacun observe, subodore, interprète puis cause82”.
Qu’observent les badauds? Ce qui sort de l’ordinaire. Au cours de l’été 973, des
regards curieux se posent sur le grand pavillon rouge, d’aspect imposant, que
le calife fait envoyer au général .Galib83. Le 15 décembre 1007, les rues de
Cordoue, où la foule se presse, est le théâtre d’un événement hors du commun:
surgissant des campagnes voisines, un sanglier déboule dans la ville; poursuivi
par des soldats à cheval, il finit sa course entre le Guadalquivir et le palais, où
une lance l’atteint84. La rue est en effet, pour reprendre l’expression de Mª I.
del Val Valdivieso, “le domaine du quotidien par excellence et, par conséquent,
le cadre où l’extraordinaire a un fort impact social85”. Les Cordouans, qui
n’avaient jamais vu de sanglier auparavant et ne connaissent pas cet animal, ne
manquent pas d’interpréter l’événement, perçu comme un mauvais présage.
Et les badauds de discuter. Le ton des conversations peut être très critique: la
quatrième expédition de `Abd al-Malik, menée contre l’Aragon au cours de
l’été 1006, suscite des commentaires méprisants de la part de la plèbe
cordouane86. La moquerie peut l’emporter: les Cordouans se raillent de .Tarafa,
l’esclavon de `Abd al-Malik, sur lequel ils font circuler des satires; ils
surnomment le calife Mu.hammad III le petit poltron, la petite bedaine87. Les
248 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
82. LEGUAY, J.-P. “La rue, lieu de sociabilité”. La rue, lieu de sociabilité?, op. cit., pp. 11-29.
83. Anales palatinos, op. cit., p. 148.
84. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., p. 30.
85. DEL VAL VALDIVIESO, Mª I. “Les rues castillanes au XVe siècle: miroir d’une société”. La rue, lieu de
sociabilité?, op. cit., pp. 63-72.
86. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., p. 20.
87. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., p. 124.
discussions sont parfois dominées par la peur, comme les rumeurs alarmistes
qui circulent à propos des troupes alors en campagne en Castille, à l’été 100788.
Tantôt aussi, c’est la colère qui l’emporte: régulièrement, les Cordouans
viennent maudire les cadavres des suppliciés exhibés sur le ra.sıf et ils sont
appelés à exprimer leur rage contre un voleur publiquement exposé à la
vindicte populaire. En juin 971, un certain A.hmad b. `Umar, auteur supposé de
malhonnêtetés, subit une promenade infamante dans le souk, avant d’être
exposé au courroux populaire; en octobre 973, une foule de Cordouans lance
toutes sortes de malédictions contre la dépouille de l’hérétique Ibn `Abd al-
Salam89. Sur un ton sans doute fort vif, commence dans le marché une
controverse entre l’hérétique Abu l-ˇHayr et le responsable de la sur.ta; lorsque
ce dernier rappelle au rebelle le respect dû aux autorités en place, celui-ci
s’écrie que s’il pouvait disposer de 5000 cavaliers, il entrerait de vive force à
Madınat al-Zahra’ afin de tuer tous ceux qui s’y trouvent et de proclamer le
régime du Fa.timide al-Mu`izz90.
Mais les conversations ne sont pas que cris de fureur et railleries. L’intonation
est parfois celle de l’admiration: en mars 973, le calife est abordé sur la mu.sara
par des cavaliers venus de Lérida, qui le bénissent, lui manifestent leur
gratitude et louent les qualités de leur gouverneur91. L’accent est parfois celui
de la commisération: en juin 975, les soldats assiégés dans Gormaz se trouvent
au cœur des conversations et les Cordouans leur manifestent leur plus
profonde compassion92. Enfin, une seule voix prononce quelquefois les mots
qui troublent la paix urbaine, celle du prédicateur qui appelle à faire
l’aumône, celle du jeune cardeur qui interrompt leˇha.tıb au moment où les
fidèles vont prêter la bay`a, celle du crieur qui proclame dans les souks que
Cordoue n’abrite plus aucun Omeyyade, celle du marchand qui appelle à la
prière dans le marché93.
249Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
88. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., p. 21.
89. Anales palatinos, op. cit., pp. 43-44 et 180.
90. LÉVI-PROVENÇAL, É. Histoire de l’Espagne musulmane, op. cit., pp. 460-461.
91. Anales palatinos, op. cit., p. 192.
92. Anales palatinos, op. cit., p. 271.
93. Anales palatinos, op. cit., p. 189. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., pp. 59 et 131.
2.2.2. LA PAIX URBAINE ÉBRANLÉE PAR DES FAITS ET DES GESTES
Des faits compromettent régulièrement la paix urbaine. Ce sont parfois des
bousculades, comme celle qui emporte les fidèles vers l’intérieur de la grande-
mosquée le 10 avril 974: depuis cinq jours, Cordoue subit les assauts d’une
violente tempête qui a arraché des arbres et mis le fleuve en crue; le vendredi,
juste avant la prière, des pluies diluviennes s’abattent de nouveau sur la ville.
“Les vêtements trempés, les gens se pressent devant les portes des nefs, à
l’intérieur de l’enceinte, et s’efforcent d’entrer dans la salle de prières, en se
poussant brutalement et en se bousculant94”. Les disputes tournent quelquefois
à la bagarre: le 26 juin 972, une altercation entre deux groupes de soldats
devant la Porte de la Azuda dégénère en rixe, à laquelle se mêle une partie de
la populace; il faut l’intervention de plusieurs détachements militaires pour
venir à bout du tumulte95.
Crimes et délits ébranlent aussi la paix urbaine: le marché apparaît comme le
lieu par excellence des forfaits, comme l’attestent les sources juridiques et la
jurisprudence élaborée autour des biens provenant d’un vol, mais des forfaits
sont parfois commis en d’autres lieux, à l’instar de la grande-mosquée où un
vol est commis au détriment du trésor, en octobre 96496. Le vol s’accompagne
quelquefois de violences physiques: à l’époque de Mu.hammad Ier, un individu
se fait voler sa maison par son voisin, le vizir Hasim b. `Abd al-`Azız, qui le
séquestre dans sa propre demeure97. Quant aux homicides, les sources
conservent surtout, mais pas seulement, la mémoire de crimes commis sur des
personnalités politiques: sous le règne de `Abd al-Ra.hman II, le cadavre
découvert dans le quartier des bouchers, dissimulé dans une couffe, appartient
à un individu qui reste dans l’anonymat98. En 1017-1018, `Alı b. .Hammud est
assassiné par ses Esclavons qui profitent de l’isolement et de la tranquillité du
bain palatin pour exécuter leur prince99. En 1031, .Hakam b. Sa`ıd, vizir de
250 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
94. Anales palatinos, op. cit., p. 195.
95. Anales palatinos, op. cit., p. 101.
96. IBN `I -D-AR-I. Histoire de l’Afrique et de l’Espagne intitulée Al-Bayano’l-Mogrib. Trad. É. Fagnan. Alger,
Imprimerie Orientale Pierre Fontana, 1904, t. II, p. 391.
97. IBN AL-Q -U .TIYYA. Historia de la conquista de España de Abenalcotía el Cordobés. Trad. J. Ribera. Madrid,
Tipografía de la Revista de Archivos, 1926, t. II, pp. 70-71.
98. IBN AL-Q -U .TIYYA. Historia de la conquista de España de Abenalcotía el Cordobés. Trad. J. Ribera. Madrid,
Tipografía de la Revista de Archivos, 1926, t. II, pp. 55-56.
99. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., p. 110.
Hisam III, est assassiné dans la rue par un groupe d’opposants qui jettent le
corps après l’avoir décapité, afin d’exposer la tête aux passants100. L’homicide
peut également avoir lieu dans l’intimité de la maison: c’est dans sa demeure
de l’Ajerquía qu’al-.Tubnı, célèbre savant et poète, est retrouvé baignant dans
une mare de sang, en mars 1065, sans doute victime de son fils aîné101. Dans
l’histoire de l’Islam, la grande-mosquée n’est pas à l’abri de telles brutalités et
IbnˇHaldun met en relation l’apparition de la maq.sura avec les tentatives
d’assassinat dont les Omeyyades Mu`awiya, puis Marwan ont été victimes102;
Cordoue échappe de justesse à la violence commise dans l’enceinte de la
grande-mosquée: au début de son règne, al- .Hakam Ier déjoue un complot
visant à l’assassiner un vendredi, dans la grande-mosquée103.
2.2.3. LA PAIX URBAINE ROMPUE: RÉVOLUTION ET RÉVOLTES
“Support et théâtre d’une vie publique intense […], le pavé fut à toutes les
époques le théâtre de défilés, de manifestations, d’affrontements, le départ de
révolutions104”: Cordoue n’échappe pas à la règle et les révoltes naissent dans
ses rues, pour se diriger contre le palais omeyyade, but de l’ire populaire. Entre
la Révolution de Cordoue, en 1009, et la disparition du califat, en 1031, le palais
est pris à quatre reprises, par des mouvements nés dans la rue: en février 1009,
la plèbe monte sur le toit du palais au moyen d’échelles; en septembre 1023,
les Cordouans s’emparent de l’Alcázar, après de rudes combats de rue contre
les Berbères; en janvier 1024, soutenu par la garde palatine, le peuple entre
dans le palais pour s’en prendre au calife; en novembre 1031, Umayya b. `Abd
al-Ra.hman réunit quelques hommes de la plèbe et de la garnison, avance avec
eux vers le palais, y pénètre puis en ordonne la mise à sac105.
251Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles
100. IBN `I -D-AR-I. La caída del califato, op. cit., p. 130. Sur ce macabre rituel, cf. FIERRO, M. “Violencia, política
y religión en al-Andalus durante el s. IV/X: el reinado de `Abd al-Ra.hman III”. FIERRO, M. (ed.) De muerte
violenta. Política, religión y violencia en al-Andalus. Madrid, C.S.I.C., 2004, pp. 37-101.
101. SOUFI, K. Los Banu Yahwar en Córdoba. 1031-1070. Córdoba, Real Academia de la Historia, 1968, pp.
183-196.
102. IBN ˇHALD-UN. Discours sur l’Histoire universelle. Al-Muqaddima. Trad. V. Monteil. Paris, Sindbad, 19973,
p. 419.
103. IBN AL-A-T-IR. Annales du Maghreb et de l’Espagne. Trad. É. Fagnan. Alger, 1898, Typographie Adolphe
Jourdan, pp. 165-166.
104. LEGUAY, J.-P. “La rue, lieu de sociabilité”, op. cit.
105. MAZZOLI-GUINTARD, C. “Quand, dans le premier tiers du XIe siècle, le peuple cordouan s'emparait de la
rue...”. Al-Qan.tara, XX, 1999-1, pp. 119-135; “Face aux émeutes urbaines, la citadelle d’al-Andalus omeyyade”.
Château et guerre, Actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire. Bordeaux, 2004, pp. 39-55.
En élargissant la thématique vers l’amont et l’aval, le même schéma se répète,
donnant à la rue la première place dans les mouvements urbains: la révolte de
mars 818 naît dans le faubourg de Secunda, sur la rive gauche du Guadalquivir,
que l’émir traverse sous les huées de la population. La foule se rue ensuite sur
le pont et fonce sur le palais, avant d’être prise à revers106. Bien plus tard, en
1121, la rue cordouane est encore et toujours le théâtre des révoltes: le 2 mars
1121, un membre de la milice almoravide tente de mettre la main sur une femme
qui appelle à l’aide; cet acte déclenche une importante émeute, opposant
Cordouans et miliciens. Les ulémas de la ville demandent au gouverneur que
justice soit faite; celui-ci refusant de prendre les mesures nécessaires, les
Cordouans marchent contre le palais où le gouverneur s’est réfugié, ils y entrent
et le mettent à sac. La révolte prend tant d’ampleur que l’émir lui-même doit
quitter Marrakech pour venir mettre le siège devant Cordoue107.
CONCLUSION
Dans la Cordoue des Xe-XIe siècles, les lieux de convivencia sont multiples,
depuis les afniya des mosquées de quartier, jusqu’à la grande-mosquée et le
marché, le point de rencontre essentiel demeurant le ra.s ıf au niveau de la
Porte de la Azuda. De l’examen de ces lieux, il émane souvent une convivencia
idéale, sous les traits d’une ville qui rassemble et permet de vivre ensemble de
manière harmonieuse, tandis que l’étude des formes du lien social laisse
mesurer l’écart entre l’imaginaire de la convivialité et les expériences
quotidiennes de celle-ci, où les rues sont des axes de circulation parfois
dangereux, où les places sont des lieux où gronde la révolte, où la majeure
252 La convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, pp. 229-253, ISBN 978-84-96637-40-5
106. L’analyse la plus complète des événements reste celle de LÉVI-PROVENÇAL, É. Histoire de l’Espagne
musulmane. I. La conquête et l’émirat hispano-umaiyade (710-912). Paris-Leiden, Maisonneuve & Cie-Brill, 1950,
pp. 160-173. La parution récente de la partie du Muqtabis relative à cette année 818 (IBN .HAYY-AN. Crónica de
los emires Al .hakam I y `Abdarra.hman II entre los años 796 y 847. [Almuqtabis II-1]. Trad. M. `Al ı Makkı y F.
Corriente. Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2001; La primera década del reinado
de Al- .Hakam I, según el Muqtabis II, 1 de Ben .Hayyan de Córdoba (m. 469 h./1076 J.C.). Ed. y trad. J. Vallvé y
F. Ruiz Girela. Madrid, Real Academia de la Historia, 2003) devrait permettre une nouvelle lecture de la révolte,
amorcée dans RUIZ GIRELA, F. “El acontecimiento que desencadenó la revuelta del Arrabal, según el Muqtabis
II de Ibn .Hayyan. Algunas puntualizaciones sobre el sentido del texto”. Anaquel, 16, 2005, pp. 219-225) ou
annoncée dans FIERRO, M. “Sobre el Muqtabis. Las hijas de al- .Hakam I y la revuelta del arrabal”. Al-Qan.tara,
XXIV, 2003, pp. 209-215.
107. BOSCH VILÁ, J. Historia de Marruecos: los almorávides. Tetuán, Editora Marroquí, 1956, pp. 196-199.
partie de la population féminine est exclue du vivre ensemble. A quel point
cette ville aux multiples lieux du vivre ensemble ne sépare-t-elle pas autant
qu’elle réunit? La convivencia ne pousse-t-elle pas, en fin de compte, à
interroger les modes de la ségrégation urbaine?
253Christine Mazzoli-Guintard - Lieux de convivialité et formes du lien social dans la Cordoue des Xe-XIe siècles


























![[Article] Soins et lien social : à propos du Patchwork des Noms](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314f5a83ed465f0570b5e93/article-soins-et-lien-social-a-propos-du-patchwork-des-noms.jpg)