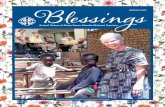R. NAIWELD, "Simon Claude Mimouni, Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe...
Transcript of R. NAIWELD, "Simon Claude Mimouni, Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe...
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.doi:�10.2143/REJ.173.1.3030672
BIBLIOGRAPHIE
Antoine GERMA, Benjamin LELLOUCH, Évelyne PATLAGEAN (dir.). — Les�Juifs�dans�l’histoire.� De� la� naissance� du� judaïsme� au� monde� contemporain, Seyssel, Champ Vallon, 2011, 928 pages («Les classiques Champ Vallon»).
Cet ouvrage collectif entend répondre à un desideratum flagrant et combler le vide concernant l’histoire juive dans les manuels d’enseignement. Il se propose aussi de substituer à des stéréotypes qui en tiennent lieu fréquemment, un ensemble de connaissances de haut niveau. Il ambitionne encore de montrer les juifs non plus comme des sujets passifs de l’histoire, mais comme des artisans de leur propre histoire et de l’histoire tout court. Ces principes sont exposés dans une introduction s’appuyant sur la Haskala, la Science du judaïsme, les grands travaux contemporains et notamment «le monument admirable mais peu maniable, et aujourd’hui vieilli de Salo Wittmayer Baron, A�Social�and�Religious�History�of�the�Jews devenu en fran-çais Histoire�d’Israël.�Vie�sociale�et�religieuse» (p. 12). Il s’ouvre sur une définition des termes désignant les juifs et une brève présentation des institutions antiques et modernes — pour les premières, dans les termes de la critique parlant de «religion yahviste».
Le départ chronologique de l’ouvrage se situe autour des Ve et VIe siècles avant l’ère commune, soit l’époque du Second Temple: «On ne s’est pas hasardé […] à retracer l’ethnogenèse des Juifs, tant la question nous paraissait pauvrement docu-mentée, méthodologiquement risquée, et idéologiquement piégée» (p. 16). Cependant en p. 19 un autre aspect s’impose: «En 1948, un État juif est fondé dans une partie de la Palestine; la totalité de celle-ci passe sous son contrôle en 1967». Quant aux auteurs, les Éd. déclarent: «Une partie d’entre eux seulement sont des habitués de l’histoire des Juifs, d’autres les avaient déjà rencontrés, d’autres enfin ont accepté d’aller à leur recherche, pour l’occasion». Ces déclarations d’intentions des respon-sables de l’entreprise précèdent trente-huit contributions (conclusion comprise), ventilées en six parties: les fondements, l’Antiquité, le Moyen Âge, la première modernité, à l’Âge des Nations (1815-1945), le monde actuel (de 1945 à nos jours).
La première partie s’ouvre sur «La naissance du judaïsme de l’exil à Alexandre» par André Lemaire (p. 21-35) qui présente de façon concise, solide, l’histoire reli-gieuse et politique des débuts de l’époque du Second Temple en faisant appel aux apports anciens et récents de l’archéologie, aux manuscrits mis au jour au XXe siècle, aux papyri samaritains, à une cartographie aussi claire que détaillée et qui attribue à Esdras la fixation officielle de la Torah. Suit «La Bible hébraïque; formation d’un corpus» par Devorah Dimant (p. 35-41). Après un paragraphe résumant les siècles séparant «le chant de Déborah vers 1000 av. J.-C.» de «la destruction de Jérusalem en 586 ou 587», elle suit la structuration du corpus biblique à l’époque du Second Temple en tenant compte des Apocryphes, des Septante, des manuscrits de la mer Morte, de la Massora, en admettant que «les premiers livres ont été composés au cours de la première moitié du premier millénaire av. J.-C. alors que les royaumes de Juda et d’Israël existaient encore: à savoir les source de la Torah, les prophètes, les psaumes et quelques livres sapientiaux». Elle traite avec bonheur de l’histoire matérielle du
97104.indb 19597104.indb 195 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
196 BIBLIOGRAPHIE
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
livre, du rouleau au codex, de la vocalisation massorétique, de l’imprimerie. Vient «L’élaboration de la Loi» par Francis Schmidt (p. 43-71), mettant dès l’abord en lumière la dialectique «Loi écrite et Loi orale» à partir des Abhot�de-R.�Nathan, pre-nant en compte le Mishneh�Torah de Maïmonide, suivant le développement de la Loi orale bien antérieurement à sa fixation par écrit, précisant la certification rabbinique, yoreh,�yoreh,�yadin,�yadin. Il s’attache à la «Discipline alimentaire», au sabbat, à la circoncision, à l’élection, traitant ces thèmes, dans leur évolution historique, à travers tannaïm, amoraïm, textes apocryphes, midrachim, liturgie synagogale, auteurs médié-vaux et contemporains jusqu’au Talmud de Steinsaltz, dans le souci constant de mettre en lumière tradition légale, tradition livresque, tradition affective, fidélité.
La deuxième partie, «l’Antiquité», offre un vaste tableau: «Les Juifs en Médi-terranée, de la mort d’Alexandre à la christianisation de l’Empire romain», due à la plume de notre regrettée collègue et amie Évelyne Patlagean (p. 75-105), sur trois périodes: «De la domination séleucide à la chute du Second Temple (323 av. J.-C.-70 apr. J.-C.)», «De la chute du Temple à l’Édit de Milan (70-313 apr. J.-C.)», «De l’Édit de Milan à la suppression du Patriarcat (313-425)». Elle mène de front les systèmes de vie et d’organisation des Juifs de l’État-temple et ceux de la diaspora et démêle avec justesse l’écheveau passablement complexe des guerres, des dynas-ties pontificales et hérodiennes, des implications intérieures et extérieures, des mou-vements messianiques et de leurs répressions, de Flavius Josèphe et de Philon d’Alexandrie, de la succession et de l’enseignement des Sages, des documents autres que purement religieux découverts dans la foulée des manuscrits dits de la mer Morte. Un développement dense et d’une richesse extrême sur la vie juive dans l’Empire au quotidien et à l’officiel, qui révèle la persistance de l’implantation juive en terre d’Israël à l’époque de la Mishna et du Talmud et ménage un accès neuf vers le judaïsme méconnu de Byzance. Une pointe de candeur pourtant: «Ces monuments textuels, le Talmud de Babylone essentiellement, sont devenus à leur tour objets d’interprétations. Étudiés de siècle en siècle dès le jeune âge, et particulièrement dans le monde ashkénaze [!], ils ont joué un rôle incommensurable dans la longue durée de l’identité juive» (p. 98).
Monique Alexandre présente «Judaïsme et culture grecque un siècle av. J.-C.-Ier apr. J.-C.» (p. 107-131). Après avoir énuméré les termes grecs très tôt entrés dans l’usage parmi les juifs de la Diaspora, elle s’attache à la Septante dont le corpus «dépassera de beaucoup les limites du canon hébraïque précisées à Yabné vers 90 après J.-C.» (p. 109), «aux sources de la littérature judéo-hellénistique» dont seuls des fragments nous sont parvenus à l’exception de la lettre d’Aristée, du roman de Joseph et Aseneth, des oracles sibyllins, de Josèphe et de Philon. Mis en pers-pective, ces fragments révèlent de grandes œuvres, des sujets ambitieux d’histoire nationale, artistique, technique, religieuse, de la fine poésie juive en grec et le théâtre avec l’Exode d’Ézéchiel le Tragique». Les excellentes synthèses sur Josèphe et Philon envisagent ces œuvres immenses comme des encyclopédies d’une richesse confondante encore que mues par une «volonté de défense et d’illustration» (p. 131). Un encart clôt cette deuxième partie: «Un royaume islamisé: le Yémen préisla-mique» par Alfred-Louis de Prémare (p. 133-134). Il s’agit en substance «d’un roi himyarite juif», Yüsuf As’ar Yath’ar, «roi de toutes les tribus», celui que les sources littéraires arabes tardives nommèrent Dhû Nuwâs.
La troisième partie, «Le Moyen Âge», débute avec «Le premier Islam et les Juifs d’Arabie» par A.-L. de Prémare (p. 137-147): les juifs du Hedjaz aux origines mal
97104.indb 19697104.indb 196 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
BIBLIOGRAPHIE 197
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
connues apparaissent en creux dans les textes coraniques d’une part, sous un jour négatif, d’autre part, dans des sources narratives islamiques tardives. La charte de Yathrib attribuée au Prophète déclare: «Ceux de Yahud qui nous suivent bénéficient du même soutien (que les autres): on ne les lèse point et on ne se ligue point contre eux». Par paliers successifs, avec des pactes respectés un temps puis violés, les diverses tribus juives des oasis du Nord furent défaites par Mahomet puis par ses successeurs. D’abord privées de leurs terres, elles furent expulsées de l’ensemble de la péninsule vers la Syrie. Youval Rotman traite «Les juifs dans l’Islam médiéval» (p. 149-175). Les «lendemains de la conquête» d’abord avec le double aspect: le statut du dhimmi protégé et assujetti d’une part, la reconnaissance des autorités juives autonomes autour de l’exilarque d’autre part. «Les Abbasides: l’Islam comme empire» étudie la structuration de la vie économique, les académies, Saadia Gaon, les responsa, le problème de l’autorité ou des autorités, les karaïtes, «La Genizah du Vieux-Caire: une documentation sans pareille sur les réseaux communautaires», utilisant à bon escient les travaux de Jacob Mann et surtout de notre maître Shlomo Dov Goitein, faisant apparaître les personnalités phares de Hasday Ibn Shaprut, Samuel Ibn Neghrila, l’Espagne musulmane, Maïmonide, les Almoravides, les Almohades et Benjamin de Tudèle. Suivent un deuxième et un troisième encart, «Présence juive dans l’Asie pré-mongole» par Étienne de La Vaissière (p. 177-182), les réseaux marchands et les centres de Boukhara, de Samarcande et autres étapes vers l’Extrême-Orient révélés brièvement mais sûrement, et «Un État mongol judaïsé: les Khazars», par É. Patlagean (p. 183-184). Là encore, la Genizah du Caire a conféré une historicité tangible aux lettres hébraïques classiques sur la conversion au judaïsme du Khagan, le roi des Khazars1. É. Patlagean consacre un chapitre aux «Juifs à Byzance (527-1453)» (p. 185-193), une histoire négligée dont elle montre la richesse à travers les sources grecques et hébraïques, la législation des empereurs byzantins, l’apport démographique et religieux des Karaïtes, les communautés ita-liennes de la mouvance byzantine Otrante, Bari, Tarente, Venosa, Siponto et leur littérature originale comme les écrits d’Ahima’az et le Yosippon.
Giacomo Todeschini présente «Les communautés juives en Occident au Moyen Âge» (p. 195-220), dans un «Occident en cours de christianisation» où les juifs constituent des sujets juridiques et territoriaux visibles trouvant leur place dans l’entrelacs des nouveaux pouvoirs chrétiens tant dans les pays du Nord que ceux du Midi». Il suit encore en l’éclairant l’itinéraire de Benjamin de Tudèle et présente avec netteté les responsa, les commentaires, les� tossafot et leurs écoles. À cette première synthèse, le même auteur joint une deuxième intitulée «Les Juifs, les pou-voirs chrétiens et l’Église en Occident pendant le Moyen Âge» (p. 221-239). Il examine les grands textes ecclésiastiques et pontificaux sur les juifs à partir d’Au-gustin, s’inspire des travaux de Bernhard Blumenkranz et de Gilbert Dahan et cite des textes juifs sur le pouvoir chrétien. Il oppose textes hostiles aux juifs et vie quotidienne somme toute conviviale et dégage des responsa de Me’ir de Rothenburg un système de pouvoirs communautaires à recomposer sans cesse.
1. À cet égard, il faudra prendre en compte la démonstration péremptoire du regretté Mosheh Gil, «Did the Khazars convert to Judaism?» et sa conclusion: «It never happened» dans la Revue, t. 170, 2011, p. 429-441. (La thèse contraire a toutefois été soutenue la même année par C. ZUCKERMAN, «On the Kievan Letter from the Genizah of Cairo», Ruthenica 10, 2011, p. 7-56 — N.d.l.R.)
97104.indb 19797104.indb 197 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
198 BIBLIOGRAPHIE
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
La quatrième partie, «La première modernité (XVe siècle-1815)», s’ouvre sur «L’expulsion des Juifs d’Espagne», par Bernard Vincent (p. 243-255) qui narre l’enchaînement des causes et des motivations de l’édit de 1492, tout en revenant sur les expulsions perpétrées antérieurement dans d’autres États, domaines ou cités de l’Europe. Il discute les chiffres avancés pour retenir — en suivant Jaime Contreras — une population juive inférieure à cent mille âmes. Il admet la motivation religieuse de la décision royale. Exploitant les travaux récents sur ce point, il décrit les condi-tions tragiques des départs et crédite l’expulsion de la naissance des monuments historiques de Joseph ha-Kohen, Élie Capsali, Abraham Torrutiel, Salomon Ibn Verga. Manque cependant à l’appel l’histoire par excellence, la première histoire juive écrite en langue vernaculaire — à savoir en portugais — depuis Flavius Josèphe, la Consolaçam�as�tribulaçoens�de�Israel�de Samuel Usque.
Benjamin Lellouch aborde «Les Juifs dans le monde musulman du XVe au milieu du XIXe siècle» (p. 257-286). Révisionniste, l’auteur fait justice du mythe de l’accueil bienveillant en terre d’Islam, Turquie comprise, des exilés de l’Espagne, comme du mythe de la tolérance: «la dhimma est censée régir les rapports entre musulmans et non-musulmans dans un cadre légal et permanent» (note p. 258). Défilent les communautés et leurs relations à travers les responsa, les marchands, les élites du pouvoir et les lettrés, les titulaires de fonctions financières ou administratives: un ensemble géographique d’une immensité jamais atteinte en mouvement et en contacts jusqu’en Pologne et en Crimée. Il met en lumière la Terre sainte du XVIe siècle, son apport capital, la Kabbale et le mouvement sabbataïste selon la vulgate de Scholem mise en question par Moshe Idel. Il consacre des développements spécifiques à la Méditerranée Orientale, au Yémen, au Maghreb, à l’Iran. Natalia Muchnik examine «Les pouvoirs et les Juifs en Europe Occidentale (XVIe-XVIIIe siècles)». Amsterdam avec ses institutions et sa confrérie de dotation des orphelines pauvres justifierait le sous-titre «un monde dominé par les Séfarades» (p. 289). À partir de contre-exemples en France, en Italie, en Angleterre, elle conteste à son tour (encore en note) la réalité d’une tolérance et souligne les mesures restrictives, voire liquidatrices, comme l’autodafé de Toulouse en 1685 et d’une manière générale l’ambiguïté des pouvoirs. Elle décrit les communautés structurées à l’extrême sous la férule d’un ma‘amad autoritaire, communautés de mieux en mieux connues grâce à l’exploitation de leurs riches archives. Un développement innovant s’attache au sort de la femme juive marginalisée (?), recluse, instrumentalisée par la dotation des orphelines, avec les exceptions notables de femmes fortes comme Glückel von Hameln, la Señora (Gracia Nasi), Deborah Ascarelli, poétesse liturgique à Rome. Un nouvel encart «Les Juifs et la Renaissance italienne» par Alessandro Guetta (p. 317-326) s’attaque à une problématique ardue et — abstraction faite du concept de Renaissance dans la culture chrétienne —, il recense les changements survenus dans la culture juive comme le théâtre de Leone de Sommi à Mantoue, l’éloquence hébraïque, la fonction de catalyseur culturel remplie par l’imprimerie, la réappropriation des sciences, la philologie, la critique historique d’Azariah de Rossi. Marie-Élisabeth Ducreux étudie avec brio «Les Juifs dans les sociétés d’Europe centrale du XVIe au XVIIIe siècle» (p. 327-379), sur les plans institutionnel, social et culturel, en général et en particu-larisant la description selon les contrées, Pologne, Bohême et Moravie, Autriche, Hongrie et Transylvanie, Bucovine, Silésie, faisant appel aux travaux de Daniel Tollet qui font désormais autorité en ce domaine, présentant brièvement in�fine les «Réformes de l’absolutisme éclairé et le début de l’Émancipation». Roland
97104.indb 19897104.indb 198 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
BIBLIOGRAPHIE 199
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
Goetschel traite «Le monde ashkénaze aux XVIe-XVIIIe siècles: une histoire reli-gieuse (p. 371-379)». Insistant sur la centralité culturelle de la Pologne, il accorde au hassidisme un développement d’une extrême précision, tant sur les institutions, les personnalités et les œuvres que la dynamique géographique et définit les enjeux du conflit opposant hassidim et mitnagdim. Évelyne Oliel-Grausz aborde, d’une manière résolument critique à l’encontre de bien des idées reçues, «L’émancipation des juifs de France» (p. 381-403), la replaçant dans la perspective générale de l’ex-tinction de l’Ancien Régime, tout en préservant sa spécificité et son unicité dans l’histoire juive. Prenant en compte les disparités régionales de départ, elle remonte aux Lumières allemandes et françaises et présente les personnages et les corps impli-qués dans cette conquête de droits, insistant sur l’action politique des juifs eux-mêmes et soulignant que l’émancipation signifie la fin de la kehillah. En fonction des travaux récents et des débats encore ouverts, elle conduit son propos jusqu’à l’Empire et à l’organisation napoléonienne du judaïsme français, suite du processus entamé sous la Révolution, pour en tirer un bilan contrasté mettant en valeur la précocité et la vélocité du mouvement français d’accès à la modernité.
La cinquième partie, «À l’âge des nations (1815-1945)», s’ouvre sur un tableau synthétique dressé par É. Oliel-Grausz, «Les juifs d’Europe occidentale au XIXe siècle» (p. 407-447). Avec une netteté prodigieuse, sans perdre de vue les disparités spa-tiales et temporelles des statuts des juifs, elle construit des modèles — France, Angleterre, Italie, Allemagne — et définit des lignes de force d’ensemble centrées sur le concept d’intégration, de sécularisation, d’acculturation, faisant intervenir l’école, la presse, la pratique religieuse, les conversions, alliant avec bonheur pul-sations sociales et biographies individuelles. Cette méthode s’applique avec vigueur au niveau de la Réforme des congrès rabbiniques, aux changements liturgiques, jusque dans des synagogues d’un quartier déterminé de Berlin, une histoire globale et in�situ. Cécile Trautmann-Waller, «Les juifs dans le monde germanique du début du XIXe siècle jusqu’à 1933: de l’émancipation difficile aux débuts du nazisme» (p. 449-469), se défend d’une réduction à la «symbiose» et à l’extermination, repre-nant pourtant la formule de Jacob Katz sur le passage longtemps entravé «d’une communauté d’exclus vivant aux marges de la société, à une minorité reconnaissable mais vivant au sein de la société». Elle traite d’une part la période précédant 1871 durant laquelle les juifs obtiennent enfin des droits pleins et entiers, tout en gravis-sant l’échelle sociale et culturelle, d’autre part l’Empire jusqu’à la Première Guerre mondiale, enfin l’après-guerre et la République de Weimar, s’attachant aux organi-sations et aux publications juives, remarquant une diminution sensible de la popula-tion juive qui passe de 600.000 personnes en 1875 à 500.000 en 1933, reprenant sa prétention d’incarner «une forme exemplaire de modernité juive». Paul Zawadzki, «Les juifs de Pologne du partage de la Pologne jusqu’en 1939» (p. 471-498), replace les communautés juives et leur poids démographique, institutionnel, linguis-tique, religieux dans un pays en construction. Il montre l’impact sur la Pologne tellement différente des débats sur l’émancipation en Europe occidentale et le mythe obsédant d’un État dans l’État. Encore que d’une extrême richesse culturelle et politique — pensons au Bund et aux multiples partis juifs —, cette population survit dans une Pologne qui entend l’éradiquer. Claude Weill, «les juifs de Russie (1722-1953)» (p. 499-517), brosse à grands traits deux siècles durant lesquels le pouvoir s’évertue à «résoudre la question juive». Dans cette perspective, mesures restrictives de toutes sortes, déplacements forcés, pogroms, émigration entravent mal l’ascension
97104.indb 19997104.indb 199 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
200 BIBLIOGRAPHIE
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
d’une bourgeoisie juive et entraînent la constitution de forces politiques juives, partis ouvriers, sionistes. Le communisme, sous couvert de progressisme, liquide institutions et culture juives. Catherine Collomp, «Les juifs aux États-Unis du XVIIIe siècle à 1945» (p. 519-539), présente brièvement le mince contingent juif de l’Amérique coloniale, terre bénie pour les juifs, et passe à la période 1820-1880 où des immigrants, allemands pour la plupart, implantent un judaïsme d’un type nouveau, influencé par la Réforme, d’un poids démographique, communautaire, philanthropique croissant, lié certes à celui de l’Europe mais bien peu efficace pour l’accueillir et le secourir. Frédéric Abécassis et Jean-François Fau, «Les juifs dans le monde musulman à l’âge des nations (1840-1945)» (p. 541-565), dressent un tableau concis du statut personnel de juifs en quête de protection consulaire euro-péenne, bénéficiant des avancées du monde méditerranéen, évoluant mais sans y parvenir vers une intégration dans les nouvelles nations musulmanes, de leur progrès économique, social et culturel dû à l’Alliance Israélite Universelle. Alain Dieckoff, «Le sionisme et la Palestine jusqu’en 1948» (p. 567-590), expose l’option sioniste de Herzl, que précèdent Alkalai, Kalischer et Pinsker, ainsi que les pre-mières vagues d’immigration et d’implantation, l’organisation pré-étatique de 1920 à 1948, avec les problèmes liés au nationalisme arabe, le tout dans une optique pour le moins discutable. Tal Bruttmann, «Dans l’ombre de la mort» (p. 591-619), traite de la destruction nazie des juifs d’Europe, mettant sous une lumière crue les exé-cutions massives opérées dès l’invasion allemande en U.R.S.S. en 1941, les camps d’extermination suivront. La résistance des juifs s’incarne dans des soulèvements, dans leur participation militaire dans les armées des alliés, dans le sauvetage de personnes et de documents. Parmi les séquelles multiples de la Shoah, s’impose le déficit démographique: la population juive actuelle est inférieure en nombre à celle de 1940.
La sixième partie, «Le monde actuel (1945 à nos jours)», s’ouvre avec Régine Azria sur «Les juifs dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale» (p. 623-629): les changements démographiques et géographiques, l’urbanisation, un tableau par ensembles géographiques de la population évaluée à 13.428.300 dont 45% en Amérique et 42,5% en Israël. A. Dieckoff, «Israël dans son environnement régional et international» (p. 633-663), narre, cartes à l’appui, «nouveaux historiens» invo-qués, avec déclarations à l’emporte-pièce, la création et la guerre d’indépendance d’Israël et «les guerres à répétition». Ce long chapitre fournit une information aussi abondante que biaisée et hostile à lsraël. A. Dieckoff encore, «Institutions et vie politique en Israël» (p. 665-680), offre dans la même veine une description parfois juste — notamment des partis politiques — mais truffée d’incises déplacées, par exemple «des décisions attentatoires aux libertés des Palestiniens» (p. 670). Le même, «Israël: une identité nationale plurielle» (p. 681-705), s’attaque — le terme convient — aux disparités bien connues d’Israël visant soit à intégrer des identités différentes, soit à reconnaître ces mêmes identités dans des partis politiques, dont le Shas,�parti religieux sépharade. La section «Israël comme État juif» pose les problèmes du rapport entre laïques et religieux et surtout insiste sur le tort causé aux Arabes: «L’État les a considérés d’abord et avant tout, non pas comme des citoyens israéliens dont il fallait respecter les droits, mais comme des Arabes palestiniens, membres d’un groupe ethno-national qu’il convenait de transformer en minorité dominée» (p. 701). Le chapitre conclut qu’Israël «est aussi, désor-mais, un foyer d’émigration autour duquel apparaît progressivement une diaspora
97104.indb 20097104.indb 200 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
BIBLIOGRAPHIE 201
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
israélienne». R. Azria, «Les juifs en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale» (p. 707-725), présente, sur un plan sociologique et au regard des mentalités, les attitudes des juifs et des communautés vis-à-vis d’eux-mêmes, de l’antisémitisme, d’Israël, du génocide. Sara Fainberg, «De la déstalinisation à la “Grande Migra-tion”, les juifs, une communauté de destins (1953-2005)» (p. 727-760), examine, à la perfection dans l’information et la compréhension des mentalités, la statique et la dynamique des juifs russes en tant que minorité exposée à la déculturation et àla discrimination, dans les stratégies de résistance culturelle des juifs du silence et les vagues d’émigration. Les transformations d’une extrême rapidité survenues après la chute de l’U.R.S.S. rendent malaisé le dessin d’un modèle: «une communauté symbolique» (p. 759). Jean-Charles Szurek, «Les Juifs en Europe de l’Est» (p. 761-780), distingue cinq périodes: 1945-1948, 1948-1956, 1956-1968, 1968-1989, après 1989, les trois premières coupures découlant des trois premières guerres d’Israël. Dans la dernière période, s’amorcent un renouveau du judaïsme, un changement positif dans l’attitude des pouvoirs vis-à-vis des juifs, mais «le centre est-européen demeure vidé de ses juifs». Daniel Sabbagh, «Les ambivalences de l’intégration: les juifs aux États-Unis depuis 1945» (p. 781-808), dépeint l’intégration dans tous les secteurs de la vie politique économique, sociale, culturelle des États-Unis, du cinéma à la littérature et même dans le domaine religieux où les communautés juives ont leur place parmi les dénominations religieuses multiples. La hantise de l’extinc-tion (et aussi d’un certain antisémitisme noir) pousse à un activisme organisationnel croissant. Frédéric Abécassis et Jean-François Fau brossent «Le monde musulman: effacement des communautés juives et nouvelles diasporas (1945-2006)» (p. 809-834). Faute de pouvoir nier la disparition des juifs des pays d’Islam, les auteurs mettent des guillemets au «million oublié» des juifs ayant quitté les pays arabes mais point au «droit au retour des quatre millions de Palestiniens vivant en dias-pora» et font un procès d’intention à Shmuel Trigano. Ils exposent cependant les circonstances dramatiques pour les juifs au Yémen, en Égypte, en Libye, en Iraq et la liquidation en 1967. In�fine l’affirmation abrupte «qu’Israël demeure par sa situation géographique une enclave au sein du Dâr al-Islam» surprendra le lecteur non averti.
Dans sa conclusion, R. Azria (p. 837- 842) redit l’ambition du volume, «combler les lacunes des manuels d’histoire proposés dans les collèges et lycées», et défend les stratégies de survie des juifs à travers l’histoire.
Au terme de cette recension, disons que l’information fournie paraît répondre à l’attente d’un vaste public d’enseignants, encore que plusieurs développements reprennent des faits et des discours déjà exposés dans des chapitres antérieurs au détriment de pans entiers d’histoire et de civilisation passés pratiquement sous silence. Signalons à cet égard l’absence des quatre siècles de présence et de culture juive dans l’Espagne chrétienne. Remarquons que — mis à part un paragraphe excellent sur l’Italie dû à Alessandro Guetta — rien n’est dit de l’imprimerie hébraïque et deson rôle majeur dans l’unité du judaïsme (quelque 32.000 titres avant 1863 dans Yeshayahu Vinograd,�Thesaurus�of� the�Hebrew�Book,�Listing�of�Books�Printed� in�Hebrew�Letters�since�the�Beginning�of�Hebrew�printing�circa�1469�through�1863, Jérusalem, The Institute for Computerized Bibliography). Le Portugal que nombre de travaux récents ont largement étudié n’apparaît pas, non plus que l’Inquisition. La bibliographie ignore les grands ouvrages d’Isaac Baer, Haïm Beinart, Jacob Rader Marcus et bien d’autres aussi fondamentaux. Ces lacunes échapperont, il est
97104.indb 20197104.indb 201 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
202 BIBLIOGRAPHIE
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
vrai, aux non-spécialistes qui feront leur miel de développements d’un grand intérêt présentés par ailleurs.
En revanche, l’impasse revendiquée du premier millénaire de l’histoire d’Israël sur sa terre, rejeté dans les limbes, tronque délibérément l’histoire autant que la mémoire du peuple juif, contribuant ainsi à une délégitimisation d’Israël à laquelle bien des enseignants s’emploient activement, en rien gênés par leur ignorance en ce domaine. L’introduction déclare: «En 1948, un État juif est fondé dans une partie de la Palestine; la totalité de celle-ci passe sous son contrôle en 1967» et parle de «l’occupation du reliquat arabe de la Palestine mandataire» (p. 644), feignant d’ou-blier que la Palestine mandataire de la conférence de San Remo (19-26 avril 1920) incluait les deux rives du Jourdain soit 119.306 km2, territoire qu’au mépris de son mandat, la Grande-Bretagne amputa en 1922 pour créer l’émirat de Transjordanie. Il n’en sera pas question dans les chapitres relatifs au sionisme et à Israël (p. 582 et 641). Le lecteur visé — en l’occurrence le corps enseignant de notre pays — ignorera qu’Israël (20.770 km2) s’étend sur 17,40% de l’ensemble tandis que les territoires arabes palestinien et jordanien totalisent respectivement 6.236 km2 et 92.300 km2, soit 98.536 km2 équivalant à 82,5% du territoire primitivement ouvert au Foyer national pour le peuple juif.
La lecture de ces chapitres interpelle le lecteur — même et surtout s’ils s’inspirent des «nouveaux historiens» — ainsi «la capture des villes de Lod et de Ramleh qui s’accompagnera de l’expulsion manu�militari de 100.000 Palestiniens» (p. 639), la «logique coloniale», «le choix de la répression du gouvernement israélien» (p. 647) et la «poursuite implacable de la colonisation juive» (p. 654). Le traitement des chiffres pourrait surprendre: p. 655 il est question d’un exode de 750.000 Arabes en 1948 et sur la même page de 3.600.000 réfugiés [!]. Sans surprise on lira que «la visite du leader du Likoud Ariel Sharon sur l’Esplanade des Mosquées / mont du Temple entraîne à Jérusalem des manifestations de protestation palestiniennes violemment réprimées, qui gagnent progressivement la Cisjordanie» (p. 634).
Aucune note ne figure au bas des pages. Sommaire, la bibliographie ventilée par chapitres a retenu de préférence des travaux hostiles à Israël (p. 867-886). Le volume comprend de nombreuses cartes, une chronologie débutant en 597 av. J.-C., un index des lieux, un index des personnes (p. 887-911), des notices sur les auteurs (p. 913-918). Le spécialiste discernera des lacunes criantes comme les expulsions de Philippe Auguste en 1182 et de Philippe le Bel en 1306, la Bible espagnole de Ferrare en 1553, la carrière et l’œuvre de Menasseh ben Israël, la partition de la Transjordanie en 1921, le statut des juifs de Vichy du 3 octobre 1940, la paix conclue entre Israël et la Jordanie par les accords de Wadi Araba du 26 août 1994.
Les contributions de spécialistes reconnus des études juives remplissent ici une fonction de faire-valoir au sein d’une entreprise d’une redoutable efficacité, une machine de guerre sophistiquée sinon contre le judaïsme, en tout cas contre l’État d’Israël. Cette artillerie lourde vise l’ablation des racines et la délégitimisation d’Israël. Disons pour conclure, en ayant bien soin de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, que les portions de l’ouvrage portant la signature d’excellents historiens du judaïsme pourront être retenues et discutées, les autres devant être scrutées à la loupe. Par sa conception même, l’ouvrage — en dépit de son poids — ne répond dans�son�ensemble ni aux exigences scientifiques ni à l’office pédagogique auquel il prétend.
Gérard NAHON
97104.indb 20297104.indb 202 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
BIBLIOGRAPHIE 203
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
Simon Claude MIMOUNI. — Le� judaïsme�ancien� du� VIe� siècle� avant� notre� ère� au�IIIe�siècle�de�notre�ère.�Des�prêtres�aux�rabbins, Paris, Presses Universitaires de France, 2012, 960 pages.
Cet ouvrage offre aux lecteurs une synthèse tout à fait remarquable sur l’histoire du judaïsme ancien ainsi qu’une présentation des problèmes méthodologiques et épistémologiques qu’implique l’étude des divers domaines qui composent cette dis-cipline. Comme l’indique l’auteur dans l’avant-propos, il a pour objectif de rempla-cer la première partie du volume publié en 1968 sous la direction de Marcel Simon et André Benoît, Le�judaïsme�et�le�christianisme�antique:�d’Antiochus�Épiphane�à�Constantin. Or le livre présent est presque trois fois plus volumineux que l’ensemble de l’ouvrage de Simon et Benoît et ce, bien qu’il n’en couvre que la première partie. Cette publication de presque mille pages entièrement consacrée au judaïsme ancien constitue donc un événement dans la recherche française sur le monde antique de manière générale et dans celle des études juives en particulier. Elle fournit non seulement une vue d’ensemble riche et exhaustive de l’histoire des juifs (ou Judéens) de l’époque antique mais, grâce à sa rigueur scientifique et à ses comparaisons toujours pertinentes et jamais forcées, il permet d’attribuer à l’étude du judaïsme ancien la place d’une discipline à part entière. Ce livre est également utile pour les chercheurs et les étudiants d’autres disciplines touchant de près ou de loin au judaïsme antique.
Écrire une histoire du judaïsme ancien aujourd’hui est une tâche d’autant plus ardue et complexe que depuis plusieurs décennies il existe une tendance de plus en plus poussée à le «morceler» à tel point qu’aujourd’hui, il est courant d’évoquer les «judaïsmes» de l’époque antique, voire la «déjudaïsation» et la «rejudaïsation» des populations judéennes palestiniennes, qui quittèrent le judaïsme puis s’y rattachèrent tout en lui imposant de nouvelles formes et de nouvelles idées. Ce morcellement s’opère sur les plans doctrinal et pratique (certaines thèses affirmant que la halakhah rabbinique n’était pas acceptée par d’autres courants juifs); géographique (le judaïsme palestinien diffère de celui d’Égypte ou d’Italie, par exemple); et évidem-ment chronologique (la mise en relief des différences entre les judaïsmes de chaque période). La majorité des recherches de ces dernières années va dans le sens de l’éclatement de ce qui, jusqu’il y a trente ans, était perçu comme une seule religion âgée de trois millénaires. Ce morcèlement du phénomène juif antique est dans l’air du temps et ce livre est le premier ouvrage français qui défend cette approche — déjà très répandue dans le monde anglo-saxon — de manière systématique.
Un chapitre introductif intitulé «Ouverture sur le judaïsme sacerdotal» débute par l’affirmation suivante: «L’histoire du judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère dont il va être question dans cet ouvrage est celle des prêtres». Tout en étant conscient du fait qu’il s’agit d’une manière «audacieuse et paradoxale de résumer ainsi toute la période envisagée», l’auteur défend son choix en insistant sur le fait que pendant presque toute cette période ce sont les prêtres qui «tiennent un rôle non négligeable dans l’existence politique et religieuse des Judéens de Palestine comme de Diaspora». Ce choix reflète cependant un parti-pris de l’au-teur — l’histoire dont il s’agit dans ce livre est le plus souvent une histoire «d’en haut», l’histoire des dominants. Ce choix, comme nous allons voir, a des consé-quences sur au moins une des thèses historiques développées par l’auteur.
97104.indb 20397104.indb 203 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
204 BIBLIOGRAPHIE
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
Ce chapitre introduit un des arguments clés de l’ouvrage, que l’organisation cultuelle et politique du peuple judéen est similaire à quelques différences près à celle d’autres peuples de l’Antiquité. En effet, un des points forts de ce livre est la mise en contexte historique de son objet (le judaïsme ancien) sans exagérer les particularités du cas juif. Bien que l’histoire judéenne ait connu une postérité incom-parable à celle des peuples voisins, dans le présent de ces événements cette postérité était dans le meilleur des cas un possible. En d’autres termes, l’auteur se livre, avec succès, à l’un des exercices les plus délicats de l’écriture historique — il nous invite à lire l’histoire du judaïsme ancien comme si nous n’en connaissions pas la fin.
La première partie qui suit ce chapitre introductif est consacrée aux prolégo-mènes. Sont abordées des questions de terminologie, de sources et de méthodologie. Dans le chapitre consacré à la terminologie, l’auteur justifie notamment, de manière fort convaincante, son choix d’employer le terme «Judéen» au lieu de «juif» dans le contexte historique de ce livre. En cela, il adhère à ce qui est en train de devenir un consensus, plus parmi les chercheurs anglo-saxons qu’européens. Contrairement au terme «juif», le terme «Judéen» a l’avantage de ne pas renvoyer aux conceptions religieuses, doctrinales et identitaires médiévales ou modernes mais de désigner plutôt les habitants originaires de la région de Judée, appartenant de ce fait à une «ethnie» au sens ancien du terme (à ne pas confondre avec le sens moderne «racial»). Comme le terme «juif», cependant, «Judéen» renvoie «à des dimensions ethnico-religieuse et ethnico-géographique» (p. 24). Les autres termes discutés dans ce chapitre sont judaïsme et hellénisme, Judée, Palestine, Diaspora, Israël et hébreu. Le chapitre se clôt par un excursus sur la question de savoir «comment les Judéens se désignent d’un point de vue collectif» dans les écrits hébraïques et grecs. Dans ce chapitre comme dans l’ensemble du livre, l’auteur présente un état des lieux relativement exhaustif, comprenant les travaux clés (articles et monographies) ainsi que les débats qui encadrent le champ de la recherche.
Le deuxième chapitre de cette première partie est dédié à la documentation. D’abord sont discutées les sources littéraires religieuses et profanes, les sources juridiques et les sources archéologiques, épigraphiques, papyrologiques et numis-matiques. Viennent ensuite quatre chapitres dont chacun traite un à un des quatre corpus suivants: Bible et Targoum, Philon d’Alexandrie, Flavius Josèphe et la litté-rature rabbinique classique (Mishnah, Tosephta et Midrashim).
La deuxième partie, «Introductions», est composée de trois chapitres — chacun consacré à un contexte historico-politique différent de l’histoire des Judéens dans l’antiquité: le monde achéménide, le monde hellénistique et l’empire romain. Ces introductions, également fort documentées, sont indispensables à la compréhension des chapitres suivants qui élaborent la démarche principale du livre, la mise en contexte historique de l’histoire judéenne dans l’antiquité.
Suit la troisième et la plus longue partie, «Le judaïsme en Palestine». Les périodes et les épisodes qui composent l’histoire du judaïsme palestinien depuis le retour de l’exil babylonien jusqu’à la période qui suit la deuxième révolte des Judéens pales-tiniens contre les Romains y sont passés en revue. La discussion de chaque période est précédée par quelques pages d’introduction suivies d’une discussion sur les sources — littéraires, archéologiques, numismatiques et autres. Le premier chapitre, «Fondamentaux du judaïsme en Palestine», met en lumière les thématiques d’ordre spirituel et religieux présentes dans le paysage palestinien de la période en question, notamment l’eschatologie et le messianisme dans leur rapport au prophétisme.
97104.indb 20497104.indb 204 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
BIBLIOGRAPHIE 205
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
Quelques pages précieuses sont également consacrées aux problèmes épistémolo-giques et méthodologiques qui doivent être pris en compte par chaque chercheur abordant la question des mouvements religieux judéens en Palestine antique. L’au-teur souligne la problématique de la partition inégale de la documentation — aussi bien sur le plan chronologique que sur celui de l’appartenance des textes. La ques-tion de la terminologie est aussi abordée puisque chaque terme, comme le min hébraïque ou le haïrésis grec, a sa propre histoire dont le chercheur moderne doit prendre conscience pour ne pas les employer de manière irréfléchie.
Les autres chapitres de cette troisième partie sont consacrés aux épisodes sui-vants: l’époque iranienne (du retour de l’exil babylonien jusqu’à la conquête d’Alexandre), l’époque hellénistique, l’insurrection des Maccabées, l’époque des Hasmonéens, les Hérodiens, la domination romaine (jusqu’à 66), la première révolte contre Rome, la domination romaine (74-132), la deuxième révolte et l’époque qui suit cette dernière. Un dernier chapitre est dédié à la question des Samaritains.
La dernière partie concerne le judaïsme en diaspora. Elle s’ouvre par une riche introduction concernant la question de la diaspora juive. Notons les pages précieuses où l’auteur discute la question de la judéophobie et celle de deux termes que l’on retrouve souvent dans les écrits grecs faisant référence aux Judéens — la misanthro-pie et la philanthropie. Ici l’auteur emploie les résultats de l’étude de Katell Berthelot sur le sujet. Ce chapitre introductif donne ainsi une image relativement complète du statut des Judéens dans la diaspora, aussi bien sur le plan légal qu’idéologique. Dans les chapitres suivants sont traitées la diaspora égyptienne et celle de Cyrénaïque; la diaspora syrienne, l’italienne et celles d’Afrique et de Gaule; la diaspora anatolienne et celles de Grèce et du Bosphore, enfin la diaspora babylonienne. Les deux derniers chapitres sont respectivement consacrés à la révolte des Judéens de la diaspora de 115-117 et à la question des thérapeutes, ce groupe mystérieux décrit dans le traité philonien De�vita� contemplativa, qui a suscité une longue série d’études arrivant souvent à des conclusions contradictoires. Comme dans le reste des chapitres,l’auteur retrace ici les points principaux du débat scientifique sur cette question complexe.
En règle générale cet ouvrage ne cherche pas à établir des thèses mais plutôt à résumer de manière impartiale les débats contemporains sur l’histoire du judaïsme ancien. Néanmoins, dans au moins un cas, l’auteur défend une thèse toujours très peu présente dans la recherche francophone — celle de l’existence d’un troisième courant du judaïsme d’après la destruction du Temple en 70, à côté du judaïsme rabbinique et du christianisme — le judaïsme dit «synagogal» (p. 553-567). Selon l’auteur, «il s’agit de la troisième composante du peuple judéen qui n’a appartenu à aucune des deux entités précédentes [mouvement chrétien et judaïsme rabbi-nique]». L’auteur se situe donc dans un courant de la recherche qui vit le jour avec les travaux d’Erwin Goodenough qui, dans son travail sur les symboles juifs, au milieu du siècle dernier, avait avancé la thèse d’un judaïsme des premiers siècles de notre ère n’obéissant pas aux normes halakhiques des rabbins. Il s’agissait pour lui d’un judaïsme hellénistique de tendance mystique beaucoup plus présent à la syna-gogue antique que le judaïsme rabbinique. La thèse de Goodenough a mis quelques décennies à s’installer mais aujourd’hui, grâce à des chercheurs comme Jacob Neusner, Seth Schwartz ou Daniel Boyarin, elle s’est répandue dans le milieu anglo-saxon et, depuis une décennie, s’affirme également en Israël malgré la résistancede certains chercheurs. L’enjeu de cette thèse concerne bien entendu la position
97104.indb 20597104.indb 205 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
206 BIBLIOGRAPHIE
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
dominante de la classe rabbinique au sein du judaïsme d’après la destruction du Temple. Si l’approche classique considère que les rabbins remplacèrent de manière plus ou moins paisible les autorités sacerdotales du Temple à Jérusalem, ces nou-velles perspectives esquissent une atmosphère moins ordonnée, où la classe rabbi-nique ne constitue qu’un mouvement idéologique/religieux sans toujours avoir la prétention de se placer à la tête de la nation. Même dans les cas où il existait une telle volonté de la part des rabbins, les recherches contemporaines montrent qu’elle était loin d’avoir correspondu à une réalité concrète.
La question qu’il reste à poser, à laquelle le livre ne donne pas une réponse satis-faisante, est de savoir si ce «judaïsme synagogal» représente un mouvement plus ou moins institutionnalisé (dirigé au moins de manière officieuse par les familles sacerdotales), ou bien s’il s’agit uniquement d’une catégorie d’analyse qui ne repré-sente pas nécessairement un groupe social distinct. Si dans une publication à venir l’auteur semble choisir la deuxième option1, ce n’est pas le cas ici. En réalité, ce livre décrit le judaïsme synagogal de manière plus négative que positive — un judaïsme qui n’est ni chrétien ni rabbinique. Mais cette description risque de fausser l’image du paysage religieux et spirituel du judaïsme ancien car le rabbinisme et le christianisme d’origine judéenne ne constituent aucunement deux groupes du même ordre. S’il est vrai que le discours élaboré par la classe rabbinique palestinienne sera finalement à la base d’une religion de masse, dans la période abordée par le livre ce discours est toujours développé à l’intérieur d’un groupe restreint, élite sur le plan spirituel et intellectuel. En réalité, l’emploi même du terme «mouvement» attribué à chacun de trois judaïsmes (chrétien, rabbinique, synagogal) semble problématique dans ce contexte car il donne l’image de trois entités similaires sur le plan structurel. En effet, lorsqu’on considère que le judaïsme rabbinique est un «mouvement» au même titre que le christianisme, il est tentant de concevoir une autre «case» pour y ranger les Judéens ayant fréquenté les synagogues, lesquelles ne correspondent ni aux normes rabbiniques ni au christianisme. Or, si l’on considère la classe rabbi-nique en termes de réseau spirituel/intellectuel (comme le font par exemple Stuart Miller ou Catherine Hezser) plutôt que comme «mouvement», ce besoin d’une troisième «case» disparaît. En tant que membres d’un réseau spirituel, les rabbins ont développé leur discours tout en participant à la vie religieuse d’autres Judéens de leur époque. Autrement dit, ils fréquentaient la synagogue et dialoguaient avec des Judéens attirés par le christianisme. Même si l’on accepte l’existence de ces trois catégories, on doit admettre qu’un Judéen des premiers siècles de notre ère pouvait être à la fois «rabbinique», «synagogal», voire «chrétien». Cette conclusion rela-tivise l’importance et l’efficacité du modèle tripartite proposé dans ce livre.
Il semble par ailleurs que ce modèle soit le fruit de la perspective historique «d’en haut» que l’auteur emploie dans ce livre: puisqu’il raconte l’histoire des dominants, il a tendance à voir les rabbins comme une classe qui se�veut dominante. L’adoption d’une perspective historique plus sociale aurait pu donner une image organique de la classe rabbinique et la décrire comme un groupe de gens qui, tout en participant à la vie religieuse de leur peuple, adoptaient un regard critique envers elle.
1. S. C. MIMOUNI, «Histoire du judaïsme et du christianisme antiques. Remarques épistémologiques et méthodologiques», dans Les� judaïsmes� dans� tous� leurs� états� aux� Ier-IIIe�siècles, Paris, Le Cerf, à paraître.
97104.indb 20697104.indb 206 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
BIBLIOGRAPHIE 207
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
Le livre se termine par une «Ouverture sur le judaïsme rabbinique», c’est-à-dire le judaïsme qui, selon l’auteur, devint dominant dans la période qui suit celle dont il traite. Contrairement au reste du livre, il semble qu’ici la description du judaïsme rabbinique soit plus traditionnelle et ne prenne pas en compte une partie des nou-velles approches et théories. L’auteur ne mentionne pas, par exemple, la théorie sur les stamaïm, ceux qui, selon des chercheurs comme David Weiss Halivni et Shamma Friedman, auraient rédigé le Talmud babylonien vers le VIIe, voire le VIIIe siècle. Les travaux sur ce groupe sont de plus en plus nombreux et apportent de nouvelles perspectives sur l’histoire de l’époque talmudique. Ainsi, comme l’a montré Jeffrey Rubenstein (cité dans le livre), beaucoup de récits talmudiques projettent sur le passé antique (en Palestine ou en Babylonie) la réalité du haut moyen âge, où les études rabbiniques se déroulaient dans le cadre d’institutions pédagogiques officielles de taille considérable (académies ou yeshivot). Or cette réalité n’est pas nécessairement valable pour la période talmudique elle-même, comme l’ont affirmé par exemple David Goodblatt pour le contexte babylonien et Catherine Hezser pour le contexte palestinien. De même, la division entre Torah orale et Torah écrite, très populaire dans le discours rabbinique à partir du moyen âge, est mentionnée par l’auteur comme un des principes organisateurs du mouvement rabbinique. Or, en réalité, il s’agit d’un développement ultérieur à l’époque talmudique, comme l’ont montré les travaux de Martin Jaffee.
Ces remarques restent cependant très marginales compte tenu de ce que représente ce livre. En effet, un de ses grands avantages est la façon dont l’auteur introduit les principaux débats qui définissent et animent la recherche sur le judaïsme ancien.Il ne s’agit pas seulement d’une description exhaustive et très à jour de l’état actuel de la question, mais aussi d’une impressionnante synthèse de questions complexes aussi bien que diverses. Dans un domaine aussi foisonnant que celui des études sur le judaïsme ancien, il est normal que l’ensemble des débats et discussions ne puisse être abordé avec la même constance. Cela ne diminue aucunement l’importance de cette contribution à l’étude du judaïsme ancien qui constituera, on l’espère, un point de départ pour le renouvellement de la recherche de ce domaine dans le paysage francophone.
Ron NAIWELD
Ron NAIWELD. — Les�anti-philosophes.�Pratiques�de�soi�et�rapport�à�la�loi�dans�la�littérature�rabbinique�classique, Paris, Armand Colin, 2011, 277 pages.
R. Naiweld, actuellement chercheur au CNRS, est l’auteur d’un livre dont le titre retient immédiatement l’attention: Les�anti-philosophes1. Le sous-titre Pratiques�de�soi�et�rapport�à�la�loi�dans�la�littérature�rabbinique�classique suggère fortement que les personnes qualifiées ici d’anti-philosophes ne sont autres que les rabbins de l’Antiquité. L’emploi de l’expression «pratiques de soi» renvoie cependant à la
1. Il s’agit d’une version remaniée de la thèse de R. Naiweld, L’anti-sujet.�Le�rapport�entre�l’individu� et� la� loi� dans� la� littérature� rabbinique� classique, préparée sous la direction de Maurice Kriegel et soutenue en 2009 à l’École des hautes études en sciences sociales. On notera les changements opérés dans le titre: le remplacement de l’anti-sujet par les anti-philosophes et l’individu par les pratiques de soi.
97104.indb 20797104.indb 207 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
208 BIBLIOGRAPHIE
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
philosophie hellénistique, notamment son éthique, telle que l’a interprétée M. Foucault: les rabbins sont donc des anti-philosophes d’un genre particulier, puisque leur anti-philosophie constitue une éthique comparable à celle de la philosophie hellénistique. Reste à comprendre ce paradoxe, ce à quoi s’emploie l’A. dans son livre. Une lecture même superficielle de l’ouvrage montre qu’il comporte un grand nombre de quali-tés: clarté du style (d’autant plus méritoire que l’A. n’a pas écrit dans sa langue maternelle), connaissance approfondie des textes rabbiniques, commentés avec une grande acuité intellectuelle et de manière souvent inventive et problématique d’en-semble particulièrement originale. Celle-ci ne s’identifie pas à la question de la signification des commandements (ṭa‘amey�ha-miṣwot) ou à celle de la dimension psychologique du rapport que le juif observant entretient avec la loi (perçoit-il les commandements comme une contrainte ou une source de joie?), même si ces deux aspects ne sont pas négligés. L’A., à la suite des travaux de M. Foucault, pose une question bien plus précise: comment dans le rapport à la loi se constitue une forme très particulière d’éthique de soi ou encore, comment le rapport à la loi trans-forme celui qui la pratique en sujet moral. Pour y répondre, l’A. a dû traiter un certain nombre de thèmes (l’ascèse, la mystique, la repentance, la souffrance, la relation maître/disciple…), qui ne sont pas nécessairement associés les uns aux autres dans les études savantes2. Il a ainsi construit un véritable objet intellectuel. La comparaison de cet «objet» avec la philosophie hellénistique s’est révélée très éclairante ainsi que la démarche herméneutique de l’A. qui vise à comprendre le fonctionnement interne du discours rabbinique et la manière dont il façonne l’his-toire au lieu de mettre uniquement l’accent, comme on le fait souvent, sur la manière dont l’histoire le façonne.
Le premier chapitre est une présentation problématisée des rabbins de l’Antiquité, de leur conception du monde et de leur littérature. L’A. souligne que le judaïsme rabbinique n’est plus simplement une religion ou une loi imposée par des autorités sacerdotales: «c’est l’individu qui est censé la choisir, l’adopter et la rendre sienne» (p. 48). La fin du sacrifice, qui touche le judaïsme comme les autres religions de l’Antiquité, est aussi sa réinterprétation: il est désormais l’auto-assujettissement à Dieu et le combat contre le péché. Les deux chapitres suivants traitent de deux rapports à la loi ou à la vérité, que les rabbins écartent comme choix d’ensemble, même s’ils en préservent certains aspects: l’ascèse et la mystique. Selon l’A., le terme d’ascèse peut s’appliquer aux rabbins, mais à condition de ne pas négliger les différences entre cette ascèse et celle de la philosophie hellénistique. Les rabbins ne connaissent pas vraiment de retour sur soi, au sens philosophique du terme. Ils sont également hostiles à la mortification du corps. Comme l’affirme à juste titre l’A., au lieu de faire simplement le lien entre la philosophie hellénistique et le judaïsme rabbinique, le thème de l’ascèse accentue plutôt les tensions conceptuelles entre les deux systèmes de pensée (p. 56). Quant à la relation controversée entre la littérature rabbinique ancienne et celle, mystique, des Hekhalot, l’A. constate que les deux corpus se distinguent assez peu sur le plan cosmologique ou théologique. Il propose une hypothèse originale pour mieux comprendre ce qui les différencie: la littérature
2. Voir cependant É. URBACH, Les�Sages�d’Israël.�Conceptions�et�croyances�des�maîtres�du�Talmud, Paris, 1996, chapitres 14 et 15 où l’on trouve les thèmes de l’acceptation du joug de la royauté céleste, de l’amour et la crainte de Dieu, des raisons de la souffrance, de la repentance et des deux penchants.
97104.indb 20897104.indb 208 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
BIBLIOGRAPHIE 209
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
talmudique et les Hekhalot n’ont pas le même projet éthique, le premier ensemble de textes étant centré sur le monde présent et le deuxième sur un accès immédiat au monde céleste.
Dans le chapitre 4, l’A. aborde l’un des concepts les plus importants de la théo-logie rabbinique, la repentance (teshubah), qui peut être rapproché d’un concept également central dans la philosophie hellénistique, celui de la conversion. Ce rap-prochement est possible parce que, pour les rabbins, la repentance n’est pas un phénomène ponctuel mais un processus constant, une véritable «pratique spiri-tuelle». Rabbi Eli‘ezer parle de mener sa vie entière en repentance et «cette vision rabbinique de la vie ressemble bien à un projet éthique perpétuel, identique à celui que l’on peut trouver chez d’autres auteurs du monde gréco-romain» (p. 102, v. la «pratique continuelle», p. 223). Dans le fond, la repentance est une pratique plus intense de la loi et les bonnes actions, qui lui sont souvent associées, sont des pra-tiques que l’on accomplit en plus de la loi. L’A. commente plusieurs textes (sur Ruben, Juda, Achab et Manassé) avec une grande finesse, proposant des lectures souvent originales: par exemple, le «père» (Jb 15, 18) à qui Juda avoue sa faute n’est autre que lui-même. L’objet du cinquième chapitre consiste en ce que les rab-bins appellent en hébreu yissurin, les souffrances. Selon l’A., leur projet éthique est construit sur la réponse qu’ils apportent au problème de la souffrance du juste. Certes, le corpus rabbinique comporte des évaluations divergentes de la souffrance (bonne pour certains rabbins, non désirable pour d’autres), mais on peut trouver en amont de cette division une conception de la souffrance comme acte de communi-cation divine. La souffrance est un message sur le sort futur de l’individu ou deman-dant à celui-ci de s’amender ou encore exprimant l’amour de Dieu à l’égard du juste. Le sujet rabbinique n’est pas invité à rechercher volontairement les souffrances, mais à les interpréter, de manière à déterminer lesquelles sont un message divin et lesquelles ne le sont pas. Une fois le message reçu, il est possible de dire: «Ni elles (les souffrances), ni leur salaire» (p. 147).
Le chapitre 6, qui porte sur le rapport entre le maître et le disciple, est certaine-ment l’un des plus séduisants du travail de l’A. Ce rapport est présenté par les rabbins à la lumière de quatre modèles et il n’est pas le même selon qu’on considère l’enjeu de l’autorité et celui de la vérité. Les trois premiers comparent la relation du maître et du disciple, à celles du maître et de l’esclave, du père et du fils et de Dieu et de l’homme. Ces trois modèles, que le disciple est vivement encouragé à suivre, contribuent à renforcer l’autorité du maître. L’identification du maître et de Dieu peut comporter des inconvénients, mais un disciple ne doit pas vénérer son maître plus que Dieu. Le quatrième modèle s’exprime dans des traditions où les rôles sont inversés et où c’est le disciple qui enseigne, exhorte, console ou contredit son maître. Dans le but d’éclairer ce quatrième modèle, l’A. propose une interprétation sugges-tive de la mishnah Abot, 1, 1: l’autorité divine ne fait que passer à travers le maître, sans résider en lui ou être incarnée en lui. En fait, le disciple a aussi un lien direct avec Dieu, sans passer par le maître. La hiérarchie qui met le maître et le disciple au même niveau par rapport à Dieu permet le renversement des rôles entre le maître et le disciple. L’autonomie par rapport au maître est aussi la possibilité de critiquer Dieu lui-même. Le septième chapitre est consacré à la notion de penchant au mal. L’expression hébraïque yeṣer�ha-ra‘ est déjà mentionnée dans le livre de Ben Sira ou la littérature qumranienne, mais c’est dans la littérature rabbinique qu’elle acquiert une place centrale. L’étude du penchant au mal permet à l’A., plus que toute
97104.indb 20997104.indb 209 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
210 BIBLIOGRAPHIE
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
autre thématique, de montrer avec éclat le contraste fondamental qui oppose la pen-sée hellénistique et celle des rabbins. Pour les philosophes (et pour les premiers penseurs chrétiens, à commencer par Paul), l’homme a en lui une composante divine: l’âme ou une partie de celle-ci. Les rabbins rejettent cette idée et situent au contraire dans l’homme une entité mauvaise, dotée d’une véritable personnalité et qui cherche sa destruction physique et morale: le penchant au mal. Le risque dualiste inhérent à cette conception est atténué par l’idée selon laquelle c’est Dieu lui-même qui a implanté le penchant au mal dans l’homme.
Le chapitre 8 tente de répondre à la question suivante: «comment les sources rabbiniques représentent la motivation pour adhérer à la Loi» (p. 186). Elles dis-tinguent en fait deux types de service de Dieu, par crainte et par amour, et connaissent une troisième forme de service, parfaitement désintéressée, qui peut être désignée soit par le terme de crainte, soit par le terme d’amour. Le premier type de service est fondé sur une émotion ou un sentiment, la crainte, le troisième type relève d’un niveau supérieur qui n’est plus d’ordre sentimental mais qui constitue selon l’A. une «position spirituelle» (p. 190-192). Le deuxième type, qui occupe une position inter-médiaire, est plus difficile à définir. Il est fondé sur une émotion (l’amour), comme le premier type, mais il ne se réduit pas à cette simple émotion, car «il est distinct des autres types d’amour par son intensité ainsi que par ses conséquences pratiques» (p. 195) et, par ce biais, il est proche du troisième type de service. Ce dernier pré-sente des ressemblances avec l’impératif catégorique kantien, même si la comparai-son se heurte assez vite à certaines limites: le service désintéressé est par exemple instrumentalisé dans le but de renforcer le rapport entre le sujet rabbinique et la loi. Dans le dernier chapitre du livre, l’A. soutient qu’à l’inverse de la philosophie hel-lénistique, la pensée des rabbins n’établit pas de lien entre la connaissance de la vérité et la pratique du bien. Cette affirmation semble concorder avec le récit du four de ‘Akhnay, où l’avis de Dieu (source de toute vérité) est rejeté par Rabbi Yehoshua‘ dans la fixation de la halakhah. Elle est aussi confortée par l’interprétation suivante d’Ex 24, 7 («nous ferons et nous entendrons»): avant d’agir et de comprendre, il faut prendre sur soi le joug des commandements. Or, cette décision ne découle pas d’un savoir théorique, elle est une prise de position spirituelle qui consiste en l’ac-ceptation préalable de l’autorité de la loi. Cette acceptation est parfois désignée par l’expression «acceptation du joug de la royauté céleste» et même identifiée à la récitation quotidienne du Shema‘�Yisra’el, que l’on peut comparer aux exercices spirituels des philosophes.
Au terme de ce parcours, nous souhaitons revenir au titre et à la principale thèse de l’A.: le judaïsme rabbinique n’est pas qu’une loi ou comme le pensait une cer-taine historiographie israélienne un «projet national», il est une éthique de soi, comparable à l’éthique des philosophes de l’époque hellénistique. À la manière de D. Boyarin, l’A. n’est pas loin de montrer, de manière très concrète, que «le judaïsme est, depuis le tout début, depuis son origine même, une forme hellénistique de culture»3. Cette thèse était loin d’aller de soi, notamment l’idée que chaque individu rabbinique a un rapport subjectif avec la loi et que l’éthique rabbinique consiste à subjectiver la loi, c’est-à-dire à la faire sienne en la méditant, en la
3. D. BOYARIN, «The Gospel of the Memra: Jewish Binitarianism and the Prologue to John», The Harvard�Theological�Review 94, 2001, p. 246.
97104.indb 21097104.indb 210 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
BIBLIOGRAPHIE 211
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
pratiquant et en la produisant. L’argumentation de l’A. l’a cependant rendue plus convaincante. L’éthique rabbinique, comme celle des philosophes, a un cadre théo-rique et des moyens, notamment des exercices ou des pratiques qui peuvent être identifiés avec certains commandements (la récitation du Shema‘), avec un groupe de commandements (ceux qui régissent les relations entre l’homme et Dieu) ou avec l’ensemble des commandements. Sur le plan du contenu, les convergences avec les philosophes sont nombreuses. L’éthique rabbinique comporte cependant des traits spécifiques, qui la distinguent de, et même l’opposent à, celle des philosophes. Là aussi, l’A. est très proche de D. Boyarin, pour qui le judaïsme rabbinique s’est ima-giné comme une communauté «libre de l’hellénisme»4. Il illustre la pertinence de cette déclaration générale dans un cadre précis, celui du discours éthique des rab-bins. Si le judaïsme rabbinique n’est pas qu’une loi, il reste d’abord et surtout une loi. Plus que la relation du sujet avec la vérité et le bien, l’éthique rabbinique est centrée sur la relation du sujet avec la loi. On peut même dire que le but principal de l’éthique rabbinique est de créer le lien le plus solide entre le sujet et la loi et de justifier le fait qu’obéir à la loi est le meilleur mode de vie. L’éthique des philo-sophes valorise l’introspection et la découverte par le sujet d’une vérité qui est à l’intérieur de lui-même. L’éthique des rabbins réside dans le rapport avec une entité d’origine extérieure, la loi, qui même assimilée par l’individu, restera toujours exté-rieure à lui, autre et contraignante. Le rapport à soi n’est donc pas la source de l’éthique et s’il est une dimension incontournable de l’éthique rabbinique, il ne doit pas devenir une pratique trop intense (p. 67). Si sur le plan du contenu, l’éthique rabbinique présente de nombreuses parentés avec celle des philosophes, les diffé-rences sont notables dans le domaine de la forme. Le discours éthique des rabbins a ceci de propre qu’il ne se présente jamais comme une éthique et qu’il apparaît même comme l’opposé direct d’un système éthique hellénistique. Il reste formulé comme une loi, dont les rabbins accentuent la dimension juridique et autoritaire, par réaction à la position des philosophes.
Le plan de l’A. distingue une catégorie générale, l’ascèse, issue de la philosophie hellénistique et des thèmes particuliers, au nombre de six, issus du judaïsme rabbi-nique. L’éthique de soi des rabbins constitue une ascèse, si l’on prend le terme au sens de l’ascèse formatrice et non de l’ascèse dualiste. Cette «ascèse rabbinique» se déploie ensuite dans les six thèmes particuliers, qui comportent des aspects à la fois conceptuels, spirituels et pratiques. Trois de ces thèmes tournent autour du péché. Le penchant au mal est la source des transgressions, la souffrance est souvent interprétée en lien avec une faute antérieure, la repentance est le regret consécutif à la faute et le retour au bien. Les trois autres thèmes concernent la loi: ses structures d’enseignement (la relation maître/disciple), les motivations qui amènent à adhérer à la loi (amour et crainte) et la position spirituelle qui est au fondement de la pra-tique de la loi (acceptation du joug du royaume céleste). Trois de ces six thèmes présentent des affinités avec l’éthique des philosophes: le rapport maître/disciple, la repentance et l’acceptation du joug du royaume céleste. Pour le premier, c’est évident, pour les deux autres, cela suppose un travail de redéfinition. La repentance, par exemple, n’est pas que le regret après une faute ponctuelle, mais un travail constant sur soi-même. Les trois autres thèmes n’ont pas vraiment d’équivalent dans
4. D. BOYARIN, op.�cit., p. 246.
97104.indb 21197104.indb 211 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
212 BIBLIOGRAPHIE
l’éthique philosophique. L’idée du penchant au mal s’oppose directement à la conviction philosophique d’un principe divin présent en l’homme. La conception de la souffrance comme un message divin ne joue aucun rôle dans l’éthique hellénis-tique. Quant aux deux services (amour et crainte), ils donnent lieu à une comparai-son avec Kant et non avec les philosophes de l’Antiquité. Dans son introduction, l’A. explique ainsi son plan: les trois premiers thèmes permettent de montrer com-ment l’individu «développe un rapport subjectif» avec la loi et les trois suivants comment le discours rabbinique se représente ce rapport (p. 29). La repentance, la souffrance ou encore le rapport maître/disciple sont en effet des phénomènes qui concernent toujours un individu en particulier et qui lui permettent de développer un rapport subjectif ou personnel avec Dieu ou la loi. Dans le cas de la repentance, le rapport que Dieu entretient avec le pécheur est aussi subjectif, car dans ce type d’affaire il ne se plie pas à des critères objectifs, rappelés par les anges (p. 125-126). Un facteur unit enfin les six thèmes: le souci constant des rabbins de renforcer le lien entre l’individu et la loi. La repentance n’est possible que par une pratique accrue de la loi. La souffrance est significative même en l’absence de faute (par exemple dans les souffrances d’amour). Le penchant au mal rend à la fois indispen-sable et toujours difficile la pratique de la loi: indispensable, car le penchant au mal est trop puissant et il faut une arme efficace pour le combattre, difficile, parce qu’avec un tel adversaire, l’individu ne parviendra jamais à un état d’harmonie complète avec la loi. Pour le service de Dieu, on valorisera les motivations lesplus désintéressées et les moins naturelles, considérées comme plus solides ou plus dépendantes de la loi.
Comme dans tout livre essentiel, certains points mériteraient d’être développés, complétés ou nuancés. L’ouvrage de J. Schofer, The�Making�of�a�Sage.�A�Study�in�Rabbinic�Ethics (Madison, 2005), aborde, dans le cadre certes plus limité des Abot�de-Rabbi�Natan, une problématique très proche de celle de l’A. (constitution du sujet rabbinique, intériorisation du discours rabbinique par son adepte, référence à Foucault) avec des thématiques parfois semblables (le motif du penchant au mal, l’amour et la crainte, les exercices spirituels). Si l’A. a connaissance de l’ouvrage, il ne lui donne qu’une place très marginale, peut-être à tort dans certains cas. J. Schofer accorde par exemple plus d’importance à la notion de transformation du sujet et montre, en étudiant diverses paraboles, que la capacité de la Tora à trans-former le cœur de l’homme et notamment le penchant au mal est évaluée de manière très variable par les rabbins. Dans le domaine de la sexualité, Rabbi ‘Aqiba et plus encore Rabbi Eli‘ezer ont tellement bien intériorisé la loi qu’ils n’éprouvent plus le besoin de lutter avec leur mauvais penchant, ce qui n’est pas le cas du Joseph biblique et de Rabbi Ṣadoq (Abot�de-Rabbi�Natan, A, 16). Une autre faiblesse éven-tuelle du livre est le traitement du christianisme. Il forme un couple solidaire avec l’éthique hellénistique. Dans un seul thème (le penchant au mal), le christianisme fait une apparition sans la philosophie, avec la lutte du moine contre les démons qui l’habitent temporairement et le tentent (p. 177). Peut-on aligner aussi nettement la position éthique chrétienne sur celle des philosophes, ce qui aurait surpris M. Foucault? L’A. précise cependant qu’il effectue un travail de comparaison en partant du point de vue des rabbins et il est possible que pour ces derniers, peu de choses distinguent l’éthique des chrétiens de celle des philosophes. Faut-il pour autant insister uniquement sur la dimension judéo-hellénistique de Paul? L’A. affirme que pour les rabbins la connaissance du vrai ou du bien n’implique pas
97104.indb 21297104.indb 212 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
BIBLIOGRAPHIE 213
automatiquement sa pratique. Or, c’est exactement l’idée que soutient Paul dans l’épître aux Romains (Rm 7, 14-23). Le chapitre sur l’ascèse mériterait une discus-sion plus approfondie. Le texte des Pirqey�Abot, 6, 4 où celui qui étudie la Tora est décrit comme un ascète (qui mange uniquement un morceau de pain…) et celui de Talmud Babli, Shabbat, 83b (les paroles de la Tora ne se maintiennent que chez celui qui «se fait mourir par/pour elle») ne doivent pas être négligés. L’opposition à ce que les rabbins appellent «la sagesse grecque» n’est pas nécessairement un rejet de la philosophie. Le fait que l’âme est un principe neutre ou vide n’est pas admis par tous les rabbins. On le voit à l’existence de deux paraboles différentes sur le jugement de l’âme et du corps. Dans la première, conformément à la conception de l’A., l’âme n’a pas plus de responsabilité que le corps dans le péché, mais dans la deuxième, c’est l’âme seule qui est jugée, parce qu’elle provient du ciel, un lieu où l’on ne pèche pas et où réside Dieu. Comme elle vient du palais, elle connaît la loi du royaume et elle est inexcusable (Wa-yiqra�Rabbah, 4, 5 et Midrash�Tanḥuma, Wa-yiqra, 6). Il est difficile de nier la présence de tout principe divin en l’homme, quand on prend en compte les versets de Gn 1, 26-27, où l’homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Certes, l’exégèse rabbinique ancienne ne commente pas beaucoup ces versets et ne les met pratiquement pas en relation avec l’âme, mais certains commentaires voient dans cette image le corps humain5. L’A. déduit de Be-re’shit�Rabbah, 27, 4 que la création du penchant au mal était inéluctable, alors que, dans l’une des opinions citées, Dieu affirme qu’il a commis une erreur en le créant (p. 179-180). L’orientation intra-mondaine de l’éthique rabbinique ne doit pas faire oublier que le monde futur occupe une place considérable dans le discours agga-dique, au point d’avoir fait l’objet d’un développement conséquent dans le recueil halakhique qu’est la Mishnah (l’A. le reconnaît en partie p. 90). Certes, Rabbi ‘Aqiba ne se réjouit pas explicitement de mourir en martyr pour Dieu. Mais, le fait qu’il accueille ses souffrances «avec amour» n’est-il pas un témoignage presque direct de joie? Le travail de l’A. est très marqué par l’influence de Y. Leibowitz et de sa conception du judaïsme rabbinique. Même si l’A. prend par endroits des distances par rapport à Leibowitz, cette influence n’a pas que des bons côtés, car Leibowitz n’est pas vraiment un historien. Parmi les compléments, un développement sur les deux types de commandements que sont les ḥuqqim et les mishpaṭim ou sur les traditions qui parlent de la joie de la miṣwah ne serait pas inutile. L’idée que l’éthique rabbinique est indépendante du concept de vérité mérite d’être confirmée par une étude des nombreuses traditions rabbiniques mentionnant le mot de «vérité» (emet). Cette relative discrétion du concept de vérité a-t-elle un lien avec l’idéologie de la polysémie scripturaire? La soumission volontaire à une loi contraignante permet-trait de résoudre la contradiction perçue par certains rabbins entre Ex 24, 7 (l’accep-tation enthousiaste de la loi) et Ex 19, 17 (la menace du mont Sinaï au-dessus de la tête des Hébreux). Il serait enfin judicieux d’intégrer d’autres traditions, parfois plus explicites que celles commentées par l’A., qui insistent sur l’existence d’un rapport personnel entre l’homme juif et la Tora, dans l’étude ou dans la pratique.
Le travail accompli par l’A. est très conséquent. Il est à la fois phénoménologique et historique, mais la dimension phénoménologique est dominante. Certes, l’A. est
5. Voir notre article «Le corps de Dieu dans le judaïsme rabbinique ancien», Revue�de�l’histoire�des�religions 227, 2010, p. 291-294.
97104.indb 21397104.indb 213 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
214 BIBLIOGRAPHIE
conscient que le développement de l’éthique rabbinique a été favorisé par des cir-constances historiques, comme la destruction du Temple et par la situation des rab-bins au sein du judaïsme de leur temps: les rabbins n’étaient pas encore dominants et observer l’éthique rabbinique relève d’un choix. D’autres questions restent cepen-dant pendantes et elles ne sont pas faciles à trancher. L’éthique de soi rabbinique est-elle déjà bien en place à l’époque tannaïtique ou est-elle plus tardive? Les rab-bins babyloniens et palestiniens ont-ils chacun une variante spécifique de cette éthique? L’A. donne quelques aperçus sur ces questions, mais ils restent à dévelop-per. Les rabbins sont-ils uniquement en dialogue (implicite la plupart du temps) avec la philosophie et le christianisme ou faut-il suggérer l’existence d’un troisième par-tenaire: le judaïsme palestinien hellénisé d’après 70? L’éthique rabbinique a-t-elle constitué l’un des vecteurs de la rabbinisation progressive des juifs dans la fin de l’Antiquité? C’est la question que pose l’A. dans ses travaux plus récents et qui confirme la fécondité des pistes qu’il a ouvertes dans son premier livre6.
José COSTA
Juliette SIBON. — Les�juifs�de�Marseille�au�XIVe�siècle, préface d’Henri Bresc, Édi-tions du Cerf, Paris, 2011, 585 pages («Nouvelle Gallia Judaica»).
Cet ouvrage original est important à plus d’un égard. Ce compte rendu sera donc plus long qu’il n’est d’usage. Nous sommes en effet en présence de la première étude consacrée à la vie d’une communauté juive provençale importante au long d’une période bien définie. L’auteur y exploite une source d’information, les archives notariales, qui a été peu ou pas utilisée dans ce cadre. Les remarquables travaux de Danièle Iancu-Agou nous avaient déjà révélé l’extrême richesse de cette documen-tation, mais ils n’étaient pas centrés sur l’histoire locale. Le travail pionnier de Joseph Shatzmiller décrivait, quant à lui, une communauté provençale d’importance secondaire, laquelle ne devait pas réussir à préserver longtemps son homogénéité. Il traitait d’ailleurs d’une période antérieure (1241-1329).
Il n’est pas nécessaire de rappeler ici que le notariat s’est rapidement propagé dans le Midi à partir du XIIIe siècle et que la conservation des registres des notaires fut considérée comme une nécessité absolue dès les premiers pas de l’institution. Elle a cependant subi des aléas, mais il n’est pas sans intérêt de noter que le plus ancien registre conservé en France — il date de 1248 — est celui d’un notaire marseillais.
Ces registres se sont multipliés par la suite et l’ouvrage que Juliette Sibon a consacré aux juifs de Marseille durant le XIVe siècle en fait le meilleur usage. Le lecteur reste confondu par la quantité des dépouillements auquel l’auteur s’est livrée. Toutes les archives notariales marseillaises conservées aux Archives Départemen-tales des Bouches-du-Rhône et partiellement à la B.N.F. ont été mises à contribution, mais il faut bien reconnaître que les pertes ne sont pas rares. La liste des sources utilisées — trois pages de la liste des sources manuscrites — est impressionnante, mais elle ne représente qu’une partie des dépouillements entrepris, puisque seules les sources ayant livré des informations sur les juifs et les néophytes sont
6. Voir par exemple R. NAIWELD, «Saints et mondains. Le traité Kallah et la propagation du mode de vie rabbinique en Babylonie», Revue�des�études�juives 172, 2013, p. 23-47.
97104.indb 21497104.indb 214 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
BIBLIOGRAPHIE 215
mentionnées. L’auteur a examiné plus de 330 registres, dont 242 ont livré le chiffre impressionnant de 3825 actes concernant des juifs ou des néophytes de Marseille entre 1289 et 1417. Le dépouillement du fonds n’est cependant pas toujours exhaus-tif. S’y sont ajoutées les données, bien moins nombreuses, fournies par les sources judiciaires — surtout des late�ou procédures engagées contre des débiteurs défail-lants�—�et une saupoudrée de sources ecclésiastiques et municipales. Les sources imprimées ne sont guère nombreuses et on n’y relève, à part le récit du périple de Benjamin de Tudèle, qu’une seule source hébraïque: les responsa des Sages de Provence publiés en 1967 par le regretté Abraham Schreiber.
Il est évident que le côté ponctuel des sources utilisées par l’A. a exercé une influence prépondérante sur la structure et le contenu de son ouvrage. Nous y décou-vrirons le portrait d’une société, mais il faut bien reconnaître que l’événementiel n’y trouve pas son compte, à tel point qu’on pourrait se demander s’il s’est passé quelque chose dans le milieu des juifs de Marseille au cours du siècle traité. On serait en peine d’y découvrir une grande crise ou un grand drame. Le XIVe siècle des juifs marseillais ne semble pas avoir souffert des grands massacres provoqués par la Peste Noire, laquelle n’a cependant pas épargné la ville. L’A. n’a pas non plus relevé d’autres événements qui auraient pu exercer une influence sur le cours de l’histoire de la communauté locale. Tout se passe comme si elle avait connu une période de calme et de stabilité prolongée, loin des agitations et des grands mouve-ments qui ont si rudement secoué l’existence des juifs des pays voisins. Il faut cependant se souvenir que la communauté de Marseille ne représentait pas la totalité du judaïsme provençal. Selon les données fournies par l’A., elle comptait pour envi-ron 14% dans un impôt payé en 1326 par les juifs de Provence (p. 354), ce que confirme le tableau comparatif dressé par l’A. des montants de la taille des juifs payés par les juifs de Provence et ceux payés par les juifs de Marseille (p. 364). Combien étaient ces derniers? Selon les estimations de l’auteur, ils constituaient environ 10% de la population de la ville, soit environ 2000 personnes avant 1348 et 1000 pendant la seconde moitié du siècle (p. 24).
Les 3825 actes relatifs aux juifs et aux néophytes repérés par l’auteur pendant la période 1289-1417 constituent une richesse documentaire à laquelle les chercheurs ne sont pas habitués, à l’exception peut-être des trésors de la Genizah du Caire. C’est cette richesse et son utilisation par l’A., qui a su éviter l’obstacle d’une suite de fiches mises en page, qui font le grand intérêt et la nouveauté de cet ouvrage.Il donne la possibilité de suivre pas à pas les activités d’une communauté qui a pu profiter d’un siècle de calme relatif en prenant part à la vie économique d’une grande ville méditerranéenne sans pour autant renoncer à son particularisme, sous la contrainte ou autrement.
Cette abondance a donc dicté à l’A. le plan de son ouvrage. Elle l’a divisé en trois parties: la première intitulée «La confiance et la foi» réunit trois chapitres consacrés respectivement à l’usure, au commerce et à la propriété; la seconde, «Le pouvoir et l’honneur», offre trois chapitres dévolus aux noms des juifs marseillais et à leurs implications, aux stratégies matrimoniales et successorales et à la place des juifs dans la cité; la troisième, «Le profane et le sacré», ne comprend que deux chapitres, l’un traitant de la vie spirituelle et intellectuelle, l’autre des néophytes. Un nombre imposant de soixante tableaux et cartes — l’A. les appelle illustrations — entrecoupe et explicite ces différents exposés, au terme desquels le lecteur pourra également découvrir plusieurs annexes du plus grand intérêt.
97104.indb 21597104.indb 215 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
216 BIBLIOGRAPHIE
Le commerce d’argent est bien entendu l’occupation principale de ces juifs. L’A. nous informe que la très grande majorité de la documentation retenue — 73% — s’y réfère! Il s’agit d’ailleurs essentiellement de prêts à la consommation souvent accor-dés à des laboureurs et à des artisans, dont les montants ne sont pas très élevés. Marseille a sans doute connu des familles et des dynasties de prêteurs, mais on peinera pour y découvrir de très grandes fortunes. Il est évident que ces prêts n’étaient pas accordés gratuitement, mais il ne paraît pas que cette activité ait été très lucrative. Nous ne sommes pas renseignés sur le montant des intérêts exigés. Sans doute l’usure, toute usure, fut elle interdite à Marseille à partir de février 1318, mais cette interdiction devait faire long feu: un intérêt annuel de 10% fut autorisé dès 1354 et il est permis de penser qu’il avait déjà été largement pratiqué auparavant (p. 37). On ne renonça pas pour autant à la lutte contre l’exigence d’intérêts exagérés réputés illicites. Il reste que la participation constante des notaires chrétiens à la rédaction des actes de prêt constituera au cours des années une reconnaissance impli-cite de la légalité des prêts à intérêt. Leur intervention diminuera l’hostilité des débiteurs qui ne pourront exciper d’une quelconque illégalité des prêts accordés par les juifs. Ce tableau reste cependant incomplet, ainsi que le précise l’A., puisque nous ne savons rien concernant les prêts sur gages, qui n’ont pas laissé de traces: ils étaient nombreux et n’exigeaient pas de contrats, la valeur du gage suffisant à les garantir.
On s’est longtemps demandé d’où provenaient les capitaux dont disposaient les juifs dans leur commerce d’argent. Grâce aux analyses de l’A. (p. 63-68), nous savons désormais qu’à Marseille les prêteurs juifs ont souvent contracté des emprunts auprès de gros capitalistes chrétiens, nobles dans la proportion de 40%, qui inves-tissaient ainsi leurs capitaux issus du commerce, du change et de la draperie. Cette participation chrétienne pouvait faciliter les poursuites judiciaires entreprises contre des débiteurs en retard dans leurs remboursements et surtout contre ceux qui oppo-saient un refus de payer partiellement ou en totalité. Le commerce d’argent pouvait donc se révéler très astreignant, encore que certains rabbins aient pu considérer que le commerce d’argent procurait des loisirs qui pourraient être consacrés utilement à des études sacrées.
Contrairement au commerce de l’argent, l’importance de la participation des juifs de Marseille au grand commerce international méditerranéen a été minimisée et limitée au seul cadre de la Catalogne et des implantations catalanes en Sardaigne. Plus de 45% du corail de Marseille était cependant exporté par les juifs de la ville vers les pays du Proche Orient. Le travail du corail avait attiré une forte participation des artisans juifs, dont la réputation n’était plus à faire dans ce domaine particulier. C’est d’ailleurs la seule forme d’artisanat dans laquelle ils jouèrent un rôle important (v. le tableau p. 113-114). L’A. multiplie les informations à leur sujet, mais reste à peu près muette concernant les autres métiers. Les juifs de Marseille n’ont pas été absents du marché intérieur, ainsi que l’atteste leur surreprésentation dans le domaine du courtage, dans lequel 10 à 20% de la population juive de la ville était impliquée.Il est clair que le travail du corail et le courtage n’exigeaient pas de grands investis-sements de leurs praticiens et il semble bien qu’ils ne provoquèrent pas un enrichis-sement rapide. Ils garantissaient cependant une certaine stabilité, qui ne semble pas avoir été menacée au cours du XIVe siècle, en dépit de la grande crise qui ébranla alors le commerce de Marseille pendant sa seconde partie. Il y eut cependant quelques grands négociants juifs qui surent servir, souvent en association avec des
97104.indb 21697104.indb 216 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
BIBLIOGRAPHIE 217
partenaires chrétiens, une clientèle répartie entre la Provence intérieure, le Langue-doc et la Provence. Certains seront même actifs jusqu’au Levant, mais tout cela restera assez éloigné du grand commerce international. D’autres, aux ambitions plus modestes, se contentèrent de développer leurs relations avec les petites communautés juives des environs de Marseille et des implantations plus importantes et plus éloi-gnées. Il reste que, le corail mis à part, l’activité économique des juifs de Marseille ne connut pas un très grand développement. Il est vrai que la conjoncture locale s’y prêtait peu. Il convient cependant de ne pas trop minimiser son importance.
Benjamin de Tudèle avait signalé en son temps l’existence des deux quartiers qu’habitaient les juifs de Marseille, l’un dans la ville haute et l’autre plus bas. Cet état de choses devait changer par la suite, mais il est clair que les juifs de la ville ne furent jamais enfermés dans un ghetto d’avant la lettre et qu’ils eurent des voisins chrétiens au sein des quartiers dans lesquels ils s’étaient établis et que certains parmi eux purent résider dans des quartiers très majoritairement chrétiens. On peut cepen-dant se demander si les juifs marseillais possédaient des biens fonciers. Il est certain qu’ils ne s’intéressaient pas beaucoup aux biens ruraux et qu’ils s’empressaient de revendre rapidement les biens dont ils étaient devenus les propriétaires involontaires (p. 171) à la suite d’une saisie prononcée contre des débiteurs défaillants. L’Aumône des juifs accumula par contre un certain nombre de biens fonciers parmi ses posses-sions. La possession de vignes, qui représentent plus de deux tiers des biens fonciers aux mains des juifs, constituait un cas particulier, étant donné l’impératif religieux qui leur imposait de s’occuper eux-mêmes de la fabrication du vin destiné à leur consommation. Les juifs participaient au commerce du vin, mais on peut se deman-der s’ils ne vendaient que du vin cacher. L’auteur convient en effet que la possession de vignes n’impliquait pas toujours qu’elles aient été travaillées par les juifs eux-mêmes. Il est clair que tout le vin produit n’était pas cacher. Le cas rapporté par l’auteur d’envoi de vin cacher de Barcelone à Marseille en 1387 sous la surveillance rituelle de deux gardiens du vin tout au long du voyage (p. 183) peut en effet donner à réfléchir: la production locale aurait-elle été insuffisante? Question troublante, d’autant que Marseille exportait du vin cacher à Majorque ou Alghero (p. 185) au cours de la deuxième moitié du siècle!
Les juifs n’étaient pas vraiment propriétaires des biens fonciers, immeubles ou vignes, qui semblaient leur appartenir: ils les occupaient sous le régime de l’emphy-théose qui garantissait leurs droits sur une période de 99 ans. Ces baux couvraient plus de 85 % de leurs biens. Il faut bien reconnaître qu’un terme aussi long peut donner le sentiment de la pleine propriété. Il est évident qu’il conforte le sentiment d’un climat de stabilité prolongé malgré de rares et faibles évolutions locales. En effet Marseille qui avait connu deux «jusaterias» ou juiveries jusqu’au début du XIVe siècle, n’en possédait plus qu’un, qui n’était pas très éloigné du port, après la réforme municipale qui unifia la ville en 1348 (p. 193). Le quartier juif de la ville haute où s’élevait la synagogue dite des tours (allusion à son architecture?) semble avoir été déserté progressivement au cours des années au moins par sa population aisée, qui eut tendance à s’agréger à celle qui résidait déjà dans la ville basse. Elle y trouva les institutions religieuses indispensables, notamment ses deux synagogues, sa maison de l’aumônerie et sans doute une école dont il sera question plus loin. Ce quartier a connu au rythme des achats et ventes des frontières mouvantes: il avait donc échappé à un cloisonnement bien délimité par une enceinte. Le regroupement de la population juive de Marseille, sans doute volontaire à l’origine, fut encouragé
97104.indb 21797104.indb 217 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
218 BIBLIOGRAPHIE��
par les autorités locales: on n’a retrouvé aucun statut qui l’imposait, mais cela ne devait pas empêcher le Conseil d’ordonner le 10 mars 1320 aux juifs qui avaient quitté le séjour du quartier juif d’y retourner dans les dix prochains jours (p. 193). La cloison ne fut pas étanche et elle a certainement souffert des exceptions. Le regroupement et la compacité de la population juive devaient aussi justifier l’exis-tence d’une Porte de la Juiverie percée dans la muraille.
Il est bien connu que les juifs d’Europe n’ont pas fait preuve d’un grand enthou-siasme pour l’adoption d’un patronyme fixe. Même quand ils avaient fini par en adopter un, il leur restait souvent personnel et leurs descendants y renonçaient sans difficulté pour en choisir un autre. Il fallut attendre les réformes napoléoniennes pour mettre fin à cet état de choses. La méthode ancienne du choix des noms ne répondait sans doute pas à des règles précises, mais l’auteur a bien montré qu’il n’était pas l’effet du seul hasard. Bientôt tous les juifs auront un nom personnel, suivi quelquefois du nom du père et plus souvent d’un nom de lieu. Il faut constater que ce toponyme représente l’origine de l’intéressé et de sa famille et non le lieu de sa résidence. Au cours du XIVe siècle le nom personnel des hommes sera d’origine biblique ou talmudique (50 à 56%) ou profane, augural (36 à 41%) avec environ 9% de sobriquets profanes et quelques divers. Il en ira différemment avec les femmes au cours de cette même période: environ 17% auront un nom d’origine biblique ou talmudique, mais le pourcentage des noms profanes auguraux tournera aux environs de 55%. Le nombre des surnoms passera d’environ 10% à plus de 20%, tandis que celui des noms d’origine chrétienne déclinera de plus de 16% à moins de 7% (p. 230-234). L’explosion du nombre des noms de femmes d’origine profane n’a cepen-dant rien de particulier à la Provence: on peut le remarquer dans la plupart des communautés juives européennes contemporaines. Il serait assez tentant de dire que l’attachement au nom hébraïque reflète une proximité de la pratique synagogale, dans laquelle il est couramment utilisé par les hommes, alors que les femmes fré-quentent assez peu les lieux du culte.
Dans quelle mesure les toponymes mentionnés dans les noms des hommes peuvent-ils nous renseigner sur l’origine de la population marseillaise? On ne s’étonnera pas de constater que les noms de diverses communautés provençales sont très dominants parmi eux. On sera plus surpris de noter que ceux qui pourraient dénoter une origine étrangère sont rarissimes dans l’extraordinaire fichier prosopo-graphique des juifs et des néophytes de Marseille qu’a réuni l’A. Quelques rares Palerme, un Pisan et des Francisci, dont l’origine française est loin d’être assurée. Il est fait allusion en 1323 à la foule des juifs étrangers, en fait des expulsés de France récemment arrivés à Marseille: or on n’en trouve aucun en provenance du Nord de la France ou du Languedoc dans la liste des immigrés juifs et néophytes arrivés à Marseille durant le XIVe siècle qu’a dressée l’auteur (p. 250)! Il y a là un mystère qui demande à être éclairci. L’auteur fait allusion à des relations ponctuelles avec la Champagne et Alençon, qui sont loin d’être démontrées. Le seraient-elles qu’elles resteraient rarissimes. Il y a eu un mince filet en provenance de la Cata-logne, qui date pour une bonne partie des années consécutives à la grande persécu-tion de 1391. Il échappe à l’analyse, puisqu’il comprend et des juifs restés fidèles à leur religion qui ont fui la Péninsule et des néophytes déclarés qui auraient aussi bien pu y rester. Tous ces mouvements ne portèrent pas atteinte au caractère pro-vençal de la communauté juive de Marseille.
97104.indb 21897104.indb 218 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
BIBLIOGRAPHIE 219
L’auteur affirme qu’il y avait des rabbins à Marseille. On peut cependant se demander s’il y existait un rabbinat. L’emploi du titre de maître utilisé aussi bien pour les médecins que pour les rabbins ou les deux à la fois ne fait qu’augmenter la confusion. Il faut en effet prendre garde de ne pas confondre les rabbins porteurs de ce titre avec ceux qui en exerçaient véritablement les fonctions. Il est clair que leur autorité pouvait être contestée et qu’il fut fait appel en plus d’une circonstance à des arbitres juifs et même à des notaires chrétiens pour des cas d’espèce (p. 414-415). Le texte des deux testaments publiés par l’auteur en appendice le montre bien. Il est évident que les testateurs ont préféré tester devant des notaires chrétiens et non devant des rabbins. Ils sont donc rédigés dans les termes mêmes des formulaires notariaux. C’est ainsi que ces testaments juifs sont introduits, le premier par la phrase�In�nomine�domini�nostri�Jhesus�Christi, le second se contentant d’un bref In�Dei�nomine. Les deux sont d’ailleurs datés selon l’année de l’Incarnation! Il faut croire que les services des notaires chrétiens avaient été préférés en raison des garan-ties qu’ils donnaient et parce qu’ils étaient alors considérés comme plus contrai-gnants que les documents hébraïques de l’époque. L’existence d’un rabbinat mar-seillais organisé reste donc très problématique.
La communauté de Marseille a-t-elle voulu créer une forme d’autorité différente afin de suppléer l’absence d’une autorité rabbinique organisée? Il est clair qu’elle échappa à l’emprise des Nassi de Narbonne et de la très imaginaire principauté que ces derniers auraient fondée et dirigée. Un certain Moïse «Nassi du pays» est signalé à Marseille par le poète Al-Harizi durant le premier tiers du XIIIe siècle, mais son titre n’indique pas la nature de sa fonction ni l’existence d’un rapport quel-conque avec la dynastie issue du Nassi narbonnais. Il s’agit en tout cas d’un cas isolé. Les juifs de la ville jouissaient d’une certaine autonomie dans le cadre de laquelle ils désignaient leurs syndics. Les exemples donnés par l’auteur indiquent qu’il y en avait généralement trois et occasionnellement deux. Chaque quartier juif avait les siens. Nous ne savons malheureusement pas comment ils furent désignés et quelle fut la durée de leur mandat. Ils durent faire face à plus d’une reprise à des situations urgentes et c’est alors que les éléments les plus fortunés de la communauté intervenaient. Faisaient-ils partie d’un conseil des anciens, d’un ma‘amad d’avant la lettre? Ce corps ne réunissait pas tous les juifs de la ville, mais seulement ceux qui participaient au payement de l’impôt. Il n’est pas impossible qu’il détînt le pouvoir de déposer les syndics (p. 362). Ses membres intervenaient lorsque leur communauté était sommée de payer rapidement un impôt imprévu très important. C’est ainsi que seize notables empruntèrent en 1387 au nom de leur université 700 florins remboursables sous un an. L’année suivante les mêmes, à une exception près, mais avec l’adjonction de neuf notables supplémentaires, durent participer à une opération de même envergure, qui, fut cependant étalée sur trois ans (p. 366-368). Il est clair que leur responsabilité était engagée et qu’ils étaient solidairement res-ponsables. Il n’est pas exclu que les syndics aient été rendus personnellement garants de la rentrée des impôts annuels, ce qui pourrait expliquer leur peu d’enthousiasme pour accepter leur désignation à ces fonctions. Y aurait-il un rapport entre cet état d’esprit et la désignation du Conservateur des privilèges des juifs en 1403 au plus tard? Il est difficile de l’affirmer, mais il semble bien que l’établissement de cette nouvelle fonction correspondît à une volonté affirmée de remise en ordre d’une situation qui risquait de se dégrader.
97104.indb 21997104.indb 219 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
220 BIBLIOGRAPHIE��
L’A. n’a pas manqué de se pencher sur les différents aspects de la vie religieuse et intellectuelle des juifs de Marseille. Ce faisant elle a découvert le petit univers des médecins juifs. Ils étaient vingt au cours de la première moitié du XIVe siècle et trente-huit au cours de la seconde et il est probable qu’ils représentaient plus de la moitié des médecins de la ville. Il y avait parmi eux un certain nombre qui se contentaient du seul titre de magister, qui laisse planer un léger doute sur la nature de la profession qu’ils exerçaient, ce titre pouvant désigner également un rabbin ou même un simple maître d’école! Les renseignements font malheureusement défaut concernant leur formation: où avaient-ils fait leurs études? Ou faut-il considérer qu’ils se contentaient d’un apprentissage plus ou moins long auprès d’un médecin confirmé? Nous ne savons pas plus quel était le collège qui leur conférait la licentia�practicandi. L’unique exemple donné — il date du début du XVe siècle — fait état d’un jury de quatre médecins, dont trois juifs (p. 398). L’existence de véritables dynasties médicales juives pourrait donner à penser que cet examen était également une forme de cooptation.
À défaut d’un rabbinat local institutionnalisé, y a-t-il eu un beth� din ou cour rabbinique à Marseille? Il semble bien que le beth� din n’avait pas un caractère permanent et qu’il n’était constitué qu’en cas de besoin. Le cas du tribunal de cinq membres relevé par l’auteur (p. 414) mérite attention: la législation rabbinique reconnaît en effet la nécessité de deux juges supplémentaires qui se joindront aux trois juges habituels dans au moins un cas de droit matrimonial.
L’histoire religieuse des juifs de Marseille semble assez contrastée dans les des-criptions de l’auteur. La conversion au christianisme y a joué un rôle très mineur et la grande crise n’aura lieu qu’au siècle suivant. On relève cependant un certain nombre d’agissements de nature à révéler un affaiblissement de la pratique reli-gieuse. Citons en premier lieu celle du repos sabbatique. L’A. dresse un tableau aux termes duquel 5 à 9% des prêts accordés par trois grands financiers juifs l’auraient été le jour du sabbat (contre 20 à 31% le dimanche!). On voudrait en savoir plus long sur ces dates, qui, semble-t-il, ont été restituées par l’auteur, l’original portant très probablement la seule date du calendrier chrétien (p. 444). Faut-il exclure la possibilité que l’acte ait pu être rédigé la nuit tombée? La rédaction du contrat nécessitait-elle la participation active, signature ou autre, du prêteur? Il devait assu-rer avant tout la responsabilité de l’emprunteur. On pourra faire les mêmes remarques pour les jours de fête et notamment pour le jeûne de Kippour. À défaut de rensei-gnements plus précis, il sera difficile de suivre ici les conclusions de l’A. Une telle conduite aurait dû provoquer le scandale. Nous sommes sans doute insuffisamment renseignés, mais il reste que ces procédés condamnables sur le plan religieux ne semblent pas avoir provoqué des remous.
Il en est d’ailleurs de même avec la fabrication du vin cacher et la production de la viande cacher. En effet le vin cacher peut très bien être fabriqué chez un non-juif, à condition de suivre les règles rituelles idoines (p. 182-185). C’est d’ailleurs ce qui se fait encore de nos jours. En ce qui concerne la boucherie, il faut se souvenir qu’il n’existait pas d’abattoir juif et que les bouchers juifs devaient donc faire abattre soit sur leur marché, soit à l’intérieur de leur quartier, soit dans l’abattoir municipal avec la complicité d’un boucher chrétien (p. 441-443). D’où la crainte de certaines confu-sions, peut-être volontaires, entre des viandes cacher ou non. La boucherie juive était d’ailleurs condamnée à vivre en symbiose avec la boucherie chrétienne, étant donné la nécessité dans laquelle se trouvaient les bouchers juifs de se débarrasser des bêtes
97104.indb 22097104.indb 220 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
BIBLIOGRAPHIE 221
reconnues non cacher lors de leur abattage, ainsi que des parties des bêtes cacher interdites à la consommation rituelle des juifs, telles les suifs ou peut-être le sang également. Comme le note l’auteur, ce commerce ne pouvait se passer d’un contrôle extérieur. Le silence des sources hébraïques ne permet cependant pas d’affirmer l’existence d’une volonté de tromperie. Son existence, si elle était démontrée, prou-verait tout au plus que les fidèles juifs pouvaient être abusés et ne témoignerait pas d’un relâchement grave de leur pratique religieuse. Il est certes tout à fait admissible que tous les juifs de Marseille ne fissent pas preuve d’une orthodoxie intransigeante, mais il n’est pas démontré que certains parmi eux, dont des notables, aient pu faire preuve d’une telle légèreté dans l’observance de plusieurs des règles essentielles de la vie religieuse juive.
L’existence d’un rite marseillais a été révélée il y a quelques années dans une publication savante1. Il date, il est vrai, de la première moitié du XIIIe siècle, mais sa seule existence montre bien l’ancienneté de l’enracinement de la communauté mar-seillaise, dont il décrit pas à pas la liturgie, ainsi qu’il le remarque dans sa conclu-sion: «Ce rituel de l’année entière, je l’ai composé à Marseille. J’y ai porté quelques additions et corrections à Montpellier, mais il traite dans sa majorité et dans sa totalité de l’usage de Marseille». On ne sait rien de l’auteur, sinon qu’il appartenait à une ancienne famille marseillaise, celle d’Isaac ben Abba Mari de Marseille, plus connu comme l’auteur du Sefer�ha-‘iṭṭur.
Un autre texte, dont l’A. n’a pu prendre connaissance pour cet ouvrage, a été publié récemment: le Ma‘aseh�Nissim, commentaire du Pentateuque de R. Nissim fils de Moïse de Marseille2. Cet ouvrage, un commentaire philosophique de la Torah, loin de toute influence kabbalistique, a été composé au cours du premier quart du XIVe siècle. Il est donc susceptible de nous renseigner sur les problèmes qui agitaient la vie intellectuelle des juifs de Marseille, grâce aux solutions qu’il leur propose. Il faut noter que l’auteur déclare l’avoir écrit dans la Metibhta,� l’école talmudique locale, dont l’existence était inconnue jusqu’à présent. Il est donc permis de penser qu’il reflète, du moins en partie, les échanges qui ont eu lieu dans cette institution entre le maître et ses élèves. Tel quel, il ne confirme pas le déclin de l’école rationaliste contemporaine.
Grâce à l’abondance des sources notariales révélées dans cette étude neuve de l’histoire juive médiévale, nous sommes à présent en mesure de mieux connaître son quotidien. La documentation utilisée est surtout de nature économique, mais c’est à travers elle qu’une reconstitution de ses activités devient possible. Le calme de ce XIVe siècle, qui a échappé aux bouleversements dont furent victimes d’autres com-munautés, aura permis une activité continue, un voisinage fructueux et somme toute bienveillant des diverses communautés provençales. Il faut remercier l’A. qui nous l’a si bien montré et souhaiter que la voie qu’elle a frayée attire d’autres chercheurs
1. Regardant l’usage de Marseille, le livre des usages de Moïse fils de Samuel a été édité par Jacob GERTNER, Kobheṣ�‘al�yad 14 (24), Jérusalem, 1998, p. 81-176 (en hébreu). L’exis-tence du manuscrit qui a servi de base à l’édition avait déjà été signalée par Henri GROSS, Gallia�Judaica, Paris-Louvain, 20113, p. 373.
2. Édité et commenté par Hayyim (Howard) KREISEL, Jérusalem, 2000 [c.r. REJ 163/1-2, p. 367-369]. Cet ouvrage n’était pas non plus inconnu du monde savant et quelques extraits en ont déjà été publiés auparavant. V.�Gallia�Judaica,�op.�cit., p. 378.
97104.indb 22197104.indb 221 12/08/14 08:4312/08/14 08:43
Revue�des�études�juives,�173�(1-2),�janvier-juin�2014,�pp.�195-222.
222 BIBLIOGRAPHIE �
à poursuivre l’exploitation des richesses notariales et judiciaires de l’espace méditerranéen.
Ce compte rendu manquerait aux règles du genre s’il omettait quelques remarques de détail. Elles seront résumées ici: p. 194: la fermeture du quartier juif répond également à la nécessité de l’installation d’un ‘erubh. P. 200, n.1: la «banlieue» shabbatique se calcule à partir des limites de la localité. P. 232: Nazon = Nathan? P. 243: le prénom Margalis ne correspondrait-il pas à l’hébreu Margalit (perle)? P. 247: Gérondin = Girondi, originaire de Gérone. P. 304: le seul mardi 15 de l’an-née 5119 tombe le 19 juin 1359. P. 305: la ketubhah est rédigée avant la cérémonie du mariage. Elle est lue et remise sous le dais nuptial. P. 339: où sont passés tous ces juifs étrangers? P. 414: Joseph ben Yoḥanan, peut-être identique avec Joseph ben Yoḥanan Trèves, appartiendrait à une famille d’origine française, mais il n’est pas impossible qu’il soit alors venu d’Espagne. P. 414, n. 6: lire p. 381. P. 476: pour devenir consommable, la viande cacher devait également être débarrassée de ses suifs et du nerf sciatique, pas seulement du sang! P. 484-485: en cas de conversion du mari, l’épouse restée juive était considérée comme mariée, d’où la nécessité d’un acte de divorce, dont l’octroi dépendait de la bonne volonté de son mari, au cas où elle souhaiterait se remarier. Celui-ci pouvait en effet considérer que sa conversion équivalait à un divorce et se refuser à participer à un rituel relevant de la loi juive. Dans les deux cas l’épouse risquait d’être soumise à un chantage pour obtenir son geṭ ou acte de divorce. Dans le cas de la conversion de la femme, il appartenait à l’Église de décider si la femme pouvait se remarier avec un chrétien sans divorce préalable. Le mari resté juif pouvait être délié du ḥerem ou ban interdisant la poly-gamie et se remarier à son gré. P. 493: il faut bien comprendre que le juif converti n’est pas un frère durant son apostasie. Il n’a cependant pas besoin de se convertir pour revenir au judaïsme, étant donné qu’il est resté un juif potentiel durant cette période.
Simon SCHWARZFUCHS
97104.indb 22297104.indb 222 12/08/14 08:4312/08/14 08:43