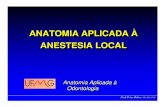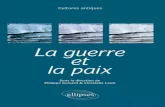Activités métallurgiques et indices d’habitat à Grospierres, Les Ferriers (Ardèche) à la...
Transcript of Activités métallurgiques et indices d’habitat à Grospierres, Les Ferriers (Ardèche) à la...
8
Fig. 1 : Vue générale de la fouille Inrap 2013 et principaux résultats archéologiques. Photo/DAO E. Durand, Inrap RAA.
En préalable à la construction d’une maison individuelle et de trois gîtes au lieu dit Les Fer-riers (Grospierres), deux opérations d’archéolo-gie préventive Inrap ont été réalisées sur les 6400 m2 de la parcelle ZD 283p (fig. 2) : une phase de diagnostic de 20 sondages (Ronco 11/2012) sui-vie d’une fouille ouverte sur 2050 m2 (Durand 06/2013).
Ces travaux de terrain ont permis de mettre au jour quatre phases d’occupation plus ou moins marquées : de rares silex chasséens, une fosse du Bronze ancien, deux structures en creux et de très nombreux indices d’activités métal-lurgiques de la fin du IIe siècle avant notre ère conservés sur environ 600 m2, et, enfin, quelques fragments de céramiques et autres tuiles du XIXe siècle (fig. 1).
Nous présentons ici une note collective syn-thétisant les premiers résultats issus des diverses analyses paléoenvironnementales (géomorpholo-gie, anthracologie, malacologie), archéologiques (céramologie, études lithiques, numismatique, verre, archéozoologie) et archéométriques (pros-pection géophysique, métallographie) réalisées fin 2013 et début 2014 sur le site des Ferriers.
Contexte géologique, géo-graphique et archéologique
La plaine de Beaulieu dans laquelle se situe Grospierres et le site des Ferriers est comblée durant le Crétacé inférieur par des dépôts d’âges Hauterivien et Valanginien caractérisés par des marnes alternant avec des bancs de calcaires marneux. Ces dépôts sont ensuite partiellement recouverts par des colluvions récentes, indif-férenciées, sablo-limoneuses (Elmi et al. 1988) observées ici sur le versant occidental de la mon-tagne de la Serre.
Le site des Ferriers, est en effet, localisé au pied du rebord ouest du massif calcaire de la Serre (134 m NGF) à plus de 1,5 km des berges actuelles du Chassezac. Il se trouve à 350 m envi-ron au sud-ouest du bourg actuel dans une zone viticole aménagée en terrasses et récemment construite de maisons individuelles.
Le contexte archéologique de ce quartier est assez pauvre. Il a livré en surface quelques indices de sites moustériens aux lieux dits Les Rodes, Les Thoulouses et Les Monteils (Gros
Activités métallurgiques et indices d’habitat à Grospierres, Les Ferriers
à la transition IIe-Ier siècle avant notre ère
F1013 F1012paléovallon
F1002
Campaniforme/Bronze ancien2e âge du Fer (fin IIe s. av. n. è.)
montagne de la Serre
Photo/DAO E. Durand, Inrap RAA
Figure 1- Vue générale de la fouille Inrap 2013 et principaux résultats archéologiques
9
2003). De nombreux tessons gallo-romains (Ier-IIe s. ap. J.-C.) également ramassés en surface entre les ruisseaux de Pissevieille et des Ferriers (Clément 2003) complètent les rares données connues de ce secteur.
Le toponyme «Les Ferriers», assez fréquent en Bas Vivarais, évoque évidemment une acti-vité métallurgique ancienne du fer. Au regard du contexte géologique et minéralogique (cf. infra), il se pourrait que les origines de cette acti-vité métallurgique remonte à la fin de l’âge du Fer. Cette période est souvent méconnue car les gisements ont parfois été arasés par les exploita-tions gallo-romaines ou médiévales (Rebiscoul in Ronco 2012, p.41), même si à ce jour, une seule scorie de fer antique a été mise au jour au pied du Chastelas, au lieu dit les Archers (Clément 2003).
Paléotopographie,paléoenvironnement etstratigraphie «naturelle»
Si le substrat de calcaire marneux Haute-rivien a souvent été atteint, son niveau reste très variable et démontre sans doute un terrain naturel vallonné (pendage S.-O/N.-E.), sujet à une forte érosion liée à l’eau (fig. 2). Ce milieu ouvert, voire déboisé, est bien confirmé par les données malacologiques et anthracologiques.
Sur les 940 restes malacologiques identi-fiés, 20 espèces sont terrestres et une est aqua-tique. Les escargots présents dans les structures archéologiques de la fin du IIe siècle avant notre ère sont majoritairement des espèces xérophiles (Granaria variabilis, Candidula gigaxii, Vallonia excentrica surtout). Ils indiquent à la fois des herbacées rases et sèches et la présence de zones où la végétation est absente, comme les zones de rocailles. Les espèces plus mésophiles et les espèces forestières sont beaucoup plus rares.
Les données malacologiques mettent, donc, en évidence des milieux végétaux particu-lièrement dégradés alors que ne subsistent, au paroxysme de l’impact anthropique, que quelques herbacées clairsemées et que les cou-vertures arborées et arbustives ont été éliminées. Cette structure très ouverte du milieu, de type pelouses, est la conséquence d’une artificiali-sation totale du secteur par les populations de l’âge du Fer (S. Martin, Inrap, UMR 5140).
L’étude anthracologique a permis d’iden-tifier 301 charbons de bois et 6 taxons sur un total 61 litres de sédiments tamisés. Si l’espèce la
mieux représentée est Quercus sp., la présence d’érable, de prunoidées et de pomoidées nous indique un milieu ouvert et anthropisé, proba-blement en bordure d’un bois de chênes (V. Bel-lavia Inrap, UMR 6042).
Toute la moitié orientale du décapage méca-nique de 2013 évoque ainsi la présence d’un paléovallon entaillée dans le terrain naturel (fig. 2). Les horizons de limon argileux gris à jaune mis en évidence dans les séquences stratigra-phiques correspondent à des niveaux colluviés de marne décomposée comblant en partie une ancienne dépression caractéristique des pay-sages pentus en ravins (bad-lands). Du mobilier anthropique est présent dans toutes les phases de la séquence colluviale jusqu’au contact du substrat (R. Mensan, Inrap, UMR 5608).
Fréquentation du site au Bronze ancien
Si un fragment mésial de lamelle (silex bédou-lien) et un grattoir latéral sur éclat cortical (silex du Secondaire) mis au jour en surface et dans le comblement de la structure F1013 renvoient à des indices de passage au Néolithique moyen (S. Saintot, Inrap), la première fréquentation du site concerne le début de l’âge du Bronze.
Repéré en 2012, une fosse ovalaire (2,5 x 1,5 m) a priori isolée a été totalement fouillée en 2013. Ses multiples niveaux de comblement
134.00
135.00
133.00
134.00
134.00
133.
00
X = 802.400
X = 802.350
Y = 6367.450
Y = 6367.400
120 a
216
282
283
320
72
0 5 25 50 m
Sondage diagnostic 2012 (positif)
Emprise du diagnostic Inrap (Ronco 2012)
Relevé stratigraphique (log)
Emprise de la fouille Inrap (Durand 2013)
Campaniforme/Bronze ancienLa Tène C2 (fin IIe s. av. n. è.)Contemporain, XIXe siècle
Sondage 2013
Sondage diagnostic 2012
paléovallon
F1011
F1012F1013
F1003F1004
F1001
F 1002
Levé topographique : N. Saadi, Inrap RAASystème de coordonnées Lambert 93 - Nivellement NGFDAO : P. Rigaud, E. Durand, Inrap RAA
Fig. 2 : Plan généraldu site de Grospierres,Les Ferriers (1/1000) : emprise des travauxInrap, structuresarchéologiqueset paléotopographie.Plan N. Saadi ;DAO P. Rigaud,E. Durand, Inrap RAA.
10
conservés sur 0,7 m de puissance ont livré un abondant mobilier.
Le corpus céramique relativement homogène compte 22 individus (vases de stockage, pots à cuire et vaisselle domestique) pour un total de 244 tessons (3,7 kg). L’examen typologique ren-voie à une série de petits vases carénés à anse type tasse (fig. 3) et à des gros vases fermés de stockage à grosses anses et/ou à préhensions décorées. Tous ces éléments sont datés, dans une fourchette assez large entre le Campaniforme et le Bronze A1 (E. Néré, Inrap, UMR 5138).
2 outils, un percuteur/broyon en grès et une petite enclume en gneiss (S. Cousseran-Néré, Inrap) et un fragment de diaphyse de cerf (D. Lalaï, Inrap) complètent cet ensemble.
Prospection géophysique
Suite aux données du diagnostic de 2012 dont le principal résultat a été la découverte d’indices de métallurgie du fer à l’époque pro-tohistorique, une prospection magnétique a été réalisée sur environ 3990 m2 en amont du décapage mécanique. Cette méthode (magnéto-mètre G-858) est particulièrement bien adaptée à la recherche de structures de chauffe et de structures en creux notamment lorsque celles-ci présentent un remplissage riche en déchets liés au travail du fer (scories, battitures). La présence d’un sol marno-calcaire quasiment amagnétique laissait, de plus, présager de forts contrastes avec d’éventuelles structures liées au travail du fer.
Malheureusement cette prospection a seule-ment permis de reconnaître la structure F1013 repérée lors du diagnostic (fig. 2) et d’orienter la stratégie de terrassement en mettant en valeur l’absence totale d’autres structures (G. Hulin, Inrap, UMR 7619).
Une fosse-dépotoir, desindices de proto-sidérurgie etdu mobilier métallique (findu IIe siècle avant notre ère)
Repérée en tranchée en 2012, une vaste dépression «aménagée» en bordure d’un paléo-vallon (fig. 4) et entaillée dans le substrat et son horizon détritique, constitue la structure archéo-logique majeure de la fouille de 2013 (fig. 5). Elle présente un plan triangulaire à angles arrondis d’environ 80 m2. L’abondant mobilier céramique (cf. infra) et métallique mis au jour et déposé/jeté dans les 0,4 m de son comblement permet d’évoquer sans équivoque une fonction de dépo-toir qui a fonctionné entre -140-120/ et -80.
Au total, 1194 déchets métallurgiques (14,217 kg) ont été découverts sur l’ensemble du site des Ferriers. Ils proviennent en très grande majorité de la fosse F1013 : 99 % des scories soit 1176 éléments (poids 13792 g). Dans cette fosse, les scories sont représentées majoritairement par des gromps (34% du nombre total), des sco-ries coulées (26%), des scories argilo-sableuses (11%) et des scories très fragmentaires inidenti-fiables (22%). Deux enseignements découlent de cet inventaire. D’une part, le lot scoriacé est très fragmentaire, en moyenne 12 g par individu. D’autre part, il est largement dominé par deux
2
0 2 10 cm
Dessin/DAO E. Néré, Inrap RAA
1
Fig. 3 : Fosse F1012,comblement : exemples
de céramiquedu Bronze ancien 1.
Dessin/DAO E. Néré,Inrap RAA.
Photo/DAO E. Durand, Inrap RAA
paléovallon
paléovallon
fosse F1012Bronze ancien
F1013
Fig. 4 : Vue généralede la dépression
«aménagée» F1013en cours de fouille
(fin IIe s. avantnotre ère).
Photo/DAOE. Durand, Inrap RAA.
11
types de scories : des fragments de métal brut enrobé de scorie (gromps) et des scories coulées (fig. 6). Ce faciès témoigne sans ambiguïté d’une activité d’épuration et de compactage de masses de fer brutes, directement issues de la production du fer en bas fourneau. Ces activités de réduc-tion du minerai en fer pourraient se trouver à proximité du site, étant donné la fréquence des minerais de fer dans la zone (G. Pagès, CNRS, UMR 7041).
L’examen de la carte géologique montre clairement que toute cette zone est propice aux minéralisations et que ces gisements métallifères peuvent avoir des structures filoniennes ou stra-tiformes. Les structures filoniennes se retrouvent aussi bien à l’est qu’à l’ouest de notre zone (nombreuses failles au nord-est de Chandolas
Photo E. Durand, Inrap RAA
Fig. 5 : Aménagementdu secteur F1013carroyé.Photo E. Durand,Inrap RAA.
Fig. 6 : F1013, les deux principaux types de scories de fer (fin IIe s. avant notre ère).Photo/DAO G. Pagès, CNRS, UMR 7041.
12
et/ou au sud-ouest de Sampzon). Il pouvait s’y trouver des gnossans (chapeaux de fer) ayant fait l’objet d’une exploitation minière de surface, les gisements stratiformes se localisant au contact de deux roches (montagne de la Serre). Enfin, issus de ces formations, des gisements secon-daires (gîtes d’éluvions emballés sur pente) ont pu livrer une masse minérale intéressante pour cette proto-sidérurgie (A. Rebiscoul, Inrap).
Cependant, aucun vestige tangible ne permet de s’assurer réellement de la proximité ou de l‘éloignement de cette activité de réduction, vu que les masses de fer brutes peuvent parfois être échangées et commercialisées sur de longues dis-tances. Le fer, en tant que matière première, peut circuler sous deux formes : celles de masses ou de fragments bruts de réduction plus ou moins épurés, ou en tant que demi-produits, correspon-dant à des réserves de métal mises en forme, au moins partiellement compactées et asséchées des inclusions héritées de la réduction (Fluzin et al., 2000). En revanche, il est certain que sur le site étaient martelées des masses de fer brutes dans le but de rendre les matériaux ferreux forgeables en éliminant les inclusions de scories (épuration) et en refermant les porosités (compactage). Cer-tains outils lithiques (1 molette, 10 fragments de moutures en basalte et en grès) présents dans la fosse pourraient être mis en lien avec ces activi-tés. Ces vestiges relatent donc une activité spécia-lisée se plaçant précisément entre les activités de réduction du minerai et les activités de forgeage et de fabrication d’objets (G. Pagès, CNRS, UMR 7041).
Sur un total de 48 objets métalliques mis au jour sur le site, 16 d’entre eux proviennent de la structure F1013. Il s’agit de 13 fibules en fer fragmentaires et 3 éléments dits «inclassables».
La parure est la catégorie la mieux repré-sentée sur le site avec 35,85 % du corpus. Les fibules sont fragmentaires et en très mauvais état de conservation (fig. 7). Deux sont cependant attribuables au type Feugère 1a2 ou Tendille 13 (fig. 7, n°47, 54), à ressort bilatéral à 4 spires et corde externe en fer, daté en Gaule méridio-nale entre -120 et -100 /-80. A Grospierres, la concentration de 13 individus du même type au sein de la structure F1013 semble s’expliquer de deux façons, soit ce regroupement est dû à leur utilisation, soit il est lié à leur méthode de fabrication. A l’âge du fer, les fibules sont parfois portées en grand nombre sur le même vêtement, elles sont également fabriquées en série, à par-tir d’ébauches (fig. 7, n°58, 57) qui seront mises en forme par martelages successifs pouvant s’accompagner d’ébarbage et polissage. Les deux polissoirs en galets siliceux et le broyon/percu-teur en grès pourraient avoir eu cette fonction.
Les activités post-réductrices authentifiées par les nombreux déchets scorifiés (cf. supra) et les 94 charbons à vitrification partielle, pour-raient être complétées par une phase de forgeage ou pré-forge ayant laissé peu de traces tangibles au dépend d’une activité d’épuration plus déve-loppée. Si aucun vestige d’activité de forge (bat-titure, scorie ou chute de forge) n’a été mis au jour, la présence probable de plusieurs éléments de préformes de fibules pourrait étayer cette hypothèse (C. Galtier, Inrap). On pourrait aussi envisager que le site des Ferriers constitue une sorte de plaque tournante liée aux productions ferreuses qui importe différents types de maté-riaux ferreux et les redistribue ensuite après les avoir plus ou moins travaillés (G. Pagès, CNRS, UMR 7041).
Autre mobilier de la fosse-dépotoir : bracelet en verre et monnaies préromaines
La présence en F1013, d’une scorie vitreuse (composition alumino-calcique) de couleur verte, identifiée comme un déchet métallurgique confirme et étaye cette activité à proximité du site fouillé.
D’après la typologie et les analyses chimiques (Gratuze 2013), les deux fragments de bracelets en verre retrouvés également en F1013, forment un même objet et appartiennent au groupe des formes larges du type Haevernick 7a, série Geb-hard 27 (L : 19 mm). Ce type désigne les bra-
0 5 cm
fibule 47 fibule 54
Photo/DAO C. Galtier, Inrap RAA
ébauche fibule 57ébauche fibule 58
Fig. 7 : F1013, fibules en fer de type Feugère 1a2 : produit finis et préformes
(fin IIe s. avant notre ère).Photo/DAO C. Galtier,
Inrap RAA.
13
celets à cinq côtes parallèles, transparents avec un fond jaune (fig. 8). Généralement daté de La Tène C2 vers -160/-130 il est répandu en Suisse sur les sites du canton de Berne et au sud de l’Al-lemagne ainsi qu’au Pays Bas et en Slovénie. En France on en retrouve surtout dans la région du Languedoc, avec notamment treize exemplaires à Nages (J. Rolland, UMR 8215).
Cette datation est confirmée par les trois monnaies mises au jour en F1013 : obole (imita-tion ?) à la légende MA ou obole à la croix, mon-naie d’argent à la croix (type indéterminé) et potin au taureau à la légende MA (J. Genechesi, UMR 8546).
Le vaisselier céramique et autres terres cuites de la fin du IIe siècle
Si la structure 1013 a livré très peu de faune (27 restes fauniques très fragmentés dont 7 capri-nés, 1 cerf ?), le mobilier céramique essentielle-ment « indigène » est, en revanche, très abon-dant. Au total, 3461 fragments de céramique ont été inventoriés sur l’ensemble du site pour la période de La Tène C2. Comme pour le mobi-lier métallique, l’essentiel du corpus provient de F1013 (87,15 %).
La céramique non tournée (CNT) largement majoritaire avec 98,4 % du total nfr, comprend d’après le nombre de bords conservés : 373 vases
dont 188 formes ouvertes type coupe, jatte ou couvercle ; 90 décors imprimés dans la plupart des cas sur des formes fermées type pots (fig. 9), 49 panses peignées, 2 vases torchis, 2 fusaïoles et 2 jetons. Le faciès culturel de cet ensemble est nettement languedocien et renvoie aux quelques vases tardo-laténiens mis au jour à Vallon-Pont-d’Arc (Ferber 2004), à Saint-Just-d’Ardèche (Gilles 1976), à Lavilledieu (Lefebvre 2006) et surtout à la série (voisine) de référence mise au jour à Alès (Kurzaj 2012, Dedet 2013).
La céramique tournée correspond seulement à 1,62 % du total avec : campanienne A 14 frag-ments (2 coupes ; fig. 9, n°1), CT engobé rouge 2 fragments (fig. 9, n°2), CELT 8 fragments (3 coupes) ; CL-REC 14 fragments (3 cruches) ; CT sableuse à cuisson oxydante 6 fragments (1 coupe).
Si aucun indice de consommation de vin ita-lique (amphore) ou aucun vase de stockage n’est à signaler sur le site, de nombreux indices d’amé-nagement domestique liés à des habitations sont présents. Les 113 fragments de sole lissée/noir-cie appartenant à plusieurs plaques foyères et les 11 fragments de torchis dont 4 présentent des négatifs de clayonnage témoignent dans ce sens.
Enfin parmi les autres artefacts en terre cuite, la présence possible d’un fragment de
Photo/DAO J. Rolland, UMR 8215
0 2 cm
Fig. 8 : F1013, fragment de bracelet en verre(fin IIe s. avant notre ère).
Photo/DAO J. Rolland, UMR 8215.
0 5 cm
Photo/DAO E. Durand, Inrap / UMR 5140
1 2
Fig. 9 : F1013, exemplesde céramique tournée àvernis noir, à engoberouge et décors inciséssur céramique nontournée : formes fermées(fin IIe s. avant notre ère).Photo/DAO E. Durand, UMR 5140, Inrap RAA.
14
tuyère (Ø 12-13 cm) et de quelques fragments de parois de four complète le corpus d’indices de la principale activité du site des Ferriers : la fonction métallurgique. Le dernier témoin est la présence sur la face interne de 14 fragments de céramique non tournée (dont 2 fonds plats) de dépôts encroutés/scoriacés. L’hypothèse ici d’un travail de (pré)forge pour le refroidisse-ment rapide dans l’eau (vase) de la barre, de la préforme ou de l’objet fini en fer conforterait la présence d’ébauches de fibules et complèterait la chaîne opératoire du travail du fer (E. Durand, Inrap, UMR 5140).
Premières conclusions
Si les quelques données relatives au mobi-lier céramique du Bronze ancien complètent celles déjà connues sur l’éperon des Conchettes (Ozanne in Durand 2000), la découverte majeure du site des Ferriers est la découverte de nom-breux indices d’activités de métallurgie du fer à la fin de l’âge du Fer. Ils renvoient et évoquent la « tradition » de cette région depuis le IIe millé-naire avec ses nombreux sites « chalcolithiques » et Bronze final étudiés par A.-C. Gros.
La présence d’un site métallurgique bien daté (fin du IIe siècle avant notre ère) et relativement bien conservé (même si en position secondaire) est assez exceptionnelle dans le quart sud-est de la France (Kurzaj 2012). Pour les âges du fer, seuls quelques rares exemples de masses brutes de réduction sont connus dans des contextes archéologiques bien documentés (Fournier, Mil-cent, 2007) et la circulation des matières pre-mières métalliques, dans le cadre de la chaîne opératoire de post-réduction du fer, est très mal connue (Pagès 2014 sous presse). Dans cette problématique, la référence en l’état actuel des connaissances est l’oppidum d’Entremont qui apparaît en Provence comme un pôle centrali-sateur de savoir-faire et d’activités sidérurgiques
variées (compactage de loupe, fabrication de demi-produits, élaboration d’objets). Il démontre une claire organisation de ses productions, à par-tir de catégories de demi-produits (portions de loupes, fragments de métal bruts et barres) ayant pu être destinés à des marchés différenciés, ainsi qu’une hiérarchisation de ses activités, organi-sées en secteurs distincts en fonction de leurs productions (épuration-forge et forge seule) (Ber-ranger, Fluzin 2007).
Le troisième apport de cette opération pré-ventive concerne la culture matérielle et l’occu-pation du sol. Le riche mobilier céramique et métallique étudié a permis ainsi d’enrichir notablement les rares données connues en Ardèche méridionale pour la seconde moitié du IIe siècle avant notre, période dont la chrono-logie est toujours délicate à caractériser (Duval et al. 1990). Exceptés les sites de Jastres sud (Lefebvre 2006)), Ruoms (Durand 2008), Cas-teljau (Lhomme 1971, Durand 2001), Les Plan-tades/Les Bruyères (Gilles 1976, Durand 2008) et Ranc Pointu (Durand 1996), très peu de sites contemporains des Ferriers sont actuellement reconnus (Durand 2001 et 2007). Plus globa-lement, la présence de ce site « sidérurgique » place et confirme que cette région devait être au centre ou du moins parfaitement insérée dans un réseau d’échanges entre sites (entre les oppi-dums de Casteljau, Ranc Pointu et Alès) et entre peuples préromains (Helviens, Volques Areco-miques, Gabales, Vellaves…). La cartographie et un schéma d’organisation du territoire à la fin du 2e âge du Fer, encore théorique, commencent même à se dessiner (Kurzaj 2012).
Eric DURAND (1) (dir.)
Collaboration : Valentina BELLAVIA,Céline GALtIER, Julia GENECHESI,
Bernard GRAtUzE, Guillaume HULIN,Sylvie COUSSERAN-NéRé, Dominique LALAï,Sophie MARtIN, Romain MENSA, Eric NéRé,
Gaspard PAGèS, André REBISCOUL,Pierre RIGAUD, Joëlle ROLLAND,Christine RONCO, Sylvie SAINtOt
1 - Inrap Rhône-Alpes, Valence, UMR 5140.
15
Bibliographie
Berranger, Fluzin 2007 : BERRANGER M., FLUZIN Ph. - Organisation de la chaîne opératoire en métallurgie du fer aux IIe-Ier siècles av. J.-C., sur l’oppidum d’Entremont (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) : la circulation du métal, ArchéoSciences [En ligne], 31 | 2007, mis en ligne le 31 décembre 2009. URL : http://archeosciences.revues.org/index547.html.
Clément 2003 : CLEMENT N. - L’occupation du sol sur la commune de Grospierres de l’Antiquité au haut Moyen Age, Grou Peïro, les nouveaux cahiers du Grospierrois, 5, 2003, p.16-23.
Dedet et Salles 2013 : DEDET B., SALLES J. - L’Ermitage d’Alès, Gard : un oppidum-marché du Ier s. av. J.-C. et la question des antécédents de la voie cévenole. In : OLMER F. dir., Itinéraires des vins romains en Gaule (IIIe - Ier siècles av. J.-C.). Confrontation de faciès. Actes du colloque européen organisé par le CNRS, Lattes, 2007. CNRS, Lattes, 2013, p. 23-38 (Monographies d’Archéologie Méditerranéenne, Hors-série 5).
Durand 1996 : DURAND E. - L’éperon barré du Ranc Pointu à Saint-Martin-d’Ardèche (VI-Ier s. av. n. è.), Ardèche Archéologie, 13, p. 62-70.
Durand 2000 : DURAND E. - L’habitat perché et fortifié des Conchettes (Grospierres) au Ve et au début du IVe siècle avant notre ère, Les nouveaux cahiers du Grospierrois, 4, p.1-16.
Durand 2001 : DURAND E. - L’Ardèche à la fin de l’âge du Bronze et aux âges du Fer (IXe siècle - Ier siècle avant notre ère) », In : Carte archéologique de la Gaule, Ardèche, dir. Dupraz J., Fraisse C., p. 70-81.
Durand 2008 : DURAND E. - La fin de l’âge du Bronze et les âges du Fer, in RAIMBAULT M. dir. De la Dent de Retz aux Gorges de l’Ardèche, histoire d’un territoire, SGGA, éd. Du Chassel, p. 178-188.
Duval, Morel, Roman dir., 1990 : DUVAL A., MOREL J.-P., ROMAN Y. dir - Gaule interne et Gaule méditerranéenne aux IIe et Ier siècles avant J.-C. : Confrontations chronologiques, Actes de la table ronde de Valbonne (11-13 novembre 1986), Revue archéologique de Narbonnaise, Supplément 21, CNRS, Paris, 349 p.
Elmi et al. 1988 : ELMI S., BROUDER P., BERGER G., GRAS H., BUSINARDO R., BERARD P. et VAUTRELLE C. - Carte géologique de Bessèges au 1/50 000 (n° 888). Bureau de recherches géologiques et minières, Orléans, 1988.
Ferber 2004 : FERBER E. - Vallon-Pont-d’Arc, Mas de Boulle 5, rapport de diagnostic, Inrap, SRA Rhône-Alpes, 14 p., 7 pl.
Feugère, Py 1989 : FEUGERE M., PY M. - Les bracelets en verre de Nages (Gard), les Castels, fouilles 1958-1981. In : FEUGERE M. dir. - Le verre préromain en Europe occidentale. Montagnac : Editions Monique Mergoil, 1989, p. 153-167.
Feugère, Py 2011 : FEUGERE M. et PY M. - Dictionnaire des monnaies découvertes en Gaule méditerranéenne (530-27 avant notre ère). Villefranche-de-Rouergue, Ed. Monique Mergoil et Bibliothèque nationale de France, 2011, 720 p.
Fluzin et al. 2000 : FLUZIN P., PLOQUIN A. et SERNEELS V. - Archéométrie des déchets de production sidérurgique, In : Domergue, C. et Leroy, M. (ed.), Mines et métallurgie en Gaule, recherches récentes, Gallia, 57, Paris, CNRS éditions, 2000, p. 101-121.
Fournier et Milcent 2007 : FOURNIER L., MILCENT P.-Y. - Actualité des recherches sur l’économie du fer protohistorique dans la région Centre, In : Milcent P.-Y. (dir.), L’économie du fer protohistorique : de la production à la consommation du métal. Actes du XXVIIIe colloque de l’AFEAF, Toulouse, 20-23 mai 2004, Bordeaux, Aquitania, supplément 14/2, 2007, p. 85-105.
Gebhard 1989 : GEBHARD R. - Pour une nouvelle typologie des bracelets celtiques en verre. In : FEUGERE M. dir. - Le verre préromain en Europe occidentale. Montagnac, Editions Monique Mergoil, 1989, p. 73-83.
16
Genechesi 2012 : GENECHESI J. - Les monnayages gaulois et marseillais découverts en vallée du Rhône : circulation monétaire et approche économique. Thèse de doctorat soutenue à l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne. Paris, 2012, 3 vol., 730 p.
Genechesi 2013 : GENECHESI J. - Les monnaies préaugustéennes découvertes en Ardèche, Ardèche Archéologie, 30, p. 72-77.
Gilles 1976 : GILLES R. - Deux sites de La Tène III dans la basse vallée de l’Ardèche, dans Etudes Préhistoriques, 13, 1976, p. 41-48
Gratuze 2013 : GRATUZE B. - Glass Characterisation Using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Methods. In : JANSSENS K. dir. - Modern Methods for Analysing Archaeological and Historical Glass, Editions John Wiley & Sons Ltd, vol 1, chap 3.1, 2013, p. 201-234.
Gros 2003 : GROS O., GROS A.-C. - Quelques sites paléolithiques inédits ou peu connus de Grospierres et Vagnas, Ardèche Archéologie, 20, 2003, p.5-13.
Gros 2007 : GROS O., GROS A.-C. - Un habitat ferrières de hauteur : l’éperon des Conchettes, Ardèche Archéologie, 24, 2007, p.11-13.
Haevernick 1960 : HAEVERNICK T.E. - Die glasarmringe und ringperlen der Mittel - und spätLatènezeit auf dem europäischen Fesland. Bonn : R. Habelt, 1960.
Kurzaj 2012 : KURZAJ M.-C. - Peuplements et échanges entre Gaule interne et Gaule méditerranéenne dans le sud-est du Massif central à la fin du second âge du Fer (160-25 av. J.-C.), thèse de doctorat, Université de Bourgogne, 3 vol., 614 p.
Lefebvre 2006 : LEFEBVRE C. - Oppida Helvica, les sites fortifiés de hauteur du plateau de Jastres (Ardèche), Gallia Romana VII, éd. De Boccard, 2006, 487 p., 170 fig., 10 annexes.
Lhomme 1971 : LHOMME G. - La surveillance des travaux du village de Casteljau. Bull. A.M.L., 1971, p. 52-53.
Martin S. et Magnin 2010 : MARTIN S., MAGNIN F. Du paléoenvironnement au paléopaysage : peut-on reconstituer les paysages anciens et leur évolution à partir de données paléoécologiques ? Apports l’analyse malacologique dans un paysage actuel méditerranéen (Sud-Est la France), In : D. Galop (éd.), Paysages et Environnement. De la reconstitution du passé aux modèles prospectifs, éd. Presses universitaires de Franche-Comté, Annales Littéraires ; Série « Environnement, sociétés et archéologie », Besançon, p. 81-96.
Matal 2002 : MATAL M. - Etude du mobilier céramique du Ier siècle avant notre ère d’Alba (Ardèche) : chronologie et faciès culturels. Revue Archéologique de Narbonnaise, 35, 2002, p.371-400.
Pagès 2014 sous presse : PAGES G. - Productions, commerces et consommation du fer dans le sud de la Gaule de la Protohistoire à la domination romaine, Gallia, 2014 sous presse.
Tendille 1978 : TENDILLE C. - Fibules protohistoriques de la région nîmoise, Document d’Archéologie Méridionale 1, 1978.
Ronco 2012 : RONCO C., coll. DURAND E., REBISCOUL A. - Grospierres, Les Ferriers (Ardèche), rapport de diagnostic, Inrap, SRA Rhône-Alpes, 82 p. 11 fig.
Vial 2011 : VIAL J. - Les Volques Arécomiques et le Languedoc oriental protohistorique. Etude d’une entité ethno-politique préromaine (IXe-Ier s. av. J.-C.). Lattes, Edition de l’Association pour le Développement de l’Archéologie en Languedoc-Roussillon, 2011, 282 p. (Coll. Monographies d’Archéologie Méditerranéenne, 30).
Vital et alii, 2012 : VITAL J., CONVERTINI F., LEMERCIER O. et coll. Composantes culturelles et premières productions céramiques du Bronze ancien dans le sud-est de la France. Résultat du PCR 1999-2009. BAR International Séries 2446. 2012. 2 vol : vol., I : 262 p., 191 fig. ; II : 468 p., 164 pl., 190 tabl.