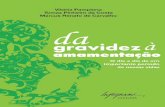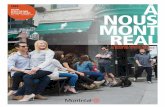"La diffusion de l'islam à Mayotte à l'époque médiévale"
Transcript of "La diffusion de l'islam à Mayotte à l'époque médiévale"
63
La diffusion de l’islam à Mayotteà l’époque médiévale 1
parMartial Pauly
L’archipel des Comores est un ensemble d’origine volcanique composé de quatreîles en guirlande (avec d’ouest en est, la Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte)localisées à l’entrée nord du canal du Mozambique, entre l’Afrique et Madagascar.Mayotte, la plus orientale, se distingue culturellement des autres îles pour être la seule àposséder une importante communauté parlant un dialecte malgache (le ki-bushi) lorsqueles autres parlers de l’archipel (le shi-ngazidja, le shi-mwali, le shi-ndzuani et leshi-maore) sont des langues bantoues 2. Cet archipel compte parmi les régions del’océan Indien les plus méridionales atteintes lors de l’expansion de l’islam. L’islampratiqué aujourd’hui dans l’archipel est majoritairement sunnite, de rite chaféite, ets’inscrit dans le même ensemble culturel que le monde swahili. La diffusion de l’islamdans l’océan Indien occidental est intimement liée aux réseaux commerciaux reliant leMoyen-Orient à l’Afrique et dont la trame est tissée dès le début du premier millénairede notre ère. Si les contacts avec des marins islamisés s’effectuent ainsi dès les premierssiècles de l’Hégire, l’islamisation de l’Afrique orientale demeure, au Moyen Âge, unlent processus : cette religion, sans prosélytisme, est avant tout élitiste, et participe à ladistinction de l’aristocratie swahilie. Il en va de même à Madagascar où les Malgachesislamisés antalaotsy, qui contrôlaient les comptoirs commerciaux du nord-ouest deMadagascar 3, n’encouragèrent pas la diffusion de l’islam parmi les populations del’intérieur. Longtemps, les communautés musulmanes sont donc restées minori-taires, disséminées dans des ports stratégiques pour la maîtrise du commerce tandisque la masse de la population, potentiel réservoir d’esclaves 4, conservait ses proprescroyances dont certainement l’animisme.
1 Nous rejoignons le point de vue de Stéphane Pradines sur la nécessité de sortir du cadre “période archaïque”, “période classique”fixé par Pierre Vérin (Pradines 2011). Le passé de Mayotte s’inscrit totalement dans le cadre du Moyen Âge oriental. La date del’irruption des Portugais dans l’océan Indien à partir de 1498 et les bouleversements politiques qui s’ensuivirent doivent êtreretenus pour les débuts de l’époque moderne dans l’océan Indien.
2 Le nombre de locuteurs du shi-maore, langue bantoue apparentée au swahili, a considérablement progressé ces dernières décennies.À l’inverse, les dialectes malgaches de Mayotte (ki-bushi et ki-antalaotsy), qui représentaient jusqu’à 40 % des locuteurs à Mayotteà la fin des années 1970, sont en net recul.
3 Avant le XVIe siècle, il existe également des comptoirs contrôlés par des islamisés à la côte orientale de Madagascar, Vohemar,occupé dès le XIIIe/XIVe siècle, étant le plus important.
4 En théorie, un musulman ne peut avoir un coreligionnaire comme esclave. Mais dans la pratique, la règle semble avoir été moinsstricte qu’il n’y paraît et les esclaves pouvaient adhérer à l’islam. Peut-être faut-il voir ici l’explication de la difficulté pour lesarchéologues de rencontrer des sépultures d’esclaves alors que les sources historiques assurent que la masse servile représentaitplus de la moitié de la population.
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page62
l’île. Plus récemment, de nouveaux éléments ont été apportés par la recherche archéo-logique et permettent de renouveler notre approche de cette question. D’importantesdécouvertes archéologiques tant dans les pratiques funéraires que dans l’archi-tecture religieuse ont été réalisées. Il sera notamment ici question de déterminersi l’islam est présent dès les origines du peuplement à Mayotte (à savoir le IXe sièclede notre ère) ou s’il y a eu un processus d’acculturation avec diffusion de cette religiondans une société pré-islamique dont les croyances seraient alors à déterminer.
Après avoir rappelé le contexte historique de la diffusion de l’islam en Afriquede l’Est, nous présenterons les données archéologiques actuelles documentant ceprocessus à Mayotte.
I
LA DIFFUSION DE L’ISLAM EN AFRIQUE ORIENTALE
a. Des contacts anciens entre le Moyen-Orient et l’Afrique orientalemais une islamisation diffuse avant le XIe siècle
Dès les premiers siècles de notre ère, les auteurs gréco-romains ont connaissancedu littoral d’Afrique de l’Est qu’ils nomment Azania pour la partie située entre le“cap des épices” (Ras Hafun en Somalie) et le “cap Prason” (cap Delgado à lafrontière entre la Tanzanie et le Mozambique). Ces connaissances géographiquesont été collectées auprès de marchands qui acheminent depuis ces régions éloignéesdes produits très prisés comme l’ivoire, les peaux de panthère et l’écaille de tortue.Le port de Rhapta, que l’on pense situé dans le delta du fleuve Rufiji enTanzanie, serait la localité la plus méridionale connectée à ce réseau commercialde l’Antiquité 5.
Écrit au Ier siècle de notre ère par un marchand grec d’Alexandrie, le Périple de lamer Érythrée dresse ainsi une description très complète des marchandises échangéesdans les comptoirs d’Afrique de l’Est. On y apprend que ces comptoirs sont essentiel-lement fréquentés par des Arabes mopharites (Yéménites). Ceux-ci entretiennentdes liens avec les populations africaines, parlant leur langue et en concluant desinter-mariages, engageant ainsi un processus qui conduira plus tard à l’élaboration
5 CHAMI, 1998.
65
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
La question de l’islamisation de Mayotte n’a longtemps été développée qu’à partirde sources écrites tardives fournies par les traditionalistes. Ces écrits, datant pour laplupart de la période coloniale et dont le plus ancien est la chronique du cadi OmarAboubacar de 1865, étaient très peu diserts sur l’islamisation de l’île. Par idéologie,ces écrits faisaient des sultans shirâzi les introducteurs des us et coutumes arabes(ustaarabu) même s’ils reconnaissaient l’islamisation des chefs (les fani) qui précé-dèrent le sultanat. Ainsi, Tsingoni, ancienne capitale de Mayotte du XVIe auXVIIIe siècle, est couramment présentée comme le point d’arrivée de l’islam dans
64
Taãrifa N°4
L’Afrique orientale et l’océan Indien.
L’archipel de Lamu (Kenya). Le nord-ouest de Madagascar et les Comores.
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page64
découvertes à Zanzibar sur le site d’Unguja Ukuu semblent privilégier cette locali-sation 11. Ce site décline au Xe siècle, or selon le témoignage d’Ibn Lakis rapporté parBorzog ibn Shahriyar dans Le livre des Merveilles de l’Inde, Qanbalu est attaquéen 946 par les pirates Waqwaq 12 qui viennent de conquérir des îles du canal duMozambique après un voyage d’un an depuis les régions voisines de la Chine. Avec lastèle de Kancana à Java, datée de 860, et qui indique comme populations soumises lemot “jenggi” (qui viendrait de l’arabe zendj), ces informations de première importancesituent la migration austronésienne dans le canal du Mozambique au cours desIXe-Xe siècles.
Au Xe siècle, le littoral africain n’est alors que sporadiquement islamisé, l’islamne se limitant qu’à quelques familles établies dans les principaux comptoirs commer-ciaux comme à Qanbalu, où selon Masundi : « Les pilotes d’Oman traversent lamer de Berbera pour atteindre l’île de Qambalu, qui est dans la mer des Zanj. Sapopulation est un mélange de Musulmans et de Zanj idolâtres. [...] Une de ces îles quiest à un ou deux jours de navigation de la côte, a une population musulmane et unefamille royale. C’est l’île de Qambalu que nous avons déjà évoquée » 13. Ibn Hawkal,toujours au Xe siècle, précise également que les Zendjs adorent de nombreux dieux etidoles.
La plus ancienne évocation d’une conversion d’un roi africain à l’islam estfournie par Borzog ibn Shahriyar dans son ouvrage Le livre des Merveilles de l’Inde,où il rapporte l’histoire d’un navire omanais qui, se rendant à Qanbalu, est déportépar une tempête jusqu’à Sofala. Là, l’équipage qui craignait d’être dévoré par desanthropophages est finalement bien reçu par un roi africain qui les autorise àcommercer chez lui librement. Après avoir échangé leurs marchandises contre desesclaves, le temps du départ arrive. Alors que le roi rend en ami une dernière visiteaux marins sur le navire, ceux-ci s’emparent de lui et décident de le vendre commeesclave en Oman. Après de longues péripéties, et devenu musulman, le roi va parvenirà regagner son royaume. Le hasard conduit quelques années plus tard l’équipage àatteindre à nouveau la contrée de ce roi. Celui-ci les reconnaît mais décide de leuraccorder son pardon, n’était-il pas devenu musulman grâce à eux? Ce témoignagerévèle comment, par contact avec des marins du golfe Persique, l’aristocratie localeafricaine adopte l’islam. Ce processus d’islamisation par le “haut” de la société estgénéral au monde swahili.
Les plus anciens témoignages archéologiques d’islamisation s’inscrivent dans cecontexte. La plus ancienne mosquée d’Afrique de l’Est a été mise au jour par MarkHorton sur le site de Shanga, dans l’archipel de Lamu, au Kenya. Celle-ci comporteplusieurs phases de construction dont la plus ancienne remonterait au IXe siècle.Des structures en torchis, datant du VIIIe siècle, ont été mises au jour, mais il n’y apas de certitude sur une interprétation comme mosquée primitive (HORTON, 1996).À Chibuene, au sud de Sofala (Mozambique), une sépulture musulmane associée àdes niveaux du IXe siècle a été identifiée par Paul Sinclair 14 : c’est le témoignage leplus méridional de la présence de l’islam dans le canal du Mozambique 15.
11 JUMA, 2004.12 Le peuple waqwaq est également localisé par les géographes arabes dans l’actuelle Indonésie. Le terme se rapproche du malgachevahoaka qui signifie “peuple”. Ce texte arabe du Xe siècle est une preuve très sérieuse de l’arrivée de proto-malgaches dans lecanal du Mozambique.
13 FREEMAN-GRENVILLE, 1962.14 SAINCLAIR, 1987.15 L’annonce faite en 2010 par le professeur Chami et son équipe, selon lesquels une mosquée du VIIe siècle avait été découverte
67
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
de la civilisation swahilie 6. Plus tard, entre les IIIe etVIe siècles, le royaume chrétien d’Axoum contrôle lesréseaux commerciaux entre la mer Rouge, l’Inde etl’Afrique : en 525, le marchand grec Comas Indico-pleustes atteint Ceylan après une escale à Axoum 7. À lamême époque, l’empire sassanide unifie le golfe Persiquedont les ports de Siraf et Sohar deviennent les princi-pales plaques tournantes du commerce avec l’Inde etplus tard l’Afrique.
Les conquêtes arabes suspendent un temps lesrelations commerciales avec l’Afrique qui s’intensifientà nouveau à partir du IXe siècle. Les sources écritesmentionnent une présence permanente de musulmansdans les comptoirs d’Afrique orientale qui accueillentdès le VIIIe siècle des groupes musulmans dissidentscomme les Zaïdites yéménites ou les Ibadites d’Oman.Les révoltes des esclaves zendjs aux VIIIe et IXe sièclesdans le Bas-Irak attestent de l’importance de la traitearabe en Afrique orientale dès le VIIIe siècle.
Diffusion de l’islam et commerce maritime sem-blent ainsi liés : aux IXe-Xe siècles, les productions dugolfe Persique comme les jarres à glaçure bleue ont étéretrouvées jusqu’au site de Chibuene 8 au sud de la baiede Sofala au Mozambique, aux Comores et à Irodo 9,au nord-est de Madagascar. La suprématie des mar-chands du golfe Persique se retrouve dans les écritscontemporains : en 916, Masundi, dans son ouvrage LesPrairies d’Or, évoque les pilotes d’Oman qui se rendentjusqu’au pays des Zendjs (actuels Kenya et Tanzanie)et au pays de Sofala (Mozambique). Ces marins, enatteignant Madagascar, découvrent des espèces aujour-d’hui disparues comme le grand ratite (l’æpyornis) quialimente les légendes de l’oiseau Rokh présent dansle récit des voyages de Sindbad le marin (IXe siècle).
Le dernier comptoir du pays des Zendjs fréquentépar les marchands islamisés se situe alors sur l’île deQanbalu où règne un roi musulman. La localisation deQanbalu est sujette à controverse 10, mais les récentes
6 Le terme de “proto-swahilie” est retenu pour qualifier la civilisation de la côte est-africaine avant les premiers contacts avec des islamisés.
7 Jean-Claude Hébert a avancé la possibilité d’un peuplement chrétien monophysiteaux Comores (HÉBERT, 2011), mais rien ne permet aujourd’hui de confirmer cettehypothèse improbable.
8 SINCLAIR, 1987.9 BATTISTINI, VERIN., 1967.10 Selon les auteurs, Qanbalu est soit sur l’île de Pemba, soit à Zanzibar ou aux
Comores. Peut-être que Qanbalu, dont la graphie arabe est très proche de “UngujaUkuu” (comme toujours en changeant les points diacritiques selon l’erreur decopiste courante), privilégierait plutôt Zanzibar. Toutefois, “Unguja” signifiant“l’escale”, ce toponyme a pu probablement désigner plusieurs comptoirscommerciaux contemporains.
66
Taãrifa N°4
Exemples de céramiquesde la période abbassidesassano-islamique à glaçurebleue (IXe-Xe siècles).De haut en bas :- exemplaire provenantde Dembéni (Mayotte) ;- jarres complètes exposées aumusée du Louvre et provenantdes fouilles de Suse. Produitesà Siraf et Basra (golfe Persique),elles servaient à l’exportationde denrées périssablessous le califat abbasside.- fragment de lampe à huileavec anse (céramique à glaçureopaque blanche et alcalinebleue) IXe/Xe siècle, Dembéni,prospection H. D. Liszkowski(© M. Pauly).
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page66
sunnite chaféite. C’est au cours du XIIIe siècle que l’islam sunnite chaféite se diffuselargement en Afrique orientale : Ibn-Al-Mujawir signale ainsi à cette époquel’existence d’une école chafii à Kilwa. En 1331, le sunnisme chaféite est devenu larègle lorsque Ibn Battuta séjourne en Afrique de l’Est et visite Mogadiscio, Mombasaet Kilwa.
Cette conversion de l’Afrique de l’Est à l’islam sunnite chaféite résulte d’unbouleversement politico-religieux qui trouve son origine en Égypte puis au Yémen: auXIIe siècle, la dynastie des Ayyûbides succède aux Fatimides. Le sunnisme chaféiteremplace désormais le chiisme ismaélien des Fatimides. En conquérant le Yémen, lesAyyûbides restaurent également le sunnisme parmi ses élites. Le Yémen joue à cetteépoque un rôle important dans les échanges avec l’Afrique orientale : une céramiqueproduite au Yémen entre 1250 et 1350, la mustard ware aussi appelée “noire et jaune”,caractérisée par des bols à glaçure jaune décorés de lignes entrelacées noires, a étérencontrée par les archéologues dans tout l’océan Indien occidental. Les changementsreligieux au Yémen auraient eu des répercussions en Afrique orientale sous l’impulsionde la dynastie des princes yéménites rassûlides et à la faveur de ces courants commer-ciaux. Cette suprématie nouvelle des clans yéménites et hadrami en Afriquede l’Est est à l’origine de révolutions comme celle qui renverse le dernier sultan de ladynastie shirâzi de Kilwa au profit de la nouvelle dynastie yéménite des Madhali àla fin du XIIIe siècle 16. Désormais, l’Afrique orientale adopte majoritairement laconfession sunnite chaféite.
d. Un conservatisme religieux chiite aux Comores?
Aux Comores, il en est autrement, car bien après l’adoption en Afrique de l’Est dusunnisme chaféite, l’islam chiite serait encore présent, ce qui laisse envisager uncertain conservatisme religieux chiite aux Comores. En effet, en 1427, l’inscription dela mosquée du Vendredi de Moroni présente encore une invocation chiite requérantla protection d’Ali et de sa famille 17.
De la même manière, certains noms de chefs de Mayotte (appelés fani), figurantdans des prières les invoquant, portent le titre de pir qui, comme l’a observé ClaudeAllibert, désigne les chefs des confréries soufies dans les sphères chiites 18. Ceséléments fournissent un faisceau d’indices attestant que l’islam chiite étaitencore bien présent aux Comores, plus d’un siècle après la conversion de l’Afrique del’Est à l’islam sunnite chaféite. Pourtant, selon le témoignage de Piri Reis, quireprend des sources portugaises datées du premier quart du XVIe siècle, l’islamsunnite chaféite est désormais lui aussi généralisé aux Comores : « Ils sont chafii,en eux, point d’hypocrisie » 19. C’est donc que la mutation religieuse entraînantla conversion des élites comoriennes au sunnisme chaféite se serait opérée au coursdu XVe siècle.
L’arrivée de clans shirâzi sunnites originaires de l’Afrique swahilie, et l’établisse-ment des sultanats qui s’ensuivit 20 y seraient certainement pour beaucoup : ils auraiententraîné chez les élites comoriennes leur conversion au sunnisme chaféite, certes,
16 CHITTICK, 1974.17 BLANCHY, SAÏD, 1989.18 ALLIBERT, 1984.19 ALLIBERT, 1989.20 PAULY, 2010.
69
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
b. L’héritage shirâzi en Afrique orientale
Un mythe est partagé par l’ensemble du monde swahili, revendiqué par des groupesethniques différents, y compris de Madagascar (Malgaches islamisés antalaotsy). Cemythe conte la migration de sept princes shirâzi dans sept boutres, chaque escale enAfrique orientale aboutissant à la création d’une cité commerçante. Ceux-ci auraientégalement donné naissance aux lignages aristocratiques gouvernant les cités swahilies.Voici par exemple comment ce mythe est retranscrit dans la chronique de Kilwa datéedu XVIe siècle : « Il arriva un navire dans lequel il y avait des personnes qui expliquè-rent qu’ils venaient de Shiraz dans le pays des Perses. Il est dit qu’il y avait sept navires :le premier s’arrêta à Mandakha ; le second à Shaugu ; le troisième à une ville nomméeYanbu; le quatrième à Mombasa, le cinquième à l’Île Verte [Pemba] ; le sixième au paysde Kilwa ; et le septième à Hanzuan. Ils dirent que tous les maîtres de ces six premiersnavires étaient frères, et que celui qui alla à la ville d’Hanzuan était leur père. SeulAllah connaît toute la vérité ! » (FREEMAN-GRENVILLE, 1962 : 35, traduit de l’anglais).
Derrière ce mythe fondateur de la civilisation swahilie, les chercheurs s’accordentaujourd’hui à y reconnaître la mémoire, en Afrique orientale, d’une plus large influenceculturelle du Golfe persique, aux Xe-XIIe siècles, (HORTON, 1996, 2000) voire la présenced’une diaspora chiite parmi les principales cités commerçantes swahilies (PRADINES,2009). Alors que d’autres communautés musulmanes sont présentes en Afrique del’Est, comme les Ibadites, ou les Qarmates ismaéliens, c’est la seule référence aux Shirâziqui a été retenue par les lignages aristocratiques swahilis comme référent idéologique,peut-être, selon Horton, du fait du plus grand prestige culturel de royaume buyaïdedont Shiraz était la capitale.
Toutefois, des monnaies frappées en Afrique orientale, comme celles du trésormonétaire de Mtambwe (île de Pemba), confirment l’existence de deux dynasties (dontcelle du Shirâzi al-Hassan) contrôlant les principaux comptoirs swahilis entre 1000et 1200 (Horton, 2000:58). Ces monnaies, inspirées du monde fatimide, comportent desinscriptions révélant une influence chiite. D’autres indices sont conservés dans l’archi-tecture religieuse, notamment les mihrabs qui, à partir du XIe siècle, présentent unedécoration beaucoup plus élaborée.
Aux Xe-XIIe siècles, l’Afrique de l’Est connaît ainsi un vaste mouvement d’urbani-sation avec développement de l’architecture en pierre de corail : mosquées, habitationsaisées, remparts utilisent des techniques de construction directement inspirées de cellesdu Moyen-Orient avec utilisation de grandes briques de corail taillé. L’architecture desmosquées est également très proche de celle décrite sur les sites médiévaux du Yémenet de l’Hadramaout, ainsi à Sanjé-ya-Kati, Stéphane Pradines (PRADINES, 2009) a relevédes parallèles architecturaux avec le site de Sharma en Hadramaout, port égalementoccupé aux Xe-XIIe siècles par des marchands persans (ROUGEULLE, 2004).
c. Bouleversements politico-religieux en Afrique orientale :du chiisme au sunnisme chaféite
Au cours du XIIIe siècle, ces communautés musulmanes du littoral africain vontconnaître un vaste bouleversement religieux, abandonnant le chiisme pour l’islam
16 à Ntsaweni en Grande Comore, a certes fait un grand bruit médiatique, mais n’a jamais été depuis démontrée ! Au contraire, lemémoire d’Ibrahim Moustakim présente une datation C14 du XIIe siècle pour les plus anciens niveaux antérieurs à la premièremosquée (MOUSTAKIM, 2012).
68
Taãrifa N°4
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page68
Si l’intégration de Dembéni aux réseaux du commerce maritime de l’océanIndien est acquise (il est à souligner la quantité surprenante d’importations sur ce sitequi placent Dembéni parmi les principaux ports médiévaux d’Afrique orientale),rien n’y apporte à ce jour la preuve de l’acceptation de l’islam. Si en 2000, dessoubassements de blocs de corail non maçonnés ont été repérés lors d’un décapagesuperficiel (BEL-HAMISSI Abdou, 2000), l’interprétation de cette structure commeéventuelle mosquée (compte-rendu Inrap, 2000) est certainement prématurée. Laconnaissance des pratiques funéraires à Dembéni fait encore défaut si bien queparadoxalement, et malgré son importance, Dembéni demeure un site dont nousn’avons qu’une connaissance partielle et lacunaire 25.
b. Bagamoyo 26 (Petite-Terre), nécropole musulmane dès le IXe siècle?
Le cordon littoral, à l’ouest de Petite-Terre, du boulevard des Crabes aux Bada-miers, était jadis occupé par une dune de sable. Les travaux de construction de ladigue du boulevard des Crabes vers 1850, reliant Dzaoudzi à l’île de Pamandzi,modifièrent l’hydrographie de la vasière de Fongoujou. Pour éviter les risquesd’inondation comme en 1927, trois chenaux furent percés dans cette ancienne duneau cours du XXe siècle 27 afin de faciliter l’évacuation de l’eau à marée basse.L’urbanisation de Petite-Terre se réalisa au détriment de cette dune dont le sable futtotalement prélevé. Cette dune était encore partiellement visible lorsqu’Allibertet les époux Argant y entreprirent des prospections puis une campagne de fouillearchéologique à partir de 1979. Outre la mise en évidence de zones à sépultures,cela fut l’occasion de fouiller un ancien four à chaux dont le couvercle (le vase deBagamoyo) est une pièce maîtresse des collections archéologiques de Mayotte 28. Lesprospections permirent de recueillir un matériel important : tessons de céramiquesassano-islamique, sgraffiatos persans, fragments de marmites en chloritoschiste,attestant d’une occupation comprise entre les Xe et XIIIe siècles. Une sépulturesituée entre le boulevard des Crabes et Mirandole fournit des ossements datés duXIIe siècle par analyse RC14.
Ce site majeur fit l’objet d’une publication en 1983 mais les renseignements surles sépultures sont très succincts (ALLIBERT, ARGANT, 1993). Dans une publication de
24 - Madagascar, introduction d’espèces malgaches comme l’escargot achatina, le lémurien et la tortue terrestre. Cependant, s’il ya bien eu production métallurgique à Dembéni, on ne peut être aussi catégorique pour affirmer qu’il s’agisse ici de fours detechnologie austronésienne. Néanmoins, le four à chaux étudié à Bagamoyo, avec son célèbre couvercle portant des décorstypiques de la tradition Dembéni possédait une ventilation forcée caractéristique de technologie austronésienne avec souffletsverticaux à pistons. Selon cette argumentation, Dembéni serait à interpréter comme étant une localité dominée par desAustronésiens qui s’assurèrent ainsi la maîtrise du commerce entre Madagascar et le « couloir swahili ». Dans ce cas également,l’aristocratie malgache présente à Dembéni pourrait ne pas être encore islamisée. Cette hypothèse éclaire les arguments desprécédentes : d’une part, ces Malgaches, minoritaires, auraient fait venir d’Afrique des populations bantoues comme esclaves– en 946, Ibn Lakis rapporte que l’attaque de Qanbalou par les Waqwaq est motivée en partie par la recherche d’esclaves.D’autre part, l’exportation de produits malgaches comme le quartz hyalin très prisé par les ateliers égyptiens fatimides du Xe
siècle, l’écaille de tortue marine, et les lingots de fer produits à Dembéni, échangés auprès de commerçants persans quis’aventuraient occasionnellement au-delà de Qanbalou, expliqueraient l’importance stratégique de Mayotte comme comptoirentre Madagascar et la côte swahilie.
25 Cette année 2013, les fouilles ont repris à Dembéni sous la direction de Stéphane Pradines. Si les structures de l’enclos ont puêtre dégagées, rien n’a encore permis d’attester de la pratique de l’islam.
26 Le toponyme Bagamoyo n’apparaît sur aucune carte ancienne. Jusqu’en 1927 et la création du village de Labattoir, les habitantsvivaient au pied de la colline de Mirandole qui portait alors le nom de Pamandzi Keli. Claude Allibert qui a mené la premièreétude de ce site en 1977 l’a ainsi spontanément appelé Pamandzi Keli. Après un entretien auprès du vieillard Bakar Mlatamuen 1979, celui-ci lui expliqua que l’espace compris entre Dzaoudzi et Polé portait jadis le nom de Bagamoyo. C’est ce nom quifut finalement retenu dans les publications. Ce toponyme est également celui d’un port de traite tanzanien d’où les esclavesétaient embarqués pour Zanzibar.
27 Le raz de marée qui causa l’évacuation du vieux Pamandzi en 1927 (colline de Mirandole) est certainement dû à un cyclone quiprovoqua une montée des eaux et l’inondation de ce secteur, si bien que l’on jugea utile de percer ces chenaux pour prévenir uneautre inondation. Près des déversoirs ou tombolos, le grès marin conserve les traces d’un engin à chenille utilisé durant cestravaux.
28 Plus récemment, Claude Allibert a pu faire dater par analyse RC14 une vertèbre de poisson associée au sédiment de colmatage
71
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
non sans heurt, puisque certaines traditions, comme celle de Tsingoni (Chroniquede Tsingoni de Cheik Adinani, 1965), rapportent de graves discordes survenues entreles nouveaux sultans shirâzi et certaines élites refusant de se convertir, prônant l’adage« Quand quelqu’un a appris le Coran, il fait la prière jusqu’à la mort » 21. Cetteanecdote montre que, si Tsingoni est un lieu important pour l’introduction de l’islamà Mayotte, c’est uniquement dans le contexte du passage de l’islam chiite à l’islamsunnite chaféite sous l’impulsion du nouveau sultanat shirâzi. Cet établissement dessultanats shirâzi à la fin du XVe siècle marque ainsi la fin du conservatisme reli-gieux aux Comores et l’adoption du sunnisme chaféite qui est encore pratiquémajoritairement aux Comores aujourd’hui.
II
L’ISLAMISATION DE MAYOTTE: LES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES
a. Dembéni, site islamique?
Le premier peuplement de Mayotte, tel qu’il est attesté à ce jour 22, s’inscrit aucours du IXe siècle, durant la phase culturelle dite de Dembéni (IXe-XIIe siècle). Cegrand site archéologique éponyme, occupé jusqu’au XIIe siècle, est situé sur leshauteurs de Tsararano et surplombe l’une des plaines côtières les plus fertiles de l’île.Si tous les chercheurs qui ont étudié ce site depuis sa découverte en 1977 23 s’accor-dent sur son importance, il n’est encore documenté que par de rares opérationsarchéologiques et son interprétation est toujours sujette à controverse 24.
21 GOURLET, 2001.22 En 1989, les chercheurs Fontes et Coudray, mais aussi Allibert, ont réalisé des prélèvements sur la plus ancienne strate apparaissant
sur la falaise sapée par la mer du site de Koungou à Mayotte. Deux datations RC14 de la fin du VIIIe/début IXe siècle ont étéobtenues. Calibrées aujourd’hui en prenant en compte les spécificités de l’hémisphère sud, ces échantillons se rattachent davantageau IXe siècle et sont donc à attribuer à la période Dembéni. En ce qui concerne l’annonce faite en 2010 par Félix Chami de ladécouverte dans la grotte de Malé, en Grande Comore, d’un site archéologique datant du deuxième millénaire avant J.-C., malgrél’enthousiasme suscité, celle-ci n’a jamais été confirmée depuis. Au contraire, nos recherches à Acoua ont montré que l’outillagelithique, loin de se rencontrer uniquement durant la préhistoire, était encore couramment utilisé aux XIIIe-XIVe siècles.
22 Nonobstant, un peuplement ancien reste toujours plausible puisqu’en 2010, Gommery et son équipe ont identifié dans les grottesd’Anjohibé au nord de Majunga des ossements d’hippopotame nain datés par analyse RC14 de 2000 avant notre ère et portantdes traces d’entailles (GOMMERY et al., 2011). Plus récemment, de l’industrie lithique associée à des niveaux datés de 2500 avantJ.-C. a été mise au jour dans l’abri de Lakaton’i Anja près d’Antsiranana (DEWAR, 2013). Ces découvertes attestent d’unenavigation ancienne dans le canal du Mozambique.
23 WRIGHT et al., 1984, ALLIBERT et al., 1989, 1993, DESACHY et al., 1999, 2000, PRADINES et al., 2011.24 Plusieurs hypothèses contradictoires s’opposent quant à la détermination de l’appartenance de ce site à une aire culturelle : 24 - L’abondance remarquable des productions du golfe Persique, acheminées en Afrique de l’Est par des marins persans, fait
envisager à Stéphane Pradines que le site de Dembéni pourrait correspondre au comptoir de Qanbalu cité par les écrits arabo-persans du Xe siècle (PRADINES, 2011). Cependant, les récentes découvertes à Zanzibar ont montré que le site de Unguja Ukuu(JUMA, 2004) est un meilleur candidat pour déterminer l’emplacement de cette localité que des auteurs comme Chittick etHorton envisagent sur l’île de Pemba. On s’étonnera alors, si Mayotte a reçu cette importante implantation arabo-persane, quele site de Dembéni, tout comme l’archipel des Comores, ne soit pas clairement signalé avant les écrits d’Al Idrisi au XIIe siècle.
24 - À défaut d’être une localité fondée par des marins arabo-persans, Dembéni serait une fondation de marins bantous ou swahilisfaisant office d’intermédiaires entre le monde malgache et les marchands persans. Cette thèse d’un peuplement bantou estavancée par Daniel Liszkowski (LISKOWSKI, 2008). La présence à Dembéni et sur d’autres sites médiévaux de Mayotte (Majicavo,Koungou et Longoni) de tessons de céramique TIW (Triangular Incised Ware) également appelée Tana Ware, et dont la filiationavec le monde bantou ne fait aucun doute, en est le principal argument. Cependant, bien que séduisante, cette hypothèse neprend pas en compte le fait que ces tessons (en réalité, moins d’une dizaine collectée à ce jour) seraient également des importations.À l’inverse, si le motif en chevron, très courant à Mayotte, est retenu comme un motif bantou inspiré de la TIW, une majeurepartie des productions céramiques comoriennes appartiendraient dans ce cas à l’aire culturelle bantoue. Notons que la céramiquede l’archipel des Comores présente très tôt un faciès régional qui la distingue tant des productions malgaches que bantoues deTanzanie et du Kenya puisque le décor emblématique des Comores entre les IXe et XIIIe siècles est composé d’impressions ducoquillage anadara erythraeonensis également appelé par Wright arca shell. Ce décor se rencontre occasionnellement sur lessites médiévaux de Madagascar (Mahilaka : RADIMILAHY, 1998) et du Kenya (Manda : CHITTICK, 1984) qui étaient les régionsentretenant des liens commerciaux privilégiés avec l’archipel. À noter que les seules populations à décorer leur céramiqued’impressions de coquillage durant le premier millénaire de notre ère sont les populations du littoral nord mozambicain (traditionMonapo : SINCLAIR, 1993), nous aurions ici une filiation très sérieuse pour déterminer l’origine de ce faciès culturel comorien.
24 - Enfin, la dernière hypothèse privilégie l’interprétation proto-malgache pour Dembéni qui serait une colonie austronésiennedans le canal du Mozambique. Celle-ci est défendue par Claude Allibert qui s’appuie sur l’importance des importations enprovenance de Madagascar : marmites en pierre ollaire et quartz hyalin dont les gisements se rencontrent à la côte orientale de
70
Taãrifa N°4
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page70
Une seule sépulture faisait exception (SP51), avec un sujet inhumé sur le dos,tête au sud et pieds au nord. Cette dernière sépulture selon la première hypothèseavancée par Patrice Courtaud se rattacherait à une période pré-islamique mais aprèsanalyse RC14, celle-ci s’avéra dater de l’époque moderne 31. Il s’agirait alors, selon lecontexte historique et culturel, d’une sépulture d’esclave 32. Cette sépulture se situe au nordde la colline de Mirandole, là où Claude Allibert a recueilli des crânes dont certainsavaient les incisives limées, particularité de l’ethnie mozambicaine makwa 33.
La nécropole de Bagamoyo semble confirmer une présence musulmane àMayotte dès l’époque Dembéni : l’existence d’un matériel céramique comparable àcelui découvert à Dembéni atteste d’une contemporanéité entre ces deux sites. Demême, bien que Patrice Courtaud dans le rapport final de 2000 remette en cause sesdatations RC14 qui d’une part ne prennent pas en compte, dans leur calibrage, laspécificité de l’hémisphère sud, et d’autre part les écarts importants du taux de C14pour des sujets se nourrissant de poissons 34, la présence sur ce site de quelques tessonsde céramique à glaçure bleue de la période abbasside, dite sassano-islamique 35 etdont la production cesse avant 1050, tend à confirmer l’ancienneté de ces sépultures.Pour les datations rattachées au XIVe siècle, nous pouvons les confirmer puisquedes tessons à décors modelés, aujourd’hui bien calés en tant que fossile directeurdes XIIIe-XIVe siècles, ont été repérés à Bagamoyo. Ces données tendraient alors àconfirmer que le peuplement de Mayotte a été initié par des populations islamiséespuisque contre toute attente, les seules sépultures non-musulmanes, d’époque moderne,étaient probablement celles d’esclaves. Et alors qu’il paraissait au premier abord plussimple de découvrir des sépultures pré-islamiques à Mayotte, il s’avère que toutesles sépultures, y compris pour les périodes les plus anciennes, répondent déjà aurituel musulman. Nos recherches à Acoua, sur la nécropole d’Antsiraka Boira, ontpermis de nuancer ce postulat.
c. La nécropole d’Antsiraka Boira 36 à Acoua
Localisé au nord-ouest de la Grande-Terre, le site archéologique d’AntsirakaBoira occupe sur la pointe Kahirimtrou 37, un petit replat dominant la baie d’Acoua.Depuis 2005, les opérations archéologiques sur la commune d’Acoua ont d’abordciblé le site d’Agnala M’kiri 38, Antsiraka Boira n’ayant fait l’objet que de prospec-tions 39. Ces deux sites sont occupés simultanément avant le XIIIe siècle : lacéramique de production locale découverte dans les premiers niveaux d’occupationd’Agnala M’kiri (XIe-XIIe siècles 40) est similaire à celle retrouvée en contexte funéraire
31 Lyon-7423, âge C14 195 ±45, âge calibré selon la courbe SH Cal13, 1655-1819 après J.-C.32 Plus qu’un rituel funéraire inédit, on reconnaît ici une orientation du défunt volontairement inversée, en opposition au rituel
musulman.33 Malheureusement, le squelette de la sépulture 51 étudiée par Patrice Courtaud était partiellement conservé avec le crâne manquant.
À l’inverse, Claude Allibert a publié en 1992 l’étude de crânes retrouvés dans ce même secteur !34 Le taux de carbone14 dans l’atmosphère et dans l’océan diffère, si bien qu’un écart de 400 ans existe entre la mesure du taux
de C14 des organismes terrestres et marins (qui paraîtront plus anciens). Enfin l’hémisphère sud présente une courbe spécifiquepour calibrer l’âge RC14, mais celle-ci n’a pas toujours été prise en compte dans les résultats publiés.
35 ALLIBERT et al., 1983.36 Antsiraka signifie le cap, le promontoire en ki-bushi (dialecte malgache). Boira étant le nom de la famille propriétaire des terrains
il y a quelques générations. Contrairement à Bagamoyo dont les terrains sont classés par le Conservatoire du littoral, AntsirakaBoira, site encore exceptionnellement préservé, est menacé sous un court terme par l’urbanisation. Des mesures de sauvegardeseraient à envisager.
37 Kahiri mutru, “appeler personne”, seul toponyme shi-maore du domaine d’Acoua, village de dialecte malgache ki-bushi. Cetoponyme fait référence à un fady (interdit) propre à ce lieu réputé hanté par les djinns. Au centre du site archéologique, un vasterocher naturel recevait des dépôts d’offrandes en tant que pierre sacrée malgache (vatomasina). Parmi ces offrandes, de nombreuxtessons portent des décors typiques des traditions médiévales de Mayotte (tradition Hanyoundrou).
38 PAULY, 2008, 2010, 2012, 2013b.39 PAULY, 2005.40 Trois analyses RC 14, sur ces premiers niveaux d’occupation d’Agnala M’kiri, fournissent les XIe et XIIe siècles comme datations :
73
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
1992, Claude Allibert présente une étudeanthropologique réalisée par le professeurMéry à partir d’ossements récoltés en vracparmi les fosses perturbées situées aunord de la colline de Mirandole (ALLIBERT
et al., 1992).
Il fallut les campagnes de fouille del’anthropologue Patrice Courtaud en 1995,1999 et 2000 pour que l’étude de ce sitesoit reprise. Entre-temps, le sable de la duneavait totalement été prélevé à l’exceptiond’un reliquat au niveau du champ de tir 29.Plus d’une centaine de sépultures furentrépertoriées. En surface, l’architecture funé-raire, lorsqu’elle est conservée, se caractérisepar des enclos rectangulaires composés dedeux rangées de dalles de grès marindressées sur leur chant. Quelques fois, àl’intérieur de cet enclos des accumulationsde corail sont notées, mais globalement, cessépultures sont très perturbées par l’actionde la mer qui les recouvre par grandesmarées. Des brûle-parfum ont été repérésen surface de certaines tombes. Les sépul-tures ouvertes lors de ces campagnesrépondaient au rite musulman: les défuntsétaient inhumés, sauf à une rare excep-tion, sans mobilier funéraire, en décubituslatéral droit (sur leur côté droit), la têteplacée à l’est, face dirigée vers le nord et lanuque calée par une pierre. Plusieurs osse-ments représentatifs de chaque secteurétudié ont été prélevés pour datation RC14.Ceux-ci ont fourni des datations comprisesentre les IXe et XVe siècles, le secteur le plusancien étant situé entre le morne deMirandole et le boulevard des Crabes. Unsujet, inhumé selon le rituel musulman, aété daté par analyse RC14 du IXe/XIe siè-cle 30. L’orientation des sépultures permetd’observer toutefois des variations maisl’orientation nord-est/sud-ouest semble icila norme suivie.
28 de ce vase. La datation obtenue fournit la fourchette chronologique 969-1111. Compte tenu des décors de ce vase similaire auxproductions de Dembéni, une datation autour de l’An Mil est envisageable.
29 En 2013, lors des prospections archéologiques en Petite-Terre dans le cadre de la carte archéologique, la dune située à proximitéde l’aéroport, côté lagon, a livré des tessons de tradition Dembéni qui suggèrent la présence d’une occupation tout aussi anciennedans ce secteur. En 1994, Liszkowski signale la présence d’un squelette mais aucun tesson n’y était associé.
30 Lyon-7424, âge C14 1085 ±55, âge calibré selon la courbe SH Cal13, 888-1069 après J.-C. L’écart entre ces deux dates estévidemment très important pour un os humain. Les Xe/XIe siècles restent néanmoins la fourchette chronologique la plus probable.
72
Taãrifa N°4
Un des secteurs étudiés durant les campagnesde fouille (Courtaud P., 2000). La sépulture 78(S.78) a livré un squelette inhumé selon le ritemusulman et daté par analyse RC14 duIXe/XIe siècle. Il s’agit actuellement du plus ancientémoignage de la présence de l’islam à Mayotte.
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page72
75
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
74
Taãrifa N°4
Antsiraka Boira, relevé simplifié des sépultures.Noter la distribution des sépultures d’enfants
organisées en groupes autour des sépultures d’adultes.
Antsiraka Boira, offrandes et dépôts funéraires.Ci-dessus, de gauche à droite :- tridacna rempli de gravillon corallien et laissé enoffrande à proximité de la sépulture 01.- céramique complète avec décor composé d’impres-sions de coquillage arca sous la lèvre, rempliede gravillon corallien et laissée en offrandedans le remplissage supérieur de la sépulture 09.
Ci-contre à droite, de haut en bas :- sépulture 05 avec aperçu du remplissagede la fosse sépulcrale avec couche de gravilloncorallien, et pierre plate et galet retrouvésau niveau des pieds du défunt.- dépôts funéraires : coupelles à bord dentelé(sépulture 12)Antsiraka Boira, relevé des architectures funéraires (campagnes de fouille 2012-2013). © M. Pauly
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page74
77
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
offrande sur la sépulture ou dans le remplissage. À deux occasions, un triton-conque percé et servant d’instrument a été retrouvé à proximité de sépultures.Une sépulture d’adulte (SP12) fouillée en octobre a livré au niveau du remplissagedeux brûle-parfum similaires à ceux rencontrés à Bagamoyo parmi les sépultures lesplus anciennes. Ils se présentent sous la forme de petites coupelles dont le bord estdentelé, volontairement brisées ; leurs tessons se rencontrent dans l’ensemble duremplissage de la sépulture.
Le sédiment de colmatage des fosses sépulcrales présente une organisation enstrates où des couches de terre s’intercalent avec des couches de gravillon corallien voirede sable. Dans ce remplissage, toujours au niveau des pieds du défunt, on rencontrequelques fois une pierre plate associée à un galet. Il s’agit d’objets rudimentaires duquotidien employés comme mortier et pilon pour broyer du piment et laissésvolontairement ici comme dépôt funéraire.
Les défunts étaient inhumés, selon l’âge, à une profondeur variant entre 45 et90 centimètres. Contrairement à Bagamoyo où les squelettes présentent un excellentétat de conservation, à Antsiraka Boira, les ossements sont partiellement conservéset friables. Certaines sépultures d’enfant n’ont livré que des dents et des fragmentsd’ossements. D’autres squelettes, mieux conservés, ont permis de lire la position dudéfunt. Nous n’avons alors rencontré que des sépultures où les défunts sont placéstête au nord ou nord-est.
Des variations de la disposition sont observées : les défunts étant soit en décubitusdorsal, soit en décubitus latéral droit (figure page suivante). Leur crâne présente uneface tournée vers leur droite. Le déplacement récurrent de la mâchoire signale une décom-position du crâne sur un espace non colmaté et suggère la présence de coussins enmatériaux périssables calant la nuque du défunt au moment de l’inhumation.Contrairement à Bagamoyo, aucune pierre sous la nuque n’a encore été observée.Les bras sont généralement étendus le long du corps, à l’exception d’un sujet dont lebras droit, fléchi, remontait le long du visage. La jambe gauche, tendue, était rejointeau niveau des chevilles par la jambe droite fléchie. Les défunts étaient placés sur unléger lit de sable. Une coquille d’escargot (achatina), encore remplie de sable, a étédécouverte dans le sédiment de colmatage de la fosse de la sépulture 03.
Deux squelettes d’adultes ont pu être étudiés en 2013. Celui de la sépulture 08(SP 08) est disposé en décubitus dorsal. Il présente de très nombreux désordres tapho-nomiques : le crâne a été retrouvé déconnecté du corps, à 18 centimètres des premièresvertèbres cervicales, face inversée par rapport à l’axe du corps, tournée vers le nord. Lesvertèbres cervicales supérieures et la mâchoire sont présentes sur le thorax ; les côteslargement éparpillées ; les vertèbres thoraciques dissociées des lombaires dont l’une étaittombée. Le bassin présentait un affaissement des coxaux. Les métacarpes, carpes etphalanges ont été retrouvés dispersés des coudes au sommet des fémurs. Toutefois, sousles phalanges de la main droite, une fusaïole a été découverte. Les fémurs étaientdissociés des tibias, eux-mêmes disposés à l’extérieur. Les rotules avaient glissé sous lesfémurs. Les os des pieds (tarses, métacarpes) ont été retrouvés dispersés sans connexionanatomique.
Ces observations n’autorisent aucun doute sur la décomposition de ce sujet dansun espace non colmaté rendant possible le déplacement des os. L’interprétation del’inhumation, primaire ou secondaire, fait débat. Selon l’anthropologue Patrice Courtaud,
76
Taãrifa N°4
à Antsiraka Boira et elle est associée sur ce site à des sgraffiato persans (type green deco-rated défini par Horton à Shanga et datés entre 1100 et 1250). Nous n’excluons doncpas l’hypothèse qu’Antsiraka Boira soit la nécropole médiévale du village d’AgnalaM’kiri autour des années 1100-1200. De superficie n’excédant pas 1,5 hectare, uneconcentration de sépultures a été découverte à l’extrémité ouest du plateau d’AntsirakaBoira et le long du littoral de la plage de Vato Madiniki 41. Les premières sépulturesont été ouvertes à la fouille en 2012 42 et la campagne de fouille s’est poursuivieen 2013.
Contrairement à Bagamoyo, où les sépultures sont attaquées par l’érosion marine,les sépultures d’Antsiraka Boira présentent une architecture funéraire parfaitementconservée. Cette conservation exceptionnelle des structures archéologiques s’expliquepar l’apport d’une couche de sédiments naturels par colluvionnement ainsi que pardes dépôts anthropiques accompagnant la réoccupation du site après l’abandon dela nécropole. Ces niveaux superficiels, dont l’épaisseur varie de 10 à 35 centimètres,recouvrent en majeure partie les sépultures qui, avant la fouille, ne laissent apparaîtreque quelques sommets de dalles dressées. Les seules altérations ont été causées surcertaines sépultures affleurant par le piétinement des zébus qui ont renversé quelquesdalles initialement plantées à la verticale sur leur chant. Cette couche superficielle desédiments contient de rares structures archéologiques : alignements de pierres,traces de métallurgie, quelques perles en pâte de verre d’un diamètre plus importantque celles retrouvées dans les sépultures, tessons de céramique qui témoignentd’activités domestiques et artisanales sur cette nécropole peu après son abandon. Lestessons recueillis datant des XIIIe-XIVe siècles, cette occupation tardive a, semble-t-il,suivi de peu les dernières inhumations sur ce site, si bien que l’on peut se demanderpourquoi ce lieu, où la présence de sépultures était encore évidente, fut choisi pouraccueillir ces activités 43.
À l’issue des campagnes de fouilles de 2012, de mai et d’octobre 2013, une tren-taine de sépultures ont été identifiées sur une zone de fouille d’une superficie d’environ80 mètres carrés. L’architecture funéraire est exceptionnellement bien conservéeet lisible à Antsiraka Boira. Celle-ci emploie des matériaux variés systématiquementprélevés sur le proche littoral que le site surplombe : dalles de beach-rock (grèsmarin), dalles de basalte, blocs de corail, gravillons coralliens et sable.
Une structure funéraire intacte présente la même architecture que celles observéesà Bagamoyo : deux rangées de dalles en basalte ou en sable enduré (grès marin oubeach-rock) sont disposées sur chant pour former un enclos rectangulaire positionnéà l’emplacement de la fosse sépulcrale. Plusieurs sépultures se présentent sous laforme de terrasses rectangulaires surélevées délimitées par des blocs de corail. Dugravillon corallien est disposé en surface à l’intérieur de ces enclos ou quelques foiségalement à l’extérieur de cette limite. Un récipient, souvent un coquillage tridacnamais plus rarement une céramique, contenant du gravillon corallien, est laissé en
41 Ly-5796, âge C14 1110±30, calibré 956-1024 après J.-C. ; Ly10257, âge C14 970±30, calibré 1030-1180 après J.-C. ; Ly-10256,âge C14 880±30, calibré 1158-1267 après J.-C.
41 Plage des “petites pierres” en ki-bushi.42 PAULY, 2013a.43 Antsiraka Boira et Dembéni, sont les seuls sites archéologiques médiévaux de Mayotte où la métallurgie a été à ce jour attestée.
Pike en 1704 rapporte un témoignage intéressant sur l’habitude de faire travailler les esclaves à proximité des cimetières, les maîtresdisant aux esclaves qu’ils étaient sous la surveillance des morts : « Ils jouent eux-mêmes le rôle de croque-mitaines après la mort.Ils prennent beaucoup de soin à répandre ces croyances, car ils disent aux esclaves qui travaillent dans ces plantations que s’ilsperdent leur temps ou négligent leur travail, un tel ou un tel de la liste va pleurer et peut-être que l’encouragement donné à ceschimères est la raison qui fait qu’ils sont si peureux ». (SAUVAGET, 2000 : 200).
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page76
79
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
taphonomiques observés seraient consécutifs au déplacement d’un corps déjà engrande partie décharné au moment de l’inhumation. La décomposition étant déjà trèsavancée au moment de l’inhumation, le transport du corps dans une natte expliqueraitles désordres observés au niveau de la colonne vertébrale, le basculement en avant ducrâne, des vertèbres cervicales et de la mâchoire, ainsi que la position en V des clavi-cules. Puis, après un ultime geste funéraire plaçant le crâne face au nord, il y auraitensuite eu colmatage complet de la fosse sépulcrale.
Cette dernière hypothèse n’est pas sans rappeler les rituels funéraires malgachessakalaves bien documentés où le corps des adultes avant inhumation est longuementexposé, couché sur une claie jusqu’à ce que le squelette, sec et décharné, soit purifié deses parties moles, les sanies n’étant pas recueillies. C’est seulement dans un deuxièmetemps que le squelette est inhumé, accompagné d’objets personnels. Ce rituelsakalave évoqué par des auteurs portugais du XVIIe siècle est également décrit endétail par Hébert pour les Sandrangoatsy, population sakalave des rives du lacKinkony 44. Nous aurions alors ici, la première sépulture de rituel malgache découverteà Mayotte 45.
À l’inverse, la deuxième sépulture d’adulte étudiée en octobre 2013 présente unsujet inhumé selon le rituel musulman : le squelette est disposé en décubitus latéraldroit selon un axe nord-est/sud-ouest, la face tournée vers le nord-ouest, aucundésordre taphonomique autre que ceux causés par le passage de racines n’a été constaté.
Sur dix sépultures d’enfants et deux d’adultes étudiées, huit ont fourni un mobi-lier funéraire important composé de plusieurs milliers de perles appartenant soit à desparures (colliers de cou, de cheville, bracelet) soit à des pagnes sur lesquels elles sontcousues, lorsqu’elles se concentrent au niveau du bassin des squelettes. Les perlesretrouvées sont soit en coquillage (nacre), soit en pâte de verre.
Les perles en coquillage se présentent sous la forme de petits cylindres de 4 à6 millimètres de longueur et autant de largeur. La tombe d’adulte que nous avons étu-diée (SP 08) a également fourni des perles en coquillage présentant des disquespercés de 4,5 à 6 millimètres de diamètre, des cylindres de 3,5 millimètres de diamè-tre et des anneaux très fins de 5 millimètres de diamètre 46. Ces perles pourraient être defabrication locale mais il n’existe pas à Mayotte de sites contemporains présentantdes preuves de cette production. Par contre, les sites africains de l’archipel de Lamuau Kenya (Manda et Shanga) présentent des polissoirs à perles et des ébauches témoi-gnant de toutes les étapes de la fabrication 47. Ces perles sont donc probablement deprovenance africaine.
Les perles en pâte de verre, bien représentées sur les sites archéologiquesmédiévaux de l’océan Indien, sont bien décrites dans la littérature où elles sont présen-tées sous le nom de perles indo-pacifiques, ou “grains de mousson” (trade windbeads). Les lieux de production sont connus : ils se situent au sud-est de l’Inde, auSri Lanka, en Thaïlande et en Indonésie. Ces perles qui sont soit étirées, soit enroulées,présentent des couleurs très variées à Antsiraka Boira : on rencontre ainsi des perles
44 HÉBERT, 1956.45 Du sédiment de fond de fosse sépulcrale doit permettre par analyse de confirmer ou non s’il y a eu décomposition du squelette
dans cette fosse.46 Ce type de perles en coquillage a également été mis au jour en 2013 à Dembéni par l’équipe de fouille de Stéphane Pradines.47 HITTICK, 1984, HORTON, 1996.
78
Taãrifa N°4
cet individu aurait eu la tête posée sur un coussin de telle sorte qu’étant dans un espacenon colmaté (sous un fond de pirogue renversée par exemple, à la manière des sépul-tures sakalaves), les ossements auraient pu se déplacer : le crâne roulant vers le nordet la mâchoire tombant en avant sur le thorax. L’éparpillement des os des mains peutêtre consécutif au passage de racines ou de petits animaux. Les désordres pourraientégalement s’expliquer par l’inhumation de ce défunt couché sur une civière, égalementdans un espace non colmaté.
Cependant, la présence des vertèbres cervicales supérieures au côté de la mâchoireinversée au niveau du thorax indique que ces vertèbres ont été emportées en avant parle poids du crâne. Or celui-ci a été retrouvé à l’opposé. Nous proposons alors une deuxièmehypothèse reposant sur une interprétation comme inhumation secondaire : les désordres
Antsiraka Boira, relevé des squelettes (SP 01, 02, 03, 05, 08 et 12).
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page78
81
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
antalaotsy, littéralement “gens de la mer”, qui sont le pendant au nord-ouest deMadagascar des Swahilis en Afrique orientale.
Il convient de remarquer que l’orientation des sépultures de Bagamoyo, toutcomme d’Antsiraka Boira, est incorrecte lorsque celle-ci n’est pas est/ouest. Toutefois,si l’on considère que l’islam a été véhiculé par des marins et marchands du golfePersique et d’Oman comme le suggèrent les sources historiques, il n’est pas étonnantque ceux-ci aient transposé à Mayotte l’orientation des sépultures de leur pays d’origine,où celles-ci sont soit nord/sud dans le golfe Persique, soit nord-est/sud-ouest enOman. À Sharma, en Hadramaout, comptoir commercial fondé par des Persansau XIe siècle et occupé jusqu’au XIIe siècle, les sépultures de la nécropole, similairesà celle d’Antsiraka Boira et de Bagamoyo, forment des petites terrasses délimitéespar des pierres orientées nord/sud 51. À ce titre, il apparaît que l’islamisation deMayotte est le fruit de contacts avec des marins et marchands qui tenaient davantaged’aventuriers que de théologiens de l’islam.
La culture matérielle identifiée à Dembéni comme à Antsiraka Boira met enévidence des similitudes qui permettent de placer Antsiraka Boira dans la continuitéchronologique de la période Dembéni : tout d’abord, ces deux sites présentent unecéramique portant des décors similaires puisque que l’on y retrouve des tessons àlèvre encochée 52, ou avec une incision en gouttière sur la lèvre pour le support d’uncouvercle. Comme à Dembéni, la métallurgie est également attestée à Antsiraka Boirapar la présence de nombreuses scories. L’une d’elles conserve des inclusions decalcaire corallien utilisé alors comme fondant. Les nodules ferreux de la latériteétaient employés comme minerai. Des fragments de paroi en argile calcinée avecnégatif d’un clayonnage en bois sont interprétés comme des restes de fours métallur-giques mais aucune structure en place n’a pu être encore étudiée.
Il ne fait donc aucun doute que l’occupation du site d’Antsiraka Boira est dansla continuité chronologique de celle de Dembéni. Ces éléments permettent aujour-d’hui d’argumenter l’hypothèse que, si Mayotte fut très tôt en contact avec des marinsislamisés du golfe Persique, son peuplement résulte en grande partie durant laphase Dembéni de populations non islamisées puisque l’islamisation ne s’est opéréqu’au cours du XIIe siècle. Bagamoyo en Petite Terre, dont la situation est typique descomptoirs swahilis, sur une lagune à proximité d’un mouillage protégé, semble être lazone de contact privilégiée par où l’islam est arrivé à Mayotte dès le Xe siècle. Puiscette religion se serait diffusée parmi les élites de Grande-Terre qui auraient un tempsconservé par syncrétisme leurs anciens rites funéraires. L’étude de sépultures sur lesite de Dembéni devrait permettre de faire progresser grandement notre connaissancede la diffusion de l’islam à Mayotte 53. Antsiraka Boira apporte cependant lapreuve que l’aristocratie à Mayotte est en voie d’islamisation au cours du XIIe siècle, cequi rejoint les écrits du géographe arabe Al-Idrisi qui, en parlant des Comores, rapporte :« Parmi les îles Javâga est l’île d’Al-Anguna [Anjouan]. La population de cette île,bien que mélangée, est actuellement principalement musulmane » 54.
51 ROUGEULLE, 2004.52 ALLIBERT et al., 1993.53 Jusqu’à présent, aucune sépulture n’a été reconnue à Dembéni. En considérant que Dembéni pourrait avoir la même organisation
spatiale qu’Antsiraka Boira, nous avons, cette année 2013, avec Dominique Tardy du BRGM, avec laquelle nous réalisons lacarte archéologique de Mayotte, ciblé le secteur compris entre le littoral et le plateau de Dembéni où s’étend ce site. Nous avonsdécouvert des structures qui pourraient s’apparenter à des sépultures. Des petits ossements sont apparus superficiellement dansune zone remaniée par des engins de chantier. Des sondages devraient confirmer la présence dans ce secteur de la nécropole.
54 FREEMAN-GRENVILLE, 1962.
80
Taãrifa N°4
translucides (soit gris-beige, soit de couleur bleu turquoise, ou quelques fois verte)mais surtout opaques (de couleurs jaunes, noires ou rouge brique). La sépultured’adulte 08 a fourni un long collier de cou alternant des perles en verre transparenteset des perles vertes très friables (en pâte de verre de mauvaise qualité) et jaunes(peut-être taillées dans du copal). Ces perles, par ailleurs décrites sur d’autres sitesarchéologiques stratifiés d’Afrique de l’Est 48, permettent de proposer une datationrelative qui, rapportée à Mayotte, situerait ces sépultures entre 1100 et 1250. Lacéramique associée, de tradition Hanyoundrou (XIe-XIIIe siècles), ne contredit pascette datation.
La nécropole d’Antsiraka Boira a donc eu une période d’activité au XIIe sièclecontemporaine de celle de Bagamoyo. Les similitudes observées pour l’architecturefunéraire et l’orientation des sépultures le confirment. Bagamoyo est toutefois occupédès le Xe siècle et les inhumations à Antsiraka Boira cessent au début du XIIIe siècleau plus tard, quand elles se poursuivent jusqu’aux XIVe/XVe siècles à Bagamoyo.Toutefois, ces deux sites présentent des rituels funéraires distincts : malgré le nombreimportant de sépultures étudiées à Bagamoyo, une seule a fourni du mobilier funé-raire 49, avec seulement 29 perles en verre dans la sépulture 13 datée du XIVe sièclepar analyse RC14. À l’inverse, à Antsiraka Boira, sur douze sépultures fouillées, huitont fourni un mobilier funéraire. La présence de parures et d’objets du quotidien(comme la fusaïole placée sous les phalanges droites du sujet de la sépulture 08) esten contradiction avec le rituel musulman, mais cette pratique est particulièrementcourante dans la nécropole islamique de Vohémar (XIIIe-XVIIe siècles), au nord-est deMadagascar 50. Avec le rituel d’inhumation secondaire que nous envisageons pour lasépulture d’adulte 08, ces éléments semblent aujourd’hui privilégier l’interpréta-tion d’une population malgache résidant à Acoua au XIIe siècle, ce qu’une analysegénétique confirmera ou non. Il faut ajouter que la sépulture 08 a fourni, dans sonremplissage, deux fragments de marmite en chloritoschiste dont les gisements sesituent à la côte nord-est de Madagascar.
À défaut de bénéficier de la certitude que nous sommes en présence ici d’un rituelmalgache, plusieurs faits se dégagent : les sépultures d’Antsiraka Boira, si elles repren-nent certains traits du rituel musulman (architecture funéraire, disposition des corps,présence d’un coussin sous la nuque), la présence d’objets du quotidien et de parures,ainsi qu’une décomposition des adultes dans un espace non colmaté, témoignent d’unsyncrétisme entre un rituel pré-islamique, peut-être malgache, et le rituel funérairemusulman.
Cet ancien rite funéraire est progressivement documenté par nos fouilles : hypo-thèse d’une inhumation secondaire avec exposition des corps de certains adultes(probablement issus de l’aristocratie), inhumation primaire pour les enfants, importancedu corail dans le rituel funéraire (et plus généralement de la mer, d’autant plus queles céramiques de cette époque sont décorées d’impressions du coquillage anadaraerythraeonensis ou arca shell, motif présent dès le IXe siècle et que la longévité surplusieurs siècles ne peut s’expliquer que par une charge culturelle très forte. Nousserions alors très tenté de reconnaître ici l’origine culturelle des Malgaches islamisés
48 Le site de Shanga, étudié par Mark Horton, fournit une datation relative des perles associées à des importations asiatiques(Moyen-Orient et Chine) que nous avons utilisée pour dater les perles d’Antsiraka Boira. Cette chronologie assez large est àpréciser, mais il semble que le XIIe siècle soit à privilégier.
49 COURTAUD, 2000.50 VERNIER, MILLOT, 1971.
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page80
83
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
82
Taãrifa N°4
d. Les mosquées médiévales de Mayotte
Comme évoqué plus haut, l’islam estattesté à Mayotte dès le Xe siècle à Baga-moyo et se généraliserait en Grande-Terreau cours du XIIe siècle parmi les commu-nautés villageoises ouvertes au commercemaritime, comme celle d’Acoua. Cependant,l’existence de mosquées se raccrochant aveccertitude à cette période médiévale a long-temps fait défaut à Mayotte. Le site deDembéni n’a pas encore fourni de vestigespouvant être interprétés comme mosquée.Pour ce qui est de Bagamoyo, on peut espé-rer que sous les accumulations du PamandziKeli, au niveau de la colline de Mirandole,des niveaux archéologiques plus anciensaient conservé les traces de l’occupation duXe siècle (une couche archéologique com-portant des tessons de la phase Dembéniapparaît sous les vestiges d’un four à chauxdu XIXe siècle et laisse espérer une bonnepréservation de structures archéologiquesplus anciennes).
Paradoxalement, Mayotte ne manquepas de ruines de mosquées anciennes. Ilen existe plus d’une vingtaine mais la data-tion de celles-ci, en l’absence de fouillearchéologique, n’est pas acquise. Néan-moins, les rares mosquées qui ont bénéficiéd’une étude archéologique, Polé 55 et Mtsan-ga Guini 56, ne remontent pas au-delà du XVIIIe siècle 57. Seule la mosquée de Tsingoni,mentionnée en 1521 dans la description de Piri Reis 58 et portant une inscriptionde 944 de l’Hégire (1538), est datée avec certitude 59.
En décembre 2012 et janvier 2013, nous avons entrepris à Acoua, sur le sited’Agnala M’kiri, un sondage archéologique sur un édifice en pierre repéré en 2006.
55 LISZKOWSKI, 1994.56 LISZKOWSKI, PAULY et al., 2011.57 L’interprétation chronologique qui a été faite de la mosquée de Polé est aujourd’hui très controversée. Le puits a été vidé en
1994 par Liszkowski qui, dans son rapport, ne mentionne aucun vestige antérieur aux XVIIe-XVIIIe siècles (LISKOWSKI, 1994).Par la suite, des datations du XIVe, voire du XIIIe siècle, ont été avancées par cet auteur avec comme argument principal laprésence d’une importation chinoise de type céladon bare circle. Néanmoins, depuis, la céramique mahoraise du XIVe siècle aclairement été définie grâce à nos travaux sur le site d’Agnala M’kiri. Celle-ci est datée par des importations moyen-orientales(noire et jaune yéménite), chinoise (céladon) et une perle indienne en pâte de verre rouge. Deux datations RC14 confirmentégalement une occupation au XIVe siècle. De plus, la céramique locale du XIVe siècle porte des décors modelés qui sont égalementprésents à Kilwa à cette époque (Hussuni Modelled Ware). Cette céramique est totalement absente à Polé, mais présente àBagamoyo (COURTAUD, 2000). Nous réaffirmons donc ici que Polé ne peut aucunement être considérée comme une mosquéemédiévale et se rattache à la fin de la période moderne. Son abandon coïncide d’ailleurs avec les attaques malgaches des années1790, et elle est signalée à l’état de ruine en 1838 par J. S. Leigh (ALLIBERT, 1998).
58 ALLIBERT, 1989.59 PAULY, 2010.60 Par ancienne mosquée, il faut entendre d’époque pré-coloniale, avant le rattachement de Mayotte à la France en 1841. Cette
appellation très large englobe donc des édifices d’époques différentes. L’urbanisation de la zone de Mamoudzou ne permet plusde savoir si des sites archéologiques signalés en 1975 (Kawéni, Mtsapéré, Tsoundzou) comportaient une mosquée. La mosquée
1
2
3 4 56 7 8
9
10 1112
13
14
15
16
1718
19
20
21 22
23
24
25
262728
Carte des anciennes mosquées 60 de Mayotte:1/Acoua (sondage 2013), 2/Mtsamboro,3/Dzoumogné, 4/Maouéni, 5/Mazamoni,6 et 7/Mitseni, 8/Kangani, 9/Koungou,10/Dzaoudzi (relevée en 1844), 11/Mirandoleou Pamandzi Keli, 12/Polé (fouille 1994),13/Pamandzi, 14/Dembéni Halé,15/Hajangoua, 16/Bandrélé, 17/Chirongui,18/Bwanatsa, 19/Hanyoundrou, 20/Djimawe,21/Domweli, 22/Ouangani, 23/Ourini,24/Tsingoni, 25/Mtsanga Guini ou Chérini (sondage2011), 26/Soulou, 27 et 28/Mtsangamouji Hadsalé.
Sondage archéologique sur la mosquée supposée, décembre 2012-janvier 2013 (relevé et DAO: M. Pauly).
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page82
85
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
XIIe siècle. Cependant, partiellement étudié, cet édifice pourrait tout à fait être unédifice civil réaménagé ultérieurement en mosquée, il convient donc d’être prudentsur son interprétation. Les couches d’accumulations sédimentaires à l’extérieur de cetédifice ont livré des tessons à décors modelés du XIVe siècle ainsi que deux fragments derécipients malgaches en pierre ollaire (chloritoschiste). La stratigraphie tout commel’analyse du parement des murs montre une importante reprise de ses maçonneries autourde 1400 avec reconstruction du mur oriental et ajout à l’intérieur d’un nouveau mur derefend qui évoque la création d’un couloir latéral séparé de la salle de prière. On retrouveici un plan très classique parmi les mosquées anciennes de Mayotte ou d’Afrique de l’Estplus généralement, où la salle de prière est encadrée par deux couloirs latéraux dont lalargeur est d’environ le tiers de celle de la salle de prière.
Durant cette phase de construction les maçonneries emploient des moellonsirréguliers qui tranchent avec les belles assises de la première phase de construction.Certains moellons, rubéfiés, indiquent que l’édifice a subi un incendie dont les tracessemblent correspondre à celles observées lors de notre sondage de 2006 et datéesdu XIVe siècle.
Lors de l’ultime phase d’occupation, une sépulture à enclos maçonné a étéconstruite au nord de l’édifice. Il s’agit d’un enclos maçonné rectangulaire recouvertd’enduit et d’orientation est-ouest. Ce type de sépulture, déjà observé à proximité dansle “quartier des notables”, semble confirmer que l’orientation est-ouest des sépul-tures — et qui répond davantage au rite funéraire musulman tel qu’il est prescrit —se généralise au cours du XIVe siècle. Peut-être faut-il y voir l’une des conséquencesde l’influence du sunnisme chaféite yéménite qui entraîna la modification à Mayottede l’orientation des sépultures d’abord initiée par des islamisés chiites du golfePersique. C’est en effet à cette époque que l’islam sunnite chaféite se généralise enAfrique de l’Est comme nous l’avons développé lors de la présentation du contextehistorique.
À Acoua, cette mosquée, tout comme le quartier des notables qui la jouxte, estabandonnée au cours du XVe siècle, sans doute à la suite d’une guerre locale avecla chefferie voisine de Mtsamboro comme l’évoque la tradition orale villageoise 65.
CONCLUSION
En l’état actuel des connaissances, il ne fait plus aucun doute que les débuts del’islamisation de Mayotte s’inscrivent durant la période médiévale, au cours desXe-XIIe siècles. Celle-ci s’est déroulée dans un contexte d’expansion du commercemaritime en Afrique orientale, impulsée par des marchands islamisés du golfePersique. Le site de Bagamoyo en Petite-Terre fournit une sépulture musulmane duIXe/XIe siècle qui est la plus ancienne connue actuellement dans l’île. Cette chrono-logie s’inscrit dans le contexte plus large de l’islamisation de l’Afrique orientale. AuXIIe siècle, l’aristocratie en Grande-Terre présente des signes d’islamisation. Lanécropole d’Antsiraka Boira à Acoua témoigne d’un syncrétisme entre d’anciensrites funéraires et le nouveau rituel musulman. La grande inconnue reste toutefois laprésence ou non d’une communauté musulmane à Dembéni dès le IXe siècle. Si l’onretient l’hypothèse d’une filiation directe entre Antsiraka Boira et Dembéni du fait
65 PAULY, 2012a.
84
Taãrifa N°4
Étant donné l’orientation nord/sud, nos hésitations sur une interprétation comme mos-quée ont été levées lorsque des tranchées de la Sogea 61, en 2011, ont fait apparaître dessquelettes à proximité. En 2006, deux sondages d’un mètre carré chacun avaientpermis d’approcher partiellement la stratigraphie à l’extérieur et à l’intérieur de l’édifice.Une couche d’incendie avait été identifiée et les charbons prélevés ont été datés duXIVe siècle 62 par analyse RC14. Nous avons donc décidé en 2012, à la suite de lapremière campagne de fouille à Antsiraka Boira, d’entreprendre un sondage d’environ8 mètres carrés sur la seule mosquée médiévale connue actuellement à Mayotte. Nousreprenons ici les conclusions de notre rapport archéologique présentant cette opéra-tion 63. Le sondage a fait apparaître les arases de l’angle nord-est de cette mosquée.Celle-ci étant hélas partiellement conservée, recouverte par une construction moderne(celle qui était en construction en 2006 au moment de nos premières observations)et tronquée lors de la construction de la route Acoua-Mtsangadoua à la fin desannées 1980.
Le relevé des maçonneries a fait apparaître plusieurs phases de construction pourcet édifice. La plus ancienne présente des maçonneries employant une technique deconstruction dont l’observation est encore inédite à Mayotte mais parfaitementdécrite sur les édifices swahilis des Xe-XIIIe siècles, à savoir l’usage de grandes briquesde corail (30 centimètres par 30 centimètres) disposées en assises régulières 64. Lors decette première phase de construction, le niveau de circulation intérieur était beaucoupplus haut que le niveau de sol extérieur, surélevé par un hérisson de pierre recouvertd’une couche de sable et de gravillons qui composait l’aménagement du sol intérieur.Nous avons eu la surprise de découvrir dans ce remplissage, consécutif au premieraménagement intérieur, des tessons de céramique locale, comportant des motifstypiques des productions de tradition Hanyoundrou (XIe-XIIIe siècles). Il n’y a doncaucun doute sur l’ancienneté de cet édifice que l’on peut dater au moins duXIIIe siècle mais qui selon les découvertes d’Antsiraka Boira pourrait remonter au
60 de Ouangani, la seule véritablement à l’intérieur des terres, date de la première moitié du XIXe siècle lorsque des Antalaotsy dePoroani s’établirent de manière pérenne dans cette zone agricole.
61 Compagnie des eaux.62 Lyon-4473.63 PAULY, 2013b.64 Cette technique est également observée aux Comores pour les premiers niveaux de construction, datés du XIIe siècle, des mosquées
shirâzi de Sima et Domoni à Anjouan (WRIGHT, 1992).
Acoua-Agnala M’kiri:parement du murextérieur nordd’une probable mosquéeprésentant un appareilrégulier composé degrandes briques de corail.
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page84
87
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévaleTaãrifa N°4
BIBLIOGRAPHIE
ALLIBERT C., Mayotte, plaque tournante et microcosme de l’océan Indien occidental, Paris,Anthropos, 1984, 352 p.« Une description turque de l’océan Indien occidental dans le Kitab-i Bahrije de PiriRe’ïs, 1521 », Études océan Indien n° 10, Paris, Inalco, 1989, p. 9-52.« Le journal de J. S Leigh (1836-1840) à bord du Kite », Études océan Indien n° 27-28,Paris, Ceroi-Inalco, 1998, p. 61-170.
ALLIBERT C., ARGANT A. & J., « Le site de Bagamoyo, Mayotte », Études océan Indien n° 2,Paris, Inalco, 1983, p. 5-40.« Le site de Dembéni, Mayotte, Archipel des Comores », Études océan Indien n° 11, Paris, Inalco,1989, p. 63-172.
ALLIBERT C., LISZKOWSKI H. D., PICHARD J.-C., ISSOUF, Le site de Dembéni III : une batterie defours métallurgiques (Mayotte, archipel des Comores), Fondation pour l’étude de l’archéo-logie de Mayotte, dossier n° 2, Paris, Ceroi-Inalco/Sham, 1993, 63 p.
ALLIBERT C., MERY A. (coll.), Mayotte : archéologie du VIIIe au XIIIe siècle. Fondation pourl’étude de l’archéologie de Mayotte, dossier n° 1, Paris, Ceroi-Inalco, 1992, 44 p.
BATTISTINI R., VERIN P., « Irodo et la tradition Vohémarienne », Taloha (revue d’histoire et decivilisation malgache), n° 2, 1967, p. 22-52.
BEL-HAMISSI A., Rapport de fouille. Dembéni 2000, Collectivité territoriale de Mayotte/DAC/Mapat, 2000, 29 p.
BLANCHY S., SAID M., « Inscriptions religieuses et magico-religieuses sur les monuments historiquesà Ngazidja (Grande Comore) - le sceau de Salomon - », Études océan Indien n° 11, Ceroi-Inalco,1989, p. 7-62.
CHAMI F., « The 1996 Archaeological Reconnaissance North of the Rufiji Delta », NyameAkuma n° 49, Houston (Texas), Society of Africanist Archaeologists, 1998, p. 62-78.« Archaeological research in Comores between 2007 to 2009 », dans Civilisations des mondesinsulaires, volume d’hommage au professeur Claude Allibert, Paris, Inalco, Karthala Éd.,2010, p. 811-823.
CHITTICK N., Kilwa : an Islamic Trading City on the East African Coast, Nairobi, BIEA, 1974,2 vol.Manda, excavations at an Island Port on the Kenya Coast, Nairobi, BIEA, 1984, 258 p.
COURTAUD P., « Le peuplement de Mayotte : l’étude des sites sépulcraux de Bagamoyo(Petite-Terre) », Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, T.11., 1999,p. 487.
COURTAUD P., CONVERTINI F., Rapport de fouille sur le site de Bagamoyo (Mayotte, Petite-Terre,commune de Labattoir – Plage des Badamiers), document final de synthèse d’évaluationarchéologique, MCC/SDA, École nationale du patrimoine, DRAC de La Réunion, Collectivitéterritoriale de Mayotte/DAC, CNRS/UMR 5809 - Université de Bordeaux 1/laboratoired’anthropologie, AFAN, 2000, 2 vol., 120 p.
COURTAUD P., ELYAQTINE M., Le site de Bagamoyo. Mayotte, Petite-Terre (Commune de Dzaoudzi-Labattoir – Plage des Badamiers), document final de synthèse d’évaluation archéologique,MCC/SDA, DRAC de La Réunion, Collectivité territoriale de Mayotte/DAC, CNRS/UMR 5809- Université de Bordeaux 1/laboratoire d’anthropologie, AFAN, 1998, 2 vol., 104 p.
DESACHY B., BELARBI M., Rapport de fouille sur le site de Dembéni (Mayotte). Missionarchéologique Août-Septembre 2009, MCC/SDA, DRAC Picardie, Collectivité territorialede Mayotte/DAC, AFAN, 2000, 155 p.
DEWAR R.E., RADIMILAHY C., WRIGHT H. T., JACOBS Z., O KELLY G., BERNA F., « Stone tools andforaging in northern Madagascar challenge Holocene extinction models », Proceedingsof the National Academy of Sciences (USA), 2013.
FONTES P., COUDRAY J., EBERSCHWEILLER C., FONTES J.-C., « Datation et condition d’occupationdu site de Kougou (Île de Mayotte) », Revue d’Archéométrie, 11, 1987, p. 77-82.
FREEMAN-GRENVILLE J.S.P., The East African Coast, select documents from the first to the earliernineteenth century, Clarendon Press, Oxford, 1962, 314 p.
GOMMERY D., RAMANIVOSOA B., FAURE M., GUÉRIN C., KERLOC’H P., SÉNÉGAS F., RANDRIANANTENAINA
H., « Les plus anciennes traces d’activités anthropiques de Madagascar sur des ossements
86
de la continuité de la culture matérielle observée, ce dernier site serait un site peuplépar une population non-islamisée. C’est déjà l’hypothèse avancée tant par ClaudeAllibert que par Henry Theodor Wright. Ce dernier à Mbashile en Grande Comore adécouvert dans une couche archéologique de la phase Dembéni une dent de porcqui suggère l’absence d’islamisation à cette époque 66. Les populations musulmanes,autour de l’an mil, ne se rencontraient donc que rarement, comme à Bagamoyo,alors principal comptoir et point d’ancrage de l’islam à Mayotte.
À l’inverse, si les recherches futures attestent de la pratique de l’islam à Dembénidès le IXe siècle, cela remettrait en cause notre hypothèse d’une diffusion de l’islamen Grande-Terre depuis la Petite-Terre. Dans ce cas, Mayotte n’aurait connu qu’unpeuplement impulsé par des islamisés dans le cadre de la mise en place de réseauxcommerciaux reliant l’Afrique à Madagascar. Antsiraka Boira, en dépit d’une culturematérielle qui témoigne d’une filiation avec Dembéni, témoignerait alors de l’instal-lation de populations nouvelles, non islamisées et certainement malgaches dontl’islamisation n’aurait débuté qu’au cours du XIIe siècle.
Enfin, si les mosquées anciennes sont nombreuses à Mayotte, souvent réduites àl’état de pierrier, la recherche archéologique est encore insuffisante à ce jour pourpermettre de dater ces édifices. Toutefois, les rares mosquées étudiées relèvent pour laplupart de l’époque moderne. Aussi, seule la mosquée d’Acoua peut, à l’heure actuelle,être considérée avec certitude comme médiévale. Son architecture correspond entout point aux mosquées swahilies des Xe-XIIIe siècles et présente une technique deconstruction introduite en Afrique de l’Est par des marins islamisés originaires dugolfe Persique. Nous ne doutons toutefois pas que la recherche archéologique mettraen évidence dans les années à venir d’autres édifices tout aussi anciens.
…/…
Ce travail de recherche archéologique mené à Mayotte et tout particulièrement àAcoua n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de la Direction des Affaires Culturelles de laPréfecture (ministère de la Culture et de la Communication) et de la Direction départe-mentale des Affaires culturelles du Conseil Général. J’adresse également mes remerciementsà la Société d’histoire et d’archéologie de Mayotte (Sham). Je tiens à remercier enfin lespropriétaires des terrains sur lesquels les opérations à Acoua se sont déroulées, et trèschaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ces chantiers : collègues archéo-logues, enseignants, proches, étudiants et jeunes lycéens d’Acoua sans qui ce travail deterrain n’aurait pu être mené à bien.
°
Martial PaulyArchéologue
Chercheur associé au Centre de recherchessur l’océan Indien occidental et le monde
austronésien (Croima) de l’Institut nationaldes langues et civilisations orientales (Inalco)
66 WRIGHT, 1984.
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page86
Taãrifa N°4
SAINCLAIR P. J. J., MORAIS J. M. F., ADAMOWICZ L., DUARTE R. T., « A perspective on archaeologicalresearch in Mozambique », The Archaeology of Africa, Food, Metals and Towns, Londres,Routteledge, 1993, p. 409-431.
VERNIER E. ET MILLOT J., Archéologie malgache, comptoirs musulmans, catalogue du Musée del’Homme, Paris, 1971, 180 p.
WRIGHT H. T., « Early seafarers of the Comoro Islands : the Dembéni phase of the IXth-Xth centu-ries AD », Azania (Nairobi), n° 19, 1984, p. 13-59.
« Nzwani and the Comoros », dans Azania (Nairobi), n° 27, 1992, p. 81-128.
Afan Association pour les fouilles archéologiques nationalesAsemi Asie du sud-est et le Monde Insulindien (revue)Ceroi Centre d’étude et de recherche sur l’océan Indien occidental, devenu Croima :
Centre de recherche sur l’océan Indien occidental et le monde austronésienDAC Direction des Affaires culturellesDDAC Direction départementale des Affaires culturellesDrac Direction régionale des Affaires culturellesEOI Études océan Indien (revue)Inalco Institut national des langues et civilisations orientalesMapat Maison du patrimoine (de Mayotte)MCC Ministère de la Culture et de la CommunicationSDA Sous-direction de l’archéologieSham Société d’histoire et d’archéologie de Mayotte
88
La diffusion de l’islam à Mayotte à l’époque médiévale
d’hippopotames subfossiles d’Anjohibe (Province de Mahajanga) », Palevol n° 10, 2011,p. 271-278.
GOURLET J.-F., Chroniques mahoraises, Paris, L’Harmattan, 2001, 221 p.HARDY-GUILBERT C., « Un marqueur chronologique : la “mustard ware” yéménite au XIVe siècle »,La Lettre de la Société française d’étude de céramique orientale (Musée Cemuschi), n° 10,nov. 2004, p. 20-21.
HÉBERT J.-C., « Mœurs et coutumes des Sandrangoatsy (population sakalava des bords du lacKinkony) », Cahier des coutumes malgaches, 1956, p. 21-47. « Le premier peuplement de Mayotte dévoilé par le proto-malgache », Taãrifa 2, revue desArchives départementales de Mayotte, 2011, p. 9-41.
HORTON M., Shanga, the archaeology of a Muslim trading community on the coast of EastAfrica, Londres, BIEA, 1996, 458 p.
HORTON M., MIDDLETON J., The Swahili, The Social Landscape of a Mercantile Society, ThePeoples of Africa, Oxford, Blackwell, 2000, 282 p.
JUMA A., Unguja Ukuu on Zanzibar, an archaeological study of early urbanism, Studies inGlobal Archaeology 3, Uppsala, Department of Archaeology and Ancient History, 2004,198 p.
LISZKOWSKI H. D., Polé, étude archéologique, mémoire de diplôme de recherche et d’étudesappliquées, Paris, Inalco, 1994, 68 p.Mayotte et les Comores, escale sur la route des Indes, Mayotte, Éd. Baobab, 2000, 415 p.« Les Bantous, premiers occupants de Mayotte? » Univers Maoré n° 11, Mamoudzou, Associationdes Naturalistes de Mayotte, 2008, p. 42-48.
LISZKOWSKI H. D., PAULY M., SOUMILLE O., Campagne archéologique 2011. Site de Soulou(Mtsanga Guini), rapport, Sham, Mamoudzou, Préfecture de Mayotte/DAC, 2011, 58 p.
MOUSTAKIM I., Archaeological investigation of the Mtswa-Mwindza’s mosque at Ntsaouenistone town (Ngazidja Island), M. A (Archaeology) Dissertation, University of Dar es Salaam,2012, 146 p.
PAULY M., Campagne de prospection archéologique : de nouveaux sites dans les communesde Mtsangamouji et d’Acoua, rapport, Sham, Mamoudzou, Préfecture de Mayotte/DAC, 2005,19 p.Acoua-Agnala M’kiri, rapport archéologique, rapport, Sham, Mamoudzou, Préfecture deMayotte/DAC, 2008, 29 p.« Développement de l’architecture domestique en pierre à Mayotte, du XIIIe au XVIIe siècle »,Civilisation des mondes insulaires, mélanges en l’honneur du professeur Claude Allibert,Paris, Karthala, 2010, p. 603-631.Acoua-Agnala M’kiri, rapport de fouille archéologique, opération mai-décembre 2011,rapport, Sham, Mamoudzou, Préfecture de Mayotte/DAC, 2012, 76 p. « Société et culture à Mayotte aux XIe-XVe siècles : la période des chefferies », Taãrifa 3,revue des Archives départementales de Mayotte, 2012, p. 69-113.Commune d’Acoua, site archéologique d’Antsiraka Boira, opération septembre-décembre 2012,rapport, Sham, Mamoudzou, Préfecture de Mayotte/DAC, 2013, 64 p.Acoua-Agnala M’kiri, rapport d’opération archéologique 2012, rapport, Sham, Mamoudzou,Préfecture de Mayotte/DAC, 2013, 51 p.
PRADINES S., « L’île de Sanjé ya Kati (Kilwa, Tanzanie) : un mythe Shirâzi bien réel », Azania :Archaeological Research in Africa, vol. 41, n° 1, 2009, p. 1-25.
PRADINES S., BRIAL P., « Dembéni, Mayotte (976), Archéologie swahilie dans un département fran-çais », Nyame Akuma 77, Houston (Texas), Society of Africanist Archaeologists, 2011, p. 68-81.
RADIMILAHY C., Mahilaka : an archaeological investigation of an early town in northwesternMadagascar, Studies in African Archaeology, Uppsala, 1998, n° 15, 293 p.
ROUGUELLE A., « Le Yémen entre Orient et Afrique : Sharma, un entrepôt du commerce médiévalsur la côte sud de l’Arabie », Annales Islamologiques 38, 2004, p. 201-253.
SAUVAGET A., « Passage du navire interlope Rochester à Anjouan », Études océan Indien, Paris,Ceroi-Inalco, n° 29, 2000, p. 177-221.
SINCLAIR P., Space, Time and Social Formation : a territorial approach to the archaeologyand anthropology of Zimbabwe and Mozambique c. 0-1700 AD, Societas ArchaeologicaUpsaliensis, Uppsala, 1987, 204 p.
Taarifa4_Mise en page 1 19/02/14 17:27 Page88