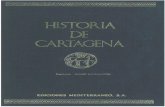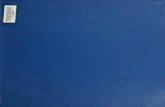L'Union Vaudoise des associations musulmanes. Une tentative de gestion locale de l'islam
Transcript of L'Union Vaudoise des associations musulmanes. Une tentative de gestion locale de l'islam
Chapitre 5
L’UNION VAUDOISE DES ASSOCIATIONS MUSULMANES
UNE TENTATIVE DE GESTION LOCALE DE L’ISLAM
Christophe MONNOT
Par un dimanche radieux d’avril, le GPS de ma voiture s’était écrié « vous avez atteint votre destination. Votre destination est à droite ! » L’adresse que l’on m’avait transmise était celle de la « mosquée turque de Lausanne ». Je gare ma voiture et cherche le numéro de la maison. Après avoir arpenté la rue de long en large un quart d’heure, j’appelle la personne qui m’a donné le rendez-vous. Un homme sort immédiatement d’un bâtiment bordant la rue et me hèle. Il me dit de venir dans le parking privé derrière la maison, car le groupe doit faire attention d’éviter les plaintes du voisinage, les places dans la rue étant limitées. J’obtempère, puis me trouve à l’intérieur d’une grande bâtisse. Après avoir enlevé mes chaussures, je monte au premier étage où l’on m’a demandé d’attendre.Cet étage est constitué du bureau du président du centre, d’une vaste salle de séjour où une dizaine d’enfants (et préados) déambulent et jouent. Vers l’entrée, un bar accueillant est gardé par un Monsieur tout sourire d’une soixantaine d’années. Il s’excuse de ne plus avoir de thé et m’offre à la place un pide turc à la viande. La pièce se prolonge par une grande terrasse sur le toit plat d’un garage. Quatre hommes sont assis à bavarder et à boire le thé au soleil sur la terrasse.Une vingtaine de minutes après mon arrivée, le président 1 vient me chercher pour monter à l’étage, une petite salle en mansarde où se tient l’Assemblée générale annuelle de l’Union vaudoise des associations
1. Lors de mon enquête de terrain, Pascal Gemperli était offi ciellement vice-prési-dent de l’UVAM, mais, en l’absence du président, fonctionnait déjà comme président et prenait les choses en mains.
MD-85215-1 A FIN.indd 123MD-85215-1 A FIN.indd 123 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
124 CHRISTOPHE MONNOT
musulmanes (UVAM). Vingt-cinq personnes – représentant les asso-ciations membres – sont présentes autour de tables agencées en U. Parmi elles, trois femmes portant un (double) voile islamique couvrant parfaitement les cheveux. Le président m’introduit par quelques mots et me demande de prendre la parole. J’explique que je mène une enquête scientifi que, dans le cadre du programme de recherche « Vivre ensemble dans l’incertain » de l’Université de Lausanne et de sa com-mission Anthropos 2, auprès des associations locales du canton de Vaud. Je serais donc intéressé à venir leur rendre visite pour discuter de la réalité concrète de leur association, de savoir également comment l’UVAM leur permet d’affronter les défi s qu’ils rencontrent.Après ma courte présentation, les questions ne manquent pas de fuser : suis-je un envoyé de l’Etat ? Y a-t-il des conséquences poli-tiques à ma venue ? Vais-je retransmettre le discours des membres, par exemple sur des sujets comme la natation à l’école, ou le discours des responsables ? Un autre insiste plusieurs fois en argumentant en substance qu’un musulman est musulman partout et qu’en se foca-lisant sur les communautés, on n’observera rien de l’islam non-pratiquant. Un autre fait la demande de ne pas solliciter des entretiens hors des horaires d’ouverture du centre, car tous les responsables sont bénévoles et donnent déjà un temps énorme à la communauté.Après ce débat où chacun a joué cartes sur table, afi n d’être certain que le contrat entre eux et moi ne tourne pas à la trahison, le président de séance prend la parole pour conclure. Selon lui, cette recherche représente une occasion unique de se faire connaître et entendre. Dans le souci de faire reconnaître leur travail et leur Union, il vaut la peine de m’ouvrir la porte. Ce sera à l’avantage des associations locales et du travail de l’UVAM 3.Une discussion informelle s’ensuivit avec quelques responsables d’as-sociations enthousiastes de me voir les visiter. L’assemblée se disperse ensuite, laissant une partie fraterniser à l’étage inférieur près du bar, d’autres partent immédiatement. En quittant les lieux, je m’efforce de trouver à l’entrée une signalisation de cette fameuse « mosquée turque ». En cherchant, je repère fi nalement une plaque dorée de 30 cm
2. La recherche, « S’inscrire dans l’espace public. Approches sociologiques et géo-graphiques des nouveaux paysages religieux », était dirigée par Laurence Kaufmann et Philippe Gonzalez de l’Université de Lausanne. Elle a donné lieu à plusieurs publica-tions, relevons notamment : Philippe GONZALEZ et Christophe MONNOT, Le religieux entre science et cité. Penser avec Pierre Gisel, Genève, Labor et Fides, 2012 ; Joan STAVO-DEBAUGE, Le loup dans la bergerie : le fondamentalisme chrétien à l’assaut de l’espace public, Genève, Labor et Fides, 2012 ; Philippe GONZALEZ et Joan STAVO-DEBAUGE, « Politiser les évangéliques par le “mandat culturel”. Sources, usages et effets de la théologie politique de la Droite chrétienne américaine », in : Jacques EHREN-FREUND et Pierre GISEL (éd.), Religieux, société civile, politique, Lausanne, Antipodes, 2012, pp. 241-276.
3. L’UVAM compte actuellement neuf membres statutaires et cinq membres asso-ciés (www.uvam.ch).
MD-85215-1 A FIN.indd 124MD-85215-1 A FIN.indd 124 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 125
sur 50 environ, qui donne l’indication que ce bâtiment banal abrite effectivement le Centre islamique et culturel turc de Lausanne 4.
Ce premier contact avec les associations et communautés musul-manes du canton de Vaud contient déjà tous les éléments que l’ana-lyse permettra de mettre à jour. Les associations musulmanes du canton sont prises dans un paradoxe : être invisibles pour éviter la stigmatisation sociale, et être visibles pour se faire entendre et reconnaître à leur juste valeur. L’invisibilité se cerne par la diffi -culté que j’ai eue à repérer un bâtiment abritant un centre musulman. Elle concerne plus spécialement l’échelon local, l’impact et les inter-actions que peuvent avoir les associations avec leur environnement proche. La visibilité se caractérise par la volonté de l’UVAM de faire sortir les musulmans de l’ombre. Elle touche le niveau supra-local : les objectifs et stratégies communs que la grande majorité des groupes se sont choisis à travers une représentation cantonale fédérative. Le dispositif que l’UVAM met en place vise à poser concrètement la question de la gestion publique de l’islam sur le plan vaudois 5.
La réfl exion de ce chapitre explicitera, à partir d’observations et d’entretiens conduits auprès des différentes salles de prière, associa-tions ou communautés religieuses 6 musulmanes du canton de Vaud, chacun de ces deux niveaux du paradoxe. Après avoir briève-ment décrit les aspects méthodologiques de l’enquête, la première partie s’attachera à comprendre la dynamique de l’invisibilité et ses conséquences pour les groupes locaux. Dans la seconde partie, l’in-térêt se portera particulièrement sur l’UVAM, qui a pour objectif de faire bénéfi cier les musulmans du canton d’un statut de reconnais-sance juridique de « communauté religieuse d’intérêt public » 7. Elle entend mener, au nom des musulmans vaudois, une lutte pour
4. L’inscription est la suivante : « Turk-Islamkultur Merkezî 1986 – 2003. Centre islamique et culturel turc de Lausanne et environs », avec la silhouette d’une mosquée en vert, de l’étoile et du croissant du drapeau de la Turquie en rouge.
5. Voir Claire de GALEMBERT, « La gestion publique de l’islam en France et en Allemagne », De l’improvisation de pratiques in situ à l’amorce d’un processus de régulation nationale 52 (4), 2003, pp. 67-78.
6. Pour le concept de communauté, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage : Ivan SAINSAULIEU, Monika SALZBRUNN et Laurent AMIOTTE-SUCHET (éd.), Faire communauté en société. Dynamique des appartenances collectives, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
7. Obtenir le statut de communauté religieuse reconnue d’intérêt public selon la loi LRCR 180.51 (adoptée en 2007 par le Grand Conseil du canton de Vaud, selon les articles 169, 171 et 172, de la Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003). Un règlement d’application est en cours d’adoption.
MD-85215-1 A FIN.indd 125MD-85215-1 A FIN.indd 125 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
126 CHRISTOPHE MONNOT
la reconnaissance, au sens considéré par Iris Marion Young 8, en « affi rmant positivement leurs différences culturelles pour contrer l’exclusion et la stigmatisation dont ils font l’objet et pour accéder à l’inclusion politique, seule garante de la justice sociale » 9. Cette réfl exion nous permettra de comprendre les diffi cultés rencontrées par les acteurs islamiques pour parvenir à se faire reconnaître dans l’espace public.
1. « S’inscrire dans l’espace public » :une enquête ethnographique
L’enquête auprès des organisations islamiques du canton de Vaud s’est déroulée de septembre 2010 à juin 2012. Elle repose sur un protocole de recherche par observation participante. Nous avons assisté à la prière ordinaire, aux repas communautaires, aux confé-rences, aux discussions avec les fi dèles dans les réfectoires des centres. Les observations étaient consignées dans un carnet de notes pendant la participation à l’événement ou directement après, selon les circonstances 10. Plus d’une trentaine d’entretiens semi-directifs ont été menés avec des responsables associatifs locaux ou supra-locaux. Soit les entretiens étaient enregistrés puis retranscris, soit une prise de notes suivait immédiatement l’entretien. Deux niveaux d’action des associations musulmanes du canton – le local, les mos-quées, et le supra-local, l’UVAM – ont été examinés.
L’enquête sur les communautés localesSur le plan local, l’enquête s’intéressait aux communautés reli-
gieuses, dans un sens plus restrictif que celle défi nie au premier chapitre du présent ouvrage. On considère ici les communautés de type « mosquée », c’est-à-dire avec une salle de prière pour la
8. Iris Marion YOUNG, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990.
9. Olivier VOIROL, « Luttes pour la reconnaissance », in : Olivier FILLIEULE, Lilian MATHIEU et Cécile PÉCHU (éd.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, pp. 326-334, ici p. 328.
10. Robert M. EMERSON, Rachel I. FRETZ, Linda L. SHAW et Philippe GONZALEZ, « Prendre des notes de terrain. Rendre compte des signifi cations de membres », in : Daniel CEFAI (éd.), L’engagement ethnographique, Paris, EHESS, 2010, pp. 129-168, Philippe GONZALEZ et Laurence KAUFMANN, « The Social Scientist, the Public, and the Pragmatist Gaze. Exploring the Critical Conditions of Sociological Inquiry », European Journal of Pragmatism and American Philosophy IV (1), 2012, pp. 55-82.
MD-85215-1 A FIN.indd 126MD-85215-1 A FIN.indd 126 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 127
pratique régulière 11. Ce sont en effet ces entités qui offrent des ser-vices religieux réguliers aux fi dèles musulmans 12 et qui cherchent à obtenir de la reconnaissance (d’intérêt public). Elles sont, comme nous l’avons relevé au chapitre un, des groupes d’interpénétra-tions 13 ou de passerelle entre la tradition d’une région d’origine et une culture d’accueil. Il s’agit donc essentiellement de commu-nautés à importante population d’origine étrangère. Ces collectivités sont fortement marquées par la culture et la langue de provenance. Le canton de Vaud compte ainsi trois associations turques, une communauté somalienne, quatre associations albanophones (dont deux, une à Yverdon et l’autre à Payerne, à la recherche de salles), une communauté bosniaque, six communautés arabo-francophones. En raison de la langue parlée, ces dernières sont composées de fi dèles aux origines diversifi ées et comptent également des Suisses convertis. Au-delà de l’origine régionale, les groupes se distinguent par le fait que certains, comme les centres turcs, rassemblent une part importante de fi dèles de deuxième génération ; ils sont par conséquent plus établis et comptent des responsables qui ont été scolarisés en Suisse 14. D’autres, comme les Bosniaques ou les Kosovars, sont presque exclusivement des membres de première génération. Les dynamiques de socialisations dans ces diverses associations sont donc différentes et dépassent largement la ques-tion religieuse
L’enquête sur les instances « représentatives »Sur le plan supra-local, les acteurs organisés en association pour-
suivent un but de représentativité de l’islam dans le canton de Vaud. Le canton compte de facto deux organismes d’une telle ambition, l’UVAM et la Mosquée de Lausanne :
– l’UVAM, avec sa quinzaine de groupes affi liés, émerge dès 2004 comme l’interlocuteur cantonal auprès de la société, des médias et des politiques. Fondée dans une dynamique faisant suite à l’attentat du 11 septembre 2001 et initiée par Montassar Ben
11. Voir Riem SPIELHAUS, « Is there a Muslim Community ? Research among Islamic Associations in Germany », in : Ivan SAINSAULIEU, Monika SALZBRUNN et Lau-rent AMIOTTE-SUCHET (éd.), op. cit., pp. 183-202.
12. Voir Pierre GISEL, Les monothéismes. Judaïsme, christianisme, islam. 145 pro-positions, Genève, Labor et Fides, 2006 ; ID. et Jacques WAARDENBURG (éd.), L’Islam : une religion, Genève, Labor et Fides, 1989.
13. Nilüfer GÖLE, Interpé né trations. L’Islam et l’Europe, Paris, Galaade, 2005.14. Le responsable du centre turc de Renens est d’ailleurs diplômé de l’Université
de Fribourg.
MD-85215-1 A FIN.indd 127MD-85215-1 A FIN.indd 127 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
128 CHRISTOPHE MONNOT
M’rad, une personne particulièrement rassembleuse au sein des dif-férents groupes musulmans, l’union comptait neuf associations au moment de son assemblée générale fondatrice en mars 2004. C’est seulement en octobre 2004 qu’elle se fi t connaître publiquement : elle envoya un communiqué de presse de soutien à l’imam de la mosquée de Lausanne qui s’était fait poignarder pendant la prière par un croyant contestataire. Ce message public est d’autant plus important, du point de vue musulman au moins, que cet imam avait refusé (et refuse toujours) de participer à l’Union vaudoise ;
– la Mosquée de Lausanne est la seconde organisation qui affi che une volonté de représentation de la communauté musulmane au niveau supra-local. Elle trouve sa légitimité dans son implantation historique. Fondée sous patronage saoudien, elle est le premier lieu de culte musulman du canton de Vaud. Il en a même été l’unique lieu de culte jusqu’à la fête de rupture du jeûne de Ramadan, en 1990. En raison de sa position historique, cette mosquée a été un partenaire privilégié pour représenter l’islam auprès des autorités, d’autant plus que l’imam est une personnalité charismatique, reli-gieusement très bien formée et parlant le français. Mais comme nous le verrons, c’est sa légitimité à l’interne de la communauté musulmane qui pose problème, car la mosquée fait partie d’un mou-vement minoritaire, une dissidence au sein du sunnisme, les ahbaches 15, une branche qui n’est pas spécialement rigoriste pour les membres, mais qui, par contre, exclut toute collaboration avec les autres groupes.
2. Atomisation des groupes par origine linguistiqueet sensibilité religieuse
Dans le canton de Vaud, comme partout en Suisse, mis à part peut-être à Genève 16, les communautés musulmanes sont d’abord organisées par origine linguistique et culturelle des fi dèles 17. En
15. Sur ce mouvement, voir Mustafa KABHA et Haggai ERLICH, « Al-Ahbash and Wahhabiyya : Interpretations of Islam », International Journal of Middle East Studies 38 (4), 2006, pp. 519-538, et Dominique AVON, « Les Ahbaches. Un mouvement liba-nais sunnite contesté dans un monde globalisé », Cahiers d’Etudes du Religieux – Recherches interdisciplinaires 2, 2008, http://www.msh-m.org/cier (consulté le 15.03.2013).
16. Par la prégnance de la mosquée de Genève et du Centre islamique des Eaux-Vives (à ce propos, voir le chapitre précédent).
17. Peggy LEVITT, Josh DEWIND et Steven VERTOVEC, « International Perspectives on Transnational Migration : An Introduction », International Migration Review 37 (3), 2003, pp. 565-575 ; Thomas LACROIX, Leyla SALL et Monika SALZBRUNN, « Les Maro-
MD-85215-1 A FIN.indd 128MD-85215-1 A FIN.indd 128 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 129
dehors des rites religieux, les collectivités locales organisent plus ou moins formellement le maintien d’un héritage (spécialement par des cours de langues pour les enfants) et d’une tradition (par l’offre de nourriture, boisson et jeux typiques du pays de provenance) ainsi qu’une solidarité avec la région d’origine (par l’organisation d’aide plus ou moins structurée en faveur de la contrée de provenance). Dans certains groupes, la part culturelle de l’association est priori-taire et dominante, tandis que dans d’autres, c’est l’aspect religieux qui représente le cœur des activités 18.
Cette atomisation par région linguistique d’origine est relative-ment nouvelle dans le canton de Vaud. Jusqu’en 1990, tous les musulmans (peu nombreux) de la région lausannoise se réunissaient à la mosquée de Lausanne. Cette année-là, la fête de fi n de Ramadan était décalée selon l’appartenance juridique. Comme, à l’époque, la Mosquée de Lausanne était sous patronage wahhabite 19, la fi n du jeûne se célébrait un jour plus tôt que pour les Turcs qui sont hana-fi tes. A la suite du refus des responsables de la mosquée d’accepter deux fêtes dans leur salle de prière, les Turcs ont cherché des locaux, qu’ils ont trouvés à Chavannes-près-Renens. Ce centre devint rapi-dement le lieu de rassemblement des musulmans de la région. Pour le responsable turc actuel, l’époque de ce centre était magnifi que, car tous les musulmans se recueillaient ensemble. Il retrouve cet idéal dans l’UVAM qui désire fédérer et réunir les différentes asso-ciations musulmanes.
Depuis cette période de « l’unique » communauté à Chavannes (dans le mythe musulman vaudois), les choses ont bien changé. L’association turque a déménagé en 2005, pour une part à Ecublens et pour l’autre à Renens. Les fi dèles d’origine kosovare ont trouvé une salle en 2004 à Renens (puis Lausanne). Le Complexe culturel des musulmans de Lausanne (CCML) réunissant les musulmans d’origine maghrébine a ouvert ses portes en 2006 à Prilly. Les anciens locaux du centre turc sont actuellement occupés par une communauté somalienne. En dehors de Lausanne, l’UVAM fédère également les associations de Montreux, Morges, Moudon, Vevey et Yverdon, donc quasiment toutes les communautés musulmanes du canton, à l’exception de la Mosquée de Lausanne ainsi que d’une
cains et Sénégalais de France, permanences et évolution des relations transnationales », Revue européenne des migrations internationales 24 (2), 2008, pp. 23-43.
18. Cette différence d’objectif dépend essentiellement de la présence ou non dans le groupe d’un imam attitré (souvent rattaché à une organisation religieuse nationale).
19. Branche de l’islam soutenue par l’Arabie saoudite, puisque cette mosquée, qui s’appelait encore Centre islamique de Lausanne, était parrainée par ce pays.
MD-85215-1 A FIN.indd 129MD-85215-1 A FIN.indd 129 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
130 CHRISTOPHE MONNOT
nouvelle petite communauté située rue du Tunnel à Lausanne 20. Les principaux groupes islamiques de la capitale font ainsi partie de l’UVAM et sont presque tous issus d’une même communauté. Malgré les différentes origines « ethniques », les protagonistes au sein de l’UVAM se connaissent, offrant ainsi une grande cohésion interne à l’Union. Sur ce point, elle se distingue de nombreuses autres fédérations cantonales, créées pour des besoins de représen-tation légale sur le plan cantonal 21. Elle apparaît véritablement comme l’émanation des acteurs musulmans pour se mettre ensemble et trouver une voix commune en vue de la reconnaissance légale sur le plan religieux.
3. L’invisibilité publique comme performance du respect
La diffi culté que j’avais rencontrée pour trouver la « mosquée turque de Lausanne » qui est en réalité une grande maison de cou-leur saumon plantée en bout de rue n’est pas anodine. Cette diffi -culté à repérer les centres culturels est un trait commun à chacune des salles de prière. Souvent, ce sont des bâtiments sans aucun luxe, qui se différencient des autres seulement par une petite plaque indi-quant la fi nalité du lieu. Les mosquées du canton de Vaud n’ont donc rien du centre de diffusion avec pignon sur rue, mais possèdent plutôt les caractéristiques de l’association privée, à l’instar des cercles italiens, espagnols ou portugais qui les ont précédés en Suisse.
Dissimuler le stigmateL’accès à ces lieux est souvent mal aisé et réservé à une popula-
tion qui connaît parfaitement l’endroit. Le centre kosovar de Lau-sanne, par exemple, est logé au deuxième étage d’une vieille bâtisse ; la communauté musulmane de Vevey se réunit dans un ancien garage localisé à la jonction de deux rues et caché derrière une sta-tion-service ; le centre bosniaque d’Yverdon est situé en pleine zone industrielle. Lors de la semaine des religions en 2009, Sarah Bour-quenoud écrivait dans un reportage pour le journal 24 heures :
20. Pascal Gemperli m’a dit vouloir s’y rendre et débuter des pourparlers avec eux. Un doute subsiste sur les options doctrinales du groupe, certains y voient des accoin-tances avec le piétisme salafi ste.
21. Voir le chapitre 2 du présent ouvrage.
MD-85215-1 A FIN.indd 130MD-85215-1 A FIN.indd 130 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 131
La mosquée de Moudon est discrète. Tellement discrète, d’ailleurs, que ce n’est pas vraiment une mosquée. « Le terme est un peu auda-cieux, vu le bâtiment ! C’est plutôt un lieu de prière », indique David Gun […]. Première halte, donc, la mosquée. A deux pas de la gare, dans un bâtiment anonyme, il suffi t d’enlever ses souliers et de fran-chir le seuil pour un dépaysement total. Ou presque : pas besoin de maîtriser la langue du Coran pour fréquenter les lieux 22.
Cette situation provient de plusieurs facteurs. Citons entre autres la diffi culté de trouver un lieu d’implantation et la précarité fi nan-cière 23. Mais pas seulement. Il y a aussi une volonté de discrétion de la part des acteurs eux-mêmes. Cette invisibilité physique des salles de prière est en partie due au refl ux des mosquées dans des zones en marge des villes et des quartiers, telle l’annexe d’un centre agricole à Moudon, mais participe aussi d’une invisibilité sociale des activités des associations 24.
Dans la perspective du sociologue Erving Goffman, cette discré-tion sociale n’est pas anodine. Fruit de contraintes internes (telle la diffi culté fi nancière d’une location), elle est également adressée « à l’intention des autres » 25. Ces autres sont les voisins, les conci-toyens ou les résidents suisses qui ont un pouvoir d’opposition. Par le jeu du système démocratique, les voisins peuvent s’opposer ou entraver l’implantation et le bon fonctionnement d’une communauté. Adrain Vatter et Deniz Danaci ont d’ailleurs relevé, dans leur analyse des votations cantonales et fédérales portant sur les minorités 26, que le système de dé mocratie directe fonctionne comme un frein à l’é galité juridique des minorité s religieuses plutô t que comme une protection. « En raison des craintes et des incertitudes d’une large part de la population », ajoute Baumann 27. En demeurant dans l’invi-sibilité sociale, les communautés musulmanes locales se prémunis-sent contre les risques d’une interaction sociale potentiellement
22. http://archives.24heures.ch/vaud-regions/actu/mosquee-eglise-brave-inconnu-2009-11-08 (consulté le 15.03.2013).
23. Voir à ce propos le chapitre premier du présent ouvrage.24. Voir Claire de GALEMBERT, « De l’inscription de l’islam dans l’espace urbain »,
Annales de la recherche urbaine 68-69, 1995, pp. 178-188.25. Erving GOFFMAN, La mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de
soi, Paris, Editions de Minuit, 1973, p. 25.26. Adrian VATTER et Deniz DANACI, « Mehrheitstyrannei durch Volksentscheide ? »,
Politische Vierteljahresschrift 51 (2), 2010, pp. 205-222.27. Martin BAUMANN, « Les collectivités religieuses en mutation », in : Christoph
BOCHINGER (éd.), Religions, Etat et société. La Suisse entre sécularisation et diversité religieuse, Zurich, Neue Zürcher Zeitung Verlag, 2012, pp. 21-74, ici p. 68.
MD-85215-1 A FIN.indd 131MD-85215-1 A FIN.indd 131 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
132 CHRISTOPHE MONNOT
négative avec leur environnement 28. Elles offrent une représentation d’elles-mêmes ou une « façade » 29 de discrétion à la société.
Cette invisibilité est d’autant plus importante que l’islam souffre en Europe de plusieurs stéréotypes 30. En évitant une forte interac-tion, on esquive les effets d’une stigmatisation sociale. Depuis le 11 septembre 2001, la fi gure du musulman a émergé et peu à peu supplanté celles des origines ethniques (le Maghrébin, le Turc, le Macédonien, etc.) 31. Connotée négativement, cette fi gure a été uti-lisée en Suisse comme repoussoir, notamment en 2004 lors des votations sur les naturalisations facilitées. Appartenir à la confes-sion musulmane est devenue un « stigmate » sur le plan social 32. Une caractéristique qui discrédite un individu dans ses rapports sociaux. Avant, on était un ouvrier turc bienvenu, maintenant on est un musulman mal intégré. Ainsi, pour continuer avec Goffman, le groupe musulman « qui aurait pu aisément se faire admettre dans le cercle des rapports sociaux ordinaires possède une caractéristique telle qu’il peut s’imposer à l’intention de ceux d’entre nous qui le rencontrent et nous détourner de lui, détruisant ainsi les droits qu’il a vis-à-vis de nous du fait de ses attributs » 33. La religion musul-mane n’est pas un attribut neutre dans l’interaction, a fortiori dans le cas des communautés, puisque le lien avec la pratique religieuse y est évident. Si le fait d’appartenir à la confession musulmane est un stigmate social, que penser alors du fait d’organiser sa pratique régulière dans une région ? L’invisibilité sociale des associations
28. Voir Samuel M. BEHLOUL, « Discours total ! Le débat sur l’islam en Suisse et le positionnement de l’islam comme religion publique », in : Mallory SCHNEUWLY PURDIE, Matteo GIANNI et Magali JENNY (éd.), Musulmans d’aujourd’hui. Identités plurielles en Suisse, Genève, Labor et Fides, 2009, pp. 53-72 ; Jörg STOLZ, « Explaining Islamo-phobia. A Test of Four Theories Based on the Case of a Swiss City », Schweizerische Zeitschrift für Soziologie – Revue suisse de sociologie 31 (3), 2006, pp. 547-566 ; Mal-lory SCHNEUWLY PURDIE, Joëlle VUILLE, « Egalitaires ou discriminatoires : considéra-tions sur l’exercice de la liberté religieuse en contexte carcéral », Revue internationale de criminologie et de police scientifi que et technique 63 (4), 2010, pp. 496-490.
29. Erving GOFFMAN, La mise en scène de la vie quotidienne, pp. 29-36.30. Raoul C. VAN CAENEGEM, « Historical Refl ections on Islam and the Occident »,
European Review 20 (2), 2012, pp. 203-209 ; Mallory SCHNEUWLY PURDIE, De l’étranger au musulman : immigration et intégration de l’islam en Suisse, Saarebruck, Ed. univer-sitaires européennes, 2010.
31. Voir le chapitre 3 du présent volume.32. Samuel M. BEHLOUL, « The Society is watching you ! Islam-Diskurs in der
Schweiz und die Konstruktion einer öffentlichen Religion », in : Michael DURST et Hans J. MÜNK (éd.), Religion und Gesellschaft, Freiburg (CH), Paulusverlag (Theolo-gische Berichte 30), 2007, pp. 276-317.
33. Erving GOFFMAN, Stigmate : les usages sociaux des handicaps, Paris, Editions de Minuit, 1975, p. 15.
MD-85215-1 A FIN.indd 132MD-85215-1 A FIN.indd 132 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 133
musulmanes permet de cacher le stigmate, dès lors qu’elle se sous-trait à l’interaction sociale 34.
Quand les femmes ne dévoilent pas le stigmateEn Europe, une part importante de ce stigmate se porte sur la
femme voilée. Cette dernière constitue la face visible d’une religion « antimoderne » 35. Le voile signe la présence islamique dans l’es-pace public 36. Mais en Suisse, les communautés sont très peu expo-sées à cette forme de visibilité, car les femmes ne vont pratiquement pas à la mosquée. Comme la salle de prière n’est pas accompagnée d’irruption de fi dèles voilées, elle peut rester cantonnée dans un espace particulier, celui des associations privées. La raison à cette situation provient du fait que les femmes de la première génération d’immigrés, peu émancipées, demeurent à la maison dans une logique traditionnelle. Nilüfer Göle l’exprime ainsi :
Quand les laïcs turcs affi rment : « On aime le foulard de nos grands-mères », c’est parce que celles-ci ne sortaient pas de leur maison, ne quittaient pas leur fauteuil de grand-mère, ne revendiquaient pas leur présence dans d’autres espaces que l’espace familial et communau-taire. Le cas est similaire à celui des femmes de la première généra-tion d’immigrés, cantonnées dans leur maison, beaucoup plus traditionnelles, beaucoup moins émancipées du point de vue fémi-niste, et moins intégrées, vivant dans l’enclave de la communauté. Ce foulard ne dérangeait pas. Mais aujourd’hui, lorsque les fi lles voilées franchissent les frontières de l’espace privé sans assimiler les conven-tions implicites de l’espace public laïque, en se référant à une autre discipline du corps, une autre discipline personnelle, cette attitude suscite l’anxiété 37.
En ne participant pas aux rites de la piété collective et en se tenant à la maison, les femmes musulmanes concourent à l’invisibilité du collectif musulman. La communauté peut rester un banal centre de rencontre.
34. Voir Alexandre PIETTRE, « La sociologie de l’espace public à l’épreuve de la communauté. Le renouveau islamique dans l’expérience politique du Kollectif de Bondy (2000-2001) », Revue européenne des migrations internationales (à paraître) ; Erving GOFFMAN, Les rites d’interaction, Paris, Editions de Minuit, 1974.
35. Nilü fer GÖLE, Musulmanes et modernes. Voile et civilisation en Turquie, Paris, La Découverte, 1993.
36. Leila AHMED, A Quiet Revolution : The Veil’s Resurgence from the Middle East to America, New Haven, Yale University Press, 2011 ; Saba MAHMOUD, Politique de la piété. Le féminisme à l’épreuve du renouveau islamique, Paris, La Découverte, 2009.
37. Nilüfer GÖLE, Interpé né trations. L’Islam et l’Europe, pp. 113-114.
MD-85215-1 A FIN.indd 133MD-85215-1 A FIN.indd 133 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
134 CHRISTOPHE MONNOT
A ce propos, attardons-nous sur deux cas particuliers dans le canton de Vaud : le Complexe culturel des musulmans de Lausanne (CCML) et la Mosquée de Lausanne. Le premier comprend dans son organisation quelques femmes très dynamiques. Relevons cependant que l’engagement féminin reste marginal. Les voiles sont loin de couvrir le tapis du CCML puisqu’on ne compte qu’une femme pour vingt hommes à la prière du vendredi 38. La visibilité dans l’espace public est certes plus importante, mais demeure limitée. Dans le second cas, la Mosquée de Lausanne, la présence féminine est plus marquée lors de la prière, mais est relativisée par un code vestimentaire beaucoup plus souple. Les femmes sont bien voilées, mais avec des foulards « Gucci ou Prada ». Même si ce n’est pas tout à fait ça, les fi dèles sont habillées selon les canons de la mode, avec des bijoux ou grandes lunettes de soleil griffées. Cet apparat fashion atténue fortement le contraste entre les fi dèles et les autres femmes de la rue. En conséquence, à l’exception toute rela-tive de ces deux communautés, on constate que l’invisibilité des groupes dans l’espace public est soutenue par la piété féminine can-tonnée pour diverses raisons à l’espace domestique.
Sur le plan local, les associations musulmanes peuvent ainsi passer quasi inaperçues. En fait, les quelques débordements sur la place publique se résument presque exclusivement à l’occupation massive des parkings disponibles par des voitures de fi dèles se déplaçant pour prier. C’est pourquoi le jeune Turc qui m’a accueilli à Lausanne m’a demandé de ne pas me garer dans la rue. A ce propos, un entrepreneur, voisin du centre bosniaque d’Yverdon, sis en pleine zone industrielle, m’a exprimé cette doléance : « Ah ! mais ils sont très discrets ces musulmans. On ne les voit presque pas, mais alors, le vendredi en début d’après-midi, on se fait envahir ! Plus une place de parc disponible dans la zone ! » En conséquence, en dehors de cette extrusion par l’automobile, les communautés musulmanes s’organisent dans le strict domaine privé. Les respon-sables peuvent de cette manière rendre compte sur le plan com-munal ou municipal d’une activité sans caractère disruptif, participant à la vie et à la tranquillité du quartier. On assure ainsi au moins la pérennisation des lieux de rencontre de la communauté, et l’on évite la stigmatisation du centre sur le plan local.
38. Au CCML, il y a environ 400 hommes et 20 femmes pour la prière du vendredi.
MD-85215-1 A FIN.indd 134MD-85215-1 A FIN.indd 134 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 135
Une stratégie de résistanceDans cette situation, les associations musulmanes, en demeurant
discrètes, développent une stratégie de la résistance. Pour l’exprimer avec James Scott, les communautés offrent un « texte public » de retenue. Elles sont d’ailleurs si effacées que peu de concitoyens ont connaissance de la foisonnante diversité des groupes. Ce « texte public » ne va pourtant pas sans un « texte caché [qui caractérise] le discours qui a lieu dans les coulisses, à l’abri du regard des puis-sants. Le texte caché a de la sorte un caractère situé : il consiste en des propos, des gestes et des pratiques qui confi rment, contredisent ou infl échissent, hors de la scène, ce qui transparaissait dans le texte public », remarque Scott 39. Dans cette perspective, il est possible de mieux interpréter les propos d’un acteur musulman qui, en réponse à la présentation de l’enquête, m’a demandé si j’allais retransmettre le discours des membres ou celui des responsables. Les discours internes, peu contrôlés, ou celui réservé à l’extérieur, plus policé et plus standardisé. Bien que ces deux niveaux ne soient pas une particularité des associations musulmanes, ils constituent néanmoins un enjeu capital pour ces groupes. C’est pourquoi, avec la fondation de l’UVAM, la communauté locale pourra avoir un organe représentatif, un émetteur offi ciel du « texte public » commun à toutes les autres mosquées du canton, tout en demeurant localement discret dans l’espace public.
Un exemple de l’importance de cet enjeu est illustré par les propos du président du centre culturel turc de Lausanne. Après le vote de l’initiative interdisant la construction de minarets, il m’avoue avoir eu très peur. « J’avais peur de la réaction des musulmans après une telle humiliation. C’était vraiment diffi cile à vivre, pourtant les musulmans ont très bien réagi. Ils ont contenu leurs émotions et n’ont pas fait le jeu de l’UDC 40, car s’ils avaient réagi ils auraient donné raison à ce parti. » Selon ce responsable, il a bien fallu affi cher un « texte public », un « discours du subordonné en présence du domi-nant » 41, qui exprimait de la retenue et de la compréhension pour ne pas envenimer le débat. Dans le cas de cette initiative, relevons ici que la stratégie de la résistance par l’invisibilité n’a pas porté les fruits escomptés. Les musulmans qui voulaient se montrer conci-liants ont l’impression de s’être fait trahir par la population lors de
39. James C. SCOTT, La domination et les arts de la résistance. Fragments du dis-cours subalterne, Paris, Editions Amsterdam, 2008, p. 19.
40. Voir note 75, p. 49.41. Ibid.
MD-85215-1 A FIN.indd 135MD-85215-1 A FIN.indd 135 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
136 CHRISTOPHE MONNOT
ce vote. Bien que le « texte public » n’ait pas changé à l’interne, une demande de reconnaissance, au moins sur le plan social, se conso-lide. La mise en commun des forces par une fédération semble plus opportune que jamais. Elle permet une reconnaissance en tant qu’acteurs religieux qui agissent dans le respect de la paix confes-sionnelle au niveau cantonal.
Quand l’invisible devient méprisA l’évidence, le dispositif implicite de l’invisibilité des commu-
nautés musulmanes dans l’espace public a très bien fonctionné jusque-là. Du point de vue local, il a permis d’obtenir des salles de prière et de protéger les faibles acquis. Il a opéré comme le degré minimal de reconnaissance, le respect. Une relation sur le plan local de reconnaissance mutuelle qui « impose de s’abstenir de certains types d’actions » 42. Les centres musulmans en demeurant réservés sur le territoire vaudois ont tenté d’obtenir un respect de leur entou-rage. Ils ont cherché à dépasser la simple connaissance d’une pré-sence dans le voisinage. En se montrant discrets, ils comptent acquérir une place à leur « valeur » 43, être reconnus comme un lieu de pratique religieuse comme d’autres lieux. « Plutôt que d’être exposées à la densité d’un “vivre ensemble” sans écart, même si [elles] y trouveraient égalité et sentiment de participation, [les com-munautés musulmanes ont] préféré la “réserve” 44 d’un espace libéré par une moindre appartenance. » 45
A Genève, par exemple, c’est bien par sa politique « prudente » 46 (mais non sans visibilité) que la Grande Mosquée a pu être reconnue « d’utilité publique ». Dans ce canton, le statut est fi scal et ne cor-respond pas à une reconnaissance juridique spécifi quement reli-gieuse. Malheureusement, coïncidant avec l’arrivée du nouveau
42. Axel HONNETH, « Invisibilité : sur l’épistémologie de la “reconnaissance” », in : ID. et Olivier VOIROL (éd.), La société du mépris : vers une nouvelle théorie critique, Paris, La Découverte, 2006, pp. 225-244, ici p. 238.
43. Paraphrase de la préface d’Olivier VOIROL, in : Axel HONNETH et Olivier VOIROL, op. cit., p. 29.
44. Georg SIMMEL, Sociologie : étude sur les formes de la socialisation (1908), Paris, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 110-111.
45. Joan STAVO-DEBAUGE, « Entre bienfaits de la moindre appartenance et solution de l’exit. L’étranger de Simmel à la lutte avec la reconnaissance », in : Ferrarese ESTELLE (éd.), Qu’est-ce que lutter pour la reconnaissance ?, Lormont, Le Bord de l’eau, 2013, pp. 134-165, ici p. 144.
46. « Chaque vendredi, 30 000 fi dèles suivent la prière », L’Hebdo, 09.12.2004, http://www.hebdo.ch/chaque_vendredi_fi degraveles_suivent_la_priegravere_19578_.html (consulté le 15.03.2013).
MD-85215-1 A FIN.indd 136MD-85215-1 A FIN.indd 136 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 137
siècle, plusieurs événements vinrent ébranler la stratégie de discré-tion des musulmans du Pays de Vaud. Actuellement, les lieux de culte, les centres islamiques, les salles de prière sont encore carac-térisés par l’invisibilité (ou la visibilité minimale : une plaque au mur désignant le but du bâtiment ou l’intrusion de voitures dans le quartier le vendredi à la mi-journée). Un silence sur la place publique censée conduire au respect. Mais ce n’est pas ce scénario qui est en train de se jouer. Comme le relève Olivier Voirol : « Les acteurs invisibles sont privés d’attention, ne font pas l’objet d’une quel-conque considération, pas même celle de la stigmatisation ; ils se trouvent exclus, non seulement des relations de reconnaissance, mais des relations tout court. Autrement dit, il y a une forme de mépris extrême qui passe par le silence et l’invisibilité dans l’espace d’apparition publique et qui surpasse de loin les formes de mépris s’exprimant par l’insulte, le dénigrement et la dévalorisation. » 47 Avec le coup de projecteur médiatique à la suite des attentats du 11 septembre 2001, c’est le mépris et la dévalorisation qui se sont peu à peu imposés. Cette situation extrême a motivé les groupes vaudois à se fédérer pour faire entendre une voix dans l’espace public.
4. L’Union vaudoise des associations musulmaneset la lutte pour la reconnaissance légale
Dans la « mosquée turque de Lausanne », banal bâtiment d’une rue d’Ecublens, dans la périphérie de Lausanne, l’assemblée de l’UVAM, à laquelle j’étais convié, se concertait sur une stratégie misant sur une tout autre dimension que la discrétion : la visibilité des musulmans. En effet, les objectifs de cette union sont notam-ment : « améliorer la visibilité des musulmans », « faire connaître les besoins des musulmans » et « promouvoir l’intégration et la reconnaissance sociale des musulmans » 48. A l’invisibilité locale des lieux, l’UVAM répond par la visibilité des musulmans. En contrepartie de la réserve et discrétion des groupes locaux, l’UVAM veut faire connaître les besoins et positions des fi dèles islamiques. Malgré la reconnaissance minimale et locale, l’UVAM a pour objectif d’obtenir une reconnaissance sociale large et si possible légale dans le canton de Vaud. L’Union constitue ainsi un parapluie
47. Olivier VOIROL, « Les luttes pour la visibilité . Esquisse d’une problé matique », Réseaux 1 (129-130), 2005, pp. 89-121, ici pp. 117-118.
48. http://www.uvam.ch (l’UVAM en bref), consulté le 15.03.2013, c’est nous qui soulignons.
MD-85215-1 A FIN.indd 137MD-85215-1 A FIN.indd 137 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
138 CHRISTOPHE MONNOT
fédératif dans la lutte pour la reconnaissance sociale en tant qu’ac-trice légitime et, espère-t-elle, fi nalement légale en tant que « com-munauté religieuse d’intérêt public ».
Les premiers pas fédératifsLa stratégie de l’invisibilité, du point de vue social, s’est montrée
inadaptée face aux changements récents. La catégorisation en Suisse de « l’étranger – musulman » 49 a rempli le vide social laissé par le retrait de la scène publique. L’invisibilité a immanquablement conduit à un « déni de reconnaissance » ou au « mépris », comme le conceptualise le philosophe et sociologue Axel Honneth 50. Les communautés se sont ainsi trouvées dans une dynamique, pour le dire avec Joan Stavo-Debauge 51, de « l’invisibilité du tort et du tort de l’invisibilité ». Dans le cas des associations musulmanes vau-doises, l’invisibilité du tort se réfère à ce dispositif d’évitement du stigmate, en se rendant le plus discret possible. En se dissimulant, le « tort » social devient invisible, mais avec un corollaire : le « tort » de ne pas apparaître dans le corps social. Et ne pas apparaître mène en fi n de compte à l’insignifi ance ou à l’inexistence sociale, ou même au « mépris ».
Après les événements du 11 septembre 2001, les musulmans se trouvèrent dépassés par l’actualité qui jetait un coup de projecteur intense sur leur présence en Suisse et en Europe. Dans cette tour-mente, ils ont été épaulés par plusieurs représentants chrétiens. Res-ponsables de centres islamiques, pasteurs et prêtres locaux vaudois ont ainsi créé le groupe « Musulmans et chrétiens pour le dialogue et l’amitié » (MCDA) au lendemain des attentats du 11 septembre. Comme le relève Axel Honneth : « Pour que je puisse apporter à l’étranger ma reconnaissance dans un sentiment de sympathie et de solidarité pour son itinéraire personnel, il faut d’abord que je sois mû par une expérience qui m’enseigne que nous sommes menacés, sur le plan existentiel, par les mêmes risques. » 52 Dans l’actua-lité du 11 septembre, la religion devient clairement un risque de
49. Voir notamment Samuel M. BEHLOUL, « Homo Islamicus als Prototyp des Fremden », Swissfuture-Magazin (11), 2011, pp. 8-11 ; ID., « Negotiating the “Genuine” Religion : Muslim Diaspora Communities in the Context of the Western Understanding of Religion », Journal of Muslims in Europe 1 (1), 2012, pp. 7-26.
50. Axel HONNETH, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000.51. Joan STAVO-DEBAUGE, « L’invisibilité du tort et le tort de l’invisibilité », Espa-
cesTemps.net, Actuel, 2007, en ligne : http://espacestemps.net/document2233.html (consulté le 15.03.2013).
52. Axel HONNETH, op. cit., p. 155.
MD-85215-1 A FIN.indd 138MD-85215-1 A FIN.indd 138 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 139
stigmatisation de la société. Elle est décrite sous son potentiel extré-miste et dangereux. C’est pourquoi l’émergence de ce groupe de dialogue interreligieux permet une première reconnaissance mutuelle des grandes confessions du canton 53. Ensemble, elles se fédèrent sur la base de la représentation qu’une religion intégrée et constitutive de la société est une religion de dialogue, d’ouverture et de solida-rité. Une reconnaissance de vis-à-vis entre acteurs religieux, mais également face à la société, comme représentants d’une religion profondément intégrée aux cadres normatifs de la société. Cette reconnaissance est d’autant plus importante que, dans le canton de Vaud, les deux Eglises reconnues comme « institutions de droit public » sont engagées dans ce dialogue.
Ce premier pas fructueux a été suivi d’un autre, initié de l’inté-rieur même de la communauté musulmane du canton. Il aboutit en 2004 à la fondation de cette Union vaudoise des associations musul-manes (UVAM) qui, comme on l’a dit, réunit toutes les commu-nautés musulmanes alors en activité sur le territoire cantonal, à part la Mosquée de Lausanne. A l’instigation de Montassar Ben M’rad, un homme d’affaires, cette Union a pu se constituer juridiquement après d’âpres négociations sur la formulation des statuts et sur les valeurs fondamentales communes. La tendance à l’atomisation de l’islam vaudois a pu être ainsi infl échie. Les différentes branches – selon les origines culturelles et linguistiques – trouvaient une même voix. La première occasion que l’UVAM saisit fut d’ex-primer son soutien à l’imam de la Mosquée de Lausanne 54 qui venait d’être poignardé. Cette première incursion dans la sphère publique était un ballon d’essai : elle était relativement feutrée et concernait une affaire intramusulmane. Il fallut un second choc pour que l’UVAM entre dans sa stratégie actuelle visant la reconnaissance au titre de « communauté religieuse d’intérêt public ».
Après l’acceptation de l’initiative contre la construction des minarets, en novembre 2009, plusieurs responsables musulmans décidèrent de sortir de l’ombre. L’UVAM était fi nalement le meilleur moyen pour se faire connaître auprès du public. Elle prend « conscience de la signifi cation sociale de ses actes. Car l’acteur ne peut “contrôler le comportement d’autrui” s’il ne connaît pas la signifi cation que son propre comportement revêt, dans leur situation
53. Voir Anne-Sophie LAMINE, « Mise en scène de la “bonne entente” interreli-gieuse et reconnaissance », Archives de sciences sociales des religions 129, 2005, pp. 83-96.
54. Mosquée avec laquelle l’UVAM n’était pas parvenue à un accord.
MD-85215-1 A FIN.indd 139MD-85215-1 A FIN.indd 139 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
140 CHRISTOPHE MONNOT
commune, aux yeux de son partenaire » 55, constate Axel Honneth. C’est à ce moment-là que Pascal Gemperli prit toute son impor-tance. Le comité de l’UVAM a approché ce Suisse bien au fait du « monde musulman » et qui travaille dans la communication et la médiation de confl its 56. Fasciné par la culture moyenne-orientale, récemment converti à l’islam (2005), ce Suisse connaît parfaitement les institutions de son pays, parle l’allemand, le français, l’anglais et s’exprime également en arabe. Etant Suisse, il n’a pas de loyauté spéciale avec un groupe d’une origine régionale particulière, si ce n’est par son épouse marocaine. Son entrée dans le comité de l’UVAM correspond à un changement de paradigme. L’Union désire transformer sa relation aux médias et en invitant le président actuel, elle se dote de « compétences communicationnelles » pour développer une stratégie d’apparence acceptable. En effet, comme le note Olivier Voirol, « les groupes peu rompus aux procédures et aux savoir-faire susceptibles de faire écho aux schèmes d’intelligi-bilité journalistiques n’ont que de faibles chances d’accéder à la médiatisation – ou, tout au plus, lorsqu’ils y accèdent, c’est davan-tage par la voix des journalistes que par leur propre parole (ils sont plus parlés qu’ils ne parlent). » 57 Les associations réalisent qu’elles ont besoin de compétences pour apparaître dans l’espace public.
L’accent mis sur la reconnaissanceLa recrue de l’UVAM apporta effectivement une impulsion en
clarifi ant le travail de l’association sur quatre axes stratégiques : 1) assurer la visibilité de la communauté musulmane ; 2) faire connaître les besoins de la communauté ; 3) obtenir la reconnaissance socié-tale puis légale de la communauté dans le canton de Vaud ; 4) consolider la cohésion interne et les structures fédératives afi n d’as-surer une représentativité de l’UVAM. Des revendications qui sont formulées dans des termes socialement et médiatiquement accep-tables. De plus, Pascal Gemperli réussit le tour de force de faire l’unanimité au sein de l’Union avec ses associations d’origines mul-tiples, mais également des tendances islamiques différentes, comptant des groupes plus piétistes, d’autres plus libéraux 58, etc. Fort de ce
55. Axel HONNETH, op. cit., p. 124.56. Voir le site : http://www.gemperli-consulting.ch pour plus d’informations sur ses
compétences. Il a écrit plusieurs brochures sur les confl its entre culture, l’islam et la paix, l’impact des médias dans les confl its, etc., aux éditions GRIN à Munich et Ravensburg.
57. Olivier VOIROL, « Les luttes pour la visibilité . Esquisse d’une problé matique », p. 110.58. Quelques présidents d’associations cultuelles islamiques faisant partie de
l’UVAM ne pratiquent pas la prière.
MD-85215-1 A FIN.indd 140MD-85215-1 A FIN.indd 140 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 141
soutien, le président a enclenché une prise de conscience auprès des responsables musulmans pour aller au-delà de la visibilité positive dans l’espace public et entrer dans une vraie lutte pour la reconnais-sance juridique des musulmans en tant que « communauté religieuse d’intérêt public » : elle s’affi rme, pour se « transposer dans le cadre d’une communauté juridique élargie » 59.
Cette stratégie de l’UVAM a trouvé un écho favorable auprès des groupes locaux, car les options discutées dès le départ étaient libé-rales, bien que basées sur des valeurs communes. Ainsi l’Union n’appuie-t-elle ni un type d’islam ni une école juridique, encore moins une pratique particulière, mais des valeurs et contingences religieuses communes à tous les centres islamiques du canton. Dans la tradition libérale, l’UVAM se pose comme un organe de défense et de revendications de droits fondamentaux des individus. Cette optique lui permet de se concentrer sur des questions pragmatiques de gestion de l’islam dans l’espace public. De cette façon, les demandes de reconnaissances sont motivées par des besoins qui paraissent politiquement légitimes 60, car relevant de la défense des droits fondamentaux : l’aumônerie dans les institutions publiques, le respect des principes de la sépulture musulmane (carrés musul-mans), l’intégration des enfants musulmans dans le milieu scolaire (nourriture dans les cantines scolaires, piscine, voile, éducation reli-gieuse, etc.). Bien que plusieurs acteurs au sein de l’UVAM soient engagés politiquement au niveau municipal 61, leurs options et charges ne transparaissent pas. Les revendications gardent un carac-tère pragmatique, apolitique et semble découler d’un meilleur « vivre ensemble ».
Un autre aspect important en vue de la reconnaissance sociale autant que légale est l’implication des femmes dans les structures. On voit mal un Etat cantonal donner une forme de reconnaissance religieuse à un groupe qui ne reconnaît pas l’égalité entre l’homme
59. Axel HONNETH, op. cit., p. 141.60. Alexandre PIETTRE, « Quand l’impolitique acquiert une portée politique. Le
renouveau islamique comme support et forme de politicité en banlieue parisienne », in : Denis MERKLEN, Eduardo RINESI et Etienne TASSIN (éd.), Les diagonales du confl it, Paris, Editions de l’Institut des Hautes études de l’Amérique latine, 2013. Voir égale-ment l’article de Philippe GONZALEZ, « Pourquoi la religion garde son poids dans une société sécularisée », Le Temps, 19 novembre 2012, qui observe que ce n’est pas le nombre de croyants qui détermine le poids d’une religion dans l’espace politique, ainsi que son article montrant comment des confi gurations religieuses et spirituelles induisent des dispositions politiques, « Lutter contre l’emprise démoniaque. Les politiques du combat spirituel évangélique », Terrain (50), 2008, pp. 44-61.
61. Le parti des Verts étant largement surreprésenté.
MD-85215-1 A FIN.indd 141MD-85215-1 A FIN.indd 141 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
142 CHRISTOPHE MONNOT
et la femme 62. Comme observé précédemment, dans les traditions hanafi tes (balkaniques et turques), l’engagement de la femme à la piété collective est traditionnellement quasi nul 63. Pourtant au niveau fédératif, il est important de signaler que les instances comp-tent les voix féminines à égalité avec celles des hommes. Malgré la rareté de la présence féminine dans les associations musulmanes, Pascal Gemperli a encouragé l’implication féminine à partir de la dynamique engagée au CCML. Au comité comptant sept membres siègent actuellement deux femmes compétentes et très engagées dans leur groupe local. Ainsi la vice-présidente, d’origine tuni-sienne, est-elle une personne très active au sein de l’UVAM, dans le groupe interreligieux MCDA et dans des organismes supra-locaux où elle fait entendre la voix de l’UVAM. La secrétaire, une Suisse convertie, s’était fait remarquer à l’époque par le fait qu’elle sié-geait (et siège toujours) au conseil communal (législatif 64) avec le foulard. L’engagement féminin et la question du genre sont impor-tants dans la stratégie de l’UVAM : elle donne une place à la cause féminine, absente dans les communautés locales. Une stratégie qui, en montrant des femmes actives et prenant la parole publique-ment 65, remet en question le stéréotype de la femme silencieuse et soumise 66.
Pour Pascal Gemperli, le travail de l’UVAM porte ses fruits. Il remarque que tous les communiqués de presse faits par l’UVAM ont été retransmis positivement dans la presse. De plus, il note que les journalistes sont plutôt compréhensifs quant aux revendications des musulmans du canton. Il s’agit pour lui clairement d’un succès à mettre sur le compte du travail de l’UVAM. Il est vrai que la com-munication de cette fédération est accessible et que les journalistes
62. Notons que, dans le canton de Vaud, c’est la Fédération ecclésiastique catho-lique romaine du canton de Vaud, succédant à la Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud, qui reçoit les subventions étatiques et non l’Eglise catholique en tant que telle. Je remercie ici Philippe Gardaz, président du conseil de l’Institut des religions de l’Université de Fribourg, pour son éclairage juridique sur les questions de droit ecclé-siastique.
63. Rappelons ici que l’invisibilité féminine est une contingence de la migration, renvoyant aux traditions des pays d’origine, bien avant d’être l’effet d’une cause reli-gieuse.
64. L’exécutif étant le conseil municipal ou Municipalité.65. Lorena PARINI, Matteo GIANNI et Gaëtan CLAVIEN, « La transversalité du genre :
l’islam et les musulmans dans la presse suisse francophone », Recherches féministes 25 (1), 2012, pp. 163-181.
66. Cet engagement est surreprésenté par les femmes d’origine maghrébine ou suisse, laissant encore peu de place aux personnes originaires des Balkans ou de Tur-quie.
MD-85215-1 A FIN.indd 142MD-85215-1 A FIN.indd 142 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 143
peuvent y trouver de véritables partenaires pour traiter l’informa-tion. Cette apparition dans l’espace médiatique n’assure pas forcé-ment une amélioration du statut des communautés sur le plan local ; en revanche, l’UVAM se profi le bien comme le pivot entre les ins-tances publiques ou politiques et les institutions locales. Un point essentiel pour acquérir de la légitimité et obtenir une quelconque reconnaissance du point de vue juridique.
L’émergence du rôle médiateur de l’Union vaudoisedes associations musulmanes
Lors de notre enquête, deux affaires viennent éclairer ce rôle encore balbutiant de pivot de l’UVAM. Les deux cas ont en commun de provenir de communautés albanophones invisibles socialement. Cette invisibilité est d’ailleurs de plusieurs natures. Tout d’abord, les fi dèles musulmans de ces associations ne se distinguent pas des autres citoyens suisses par des habillements spécifi ques : les hommes ne portent pas de barbe ni de couvre-chef, les femmes sont très rarement voilées. Ensuite, les initiateurs de lieux de prière sont des immigrants de première génération dont les positions sociales n’of-frent pas non plus une grande visibilité dans la société 67. Enfi n, leur connaissance des institutions publiques est pratique, ils sont peu familiers des subtilités légales. Ce manque de visibilité confère, comme nous l’avons relevé, un « tort » pour la reconnaissance. Dans les deux cas retenus, les revendications portent sur l’obtention d’un lieu de culte. La position sociale et le réseau des initiateurs ne leur permettent pas d’être pris au sérieux, et leurs demandes sont reléguées dans l’espace des requêtes mineures, puisque peu visibles.
Le premier cas concerne l’association albanophone d’Yverdon. Il a suffi que Le Matin s’intéresse à leur lieu de prière (l’ancien loft d’un politicien s’était transformé en salle de prière musulmane) 68 pour que la communauté en soit éjectée. Au moment des faits, le journal 24 heures s’est bien intéressé à raconter l’éviction de ce groupe, mais, depuis, c’est le silence complet. Cette communauté est toujours à la recherche d’un lieu de culte. Les fi dèles se rendent, en attendant, à la salle de prière du centre bosniaque sans véritable-ment comprendre la langue. A cette époque, l’UVAM n’avait pas
67. Voir Pierre BOURDIEU, « Espace social et genèse des “classes” », Actes de la recherche en sciences sociales 52-53 (1), 1984, pp. 3-14, et ID., « La représentation de la position sociale », Actes de la recherche en sciences sociales 52-53 (1), 1984, pp. 14-15.
68. Fabiano CITRONI, « Le bordel est devenu un lieu du culte », Le Matin du 11 mars 2011, p. 7.
MD-85215-1 A FIN.indd 143MD-85215-1 A FIN.indd 143 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
144 CHRISTOPHE MONNOT
été interpellée. Le comité l’a appris par la presse, ce qui révèle bien que le programme de l’Union faîtière n’est pas encore parfaitement intégré au niveau local 69. Plus tard, l’UVAM a diffusé un commu-niqué et en a profi té pour rappeler le cas d’Yverdon, mais c’était trop tard. L’information n’a pas été relayée.
Le deuxième cas est assez similaire, car c’est également par voie de presse, au travers de 24 heures, que Pascal Gemperli apprit que la municipalité avait refusé d’octroyer un permis de changement d’affectation du local. Il a alors téléphoné au responsable de la com-munauté kosovare de Lausanne qu’il connaît bien, puisque très impliqué dans l’UVAM, et lui a expliqué les faits. Une fois de plus, on remarque ici que si l’Union a su clarifi er sa mission et ses objec-tifs qui transcendent les origines nationales, les associations locales, de leur côté, sont encore profondément ancrées dans leur réseau de solidarité nationale. Pour Payerne, cependant, Pascal Gemperli apprit l’événement assez tôt pour proposer ses services de média-tion auprès des responsables locaux. Ainsi, cinq jours après l’an-nonce offi cielle du refus de la commune, l’UVAM a pu faire un communiqué de presse donnant sa position et invitant les différentes parties à une table ronde. Par ce moyen, l’UVAM devenait un médiateur entre les autorités, les représentants religieux et l’associa-tion kosovare locale.
Le communiqué de presse de l’UVAM a eu un grand retentisse-ment médiatique puisque plusieurs articles de presse s’y sont référés et que la radio et la télévision suisse romande en ont fait des repor-tages. L’Union a pu ainsi montrer son utilité et sa légitimité, autant pour les musulmans que pour les différents acteurs sociaux. Cepen-dant, au lendemain de la table ronde, l’article du gratuit 20 Minutes commençait par : « Des femmes voilées et des hommes barbus dans la paroisse catholique de Payerne lundi soir… » Il était en outre agrémenté d’une photo aérienne de la mosquée de Genève avec pour légende : « Les adeptes de l’islam à Payerne voudraient disposer d’un lieu de culte comme celui du Petit-Saconnex à Genève » 70. Ces points montrent l’immense travail qu’il reste
69. Conscient de ce problème, le comité de l’UVAM a invité Tariq Ramadan en avril 2012 pour donner une conférence « Musulmans vaudois : ensemble pour la recon-naissance ». Une rencontre qui a mobilisé 300 hommes et 150 femmes. L’attention s’était portée sur la star et son avis sur le Printemps arabe. Bien que s’éloignant du thème, le but premier de la conférence était atteint par la mobilisation suscitée à l’inté-rieur de la communauté musulmane.
70. Abdoulaye PENDA NDIAYE, « Nous voulons prier et être enterrés là où nous vivons », 20 Minutes, 21 mars 2012, p. 7 (la version papier que nous citons ici ne cor-respond pas à la version en ligne).
MD-85215-1 A FIN.indd 144MD-85215-1 A FIN.indd 144 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 145
encore à faire à l’UVAM pour faire entendre leur voix et sortir des stéréotypes. Lors de la soirée qui a rassemblé une centaine de per-sonnes, il y avait peut-être trois hommes portant la barbe islamique et au plus dix femmes avec un foulard… De plus, que la demande pour une salle de prière d’une centaine de mètres carrés soit com-parée à la mosquée Genève qui réunit chaque week-end 2000 fi dèles le vendredi est un geste qui n’est pas anodin ! Evidemment, en se positionnant comme le représentant de tous les musulmans sans dis-tinction, l’UVAM risque, et c’est ce que l’on perçoit ici, d’être décrite selon le stéréotype dominant des médias comme une organi-sation arabisante, alors que c’est loin d’être le cas 71.
Avec ces deux affaires, on comprend mieux le positionnement de l’UVAM et le besoin qu’elle ressent de porter la voix des musul-mans. Ces derniers connaissant souvent mal la langue et les subti-lités juridiques, l’Union apporte une compétence professionnelle à leurs instances locales, qui se tournent encore d’abord vers leur réseau de solidarité nationale. Débouchant sur une table ronde, l’af-faire de Payerne semble pourtant avoir parfaitement mobilisé les acteurs musulmans et montré, à l’interne, la pertinence d’une telle organisation. L’UVAM fait sortir de l’ombre des communautés pour qu’elles puissent obtenir gain de cause 72. Et, au-delà des orga-nisations locales, elle aimerait rendre visible l’ensemble de la confession musulmane afi n d’obtenir une reconnaissance légale de la part du canton.
Une légitimité disputée avec la Mosquée de LausanneL’objectif de la reconnaissance légale est maintenant le centre
d’attention et des activités du comité de l’UVAM qui attend le « Règlement d’application » de la loi ouvrant la porte à une recon-naissance de communautés en dehors de celles déjà reconnues. Ce programme est cependant limité par une autre organisation sur le canton qui affi che une même volonté de représentation de la communauté musulmane au niveau supra-local. Il s’agit de la Mos-quée de Lausanne qui trouve sa légitimité dans son implanta-tion historique et dans le fait qu’« elle dénonce toute forme de
71. Voir le chapitre 3 du présent ouvrage où cette problématique de la représentation est développée et montre combien il est diffi cile pour les musulmans pourtant européens de se départir des stéréotypes d’une religion « étrangère » et non européenne.
72. Les instances communales ont d’ailleurs promis à l’occasion de la table ronde qu’elles feraient leur possible pour informer l’association musulmane des possibilités de location sur la commune. Une promesse qui a été tenue, puisque plusieurs locaux privés ont été proposés à la communauté.
MD-85215-1 A FIN.indd 145MD-85215-1 A FIN.indd 145 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
146 CHRISTOPHE MONNOT
fanatisme, d’extrémisme, de xénophobie et autre déviance » 73. Le discours de l’imam en posture d’érudit islamique plaît. Sa position à l’égard des femmes semble ouverte, ce qui en fait un lieu de ren-contre central pour les converties suisses à l’islam. Cette ouverture pour les membres est contrebalancée par l’opposition à « toute forme de fanatisme » ou de « déviance », qui signifi e, en réalité, une intransigeance envers tous les autres groupes religieux, alors juste-ment taxés de fanatiques. « Pourquoi discuter avec les catholiques ou les protestants, puisqu’ils sont dans l’erreur ? » me dira l’imam. Au sujet de l’UVAM, il s’agit pour lui d’une fédération « infestée par l’extrémisme wahhabite » 74, à laquelle l’imam ne veut pas par-ticiper. Cette position ferme n’a pas permis une entente entre cette Mosquée et l’UVAM qui, depuis, se disputent la légitimité d’être le représentant de l’islam dans le canton.
La mosquée de la Mosquée de Lausanne a un dôme de verre, son architecture est très réussie, son implantation est idéale, son culte est en français, l’accueil est chaleureux, ce qui fait d’elle un lieu privilégié de la part des élus locaux pour marquer sa sympathie lors des fêtes. A l’intérieur, la présence importante de femmes qui, en dehors d’un foulard, sont habillées à l’occidentale et la présence de nombreux Suisses rassurent le visiteur. L’érudition de l’imam et son discours contre l’extrémisme ne font qu’ajouter à sa notoriété. Il est alors très diffi cile pour un non-spécialiste de distinguer qui de l’UVAM ou de la Mosquée de Lausanne est le représentant légitime de l’islam. La stratégie en solo de la Mosquée représente une contra-riété pour la reconnaissance des musulmans dans le canton, puisqu’elle pose de fait la question de la légitimité des instances. Dans les démarches pour obtenir la reconnaissance juridique, il faudra bien que les institutions publiques choisissent entre l’une ou l’autre des organisations. Comment rendre visible une dissidence islamique à des non-musulmans qui ne savent rien des différents courants de l’islam ? Comment faire voir la rigueur doctrinale de cette mosquée d’apparence si ouverte ? L’issue à ce dilemme, pour l’UVAM, est de fait venue des responsables chrétiens locaux quand
73. Presque tous les grands groupes musulmans ont des règlements stricts pour éviter de se faire déborder par l’extrémisme. La déclaration n’a donc rien de particulier si ce n’est que la Mosquée de Lausanne tente de se présenter dans l’espace public comme le fer de lance contre l’excès. Citation tirée de Mouhammad KABA, « Commu-niqué de presse de la Mosquée de Lausanne », 17 novembre 2012 (en réponse à un article de 20 Minutes insinuant que l’imam de la mosquée était polygame).
74. Une accusation non fondée : aucune association de l’UVAM ne vit de fonds saoudiens ou n’entretient de lien particulier avec l’Arabie saoudite, si ce n’est le respect spécifi que pour le pays qui abrite les principaux lieux de pèlerinages.
MD-85215-1 A FIN.indd 146MD-85215-1 A FIN.indd 146 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 147
ils ont proposé de constituer un groupe d’amitié entre responsables religieux. Ils ont pu ainsi engager un dialogue interreligieux dans lequel l’Union s’est fortement impliquée. La Mosquée de Lausanne l’a rejeté, malgré les pressions insistantes des autres protagonistes. De cette manière, l’UVAM a pu obtenir de la légitimité auprès des acteurs religieux et rendre visible l’appartenance de la Mosquée de Lausanne au courant libanais ahbache 75. Même si, pour les acteurs politiques, l’hésitation entre les deux instances peut se justifi er, cela n’est pas le cas des acteurs religieux. Pour eux, la seule instance représentative de l’islam du canton est l’UVAM. Une force non négligeable quand on sait que l’enjeu de la reconnaissance se joue aux Affaires religieuses du Département de l’intérieur de l’Etat de Vaud.
5. Conclusion
Pour les communautés musulmanes du canton de Vaud, le para-doxe de l’exigence d’invisibilité d’une part, de visibilité de l’autre, s’explique par deux niveaux d’action correspondant chacun à un moment historique. Le premier est relatif aux centres, associations et communautés locales qui, jusqu’au début des années 2000, ten-tent de s’établir discrètement. Les communautés cherchaient à obtenir le respect de l’environnement immédiat, du voisinage et des autorités locales. C’était sans compter avec l’exposition publique et la stigmatisation médiatique qui allaient survenir dès 2001. L’invi-sibilité des groupes censée apporter le respect bascule à ce moment-là en potentiel mépris. Plusieurs communautés ont alors été invitées par les responsables chrétiens à entrer dans un dialogue amical. Ce fut la création du MCDA, premier pas vers une reconnaissance mutuelle et une prise de conscience des responsables musulmans de leur valeur en tant qu’acteurs religieux. En 2004, lorsque le climat envers les musulmans se détériora encore, à l’occasion du vote fédéral sur les naturalisations facilitées, les associations locales se fédérèrent dans une union cantonale. Un organe pour faire entendre les revendications musulmanes d’une seule voix était né. L’inter-vention des nouvelles instances dans la sphère publique fut tout d’abord timide. C’est au lendemain du vote contre la construction
75. Les sept associations suisses de cette « dissidence » ou particularité sunnite sont fédérées au sein d’un Conseil islamique suisse : http://www.imam.ch (consulté le 15.03.2013).
MD-85215-1 A FIN.indd 147MD-85215-1 A FIN.indd 147 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
148 CHRISTOPHE MONNOT
des minarets, en 2009, que l’UVAM mit en place une stratégie de visibilité de l’islam. Son objectif déclaré a alors été de tout miser sur la possibilité offerte par le canton de Vaud d’obtenir une reconnais-sance légale.
La situation à laquelle l’UVAM entend répondre peut se résumer par une déclaration que m’a faite l’imam de la mosquée de Vevey :
L’Etat ne doit pas faire semblant de ne rien voir. On se sent stigma-tisé, il est grand temps que l’Etat intervienne pour rétablir l’ordre. Ne rien faire, c’est laisser véhiculer ce qui nuit à notre pays. Beaucoup de nous sommes devenus des musulmans suisses, nous devons être respectés en tant que Suisses 76. Malheureusement, quand on vient chercher le dialogue avec nous, ce n’est pas pour nous connaître, mais pour que l’on doive s’innocenter.
L’Union permet ainsi d’apporter une visibilité pour les associa-tions locales avec des compétences en relations publiques. Et elle entend déjouer la stigmatisation en faisant connaître des revendica-tions pragmatiques et politiquement légitimes des musulmans.
Son emprise a augmenté ces dernières années pour porter une réelle volonté de représentation fédérative et crédible aux yeux des autorités cantonales. Certains groupes sont très engagés dans le pro-gramme de l’UVAM, tandis que d’autres se sont plutôt résolus à y entrer du fait qu’elle constitue l’unique manière « raisonnable » à leurs yeux de se faire entendre auprès des autorités. En retrait du projet, la Mosquée de Lausanne se voit ainsi ravir peu à peu son fl ambeau de représentant naturel. En outre, son dogmatisme à l’égard des autres religions est de plus en plus dénoncé. La situation de lutte pour la légitimité semble tourner en faveur de l’UVAM, mais l’avantage de cette dernière est fragile : elle dépend de la rapi-dité avec laquelle le Canton va adopter le Règlement d’application de la loi sur la reconnaissance des communautés minoritaires et entrer en matière sur une demande formelle de reconnaissance de la part des musulmans 77.
Dans cette attente, les liens qui soudent l’UVAM pourraient se distendre, les diffi cultés concrètes des communautés (et les schismes en faveur de groupes plus rigoristes) gagnant sur l’intérêt général.
76. Relevons ici qu’en 2000, selon le recensement fédéral (OFS), on ne comptait que 10 % de musulmans suisses. Avec les naturalisations des dix dernières années, l’enquête National Congregations Study menée auprès des groupes religieux indique que cette proportion de Suisses (souvent naturalisés) est passée à un tiers environ.
77. Ce canton pourrait être le premier à reconnaître la communauté musulmane en Suisse, Bâle-Ville n’ayant reconnu que les alévis, cf. chapitre 2 du présent ouvrage.
MD-85215-1 A FIN.indd 148MD-85215-1 A FIN.indd 148 23/05/14 09:2823/05/14 09:28
UNE GESTION LOCALE DE L’ISLAM 149
Certains acteurs pourraient alors préférer une visibilité « à la Blancho » 78, beaucoup plus mobilisatrice et médiatiquement por-teuse. Pour conclure, relevons avec Olivier Voirol que « si les acteurs sociaux s’engagent dans des luttes, c’est moins pour maxi-miser leurs intérêts sur la base d’un calcul stratégique que parce que leurs attentes de reconnaissance ont été blessées ; la lutte est alors un moyen de reconquérir une image positive de soi et d’accéder aux conditions sociales de la reconnaissance. » 79 C’est dans cette lutte qu’est engagée l’UVAM au nom des musulmans, une lutte qui représente un défi politique majeur pour les Affaires religieuses du Département de l’intérieur du canton de Vaud d’abord et du Conseil d’Etat (l’exécutif cantonal), pour le Parlement cantonal ensuite.
78. Qui défraie la chronique avec son Conseil central islamique suisse (CCIS), voir le chapitre suivant.
79. Olivier VOIROL, « Luttes pour la reconnaissance », p. 333.
MD-85215-1 A FIN.indd 149MD-85215-1 A FIN.indd 149 23/05/14 09:2823/05/14 09:28