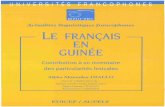Guinée - Projet de renforcement du systeme de sante (Sante III)
Analyse du programme politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Analyse du programme politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).
1
Analyse du programme de société de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG)
2015
Ibrahima SANOH
Citoyen guinéen
2
Sommaire
Introduction ...................................................................................................................................... 4
1) Le renforcement de stabilité macroéconomique ................................................................... 5
2) La stabilité politique ................................................................................................................ 6
3) Les leviers de la croissance économique ................................................................................. 9
a) L’agriculture ......................................................................................................................... 9
b) L’élevage ............................................................................................................................ 11
c) La pêche ............................................................................................................................. 12
d) Les mines ................................................................................................................................ 12
e) Le tourisme et artisanat .................................................................................................... 13
4) Les facteurs clés de succès .................................................................................................... 14
a)L’électricité .............................................................................................................................. 14
b) L’eau ....................................................................................................................................... 15
c) L a justice ........................................................................................................................... 16
d) La lutte contre la corruption ............................................................................................. 17
e) L’inclusion de la gente féminine ........................................................................................ 19
5) La gouvernance ...................................................................................................................... 21
a) La gouvernance économique ............................................................................................ 21
b) La gouvernance financière ................................................................................................ 22
c) La gouvernance politique .................................................................................................. 22
3
d) La gouvernance administrative ......................................................................................... 24
5) Les réformes de l’éducation .................................................................................................. 25
6) Les réformes de la santé........................................................................................................ 27
7) La promotion d’un environnement sain des affaires ............................................................ 28
Conclusion ....................................................................................................................................... 30
4
Introduction
Analyser le programme de société d’un parti politique n’est pas aisé, surtout quand on dispose d’un
délai imparti. On est pris entre le désir de faire vite et la contrainte de bien le faire. Par ailleurs,
l’analyse doit porter sur des thématiques diverses que difficiles. Dans l’analyse du programme de
société de l’UFDG, comme ce sera pour celui des autres partis, nous avons tenu en compte la forme
de l’expression de la promesse d’intervention publique et le contenu des idées exprimées. La
faisabilité du contenu, la mesurabilité des objectifs, sa spécificité et aussi la cohérence entre les idées
exprimées ont été tenues compte pour la production de ce travail.
Il ne nous a pas été facile de résumer le plus ce travail. Le programme de l’UFDG était lui-même
grand et cernait diverses problématiques. Désireux de faire le travail le plus objectif qui soit et
désintéressé, je ne pouvais simplifier l’irréductible quitte à perdre de vue mon dessein celui de la
manifestation des vérités, de la force de proposition de chacun des partis. La méthodologie suivie
dans ce travail est celle que nous avions esquissée dans l’article : « Tyrannie des chiffres et mots :
Analysons le programme de société de nos partis politiques», publié le 28 septembre 2015.
5
1) Le renforcement de stabilité macroéconomique
L’UFDG, désireux de préserver le pouvoir d’achat des Guinéens et la stabilité de la valeur de notre
monnaie, entrevoit des mesures qui ont pour vocation le renforcement de la stabilité
macroéconomique. Il compte ainsi doter la BCRG d’instruments de stabilisation. Sous son mandat,
la stabilité des prix ne sera pas le seul mandat de la BCRG. « La banque centrale ne sera pas
uniquement cantonnée à un simple rôle de stabilisation des prix. Elle jouera un rôle dans le
rétablissement des équilibres macroéconomiques. Ainsi, la banque participera de façon active à la
lutte contre le chômage et la relance de la croissance (modèle qui se rapproche d’avantage du
modèle américain que du modèle européen)1. » Cela veut dire la BCRG aura un double mandat : la
stabilisation des prix et puis la contribution à la croissance.
Il devait expressément dire qu’il compte, une fois au pouvoir, reformer les statuts immuables de la
BCRG, que de procéder à une description sommaire. L’idée est géniale et je la défends. Car
changement de mandat permettra à la BCRG de contribuer plus activement à la stabilisation
macroéconomique (contribuer à la relance de l’économie quand elle est en récession et puis à son
ralentissement quand elle menacera de surchauffe). Ayant un régime de change flexible, il faut
une politique monétaire active. Par ailleurs, l’UFDG se contredit. Dans la partie consacrée au
renforcement de la stabilité macroéconomique, il écrit plus haut : « L’objectif de maîtriser de
l’inflation sera atteint grâce à un contrôle ferme de la masse monétaire2. »Quand la stabilité des prix
n’est plus le principal et unique mandat d’une banque centrale, l’instrument de contrôle de l’inflation
n’est pas la masse monétaire mais le ciblage de l’inflation par la règle de Taylor. Nonobstant, l’idée
comme je l’avais signalé n’était pas mauvaise.
L’UFDG dans son programme de renforcement de la stabilité macroéconomique ne fait pas allusion
à l’autonomie de la banque centrale. L’autre vérité est que même en cas de réforme des statuts de la
1 Programme de société de l’UFDG, 2015, pp. 37.
2 Ibd .pp.37.
6
BCRG, elle aura du mal à réussir ses mandats en absence d’autonomie réelle. Il y aura toujours des
incohérences inter -temporelles.
2) La stabilité politique
Les cinq dernières années, le gouvernement d’Alpha Condé ne sut imprimer une stratégie claire de
réconciliation nationale en dépit du fait qu’il ait mit en place en 2011 une commission provisoire de
réconciliation nationale. L’UFDG propose une formule de réconciliation pour répondre à la
demande des Guinéens . Il dit proposer des idées se voulant holistiques et systémiques .Par ailleurs,
il dit promouvoir une démarche participative, inclusive et itérative suivant le fondement de la
justice dite transitionnelle ; ce qui veut dire qu’il compte mettre le plus d’accent sur le pardon que
la justice. Pour lui , la vraie réconciliation rime avec : le droit au savoir ( la vérité , de la mémoire , de
savoir des victimes ) , le droit à la justice , le droit à la mémoire , le droit à la réparation et puis au
droit aux garanties de non-répétition ( lutte contre l’impunité ) et l’engagement des réformes .
Dans le développement de ces différents droits, il manque de cohérence. Dans son développement
laconique du premier pilier du droit au savoir, qui n’est autre que celui à la vérité ; il dit : « La
recherche de la compréhension des douloureux évènements vécus, les circonstances et les raisons
fondamentales qui ont conduit aux multiples cas de violences d’Etat ou conflit violents constituera
une étape cruciale dans le cadre de la manifestation de la vérité3. » A l’UFDG, ils veulent comprendre
le passé. Mais si l’on comprend les évènements et manque à s’intéresser aux auteurs, comment
pourrait-on parler de droit à la justice ? Par ailleurs, il parle de manifestation de la vérité, mais
laquelle ? Celle des bourreaux, de victimes ? Celle de victimaires ? Il faut définir la vérité à faire
triompher, sinon les autres piliers de la réconciliation seront négativement impactés. Si la vérité est
mal définie, comment pourrions-nous léguer une bonne mémoire à nos enfants ? Si la vérité à
rétablir n’est pas bien définie, les objectifs visés par l’élaboration d’une mémoire collective et
historique ne seront pas atteints et les prochaines générations seront autant tourmentées par
l’histoire de leur pays que le sont aujourd’hui leurs ainés du fait de la fragmentation de notre
mémoire collective. L’UFDG ne définit pas avec rigueur cette vérité ou même ces vérités à rétablir.
3 Page 5 .
7
Dans son développement du droit à la mémoire, il parle de l’identification et de la conservation des
moyens de preuve (archives, lieux) ayant servi à la violation des droits humains. La rédaction d’un tel
document, dit-il, serait consensuelle et par des personnes de haute probité. Je l’avais dit tantôt, si la
vérité à rétablir n’est pas définie, la fabrication d’un consensus et la rédaction d’un document
devant servir de mémoire ne mettra pas fins aux problèmes futurs quant à l’interprétation du passé.
Les diversions et multiplicité d’interprétations subsisteront en dépit de l’existence d’un tel
document. La réconciliation est mal comprise à l’UFDG, car elle n’est pas stationnaire et ne doit pas
l’être, c’est un continuum. Un consensus mou et fabriqué aujourd’hui ne le sera pas demain. La
réconciliation mal comprise est dangereuse car diffère les problèmes et les font porter sur les
prochaines générations. La réconciliation consiste à établir le pont entre le passé et l’avenir. Elle vise
à permettre l’avenir et non de permettre le présent et différer ses problèmes.
Dans le droit de savoir des victimes, il dit que les victimes devront savoir les circonstances des
violations des droits de l’homme. C’est bien, mais faudrait-il que nous connaissions aussi les vraies
victimes et des victimaires ? Il dit que les cas qui feront l’objet de poursuites judiciaires seront
adressés aux juridictions compétentes. Puis, l’UFDG développe une expression dangereuse : «Ceux
qui révèlent du pardon en accord avec les victimes et leurs bourreaux, les excuses seront présentées
et acceptées afin de faciliter la transition4. » Les excuses seront acceptées par qui ? Qui est la
victime : l’opprimée ou l’Etat ? Et il dit pour faciliter la réconciliation. Le pardon ne s’impose pas, il
est individuel, c’est un acte de générosité et il ne doit pas être arrangé. Un pardon arrangé conduit
au ressentiment. Les victimes portent des douleurs morales et physiques, elles doivent trouver les
bonnes raisons de faire pardonner leurs bourreaux et de renoncer à leurs droits de vengeance. Un
pardon arrangé peut conduire la victime à devenir un bourreau. L’Etat dans un processus de
réconciliation nationale ne doit pas substituer les victimes, il doit créer les conditions d’une vraie
réconciliation, celle sans ressentiment. La réconciliation veut dire recommencer ou partir sur de
nouvelles bases solides et des substrats de sables.
Dans son développement, en deux lignes et seulement deux, du droit à la justice, l’UFDG dit que ce
droit portera sur l’examen minutieux de tous les cas de violations des droit de l’homme afin de
rendre justice et ce, selon nos lois et les conventions internationales paraphées par la Guinée. Je dis
bien qu’il pourrait arriver que certaines personnes ayant été des bourreaux ou suspectés de l’être
possèdent des informations pouvant soulager les victimes ou leur famille, et d’amorcer leur deuil
manqué. Ces informations pourraient être sur certaines réalités lugubres, les fosses communes, les
lieux d’enterrement déguisés et dont le dévoilement permettrait aux familles des victimes
4 Page 6 .
8
d’amorcer leur deuil manqué. Mais connaissant à priori qu’ils seraient punis, qu’ils se dévoilent ou
pas, ils tairaient leurs secrets et les familles continueraient de vivre leurs souffrances . Comment
faire ébruiter des informations factuelles de ce genre ? Il faut des solutions pour un tel cas proche de
celui de dilemme du prisonnier, l’UFDG ne dit rien à ce sujet. Il faut des incitations en ce sens, il ne dit
rien. Cela s’appelle créer les conditions de l’amnistie sans amnésie. La réconciliation c’est AUSSI
œuvrer à permettre la coexistence entre le bourreau et sa victime dans certaines circonstances.
Oui, la justice dans la limite du possible.
Dans son développement du droit à la réparation, il demeure humble lorsqu’il dit : « Le droit à la
réparation consistera à s’accorder sur l’esprit des dites répartitions et ensuite la mise en place des
mécanismes y afférents5 .» Par ailleurs, il reconnaît de façon implicite quelques-unes de ses lacunes,
car dans l’opérationnalisation de la réconciliation, il prévoit trois phases dont celle préparatoire en
premier lieu. Ainsi dans la phase préparatoire de son programme de réconciliation nationale ( PRN) ,
il parle de la nécessité de définition des critères de choix des membres devant piloter la
réconciliation en faisant un benchmarking des cas Sud-africain , béninois et ghanéen .
En plus, il parle aussi de la délimitation des périodes de la réconciliation. Mais, il n’est secret pour
personne qu’une victime est une victime et qu’il faille étendre le mandat de la commission à mettre
en place aux violences des différents pouvoirs et ce, depuis l’indépendance. Cette indécision est
déjà inquiétante. Il dit : « Délimiter la phase des investigations afin de couvrir toutes les périodes
sombres de l’histoire de la Guinée.» Définir le périmètre, le champ des investigations ou délimiter ?
Et puis, il dit : « […] Afin de couvrir toutes les périodes sombres de l’histoire de la Guinée. »
Délimiter sous-entend l’idée de limitation et l’expression ‘’couvrir l’histoire de la Guinée’’, sous-
entend l’idée de l’extension. Pourquoi l’usage d’une expression inappropriée pour parler d’un point
très aussi pertinent que le mandat de la commission de réconciliation nationale ? En politique tout
est calculé, d’où mon doute cartésien. En outre, dans cette phase préparatoire, il parle de la
réalisation du montage financier et aussi de mobilisation des moyens et ressources diverses. Il
ajoute aussi l’idée de sensibilisation à l’intérieur et à l’extérieur en vue de vulgariser ses idées de son
programme national de réconciliation.
Dans la seconde phase qui est celle de la conduite, il parle du recrutement et du déploiement du
personnel en charge du déroulement des investigations sur les différents cas de violations des droits
de l’homme. Mais les commissionnaires serviront à quoi ? Le choix de recruter et déployer d’autres
personnes pour des fins d’investigations laisse entendre que la quête de la vérité rimera avec
investigation. Il définit mal la missions des commissionnaires .Si la parole n’est pas donnée aux
5 Page 6 ;
9
victimes et qu’on vienne les étayer, comme le fameux droit de savoir des victimes le sous-entend, les
causes des violences et des violations des droits de l’homme, c’est déjà raté la quête de la catharsis
nationale. La théorisation de la réconciliation faite à l’UFDG est incohérente. D’ailleurs son détail des
autres points de cette seconde phase le démontre. Il parle aussi de choix et d’identification des outils
de collecte et d’analyse des données. Dans un pays où l’histoire à toujours été niée et où la
mémoire fut détruite à dessein, l’usage d’une méthode quantitative pour des fins de réconciliation
est insensée. Comme le disait le révérend Desmond Tutu, il faut mettre la victime au cœur de la
quête de la vérité. Les vérités plurielles abondent. L’investigation ne permettra pas la conciliation
des parties et des opinions, il faut une autre méthode de la quête de la vérité.
Dans la dernière phase, celle de l’implémentation de son programme de réconciliation nationale, il
met l’accent sur la rédaction de la mémoire et puis l’évaluation des réformes à engager. Si les
développements des étapes et des concepts clés sont biaisés, il va falloir revoir leur théorisation.
Nous ne voulons pas de réconciliation factice, mais de la vraie, celle sans ressentiment et un vrai
départ. Nonobstant, il reconnaît que seule la volonté politique réelle pourrait créer les bases de la
réussite d’un tel programme. Il compte mobiliser toutes les forces et ressources de la nation pour
réussir la réconciliation nationale.
3) Les leviers de la croissance économique
Le président de l’UFDG dans son allocution au congrès de son parti disait qu’il comptait faire de la
Guinée un pays émergent en 2025 et qu’il multiplierait le revenu guinéen par tête d’habitant par cinq
en 10 ans. Il avait à cet effet esquissé quelques idées sans y aller très loin dans le détail. Il disait
donc qu’il comptait redéfinir le rôle de l’Etat , améliorer l’attractivité du climat des affaires en vue de
l’essor du secteur privé et puis mettre en place des pôles de croissance économique ( PCE) en
partant de l’avantage comparatif de chacune de nos régions . Dans son programme de société, il fit
un détail. Les leviers de la croissance économique ou les facteurs clés de succès de l’UFDG seront
donc :
a) L’agriculture
10
L’UFDG entend mettre en place une stratégie dite de la remontée en filière en se basant sur les
avantages comparatifs de la Guinée. Elle consiste en une diversification de l’appareil de production
en vue de faire augmenter la valeur ajoutée. Il propose de combiner l’approche en filière et celle
des avantages comparatifs de nos régions dans le dessein de favoriser la création des valeurs. « Les
actions visant le développement de l’industrie, de l’agriculture, des routes et de l’énergie seront
construites à partir et autour des avantages identifiés de la Guinée et des stratégies de remontées
en filières6 . »
Dans son programme de société, l’UFDG énumère les paradoxes suivants :
-La faible contribution du secteur agricole à la création de la richesse à 20% alors que 80 %
de la population l’occupent et surtout la grande frange rurale où sévit le plus la pauvreté ,
- L’énorme potentiel agricole de la Guinée : 6,2 millions d’hectares et sa faible exploitation à
hauteur de 25 % ,
- La mauvaise maîtrise de l’eau,
-Le sous –investissement public dans le secteur et les difficultés des paysans à accéder au
crédit,
- L’inefficacité des circuits de distribution des engrais, produits phytosanitaires et des
intrants,
- Le faiblesse de la recherche agricole et de la vulgarisation.
Il fait un bon diagnostic mais ne propose presque rien comme remède. Diagnostiquer n’est-il pas
un pas vers la proposition de remèdes? Il renchérit quand même en ces termes : « La
modernisation de l’agriculture guinéenne passera par l’agrandissement des surfaces agricoles, les
aménagements hydro-agricoles, l’amélioration des techniques d’exploitation, l’ouverture ou la
réfection des pistes villageoises, le forage des points d’eau en zones rurales et enfin la hausse de la
disponibilité des intrants agricoles7 . »Il soulève des défis, mais comment les relever ? Il ne dit rien. Il
dit aussi : « Une amélioration de l’accès au crédit dans les milieux ruraux contribuera à l’atteinte de
ces objectifs en associant pleinement les acteurs locaux. » Comment compte-t-il améliorer cet accès
aux crédits, est-ce en mettant en place des microcrédits subventionnés par l’Etat ou est-ce en
libérant les forces du marché ? Quelles politiques pour y arriver ? Il ne dit rien.
6 Pp. 39 .
7 Pp.41 .
11
b) L’élevage
Le diagnostic fait par l’UFDG est incomplet et ignore nombre de réalités au sujet de l’élevage. Quand
le diagnostic n’est pas bien fait, comment les solutions peuvent être efficaces ? Dans son diagnostic
des problèmes qui freinent l’essor de l’élevage, il cite :
-La faible offre fourragère en saison sèche
- Le conflit entre éleveurs et agriculteurs pour l’usage de l’espace
-Les problèmes d’abreuvement, la technicité insuffisante des éleveurs en matière de
traitement sanitaire
-Les difficultés liées à l’alimentation et la commercialisation et à l’insuffisance de
l’offre .Et la disponibilité des produits vétérinaires et des soins ? Il continue : « Des
efforts considérables doivent être consentis en matière d’approvisionnement en produits
vétérinaires, soins primaires, de conseils techniques, de commercialisation, du
renforcement des opérateurs privés et de représentativité des organisations
professionnelles d’éleveurs8 . »
Les solutions qu’ils préconisent et compte implémenter sont :
- Le renforcement des capacités des producteurs (éleveurs) à travers la formation,
l’information et la participation aux instances de concertation,
- L’amélioration des conditions d’élevage par la mise en place des programmes
d’amélioration de l’abreuvement et conditions sanitaires,
- La lutte contre le vol de bétail,
- L’intensification des spécialisations et spécialisation des élevages,
- L’amélioration de la conservation et de la transformation des produits d’élevage en
vue de développer une valeur ajoutée aux produits primaires.
8 PP.42
12
Quand il parle de la lutte contre le vol de bétail, il ne dit pas comment il compte s’y prendre. Il
n’évoque pas la nécessité de refonder la recherche pour la conception des produits vétérinaires en
Guinée. Il ne parle pas de la construction et rénovation des abattoirs. La vision qu’il porte sur le
secteur n’est pas stratégique.
c) La pêche
Il fustige la faible contribution de ce secteur à la création de valeur ajoutée en depuis de nos
dotations : seulement 2% du PIB. Il procède aussi à un diagnostic de cette funeste réalité. Il pointe
les raisons suivantes :
- L’érosion de la ressource halieutique à cause de la pêche illicite,
- La faiblesse des investissements publics et privés pour : la capture, le traitement aux
normes sanitaires et la conservation des produits halieutiques,
- La faiblesse des moyens de surveillance et de la recherche scientifique,
- La dégradation de l’environnement marin et continental,
- La faible qualification des ressources.
Les solutions qu’il compte implémenter une fois au pouvoir sont :
-La gestion rationnelle de la pêcherie par le renforcement de la recherche et de la
surveillance ,
-L’accroissement des investissements publics et les capacités nationales de
conservation, de traitement et commercialisation ,
-L’appui institutionnel à la profession,
-La révision des accords de pêche ,
-Le renforcement de la qualité des infrastructures ,
-L’aménagement des mares (Haute Guinée ) , des piscicultures ( Guinée forestière )
et l’usage de la pêche artisanale (Basse Guinée) ,
- La refonte du coût des licences afin de rendre accessible les produits de la pêche à
nos concitoyens.
d) Les mines
13
Il décrit que l’apport du secteur minier à l’économie est grand, que sa contribution au PIB est de
15%, aux recettes de 25 % et en devises étrangères de 80%. Il dit que sa contribution à la création
d’emplois est marginale, seulement 15 000 emplois directs et une centaine de milliers d’emplois
indirects.
Il propose les solutions suivantes :
- La primauté aux initiatives et investissements privés ; du fait de leur savoir-faire ,
technologie et facilité d’accès aux ressources financières ( Mais ce qui a toujours été
fait . Quand même !)
- L’amélioration du cadre juridique et institutionnel ( En faisant quoi ? En élaborant un
nouveau code minier ? Si c’est le cas en changeant quoi par rapport à l’ancien ? Il
ne dit rien à ce sujet. )
- La diversification des exploitations minières (Comment y arriver ?)
- L’organisation et l’appui à l’exploitation artisanale de l’or et du diamant
- Le développement des infrastructures auxiliaires aux mines (ports, chemin de fer) et
mises en place de mégaprojets (Quels ports ? Le chemin de fer sur lequel des
itinéraires et par quel moyen ? Où seront ces mégaprojets ? Comment seront-ils
quels moyens ? )
-La mise en œuvre des recommandations de l’audit institutionnel du ministère des
mines et de la géologie (Diriger, c’est implémenter les recommandations ! ) .
Qu’en est-il de la mise en place d’une instance dont le mandat sera de promouvoir l’attractivité du
secteur minier et d’améliorer nos capacités négociations face aux firmes multinationales plus
armées ? Qu’en est-il de l’élaboration d’un plan comptable minier en vue de la promotion de la
transparence des informations financières des firmes minières ? Qu’en est-il des réformes des
statuts de la SOGUIPAMI et de la mise en place d’un organe devant exiger d’elle de la redevabilité ?
e) Le tourisme et artisanat
Pour rendre le secteur minier guinéen attractif, l’UFDG entrevoit les actions suivantes :
14
-L’élaboration du nouveau plan du tourisme en partant des acquis du plan
stratégique du développement du tourisme élaboré en 2000 avec l’aide du PNUD et
de l’OMT ( Mais le gouvernement d’Alpha Condé a déjà élaboré un plan du
tourisme , pourquoi revenir à celui d’il y a une décennie si un nouveau existe ?
Peut-être que l’UFDG ignore les réalisations du pouvoir. )
- L’amélioration des infrastructures (réseaux routiers, ferroviaires, eau et électricité,
télécommunication) . Cette proposition est imprécise, il y a eu quelques
améliorations et le terme’’ amélioration ‘’ est évasif.
-La mise en place d’une politique de concertation des pouvoirs publics et privés.
Il aurait pu dire , qu’il entrevoit promouvoir la construction des hôtels à l’intérieur , car le pouvoir
d’Alpha Condé construisit des hôtels mais à Conakry pour la plupart alors les sites touristiques se
trouvent pour la plupart à l’intérieur .
Pour l’artisanat qui emploie 30 % de la population urbaine, l’UFDG propose :
- L’application du code de l’artisanat. Pour lui, le code est en désuétude et son
application, sa simple application serait un salut pour les artisans,
- La création des cadres appropriés pour la promotion du secteur par le truchement
de la mise en place des chambres de métiers, villages artisanaux, des maisons de
l’artisanat,
- Le renforcement des capacités des artisans et l’amélioration des conditions
d’apprentissage,
- La création d’un fonds d’appui pour le financement du secteur
- Le recensement global des activités du secteur artisanal en vue d’identifier les
créneaux porteurs,
- L’élaboration d’une stratégie nationale de développement du secteur.
4) Les facteurs clés de succès
Les facteurs de succès de sa politique d’élévation du niveau de bien-être et de transformations
économiques seront :
a)L’électricité
15
L’objectif de l’UFDG est la production de 1000 MW en 2018 en misant sur plusieurs barrages de très
fortes puissances : Souapiti , Amaria , Diaoya , pouldade , koukoutamba . Il compte donc combler le
besoin intérieur et puis exporter de l’électricité. Comment financer concomitamment tout ces
projets ? L’échéance de production de ces 1000 MW est très proche, soit trois ans après son
accession au pouvoir. Son président ne disait-il pas qu’il comptait produire 2000 MW en 2020 ?
Pourquoi produire 1000 MW en trois ans et les 1000 autres en sept ans ? La vérité toute nue est que
la contrainte de financement se pose et cela exige que l’on priorise les projets. Pour construire un
barrage hydroélectrique digne de nom, il faut au minimum 4 ans. L’étude de faisabilité de Souapiti
est faite et la construction est presqu’amorcée, quant aux autres projets aucune étude de faisabilité
n’est faite. Comment peut-on construire un barrage dans trois ans pour lequel aucune étude de
faisabilité n’est encore disponible ?
Il entrevoit aussi la restructuration et puis la privatisation de l’EDG. Il dit que le traitement de choc
sera réservé à l’EDG et que les axes d’une telle thérapie seront : la bonne gouvernance, la
planification et puis la privatisation. Mais la thérapie du choc a toujours un coût social très élevé.
L’UFDG dit que l’Etat assumera en totalité ce social induit par une telle thérapie. Le gradualisme
serait plus profitable et permettrait la minimisation du coût social qui découlerait de la privatisation.
En parlant de l’interconnexion , il entrevoit trois projets : le boucle d’environ 1700 km pour relier les
pays de l’OMVG , le second est une interconnexion entre quatre pays riverains du fleuve Sénégal et
le troisième est une interconnexion entre le Guinée et le Mali . Les études de ces différents projets
ont été faites par la BAD et le décaissement n’a pas encore lieu. Cette idée n’est donc pas neuve,
mais vieille.
b) L’eau
Dans son diagnostic, il fustige les réalités sidérantes et arrive la conclusion irréfutable que l’accès à
l’eau potable reste une préoccupation majeure des Guinéens. Il envisage implémenter les actions
suivantes :
- L’élaboration d’une nouvelle politique nationale de l’eau
- La suppression des entraves institutionnelles et politiques à l’essor du secteur de
l’eau et l’engagement des réformes devant conduire à sa meilleure organisation
stratégique et opérationnelle. Que pourraient être ces réformes ? Il n’en pas assez.
Peut-être que la nouvelle politique nationale de l’eau qu’il entrevoit mettre en
place abordera la question.
16
- La mise en place d’un véritable mécanisme de financement du secteur par le
truchement du développement des partenariats public-privé et des coopérations
Sud-Sud.
- La restructuration de la Société des Eaux de Guinée ( SEG) et l’ouverture de son
capital au privé ,afin d’améliorer sa performance , ses capacités de mobilisation des
ressources diverses et sa prestation de service .
- Le renforcement du programme d’émergence visant la réalisation de nouveaux
forages. (Combien de forages compte-t-il construire ? Où ? Pour quel
investissement global ? )
- L’investissement dans la récupération, le traitement et la canalisation des eaux de
surface vers les ménages (Pour un coût de combien ?)
- La poursuite du programme d’augmentation des capacités de production et
d’extension des réseaux de branchements sociaux sur toute l’étendue du territoire.
Pour lui , ces interventions permettront de porter le taux d’accès des populations à l’eau potable à
95 % à l’horizon 2020 avec une ration journalière de 100 litres aux habitants en milieu rural et 60
litres pour vivant dans en zone rurale .
c) L a justice
Il décrit la justice guinéenne en trois mots : inefficacité, manque d’indépendance et d’intégrité. Il
évoque l’urgence d’une réforme de la justice. Pour lui , cette réforme portera sur l’amélioration de
l’accès , l’efficacité du service public de justice , le renforcement des capacités du personnel , la
révision des frais de justice , l’amélioration de l’équipement et la logistique du secteur , la révision à
la hausse des ressources allouées au secteur , l’application du statut des magistrats ( c’est déjà fait ),
l’amélioration des conditions de détention par la réforme de l’administration pénitentiaire et
carcérale. Il met l’accent sur l’amélioration des conditions de détention des femmes, des enfants et
des malades et puis sur la modernisation et rénovation des infrastructures. Il entrevoit aussi la
promotion de la réinsertion sociale des ex-détenus. Il entrevoit l’harmonisation et la vulgarisation
du droit des affaires OHADA en vue de sécuriser les investisseurs (une commission de simplification
et d’harmonisation a déjà été mise en place par le pouvoir en place).
L’UFDG compte abroger le Conseil Supérieur de la Magistrature, car présidé par le président de la
République et ayant pour vice-président le ministre de la justice, ce n’est pas un bon signe
d’intégrité et d’indépendance à ses yeux. Il dit que les membres de cette instance sont nommés par
le président de la République. Il déclare être pour l’équilibre des pouvoirs et non pour leur
17
collusion. Mais que propose-t-il ? « Ce dispositif doit être abrogé et remplacé par un dispositif adapté
aux exigences d’une administration judiciaire fonctionnelle, indépendante et performante», telle sa
réponse à cette question. Il dit aussi que les modalités de désignation seront revues. Il ne propose
rien quant à l’organisation du conseil à dissoudre, aux modalités de désignation de ses membres et la
promotion de son efficacité, indépendante et intégrité. Au lieu d’abroger l’organe, il serait bien de
corriger ses dysfonctionnements et faiblesses. Il ne donne aucune idée de ce que sera le budget à
allouer à justice et les modalités de répartition de celui-là. Il ne dit pas grand-chose quant à
l’amélioration de l’effectif des magistrats, très faible ; soit 250 pour 38 000 habitants. Seulement qu’il
propose des recyclages pour les magistrats. Le vocable de la formation continue serait mieux indiqué
que celui du recyclage.
d) La lutte contre la corruption
L’UFDG entend luter contre la corruption et l’impunité. Il cite à cet effet une batterie de solutions qui
sont :
-La mise à jour de la législation contenue dans le code pénal relative aux peines et
sanctionnant la corruption active et passive,
-La mise en place d’un système rigoureux de sélection des cadres sur la base d’un rapport
d’enquête de moralité des cadres,
-L’assainissement des douanes, impôts, services de passation des marchés publics, de
sécurité, entreprises publiques et le renforcement du système des audits
- La mise en place d’un programme nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption en tenant compte des recommandations de l’ONU, l’UA et le CEDEAO
-L’éducation, la sensibilisation des populations,
-L’introduction de la problématique de la corruption dans les programmes scolaires
d’enseignement.
Ces solutions sont incomplètes car ne permettront pas de contenir la corruption, très mal comprise
par l’UFDG qui l’a réduit à celle du secteur public. Premièrement, entrevoir la révision des
dispositions du code pénal sur les peines et sanctions concernant la corruption active et passive est
une bonne idée . Mais il faut être plus explicite, car l’être montre que l’on maîtrise le sujet. Il y a une
dissymétrie entre la corruption active et celle passive dans le code pénal guinéen, pourtant le
corruption n’est pas un délit passionnel mais calculé. L’idée qui consiste à dire qu’il faut revoir les
peines et les sanctions pour la corruption active et passive est bonne, mais lesquelles peines et
sanctions ? Celles matérielles ou immatérielles (l’emprisonnement, la déchéance et destitution des
18
fonctionnaires et cadres corrompus) ? L’expérience montre que faire augmenter les peines et
sanctions immatérielles est plus efficace que de procéder à l’augmentation de celles matérielles.
L’UFDG donne une bonne idée, mais ne la développe pas . Il faut développer pour vendre son idée.
Mais qu’en est-il des sanctions et peines relatives à la petite et grande corruption ?
Deuxièmement, Il entrevoit la mise en place d’une enquête de moralité pour la sélection des
cadres. L’expression « enquête de moralité » est mal placée et indélicate. Aucun homme n’est sans
vices, il faut mettre en place des modèles de sélection des cadres à l’aune de leur compétence .Le
favoritisme, le népotisme sont des formes de corruption qu’il faut bannir et cela se fait par la mise en
place des de solutions qui permettent l’égalité des chances et puis l’expression de la compétence.
Par ailleurs, on peut bien être de bonne moralité, je veux dire de bonne probité morale, mais
l’environnement et les réalités peuvent pousser à devenir corrompu et être corrupteur. Il faut
attaquer les raisons qui permettent une telle transformation et métamorphose du cadre. Les
modèles d’évaluation des compétences et de justification des promotions et nominations doivent
être définis .Par ailleurs, les conditions et l’environnement du cadre doivent être de telle sorte qu’il
n’ait pas recours à la corruption. Au cas où il recourrait à la corruption, qu’il y ait des mécanismes de
détection de son acte et puis de sanctions. L’idée de l’enquête de moralité peut étayée, est
dangereuse.
Troisièmement, il entend assainir les douanes. La question est : en faisant quoi ? Il veut aussi
assainir les impôts. Le terme est même incorrect, importe ! Assainir la fiscalité en faisant quoi, par la
simplification et l’harmonisation ? Il ne dit rien. Il entrevoit aussi assainir les services de passation de
marchés publics. Il dit bien les services. Mais lesquels ? Le Contrôle des marchés publics est
aujourd’hui rattaché à la présidence de la République, il faut la détacher de là et peut -être même le
supprimer. Mais il ne dit rien de ces services. Qu’en est-il de la loi des marchés publics ? . Assainir les
services de sécurité en faisant quoi ? Il ne dit rien de la refonte des modalités de sélection, des
modalités d’avancement en grade et de promotion, des instances de gestion des dépenses militaires
et des subventions afférentes.
Il entend aussi assainir le système d’audit. Mais l’expression est mal placée qu’elle engendre une
dissonance cognitive. On n’assainit pas un système d’audit, mieux serait de dire assainir le système
d’information ou renforcer les systèmes d’information. Si l’idée exprimée n’est pas développée, elle
reste une coquille vide de quintessence. Oui, le détail est important, il dénote de la préparation et
aussi de la maîtrise des problématiques abordées. Quatrièmement, l’UFDG réduit la corruption au
seul secteur public. Pourtant celle du secteur privé est plus grave en intensité et en profondeur. Il
ne propose rien pour l’amélioration de la qualité de l’information comptable et financière, pour la
19
sanction des entreprises privées. Les études de l’OCDE ont montré que la manipulation des prix de
transfert est une grosse arme utilisée par les firmes multinationales en vue de s’éluder d’impôt.
L’UFDG ne propose rien au sujet des réformes de la fiscalité. Quatrièmement, il ne parle pas de la
corruption internationale, pourtant avec la mondialisation la corruption est devenue globale
d’autant plus les frontières des pays s’ouvrent et que les flux de capitaux se meuvent. Il ne parle pas
de coopérations avec les grandes puissances en vue de parer les faiblesses de nos institutions. Sans
la grande coopération en matière fiscale et de lutte contre la corruption notre pays sera désarmée
contre les multinationales que nous escomptons attirer . Cinquièmement, l’UFDG n’entrevoit pas la
mise en place des institutions appropriées par le biais des actions concrètes. Le Comité d’audit mit
en place en 2011 est dangereux .Il doit disparaître, l’UFDG ne dit rien à son sujet. Il ne dit rien au
sujet de la mise en place de la Cour des comptes qui est l’organe institutionnel approprié pour
exiger de la reddition des comptes. Pourtant, il est défini dans l’article 115 de la constitution de
2011. L’Agence nationale de lutte contre la corruption (ANLC) substitut de fois la justice, l’UFDG ne
dit rien à son sujet. Il se contente de dire qu’il œuvrera à la mise en place d’un organe indépendant
efficace de lutte contre la corruption. Un tel organe sera-t-il centralisé pour encore renforcer les
pouvoirs et monopoles discrétionnaires ? Sera-t-il décentralisé ? Il ne donne aucun détail en ce sens.
Par ailleurs, l’idée d’introduire la thématique de la corruption dans les programmes scolaires pour
des fins de sensibilisation n’est pas mauvaise en soi. Il faut mettre l’accent sur la transmission et
l’acquisition par tous des valeurs désirées. Parler de corruption sans transmettre les valeurs est vain.
L’école est un régulateur social. Dans l’un des discours tenu au congrès de l’UFDG, son président en
énumérant les douze défis à relever citait l’absence de corruption. Quand on n’a pas su définir les
meilleures idées pour contrôler la corruption comment peut-on l’extirper ?
e) L’inclusion de la gente féminine
L’UFDG déclare que l’égalité des sexes est pour lui, un principe sacré et qu’il adhère à l’esprit et à la
lettre de Conférence de Beijing de septembre 1995. Il dit qu’il prendra toutes les mesures
nécessaires pour garantir aux femmes une participation d’au moins 30 % dans les instances de
prise de décision du parti et du pays .Pour y arriver à l’inclusion des femmes , il compte emprunter
cinq moyens :
- La réforme des lois en vue de garantir les droits égaux et opportunités. Ces textes
de loi à réformer sont pour lui ceux réglementant le mariage, le divorce, la lutte
contre l’excision, la garde des enfants, la propriété conjugale et l’héritage. Il
reconnaît que ces corpus ont été amendés et que les coutumes sont plus suivies
20
que les textes légiférés. Il entrevoit la publication d’un nouveau code civil qui
prendra en considération nombre de nos valeurs coutumières. Le but est de
permettre à la femme d’accéder à la propriété, l’idée est à saluer.
-La promotion de l’accès égal à l’éducation aux ressources et emplois. Il entrevoit
ainsi la construction d’école d’excellence pour les jeunes filles dans les capitales
administratives du pays.
- La réduction du fardeau familial des femmes et des coûts afférents. Il entrevoit
améliorer l’accès des femmes à la santé par la gratuité des soins aux femmes en
grossesse et en cas de césarienne.
-La protection sociale appropriée à la femme.
-L’accroissement de la participation et à l’influence des femmes dans la gestion des
affaires politiques.
Multiplier le PIB par habitant par cinq en dix ans est-il réaliste ? Mettons à l’épreuve cette idée. Nous
userons la formule suivante, celle d’une suite géométrique : .
Avec g niveau de revenu futur par tête d’habitant, g0 le niveau du PIB actuel par tête d’habitant. r
est le taux de croissance annuel moyen du revenu par tête d’habitant et n est le nombre d’années.
Multiplier le PIB par habitant par 5 en dix ans, reviendrait à écrire que g=5*g0 et calculons ainsi r .
Par simplification nous aurons : et . Le taux de croissance annuel
moyen du revenu par tête d’habitant serait ainsi de 17,46 %.
Cela veut dire, toute chose égale par ailleurs, que le taux de croissance de l’économie sera de 17,46
% par an sur 10 ans. Un tel taux est tel réaliste ? Le gros mensonge de l’UFDG ne passe pas. Et
après, il dit qu’ils créeront 1 million d’emplois. Mais il faut arrêter le mensonge. Soit ils
méconnaissent les carences structurelles de l’économie guinéenne soit ils font exprès de mentir en
vue d’attirer l’attention des ignorants. Une croissance a deux chiffres est possible, mais est
difficilement vivable et pérenne ( sustainable) .La Mongolie a déjà affiché des taux de croissance
proches de 17, 46 % . En 2010, son économie connut une croissance de 20, 9 % et en 2011 ce fut
17,3%. Ces performances étaient dues au boom minier. La croissance économique dopée par les
activités minières est difficilement soutenable et durable. Car les performances du secteur minier
sont tributaires de la conjecture de l’économie mondiale et de l’évolution du cours des matières
premières. Le grand essor du secteur minier peut aussi donner lieu à la maladie hollandaise. Le
taux moyen de 17 ,46 % de croissance en dix ans est irréaliste. Multiplier le niveau de revenu par
habitant par cinq est une idée belle, mais il faudrait que l’on mette plus l’accent sur la qualité et la
structure de cette croissance afin qu’elle soit inclusive et créatrice d’emplois.
21
5) La gouvernance
La question de gouvernance est pour l’UFDG la mère de ses priorités. La notion, elle l’aborde avec
attention particulière. Nous pourrons ainsi diviser cette gouvernance en quatre : économique,
politique, financière et administrative.
a) La gouvernance économique
L’UFDG propose l’élaboration des bilans en vue d’évaluer les actions et réalisations du
gouvernement. Ces bilans serviront d’indicateur de performance. Ils seront élaborés , dit-il , par un
cabinet d’audit indépendant sur la base des critères : macroéconomiques( inflation , stabilité
monétaire , dettes ) , sociaux ( baisse des prix , construction d’hôpitaux…) , institutionnel( réformes
de l’administration , de la justice , climat des affaires ) . Ces trois bilans seront :
- Le bilan économique de début du mandat (qui permettrait de fixer le point de
départ et d’identifier les challenges futurs)
- Le bilan économique de mi-mandat ( qui visera à recenser les actions réalisées par
le gouvernement )
- Le bilan de fin de mandat
L’idée est ingénieuse et se veut être une grande innovation. Mais ne serait-il pas possible de mettre
en place un organe institutionnel guinéen ? Ce qu’il propose s’appelle redevabilité sociale, nous en
manquons cruellement en Guinée. Bravo !
Il entend aussi définir une modalité de financement de l’économie guinéenne, car il dit qu’il veut
faire de la Guinée un pays émergent à l’horizon 2025. Pour ainsi financer l’économie, il entrevoit
l’élaboration d’un plan national de développement (PND) qui va s’étaler sur l’horizon 2016-2020.
Pour lui, ce plan va servir de cadre de référence en matière de stratégie de développement et de
réduction de la pauvreté. Ce plan a donc vocation de s’approcher au cadrage macroéconomique. Il
dit aussi que ce plan sera la base des politiques et plans de stratégies sectorielles. Par ailleurs , il
entend mettre en place un programme d’urgence de neuf (9 )mois en vue d’attaquer par le
truchement du concours des partenaires techniques et financiers (PTF) les axes prioritaires suivants :
22
le processus démocratique , l’emploi des jeunes , l’eau et l’électricité , l’assainissement des voieries
urbaines , le renforcement des capacités du personnel enseignant notamment primaire et
technique , la santé , la sécurité des hommes et de leurs biens .Il définit les considérations que
doivent prendre en compte le financement de l’économie et les porte au nombre de 7 . Ces
contraintes sont intelligentes : l’hypothèse dévolution du commerce international et de la croissance
de l’économie mondiale , l’évolution du cours des matières premières , le coût budgétaire du
programme d’investissement pluriannuel , l’ évolution des dépenses courantes du programme de
relance économique et de résilience post- Ebola , les objectifs du développement durable et les ceux
de la politique monétaire et du crédit .
b) La gouvernance financière
Il reconnaît, le parti, dans son programme de société l’inefficacité du secteur bancaire guinéen .Il
conclut qu’en dépit des réformes que le système bancaire guinéen est incapable d’effectuer une
allocation efficiente des ressources à l’économie nationale. ll constate aussi que les banques
guinéennes affectent moins de 5 % de leurs ressources financières aux emplois durables. Pour
mettre fin au rationnement de crédit et sortir le secteur bancaire de sa frivolité, il entend mettre
œuvre les actions suivantes :
-La redéfinition du rôle de l’Etat en vue d’une réorientation efficace des services bancaires
vers les activités productives,
- La contribution à la mobilisation des ressources financières de l’économie
-La mise en place des fonds de garanties effectives en vue de faire augmenter le crédit
octroyés aux entreprises,
-L’usage du Mobile Banking (M-Banking ) pour favoriser l’inclusion des populations à faible
revenu et celles vivant dans les zones rurales .
Nos observations sont qu’il propose quelques solutions intéressantes et innovantes, c’est le cas du
M-Banking dont il définit les modalités de mise en œuvre par le biais de la coopération avec les
opérateurs de télécommunication. Les autres solutions sont discutables. Il n’aborde pas la
réformation des statuts organisant le secteur bancaire, il le faut portant. Les solutions proposées en
vue d’inciter les institutions bancaires à octroyer plus de crédit sont insuffisantes.
c) La gouvernance politique
23
L’UFDG est un parti que se dit libéral et pour qui le concept de liberté est crucial . Il met l’individu au
centre de ses considérations. Il entrevoit l’instauration d’une forte démocratie par la mise en place
des institutions crédibles , légitimes , le respect de la séparation effective des pouvoirs , la
promotion d’un système judiciaire garant du respect du droit , l’indépendance de la magistrature .
Dans cet Etat de droit, qu’il entend promouvoir, nulle ne sera au dessus de la loi qui sera appliquée à
tous. Par la promotion des institutions appropriées, il entend briser les vecteurs de la fragilité de
notre Etat. Il entrevoit aussi la séparation et l’équilibre des pouvoirs. C’est dans ce dessein qu’il
entrevoit la suppression du Conseil Supérieur de Magistrature, organe qu’il décrit comme
inapproprié et dans l’indépendance est plus que jamais menacée. Il compte donc abroger les
dispositions de la loi organique l’ayant instituée. Il entend faire émerger l’Etat de droit par l’idée
d’équilibre et de définition claire des compétences de chaque pouvoir de sorte à éviter leur
collusion.
Il décrit l’exécutif sous son règne comme étant fort quand il sera question de protéger les Guinéens
et discret quand il sera question de l’exercice de la liberté d’expression par les même citoyens. Il dit
qu’il opte pour un système parlementaire qui ne décrit pas bien. Il se contente juste de dire : «
Notre parti opte pour le système parlementaire éloigné des caricatures que l’on peut voir ici et là,
où les parlementaires sont si proches de l’exécutif qu’on a tendance à les confronte. » Mais de
quel pouvoir législatif veut-il de façon concise ? Eu égard au pouvoir judiciaire, il se contente de
dire qu’il nous faut un système judiciaire qui garantisse le respect du droit et l’équilibre des
pouvoirs. La judiciaire ne peut à lui seul garantir l’équilibre des pouvoirs. C’est une grosse erreur
que de le croire. Il parle de la séparation et l’équilibre des pouvoirs mais ne décrit pas avec les mots
appropriés ce qu’il faut pour y arriver.
La force de l’exécutif dans la protection de ses citoyens n’est pas suffisante, il faut aussi qu’il
promeuve par des actions concrètes l’intégrité de nos institutions en arrêtant de les vassaliser. Il
faut qu’il permette aussi l’exercice des libertés économiques. Quem gouvernement propose l’UFDG
aux Guinéens, celui des copains, d’unité nationale, celui des compétences ? Il ne dit rien. Il faudrait-
il aussi que les parlementaires arrêtent d’être les mégaphones du pouvoir ou de leurs partis pour
lesquels ils devraient défendre les intérêts. Les autres institutions doivent aussi arrêter de se faire
marcher sur les pieds et de jucher l’exécutif sur les épaules. L’exécutif aura donc un grand rôle à
jouer pour arrêter la vassalisation de nos institutions .Mais la description du pouvoir exécutif et des
autres , par l’UFDG est insuffisante pour assurer cet équilibre des pouvoirs qui n’est qu’un idéal et
dont l’absence d’idées claires pourrait faire un mirage .
24
d) La gouvernance administrative
Il fait la part de l’administration qu’il qualifie de centralisée et de celle locale dite aussi décentralisée
dans son projet portant sur la gouvernance administrative. Il déclare que la Guinée appartiendra au
groupe de pays africains où l’administration aura un système de gestion axée sur les résultats . Il
entend mettre en place des méthodes d’évaluation des compétences des fonctionnaires et s’y
référer tenir pour la définition de leur itinéraire et justifier les promotions et nominations des cadres.
Pour la gouvernance de l’administration centralisée, il entend mener les actions suivantes :
- La réforme en profondeur des structures administratives,
- La rigoureuse sélection des cadres sur la base des tests et concours
- Le respect scrupuleux des dispositions du statut général de la fonction publique en
vue de dépolitiser l’administration publique ,
- La mise en place d’un système de suivi -évaluation des performances des agents et
services de l’administration,
- La création d’une Ecole Nationale d’Administration avec au moins quatre filières :
administration, finances publiques, contrôle et audit, diplomatie.
L’UFDG semble être déconnecté des réalités, comment peut-il proposer la création d’une institution
déjà créée ? Compte-t-il créer une nouvelle ENA ? La vérité toute nue est que ce programme de
société, objet d’analyse est analogue à celui de 2010. Les modifications sont minimes à part
l’introduction de deux nouvelles pages consacrées à la réconciliation nationale. C’est inacceptable de
concevoir un programme de société en partant de ce que l’on croit être la réalité. La réalité est que
l’ENA a été créée par décret présidentiel le 18 mai 2015. Le 2 juin 2015, dans les locaux parisiens de
l’ENA un accord tripartite a été signé entre l’Ecole nationale d’administration publique (ENAP) de
Québec, l’ENA de Paris et l’ENA de Conakry au sujet des l’échange des expériences.
Par ailleurs, l’UFDG entrevoit des actions concrètes en vue de réussir la décentralisation. Il compte
engager un débat public à ce sujet afin de cerner les contraintes, les pesanteurs et de saisir les
recommandations. Aux collectivités, il compte accorder le pouvoir de collecter les impôts et taxes
sur la base de leurs potentialités et sur le principe de subsidiarité. Il faut dire que cette idée est
bonne, mais il-est qu’il faut mettre à leur disposition des moyens d’y arriver et d’éviter la course à la
rente et le mirage de la déconcentration du pouvoir ! Il entrevoit aussi pour les collectivités des
quote-parts élevées et garanties sur les recettes issues au niveau central. Proposer des quote-parts
aux collectivités est bonne , mais il faut définir leurs modalités de répartition.
25
Dans les régions, il entrevoit la mise en place des pôles de croissance économique (PCE) en vue de
diversifier l’économie. Il ne clarifie pas les modes de financement de ses ambitions à ce niveau. Il se
contente juste de dire : « Il sera analysé au cas par cas afin de déceler les différentes options
possibles de financement entre le partenariat public-privé et le privé9. » Au niveau des préfectures, il
entend mettre en place des Comités Préfectoraux de Développement ( CPD) et associer les
ressortissants des différentes préfectures à la planification des besoins de leur localité . Il donne une
place de choix à l’organisation des consultations citoyennes afin que les collectivités participent de la
prise de décision.
L’ingénieuse idée qu’il propose est de promouvoir la culture de rendre compte afin d’éviter les
problèmes liés à l’aléa-moral. Il envisage trois niveaux, ceux des supérieurs, des collaborateurs et
puis des citoyens .Il parle-là des collectivités. Eu égard à l’Etat central, il ne tient pas pareil discours.
Il ne parle de redevabilité de l’exécutif . L’institution de la culture de faire évaluer son patrimoine et
de le contraindre à la transparence. Le leadership éthique c’est bien ça.
5) Les réformes de l’éducation
Le système éducatif guinéen est inefficace, il le reconnait aussi. Parmi ses actions à implémenter
suivantes :
- La hausse du budget alloué à l’éducation nationale à 30 % au minimum,
- L’universalité de l’éducation primaire à travers un programme d’éducation de qualité
pour tous,
- La valorisation du statut de l’enseignant par le truchement de la bonne rémunération
salariale, de la mise en place des primes et indemnités, les avantages de logement et
ceux en fonction de la mobilité géographique ,
- La révision du système d’évaluation des connaissances durant les cursus scolaire et
examen afin de promouvoir les règles de moralité, de transparence et d’équité.
- La diversification des filières de l’enseignement secondaire,
- L’organisation des états généraux de l’éducation précédée d’un audit institutionnel,
La refondation de l’éducation nationale et de la recherche scientifique ,
9 Page 16 .
26
- La création d’université régionale et autonome puis la signature d’un accord
quinquennal avec des instituts universitaires et de recherches respectées,
- L’ouverture d’une Ecole Normale d’Instituteurs dans chaque région,
- La primauté aux sciences techniques et technologiques.
-
Un certain nombre de remarques s’impose. Premièrement, il ne suffit pas de porter le budget alloué
à l’éducation à 30 % pour qu’elle soit efficace. La proposition est quand même courageuse. Il faut
aussi définir les modalités de répartition de ce budget.
Deuxièmement, l’idée de rendre universel l’enseignement pour tous les enfants en âge de
scolarisation sans aucune discrimination est vieux, mais faudrait-il que les conditions de son
application soient créées ? Cette une idée ressassée. La charte constitutive du 10 novembre 1958
avant des dispositions similaires, mais n’ont pas marché. Comment l’UFDG compte s’y prendre ? Il d
répond à cette question de la manière suivante :« Pour atteindre cet objectif , la priorité principale
de notre administration portera sur la mobilisation des ressources internes et externes
suffisantes 10. » Je ne comprends pas pourquoi nos politiques ne comprennent pas qu’ils ne
comprennent pas certaines réalités. Un pauvre dont l’enfant serait en âge d’aller à l’école enverrait
ce dernier au champ s’il venait à manquer de moyens. L’école est un investissement, et le pauvre
n’a souvent pas les moyens pour supporter les charges afférentes aux études de ses enfants.
Certaines contrées sont dépourvues d’écoles, comment garantir à tous les enfants en âge de
scolarisation le droit à l’éducation ? Entre incitations et écoles de proximité, il a plus d’inclination
pour l’école de proximité. Mais comment il compte garantir ce droit à l’éducation à tous les enfants
en âge de scolarisation ?
Troisièmement, l’ouverture des Ecoles Normales d’instituteurs est une bonne idée, mais ces écoles
existent déjà .Comment les rendre plus performantes ? Que seront les modalités de sélection de nos
instituteurs, enseignants ? Quatrièmement, la révision des systèmes d’évaluation ne doivent pas
s’opérer pour les seules raisons citées mais pour la principale raison qu’il faut améliorer
l’acquisition des connaissances. Cinquièmement, il faut aussi définir le mode de gouvernance de
nos universités. Qu’en est-il de la régulation des universités privées qui sont de nos jours de
véritables moulins à diplôme ? Quelles stratégies de promotion de l’innovation et de la recherche
académique ?
10
Page 24 .
27
Par ailleurs, La valorisation du statut de l’enseignant est une bonne idée et les mesures définies sont
bonnes. L’idée d e refonder notre système d’enseignement est bonne, mais suivant quelles
valeurs et paradigmes ? La diversification des filières du secondaire est une bonne idée, mais il faut
définir les nouvelles filières à implémenter.
6) Les réformes de la santé
Il décrit l’inefficacité de notre système de santé. Il évoque aussi le déficit de couverture sociale à
juguler. Il note aussi que l’observation des dispositifs de protection en vigueur en Guinée conduit
l’UFDG à conclure qu’elles sont iniques et inefficaces.
Il entrevoit quatre angles d’attaque pour réformer le système de santé de notre pays. Ce sont :
-L’amélioration de l’accessibilité. Il évoque la gratuité aux soins de santé aux femmes en
grossesses et aux enfants de moins de 5 ans. Est-ce suffisant pour garantir le droit à la santé à tous y
compris les pauvres ?
-Le contrôle et la prévention des maladies. Il évoque son dessein de contrôler diverses maladies
dont le VIH /Sida, le paludisme , la lèpre , la tuberculose , les diarrhées , les infestions respiratoires
aigues . Mais par quels sont les outils et moyens qu’il compte utiliser ? Il n’en pas assez à ce sujet.
-Le développement de l’offre de santé. Il entrevoit élargir l’offre de santé à tous en améliorant le
qualité des prestations de nos hôpitaux. Ces moyens d’intervention seront ainsi : l’extension de la
couverture sanitaire, l’amélioration des ressources techniques, humaines et financières dans nos
hôpitaux, l’établissement d’un réseau d’un laboratoire de santé publique pour le diagnostic clinique
et de surveillance épistémologique et puis l’amélioration du financement du secteur. Quant au
financement, il ne dit pas grand-chose, il ne donne aucune idée claire de financement de ce secteur
et surtout de répartition du financement entre les centres de santé et de recherche. Aujourd’hui, ce
système est sous-financé et puis les maigres allocations financières du secteur sont mal réparties
entre les centres de santé. Il parle quand même de rehaussement significatif du budget alloué au
28
secteur, mais ne donne pas d’informations chiffrables comme il fit par le secteur de
l’éducation11.Quand il parle de l’amélioration des effectifs, il ne dit pas comment s’y prendre.
-La mise en place d’un système de bonne gouvernance du système de santé. L’UFDG dit ce qui
est une lapalissade : « De tous les maux dont souffre le système de santé guinéen, la mal-
gouvernance et le défaut de leadership sont les plus urgents […].»Il entrevoit des solutions pour
pallier ces maux. Il exprime son dessein de la promouvoir la gestion axée sur les résultats, mais ne
décrit pas le mécanisme pour y arriver. Puis, il ajoute la coordination des interventions des
partenaires techniques et financiers. Ceci est une bonne idée car permettra de faire accroître
l’effet synergie et d’améliorer la qualité des interventions . En suite , il entrevoit la promotion de la
culture de redevabilité par la mise en place de suivi-évaluations rigoureux . L’idée est excellente
quand on sait que cela manque de nos hôpitaux , mais les suivi-évaluations à eux seuls ne seraient
pas efficaces , il faut aussi . Il faut d’autres mécanismes comme l’élaboration des plans comptables
sectoriels dont ceux du secteur de santé afin de donner nos hôpitaux d’instruments permettant la
production des informations financières de qualité et d’évaluer leur performance . Une instance
d’évaluation de la performance de nos hôpitaux devrait naître aussi. Par ailleurs , il parle de la
coordination intersectorielle dans le dessein de la définition et mise en application des politiques
sectorielles concernant l’amélioration de l’ état de santé des populations ( politiques d’instruction et
d’éducation , l’accès à l’eau potable , l’assainissement et la réduction des inégalités sociales ).Et
enfin , il parle de l’application stricte et correcte des lois et règlements afin de lutter contre
l’impunité et de promouvoir la déontologie des acteurs du système de santé .
Il propose aussi mise en place d’une assurance maladie obligatoire (AMO) pour les occupants de
l’économie formelle. Quant à ceux de l’informelle, il propose un fond d’assistance médicale (FAM) ,
autonome au budget national . Comment sera-t-il constitué ? Il dit seulement : « Ce qui permettra
d’identifier clairement ses sources de financement et de mettre en place une procédure rigoureuse
d’éligibilité. »
7) La promotion d’un environnement sain des affaires
Dans la promotion du secteur privé l’UFDG ne propose rien, ce qui est étonnant pour un parti se
voulant libéral et qui croit au marché. Il cite les obstacles qui pèsent sur le secteur privé guinéen :
11
Voir 28 du programme de société de l’UFDG .
29
ceux physiques (infrastructures , eau , électricité , transport et télécommunications ) , obstacles
d’ordre institutionnel ( les tracasseries et lourdeur administrative , le mauvais fonctionnement du
système judiciaire ) , les obstacles d’ordre humain ( formation et qualification des ressources
humaines ).
Il dit : « L’UFDG fait de la relance effective du secteur privé la priorité de ses priorités ». Mais il
propose quoi ? Il répond à cette question en ces termes : « Le parti propose l’organisation d’une
table ronde sur la problématique du secteur et la préparation d’un nouveau projet de production et
renforcement de ses capacités institutionnelles et humaines12 . » L’organisation de la table ronde
n’est pas mauvaise en soi, mais il faut donner une idée des questions devant y être abordées.
Voilà le plus gros aveu de faiblesse et d’incapacité. Les trois faillites du marché en Guinée sont
connues : la faiblesse institutionnelle, la faiblesse de qualification des ressources humaines et la
faiblesse des infrastructures. Chacune de ses faiblesses a une solution. Pour celle de institutions, il
faut réformer nos législations en vue d’améliorer la protection des droits de propriété, des
propriétés intellectuelles, des investisseurs minoritaires, la clarté de la règle de droit par la
simplification et l’harmonisation du droit des affaires et de la fiscalité. Pour pallier la seconde
faiblesse, il faut réformer le système éducatif, permettre l’adéquation de la formation aux besoins
du marché de travail et des exigences de la mondialisation. Cela peut commencer par la promotion
de la cohérence et la continuité entre le secondaire et le tertiaire : l’instauration de nouveaux filières
au baccalauréat, la refonte des programmes d’enseignement, la diversification des filières
d’enseignement au tertiaire, la définition de nouveaux modèles d’évaluation des performances de
notre système d’enseignement. Par ailleurs , procéder à l’amélioration de la gouvernance de nos
institutions d’enseignement supérieur en vue de les arrimer à leur environnement extérieur et les
rapprocher du monde de l’entreprise. Par rapport à la faiblesse des infrastructures, les solutions sont
connues et certaines sont implémentées depuis quelques années. Il faut juste chercher le mode de
financement adéquat.
Par ailleurs améliorer l’efficacité du gouvernement exige de mettre en place un gouvernement dans
lequel les compétences triompheront de l’engagement politique .L’UFDG dans son programme de
gouvernance n’a rien dit au sujet d’un type de gouvernement qu’il compte mettre en place .
12
Page 46 du programme de société de l’UFDG .
30
Conclusion
Le programme de société de l’UFDG comporte certaines forces, certaines idées claires novatrices. Du
nombre de ses idées, se trouvent, les problématiques liées à la fourniture de l’eau et de l’électricité.
Il entend , sans le dire expressément , poursuivre les mêmes politiques entreprises sous le
quinquennat d’Alpha Condé : la construction des barrages hydroélectriques et puis le recours à
l’interconnexion sous-régionales pour lesquelles les études de faisabilité sont menées par le
partenaires techniques et financiers . L’atteinte de l’un de ses objectifs, celui de produire 1000 MW
d’électricité en 2018 est caution à réserve d’autant plus qu’il est confus et évasif quant à son mode
de financement. Il a raison de dire qu’il faut restructurer l’EDG et la SEG, et que le second mérite une
privatisation. Mais le traitement de choc qu’il escompte réserver à l’EDG engendrerait des coûts
sociaux élevés, le gradualisme serait mieux.
Par rapport à la réconciliation nationale, il exprime de bonnes idées. Toutefois, il est incongru dans
son explication du programme national de réconciliation, je veux dire dans le développement
théorique des piliers de ce programme. Ses efforts pour la quête de solutions efficaces, attestent de
sa volonté à œuvrer pour une réconciliation vraie. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas ! Son
programme ne permettra que le différemment des maux et engendrerait, s’il est appliqué sans
amendements théoriques, des ressentiments et causerait des tords aux prochaines générations.
Comme ce programme entrevoit trois phases dont celle préparatoire, le parti et ses dirigeants
devraient revoir leurs formulations théoriques. D’ailleurs, il déclare vouloir apprendre des
expériences réussies dans d’autres pays : l’Afrique du Sud, le Bénin et le Ghana.
31
L’autre de ses forces est d’avoir exprimé de bonnes idées pour la renforcement de la stabilité
macroéconomique .Il est à déplorer son impertinence quant à la définition des instruments
monétaires nécessaires à la réalisation de ce dessein. Il élude la question de l’autonomie de la
BCRG. Celle-là mérite aussi une grande attention.
Sur les questions de la diplomatie, il est brillant .Et ses idées exprimées à ce sujet sont vivables. Il
compte protéger les Guinéens de l’extérieur et aussi améliorer les conditions de vie des étudiants
boursiers vivant à l’extérieur. Eu égard à la gouvernance, il a des solutions admirables et bonnes
malgré que le développement de la gouvernance politique dans son programme ait été insuffisant
surtout au sujet de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs. L’autre de ses forces est d’avoir
réussi à proposer des idées novatrices au sujet de la gouvernance du système de santé. Il est aussi à
déplorer son absence de chiffres quant au budget qu’il entrevoit alloué au secteur et aux modalités
de sa répartition entre les centres de santé primaires et secondaires. Il ne faut pas l’oublier, l’autre
de ses forces est d’avoir suggérer des solutions permettant l’inclusion de la gente féminine dans la
vie économique, politique. Il manque toutefois d’idées pour la convection de l’économie informelle
en celle formelle en vue d’inclure ses acteurs dans le dessein de corriger les défaillances du processus
dévaluer de la performance de l’économie et de formation du PIB.
Ses faiblesses sont énormes. Son développement du levier de la croissance économique est bon,
mais très insuffisant. Sa plus grande faiblesse est d’avoir raté sa proposition phare, celle de
multiplier dans 10 ans la richesse agrégée moyenne par 5 . Multiplier le PIB par habitant par 5 en 10
ans , exigerait un taux moyen de croissance annuelle égal à 17, 46 % . Son développement des
leviers de la croissance laisse conclure qu’un tel objectif sous-jacent est irréaliste.
L’autre de ses faiblesses est d’avoir trop réduit les armes de lutte contre la corruption. Il réduit la
lutte contre la corruption à celle du secteur public, à l’audit et puis la sensibilisation. Il a perdu de vue
les autres dimensions de la corruption et que celle du secteur privé était plus dangereuse. Ses
mesures sont insuffisantes pour contenir la corruption. Par ailleurs, ses idées de réforme du secteur
minier ne pourraient conduire au boom de ce dernier. En matière de réforme de l’agriculture , il fait
un diagnostic percutant , mais s’est montré incapable de proposer des solutions claires à l’aune du
diagnostic presque parfait . Nous jugeons du programme de société, des promesses d’interventions
publiques et non des essais de diagnostic.
En matière de réforme de l’éducation guinéenne, il ne fait que trois propositions novatrices :
porter le budget alloué au secteur à 30 % , améliorer le statut des enseignants et diversifier la
formation au secondaire. Ces trois solutions sont insuffisantes pour faire de notre système éducatif
32
un modèle. Il ne définit pas le mode de gouvernance dont a besoin nos institutions d’enseignement
tertiaire, les modalités de financement de la recherche académique, il ne propose pas l’arrimage de
notre système éducatif à son environnement externe dont celui des entreprises. Il n’évoque pas la
nécessité de transmission des valeurs souhaitées dans nos établissements d’enseignement. L’Ecole
est pourtant un régulateur social. Il ne met pas l’accent sur la nécessité d’améliorer l’acquisition des
connaissances dans nos établissements d’enseignement par le truchement de l’apprentissage des
langues étrangères dont l’anglais et la maîtrise de l’outil informatique.
L’autre de ses faiblesses est qu’il n’évoque nullement pas la nécessité de la réforme du système de
retraite dans notre pays. Peut-être qu’il a peur de l’écho que pourrait engendrer une telle initiative !
Il ne donne aucune mesure claire et convaincante au sujet des réformes de la fiscalité, de
l’administration fiscale, de la gestion de la dette publique. Il sait contenter de dire : « assainir les
impôts, l’administration fiscale etc.» Les contenus des réformes sont inconnus.
Il ne possède pas une politique d’emploi. L’objectif « 1 million d’emplois » déclaré par le cadre les
cadres de l’UFDG est irréaliste, bien qu’ils peuvent rêver à faire éclore une génération
d’entrepreneurs. L’autre fiasco est qu’il ne sut pas en tant que parti se définissant d’obédience
libérale à définir des réformes claires pour libérer les forces du marché et rendre l’environnement
des affaires alléchant. L’idée qui consiste à dire qu’il faut l’organisation des tables rondes sans
définir les points sur quoi de telles rencontres doivent aborder est un aveu de faiblesse. Quand on
n’a pas su donner des idées claires pour rendre l’environnement des affaires attractif comment
pourrait-on créer 1 million d’emplois ? Par décret présidentiel ? Comment pourrait-on faire
multiplier le PIB par habitant par 5 ? Comment pourrait-on dire que la Guinée serait un pays
émergent en 2025 quand on pas su proposer des idées claires au sujet de l’innovation ? Cette
émergence -là serait plus un gadget politique qu’une réalité. Elle ne décrète pas !
En définitive, le programme de société de l’UFDG est assez bien. Il n’est pas globalement positif
encore loin globalement négatif, il est approximatif tant dans l’expressivité des idées et dans la force
de proposition.