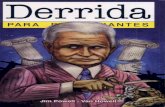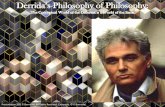Derrida.: Éléments d'un lexique politique
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Derrida.: Éléments d'un lexique politique
DERRIDA.
Éléments d'un lexique politique
Charles Ramond
Presses Universitaires de France | « Cités »
2007/2 n° 30 | pages 143 à 151 ISSN 1299-5495ISBN 9782130560661
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.info/revue-cites-2007-2-page-143.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France.© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans leslimites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de lalicence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit del'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockagedans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
Derrida.Éléments d’un lexique politique1
CHARLES RAMOND
Auto-immunitéL’auto-immunité, c’est le fait de
se protéger contre soi-même : c’est-à-dire de se considérer soi-même commeun étranger, ou un parasite : « l’auto-infection de toute auto-affection »(Voyous, 154). L’auto-immunité con-duit donc à la mort par un suicide quin’est pourtant pas « voulu ». Cettenotion intéresse Derrida (il lui ac-corde même « une portée sans limite »– Voyous, 175), non seulement parcequ’elle contribueà rendre indécidableetimpensable le « propre » (cible princi-pale de la philosophie de Derrida), maisaussi parce qu’elle met en cause circulai-rement la possibilité d’un soi-même,d’un « auto » : « Ce que j’appelle l’auto-immunitaire ne consiste pas seulementà senuireouà se ruiner, (...) nonpas seu-
lement à se suicider, mais à com-promettre la sui-référentialité, le soi dusuicide même. L’auto-immunité estplus ou moins suicidaire (...) mais me-nace toujours de priver le suicide lui-même de son sens et de son intégritésupposés ». Pas de maîtrise dans lesuicide :Derrida retrouve iciunepenséede Spinoza, qui pensait qu’il était im-possible de « se » « sui »-cider, et quec’était toujours « un autre » qui noustuait. Surtout, cette pensée de l’auto-immunité s’applique entièrement, se-lon Derrida, à la démocratie, et en dit lesconstants paradoxes. Pour cette raison,Derrida souligne la parenté entre « dé-mocratie », « auto-immunité » et « dé-construction » (Voyous, 130).
Voir Démocratie, Mondialisation,Roue.
143
Derrida.Éléments
d’un lexique politiqueCh. Ramond
1. On trouvera ici, conformément à l’ambition générale du présent numéro de Cités, un« lexique » de la politique derridienne. Pour une vision plus générale de la philosophie de Derrida,voir notre Vocabulaire de Derrida (Paris, Ellipses, 2002).
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
Calculable/incalculable
La politique articule du calculable(le droit, l’économique, l’hospitalitéconditionnelle) et de l’incalculable (lajustice, le don, l’hospitalité incondi-tionnelle).
Voir Justice/droit ; Don-pardon/économie.
Circoncision/excision
De quoi demain, 313-314 : Derridaassocie ces deux pratiques : « Celareste (...) une question qui ne man-quera pas d’être soumise, de plus enplus, comme la peine de mort, àdes débats “mondialisés”. (...) Si l’onabandonne la circoncision, on est surla voie d’un abandon du phallocen-trisme. Cela vaudrait a fortiori pourl’excision ».
Voir Mondialisation, Peine demort.
Clonage, clonesque
« Comme si le clonage commençaitavec le clonage ! Comme s’il n’y avaitpas clonage et clonage ! Comme s’iln’y avait pas une façon clonesquede reproduire le discours contre le clo-nage. Partout où il y a de la répétitionet de la duplication, voire de la res-semblance, il y a du clonage, c’est-à-dire partout dans la “nature” et dansla “culture” qui ne va jamais sansquelque clonage » (De quoi demain,70-71) ; Ibid., 95 : « De la reproduc-tion, il y en a toujours eu. Prenons parexemple le cas du dressage. Je ne pensepas seulement au dressage des ani-maux, mais à celui de certains mili-tants politiques. On chercher à “repro-
duire” des individus qui pensent lamême chose, qui se conduisent de lamême manière (...) ; il s’agit là aussi declonage » (p. 98 : rapproche de toutcela le « plagiat » en littérature).
Déconstruction (et politique)
En général, la « déconstruction » estune méthode de lecture qui consiste,un peu à la manière de l’ironie, à laisserse détruire d’elle-même la thèse quel’on déconstruit. Il ne s’agit donc pasd’une critique résultant d’une inten-tion de nuire. Derrida se contente leplus souvent de rapprocher certainspassages : par exemple, pour Socrate,dans le Phèdre, l’écriture est un « poi-son » pour la mémoire, tandis que laphilosophie est un « remède » pour lapeur de la mort. Mais Platon emploieun seul mot (pharmakon) pour « poi-son » et « remède ». Chasser l’écriturede la philosophie, ce serait donc chas-ser la philosophie de la philosophie,ce qui est impossible. La « construc-tion » d’une opposition entre ces deuxnotions aura donc (toujours déjà)échoué.
La déconstruction ne reste pas àl’écart de la politique, tout au con-traire : « Pas de déconstruction sansdémocratie, pas de démocratie sansdéconstruction » (Voyous, 130) ; « Ladéconstruction, si quelque chose de telexistait, cela resterait à mes yeux, avanttout, un rationalisme inconditionnelqui ne renonce jamais, précisément aunom des Lumières à venir, dans l’es-pace à ouvrir d’une démocratie à ve-nir, à suspendre de façon argumentée,discutée, rationnelle, toutes les condi-tions, les hypothèses, les conventions
144
Lexique
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
et les présuppositions, à critiquer in-conditionnellement toutes les condi-tionnalités (...) » (ibid., 197). La dé-construction dit à la fois le rapportparadoxal (critique) que la démo-cratie entretient avec elle-même et letype d’interventions (prudentes, sin-gulières, toujours contextualisées, ja-mais acquises d’avance) de Derridaconcernant les questions politiques.
Démocratie (à venir)
La démocratie est le plus souvent dite« à venir » par Derrida (l’expression ap-paraît pour la première fois dans Dudroit à la philosophie, 1990, p. 53), car,pour un certain nombre de raisons, ellelui semble un État instable ou indéci-dable par définition, toujours à la fois enphase d’autoconfirmation de soi et decritique de soi. La démocratie est « bi-garrée », « bariolée », dit Derrida aprèsPlaton (Voyous, 48-49) : démocratie« n’est ni le nom d’un régime ni le nomd’une constitution. Ce n’est pas uneforme constitutionnelle parmi d’autres.De fait, nous avons connu, outre les dé-mocraties monarchiques, ploutocrati-ques, tyranniques de l’Antiquité, tantde régimes modernes soi-disant démo-cratiques. Du moins se présentent-ilscomme démocratiques (...) : démocratieà la fois monarchique (monarchie diteconstitutionnelle) et parlementaire (ungrand nombre d’États-nations d’Eu-rope), démocratie populaire, démo-cratie directe ou indirecte, démocratieparlementaire (présidentielle ou non),démocratie libérale, démocratie chré-tienne, social-démocratie, démocratiemilitaire ou autoritaire, etc. ». Quela démocratie n’ait pas de « propre »,
qu’elle « diffère » toujours d’elle-même,qu’elle soit « à venir » : autant de façonsde dire que la démocratie « relève de ladifférance », ou de la « trace » (Voyous,63 et 64 : « De démocratie, il ne sauraity avoir que trace »). C’est pourquoi,Derrida y insiste, ses thèses ont toujourseu une dimension politique : « Lapensée du politique a toujours été unepensée de la différance, et la pensée de ladifférance toujours aussi une pensée dupolitique » (Voyous, 64).
Que la démocratie soit dite parDerrida « à venir » n’implique cepen-dant en aucune manière, de sa part,une distance par rapport aux démocra-ties telles que nous les connaissons, oul’idée que la démocratie pourrait at-tendre pour ceux qui n’y ont pas en-core eu accès. Derrida est tout à faitclair sur ce point : « La démocratie àvenir ne signifie surtout pas simple-ment le droit de différer (...) l’ex-périence ou encore moins l’injonctionde la démocratie » (Voyous, 53). Il neveut pas dire que la démocratie seratoujours différée (il sait très bien que,comme l’avait annoncé Tocqueville,la démocratie envahit peu à peu lemonde), mais il estime que ladémocratie « restera toujours aporé-tique dans sa structure » : « Force sansforce, singularité incalculable et égalitécalculable, commensurabilité et in-commensurabilité, hétéronomie et au-tonomie, souveraineté indivisible etdivisible ou partageable, nom vide,messianicité désespérée ou désespé-rante, etc. » (Voyous, 126).
Voir Auto-immunité, Mondialisa-tion, Roue.
145
Derrida.Éléments
d’un lexique politiqueCh. Ramond
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
Engagements, interventions poli-tiques
Derrida, dans sa politique commedans sa philosophie, dénonce sans re-lâche les « positions » ou les « opposi-tions » toutes faites, et demande à exa-miner chaque cas en particulier. De làson refus systématique de se présenteren défenseur de quelque cause que cesoit « en général ». Tel combat mérited’être mené en un certain temps et enun certain lieu, mais pas ailleurs et à unautre moment, dans un autre contexte.Parfois il faudrait agir plutôt en « dé-mocrate », parfois plutôt en « républi-cain », être parfois « conservateur »,parfois non (De quoi demain, 29). Ildéclare par exemple, à propos du« communautarisme » : « Il faut (...)prendre en compte le contexte de lamanière la plus fine possible sans céderau relativisme. Je ne suis partisand’aucun communautarisme pur et sim-ple, et en tant que tel. Mais dans cer-taines situations, qu’il faut analyserchaque fois de façon singulière, je peuxêtre amené à prendre des positions quipeuvent ressembler, aux yeux des genspressés, à cela même que je conteste :et le relativisme et le communauta-risme » (De quoi demain, 48) ; ou en-core, à propos de la liberté de blas-phémer, ou du politiquement correct :« Dans ce domaine comme dans d’au-tres, la seule réponse est économique :jusqu’à un certain point, il y a toujoursune mesure, une meilleure mesure àprendre. Je ne veux pas tout interdire,mais je ne veux pas rien interdire. Je nepeux certes pas éradiquer, extirper lesracines de la violence à l’égard des ani-
maux, de l’injure, du racisme, del’antisémitisme, etc., mais sous pré-texte que je ne peux pas les éradiquer,je ne veux pas les laisser se développersauvagement. Donc, selon la situationhistorique, il faut inventer la moinsmauvaise solution. La difficulté de laresponsabilité éthique, c’est que la ré-ponse ne se formule jamais par un ouiou par un non, ce serait trop simple. Ilfaut donner une réponse singulière,dans un contexte donné, et prendre lerisque d’une décision dans l’endurancede l’indécidable. Chaque fois, il ya deux impératifs contradictoires »(ibid., 126-127) ; ou enfin, à proposdu souverainisme : « Selon les situa-tions, je suis antisouverainiste ou sou-verainiste – et je revendique le droitd’être antisouverainiste ici et souverai-niste là. Qu’on ne me fasse pas ré-pondre à cette question comme onappuie sur le bouton d’une machineassez primitive. Il y a des cas où jesoutiendrais une logique de l’État,mais je demande à examiner chaquesituation pour me prononcer. (...) àexiger de ne pas être incondition-nellement souverainiste, d’être sou-verainiste à certaines conditions, onremet déjà en cause le principe de sou-veraineté. La déconstruction com-mence là » (ibid., 152).
Derrida, il le sait, décevra donc tou-jours les militants : « De cette pensée,on ne peut sans doute déduire aucunepolitique, aucune éthique et aucundroit. Bien sûr, on ne peut rien enfaire. On n’a rien à en faire. Mais irait-on jusqu’à en conclure que cettepensée ne laisse aucune trace sur cequ’il y a à faire – par exemple, dans
146
Lexique
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
la politique, l’éthique ou le droit à ve-nir ? » (Voyous, 15).
Événement
Derrida, de façon parfois surpre-nante pour qui l’aurait suivi dans saphilosophie de la différance, du dif-féré, de l’itérabilité – bref, de ce qui ja-mais ne vient mais toujours revient,montre une obsession toujours plusgrande, d’œuvre en œuvre, pour la no-tion d’« événement » : des tentativestoujours plus précises pour s’approcherde cette « essence de l’événement, de cequi advient, une fois, une seule fois,une première et dernière fois, de façontoujours singulière, unique, exception-nelle, irremplaçable et imprévisible, in-calculable, de ce qui arrive ainsi, ou dequi arrive (...) » (Voyous, 189). Sur lemodèle d’un « don » qui serait absolu-ment pur, absolument immotivé (undon comme à vrai dire on n’en ren-contre pas), ou d’une décision sup-posant une « interruption absolue »d’avec ses propres motifs, Derridaconstruit en effet la notion d’une évé-nementialité absolument pure, absolu-ment immotivée, absolument incon-ditionnée. Le véritable événementdevrait être absolument imprévisible,devrait ne s’insérer dans aucun pos-sible, n’être la réalisation d’aucunepossibilité, ne pas même s’inscrire dansquelque horizon d’action ou d’attenteque ce soit. Seul un tel type d’évé-nement pourrait être véritablement dit« arriver », et c’est pour cela que Der-rida soutient que seul « arrive » « l’im-possible » – c’est sa définition (204).Et, pour lever tout soupçon de pen-chant mystique, Derrida précise que
« c’est la raison même qui nous com-mande de le dire, loin d’abandonnercette pensée de l’événement à quelqueobscur irrationalisme » (Voyous, 198).
Hospitalité
La question de l’hospitalité est unequestion politique de première impor-tance, depuis toujours : qui accueillir,à quelles conditions, dans quelles con-ditions ? Derrida est intervenu dansl’« affaire des sans-papiers » en 1996(De quoi demain, 100-101). La ques-tion de l’hospitalité prend de plusen plus de place dans les préoccupa-tions logiques et politiques de Derrida.Il distingue « hospitalité incondition-nelle » et « conditionnelle » ou « con-ditionnée ». La première « s’exposesans limite à la venue de l’autre, au-delà du droit, au-delà de l’hospitalitéconditionnée par le droit d’asile, par ledroit à l’immigration et même par ledroit à l’hospitalité universelle dontparle Kant et qui reste encore contrôlépar un droit politique ou cosmopoli-tique » (Voyous, 205). Cette « hospi-talité inconditionnelle » fait systèmeavec la doctrine de l’ « événement » ouencore avec celle du « don », ou del’ « im-possible » : c’est-à-dire, précisé-ment, « ce qui arrive ».
Voir Événement.
Justice/droit
Pour Derrida, « la justice excède ledroit » (Voyous, 205), car la justicerelève de l’incalculable, de l’événe-mentiel et de l’im-possible, tandis quele droit relève de la « raison calcula-trice ». La justice, en effet, supposel’application des règles du droit. Et
147
Derrida.Éléments
d’un lexique politiqueCh. Ramond
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
cette application, qui est une décision,ne peut pas aller sans suspensionmomentanée de cela même qui doitêtre appliqué. Au moment de rendre lajustice, le juge n’applique pas les rè-gles mécaniquement, mais les suspendpour les appliquer avec justice. SelonDerrida, la production de respon-sabilité produit, à ce moment précis,une « interruption absolue » (199), ou« folle », qui est pourtant la condi-tion de possibilité de la justice. On re-trouve ce schéma à propos du « don »,de l’ « hospitalité » et de l’ « événe-ment » : chacune de ces notions peutse dédoubler en une situation donnée(l’ordre du calculable, de l’écono-mique) et en un excès par rapport à lasituation (de l’ordre de l’incalculable,du non-économique), les deux restantà la fois incommensurables et indisso-ciables (208).
Voir Hospitalité.
Liberté
Derrida n’a jamais été un penseur dela liberté, au sens de Descartes ou deSartre, c’est-à-dire au sens d’une maî-trise exercée sur le monde ou sur soi parun sujet conscient. Pour Derrida, il y aen chacun de nous « plus d’un » sujet,et la maîtrise et la conscience relèventdu fantasme ou de l’hypocrisie. Il estmême allé, dans La Carte postale, jus-qu’à montrer quelque indulgence pourles « livres des sorts » et pour la supersti-tion fataliste. Cependant, dans ses der-nières années, Derrida est revenu de fa-çon plutôt inattendue à la pensée de laliberté : « Il m’est souvent arrivé, aucours de ces dernières années, quand
j’avais à nommer des choses de cetordre – le “libre”, l’incalculable, l’im-prévisible, l’indécidable, l’événement,l’arrivant, l’autre –, de parler de “ce quivient” » (De quoi demain, 90-91) ; dansces pages, Derrida développe cetteexpression à la limite, en essayant dedécrire une « hétéronomie » totale :quelque chose qui « surprendrait abso-lument », « (ce) qui vient », on ne saitmême pas si c’est un « ce » : « On peutappeler cela liberté, mais avec les réser-ves que je viens d’esquisser. (...) Je dissouvent, et j’essaie de démontrer, enquoi “ma” décision est et doit être la dé-cision de l’autre en moi, une “décisionpassive”, une décision de l’autre qui nem’exonère d’aucune responsabilité ».Dans Voyous, Derrida évoque la ques-tion de façon programmatique et para-doxale à l’extrême : « Ce qu’il faudraitpenser ici, c’est cette chose inconce-vable ou inconnaissable, une liberté quine serait plus le pouvoir du sujet, uneliberté sans autonomie, une hétéro-nomie sans servitude, bref quelquechose comme une décision passive »(210). Derrida ne donne pas d’exem-ples ; mais on pourrait peut-être penserà bien des choses qui nous apparaissentcomme des « décisions passives » : unevocation, un amour, la reconnaissanceet l’acceptation de nos désirs, la plupartdes choix vraiment déterminants quenous faisons dans notre vie, justement,ne nous semblent déterminants queparce qu’ils s’imposent à nous.
Messianicité sans messianisme
Expression qui apparaît assez sou-vent chez Derrida (voir par exempleVoyous, 126, 128, et s.). Elle caractérise
148
Lexique
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
la démocratie, selon un schéma kantien(comme la « finalité sans fin », décons-truite par Derrida dans La vérité enpeinture). Le sens est assez clair : la dé-mocratie délivre structurellement uneespérance, sans qu’on puisse dire exac-tement laquelle. Comme la plupart desstructures démocratiques, il s’agit doncd’une détermination paradoxale.
Mondialisation, mondialatinisation
« Aujourd’hui, on assiste à la fois,d’une part, à la consolidation de tout cequi lie le droit, la politique et la citoyen-neté à la souveraineté du “sujet” et,d’autre part, à une possibilité pour le su-jet de se déconstruire, d’être décons-truit. Les deux mouvements sontindissociables. D’où ce paradoxe : lamondialisation, c’est l’européanisa-tion. (...) L’Europe, c’est à mes yeux leplus bel exemple, l’allégorie aussi del’auto-immunité. Je dis “bel exemple”parce que si c’est beau l’Europe, c’est decette étrange beauté-là : l’auto-im-munité comme survie, l’invincibilitécomme auto-immunité. L’immensetragédie d’un beau suicide, quoi... »(De quoi demain, 288-289). La « mon-dialisation » est « mondialatinisation »parce qu’elle est d’abord européenne.Et l’Europe est à la fois l’empire et lesraisons de la lutte contre l’empire : « Leparadoxe, c’est en effet que l’on se libèrede l’ethnocentrisme, et éventuellementde l’européocentrisme, au nom de laphilosophie et de sa filiation euro-péenne. Il y a là une contradiction vi-vante, celle de l’Europe même, hier etdemain : non seulement elle se donnedes armes contre elle-même et contre sapropre limitation, mais elle donne des
armes politiques à tous les peuples et àtoutes les cultures que le colonialismeeuropéen a lui-même asservis. Celaressemble, une fois encore, à un pro-cessus auto-immunitaire » (De quoidemain, 38-39).
Voir Roue.
Peine de mort (philosophie/poli-tique)
Pour Derrida, la peine de mort n’estpas tant « un phénomène ou un articledu droit pénal que (...) la condition(...) du droit pénal et du droit en géné-ral ». Il poursuit (De quoi demain, 235-236) : « Pour dire la chose de façonbrève et économique, je partirai de cequi aura depuis longtemps été pourmoi la donnée la plus signifiante et laplus stupéfiante, la plus stupéfiée ausside l’histoire de la philosophie occiden-tale : jamais, à ma connaissance, aucunphilosophe en tant que tel, dans un dis-cours proprement et systématiquementphilosophique, jamais aucune philo-sophie en tant que telle n’a contesté lalégitimité de la peine de mort ». Ici,liaison entre « en tant que tel », « systé-matiquement », « propre » et « peinede mort » : la philosophie, précisémenten tant qu’elle est « systématique », re-cherche du « propre » et de l’ « iden-tique », participe selon Derrida d’une« souveraineté » consubstantielle à laraison et à l’Occident, dont la peine demort (ou le droit de grâce, qui n’en estque l’envers) fait nécessairement par-tie. La peine de mort fait ainsi le lien,selon Derrida, entre le « philosophi-que » et le « politique » : « Le proprede l’homme consisterait à pouvoir “ris-quer sa vie” dans le sacrifice, à s’élever
149
Derrida.Éléments
d’un lexique politiqueCh. Ramond
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
au-dessus de la vie, à valoir, dans sa di-gnité, plus et autre chose que la vie, àpasser par la mort vers une “vie” quivaut plus que la vie. C’est (...) la philo-sophie qui enjoint de s’exercer à lamort (...). La peine de mort serait doncbien, comme la mort elle-même, le“propre de l’homme” au sens strict.(...) Depuis longtemps, je suis doncpersuadé que la déconstruction del’échafaudage spéculatif (pour ne pasdire de l’échafaud) qui soutient le dis-cours philosophique sur la peine demort n’est pas une nécessité parmid’autres, un point d’application parti-culier. (...) La peine de mort serait<plutôt> une clef de voûte ».
Phallo-paterno-filio-fraterno-ipsocentrique (ou ipsocratique)
Caractérise la souveraineté démo-cratique (Voyous, 38), qui ne va jamaissans quelque filiation masculine et fra-ternelle d’un sujet capable de se déter-miner « soi-même » (à propos des troisvaleurs de la République, Derrida parlede « fraternocratie » – Voyous, 76).
Voir Démocratie, Roue, Souve-raineté.
Roue, tour, retourDerrida voit la démocratie au rouet.
« Je n’imagine pas qu’on ait pu jamaispenser et dire, ne serait-ce qu’en grec,“démocratie” avant le roulement dequelque roue. [...] rotondité d’un mou-vement giratoire, rondeur d’un retourà soi [...] » (Voyous, 29). Thèse de Der-rida : la démocratie ne va pas sans uncertain nombre de « retours », dont lepremier est peut-être le « retour à soi »,c’est-à-dire la réflexivité qui fait de
l’homme un sujet conscient de lui-même, maître de lui-même, souverainen une certaine manière. L’ipséité engénéral ( « être soi-même » ) envelop-perait ainsi « quelque “je peux”, ou àtout le moins le pouvoir qui se donne àlui-même sa loi, sa force de loi, sa re-présentation de soi, le rassemblementsouverain et réappropriant de soi de lasimultanéité de l’assemblage ou del’assemblée (...) » (30). La démocratiesuppose en effet ce « retour », ou ce pli,qui fait que chacun y est par définitionà la fois (et « tour à tour ») sujet et sou-verain : « Pas de liberté sans ipséité, etvice versa, pas d’ipséité sans liberté. Etdonc sans quelque souveraineté » (45).La souveraineté démocratique est donc« circulaire ». Derrida reprend les for-mules de Tocqueville : dans la démo-cratie, la société agit « par elle-même,et sur elle-même » ; circulairement, lepeuple y est « la cause et la fin de toutechose ; tout en sort et tout s’y ab-sorbe » (34). Il y a toujours quelque« révolution » dans la souveraineté dé-mocratique. Et la « mondialisation »démocratique est une « globalisation »,qui désigne bien « une vision dumonde déterminée par la rondeursphérique du globe ».
Ce retour sur soi, qui associe à l’ori-gine la souveraineté démocratique à laforce et à la puissance, est égalementlu par Derrida, et simultanément,comme « auto-immunité » par laquellela démocratie se « retourne sur soi »comme son propre ennemi. La démo-cratie est en effet essentiellement cri-tique de soi, retour fragilisant et nonpas seulement fortifiant sur soi. Ellevit/meurt de ce paradoxe : « La démo-
150
Lexique
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)
cratie a toujours été suicidaire » (57).Cette critique de la démocratie peut eneffet aller jusqu’à remettre en cause ladémocratie elle-même, de façon dé-mocratique : « L’alternative à la dé-mocratie peut toujours être repré-sentée comme une alternance démocra-tique » (54).
La démocratie relève donc d’un« tour » ou « retour » contradictoire,que Derrida appelle parfois le doublebind (double injonction contradic-toire) auto-immunitaire ou démocra-tique (Voyous, 64).
Voir Auto-immunité, Démocratie,Mondialisation.
Souveraineté, inconditionnalité
La tentative pour dissocier « souve-raineté » et « inconditionnalité » est legeste principal de Voyous.
Pour Derrida, Karl Schmitt a bienvu que la souveraineté était affaired’exception : a la souveraineté celuiqui décide de l’exception et quant àl’exception (Voyous, 142). De ce fait, lasouveraineté ne peut pas, par défini-tion, se soumettre ou se concilier avecle discours du droit. Elle est forcément« indivisible », « pure », « silencieuse »et « inavouable » : « L’abus de pou-voir est constitutif de la souverainetémême » (Voyous, 145) ; « L’abus est laloi de l’usage, telle est la loi même, telle
est la “logique” d’une souveraineté quine peut régner que sans partage »(ibid., 146). Il y a donc incompatibi-lité entre « droit » et « souveraineté »(ou imposture, comédie) : et, par con-séquent, tout État « souverain » est etne peut être qu’un « voyou », celui qui« ne respecte pas les règles » : « Il n’y adonc plus que des États-voyous, et iln’y a plus d’État-voyou » (150).
Voir Exception, Peine de mort,Voyou.
Voyou, État-voyouLe voyou est « ce qu’il y a de plus po-
pulaire dans le peuple. Le demos n’estdonc jamais loin quand on parle duvoyou. Ni la démocratie très loin de lavoyoucratie » (Voyous, 97). Un des butsde Derrida, dans Voyous, est en effet demontrer que le terme « voyou », qui sertà stigmatiser certains États, dits « États-voyous », ceux qui ne respectent pasles règles du droit international, parexemple, se retourne nécessairementcontre ceux qui l’emploient : car toutÉtat « démocratique », comme on vientde le dire, et tout État « souverain », ence que la souveraineté se définit commecapacité à ne pas obéir aux contrainteslégales dans certaines circonstances,peuvent très légitimement être qualifiésde « voyous ».
Voir Souveraineté.
151
Derrida.Éléments
d’un lexique politiqueCh. Ramond
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
20/
06/2
021
sur
ww
w.c
airn
.info
via
Uni
vers
ité P
aris
8 (
IP: 1
93.5
4.17
4.3)
© P
resses Universitaires de F
rance | Téléchargé le 20/06/2021 sur w
ww
.cairn.info via Université P
aris 8 (IP: 193.54.174.3)