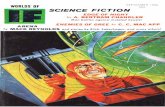« Biopouvoir. Les sources historiennes d’une fiction politique »
-
Upload
univ-rennes1 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of « Biopouvoir. Les sources historiennes d’une fiction politique »
BIOPOUVOIR, LES SOURCES HISTORIENNES D'UNE FICTIONPOLITIQUE Luca Paltrinieri Belin | Revue d'histoire moderne et contemporaine 2013/4 - n° 60-4/4 bispages 49 à 75
ISSN 0048-8003
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2013-4-page-49.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paltrinieri Luca, « Biopouvoir, les sources historiennes d'une fiction politique »,
Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2013/4 n° 60-4/4 bis, p. 49-75.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Belin.
© Belin. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
Foucault historien ?
Biopouvoir,les sources historiennes d’une fi ction politique
Luca PALTRINIERI
La notion de « biopouvoir » a fait l’objet, ces dernières années, d’un intérêt consi-dérable et d’une véritable explosion discursive. Sans entrer dans les détails des innombrables interprétations en présence, on peut identifi er schématiquement deux grandes manières de comprendre la notion. Selon une première pers-pective, le terme est synonyme d’une théorie du pouvoir et puise sa légitimité dans le domaine de la philosophie politique. C’est en s’appuyant précisément sur cette approche que la notion a pu resurgir après une longue éclipse vers le milieu des années 1990, lorsque Giorgio Agamben l’a remise au goût du jour en la déconnectant de son contexte de formulation – l’histoire de la sexualité – pour la situer dans une histoire de la philosophie allant d’Aristote à Schmitt1. À travers cette opération, le terme de « biopouvoir » a été renvoyé d’un côté à un pouvoir souverain immémorial, de l’autre à la culmination d’une époque métaphysique où coïncident bios et zoé. Seule une relecture de l’histoire de la philosophie pourrait alors révéler l’étendue métaphysique de la notion et indi-quer les voies de déconstruction de la machine gouvernementale moderne2. Bien que revendiquant une approche en tout point opposée à celle d’Agamben, Hardt et Negri sont assez proches de cette conception lorsque, tout en essayant de penser une « biopolitique affi rmative » immanente au social, ils la renvoient à une sorte de production ontologique de la vie par la vie elle-même3. Dans les deux cas, on reconnaît l’existence du biopouvoir comme un ensemble de procédures historiques données mais pour le renvoyer à un autre principe
1. Giorgio AGAMBEN, Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue [1995], Paris, Seuil, 1998.2. G. AGAMBEN, « Note liminaire sur le concept de démocratie », in G. AGAMBEN et alii, Démocratie,
dans quel état ?, Paris, La fabrique, 2009, p. 9-13.3. Selon eux, « le biopouvoir se tient au-dessous de la société, il est transcendant, à l’image d’une
autorité souveraine, et il impose son ordre. La production biopolitique est en revanche immanente au social ; elle crée des relations et des formes sociales à travers des modalités de travail coopératives », voir Michael HARDT, Antonio NEGRI, Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire [2004], Paris, La Découverte, 2004, p. 121.
REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE60-4/4bis, octobre-décembre 2013
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 498105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 49 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
50 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
qui surdétermine l’événement historique : soit une machine métaphysique qui semble régir l’histoire occidentale, soit une puissance ontologique créatrice4.
Différente a été la réception de la notion de « biopouvoir » dans les sciences sociales5. Séduits par la puissance de dévoilement des concepts foucaldiens, les sociologues, les anthropologues ou les politistes les ont transformés en outils opératoires pour la description du présent. Or, si ces usages proliférants ont parfois tendance à déshistoriciser la notion, il est intéressant de remarquer que, dans d’autres cas, le concept de biopouvoir est susceptible d’être interprété comme une thèse purement descriptive qu’il faut donc confi rmer ou invalider par des reconstructions historiques ou des observations de terrain. Mais cette « objectivation » s’opère alors au détriment de la valeur heuristique de la notion qui était censée ouvrir de nouveaux champs d’enquête et d’étude6.
Célébrés comme des néologismes foucaldiens7, les concepts de biopouvoir et de biopolitique se retrouvent ainsi au cœur d’un paradoxe : si le courant philosophique les « abstractifi e » et les déshistoricise sous la forme d’un pou-voir souverain transcendantal ou d’une « puissance » de (dé)formation et (re)composition des corps et des collectivités, les sciences sociales réduisent le biopouvoir à une perspective purement historique ou sociologique, dont la valeur explicative est mesurée selon sa pertinence « objective ».
Bien que légitimes au sein de leurs domaines respectifs, ces deux approches confl ictuelles ne semblent pas pourtant pouvoir rendre compte de la complexité de la notion dans sa formulation foucaldienne. En effet, la fascination durable que le travail de Foucault a manifestement exercée sur nombre de lecteurs provient probablement du fait qu’il n’a pas choisi entre la perspective philosophique et la problématisation historique8. Autrement dit, il nous semble qu’un certain nombre d’interprétations ignorent la nature hybride, mi-théorique et mi-hypothétique
4. Pour une critique similaire : Paul RABINOW, Nikolas ROSE, « Biopower today », BioSocieties, 1-2, juin 2006, p. 195-217.
5. Deux exemples de la reprise de la notion dans des perspectives sociologiques, anthropologiques et historiques dans : Didier FASSIN, Dominique MEMMI (éd.), Le gouvernements des corps, Paris, Édi-tions de l’EHESS, 2004, et N. ROSE, The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton, Princeton University Press, 2007. Voir aussi, sur ces différents usages, Frédéric KECK, « Les usages du biopolitique », L’Homme, 187-188, juillet-décembre 2008, p. 295-314.
6. Alors que bon nombre d’historiens avaient mis en garde contre la tentation d’objectivation en soulignant que justement, après Foucault, il était devenu impossible de considérer les objets de l’historien comme des catégories universelles dont il faudrait repérer les variations historiques. Parmi les autres : Paul VEYNE, « Foucault révolutionne l’histoire », in ID., Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1978, p. 385-429 ; Roger CHARTIER, « Foucault et les historiens, les historiens et Foucault. Archéologie des discours et généalogie des pratiques : à propos de la Révolution », in Au risque de Foucault, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1997, p. 223-237.
7. Virginie TOURNAY, « Le biopouvoir à l’épreuve des travaux sur la biomédecine : succès poli-tique d’un néologisme », in Sylvain MEYET, Marie-Cécile NAVES, Thomas RIBEMONT, Travailler avec Foucault, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 97-117.
8. Pour une autre perspective sur la même question, cette fois-ci du point de vue de l’histoire de la philosophie : Luca PALTRINIERI, « L’histoire de la philosophie saisie par son dehors », in Damien BOQUET, Blaise DUFAL, Pauline LABEY (éd.), Une histoire au présent : les historiens et Michel Foucault aujourd’hui, Paris, CNRS Éditions, 2013, p. 319-335.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 508105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 50 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 51
de la notion de biopouvoir9. Il ne s’agira pas ici de réfuter ces interprétations ni d’établir une sorte de police des usages de Foucault, mais de reconstruire le contexte historique et intellectuel dans lequel est née cette notion paradigma-tique. Car il est urgent, aujourd’hui plus que jamais, de mettre en lumière une certaine structure du travail foucaldien dans lequel est inscrite la nécessité de positionnement politique par rapport aux enjeux de son propre temps.
ENTRE PHILOSOPHIE ET HISTOIRE : LA GÉNÉALOGIE FOUCALDIENNE
Nous pouvons commencer par rappeler que l’un des passages où est ouverte-ment explicitée la double exigence, historique et philosophique, de la généalogie se trouve à la fi n du premier chapitre de ce manifeste quasi-programmatique qu’est la quatrième partie de La volonté de savoir (intitulée « Le dispositif de sexualité »). On peut en effet y lire, lorsque l’on aborde le projet foucaldien de produire une histoire de la sexualité, le passage suivant :
« Il s’agit à la fois, en se donnant une autre théorie du pouvoir, de former une autre grille de déchiffrement historique ; et, en regardant d’un peu près tout un matériau historique, d’avancer peu à peu vers une autre conception du pouvoir. Penser à la fois le sexe sans la loi, et le pouvoir sans la loi »10.
Ce caractère circulaire de l’analyse pourrait rappeler la structure de l’interprétation herméneutique si l’aller-retour ne se faisait pas entre le texte et ses parties, mais entre la « théorie du pouvoir » et le « matériau historique », c’est-à-dire entre deux objets qui impliquent normalement deux différentes modalités de travail et de construction.
En effet, au lieu de partir des archives, le généalogiste assume d’emblée la nécessité d’une hypothèse qui assure l’émergence d’un nouveau champ d’objets. Ce regard « théorique » permet alors un premier découpage historique et appelle, par conséquent, une nouvelle périodisation. Mais il est certain que la théorie n’est pas justifi ée et justifi able en elle-même : elle consiste en une sorte de « fi ction », c’est-à-dire une modalité de connaissance du réel qui doit tout au plus assurer la rencontre avec un matériau historique11. C’est bien là que le philosophe doit se
9. Foucault se défi nissait lui-même comme un « empiriste aveugle » : « Je n’ai pas de théorie générale et je n’ai pas non plus d’instrument sûr. Je tâtonne, je fabrique, comme je peux, des instruments qui sont destinés à faire apparaître des objets. Les objets sont un petit peu déterminés par les instruments bons ou mauvais que je fabrique. Ils sont faux, si mes instruments sont faux… J’essaie de corriger mes instruments par les objets que je crois découvrir et, à ce moment-là, l’instrument corrigé fait apparaître que l’objet que j’avais défi ni n’était pas tout à fait celui-là, c’est comme ça que je bafouille ou titube, de livre en livre. » (« Pouvoir et savoir », entretien avec S. Hasumi, in M. FOUCAULT, Dits et écrits (1954-1988), Paris, Gallimard, 1994, vol. 3, p. 404-405).
10. M. FOUCAULT, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 120.11. Voir aussi, pour une conception similaire de la fi ction comme modalité d’intelligibilité reliant
l’historien à son présent, Michel DE CERTEAU, « La fi ction de l’histoire. L’écriture de Moïse et le “monothéisme” », in ID., L’écriture de l’histoire, Paris, 1975, p. 365-419 ; M. DE CERTEAU, Dominique JULIA, Jacques REVEL, Une politique de la langue, Paris, Gallimard, 1975, chap. 4 : « Théorie et fi ction (1760-1780) : De Brosses et Court de Gébelin », p. 80-98.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 518105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 51 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
52 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
faire historien et archiviste pour pouvoir mettre en perspective le lieu d’où il parle12. En d’autres termes, si l’opération généalogique consiste précisément à se focaliser sur un problème actuel en vue d’en reconstruire l’histoire, elle doit permettre également de revenir au présent afi n de créer une autre grille de déchiffrement des relations de pouvoir13.
Il faut souligner que cette référence au présent et à la connaissance de l’actua-lité, de ses points délicats et des modifi cations possibles dont elle peut faire l’objet, traverse l’œuvre de Foucault tout au long des années 1970 et 1980. Foucault en fait même la tâche première de la philosophie qu’il redéfi nit successivement comme « diagnostic », « politique de la vérité » ou « ontologie du présent »14. Mais la distanciation nécessaire, que doit réaliser le généalogiste par rapport à son présent afi n de le connaître et le manifester, est possible précisément grâce à la surdétermination de la reconstruction historique par la connaissance fi ctionnelle. Les reconstructions historiques foucaldiennes sur la naissance de la prison, de la folie ou de la psychiatrie doivent donc être considérées comme des fi ctions préci-sément dans la mesure où elles nous permettent de jeter un regard différent sur notre présent, comme lieu privilégié où se nouent les enjeux d’une « politique de la vérité »15. Ainsi, le terme de « fi ction » signifi e ici que le but du travail généalogique est moins de construire un récit objectif (ou tout simplement « convaincant ») que de mettre en lumière, par un diagnostic critique, notre présent. Une formule lapidaire, énoncée au cours d’un entretien sur La volonté de savoir, résume assez bien cette structure complexe : « La question de la philosophie, c’est la question de ce présent qui est nous-mêmes. C’est pourquoi la philosophie aujourd’hui est entièrement politique et entièrement historienne. Elle est la politique immanente à l’histoire, elle est l’histoire immanente à la politique »16.
Cette projection de la pratique historique sur la compréhension des enjeux du présent n’est d’ailleurs pas sans rappeler le « présentisme » assumé des premiers
12. M. FOUCAULT, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », in Hommage à Jean Hyppolite, Paris, PUF, 1971, p. 145-172.
13. Dans l’un de ses derniers entretiens, à propos de ses recherches sur l’Antiquité, Foucault écrit : « Je pars d’un problème dans les termes où il se pose actuellement et j’essaie d’en faire une généalogie ». M. FOUCAULT, « Le souci de la vérité », in ID., Dits et écrits…, op. cit., vol. 4, p. 674.
14. « La philosophie structuraliste permet de diagnostiquer ce qu’est aujourd’hui », entretien accordé en 1967 à La presse de Tunisie, « la défi nition de la philosophie comme “politique de la vérité” », in M. FOU-CAULT, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard-Seuil-EHESS, 2004, p. 5 ; voir aussi ID., La volonté de savoir, op. cit., p. 81. L’expression « ontologie du présent » apparaît dans une conférence tardive, « Qu’est-ce que les Lumières ? », in ID., Dits et écrits…, op. cit., vol. 4, p. 562-578. Sur le rapport « philosophique » de Foucault à l’histoire, s’inscrivant dans le long débat fran-çais entre philosophes, historiens, sociologues et économistes, voir Gérard NOIRIEL, Penser avec, penser contre. Itinéraire d’un historien, Paris, Belin, 2003, p. 25-46. Cf. aussi RHMC, 51-4 bis, supplément 2004.
15. « Entretien avec M. Foucault », in M. FOUCAULT, Dits et écrits…, op. cit., vol. 4, p. 44 : « Mon problème est de faire moi-même, et d’inviter les autres à faire avec moi, à travers un contenu histo-rique déterminé, une expérience de ce que nous sommes, de ce qui est non seulement notre passé mais aussi notre présent, une expérience de notre modernité telle que nous en serions transformés. Ce qui signifi e qu’au bout du livre nous pussions établir des rapports nouveaux avec ce qui est en question ». Sur ce point : L. PALTRINIERI, L’expérience du concept. Michel Foucault entre généalogie et histoire, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 198-229.
16. M. FOUCAULT, « Non au sexe roi », in ID., Dits et écrits…, op. cit., vol. 3, p. 266.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 528105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 52 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 53
représentants de l’École des Annales. Lorsque Lucien Febvre et Marc Bloch étudiaient les fl uctuations économiques et monétaires du passé, c’était à partir de l’expérience de la grande dépression économique de l’époque17. Ainsi, le présent était simultanément le point de départ et d’arrivée de l’analyse histo-rique, la tâche de l’historien étant précisément de répondre aux questions que se pose l’homme d’aujourd’hui18.
Toutefois, l’analogie entre le « présentisme » des historiens et l’histoire foucaldienne du présent n’épuise pas la question du rapport de Foucault à la fabrique de l’histoire : si la philosophie peut devenir « entièrement politique » à travers un certain usage de la construction historique, cela signifi e précisément que pour être aux prises avec le présent elle doit payer une dette spécifi que ou, pour le dire autrement, une série de dettes à « l’histoire des historiens ». Il s’agit d’abord d’une dette en termes de pratiques : depuis l’Histoire de la folie le philosophe se fait archiviste et multiplie les invitations à construire « sa » propre histoire19. Pourtant, parmi les « matériaux historiques » mobilisés par le généalogiste, il n’y a pas seulement les archives, mais aussi les sources secondaires et les ouvrages d’historiens20. Il nous paraît important d’insister sur ce point car il s’agit là d’un aspect qui a souvent été délaissé par les com-mentateurs : comment en effet Foucault lisait-il les historiens de son époque ? En quoi ces lectures lui permettaient-elles de défi nir un champ d’études ou un concept ? Comment ces récits s’inscrivaient-ils dans sa lecture fi ctionnelle de son propre présent ?
Nous voudrions essayer ici de répondre à ces questions en nous attachant moins à la signifi cation de la notion de biopouvoir qu’à son élaboration contex-tuelle. Autrement dit, il ne s’agit pas pour nous de déterminer la signifi cation réelle de la défi nition foucaldienne, mais de nous immerger dans la fabrique des concepts foucaldiens à travers une opération de contextualisation qui nous permettra également de faire le point sur le rapport qu’entretient Foucault à la littérature historienne de son temps. En nous appuyant sur les quelques indices que nous recueillerons à partir de ces lectures, il s’agira alors de montrer à la fois le rôle qu’elles ont pu jouer dans les prises de positions politiques du philosophe, et la façon dont elles ont été « instrumentalisées », souvent de façon ironique, pour révéler certains aspects de notre actualité.
17. André BURGUIÈRE, L’École des Annales. Une histoire intellectuelle, Paris, Odile Jacob, 2006, p. 33 sq. ; Jacques LE GOFF, « Foucault et la “nouvelle histoire” », in Au risque de Foucault, op. cit., p. 129-139.
18. Voir, plus particulièrement sur Lucien Febvre, François HARTOG, Régimes d’historicité. Pré-sentisme et expériences du temps [2003], Paris, Seuil, 2012, p. 22-23.
19. Voir par exemple « Entretien avec Michel Foucault », entretien avec D. Trombadori, in M. FOU-CAULT, Dits et écrits…, op. cit., vol. 4, p. 76 : « Je n’entends pas affi rmer que chacun doit construire l’histoire qui lui convient, mais il est un fait que je ne me suis jamais pleinement satisfait des travaux des historiens. Même si je me suis référé à de nombreuses études historiques et si je m’en suis servi, j’ai toujours tenu à conduire moi-même les analyses historiques dans les domaines auxquels je m’intéressais ».
20. Voir la note précédente ; sur le rapport aux sources secondaires, plus particulièrement dans Les mots et les choses : L. PALTRINIERI, « L’analyse des richesses dans Les mots et les choses », in Philippe ARTIÈRES et alii (éd.), Michel Foucault. Les cahiers de l’Herne, Paris, L’Herne, 2011, p. 122-130.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 538105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 53 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
54 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
LE CONTEXTE : L’HISTORICISATION DE LA NOTION DE « BIOPOUVOIR »
Pour comprendre le contexte de formulation de la notion de biopouvoir, encore faut-il partir du constat que les mots « biopouvoir » et « biopolitique » ne sont pas des néologismes foucaldiens. Au moment où Foucault commence à se les réapproprier, c’est-à-dire au milieu des années 1970, ils font déjà l’objet d’un usage académique et d’une certaine visibilité disciplinaire notamment dans le contexte de la sociobiologie, où ils sont le plus souvent les marqueurs d’une approche naturaliste du politique qui consiste à reconduire le comportement politique aux données éthologiques, neurobiologiques ou physiologiques de la vie humaine. Pour des auteurs comme Albert Somit, David Schwartz ou Thomas Thorson, la nature humaine cesse d’être le problème majeur que la politique moderne tenta de surmonter par une approche purement contractua-liste et se retrouve désormais à l’origine génétique d’un agir politique dont la vie biologique est considérée comme une donnée inaltérable et intemporelle21.
Par conséquent, l’usage du mot « biopolitique » par Foucault relèverait non pas d’une invention sémantique mais d’une transcription qui permet de redéfi nir le terme lui-même ou, plus précisément, de s’emparer d’un concept pour le défi nir autrement22. Cette opération foucaldienne, qui s’échelonne entre 1975 et 1979, pourrait alors être décrite comme une tentative de prendre le contre-pied de l’interprétation dominante du biopouvoir comme réduction du politique au biologique. Il ne s’agit pas toutefois de soulever l’argument « humaniste » de l’irréductibilité de l’existence et de l’expérience humaines contre la biologisation du politique, mais de montrer qu’entre histoire et nature il n’existe pas d’opposition totale. Dans une recension du livre du généticien Jacques Ruffi é, De la biologie à la culture, Foucault écrit que les recherches en génétique des populations ont montré qu’il ne faut pas chercher « des faits biologiques bruts et défi nitifs qui, du fond de la “nature” s’imposeraient à l’histoire »23. Il faut penser, en revanche, les interactions entre les vivants et leurs milieux comme autant de transformations historiques des processus « naturels », qui déstabilisent fi nalement l’idée même d’une « nature humaine ». Dans La volonté de savoir, ce programme prend une dimension plus politique : tout en refusant ces grandes synthèses dans lesquelles « le biologique et l’historique se feraient suite », il s’agit d’affi rmer que la vie biologique de l’homme est continuellement transformée et traversée par une histoire politique de la sexualité24.
C’est la raison pour laquelle Foucault introduit également le concept de « bio-histoire » qui commencerait là où l’action humaine laisse une « trace »
21. Sur ces questions : Antonella CUTRO, Technique et vie. Biopolitique et pensée du bios dans la pensée de Michel Foucault, Paris, L’Harmattan, 2011.
22. L. PALTRINIERI, « L’équivoque biopolitique », Chimères, 74, 2010, p. 153-166.23. M. FOUCAULT, « Bio-histoire et bio-politique », in ID., Dits et écrits…, op. cit., vol. 3, p. 97.24. M. FOUCAULT, La volonté de savoir, op. cit., p. 200. Il s’agit d’une allusion claire au darwinisme
social et à l’évolutionnisme sociologique.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 548105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 54 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 55
perceptible dans la « confi guration biologique » de l’espèce humaine. Les effets biologiques de l’intervention médicale sur l’espèce humaine représentent, par exemple, un événement de la bio-histoire : au milieu du XVIIIe siècle, un seuil aurait été franchi lorsque les grands États mirent en place les principaux appareils médicaux dont le but était de gérer les phénomènes propres à l’espèce humaine25. Le « seuil de modernité biologique » serait dépassé lorsque l’inter-férence entre biologie et histoire commence à être réfl échie à l’intérieur de la pratique humaine elle-même et lorsque les processus biologiques propres des corps et des populations commencent à être étudiés, contrôlés et transformés par une série de mécanismes étatiques régularisateurs26. À partir de ce moment précis, la politique doit alors constamment imiter et reproduire quelque chose comme une « nature »27. La notion de bio-pouvoir est donc la traduction conceptuelle de cette nouvelle articulation de l’histoire et de la vie décrite par Foucault, caractérisée par « cette position double de la vie qui la met à la fois à l’extérieur de l’histoire, comme son entour biologique, et à l’intérieur de l’historicité humaine, pénétrée par ses techniques de savoir et de pouvoir »28.
Selon un premier niveau de lecture, le concept de biopouvoir permet donc de répondre à la biologisation du politique par une historicisation du biologique afi n de reconstruire l’origine historique de « l’obsession naturaliste » de la politique contemporaine. Notons également que cette reformulation s’inspire de la leçon philosophique de Georges Canguilhem selon laquelle l’histoire de l’homme serait celle d’un être capable de structurer son milieu à travers le dépassement de normes biologiques et la création de normes sociales29. Mais cette problématisation du biopouvoir est également tributaire de l’infl uence évidente des historiens des Annales, et plus particulièrement de Fernand Braudel qui avait en effet mis l’accent sur l’articulation entre le monde biologique et le monde social dans la construc-tion historique d’une culture. À ce sujet, Braudel avait montré l’historicité des interactions entre le milieu naturel et le milieu humain en examinant comment le commerce avec l’Orient ou le Nouveau Monde avait non seulement mis en circulation des idées et des usages nouveaux, mais importé aussi des plantes qui avaient modifi é le milieu végétal, des épidémies responsables de plusieurs fl uctua-tions démographiques perceptibles jusqu’à l’aube de la modernité et une nouvelle alimentation qui a fi ni par modifi er durablement les dimensions biologiques et
25. M. FOUCAULT, « La naissance de la médecine sociale », in ID., Dits et écrits…, op. cit., vol. 3, p. 207.26. M. FOUCAULT, Il faut défendre la société. Cours au Collège de France, 1975-1976, Paris, Galli-
mard-Seuil-EHESS, 1997, p. 213 sq.27. Voir la défi nition du libéralisme comme « naturalisme », M. FOUCAULT, Naissance de la biopo-
litique, Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Gallimard-Seuil-EHESS, 2004, p. 63.28. M. FOUCAULT, La volonté de savoir, op. cit., p. 189.29. Voir en particulier les « Nouvelles réfl exions sur le normal et le pathologique » parues dans la
nouvelle édition du Normal et le pathologique en 1966 (Paris, PUF). Mais on doit parler d’une infl uence réciproque entre Canguilhem et Foucault : Pierre MACHEREY, « De Canguilhem à Canguilhem en passant par Foucault », in Georges Canguilhem. Philosophe, historien des sciences, Paris, Albin Michel, 1993, p. 286-294.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 558105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 55 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
56 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
physiques de l’existence humaine30. Pour l’historien, le travail perpétuel de réa-gencement et de réajustement des sociétés modifi e l’environnement biologique où évolue l’humanité, mais aussi les dispositions physiques et mentales des êtres humains. C’est ce modèle braudelien que Foucault mobilise lorsqu’il affi rme que la « bio-histoire » est continuellement traversée par une « biopolitique », qui n’est pas une simple adaptation du pouvoir à la vie, une « imitation de la vie », ou une « capture de la vie » dans l’ordre politique. La biopolitique décrit davantage le domaine de l’action humaine et de ses effets sur la vie dans le contexte plus large de l’« interférence » entre les mouvements de la vie et les processus historiques31.
LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE : UNE QUESTION POUR LES HISTORIENS
On sait que, depuis Marx, l’historicisation d’un concept permet de le déna-turaliser et de questionner les évidences et les présupposés qu’il véhicule. L’originalité et la spécifi cité de l’opération foucaldienne tiennent en revanche au fait que ce processus d’historicisation se base moins sur une philosophie de l’histoire hégélienne que sur la lecture et l’usage des travaux des historiens. Les pages de La volonté de savoir où Foucault mobilise la notion de biopouvoir sont en effet imprégnées des débats historiens de l’époque. Les allusions au fait que le rapport de l’homme à la nature était, dans les sociétés d’Ancien Régime, placé « sous le signe de la mort » et que « la pression du biologique sur l’histo-rique était restée, pendant des millénaires, extrêmement forte » renvoient aux longues durées braudeliennes et à « l’histoire immobile » de Le Roy Ladurie32. Même la célèbre description de la relève du droit souverain « de faire mourir et laisser vivre » par un biopouvoir qui « fait vivre et laisse mourir » se fonde sur les acquis de l’histoire quantitative et sérielle dont Foucault avait fait l’éloge dans L’archéologie du savoir33. Il convient alors de s’attarder quelque peu sur les sources historiennes spécifi ques de la lecture foucaldienne.
Pierre Goubert avait déjà dessiné en 1958 les traits du régime démogra-phique d’une série de paroisses autour de Beauvais pendant le XVIIe siècle et le premier tiers du XVIIIe siècle34. Il parvenait à montrer que la mortalité annulait la natalité par des crises cycliques d’une durée de trente ans en ramenant ainsi
30. Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949.
31. M. FOUCAULT, La volonté de savoir, op. cit., p. 187. Voir aussi ID., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 30-31 : « Les historiens ont montré jusqu’à quel point les processus historiques étaient impliqués dans ce qui pouvait passer pour le socle purement biologique de l’existence ; et quelle place il fallait accorder dans l’histoire des sociétés à des “événements” biologiques comme la circulation des bacilles, ou l’allongement de la durée de la vie ».
32. Emmanuel LE ROY LADURIE, « L’histoire immobile », Annales ESC, 29-3, mai-juin 1974, p. 673-692. Foucault mentionne Le Roy Ladurie dans Surveiller et punir, op. cit., p. 31.
33. M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 9-21. Sur ce sujet également : L. PALTRINIERI, « L’histoire… », art. cit.
34. La thèse sera publiée en 1960 : Pierre GOUBERT, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’histoire sociale de la France du XVIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1960.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 568105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 56 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 57
la population « au niveau requis par les subsistances, c’est-à-dire par le système économique et social »35. L’idée d’un comportement démographique « froid », typique des sociétés d’Ancien Régime, où le biologique « tenait une place rela-tivement plus importante que de nos jours »36 revenait également dans l’étude de Le Roy Ladurie sur Les paysans de Languedoc qui fut publiée en 1966 et qui reconstruisait l’histoire économique et démographique longue du Languedoc entre 1500 et 1700. Le Roy Ladurie décrivait en effet une société où l’obsession et la quotidienneté de la mort étaient les refl ets d’une démographie fragile, caractérisée par une forte fécondité mais aussi par une redoutable mortalité qui frappait par grandes vagues sans envisager aucune possibilité de réplique. Dans l’ancien système démographique, la mort était donc le maître du jeu : « C’est la mort indubitablement qui manœuvre les populations. C’est elle qui ajoute aux conséquences normales des disettes, les effets multiplicateurs de l’épidémie »37.
À travers les données de la démographie historique, les historiens des Annales avaient également découvert le recul défi nitif des quatre « chevaliers de l’apocalypse » (la peste, les épidémies, la guerre, la famine) à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les progrès de la médecine et de l’hygiène publique, auxquels s’ajouta la croissance de subsistances qui résulta de la révolution agricole et manufacturière du début du siècle, auraient fait reculer la mortalité en créant un excédent important de population. La diffusion des méthodes de limita-tion des naissances au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, puis tout au long du XIXe siècle, aurait également réduit la natalité pour aboutir à un nouvel équilibre entre morts et naissances dès les débuts de la phase moderne.
Ce modèle avait été observé pour la première fois en 1929 par le démo-graphe américain Warren Thompson et l’avocat polonais Léon Rabinowicz, pour être ensuite repris par Frank Notenstein, inventeur du terme « transition démographique » en 194538. Au même moment, en France, Landry parlait
35. Compte rendu de Marcel REINHARD, « La population française au XVIIe siècle », Population, 1958-4, p. 619-630.
36. Jacques DUPÂQUIER, Pour la démographie historique, Paris, PUF, 1984, p. 64.37. E. LE ROY LADURIE, Les paysans de Languedoc, Paris, SEVPEN, 1966, p. 428. Voir Serge
DONTENWILL, « La démographie de l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècle). Méthodes, bilan, pers-pectives », Bulletin du Centre d’Histoire régionale de l’Université de Saint-Étienne, 1, 1975, p. 15-39 : « La vitalité des populations de l’époque pré-moderne se heurtait à une redoutable mortalité à la fois forte et irrégulière, et c’est là évidemment que résidait une menace permanente de rupture d’équilibre et la cause de la fragilité démographique si caractéristique de cette période ». En cas de catastrophe démographique, la réduction du célibat et l’abaissement de l’âge au mariage rééquilibraient bientôt la mortalité, ce qui conduisait à une forte stabilité de la population. En ce sens, le schéma malthusien du positive check, la limitation directe du surplus de population par la mortalité, informe la démarche des historiens. Lorsque Le Roy Ladurie constate le plafonnement et même le recul de la population du Bas Languedoc après 1677, il écrit : « La hausse progressive du peuplement peu à peu sature les terroirs, les subsistances, l’emploi ; l’essor démographique se retourne contre lui-même ; il dévore ses propres enfants ».
38. Pour une histoire intellectuelle du concept de « transition démographique » : Simon SZRETER, « The idea of demographic transition and the study of fertility change : a critical intellectual history », Population and Development Review, 19-4, 1993, p. 659-701 ; Jean-Claude CHESNAIS, « La transition démographique : 35 ans de bouleversements (1965-2000) », in Jean-Claude CHASTELAND, J.-C. CHESNAIS (éd.), La population du monde. Géants démographiques et défi s internationaux, 2e éd., Paris, INED, 2002, p. 455-475.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 578105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 57 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
58 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
dès 1934 de « Révolution démographique » avec des accents similaires39. Historiquement située entre la fi n du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, la « transi-tion démographique » des pays européens pouvait en effet se défi nir comme un « ensemble de réponses données par les sociétés à la forte impulsion à la croissance caractérisant l’affaiblissement du système de constrictions typique de l’Ancien Régime »40. La théorie de la « transition démographique » postule l’existence de quatre phases dans le développement historique de toute population humaine : une phase de quasi-équilibre entre une mortalité forte et une fécondité forte, qui caractérise les sociétés anciennes ; une phase de recul de la mortalité et d’accélération de la croissance démographique ; une phase de baisse de la fécondité et de contraction de la croissance de la population ; un nouvel équilibre, parfois défi citaire, entre mortalité basse et fécondité basse. Ce modèle, on l’aura compris, représente pour les démo-graphes de l’époque un développement nécessaire de l’interaction historique entre les « forces de constriction » et « les forces de choix »41. En même temps, les hommes seraient passés d’une économie de subsistance où « l’homme dépend de la nature » à une économie de concurrence internationale où « la nature dépend de l’homme »42.
Nous pouvons donc en conclure que l’adoption d’un modèle démogra-phique par les historiens n’était pas surprenante à une époque où l’on esti-mait que « chaque bon historien aurait dû se faire démographe »43. Toutefois, dans la mesure où l’hypothèse de la transition démographique postulait des développements analogues pour toutes les populations humaines, le risque était grand d’introduire un déterminisme biologique au cœur des analyses historiques, c’est-à-dire une forme de détermination univoque des normes sociales par un ensemble de normes vitales.
Dans les modèles de « l’autorégulation des populations traditionnelles », qui ont eu un certain succès en France dans les années 1970, cette tentation vitaliste du déterminisme biologique est souvent présente, comme le montre le succès du modèle de régulation éthologique de Vero Copner Wynne-Edwards44. Observant des populations de rats, le zoologiste britannique avait en effet montré que l’organisation sociale résultant d’une densité excessive jouait un rôle central dans les variations de fécondité. Cette démonstration était selon lui capitale, car elle prouvait que, dans le processus de régulation
39. Adolphe LANDRY, La révolution démographique. Études et essais sur les problèmes de la population [1934], Paris, INED, 1982.
40. Massimo LIVI-BACCI, La popolazione nella storia d’Europa, Rome-Bari, Laterza, 1998, p. 193.41. M. LIVI-BACCI, Storia minima della popolazione del mondo, Bologne, Il Mulino, 1998, chap. 2.42. André ETCHELECOU, « Espace, développement, régulation démographique : du local au pla-
nétaire », in Les modes de régulation de la reproduction humaine, Paris, PUF, 1994, p. 135-145.43. P. GOUBERT, « L’histoire démographique, facteur d’explication du présent », Cahiers de Clio,
Bruxelles, 1981, p. 32-37.44. Vero C. WYNNE-EDWARDS, Animal Dispersion in Relation to Social Behavior, Édimbourg,
Oliver & Boyd, 1962.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 588105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 58 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 59
des populations animales, la mortalité par manque de subsistances n’est pas le facteur décisif, l’autorégulation du système passant alors par une varia-tion de la procréation : « La fécondité serait donc en proportion inverse des subsistances, et de l’espace disponible, à un certain degré de saturation par le nombre d’adultes »45.
Ces conclusions suffi saient à Edward Wrigley en 1965, puis à Jacques Dupâquier et à Emmanuel Le Roy Ladurie dans les années 1970, pour appliquer les observations de Wynne-Edwards aux populations humaines46. Il s’agissait en effet d’expliquer le surprenant équilibre caractérisant les populations de l’Ancien Régime : les crises récurrentes de mortalité, qui frappaient toute la population, étaient suivies par des mouvements de récupération qui rame-naient la population à son niveau initial47. Le rouage central de ce mécanisme autorégulateur était le mariage. Perçu comme un « permis de reproduction » accordé par la société, le mariage rendait possible la formation d’un ménage. Cette double fonction – reproductrice et économique – faisait alors du mariage une variable corrélée aux crises démo-économiques : les périodes de croissance démographique s’accompagnaient d’un retard de l’âge du mariage et d’une réduction du marché matrimonial, avec pour corollaire une diminution de la fécondité. Au contraire, après les grandes crises de mortalité ou durant les périodes de décroissance démographique, les époux étaient plus jeunes et en plus grand nombre, ce qui permettait d’amorcer un processus de récupération démographique48. Au cours des périodes dites « normales », se formait alors une armée de réserve de vieux garçons célibataires et de « fi lles anciennes », permettant à la société de faire face en cas de crise éventuelle.
Il est évident que le mécanisme d’autorégulation des populations anciennes reste, comme toujours en démographie, dépendant des mécanismes sociaux. Mais ces mécanismes – c’est là la nouveauté de l’approche de la démographie historique – étaient rapportés à une adaptation homéostatique de l’espèce humaine au milieu qui se faisait sur la base d’une sélection naturelle. Le Roy Ladurie a parlé, à ce propos, d’une sorte de « pouvoir inconscient » de l’humanité sur elle-même dans les populations d’Ancien Régime, conduisant
45. E. LE ROY LADURIE, « Homme-animal, nature-culture. Les problèmes de l’équilibre démo-graphique », in Edgar MORIN, Massimo PIATTELLI-PALMARINI (éd.), L’unité de l’homme. Invariants biologiques et universaux culturels, Paris, Seuil, 1974, p. 553-594.
46. Edward A. WRIGLEY, Sociétés et population [1965], Paris, Hachette, 1969. Pour Dupâquier et Le Roy Ladurie, voir les notes suivantes.
47. Pour reprendre les termes de Dupâquier : « Comme les contemporains n’avaient guère conscience des phénomènes démographiques, et qu’ils ne pratiquaient pas le contrôle des naissances, nous voilà portés à soupçonner l’existence d’un mécanisme autorégulateur, d’un système complexe de relations entre économie, démographie et société, qui aurait pu jouer, dans l’ancienne civilisation européenne, un rôle analogue à ceux qu’observent aujourd’hui les spécialistes de l’écologie chez la plupart des populations animales » (J. DUPÂQUIER, « De l’animal à l’homme : le mécanisme autorégulateur des populations traditionnelles », Revue de l’Institut de Sociologie, 1972-2, p. 177-211).
48. J. DUPÂQUIER, « L’autorégulation de la population française (XVIe-XVIIIe siècle) », in ID. (éd), Histoire de la population française, vol. 2 : De la Renaissance à 1789, PUF, Paris, 1988, p. 413-436.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 598105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 59 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
60 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
à une « politique inconsciente » de baisse des conceptions49. Pour le dire avec Canguilhem, l’organisation sociale était ramenée à l’organisme50.
L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Mais encore faut-il préciser que cette approche biologisante, dominante au sein de la Société de Démographie Historique, ne l’était pas pour autant au sein de l’histoire quantitative. Dans les trois premiers chapitres du deuxième volume de l’Histoire économique et sociale de la France, Goubert abordait déjà l’histoire de l’ancien régime démographique et de ses transformations au XVIIIe siècle51. En bon élève de Labrousse, Goubert s’intéressait prioritairement aux trans-formations du climat et de l’environnement, mais il introduisait également le rôle structurant de l’économie pour expliquer la transition démographique qui avait eu lieu en France à partir du milieu du siècle. Le lent déclin du « petit âge glaciaire »52 ainsi que la disparition des deux grands fl éaux de la peste et de la guerre auraient permis d’un côté de réaliser de meilleures récoltes céréalières et, de l’autre, d’enclencher une légère baisse du taux de mortalité. Cette tendance lourde serait à l’origine d’un cercle vertueux entre expansion économique et expansion démographique qui aurait conduit, vers le milieu du XVIIIe siècle, au décollage de la population. Les techniques de contrôle des naissances qui commencent à se répandre en France dans la seconde moitié du siècle seraient ainsi une conséquence logique de la diminution de la mortalité infantile, qui exhorte les parents à limiter le nombre de naissances pour ne pas engendrer de familles trop nombreuses.
Il est également intéressant de noter que le modèle explicatif de l’histoire « marxiste » était alors repris à la lettre : les transformations de la « structure » (matérielle, organisationnelle, scientifi que, économique) précèdent et déterminent les modifi cations de la « superstructure » (mentalité, idéologie, conception du monde, mœurs). Certes, les historiens douteront par la suite de l’existence d’une véritable révolution agricole ainsi que d’un réel impact du progrès médical sur
49. E. LE ROY LADURIE, « Homme-animal… », art. cit., p. 582-583. H. Le Bras a critiqué ce modèle postulant selon lui une homogénéité sociale qui gommerait toute stratégie de domination et d’ascension, et conduirait à l’adoption d’un comportement individuel irréel. Plus généralement, Le Bras conteste le concept même de système appliqué à des sociétés humaines : « La critique la plus grave que l’on peut faire à toutes ces constructions est de séparer l’homme de son destin en posant ce dernier comme naturel et inatteignable par l’action ou la volonté » (Hervé LE BRAS, « Histoire et systèmes démographiques », Annales de démographie historique, 1996, p. 359-372).
50. Georges CANGUILHEM, « Le problème des régulations dans l’organisme et la société », Cahiers de l’Alliance israélite universelle, 92, sept-oct. 1955, repris in ID., Écrits sur la médecine, Paris, Seuil, 2001.
51. F. BRAUDEL, Ernest LABROUSSE (éd.), Histoire économique et sociale de la France, Paris, PUF, 1970, vol. 2, p. 9-82.
52. Sur le « petit âge glaciaire » et plus généralement l’histoire des changements climatiques : E. LE ROY LADURIE, Histoire humaine et comparée du climat, t. 1 : canicules et glaciers (XIIIe-XVIIIe siècle), Paris, Fayard, 2004.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 608105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 60 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 61
l’allongement de l’espérance de vie au XVIIIe siècle53. Mais il est clair que, dans le modèle historien qui s’affi rme dans la première moitié des années 1970, les conditions de la transition démographique semblent ou naturelles (amélio-ration du climat) ou administratives (l’hygiène publique, le cloisonnement, la prévention et la répression contre la contagion, ayant joué un rôle dans le recul de la peste)54.
Dans le chapitre fi nal de La volonté de savoir, Foucault reprend à son compte presque mot à mot (sans le citer) l’explication de Goubert en en faisant, semble-t-il, la matrice historique de son hypothèse biopolitique :
« […] par un processus circulaire, le développement économique et principalement agricole du XVIIIe siècle, l’augmentation de la productivité et des ressources encore plus rapide que la croissance démographique qu’elle favorisait, ont permis que se desserrent un peu ces menaces profondes : l’ère des grands ravages de la faim et de la peste – sauf quelques résurgences – est close avant la Révolution française ; la mort commence à ne plus harceler directement la vie. Mais en même temps le développement des connaissances concernant la vie en général, l’amélioration des techniques agricoles, les observations et les mesures visant la vie et la survie des hommes, contribuaient à ce desserrement : une relative maîtrise sur la vie écartait quelques-unes des imminences de la mort. Dans l’espace de jeu ainsi acquis, l’organisant et l’élargissant, des procédés de pouvoir et de savoir prennent en compte les processus de la vie et entreprennent de les contrôler et de les modifi er »55.
Que l’on retrouve le modèle de la transition démographique au cœur de l’hypothèse biopolitique pourrait sembler étonnant, pourtant Foucault n’hésite pas à revenir quelques années plus tard sur ces « processus circulaires », « que les historiens connaissent bien et que par conséquent j’ignore », lesquels déjouent la pression biologique de la mort et ouvrent un nouvel « espace de jeu » où des procédures de savoir-pouvoir pourront contrôler les processus vitaux56. De même, la description de la naissance du « dispositif de sexualité » s’opposant terme à terme à l’ancien « dispositif d’alliance » – fondé sur le mariage, le déve-loppement des parentés, la « reproduction » – n’est pas compréhensible si on l’accepte sans bénéfi ce d’inventaire comme une « vérité » historique découverte par Foucault. La « sexualisation du corps social », liée à la fois à une intensifi ca-tion des corps et à un nouvel agencement de pouvoir qui ne serait plus ordonné à la reproduction, se fonde en effet sur l’investissement de la « famille » par des politiques gouvernementales et la disparition du mariage comme « rouage » des systèmes démographiques autorégulés anciens57.
C’est pourquoi cet héritage historien que l’on retrouve au cœur de l’œuvre de Foucault nous semble essentiel pour comprendre la mise en place et la
53. Michel MORINEAU, Les faux-semblants d’un démarrage économique : agriculture et démographie en France au XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1971 ; Jean-Noël BIRABEN : « Le médecin et l’enfant au XVIIIe siècle (aperçu sur la pédiatrie au XVIIIe siècle) », Annales de démographie historique, 1973, p. 215-223.
54. M. LIVI-BACCI, La popolazione…, op. cit., p. 107 sq.55. M. FOUCAULT, La volonté de savoir, op. cit., p. 187.56. M. FOUCAULT, Sécurité, territoire, population…, op. cit., p. 107.57. M. FOUCAULT, La volonté de savoir, op. cit., p. 140-141 ; Jacques DONZELOT, La police des
familles, Paris, Minuit, 1977.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 618105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 61 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
62 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
signifi cation de la notion de biopouvoir. La construction de cette dernière ne s’appuie ni sur une intuition, ni sur une argumentation philosophique, mais sur des sources historiennes bien précises. Toutefois, on se tromperait gran-dement en interprétant la thèse sur le biopouvoir comme une simple synthèse des interprétations en vogue à l’époque, ou pire, comme une sorte d’histoire de seconde main. La généalogie du biopouvoir n’apportait aucune pierre à l’édifi ce conceptuel de l’auto-régulation biologico-sociale, ni à celui de l’histoire économique et sociale. Comme nous l’avons vu, l’historicisation généalogique des concepts vise avant tout à créer un effet de distanciation par rapport à une actualité qu’il faut connaître pour y introduire une différence58. La valeur ajoutée de la généalogie du biopouvoir serait davantage à chercher dans la mise en perspective des thèses historiennes au regard des enjeux politiques. Comment en effet ces enjeux sous-tendaient-ils les recherches historiennes de l’époque ? Et quelle était alors la « différence » introduite par la notion de biopouvoir ? Il nous apparaît également essentiel de traiter ces interrogations en abordant désormais la question du contexte politique.
LE CONTEXTE POLITIQUE
Rappelons, pour commencer, qu’au moment où Foucault décrit la grande stra-tégie biopolitique axée sur les corps individuels et la population, le « problème démographique » se trouve au centre de l’actualité politique. En 1968, Paul Ehrlich publie The Population Bomb, best-seller qui met en évidence le risque d’une explosion démographique à un niveau mondial et décrit la surpopulation comme une cause possible de déséquilibres écologiques et de confl its pour l’accès aux ressources naturelles59. La même année, l’économiste Garrett Hardin soutenait qu’un problème grave comme celui de la surpopulation n’avait aucune solution technique sur le long terme et ne pouvait être laissé à l’appréciation de chacun. Hardin plaidait alors pour une révision radicale de l’idée de liberté personnelle en matière de procréation et pour la reconnais-sance de la nécessité de limiter les naissances60. De son côté, Goran Ohlin soutient dans un rapport de l’OCDE que la croissance démographique doit se régler sur les impératifs de la croissance économique : ce sont les débuts du discours sur le développement durable61. Ces débats ne sont pas sans effets sur la scène politique : en 1969, c’est le président des États-Unis lui-même,
58. Voir la lecture de François EWALD, « Foucault et l’actualité », in Au risque de Foucault, op. cit., p. 203-212, qui s’inspire de Gilles DELEUZE, Différence et répétition, Paris, Minuit, 1968.
59. Paul EHRLICH, La bombe P [1968], Paris, Fayard, 1968.60. Garrett HARDIN, « The tragedy of the commons », Science, 162, 1968, p. 1243-1248. Cf. Fabien
LOCHER, « Les pâturages de la guerre froide. Garrett Hardin et la “Tragédie des communs” », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 60-1, janvier-mars 2013, p. 7-36.
61. Goran OHLIN, Régulation démographique et développement économique [1967], Paris, Centre de développement de l’OCDE, 1967.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 628105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 62 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 63
Richard Nixon, qui exprime son inquiétude face au baby boom américain, en se prononçant notamment pour une meilleure qualité de vie et un arrêt de la croissance démographique62.
C’est dans ce contexte que le Club de Rome, en 1972, commande au MIT une célèbre expertise sur les limites de la croissance mondiale dont les résultats seront considérés comme l’apothéose de la pensée néo-malthusienne contemporaine : l’accroissement exponentiel de la population, surtout dans les pays en voie de développement, n’est pas viable sur le long terme. Il faut donc établir au plus tôt un « état d’équilibre global qui se caractérise par une population et un capital essentiellement stables »63. La Conférence interna-tionale de la Population qui a lieu en 1974 à Bucarest devait, dans l’intention des organisateurs, conduire à un accord mondial à propos des politiques de population. Son échec, suite à l’opposition du Vatican et des pays d’Amérique latine, montre l’émergence d’un front hétérogène de contestation des politiques de population, allant de mouvements religieux pour la vie aux marxistes tiers-mondistes64. Le problème de la surpopulation mondiale et de l’instrumenta-lisation de l’argument démographique pour imposer le birth control aux pays en voie de développement devient alors un sujet débattu dans les journaux et les émissions télévisées65.
La réfl exion sur la transition démographique et le développement de la contraception dans les populations d’Ancien Régime était évidemment liée à ces enjeux politiques de la « Family Planning Industry »66. À ce sujet, Dennis Hodgson a montré qu’à partir des années 1950 la science démographique aux États-Unis devient de moins en moins descriptive et de plus en plus prescrip-tive. Ainsi, le processus de la transition démographique, présenté comme un phénomène invariant destiné à se reproduire dans toutes les aires géographiques
62. « Depuis 1945 seulement, quelque 90 millions de bébés sont nés dans notre pays […]. Comment éduquerons-nous, comment emploierons-nous un aussi grand nombre de gens ? L’un des plus grands défi s, lancés à l’humanité et à son destin durant le dernier tiers de notre siècle, sera celui de l’expansion démographique ». Cité in J.-C. CHESNAIS, « Prévision et projection », Le débat, 8, janvier 1981, p. 102. Quelques années plus tard, en 1974, la U.S. Central Intelligence Agency fournira au président Nixon un rapport, demeuré secret, qui lie la croissance démographique, et donc un pourcentage important des jeunes générations, au risque d’émeutes, d’insurrection, de terrorisme (Malcolm POTTS, Martha M. CAMPBELL, « Population », in Maryanne C. HOROWITZ (ed.), New Dictionary of the History of Ideas, vol. 5, Detroit, Thomson Gale, 2005, p. 1846-1849). Ces propos aboutiront, entre autres, à une cam-pagne de stérilisation massive de la population américaine qui touchera près de 10 millions de couples dans les années 1970.
63. Donella H. MEADOWS et alii, Halte à la croissance ? Enquête du Club de Rome [1972], Paris, Fayard, 1972.
64. Voir par exemple Samir AMIN, « L’Afrique sous-peuplée », Développement et civilisations, 47-48, mars-juin 1972, p. 39-67.
65. Une enquête montrant l’émergence de l’angoisse de la surpopulation dans la presse américaine entre 1946-1990 : John R. WILMOTH, Patrick BALL, « The population debate in American popular magazines, 1946-1990 », Population and Development Review, 18-4, 1992, p. 631-668. Pour une his-toire du « problème démographique » sur le XXe siècle à l’échelle mondiale : Matthew CONNELLY, Fatal Misconception : The Struggle to Control World Population, Boston, Harvard University Press, 2008.
66. Paul DEMENY, « Social science and population policy », Population and Development Review, 14-3, septembre 1988, p. 451-479.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 638105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 63 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
64 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
du monde, devient un instrument puissant pour prévoir, infl uencer et gérer les mouvements démographiques des pays en voie de développement qui étaient censés suivre le modèle européen67. Quelques années plus tard, l’immense pro-gramme de la démographie historique lancé par le démographe français Louis Henry, concernant l’étude de la natalité des populations d’Ancien Régime, avait pour but d’établir une série de concepts (fécondité naturelle, stérilité, mortalité infantile) directement liés aux politiques de population contemporaines et aux enjeux budgétaires allant de pair avec elles. Au nom de la même équivalence espace-temps, les données de l’enquête de Henry pouvaient en effet être prises en compte par la biologie exactement comme les études concernant les popu-lations non-contraceptives contemporaines. Ses recherches fournissaient en même temps des clés explicatives du phénomène du baby boom qui remettait en question les dispositifs ambitieux de protection sociale européens68. En ce sens, la démographie historique était censée représenter une sorte d’observa-toire historique sur le présent69.
Pour comprendre la place stratégique que prend le projet de la démo-graphie historique à ce moment, il faut mentionner la série de décisions poli-tiques s’échelonnant entre 1967 et 1975, et qui semblent pouvoir bouleverser l’avenir démographique de la France : légalisation de la contraception orale (Loi Neuwirth, 1967), légalisation du recours à l’interruption volontaire de grossesse (Loi Veil, 1975), instauration du divorce par consentement mutuel (1975) et restrictions à la politique d’immigration (1974). Cette même année, l’indice de fécondité en France passe sous la barre mythique des 2,1 enfants par femme, ce qui correspond au seuil incompressible permettant d’assurer la régénération de la population. C’est encore en 1974 que Valéry Giscard d’Estaing commande à l’INED une étude prévisionnelle de la population française jusqu’à 2075. La fi n prévue du baby boom n’avait pas tardé à réveiller les préoccupations natalistes d’un pays traditionnellement obsédé par le déclin démographique et qui avait pourtant connu, au cours des années 1960, un regain des idées néo-malthusiennes70.
67. Dennis HODGSON, « Demography as social science and policy science », Population and Deve-lopment Review, vol. 9-1, mars 1983, p. 1-34.
68. Paul-André ROSENTAL, « La nouveauté d’un genre ancien : Louis Henry et la fondation de la démographie historique », Population, 58-1, 2003, p. 103-135 ; ID., « Treize ans de réfl exion : de l’histoire des populations à la démographie historique française (1945-1958) », Population, 51-6, 1996, p. 1211-1238.
69. P.-A. ROSENTAL, L’intelligence démographique. Science et politiques de population en France, 1930-1960, Paris, Odile Jacob, 2003, chap. 11.
70. Gaston BOUTHOUL avait publié dès 1958 son ouvrage La surpopulation dans le monde (Paris, Payot, 1958) dénonçant « l’infl ation démographique » moderne. Dans la modernité, l’humanité serait désormais « une espèce animale nouvelle » caractérisée par une « accélération de son potentiel d’expansion numérique ». Cette mutation biologique et anthropologique aurait des conséquences graves, notamment la promotion des politiques biologiques racistes et nationalistes par des gouvernements autoritaires. Le naturaliste Jean DORST décrivait en 1962 le problème de la surpopulation comme « le plus angoissant de ceux auxquels nous avons à faire face dans les temps modernes » (Avant que nature meure, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1962) alors que l’année suivante, Alfred FABRE-LUCE reprenait la thèse et l’exis-tence d’un lien intrinsèque entre la surpopulation et la régression de l’humanité jusqu’à l’identifi cation
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 648105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 64 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 65
Deux intellectuels prennent alors le devant de la scène au cours de l’offen-sive contre les moyens de contraception oraux, accusés d’être à l’origine du dépeuplement et du vieillissement de la population française : le démographe Alfred Sauvy, directeur de l’INED, et l’historien Pierre Chaunu, qui défend de son côté une « analyse historique du présent », destinée à « déceler les facteurs hétérogènes à toute expérience antérieure »71. Ce dernier, dans son pamphlet de 1976, La peste blanche, reprend à son compte l’idée d’un lien nécessaire entre « dépopulation et décadence », qui fut notamment avancée par Landry en 1934 pour soutenir qu’une sorte de « maladie morale » frappait la société occidentale72. La crise générale de l’identité française, qui se traduirait par le déclin de la courbe démographique et se manifesterait sous les traits d’un affaiblissement physiologique de la société, serait alors liée à l’apparition d’un individualisme « sans contrepoids », à la diffusion de nouvelles licéités en matière de comportements sexuels et à la nécessité de rentabiliser les puis-sants moyens contraceptifs mis en place à l’échelle mondiale dès 1951 par le Population Council 73.
Rappelons que la diffusion en France et dans les autres pays européens de la méthode du coïtus interruptus au cours du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle avait déjà provoqué une baisse consistante de la natalité. Toutefois, cette technique demeure pour Chaunu un moyen « naturel » de contraception car son application conserve un décalage entre le nombre d’enfants désirés et le nombre d’enfants effectivement nés, ou encore entre la volonté de procréer et une « nature » intouchable de la procréation74. Ainsi, « on peut dire que, en gros, les générations obtiennent la descendance qu’elles désirent. Les femmes et les hommes obtiennent le nombre d’enfants qu’ils veulent, à condition de ne pas les avoir quand ils veulent »75. Autrement dit, pour l’historien, même une naissance non programmée est « inconsciemment acceptée », et ce sont ces mécanismes inconscients de masse qui rétablissent l’équilibre nécessaire à une croissance régulière de la population. En revanche, les nouveaux moyens de contraception – notamment la pilule de « Pincus » – auraient brisé la phase de la « contraception naturelle » en faisant « de la stérilité l’état normal, l’état de
de plus en plus poussée de l’homme avec l’animal (Six milliards d’insectes, Paris, Arthaud, 1962). Pour une reconstruction du débat français autour de la surpopulation mondiale dans les années 1950 et 1960, et notamment de la position de Lévi-Strauss : Wiktor STOCZKOWSKI, Anthropologies rédemptrices, Paris, Hermann, 2008, chap. 10-11 ; H. LE BRAS, Les limites de la planète, Paris, Flammarion, 1994.
71. Pierre CHAUNU, « Analyse historique du présent. La dénatalité », L’Histoire, 3, juillet-août 1978, p. 62-66, republié in ID., Pour l’histoire, Paris, Perrin, 1984, p. 257-266. Voir aussi : ID., De l’histoire à la prospective, Paris, Robert Laffont, 1975.
72. A. LANDRY, La révolution démographique…, op. cit., p. 107-165.73. P. CHAUNU, La peste blanche. Comment éviter le suicide de l’Occident, Paris, Gallimard, 1976.74. Sur ce sujet, voir aussi les observations d’Alfred Sauvy dès 1957 sur l’espacement des naissances
et le retardement de la naissance du premier enfant provoqués par l’usage de la pilule contraceptive (« Observations et conséquences possibles » in Jean SUTTER, « À la recherche de la pilule stérilisante », Population, 12-3, 1957, p. 495-504).
75. P. CHAUNU, « Analyse… », art. cit., p. 262.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 658105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 65 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
66 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
surnature du civilisé ». Désormais, pour faire un enfant, il ne suffi rait plus de le « désirer inconsciemment », mais il faudrait manifester une volonté claire de rupture avec une normalité complètement artifi cielle. L’imposition idéologique de cette contraception non-naturelle, dissociant défi nitivement fécondité et plaisir, serait, de l’avis de l’historien, la première cause du non-renouvellement intergénérationnel dans les pays développés76.
LES ORIGINES DE LA CONTRACEPTION, UN DÉBAT ENTRE HISTORIENS
Les prises de position que l’on retrouve dans les travaux de Chaunu permettent de saisir précisément le rapport entre le récit historique, les débats contem-porains sur la surpopulation et la dénatalité, et les politiques de population. Car Chaunu pense que l’incapacité des experts à prévoir le déclin des taux de fécondité des populations occidentales et l’implosion démographique du monde industriel découle de leur ignorance de l’histoire77. Ce n’est donc pas un hasard si ces enjeux politiques du présent se refl ètent dans le prisme du débat entre historiens sur les origines de la contraception et le début de la transition démographique française au milieu du XVIIIe siècle.
Selon Chaunu, l’ouverture d’une parenthèse rigoriste à partir des années 1680 (marquées par le jansénisme et un retour à l’augustinisme) aurait fait du mariage le lieu du danger de concupiscence : la femme luxurieuse est une fois de plus diabolisée, la virginité exaltée et la chair devient l’objet d’une suspicion voire d’une haine explicite. Durant cette période, les confesseurs et les clercs redoublent la condamnation des pratiques anticonceptionnelles au sein du mariage qui étaient perçues comme le pire des affronts lancés à Dieu. Cette « parenthèse rigoriste » aurait alors engendré une très forte austérité sexuelle, la raréfaction des rapports entre époux et une sublimation des sens et de l’ascèse sexuelle jusque dans les campagnes : « la modalité des réformes religieuses en France est plus radicale, plus acculturatrice, plus appliquée au contrôle social total de la sexualité »78. Cette association étroite entre chair et péché, mettant l’accent sur l’impureté fondamentale du rapport sexuel et sur la nécessité de l’abstention, aurait favorisé un contrôle plus strict du corps et, en même temps, renforcé le sentiment d’une culpabilisation de la grossesse qui serait désor-mais jugée comme un symptôme d’impureté. Ces deux conditions auraient, selon Chaunu, encouragé une pratique de l’acte incomplet qui, d’une part,
76. P. CHAUNU, Huguette CHAUNU, Jacques RENARD, Essai de prospective démographique, Paris, Fayard, 2003.
77. Ainsi Chaunu aura plus tard relié ce sentiment de « décadence démographique et morale » au programme scientifi que de la démographie historique : « […] sans la grande hantise d’un monde vieux, exsangue […], sans le désir de comprendre la leçon du passé pour tenter d’arracher un destin autre que la décrépitude et la mort […], le miracle épistémologique de la démographie historique ne serait pas sorti de rien » (« Préface », in J. DUPÂQUIER, Pour la démographie historique, Paris, PUF, 1984).
78. P. CHAUNU, « Postface », in J. DUPÂQUIER (éd.), Histoire de la population française, vol. 2 : De la Renaissance à 1789, Paris, PUF, 1988, p. 553-536.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 668105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 66 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 67
se fonde sur la maîtrise accrue de son propre corps et, d’autre part, permet de dissimuler le péché charnel en évitant la grossesse. Le coitus interruptus, adopté dans le couple conjugal, permettait en somme de se soustraire au contrôle social de la sexualité par l’Église : « L’ascétisme, en permettant une meilleure maîtrise de l’instinct sexuel, se transforme en technique d’épargne et de plaisir contrôlé »79. La baisse de fécondité serait alors un effet secondaire et paradoxal de la diffusion de la prédication janséniste : « Placez sur la carte des zones de jansénisme diffus, de déchristianisation précoce et persistante et de chute rapide, continue et profonde de la fécondité, et vous verrez qu’elles se superposent parfaitement »80.
La perspective adoptée par Flandrin, dans le premier tome d’une histoire de la sexualité qui évolue parallèlement à celle de Foucault, s’opposait point par point à la thèse de Chaunu81. En s’appuyant sur les résultats récents de l’enquête conduite par Henry, Flandrin cherchait à reconstruire la vie sexuelle des couples dans l’Ancien Régime pour aborder une question à laquelle la démographie historique n’avait pas de réponse : pourquoi dans l’ancien régime démographique, où les femmes se mariaient en moyenne assez tardivement et dans lequel les techniques contraceptives étaient peu répandues, y avait-il aussi peu de naissances illégitimes ? Et pourquoi à partir des années 1740-1750 constatons-nous une augmentation de ce type de naissances ? Selon Flandrin, il était erroné de s’appuyer sur les taux de naissance illégitime pour élaborer une thèse générale sur les comportements sexuels. Il était selon lui plus judi-cieux de souligner l’existence d’une différence entre l’amour dans le mariage, absorbé dans le coït, et l’amour hors mariage, caractérisé par une sexualité sans coït entre puberté et mariage et toute une série de pratiques telles que la masturbation réciproque, l’échange de caresses ou la sodomie. Stigmatisée à la fois par l’Église (surtout après le concile de Trente) et par les philosophes populationnistes, cette sexualité ancienne non-coïtale montrait l’existence, déjà dans l’ancien régime démographique, d’une série de conduites sexuelles qui préparent la diffusion du contrôle des naissances dans le couple conjugal. Ces conduites étaient par ailleurs bien plus fréquentes dans les campagnes que dans les strates supérieures de la société. La révolution contraceptive résulterait alors du transfert du comportement sexuel extraconjugal dans les rapports conjugaux82.
Contrairement au point de vue de Chaunu, l’adoption de la fruste tech-nique du coïtus interruptus dans le cadre du mariage témoigne, selon Flandrin,
79. A. BURGUIÈRE, « La démographie », in J. LE GOFF, Pierre NORA (éd.), Faire de l’histoire, vol. 2 : Nouvelles approches, Paris, Gallimard, 1974, p. 74-104, ici p. 94.
80. P. CHAUNU, « Postface », in J. DUPÂQUIER (éd.), Histoire de la population française, op. cit., p. 536 ; ID., « Malthusianisme démographique et malthusianisme économique. Réfl exions sur l’échec de la démographie normande », Annales ESC, 27-1, 1972, p. 1-19.
81. Jean-Louis FLANDRIN, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Hachette, 1976. Ce livre est une des rares sources secondaires citées par Foucault dans La volonté de savoir, p. 34.
82. J.-L. FLANDRIN, Les amours paysannes (XVIe-XIXe siècle), Paris, Gallimard-Julliard, 1976, p. 120 sq.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 678105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 67 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
68 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
de l’affi rmation d’un système de valeurs moins marqué par l’hédonisme et l’individualisme. Cette morale aurait pu développer chez les parents le sens des responsabilités qu’ils endossaient en procréant. En effet, mettre au monde moins d’enfants pour leur prodiguer davantage de soins signifi ait les soustraire au cercle infernal de la surnatalité et de la surmortalité enfantine83. Il n’en demeure pas moins que cette transformation ne fut pas vécue sur le mode de la rupture car elle s’inscrit davantage dans la continuité de la nouvelle morale de l’Église, qui insiste à la fois sur le danger des grossesses trop fréquentes, la nécessité de l’allaitement maternel et les devoirs des parents envers leurs enfants, notamment le devoir de préserver les nourrissons et d’assurer leur établissement84. Mais à la différence de Chaunu, Flandrin doute que toute conduite morale dans les relations sexuelles puisse être rapportée à la doctrine de l’Église. L’accusation de « crime contre nature » soulevée par les théologiens n’est pas uniformément interprétée par tous les groupes sociaux : « Il est clair, en effet, que beaucoup de chrétiens, informés de cette doctrine, non seulement ne la suivent pas, mais ne l’acceptent pas. C’est-à-dire qu’ils se conforment sur ce point à un idéal moral qui n’est pas celui de l’Église de leur temps »85.
En somme, nous sommes ici en présence de deux lectures antagoniques qui, tout en partant des mêmes présupposés – la réappropriation par les fi dèles du discours de l’Église pour le retourner contre ses propres fi ns – aboutissaient à des thèses assez opposées86. Pour Chaunu c’est l’intériorisation inconsciente de l’interdit qui a favorisé l’essor « paradoxal » de la contraception, tandis que pour Flandrin c’est l’affi rmation d’une nouvelle morale familiale, fondée sur le respect réciproque des conjoints et la protection de l’enfant, qui amène les croyants à une sorte d’insurrection contre les interdits de l’Église en matière de procréation. Débat dans lequel nous pouvons percevoir en fi ligrane, et sans grand effort, les enjeux politiques de l’époque : pour Chaunu, l’idée que le coï-tus interruptus ait été pratiqué par souci de protéger l’enfant est jugée comme une thèse inacceptable et « aventureuse », précisément dans la mesure où elle
83. J.-L. FLANDRIN, Familles…, op. cit., p. 220 : « Ce que les couples malthusiens ont reproché aux lois de la nature, ce n’est pas de restreindre leur plaisir – comme le soutenaient Moheau et les moralistes chrétiens – c’est d’établir l’équilibre par la mort des enfants en surnombre ». Sur ce point : M. FOUCAULT, « Le jeu de Michel Foucault », in ID., Dits et écrits…, op. cit., vol. 3, p. 328 : « Flandrin fait apparaître ceci, qui me semble très intéressant, à propos du jeu entre l’allaitement et la contraception, que la vraie question, c’était la survie des enfants, et non pas leur création. Autrement dit, on pratiquait la contraception, non pas pour que les enfants ne naissent pas, mais pour que les enfants puissent vivre une fois nés. La contraception induite par une politique nataliste, alors ça, c’est assez marrant ».
84. Sur le risque de mort en couches au XVIIIe siècle : Mireille LAGET, Naissances. L’accouchement avant l’âge de la clinique, Paris, Seuil, 1982, p. 229-280.
85. Plus profondément, c’est l’idée même d’un interdit absolu de contraception par la doctrine de l’Église que Flandrin remet en cause. Le célèbre passage où saint Thomas condamne le gaspillage de semence en tant que « contraire au bien de nature qui est la conservation de l’espèce », serait plutôt dirigé contre tout accouplement extraconjugal à la recherche du plaisir pour lui-même : J.-L. FLAN-DRIN, « Contraception, mariages et relations amoureuses dans l’Occident chrétien », Annales ESC, 24-6, 1969, p. 1370-1390.
86. Sur cet affaiblissement de la norme morale catholique en matière de vie et de mort : R. CHAR-TIER, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990, p. 140-146.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 688105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 68 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 69
laisse planer le soupçon d’une légitimation morale de la contraception et donc aussi de la pilule87. Chez Flandrin, en revanche, la découverte d’une sexualité populaire et préconjugale absque coïtu qui, dans les anciennes sociétés, semblait déjà se moquer des diktats religieux, faisait davantage écho aux mouvements de libération sexuelle de l’après 1968. À travers cette opposition frontale, on voit particulièrement bien comment le souci présentiste traversait le débat sur les mœurs populaires au XVIIIe siècle.
LA PLACE DE PHILIPPE ARIÈS, OU LE PAS DE CÔTÉ DE LA GÉNÉALOGIE
Comme nous l’avons dit plus haut, il faut distinguer le présentisme des historiens du présentisme généalogique. Ce dernier ne consiste pas à choisir entre des perspectives différentes sur des faits avérés (par exemple, entre le modèle de l’autorégulation biologico-sociale et celui de l’évolution des « mentalités »), mais bien plutôt à révéler un certain nombre d’évidences qui seraient communes à des discours apparemment opposés. Ce souci présentiste propre à l’entreprise généalogique explique la référence foucaldienne à Philippe Ariès, un historien dont les idées pouvaient paraître dépassées dans le milieu des années 1970. Il n’est pas inutile de rappeler que, dès la fi n des années 1940, Philippe Ariès fut l’un des premiers à intégrer l’analyse démographique et sociologique dans une réfl exion sur les comportements collectifs au cours de l’histoire. Dans son Histoire des populations françaises, rédigée en 1948, Ariès avait en effet montré que la lutte contre la mort par le biais de la médecine et de l’hygiène fut menée parallèlement à celle contre la vie par le biais de la contraception88. Selon lui, toute une série d’outillages techniques (les habitudes de paucina-talité, les techniques d’hygiène et le recours aux médecins) auraient d’abord été adoptés par la bourgeoisie avant d’« envahir » les autres classes sociales, à commencer par l’aristocratie :
« Sous l’infl uence des apports bourgeois qui l’alimentent, la noblesse cesse peu à peu d’être un ordre du sang, un ordre de la nature, confondu avec les autres spécialisations organiques nécessaires à la marche du monde. Et c’est justement au moment où les caractères originaux de la noblesse s’adultèrent, que la bourgeoisie se dresse en face d’elle, non plus pour y entrer, mais pour la détruire. […] la bourgeoise prend conscience d’elle-même, de la spécifi cité de ses mœurs, de ses genres de vie. Elle oppose à l’ordre traditionnel du sang sa conception personnelle de l’existence, fondée sur le profi t, l’activité technique, calculatrice, déjà comptabilisée »89.
87. P. CHAUNU, « La famille en question, de J.-L. Flandrin », Le Figaro, 8 mai 1976, puis in ID., Pour l’histoire, Paris, Perrin, 1984, p. 234-235 : « La thèse de Jean-Louis Flandrin est seulement contredite par la totalité de l’histoire en sciences humaines. […] il ne retient dans la lecture des textes théologiques que ce qui va dans son sens. Il se laisse enfermer dans une dialectique courte entre le présent occidental et l’Ancien Régime. Sa lecture du passé est encombrée de préjugés, froide, souvent haineuse et polémique ».
88. Philippe ARIÈS, Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIIIe siècle, Paris, Éditions Self, 1948 (rééd. Seuil, 1971).
89. Ibidem, p. 411.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 698105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 69 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
70 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
La « révolution démographique » moderne, caractérisée par les habitudes de paucinatalité et le recul de la mortalité enfantine, marque ensuite l’extension de ces « techniques de soi » de la bourgeoisie aux classes populaires au cours du XIXe siècle : « le mouvement démographique moderne présente cette originalité qu’il a débordé les limites des classes où il est né pour mobiliser la totalité de la population occidentale »90.
Il ne s’agit donc plus d’évoquer l’imposition d’une médecine sociale aux masses, selon un point de vue qui assignerait toujours la priorité aux transforma-tions scientifi ques par rapport aux évolutions des « mentalités ». Ariès soutenait en effet que l’extension du calcul raisonnable, « économique », au corps et à la santé a été une « forme de conscience de soi-même » de la bourgeoisie dans son ascension vers le pouvoir. Le rejet ou l’adoption de ces nouvelles pratiques ne dérive donc pas de l’infl uence de la doctrine religieuse, d’une répression exercée par l’Église ou d’une libération qui en prendrait le contre-pied, mais s’enracine dans une transformation bien plus profonde, dont le changement des consignes pastorales n’est qu’un épiphénomène91. Le souci de lutter contre la souffrance et de retarder la mort témoigne de la possibilité d’agir dans un domaine sur lequel l’homme n’avait auparavant aucune prise. C’est dans ce nouveau rapport à la vie et à la mort, et non pas dans les courbes statistiques, qu’Ariès cherche les origines de la révolution démographique :
« La véritable révolution démographique est probablement antérieure à l’époque où elle apparaît dans le fl échissement de la courbe du taux de fécondité, c’est-à-dire après 1790 ; elle doit dater du moment où les procédures anti-conceptionnelles sont apparues comme un moyen d’éviter une fécondité physiologique à l’intérieur des rapports conjugaux, avant de devenir le moyen moderne de limiter la famille au nombre habituel de deux ou trois enfants »92.
Encore faut-il souligner que ces thèses vont se préciser au fur et mesure qu’Ariès développe ses recherches sur la naissance de l’enfance et la perception de la mort et poursuit son dialogue avec les autres historiens (notamment Flan-drin). Mais le noyau de son intuition reste le même : au lieu d’assimiler l’appareil étatique ou certaines consignes pastorales au moteur de la transformation, il interprète les progrès de la science médicale, de l’agriculture et de l’hygiène comme des réponses à un « besoin social » résultant d’une « révolution des mœurs et des comportements »93. En d’autres termes, Ariès ne reconnaît pas l’existence d’une différence absolue entre la « science » et des « mentalités » toujours en retard par rapport aux progrès issus de la première. La vie et la mort ne sont pas, chez
90. P. ARIÈS, « Attitudes devant la vie et devant la mort du XVIIe siècle au XIXe siècle », Population, 4-3, 1949, p. 463-470.
91. P. ARIÈS, Histoire des populations…, op. cit., p. 466-468 : « […] la pratique religieuse, si elle est parvenue à freiner l’application excessive des méthodes restrictives, a été impuissante à enrayer le grand mouvement démographique qui a réduit le format courant de la famille. […] Par conséquent, la grande évolution démographique du monde moderne a agi indifféremment quelles que soient les croyances, un peu amortie peut-être en chrétienté ».
92. Ibidem, p. 469.93. Ibidem, p. 344, 387.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 708105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 70 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 71
Ariès, des « objets » manipulables exclusivement « d’en haut », ils sont au cœur de choix quotidiens, de calculs minimes et en apparence insignifi ants, mais dans lesquels il y a autant de pensées que dans les grandes entreprises scientifi ques :
« […] la technique anticonceptionnelle et la science démographique ne furent-elles pas déterminées à la fois par un même sentiment : la société a pris conscience de la positivité des phénomènes de la vie et s’est aperçue qu’elle pouvait ensemble les étudier et les régler ? »94.
En ce concentrant sur ce qui rassemble rationalités scientifi ques et pratiques quotidiennes, Ariès peut donc échapper à la fois à la description de la pure « mise en ordre » du social et aux oppositions tranchées entre « nature » et « culture », « vitalisme » et « constructivisme », biologie et histoire.
On connaît les nombreuses critiques adressées à cet « historien du dimanche » que Foucault connaissait depuis la publication de l’Histoire de la folie, notamment l’absence de quantifi cation et un usage désinvolte de la notion de « mentalité »95. Mais les failles « scientifi ques » de la thèse défendue par Ariès pouvaient apparaître comme autant de points d’appui au généalogiste. Avec Ariès, nous nous situons en effet d’emblée sur un terrain familier pour Foucault : celui d’une transformation de la pensée qui habite des gestes, des comportements, des conduites et qui donne la priorité aux détournements subtils et aux résistances discrètes96. Parce qu’il a étudié les faits démographiques, non pas comme l’arrière-plan biologique de l’histoire sociale mais comme une « manière de se conduire vis-à-vis de soi-même, de sa descendance, de son avenir », Ariès fut alors perçu par Foucault davantage comme un « historien des pratiques corporelles » que comme un « historien des mentalités »97. La sous-évaluation systématique du rôle de l’État, qui est sympto-matique d’une analyse qui privilégiait les transformations sociales, permettait à Foucault de « passer par l’extérieur » de l’État en le considérant moins comme le premier agent du biopouvoir que comme l’effet d’une gouvernementalité indexée sur la vie98.
Il n’est donc pas étonnant que cet usage stratégique des thèses ariésiennes trouve toute sa place dans les pages de La volonté de savoir, où Foucault décrit la « sexualité bavarde » et proliférante qui a débordé l’ordre du sang et du lignage de la noblesse et « converti le sang bleu des nobles en un organisme bien portant et une sexualité saine »99. Là encore, c’est bien la famille bourgeoise qui a expérimenté la « nouvelle technologie du sexe » centrée sur l’ensemble perversion-hérédité-dégénérescence, et c’est à travers l’appareil administratif (via l’architecture, l’éducation, la médecine sociale, etc.) que cette technologie a ensuite colonisé les classes populaires100. Les « techniques de la vie et de la
94. Ibidem, p. 361.95. L. PALTRINIERI, « L’histoire… », art. cit.96. Voir en particulier M. FOUCAULT, Histoire de la sexualité, t. 2 : L’usage des plaisirs, Paris, Gal-
limard, 1984, p. 9-21.97. M. FOUCAULT, « Le souci de la vérité », in ID., Dits et écrits…, op. cit., vol. 4, p. 646-649.98. M. FOUCAULT, Sécurité, territoire, population…, op. cit., p. 112.99. M. FOUCAULT, La volonté de savoir…, op. cit., p. 152-168.100. Ibidem, p. 152-168.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 718105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 71 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
72 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
mort » comme moyens d’affi rmation de soi et forme de conscience primordiale de la classe bourgeoise, le « dispositif de sexualité » comme protection de sa « sexualité saine », la transmission d’une « culture » du corps aux autres classes sociales : autant d’éléments qui montrent comment Foucault s’est inspiré des conclusions émises par Ariès dans la formulation de sa thèse sur le biopouvoir. Or, cette référence lui permet d’ouvrir un autre point de vue sur les débats contemporains entre historiens. C’est ce dernier thème que nous souhaiterions désormais aborder.
LE BIOPOUVOIR COMME FICTION POLITIQUE
À défaut de proposer une analyse comparative exhaustive, il est intéressant de remarquer que 1976 est une année de publication stratégique pour notre pro-blématique puisque sont publiées successivement La peste blanche de Chaunu, Familles de Flandrin et La volonté de savoir de Foucault, dont Ariès fournit un précieux compte rendu dans la revue L’arc101. Autour de ces trois ouvrages se dessine une relation précise entre problématisation théorique, recherche historique et actualité politique. Les débats entre les historiens, nous l’avons vu, sous-tendent les enjeux politiques de l’actualité mais essayent également d’infl uencer la sphère de l’action politique. Et on aurait tort d’interpréter la thèse sur la « sexualisation du corps » par le discours, que Foucault défend dans La volonté de savoir, uniquement comme une polémique contre le freudo-marxisme : elle se nourrit de ces débats entre historiens et notamment du présupposé selon lequel la mise en discours du désir opérée par le rituel de la confession a produit des effets paradoxaux, débordant de loin le simple interdit.
Toutefois, pour le généalogiste, la reconstruction historique n’est pas seule-ment le terrain privilégié pour poser des questions provenant du présent : c’est aussi un moyen puissant pour en historiciser et dénaturaliser les évidences, pour mettre en place une grille d’interprétation du politique alternative et une autre politique de la sexualité. De ce point de vue, la généalogie du biopouvoir est un instrument de distanciation ironique qui permet de révéler non seulement les implicites et les présupposés de l’actualité, mais aussi le présentisme latent des historiens. Le programme inauguré et jamais achevé par La volonté de savoir était, de ce point de vue, au moins double : il ne s’agissait pas seulement d’écrire une autre histoire de la sexualité, mais aussi d’affranchir l’histoire existante de ce qu’elle pense silencieusement102.
Du point de vue foucaldien, les deux lectures symétriques et opposées de Chaunu et Flandrin révélaient alors un présupposé commun, à savoir une même conception de la pulsion sexuelle comme constante universelle : « Si l’érotisme
101. P. ARIÈS, « À propos de La volonté de savoir », L’arc, 70 : La crise dans la tête, 1977, réed. Inculte-l’arc, 2007, p. 71-83.
102. M. FOUCAULT, L’usage des plaisirs, op. cit., p. 17.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 728105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 72 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 73
n’apparaît pas à la surface par tel canal, il en empruntera un autre »103. La raison en est que les deux historiens utilisent les mêmes données de la démographie historique qui se base sur l’hypothèse d’une « fécondité naturelle », entendue comme le résultat d’une passion constante et réciproque entre les deux sexes et devant marquer la distinction entre le moderne et l’ancien « régime démo-graphique »104. Paradoxalement, c’est le débat entre historiens s’interrogeant sur la « réalité » et les dimensions du contrôle des naissances chez les classes populaires au XVIIIe siècle qui a fi ni par réifi er un modèle dont les origines étaient expérimentales105. La tentative de conjuguer les données biologiques avec les « attitudes » et les transformations culturelles aboutit ainsi à « natura-liser » une fi ction méthodologique, tout en restant prisonnière de l’opposition matricielle entre « nature » et « histoire » que la notion de biopouvoir devait précisément désarticuler.
C’est l’adoption du point de vue décalé des thèses d’Ariès qui permet pré-cisément cette opération de dévoilement : contre l’idée qu’il y aurait quelque part une « nature », et donc une « fécondation naturelle » de laquelle on se serait éloigné en mettant en place des moyens plus ou moins sophistiqués de contraception, il s’agit de montrer que la sexualité n’a été qu’une stratégie d’« affi rmation de soi-même » de la bourgeoisie dans son accession au pouvoir d’État106. Le sexe lui-même, et par conséquent sa « responsabilité biologique » par rapport à l’espèce, n’est que ce « point imaginaire » qui permet de saisir comment les sociétés sont passées d’une symbolique du sang à une analytique de la sexualité107. L’immense prolifération des discours sur le sexe fait alors l’objet d’un recodage clinique par une scientia sexualis qui soumet le discours
103. Edward SHORTER, Naissance de la famille moderne [1957], Seuil, Paris, 1977, p. 124 (Shorter commente ici le livre de Flandrin).
104. Il faut sans doute remonter à MALTHUS pour retrouver les origines de ce raisonnement : Essai sur le principe de population [1798], traduction française : Paris, INED, 1980, p. 24. Flandrin, qui a développé largement une critique des approches purement statistiques fondées sur le postulat de la « fécondité naturelle », n’a toutefois jamais renoncé à la catégorie de « répression ». Sur la critique de Flandrin envers la statistique démographique : J.-L. FLANDRIN, Le sexe et l’occident. Évolutions des attitudes et des comportements, Paris, Seuil, 1981, partie 4.
105. Louis HENRY est très clair sur ce point dans « Aspects divers de la fécondité des populations humaines », Revue des questions scientifi ques, 123, 1952, p. 360-381. Sur cette réifi cation par les histo-riens, voir également P.-A. ROSENTAL, « Pour une histoire politique des populations », Annales ESC, 61-1, janvier-février 2006, p. 7-29.
106. Conception sans doute limitée et limitante comme le dit l’historienne Carol Blum. Selon elle, les questions de population et de reproduction « spring from a variety of sources and incorporate a whole range of often confl icting concerns, diffi cult to attribute to a single mentality looking to further only one agenda » (Carol BLUM, Strength in numbers. Population, Reproduction and Power in Eighteenth-Century France, Baltimore, John Hopkins University Press, 2002, p. 193). Critique qui serait pertinente si effectivement Foucault faisait une histoire des mentalités, alors que, on l’a vu, ce n’est pas le cas.
107. M. FOUCAULT, La volonté de savoir, op. cit., p. 201, 203, 205 : « On pourrait montrer, en tout cas, comment cette idée “du sexe” s’est formée à travers les différentes stratégies de pouvoir et quel rôle défi ni elle y a joué […] c’est le dispositif de sexualité qui, dans ses différentes stratégies, met en place cette idée “du sexe” […]. Le sexe est au contraire l’élément le plus spéculatif, le plus idéal, le plus intérieur aussi dans un dispositif de sexualité que le pouvoir organise dans ses prises sur les corps, leur matérialité, leurs forces, leurs énergies, leurs sensations, leurs plaisirs ».
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 738105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 73 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
74 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
sur la sexualité aux critères du vrai et du faux. En montrant que la production d’une « vérité du sexe » est traversée par des rapports de pouvoir et rendue possible par une politique de la vérité, le généalogiste dissout l’idée même d’une pulsion sexuelle « naturelle ». À travers la thèse de la « sexualisation » et de « l’érotisation » des corps, Foucault pouvait alors détruire le présupposé de la controverse entre historiens et montrer que la sexualité elle-même se forme au croisement de concepts, de rationalités et de rapports de forces. Il n’y a donc pas lieu de s’appuyer sur l’histoire pour discuter une position politique favorable ou contraire à la « nature » de la « bonne sexualité » : la dissolution de l’objet « sexualité » s’avère être un geste politique et critique bien plus puissant108.
C’est là que, en effet, la généalogie dévoile sa force d’interrogation du pré-sent. La fi ction hypothétique de l’inexistence du sexe permet d’établir un écart ironique dans l’actualité, à l’instar de la mise entre parenthèses de « l’universel de l’État »109. Nous pourrions alors montrer que les débats contemporains sur la possibilité de donner la vie sont habités par des présupposés politiques et que les notions qui se présentent comme « naturelles » ont été en réalité formées, construites et déconstruites au cours de l’histoire. De ce point de vue, la généa-logie, bien mieux que l’attribution d’une signifi cation à un matériau historique « brut » à l’instar d’une philosophie de l’histoire, est un exercice qui cherche à donner un contenu réel à la réfl exion sur notre présent, une « manière de faire faire à la pensée l’épreuve du travail historique ; une manière aussi de mettre le travail historique à l’épreuve d’une transformation des cadres conceptuel et théorique »110. De cette circulation entre histoire et présent, politique et théorie, que nous avons cherché à reproduire dans la structure même de notre article, il faut tirer les conséquences : en tant que « fi ction », le biopouvoir foucaldien est peut-être moins un concept pertinent pour « faire » l’histoire que pour interroger les historiens et les philosophes sur leurs pratiques respectives, leurs certitudes insoupçonnées et leur rapport politique au présent.
Luca PALTRINIERI
CIRPP – Direction de l’innovation pédagogiqueChambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France
8, avenue de la Porte de Champerret75017 Paris
108. Sur ce point : David M. HALPERIN, Saint Foucault [1995], Paris, Epel, 2000.109. M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 4-6.110. M. FOUCAULT, « À propos des faiseurs d’histoire », in ID., Dits et écrits…, op. cit., vol. 4, p. 413.
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 748105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 74 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin
BIOPOUVOIR, HISTORIENS ET POLITIQUE 75
Résumé / Abstract
Luca PALTRINIERIBiopouvoir, les sources historiennes d’une fi ction politique
Cet article développe la notion de « biopouvoir » à travers sa contextualisation historique et méthodologique. À partir de l’examen du travail foucaldien, nous défi nissons la généalogie comme une enquête philosophique sur l’actualité, de nature fondamentalement fi ctionnelle, qui s’avantage d’un travail historique sur des archives et encore plus de la connaissance des enquêtes conduites par les historiens. L’analyse des sources historiennes de l’hypothèse biopolitique conduit à retrouver une série de problèmes et de controverses qui appartiennent à l’actualité politique et historiographique des années 1970 en France : la thèse de la transition démographique et son infl uence sur les historiens, les débats sur les origines de la contraception et leur lien avec les politiques démographiques internationales. On examine enfi n les prises de position de Foucault sur ces questions, en montrant comment, à travers la « fi ction » du biopouvoir, il cherche à déna-turaliser ces débats en explicitant leurs présuppositions communes, notamment la croyance que la sexualité est expression d’une « nature ».
MOTS-CLÉS : France, années 1970, biopouvoir, Foucault, démographie historique, contra-ception ■
Luca PALTRINIERIBiopower: the historiographical roots of a political fi ction
This article focuses on the concept of “biopower” and tries to explain it by its historical and methodological contextualization. Through the analysis of Foucault’s work, I defi ne “genealogy” as a philosophical inquiry into the present, which is basically a fi ctional narration, built through a strong knowledge of historians’ works. The analysis of historiographical sources of Foucault’s work leads to fi nd a series of political and historiographical controversies that belongs to the French intellectual fi eld of the Seventies: the theory of demographic transition and its infl uence on historians, the debates on the origins of contraception and their relationship with the international population policy. My aim is to highlight the positions of Foucault on these issues, showing how through the “fi ction” of biopower, he seeks to denaturalize these debates by explaining their common assumptions, including the belief that sexuality is an expression of a “nature”.
KEYWORDS: France, seventies, biopower, Foucault, historical demography, contraception ■
8105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 758105_rhmc60-4-4bis_007_208.indd 75 21/01/14 13:1421/01/14 13:14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 17
/06/
2014
11h
16. ©
Bel
in
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 17/06/2014 11h16. ©
Belin