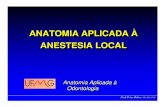Appropriation de l'espace urbain à travers la langue: Comment la communauté marocaine s'affiche à...
Transcript of Appropriation de l'espace urbain à travers la langue: Comment la communauté marocaine s'affiche à...
Chapitre 22
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue :
Comment la communauté marocaine s’affiche à Madrid et à
Saragosse
Montserat Benítez Fernández
1 Introduction
Le présent chapitre est basé sur une recherche en cours,
entreprise en 2010, portant sur les pratiques langagières de la communauté marocaine dans la diaspora, en Espagne, et plus concrètement dans la ville de Saragosse (dans la région autonome d’Aragon). Cette recherche essaie de poursuivre la voie ouverte par Vicente (2004), qui a constitué une nouvelle façon d’envisager les études migratoires en Espagne. Les études à propos des migrations en Espagne, plus précisément sur l’immigration marocaine, se sont concentrées sur des aspects sociaux (comme les modèles d’intégration, la résolution des conflits, le rôle de l’école, etc.) voir par exemple, Mijares, 2007; sur des travaux de sociolinguistique quantitative voir Broeder & Mijares, 2004 ; ou sur l’acquisition de l’arabe marocain en contexte migratoire Nouaouri, 2006 et 2008. En revanche, les travaux de Vicente se consacrent aux pratiques langagières, proprement dites, de la communauté des migrants d’origine marocaine (Vicente, 2004, 2007). Ce n’est pas le cas dans d’autres pays européens où les pratiques langagières de la communauté marocaine ont fait, et font encore, l’objet de
264 Evolution des pratiques et des représentations langagières
nombreuses études : Boumans & De Ruiter, 2002 ; Barontini, 2006 ; Barontini & Caubet, 2008 ; Caubet, 2004, 2007.
La ville de Saragosse a été choisie ici pour trois raisons : d’abord, il s’agit de la cinquième ville d’ Espagne en nombre d’habitants ; ensuite, son taux d’immigration est de 15,5 % et la communauté marocaine en est la troisième minorité (source : Ayuntamiento de Zaragoza, 2011) ; finalement la plupart des études sur l’immigration en Espagne se concentrant sur les villes de Madrid et Barcelone, une approche sur une ville périphérique comme Saragosse procure une vision plus complète ; de là l’intérêt de comparer les deux villes de Madrid et Saragosse dans cette contribution.
Cette étude tente d’apporter une réponse à la question de l’appropriation de l’espace urbain par la communauté marocaine habitant en Espagne, c’est-à-dire comment elle s’affiche publiquement dans la société hôte. On a choisi d’analyser cet aspect en utilisant comme moyen d’étude les enseignes, car, par ce biais, le locuteur (dans ce cas le propriétaire du magasin) peut exposer – ou imposer – son univers de référence culturel (Lucci, 1998 : 168-170). En partant des affiches et des enseignes, ce travail se focalise sur la langue employée, l’alphabet utilisé (arabe ou latin) et l’importance de ce choix comme marqueur identitaire. D’autres éléments importants du marquage identitaire, tels que les images ou les produits proposés en vitrine ont été également pris en considération. Le résultat obtenu présente donc une image de l’identité marocaine telle qu’affichée dans le pays d’accueil, que cela soit par la langue, le message évoqué par cette langue, ou les images qui l’accompagnent.
2 La communauté marocaine en Espagne
L’immigration en Espagne est un phénomène assez tardif, si on le compare avec les mouvements migratoires d’autres pays de l’Union Européenne. Ce n’est qu’au début des années 1990 que l’Espagne a commencé à recevoir un nombre important de
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 265
migrants étrangers. L’éclosion du phénomène migratoire ne remonte donc pas à plus de deux décennies.
L’immigration marocaine, bien que cette communauté soit l’une des plus anciennes communautés migrantes résidant en Espagne, ne fait pas exception. Les migrants d’origine marocaine commencent à arriver de façon massive en Espagne à la fin des années 1990. Selon les données statistiques disponibles (www.ine.es), en 1996, la population marocaine résidente en Espagne était de 81 468 personnes; cinq ans plus tard ce chiffre était multiplié par plus de deux, arrivant à 216 470 et par 6 en 2006, soit 522 007 au total. Au 31 décembre 2011, la population marocaine atteint le chiffre de 642 652 personnes dans toute l’Espagne, et à ce chiffre il faudrait ajouter les personnes nées en Espagne et celles ayant obtenu la nationalisé espagnole, mais qui conservent dans une large mesure leur culture et leur langue d’origine. En bref, la communauté marocaine représente la troisième minorité en Espagne, après les communautés équatorienne et roumaine, la première étant hispanophone et la deuxième, membre de l’Union Européenne.
3 La communauté marocaine dans les régions de Madrid et d’Aragon
Dans la région de Madrid, le taux de population immigrante
est de 16,7 %. Les Marocains sont au nombre de 86 386, soit 8 % de la population étrangère. Environ un tiers des Marocains (concrètement 26 530) demeurent dans la ville de Madrid (source : Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid, 2011). Les districts où la présence marocaine est la plus élevée sont localisés au sud-est de la ville (Villaverde, Puente de Vallecas, Carabanchel) et dans le centre (Centro et Tetuán).
La région d’Aragon, de son côté, subit un phénomène de dépopulation généralisée, et, de plus, ses habitants se concentrent dans la ville de Saragosse, aussi bien la population autochtone que celle d’origine étrangère. Le phénomène migratoire y est encore plus récent que dans la région de Madrid
266 Evolution des pratiques et des représentations langagières
et le reste de l’Espagne. C’est au cours de l’année 1997, que l’on y a enregistré la plus grande croissance de la population étrangère en général et marocaine en particulier.
Le taux migratoire dans la région d’Aragon est de 12,8 %. La communauté marocaine s’élève à 18 347 personnes, ce qui en fait la deuxième minorité (contrairement à Madrid et à la ville de Saragosse) après la communauté roumaine. Elle représente 10,6 % de la population étrangère (Instituto Aragonés de Estadística, 2011 : 21), dont deux tiers sont des hommes (10 021) et le tiers restant des femmes (5 087). L’immigration marocaine en Aragon est donc essentiellement masculine.
Plus de la moitié de la communauté marocaine résidant dans la région d’Aragon habite dans la ville de Saragosse (8 062), dont 4 922 (60,9 %) sont des hommes et 3 149 (39,1 %) sont des femmes (Ayuntamiento de Zaragoza, 2011). Les Marocains de cette ville représentent 10,5 % de la population étrangère. Depuis 2004, d’après les données présentées par Vicente (Vicente, 2007), la communauté marocaine à Saragosse a augmenté de 2,4 fois.
4 Les quartiers
Ma priorité est ici la ville de Saragosse, car elle a été moins étudiée sur le plan migratoire (mis à part les travaux sur les caractéristiques linguistiques des Marocains de Saragosse présentés par Vicente cf. ci-dessus). Je me suis en premier lieu penchée sur la question de la sélection du quartier, sur lequel baser cette étude dans cette ville. Selon les données statistiques de la mairie de Saragosse (voir supra) le district dans lequel habitent le plus de Marocains est le district Casco histórico. Ce district se trouve au sud de l’Ebro (la grande rivière qui divise la ville en deux), dans le cœur de la ville et il est divisé en quatre quartiers : un centre historique et commerçant assez huppé, entouré de trois quartiers dont les origines sont les différentes phases d’agrandissement de la cité médiévale.
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 267
Je me suis concentrée sur le quartier San Pablo, qui est un faubourg situé à l’ouest du quartier historique et commerçant. Ce quartier se caractérise par de petites ruelles se croisant les unes avec les autres, ceci étant dû à son origine médiévale ; les habitations sont des blocs verticaux d’appartements d’environ trois ou quatre étages.
Plan de la ville de Saragosse
Le quartier pourrait être divisé en deux : d’un côté des rues avec des habitations très anciennes et mal conservées, voire à l’état de ruine dans certains cas ; d’un autre côté, des rues très bien entretenues, avec des maisons refaites, conservant la structure ancienne mais dont les appartements datent de moins de dix ans spécialement dans les rues les plus proches de la rivière. Cela s’explique clairement par la spéculation immobilière dont le quartier a fait l’objet depuis le début du XXIème siècle. La majorité de la population occupant ce quartier est de classe moyenne, voire modeste. Ce quartier regroupe le plus grand nombre d’habitants marocains et, d’après mes informateurs, il sert de point de rassemblement pour la communauté.
A Madrid, j’ai sélectionné le quartier Lavapiés appartenant au district Centro. Bien qu’ayant une population marocaine assez significative, il ne s’agit pas du quartier le plus peuplé par les immigrés d’origine marocaine. Le choix a principalement été motivé par l’analogie avec San Pablo et surtout par sa
268 Evolution des pratiques et des représentations langagières
proximité avec le centre-ville et ses origines historiques ainsi que pour ses caractéristiques sociales. Il s’agit d’un quartier situé au sud du centre-ville commercial, historique et touristique. Aux origines du quartier, on trouve l’ancien quartier juif de la ville de Madrid. Les habitations rencontrées sont également des bâtiments de deux ou trois étages, comme dans le cas de San Pablo à Saragosse, mais où les appartements sont distribués autour d’un patio.
Dans le passé, Lavapiés a été une zone un peu délaissée, voire abandonnée, et les prix des locations y étaient assez bon marché. Par conséquent, à partir des années 1980 le quartier a commencé à se remplir de jeunes à faibles revenus. Une décennie plus tard, lors de l’éclosion du phénomène migratoire et du fait des prix assez élevés des locations à Madrid, le quartier s’est peuplé d’habitants venus de partout. Une estimation de la population du quartier montre qu’environ un tiers des habitants est d’origine étrangère, ce qui en fait un quartier multiculturel par excellence, où l’on trouve de nombreuses activités associatives et alternatives. Dans ce quartier, on fête aussi bien le nouvel an chinois que le ramadan et les associations d’immigrés organisent des soirées bangladeshies, sénégalaises, etc.
Plan du centre de Madrid
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 269
5 Récolte des données
Le corpus a été récolté lors d’une recherche de terrain effectuée dans les deux villes au cours de l’été 2011. J’ai choisi des itinéraires assez courts, pouvant se parcourir à pied, afin d’observer les commerces de proximité où l’on suppose rencontrer un plus grand nombre d’enseignes commerciales correspondant aux caractéristiques recherchées. Le corpus est constitué d’un ensemble de 31 images, 18 dans le cas de San Pablo et 22 prises à Lavapiés. L’essentiel du corpus se compose d’enseignes, de devantures de magasins ainsi que de quelques affiches. Lors de la récolte des données, l’idée de départ était que l’on trouverait plus de commerces marocains à Madrid, et donc plus d’enseignes à utiliser dans cette étude. Cette ville étant plus habituée à recevoir des gens d’ailleurs et plus cosmopolite. De plus, Lavapiés est un quartier plus grand et plus peuplé que San Pablo à Saragosse. De la même façon, en tenant compte des dimensions de la ville de Saragosse, moins habituée à avoir des communautés étrangères, ou du moins depuis moins longtemps, on ne comptait pas trouver beaucoup de témoignages de l’appropriation de l’espace, ni de changements fondamentaux dans le paysage urbain de Saragosse. La récolte des données a montré que cette hypothèse de départ était erronée comme on le verra lors de l’analyse. Malgré cet a priori sur les deux villes à propos de la visibilité de la communauté marocaine, l’observation des enseignes trouvées dans l’un et l’autre quartier permet de se rendre compte comment la communauté marocaine résidant dans ces deux villes s’affiche différemment en public et comment l’appropriation de l’espace est asymétrique.
6 Classification et analyse des enseignes
Les enseignes ont été classes selon deux critères. D’un côté, on a pris en compte le choix linguistique ; c’est-à-dire la langue qui a été choisie pour communiquer avec le public et donc, attirer l’attention des clients. D’un autre côté, on a classé les
270 Evolution des pratiques et des représentations langagières
enseignes en fonction de l’alphabet qui a été utilisé. Trois catégories ont été répertoriées :
a. Les enseignes monolingues en langue espagnole. Il s’agit de
celles où l’on ne trouve qu’un nom propre ou un toponyme, ou parfois seulement une référence à une prescription alimentaire. Ce genre de panneaux n’utilise que l’alphabet latin et c’est à Lavapiés qu’ils sont le plus nombreux. On a trouvé huit enseignes écrites exclusivement en langue espagnole dont cinq localisées à Lavapiés. Elles représentent 38,5 % des enseignes photographiées à Lavapies et 16,6 % des enseignes localisées à San Pablo.
b. Les enseignes bilingues sont celles qui emploient les deux alphabets, arabe et latin. Dans cette catégorie, on verra que le bilinguisme peut se montrer selon différents degrés, allant d’un contenu équilibré où le locuteur (le propriétaire du magasin) fournit les mêmes informations dans les deux langues, au déséquilibre total où l’interlocuteur obtient différentes informations dans une langue ou dans l’autre. Les enseignes bilingues sont majoritaires dans notre corpus, s’élevant au nombre de 14 à San Pablo (Saragosse), soit 77,8 %, et à 8 à Lavapies, c’est-à-dire 61,5 % des panneaux de la ville. Cette quantité des devantures semble être normale, car même si « le marquage représente une forme de la matérialisation de l’identité, à la fois individuelle et collective » (Bulot & Veschambre, 2004), ces enseignes se localisent dans un environnement dominé par une autre langue (l’espagnol) qui impose ses normes.
c. Les enseignes monolingues n’employant que la langue arabe et l’alphabet arabe. On a localisé une seule occurrence de ce type d’enseigne et uniquement dans la ville de Saragosse, ce qui représente 5,5 % du total des devantures de magasins situés à San Pablo.
Dans l’analyse du corpus le contenu des affiches est montré
en respectant les majuscules et minuscules tels qu’il apparaît dans l’image originale, suivi d’une traduction en français entre
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 271
parenthèses ; les termes écrits en caractères arabes sont retranscrits en utilisant la transcription arabisante et mis en italique.
D’après le contenu linguistique des affiches, on peut signaler
trois marqueurs principaux qui caractérisent une visibilité plus importante de la communauté marocaine aussi bien à Saragosse qu’à Madrid.
Premièrement, on remarque l’apparition des noms propres tels que NAZIRA (figure 1), MOHI (figure 2), HAKIM (figure 3) et RACHID (figure 4) qui apparait dans les deux alphabets.
Figure 1 : Prise à Madride
Figure 2 : Prise à Madrid
Figure 3 : Prise à Madride
Figure 4 : Prise à Madrid
On a voulu considérer les noms propres comme étant une
façon de marquer l’espace de la part de la communauté marocaine car ceci sert à identifier, à repérer, à donner existence (Lajarge & Moïse, 2005 : 109-110). L’emploi du nom propre contribue à donner des informations sur le locuteur (propriétaire
272 Evolution des pratiques et des représentations langagières
du magasin) et apporte des renseignements spécifiques sur le métier des locuteurs. Ces noms propres nous disent qu’ils appartiennent à une communauté différente de la communauté dominante, l’espagnole : à travers l’usage des noms propres le locuteur manifeste son appartenance d’abord, à la communauté arabe, mais en plus – sachant que la nationalité marocaine est la plus nombreuse parmi les minorités arabes en Espagne – on pourrait lui attribuer une filiation à la communauté marocaine. Il faut signaler que l’utilisation des noms propres a été attestée seulement dans les devantures des magasins localisées à Lavapiés (Madrid).
Le deuxième élément qui semble être un marqueur de la communauté marocaine, au moins à Lavapiés et à San Pablo, est l’utilisation des toponymes renvoyant à un ailleurs lointain. Il est évident que le mot RIF (figure 3, voir au dessus) renvoie au nord du Maroc et cerne assez bien la communauté dans laquelle se concentre cette recherche. Le toponyme CEUTA (figure 5 voir au dessous), ou bien Səbta, tel qu’il apparaît dans la partie écrite en caractères arabes, est un peu ambigu ; il dépend du type d’interlocuteur qui reçoit le message de l’enseigne. S’il s’agit d’un interlocuteur d’origine marocaine, il y verra une référence au toponyme revendiqué comme étant territoire marocain sous domination espagnole. Alors, ce toponyme-ci, comme dans le cas précédent, renvoie au Maroc et à une communauté qui s’affiche par ses villes. En revanche, lorsqu’un interlocuteur espagnol reçoit ce message, il ne trouve aucune référence à une origine autre que l’espagnol. D’ailleurs, le message BAZAR CEUTA et les produits qui y se vendent, en partie, ne sont en aucun cas étrangers à la culture espagnole, car on pouvait trouver à Ceuta – de par son caractère de ville franche – pendant des années, le « dernier cri » des appareils électroniques (à côté des bijoux, produits de décoration, tissus, etc.) et les BAZAR CEUTA repartis dans la géographie espagnole ont plutôt été interprétés par les interlocuteurs comme un magasin dans lequel on pouvait trouver ce genre de marchandise achetée dans cette ville. En revenant au magasin BAZAR CEUTA à San Pablo, le marqueur d’identité marocaine est représenté par l’ensemble des produits qui s’y trouvent, on y
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 273
reviendra plus tard. Finalement, le dernier toponyme de cette sélection d’enseignes se trouve dans la figure 6 : CAFE ARABIA. Ceci nous fait penser à la Péninsule Arabique, à des paysages exotiques, à des histoires d’aventuriers du passé, mais dans tous les cas, ce marqueur nous éloigne de la réalité que l’on veut analyser. Il faudrait retenir, comme dans le cas des noms propres, le fait qu’ARABIA renvoie à une communauté arabe, quelle que soit sa nationalité précise.
Figure 5 : Prise à Saragossee
Figure 6 : Prise à Saragosse
Le troisième marqueur que l’on va étudier est le mot halal et
ses différentes formes d’apparition sur les devantures de magasins. Ce mot est présent sur les panneaux des magasins d’alimentation ou dans les boucheries, aussi bien à San Pablo qu’à Lavapiés, tantôt en caractères latins, tantôt en caractères arabes (figures 7, 8, 9 et 10), ou même dans les deux alphabets (figures 11 et 4 voir au dessus).
Figure 7 : Prise à Saragossee
Figure 8 : Prise à Saragosse
274 Evolution des pratiques et des représentations langagières
Figure 9 : Prise à Saragossee
Figure 10 : Prise à Saragosse
Figure 11 : Prise à Saragosse
Premièrement, le mot halal présuppose une prescription alimentaire d’ordre religieux qui s’adresse à la communauté musulmane en général. A côté de cette prescription alimentaire, on voudrait faire ressortir certaines nuances relatives à l’usage de l’alphabet dans lequel ce mot est écrit. À Lavapiés, ce mot est utilisé en caractères latins sur la plupart des panneaux (figures 12, 22 et 2 voir au dessus).
Figure 12 : Prise à Madride
Figure 22 : Prise à Madrid
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 275
Il est évident que le locuteur s’adresse à un public beaucoup plus large que la communauté musulmane arabophone – dont la majorité est marocaine – et que le mot halal entend attirer également d’autres musulmans (Pakistanais, Africains de l’Ouest, Espagnols convertis) en tant que clients. Inversement, l’apparition de ce mot à San Pablo, se fait majoritairement en caractères arabes, plus particulièrement sur les enseignes bilingues (sauf sur l’enseigne de la figure 10, voir au dessus, qui est monolingue en arabe). Seulement dans deux cas (figures 4 et 11 voir au dessus), le mot halal apparaît dans les deux alphabets, arabe et latin. Plus précisément, dans le cas de la figure 11, tout le contenu du panneau est écrit en espagnol sauf ce mot qui est bilingue : Asador HALAL (Grill halal) // ḥalāl Al Saada (accompagné sur les côtés d’images des produits alimentaires que l’on peut y trouver). Sur le reste des panneaux localisés à San Pablo, le mot halal apparaît en caractères arabes. Sur ces devantures, on trouve, d’abord, une information assez générale en espagnol (informant sur le type de magasin et donnant un nom), suivie du mot halal en caractères arabes. Ex. Figure 7 (voir au dessus): CARNICERÍA ALMANAR (BOUCHERIE ALMANAR) // lḥūm ḥalāl (viandes halal) // ALIMENTOS EN GENERAL (Alimentation générale) Figure 8 : CARNICERÍA (BOUCHERIE) // ALIMENTACIÓN (ALIMENTATION) // Y FRUTOS SECOS (ET FRUITS SECS) // ḥalāl (halal)
7 Le poids de la langue
Comme indiqué plus haut, le corpus analysé est formé par
des devantures de magasins et par quelques affiches écrites à la main. Ce matériel a été classé en fonction de la langue et de l’alphabet utilisés. Il est clair que l’utilisation d’une langue ou de l’autre doit jouer un rôle dans l’appropriation de l’espace, raison pour laquelle on va essayer d’approfondir l’importance d’employer une langue ou une autre.
276 Evolution des pratiques et des représentations langagières
On a pu relever que certaines enseignes monolingues cachent une réalité « historique », une première étape du magasin, du propriétaire, et aussi, de la communauté elle même. En revenant sur la figure 7 (au dessus), on s’aperçoit des deux étapes du magasin. D’abord, un panneau monolingue : CARNICERIA ALMANAR (BOUCHERIE ALMANAR) // Alimentos en General (Alimentation générale) (sur la photo on ne voit pas le « l » final de « general » suite à une erreur de cadrage). À côté de ce panneau, on remarque une nouvelle enseigne dans lequel il y a un mélange de deux langues et deux alphabets. Cela pourrait indiquer que le seul fait de se nommer « ALMANAR » ne suffit plus pour attirer l’attention de la communauté à laquelle le locuteur voudrait s’adresser, donc il a fallu ajouter d’autres informations qui, sans doute donnent plus de confiance à l’acheteur : CARNICERÍA ALMANAR (BOUCERIE ALMANAR) // lḥūm ḥalāl (viandes halal) // ALIMENTOS EN GENERAL (ALIMENTATION GÉNÉRALE).
Un autre exemple de monolinguisme qui devient bilinguisme se trouve dans le CAFE ARABIA (figure 6, au dessus). L’enseigne, sur laquelle on avait déjà abordé l’utilisation du toponyme, ne dévoile pas la réalité linguistique du propriétaire qui, en revanche, s’affiche clairement dans la vitrine par le biais des petites affiches écrites à la main, aussi bien en espagnol qu’en arabe, cette fois-ci dans une variété d’arabe parlé. L’ensemble des affiches essaie d'attirer la clientèle du quartier en offrant des produits typiquement espagnols afin de concurrencer d’autres cafés ou bars de la zone : (figure 14) Minibocadillo de jamon + caña (Minisandwich de jambon + petite bière), (figure 15) Café con leche + churros (Café au lait + beignets) // Pincho de tortilla + caña (part d’omelette + petite bière).
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 277
Figure 14 : Prise à Saragosse
Figure 15 : Prise à Saragosse Mais il offre aussi des produits spécifiques à un café
marocain, tenant compte du voisinage dans lequel se localise ce CAFE ARABIA, comme on peut voir dans les exemples suivantes.
Figure 14 : kās š-šāy + l-msəmmən [verre de thé + crêpe feuilletée enduite de beurre rance (voir DAF, vol 6, 201)] // l-ḥarīra (soupe traditionnelle marocaine). L’usage de š-šay, doit s’inscrire dans l’intention d’attirer d’autres communautés arabes.
Figure 15 : ž-žumʕa l-kūskŭs hna (le vendredi couscous ici). On trouve ici sans doute une mauvaise transcription du terme kəsksu (couscous).
Figure 16 : r-rāyb (lait caillé)
278 Evolution des pratiques et des représentations langagières
Figure 16 : Prise à Saragosse Ici, l’appropriation de l’espace en tant que marocain paraît
plus évidente, car l’offre des produits s’insère davantage dans ce contexte et le lexique relève de l’arabe marocain. Il est curieux que cela se fasse par des affiches en papier, que l’on peut changer très facilement. Serait-ce une façon de transgresser les normes, tout en respectant les limites (car les affiches ne sont pas permanentes) ? On fait référence ici à la convention, chez les arabophones en général et les Marocains dans ce cas présent, d’utiliser quasi exclusivement l’arabe standard à l’écrit, convention qui est, d’ailleurs, de plus en plus contestée dans le pays d’origine (voir, par exemple, les contributions faites par Aguadé, Caubet, Gago et Hoogland dans volumes I et II, et aussi, entre autres, Benítez Fernández 2008, 2010 : 188-202, et 2012). Ces affiches sont aussi une façon d’inciter d’autres Marocains à fréquenter cet endroit, à ne pas se sentir dépaysés car on trouve des produits que l’on connaît bien, à se réunir et former une vraie communauté qui se rassemble et qui partage ses problèmes, ses réussites.
En tout cas, l’usage du bilinguisme est rarement équilibré, l’une ou l’autre langue va bénéficier d’une place dominante selon l’information que le locuteur désire partager et avec qui il veut la partager. Comme on l’a vu plus haut, parfois on ne repère qu’un seul mot en arabe (comme dans les enseignes avec le marqueur halal) et dans d’autres cas l’arabe est la langue dominante et l’espagnol est employé uniquement dans le nom du magasin ou le type d’activité à laquelle il se consacre.
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 279
Dans la figure 9 (voir au dessus), on voit beaucoup plus d’informations en arabe qu’en espagnol. Il y a une certaine égalité sur les deux premières lignes : même couleur des lettres, même couleur sur les bords (noir avec les limites en jaune sur un fond rouge). En revanche, le contenu commence à être déséquilibré dès ces deux premières lignes : məgzara n-nūr al-ʔslāmiyya (boucherie islamique Nur) // CARNICERÍA ANNUR (BOUCHERIE ANNOUR), car le locuteur donne l’information « al-ʔslamiyya » (islamique) en arabe, ce dont il se dispense en espagnol. Puis, la dernière ligne : žmiʕ ʔnwaʕ al-lḥəm l-ḥalāl w-l-mawād al-ġadaʔiyya » (toutes sortes de viandes halal et de produits alimentaires) complète l’information donnée à la première ligne et la concrétise à propos des produits vendus dans le magasin. Il est évident que le propriétaire de ce magasin s’adresse à une clientèle assez particulière, ses voisins, ses compatriotes, mais sûrement aussi ses confrères.
A Lavapiés on a également remarqué un bilinguisme déséquilibré, mais dans ce cas (figure 17), ce n’est pas la quantité d’informations qui varie d’une langue à l’autre mais le contenu de l’information. Aucune langue ne domine l’autre, mais les messages ne correspondent pas, il ne s’agit pas d’une traduction vers l’arabe ou vers l’espagnol.
Figure 17 : Prise à Madrid
En espagnol, l’enseigne nous informe du fait que dans ce
local se trouve l’ASOCIACIÓN AL HUDA (ASSOCIATION AL HUDA). Pour ceux qui connaissent l’arabe, le fait d’appeler l’association AL HUDA (le droit chemin ou le salut) a des
280 Evolution des pratiques et des représentations langagières
connotations religieuses assez importantes qui se confirment avec la partie de la devanture écrite en arabe : Masžid al-hudá (mosquée al-Huda). Le fait d’écrire cette information en arabe, une langue plus cryptique pour la majorité de la population, peut cacher une réalité irrégulière de cette institution, car les lieux de culte doivent être inscrits dans le Registre des Entités Religieuses (sous contrôle du Ministère de la Justice d’Espagne). D’un autre côté, il est possible que ce lieu abrite les deux activités, qu’il soit un lieu consacré à la prière et puis un endroit où la communauté peut se rencontrer, où les gens peuvent trouver des réponses à leurs problèmes, créer un réseau social, ce à quoi on a difficilement accès lorsqu’on est dans une situation migratoire. En tout cas, les informations pour les non arabophones ont une toute autre connotation que pour les arabophones.
Le déséquilibre des langues peut aussi se produire au profit de l’espagnol, comme on l’a déjà vu, par exemple dans la figure 5 (voir au dessus). Sur cette enseigne, le seul renseignement en langue arabe est le nom du magasin : bazār səbta et ceci est situé sur la devanture latérale, car l’enseigne frontale du magasin n’a même pas de contenu en arabe. En revanche, d’après les entretiens que l’on a pu enregistrer parmi les membres de la communauté marocaine de la ville, il apparaît que ce magasin est un des points où une grande partie des Marocains de la ville se rend afin de réaliser certains achats : ils vendent des corans illustrés, des livres pour apprendre l’arabe aux enfants, des valises, des tapis pour la prière, des décorations proprement marocaines, qui sont tous exposés en vitrine.
Un autre exemple d’espagnol comme langue dominante se retrouve dans le cas de ce restaurant de Lavapiès où la fonction et le nom du magasin ont été traduits en arabe, mais où le reste des informations se trouve en espagnol.
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 281
Figure 18 : Prise à Madrid On peut lire Maqhá w maṭaʕam al-xayma (Café et restaurant
al-xayma), ce qui correspond à CAFETERÍA Y RESTAURANTE ALJAIMA (Café et restaurant al-xayma). Ensuite, on a l’information COMIDA ÁRABE (NOURRITURE ARABE) dont la traduction arabe n’a pas été jugée nécessarie, peut-être parce que le nom du magasin est assez explicatif, ou éventuellement parce que des illustrations de plats arabes sont présentes.
Par rapport au monolinguisme arabe, on a trouvé une seule enseigne complètement en langue arabe, à Saragosse (figure 10) et sans équivalent à Madrid. Du fait du petit nombre d’occurrences de ce type d’enseignes, on n’entreprendra pas d’analyse.
8 Autres éléments identitaires : Éléments identitaires non verbaux
Jusqu’à présent, on a pu voir des enseignes, principalement
bilingues (arabe standard-espagnol) ou bien monolingues (espagnol) et très peu d’enseignes en arabe marocain. Il convient donc de se demander en quoi la communauté marocaine s’affiche, en tant que telle, dans ces enseignes ? Il faut rappeler les données démographiques qui ont été exposées au début de cet article et qui indiquent la prédominance de la communauté marocaine résidant dans ces deux villes (par rapport aux autres communautés arabophones). Il est également
282 Evolution des pratiques et des représentations langagières
important de noter que la population marocaine se consacre principalement à deux activités professionnelles : la construction et le commerce. De ce fait, malgré l’utilisation de la langue arabe standard qui n’est pas de l’arabe marocain et à laquelle toutes les communautés arabes pourraient s’identifier, on est tenté de dire que cette langue est un marquage qui permet à la communauté marocaine résidente en Espagne de s’approprier l’espace public, au moins en ce qui concerne les personnes habitant à San Pablo et Lavapiés.
D’autre part, lorsqu’on regarde le magasin dans son ensemble, c’est-à-dire l’enseigne, les images qui l’accompagnent et les produits qui s’y vendent, on trouve d’autres éléments qui contribuent à identifier ce marquage de l’espace comme étant « marocain ». Il s’agit, par exemple, des images (figure 4 au dessus) accompagnant un texte bilingue, sur lesquelles on peut voir de petits gâteaux marocains. De plus, lorsqu’on s’approche du magasin, on peut constater, dans la vitrine, une liste de nourriture avec des images de mets spécifiques de la gastronomie marocaine (ḅaṣṭila, ṭāžin, ḥaṛira…) accompagnée d’une femme habillée à la façon traditionnelle de Žbala (figure 19), ce qui nous ramène tout de suite à cette région du Maroc.
Figure 19 : Prise à Madrid
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 283
9 Récapitulation et conclusion
La communauté marocaine s’affiche par de la langue, voire des langues – L’usage de l’arabe marocain est très restreint, voire pratiquement nul, exception faite des petites affiches écrites à la main qui ont été analysées auparavant, faisant référence à certains produits des petits-déjeuners marocains. Les devantures des magasins sont écrites en arabe standard dans le pays d’origine. Il ne devrait pas, par conséquent, être différent dans la diaspora. On peut dire que la communauté marocaine ne s’affiche pas, ne s’approprie pas l’espace public en employant l’arabe marocain ou, au moins, pas d’une façon permanente. Tout au contraire, ils le font principalement par le biais de l’arabe standard, mais aussi, par le bilinguisme, surement en acceptant la réalité multiple qu’implique l’immigration.
On s’est beaucoup questionné sur le fait de trouver plus de monolinguisme espagnol à Madrid, une ville plus cosmopolite, plus habituée à l’immigration, qu’à Saragosse. Comme déjà mentionné, San Pablo représente – pour la communauté marocaine résidant à Saragosse – un vrai point de rassemblement, tandis que Lavapiés est le quartier multiculturel par excellence, même un peu bobo, proche du centre-ville touristique. Etant donné les caractéristiques des deux quartiers, ce monolinguisme préférentiel de Lavapiés pourrait être dû au fait que les commerçants sont plus intégrateurs de par la localisation du quartier. C’est-à-dire qu’ils cherchent à attirer plus de clients et pas seulement les immigrés ou les musulmans. En revanche, les commerçants de San Pablo, lieu d’ancrage pour la communauté, ciblent très concrètement leurs clients parmi les Marocains de la ville. Une autre réponse possible pourrait être la forte politique de contrôle d’identité mise en place spécifiquement à Madrid et, d’une façon très particulière, dans ce genre de quartier. Ceci pourrait engendrer dans la communauté migrante en général le besoin de passer inaperçu, de ne pas se faire remarquer. Toutefois, on n’est pas en position de donner une réponse définitive à ces hypothèses dans ce travail.
284 Evolution des pratiques et des représentations langagières
La communauté marocaine s’affiche par des prescriptions religieuses – Comme on a pu constater dans le corpus, la plupart des enseignes se consacrent à l’alimentation, et plus spécifiquement à la vente de viande halal, à laquelle s’ajoutent quelques coiffeurs (figures 3 voir au dessus et 20).
Figure 20 : Prise à Madrid
Dans les deux cas, il s’agit de prescriptions de type
religieux : d’un côté la prohibition de manger de la viande n’ayant pas été sacrifiée et sur laquelle on n’a pas prononcé le nom de Dieu – les boucheries halal s’avèrent un besoin dans la communauté – et d’un autre côté, l’apparition du coiffeur fait également penser à des purifications rituelles présentes dans la vie des musulmans. On peut donc affirmer que la communauté s’affiche aussi par son caractère musulman.
La communauté marocaine s’affiche par des produits traditionnels – Comme avancé précédemment, les produits en vente dans ces magasins sont de type traditionnel : des tapis, des ṭwažin, des ingrédients de plats traditionnels comme de la farine, de la semoule, etc. Ils identifient aussi bien le vendeur que les acheteurs comme appartenant à une société attachée à ses coutumes.
Plus d’affichages dans des rues moins visibles, moins attirantes – Bien que l’immigration à Saragosse soit plus récente, les immigrés les plus anciens étant arrivés à la fin des années 1990, il apparaît que la communauté marocaine de la
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 285
ville est plus « assise », plus unie. Elle est plus à l’aise pour afficher publiquement son identité, bien que cela soit dans des endroits encore assez discrets, dans des petites rues habitées et fréquentées par l’ensemble de la communauté. On observe donc que ces endroits bénéficient d’un affichage plus marocain, plus arabe et plus musulman.
En revanche, à Madrid, une ville beaucoup plus grande, avec une population plus cosmopolite et habituée à être un grand carrefour récepteur de gens de tous horizons, les Marocains, rappelons-le ici étant la deuxième communauté en nombre et en ancienneté dans la ville, sont moins présents dans le paysage visuel de la ville.
L’objectif initial de ce travail était d’observer comment la communauté marocaine s’approprie l’espace dans son nouveau lieu de résidence, c’est à dire d’examiner comment les Marocains s’affichent dans l’espace public et en quoi on peut distinguer qu’il s’agit d’une communauté marocaine. On partait de l’idée de trouver un marquage linguistique assez lié aux langues vernaculaires (arabe marocain ou tamazight), car la communauté marocaine est la plus nombreuse parmi les communautés immigrées d’origine arabe. Or les langues vernaculaires sont pratiquement inexistantes, à l’exception de quelques affiches à San Pablo. On peut donc conclure que, pour le moment, la communauté marocaine s’affiche dans l’espace public de ces villes espagnoles comme étant une communauté éminemment arabe, qui emploie davantage l’arabe standard.
D’un autre côté, certains veulent jouer le rôle de l’exotisme, en mélangeant les deux langues (l’espagnol et l’arabe). Tout en faisant référence à leurs origines, ils veulent aussi attirer l’attention de l’autre, le client, qui par curiosité, ou par plaisir, profitera de cette diversité urbaine. Face à cela, on trouve une volonté importante de passer inaperçu, comme on a pu le constater dans les nombreuses enseignes monolingues en espagnol.
286 Evolution des pratiques et des représentations langagières
Références bibliographiques AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, 2011, Unidad de
estadística y gestión padronal, http://www.zaragoza.es/ ciudad/estadistica/menuTablasMunicipales_Cifras (consulté 01/10/2011).
BARONTINI, A., 2006, « Alternance codique arabe algérien/français, en France : négociations à partir d’une consigne donnée par la recherche », Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí, no 10, p. 69-80.
BARONTINI, A. & CAUBET, D., 2008, « La transmission de l’arabe maghrébin en France : état de lieux », Le français aujourd’hui, no 158(3), p. 21-28.
BENÍTEZ FERNÁNDEZ, M., 2008, « Arabe marroquí como proyecto editorial, ¿es una experiencia posible ? », ABU-SHAMS [éd.], Actas del III Congreso de Internacional de árabe marroquí : Estudio, enseñanza y aprendizaje, Vitoria, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco., p. 37-54.
BENÍTEZ FERNÁNDEZ, M., 2010, La política lingüística contemporánea de Marruecos : de la arabización a la aceptación del miltilingüismo, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo.
BENÍTEZ FERNÁNDEZ, M., 2012, « TelQuel : una fuente contemporánea para el estudio del àrabe marroquí », MEOUAK, SÁNCHEZ & VICENTE [éds.], De los manuscritos medievales a internet: la presencia del árabe vernáculo en las fuentes escritas, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, p. 403-417.
BOUMANS, L. & DE RUITER, J.J., 2002, « Moroccan arabic in the Eurpean diaspora », ROUCHDY [éd.], Language Contact and language conflict in Arabic. Variations on a Sociolinguistic Theme, London, Routledge Curzon.
BROEDER, P. & MIJARES MOLINA, L., 2004, Multilingual Madrid. Languages at home and at the primary school, Amsterdam, European Cultural Foundation.
BULOT, T. & VESCHAMBRE, V., 2005, « Socilinguistique urbaine et géographie sociale : hétérogénéité des langues et
Appropriation de l’espace urbain à travers la langue 287
des espaces », Penser et faire de la géographie sociale. Contributions à une épistémologie de la gógraphie sociale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 305-324.
CAUBET, D., 2007, « L’arabe maghrébin – darja, une langue ressource en France », LAMBERT, MILLET, RASPAIL & TRIMAILLE [éds.], Variations au cœur et aux marges de la sociolinguistique, Mélanges offerts à Jacqueline Billiez, Espaces Discursifs, Paris, L’Harmattan, p. 49-54.
INSTITUTO ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA (IAEST), 2011, Datos básicos de Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasGenericas/DatosBasicos/ci.01_Actualizados.detalleDepartamento?channelSelected=0 (consulté 01/10/2011).
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2011, http://www.madrid.org/iestadis/ (consultado 01/10/2011).
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2011, http://www.ine.es (consulté 01/06/2012).
LAJARGE, R. & MOISE, C., 2005, « Enseignes commerciales, traces et transition urbaines. Quartier de Figuerolles, Montpellier », Revue de l’Université de Mocton, no 36(1), http://id.erudit.org/iderudit/011990ar.
LAJARGE, R. & MOISE, C., 2008, « Néotoponymie, marquer et référent dans la recomposition de territoires urbains en difficulté », L’Espace Politique, no 5(2) (mise en linge le 17/12/2008) http://espacepolitique.revues.org/index324. html.
LUCCI, V., 1998, « En quête d’une identité », LUCCI et al. [éds.], Des écrits dans la ville : sociolinguistique d’écrits urbains : l’exemple de Grenoble, Paris, L’Harmattan, p. 166-219.
MIJARES MOLINA, L., 2007, Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración diversidad lingüística y escuela en España, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
NOUAOURI, N., 2006, « Relative Clauses in Moroccan Arabic : its Use and Acquisition in Narratives », MOSCOSO & NOUAOURI [éds.], Actas del I Congreso Árabe
288 Evolution des pratiques et des représentations langagières
Marroquí : estudio, enseñanza y aprendizaje, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, p. 169-191.
NOUAOURI, N., 2008, « Poner las cosas en su sitio, semántica del léxico de actos de desplazamiento », MOSCOSO, PÉREZ & NOUAOURI [éds.], Actas del II Congreso Árabe Marroquí : estudio, enseñanza y aprendizaje, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, p. 141-153.
VICENTE, Á., 2004, « El árabe dialectal en situación de inmigración. La comunidad arabófona de Zaragoza », VICENTE [éd.], Musulmanes en el Aragón del silgo XXI, Zaragoza, IEIOP, p. 85-104.
VICENTE, Á., 2007, « Two cases of Moroccan Arabic in the diaspora », MILLER et al. [éds.], Arabic in the city. Issues in dialect contact and language variation, New York, Routledge, p. 123-143.