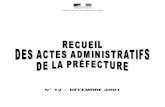Le Terrorisme d'Etat: un défi pour l'état de droit en droit international
Structure et bioévaluation de l'état écologique des communautés benthiques d'un écosystème...
Transcript of Structure et bioévaluation de l'état écologique des communautés benthiques d'un écosystème...
3/
ntaires debenthiques ationnelle.suspensi-euséquilibrés.
u niveau des
This paperzoobenthicdiversityated by
munitiesall through
C. R. Biologies 328 (2005) 977–990
http://france.elsevier.com/direct/CRASS
Écologie / Ecology
Structure et bioévaluation de l’état écologiquedes communautés benthiques d’un écosystème lagunaire
de la côte atlantique marocaine
Hocein Bazairia, Abdellatif Bayedb, Christian Hilyc,∗
a Unité de biologie et écologie marines, département de biologie, faculté des sciences, université Hassan-II Aïn Chock,BP 5366, Maârif, 20100 Casablanca, Maroc
b Unité d’océanologie biologique, Institut scientifique, université Mohammed-V–Agdal, BP 703, Agdal, 10106 Rabat, Marocc Laboratoire des sciences de l’environnement marin, Institut universitaire européen de la mer, place Nicolas-Copernic,
université de Bretagne occidentale, 29280 Plouzané, France
Reçu le 1er mars 2005 ; accepté le 20 septembre 2005
Disponible sur Internet le 27 octobre 2005
Présenté par Pierre Buser
Résumé
La lagune de Merja Zerga est un écosystème semi-fermé, qui fait l’objet de nombreux usages. Les habitats sédimecet écosystème ont été caractérisés et un état de référence de la qualité et de la santé de leurs peuplements macrozooété établi. L’inventaire faunistique révèle une diversité taxonomique de 147 taxons, à la base d’une grande diversité foncL’organisation trophique est conditionnée par un nombre restreint d’espèces qui dominent quantitativement, le bivalvevore Cerastoderma eduleet le bivalve déposivore de surfaceScrobicularia plana. Les microbrouteurs et les herbivores sont pabondants. Le calcul des indices biotiques qualifie le site de légèrement perturbé, avec des peuplements benthiques déCependant, le système est stable à l’échelle saisonnière en termes de richesse spécifique et abondances, ainsi qu’aindices biotiques.Pour citer cet article : H. Bazairi et al., C. R. Biologies 328 (2005). 2005 Académie des sciences. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Structure and bioassessment of benthic communities of a lagoonal ecosystem of the Atlantic Moroccan coast. The MerjaZerga lagoon is a semi-enclosed marine ecosystem in which various types of human activities have been developed.characterizes the biosedimentary units of the lagoon and defines a reference status of the quality and health of the macrocommunities that can be used as bioindicators of the quality of the global marine environment. Specific and functionalwere high: 147 taxa were identified; they were distributed within seven main trophic groups. Trophic structure is dominthe suspension-feeding bivalveCerastoderma eduleand the deposit-feeding bivalveScrobicularia plana, while micrograzers andmacroherbivores remain low. Biotic index values indicated that the site is moderately perturbed and that the benthic comare unbalanced. Nevertheless, the communities showed a seasonal stability of abundances and a high specific richnessthe year.To cite this article: H. Bazairi et al., C. R. Biologies 328 (2005). 2005 Académie des sciences. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
* Auteur correspondant.Adresse e-mail :[email protected](C. Hily).
1631-0691/$ – see front matter 2005 Académie des sciences. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.crvi.2005.09.006
978 H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990
Mots-clés :Lagune côtière ; Habitats sédimentaires ; Macrozoobenthos ; Biodiversité ; Qualité écologique ; Maroc
Keywords:Coastal lagoon; Sedimentary habitats; Macrozoobenthos; Biodiversity; Ecological quality; Morocco
uc-tur-andts.ple-uresAt-blel is-thisthe
indi-ecophiccies
ch-in-
udybti-and
ts inementThedi-reu-
uredidalthedomthe
spetoys-
antintoun-
y artheby
ofies.
nalper-zerssys-tur-rmedrjathenticral-
thehe
re-ntlybal-andat-f la-rantingthatoftheof
u-er,meical
thealy-vari-thents
in-woucedde-
cô-na-
Abridged English version
Coastal lagoons are considered to be highly prodtive ecosystems, but are vulnerable to human disbance as a result of their semi-enclosed situationtheir proximity of the sources of terrestrial effluenMonitoring surveys are therefore necessary to imment effective management and conservation measThe Merja Zerga lagoon, located on the Moroccanlantic coast, is an example of this type of vulneraecosystem concerning a number of environmentasues that have been raised recently. The aim ofstudy was to assess the quality and the health ofecosystem using the benthic macrofauna as a biocator. Two complementary approaches, based onlogical groups of species, were used here: etho-trogroups to assess the functional biodiversity and spegrouped according to their sensibility to organic enriment (ecological groups) in order to estimate thetensity of perturbation of these communities. The stinvolved seasonal sampling in both intertidal and sudal zones over one year. Sands, muddy sands and smuds were the three dominant sedimentary habitathe lagoon. Among the 147 taxa sampled, most of thwere identified to the species level. Eighty-six percof these species were newly recorded for the site.sedimentary habitats of the subtidal zone were moreversified than the intertidal, which is an original featufor this type of lagoonal environment. The macrofanal assemblages were more diversified and structin sandy muds habitats, both in intertidal and subtzones. All the trophic group types were present inlagoon, but suspension and surface deposit feedersinated all through the year. Within these two groups,BivalvesCerastoderma eduleandScrobicularia plana,respectively, were the most abundant species. Thecific diversity within one trophic group is consideredbe a good indicator of the potential resilience of the stem.
In this study, only species that were both dominand common were considered; this avoids takingaccount the occasional marine species which areable to develop permanent populations because thenot adapted to estuarine conditions. In Merja Zerga,number of dominant and common species groupedtrophic guilds showed that the trophic organizationthe benthic fauna was dominated by only a few spec
.
-
y
-
-
e
Such a feature is a global characteristic of lagoocommunities, which leads to their consideration asturbed. The reduced representation of the micrograand the herbivores could be a weak point of the ecotem, especially in the case of eutrophication. The disbance of the macrobenthic assemblages was perfousing biotic indices where the Hily (1984) and Boet al. (2002) models were tested. This study wasoccasion to compare these two methods in an Atlaecosystem located in a Southern area of the Gibtar straight. At Merja Zerga, the two models gavesame results. No heavy pollution was identified. Tvalues recorded in biotic indices (Ambi= 2) did notshowed seasonality, and the opportunistic speciesmained at low densities all the year round: consequethe Merja Zerga lagoon can be considered as unanced. The values of the biotic indices recordedthe dominance of the ecological group III under nural unbalanced conditions could be characteristic ogoonal communities, in which species must be toleto large variations of environmental factors, includorganic matter in the sediment. The results suggesta combined approach analysing both the variabilitythe relative dominance of the ecological groups andBC and Ambi indexes could give the best evaluationthe quality of the benthic community, and in particlar when surveying the temporal evolution. Howevfurther work is needed to adjust the position of solagoonal brackish species with the different ecologgroups.
Moreover, the benthic macrofauna survey inMerja Zerga lagoon shows that the trophic-group anses are useful to understand the structure and theability and could be a complementary approach forbiotic indexes, being able to identify the weak poiof the community structures. These groups are gooddicators of the functional diversity. By crossing the tapproaches in the Merja Zerga lagoon, it can be dedthat the benthic ecosystem is of a satisfying quality,spite the human activities.
1. Introduction
Les lagunes côtières occupent 13% de la zonetière du globe et subissent des influences d’origines
H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990 979
s
ennvi-
les
iqueourffec-
entem-une
at-nes
mesuenuti-ent
eauvil-cro-elleauxin-chema-rmis
ts ett la
au-
et lat
nt leitioniquess en
iserdesurdest lescolo-
de
fa-bat
vreear lesader,ageireinci-
turelles et anthropiques[1]. Elles comptent parmi leécosystèmes les plus productifs de la biosphère[2].Dans ces écosystèmes, les conditions environnemtales, régulièrement changeantes, les qualifient d’eronnements stressés[3]. Leur proximité du domainecontinental les rend tout particulièrement vulnérabaux perturbations d’origine anthropique[4].
Face à de telles contraintes, la faune macrobenthest reconnue comme un outil biologique de choix ptenter de mettre en évidence les perturbations qui atent les écosystèmes côtiers[5]. C’est en particulier unbon indicateur des conditions écologiques qui règnà l’interface eau–sédiment, où s’accumulent fréqument les effets d’un enrichissement organique ou d’perturbation plus importante du milieu[6].
La lagune de Merja Zerga, située sur le littorallantique marocain, constitue un exemple de ces zocôtières vulnérables, puisque de nombreux problèenvironnementaux sont apparus récemment ou risqde se poser dans un futur proche. Ils sont liés à l’lisation des ressources naturelles, aux aménagemagricoles dans le bassin versant, aux vidanges desde rizières dans la lagune et aux extensions dulage balnéaire de Moulay Bousselham. La faune mabenthique y occupe une place particulière, puisqu’constitue une ressource alimentaire pour les oiselimicoles et qu’elle présente pour les poissons untérêt socio-économique, de par les activités de pêpratiquées. Un suivi écologique de la composantecrozoobenthique de cet écosystème lagunaire a ped’établir un état de référence pour ces peuplemend’identifier les facteurs environnementaux régissan
-
t
sx
structure et le fonctionnement des communautés[7,8].Trois communautés ont été identifiées : les communtés àCerastoderma eduleet àScrobicularia plana, lo-calisées à la fois en zones intertidale et subtidalecommunauté àTapes decussataprésente, uniquemenen zone subtidale. Ces communautés se distribuelong d’un gradient écologique sans stade de transet sont contrôlées davantage par les facteurs édaphen zone intertidale et par les facteurs hydrologiquezone subtidale.
La présente étude se fixe l’objectif de caractérphysiquement l’habitat sédimentaire de la laguneMerja Zerga et d’apporter des données nouvellesla composante biotique. Une évaluation écologiquecommunautés benthiques est conduite en croisanapproches par groupes trophiques et groupes égiques, en considérant la variabilité spatiotemporellela faune benthique[9,10].
2. Matériel et méthodes
2.1. Site d’étude
La lagune côtière de Merja Zerga se situe sur laçade atlantique du Maroc, à 120 km au nord de Ra(Fig. 1). Elle présente une forme elliptique et recouune superficie d’environ 27 km2. Les eaux de la lagunsont un mélange des eaux océaniques apportées pmarées et des eaux douces apportées par l’oued Drà l’est, et du canal du Nador, au sud. Le remplisset la vidange de la lagune se font par l’intermédiad’un réseau de chenaux permanents : le chenal pr
s
Fig. 1. Présentation du site et localisation des stations de prélèvement de la macrofaune et du sédiment. Les lettres deA à R désignent les stationintertidales, les chiffres de1 à 15 les stations subtidales.980 H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990
4) indique
Tableau 1Définition des indices biotiques (IB 0 à 6) en fonction des pourcentages des groupes écologiques (I à V). Un double indice (0–2 ou 0–une importance équivalente de deux groupes écologiques[6]Groupes écologiques Indices biotiques
0 0–2 2 0–4 4 6
I >40% 20–40% 20–40% 20–40% <20%III 20–40% 20–40% >40% <20% 20–40% <20%IV <20% <20% <20% 20–40% >40% 20–40%V >40%
t les
des
di-
las’efs oùnaorté
lise
desrin-
) etns
ne
(1 à’un
lesen-
mo-
pré-s enaireté
sur
re,er-
ni-dé-
rfaces l’unnant
omi--ents
du
aluédices
épar-dontentom-s
s de
s :
nt lese desva-
g dessontaux Iocali-zone
pal (chenal I), les chenaux secondaires (chenal II) echenaux tertiaires (chenal III) (Fig. 1). Les eaux conti-nentales représentent, en moyenne annuelle, 1 à 2%eaux qui transitent par la lagune[11]. Les températuredes eaux de la lagune varient de 13 à 15◦C en hiver etde 27 à 28◦C en été. Deux principaux ensembles sémentaires sont reconnus dans la lagune[12]. Le premier,sableux, est d’origine marine. Il est lié à l’action dehoule et des courants de marée et la sédimentationfectue essentiellement pendant le flot, dans les zonele niveau énergétique reste élevé. Le deuxième, deture envasée, est d’origine continentale et est transppar l’oued Drader et le canal du Nador. Il se locadans les zones à faible énergie.
2.2. Échantillonnage et analyses des prélèvements
L’échantillonnage de la macrofaune benthiquesubstrats meubles a été réalisé en avril 1994 (ptemps), juillet 1994 (été), octobre 1994 (automnejanvier 1995 (hiver). En zone intertidale, 18 statio(A à R) (Fig. 1) ont été échantillonnées à l’aide d’ubêche, sur une surface de 0,25 m2 jusqu’à une pro-fondeur de 20 cm. En zone subtidale, 15 stations15) ont été échantillonnées à l’aide d’une drague dmodèle équivalent à celui employé par Picard[13]. Letamisage a été effectué sur une maille de 1 mm2. Le re-fus du tamis est fixé au formol à 8%. Au laboratoire,refus sont triés et la macrofaune isolée, identifiée etsuite comptée. La diversité est exprimée suivant ledèle DiMo (Diversity Monitoring) de Quinghong[14],qui tient compte de la richesse spécifique(Log2 S), dela diversité(H ′) et de l’équitabilité(J ′).
Les échantillons de sédiment ont été égalementlevés. Les fractions sédimentaires ont été identifiéeutilisant les principes de classification biosédimentde Chassé et Glémarec[15]. La matière organique a éestimée par la méthode de perte au feu.
L’étude de la biodiversité fonctionnelle se basela classification adoptée par Grall et Glémarec[16],qui repose sur la nature et l’origine de la nourrituson mode de collecte et le microhabitat exploité : h
s
-
-
bivores (H), nécrophages (N), détritivores (Dt), carvores (C), microbrouteurs (µB), suspensivores (S),posivores de surface (Ds) et déposivores de sub-su(Dss). Chaque espèce récoltée a été classée dandes groupes trophiques indiqués ci-dessus, en preen considération les données de la littérature[16–25].
Dans chaque groupe trophique, les espèces dnantes (abondance totale> 1%)[26] et les espèces communes (présentes dans plus de 50% des prélèvemtemporels)[27] sont utilisées comme indicateursgroupe.
L’état de dégradation des peuplements a été évpar la méthode des groupes écologiques et des inbiotiques[22] et par la méthode de Borja et al.[28].Dans les deux cas, les différentes espèces sont rties en cinq groupes dits « groupes écologiques »,les réactions respectives vis-à-vis de l’enrichissemdu milieu en matière organique sont considérées cparables (GE I, II, III, IV et V). La définition des indicebiotiques (IB) repose sur les proportions respectivechacun des groupes écologiques (Tableau 1) [22] et [6]et sur le calcul d’un coefficient biotique (Tableau 2)[28].
3. Résultats
3.1. Habitat sédimentaire
Trois catégories sédimentaires sont identifiéesables (pélites< 10%), sables vaseux (10%< pélites<30%), vases sableuses (30%< pélites< 80%) et vases(pélites> 80%).
Les sables, sables vaseux et vases sableuses sotrois types sédimentaires rencontrés dans la lagunMerja Zerga (Tableau 3). Dans la zone intertidale, lesables sont répartis le long du chenal I. Les sablesseux et les vases sableuses se rencontrent le lonchenaux I et II. Dans la zone subtidale, les sablesmieux représentés et se situent au niveau des chenet II. Les sables vaseux et les vases sableuses se lsent dans les chenaux I et II. Les sédiments de la
H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990 981
nthique
aire durant la
Tableau 2Définition des indices biotiques et des indices biotiques d’après Borja et al. (2000)
Degré de pollution Coefficient biotique Indice biotique GE dominant État de santé du peuplement be
Non pollué 0,0 < BC � 0,2 0 I NormalNon pollué 0,2 < BC � 1,2 1 III AppauvriLégèrement pollué 1,2 < BC � 3,3 2 IV–V DéséquilibréMoyennement pollué 3,3 < BC � 4,5 3 V Transition vers polluéMoyennement pollué 4,5 < BC � 5,0 4 Azoïque PolluéFortement pollué 5,0 < BC � 5,5 5 Transition vers très polluéFortement pollué 5,5 < BC � 6,0 6 Fortement polluéExtrêmement pollué Azoïque 7 Azoïque
Tableau 3Caractérisation de l’habitat sédimentaire en fonction des saisons. Les stations indiquées en gras n’ont pas changé de nature sédimentpériode d’étude. Les lettres et les chiffres correspondent respectivement aux stations intertidales et subtidales
Saison Types sédimentaires Stations Médianemin–max
Pélites (%)min–max
Matière organiquemin–max
Avril 1994 Sables A, B, C, D, E, F, H, O 180–340 0,19–3,86 1,46–1,921, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12,13, 15 150–380 0,25–4,89 1,44–2,16
Sables vaseux I, L, N 115–205 11,83–27,40 2,52–3,8910, 11 120 18,20–20,9 3,87–6,74
Vases sableuses G, J,K, M, P, Q, R <63–120 36,75–73,42 3,89–8,905, 14 <63–110 39,21–84,6 9,87–14,60
Juillet 1994 Sables A, B, C, D, E, F, H, I, O 160–370 0,45–4,02 1,23–2,031, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15 180–950 0,71–15,1 1,48–3,60
Sables vaseux G, N, Q 115–150 17,49–34,06 3,25–5,187, 9, 10, 11 135–215 1,39–37,1 2,35–4,91
Vases sableuses J,K, L, M, P, R <63–120 31,90–72,91 5,86–12,605, 12, 14 105–210 21,40–42,8 7,13–12,20
Octobre 1994 Sables A, B, C, D, F, H, I, O 220–325 0,66–5,32 1,52–2,081, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12,13, 15 150–500 0,52–8,17 1,18–2,72
Sables vaseux E, G, L, N, Q 120–205 12,32–28,54 2,48–5,798, 10 125–140 10,50–13,20 3,00–3,04
Vases sableuses J,M, K, P, R <63–120 46,73–74,61 6,20–12,235, 11, 14 <63–115 42,20–70,50 7,36–13,30
Janvier 1995 Sables A, B, C, D, E, F, H, I, O 190–425 0,65–6,35 1,49–2,021, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 15 140–800 0,96–5,27 1,10–2,11
Sables vaseux G, L, N 120–150 18,93–23,16 3,77–5,3814 110 34,6 6,13
Vases sableuses J,K, M, P, Q, R <63–120 32,77–71,73 4,66–10,42– – – –
terti-
n-uéstureerti-desubti-13,staclusna-x) etaire
e sé-ases
riantplus
dans
s 132
-sse
subtidale sont plus grossiers que ceux de la zone indale.
Selon l’évolution temporelle de la nature sédimetaire, deux groupes de stations peuvent être distingLe premier groupe renferme des stations dont la nasédimentaire est restée stable. Il s’agit en zone intdale des stations A, B, C, D, F, H et O (sables),stations K, M, P, R (vases sableuses). En zone sdale, ce groupe renferme les stations 1, 2, 3, 4, 6,15 (sables). Le deuxième groupe est constitué detions dont la nature sédimentaire a changé. Sont indans ce groupe les stations intertidales E, I, L, N (ture sédimentaire variant de sables à sables vaseules stations subtidales 7, 8, 9, 10 (nature sédimen
.
-
t
variant de sables à sables vaseux), 5, 11, 12 (naturdimentaire variant de sables à sables vaseux et à vsableuse) et la station 14 (nature sédimentaire vade sable vaseux à vase sableuse). Logiquement, lesfortes valeurs en matière organique totale se situentles sédiments les plus envasés.
3.2. Caractéristiques biocénotiques des habitats
Cent quarante-sept taxons sont présents dans leprélèvements biologiques réalisés (Tableau 4). Le mo-dèle DIMO (Fig. 2) permet d’illustrer de manière synthétique l’évolution spatiale et temporelle de la richespécifique(Log2 S), de la diversité(H ′) et de l’équita-
982 H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990
oupes écolo-nt les espècesnvier 1995.
Tableau 4Abondances (en %) des espèces dans différents habitats sédimentaires de Merja Zerga ainsi que leur groupes trophiques (CT) et grgiques (GE). Les espèces dominantes et régulières sont respectivement soulignées et suivies du symbole †. Les astérisques indiquenouvellement signalées pour le site. Les chiffres 4, 7, 10 et 1 correspondent respectivement à avril 1994, juillet 1994, octobre 1994 et jaLes abréviations utilisées pour les CT et GE sont expliquées dans le texte
984 H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990
Tableau 4 (Suite)
aointtenan
;s) ;
na--ngeilitédes
où
ter-mens vaationturé
des
nette-terti-risents sa-illettalessesbles,vril
dede 5ueéle-
ute-mi-
veaus (S)nts.
iveaues va-usessur-aseuxiveauLo-aug-rfaceone(
iqueles,
Fig. 2. Représentation simultanée de la richesse spécifique(Log2 S),de l’indice de Shannon(H ′) et de l’équitabilité (angle formé par ldroite reliant l’origine et chacun des points « habitats »). Chaque preprésente le barycentre du nuage des points « habitats » apparà la même catégorie sédimentaire. Chiffres 4= avril 1994, 7= juillet1994, 10= octobre 1994, 1= janvier 1995 ; S= sables (carreaux)SV = sables vaseux (triangles) ; VS= vases sableuses (losangefigurés pleins= zone intertidale ; figurés clairs= zone subtidale.
bilité. Les peuplements intertidaux montrent une dymique de type 2 (typeeveness), où les modifications observées dans la diversité sont en rapport avec les chaments de la richesse spécifique, tandis que l’équitabreste stable. Les peuplements subtidaux ont à la foisrichesses spécifiques plus élevées et des indicesQ plusforts, et montrent une situation de type 4 « non type »les trois paramètres changent.
En termes d’habitats sédimentaires de la zone intidale, les vases sableuses hébergent des peupleplus riches et mieux structurés que ceux des sableseux et des sables. En zone subtidale, c’est la situinverse, avec des sables plus riches et mieux strucque les sables vaseux et vases sableuses.
L’évolution temporelle des peuplements au seinchaque habitat sédimentaire (Fig. 3a et b) montre que le
t
-
ts-
s
richesses spécifiques et abondances totales sontment supérieures pour la zone subtidale. En zone indale, les peuplements des sables vaseux se caractépar un maximum en octobre ; les sables et les vasebleuses montrent des maxima respectivement en juet en janvier. En zone subtidale, les abondances tosont maximales entre juillet et octobre ; les richesspécifiques sont maximales en octobre pour les saen juillet et octobre pour les sables vaseux et en apour les vases sableuses.
3.3. Structure trophique
Pour un même habitat sédimentaire, le nombregroupes trophiques qui coexistent est en moyenne(Tableau 5). Le nombre de groupes trophiques ainsi qleurs abondances relatives sont en moyenne plusvées en zone subtidale qu’en zone intertidale. Tofois, seulement un ou deux groupes trophiques donent (abondance relative supérieure à 25%) au nid’un habitat sédimentaire donné. Les suspensivoreet/ou les déposivores de surface (Ds) sont dominaLes suspensivores prédominent généralement au ndes sables et occasionnellement au niveau des sablseux en octobre (zone intertidale) et des vases sableen juillet (zone subtidales). Les déposivores de subface sont mieux représentés au niveau des sables vet des vases sableuses et occasionnellement au ndes sables, tout particulièrement au mois d’octobre.calement et/ou temporairement, d’autres groupesmentent leur dominance : les déposivores de subsu(Dss), les détritivores (Dt) et les carnivores (C) en zintertidale, et les nécrophages (N) en zone subtidaleTa-bleau 5).
La richesse spécifique dans chaque groupe trophvarie, en zone intertidale, entre 2 et 11 pour les sab
H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990 985
aire pour les1995. S
Fig. 3. Évolution temporelle des abondances totales et richesses spécifiques totales en fonction des saisons et de l’habitat sédimentzones intertidale et subtidale. Les chiffres 4, 7, 10 et 1 correspondent respectivement à avril 1994, juillet 1994, octobre 1994 et janvier=sables ; SV= sables vaseux et VS= vases sableuses.
poue to1 et
va-s es
s aus
, dées este
le-
desparpar
0)soitdenes to-mo-uxents
etet
bio-
cinqrap-uertypes, der les
les
entre 1 et 8 pour les sables vaseux et entre 1 et 10les vases sableuses. En zone subtidale, le nombrtal d’espèces par groupe trophique fluctue entre17 pour les sables, entre 1 et 9 pour les sablesseux et entre 1 et 14 pour les vases sableuses. Lepèces qui sont à la fois dominantes et communesein de chaque habitat (Tableau 4) se répartissent dansix groupes trophiques (carnivores, suspensivoresposivores de surface et de subsurface, nécrophagdétritivores). Leur nombre par groupe trophique refaible, puisqu’il varie entre 0 et 4. Il s’agit essentielment du bivalve suspensivoreCerastoderma eduleet dubivalve déposivore de surfaceScrobicularia plana, quisont numériquement les mieux représentés.
3.4. Bioévaluation des structures benthiques
La Fig. 4 illustre les variations des abondancesgroupes écologiques GI à GV par type d’habitat etsaison. Les valeurs des indices biotiques obtenues à
r-
-
-t
-
tir des modèles de Hily (1984) et Borja et al. (200ne montrent, ni périodicité, ni saisonnalité, que cepour l’intertidal ou le subtidal, tandis qu’aucun étatpollution évident n’y est défini. Cependant, on note ularge dominance des espèces du groupe III (espècelérantes) dans tous les habitats sédimentaires. Ledèle de Hily [22] donne des indices biotiques égaà 2 pour tous les types sédimentaires. Les coefficibiotiques (BC), calculés à partir du modèle de Borjaal. [28], varient entre 1,42 et 3 en zone intertidaleentre 1,87 et 2,92 en zone subtidale. Les indicestiques qui en résultent sont partout égaux à 2 (Fig. 4).La prise en compte de la dominance respective desgroupes écologiques permet de mieux visualiser lesports entre les différentes situations. Il faut remarqque les taux de matière organique varient selon lede sédiment, passant de 1,6 à 2,1 pour les sables fin3,1 à 6,1 pour les sables vaseux et de 6,4 à 12,2 pouvases (Fig. 4). Par ailleurs, pour un même sédiment,
986 H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990
nthiques desen
Tableau 5Abondance relative et richesse spécifique totale des différents groupes trophiques par habitat et par saison pour les peuplements bezones intertidale et subtidale. 4= Avril 94 ; 7 = juillet 1994 ; 10= octobre 94 ; 1= janvier 95. Dans chaque cellule, l’abondance est le chiffrehaut à gauche, le nombre d’espèce est le nombre en bas à droite
u’en
ua-despoutal, onsonue,tro-
en-s, lezoneéjàcôterga,ob-lieu,enton--aletro-
valeurs sont en moyenne plus élevées en subtidal qintertidal.
4. Discussion
Les lagunes, milieux de transition à fortes flucttions environnementales, comportent naturellementespèces tolérantes (rassemblées dans le groupe IIIles calculs d’indices biotiques), mais le nombre tod’espèces y est faible à modéré. Dans ce contextepeut considérer que les peuplements à Merja Zergaparticulièrement riches au niveau diversité spécifiqmais aussi fonctionnelle. En effet, les huit groupes
r
t
phiques coexistent au sein d’un même habitat sédimtaire. Par ailleurs, au sein des groupes trophiquenombre total d’espèces recensées est plus élevé ensubtidale qu’en zone intertidale. Cette situation a dété notée dans l’estuaire du Bou Regreg sur cetteatlantique marocaine 120 km au sud de Merja Zemais elle est originale par rapport à la plupart desservations réalisées ailleurs dans ce type de mipour lesquels les milieux subtidaux sont globalemplus pauvres qu’en zone intertidale : estuaire de Mdego [29], lagune d’Arcachon[30], estuaire de l’Escaut [31]. C’est aussi au niveau de la zone subtidque les abondances dans les principaux groupes
H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990 987
e l’indices 4, 7, 10
Fig. 4. Pourcentages des groupes écologiques (I à V) de la matière organique totale (MOT) et de l’indice biotique (modèle d’Hily) dbiotique (BC) et de l’AMBI de Borja et al. par habitat sédimentaire et par saison au niveau des zones intertidale et subtidale. Les chiffreet 1 correspondent respectivement à avril 1994, juillet 1994, octobre 1994 et janvier 1995. S= Sables ; SV= sables vaseux et VS= vases.
oresen
s dos élee ceque-
uvaol-
onségieEn
fac-ues,s rege-
déro-
voreuplence
rgaer-
trôle-sités
oces-Ceeu
lière-peu-
ègregu-cestionsqueent
mi-hiqueivi-es se-t parar len’ar-onstion
erga’es-éris-aires,
phiques (carnivores, déposivores de surface, détritivet suspensivores) sont les plus élevées. Les peuplemapparaissent donc mieux structurés en subtidal.
Les déposivores de surface et les suspensivoreminent respectivement dans les sédiments à teneurvées et à teneurs faibles en éléments fins. Chacun ddeux groupes sont très largement dominés numériment par une espèce de Bivalve,Scrobicularia plana,pour les déposivores, etCerastoderma edule, pour lessuspensivores. Ce sont deux espèces euryèces pocoloniser plusieurs types sédimentaires. Ces deux Mlusques montrent des stratégies démographiques cdérées comme un ajustement permanent des stratde reproduction dans un environnement variable.effet, aux fluctuations régulières et élevées desteurs édaphiques, hydrologiques et hydrodynamiqles deux populations répondent en développant decrutements quasi continus, en relation avec un rallonment de la période de reproduction[7].
La dominance relative des suspensivores ou desposivores de surface résulterait de l’action de l’hyddynamisme et de la granulométrie[19,20,22–25,32,33].De manière générale, la prépondérance des déposide surface est généralement observée dans les pements côtiers et lagunaires se trouvant sous l’influed’apports sédimentaires continentaux[19,34] ou biendans des zones intertidales[35].
La diversité fonctionnelle observée à Merja Zeconstitue un témoin de la disponibilité et de la div
ts
--s
nt
i-s
-
-
s-
sité des ressources trophiques. Les prédateurs conraient les autres groupes en maintenant leurs denrespectives au-dessous d’un seuil autorisant des prsus d’exclusion compétitive favorisant la diversité.concept de Gause[36] a été largement évoqué en miliintertidal rocheux[37], en milieu abyssal[38], pour lesfonds de maërl[16] et pour les herbiers de Zostères[39].
La prise en compte des espèces présentes régument (c’est-à-dire des espèces constantes) dans leplement, même si elles sont de faible abondance, intles particularités environnementales des milieux lanaires, limitant considérablement le nombre d’espèsuffisamment adaptées pour développer des populaabondantes. C’est ainsi que si la richesse spécifidans les différents groupes trophiques est relativemélevée, le nombre d’espèces qui sont à la fois donantes et communes au sein de chaque groupe tropreste faible. L’hypothèse explicative est que les inddus de ces espèces régulières de faibles abondancraient issus des flux de larves émises régulièremenles populations extérieures à la lagune, introduites pjeu des courants de marée dans la lagune, mais quiriveraient pas à y constituer de véritables populatipérennes. Les résultats montrent ainsi que l’organisatrophique des peuplements benthiques de Merja Zn’est conditionnée que par un nombre restreint dpèces qui dominent quantitativement. Cette caracttique, assez classique dans les peuplements lagun
988 H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990
peu
t enrousubdece
. Endesôtiern
ssenrbi-éva-adesti-ancequis et
abonDanutés
voreuble
es dtion,lle-
n eninsi
al.a-
de. Ceanceden-. Auntebilque
ice.nor
finiunendéêtre
abi-âtre
les
eourque,extedese que,5)c une or-se à
ultatstatspara-s dest un
s in-desMOTiers
nspar-
une0%lités in-e deper-deétéhi-dedanséta-tatca-itionse ré-pècestionnri-
plu-type
s ceuant’étatue.
t leur’at-c àbio-rins
tend à les rapprocher, en termes de structure, desplements marins en milieu perturbé[40].
La faible représentation en nombre d’espèces eabondance de certains groupes trophiques (microbteurs, herbivores et déposivores de subsurface (entidal essentiellement)) tend à affaiblir la résistancela structure fonctionnelle des peuplements. Danscontexte il y a dans la lagune une réelle menaceeffet l’eutrophisation, reconnue comme étant l’unemenaces majeures pour les écosystèmes marins cà l’échelle du globe[41], entraîne dans la lagune udéveloppement de macrophytes, entéromorphes etiellement, qui ne peut pas être contrôlé par les hevores. Une très faible proportion de ces algues estcuée en mer ouverte au jusant. Ces algues se dégrdonc majoritairement sur place, les détritivores contuant alors un des seuls points potentiels de résistde la communauté. De même, les microbrouteurs,se nourrissent majoritairement de microphytobenthodes très jeunes algues macrophytes, sont très peudants et ne peuvent donc contrôler ce processus.une étude de la structure trophique des communamacrobenthiques des côtes portugaises, les herbireprésentaient 23% de l’abondance des habitats melagunaires et 45% de l’habitat estuarien[42]. L’atoutmajeur de la lagune pour résister à ces phénomèn« marées vertes », et plus largement à l’eutrophisaest donc très probablement le fort taux de renouvement journalier des eaux, qui permet une évacuatiomer d’une majeure partie des sels nutritifs, limitant al’induction de la production primaire sur place.
Les deux méthodes de bioévaluation (Borja et[28] et Hily [22]) conduisent à des résultats comprables. L’avantage du modèle de Borja et al.[28], utili-sant un calcul de l’indice biotique issu d’une mesurevaleurs discrètes, rend cette méthode plus précisependant, la représentation graphique de la dominrelative des différents groupes est plus sensible et itifie plus précocement les épisodes de perturbationniveau méthodologique, l’approche la plus performaserait donc de compléter le calcul de BC et de l’Ampar cette représentation graphique, qui est en quesorte l’explication des variations observées de l’indDans la lagune, en absence de zones en conditionmale (IB 0), aucun état de pollution évident n’est dé(IB 4 et/ou 6). Les peuplements benthiques de la lagmontrent des états de déséquilibre, avec une préporance d’espèces tolérantes (groupe III) qui sembleune caractéristique naturelle des milieux à forte varilité physicochimique hébergeant des espèces saumtolérant bien des surcharges en matière organique[16,28]. La comparaison des indices, en relation avec
-
--
s
-
nt
-s
ss
e
-
-
-
s
taux de matière organique (Fig. 4), met bien en évidencle fait que les indices biotiques, qui ont été définis prévéler le niveau de surcharge en matière organidoivent impérativement être replacés dans leur contsédimentaire précis. Il est en effet normal de trouvertaux de matière organique plus élevés dans une vasdans un sable. L’indice 2 (et un BC variant de 2,1 à 2peut donc logiquement se trouver dans un sable avesédiment contenant seulement 1,5 à 2,1% de matièrganique totale, tandis qu’il est associé dans une vades taux de matière organique de 9 à 12%. Ces réssoulignent également l’importance de disposer d’éde référence non perturbés, avec des valeurs desmètres de l’environnement couplées aux paramètrepeuplements pour chaque type sédimentaire. C’esélément essentiel pour une utilisation pertinente dedices biotiques. Ainsi, dans l’estuaire de Montego,vases sables eutrophes présentaient des taux dede 3,7%, alors qu’ils étaient de 6,8% dans des herbnon perturbés[43]. Dans les milieux lagunaires, dalesquels la marée ne peut évacuer efficacement lesticules fines, la matière organique peut constituerfraction très importante du sédiment, jusqu’à 25 ou 3en poids sec[44]. De même, l’absence de saisonnaet la relative stabilité observée dans les valeurs dedices biotiques suggèrent que le système benthiqula lagune de Merja Zerga n’est pas profondémentturbé, malgré le niveau 2 de l’indice. Cette stabilitéla structure trophique en milieu lagunaire a déjàsoulignée dans les milieux à faible niveau d’eutropsation[45]. Cependant, bien que l’utilité de la méthodes groupes écologiques et des indices biotiquesla bioévaluation des structures benthiques soit bienblie, son utilisation pour une évaluation directe de l’éde santé d’un milieu lagunaire devra intégrer la fortepacité naturelle des espèces à supporter des condenvironnementales très variables. Ces capacités dsistance aux différents types de stress que ces esont développées les rendent moins sensibles à l’acdes perturbations anthropiques, en général, et à l’echissement en matière organique, en particulier. Lapart des espèces dominantes naturellement dans cede milieu sont « tolérantes », et donc classées dangroupe écologique, les indices qui en découlent risqdonc de conduire à des diagnostics surévaluant lréel d’enrichissement organique du milieu benthiqDe plus, les caractéristiques sédimentaires perdenrôle déterminant à mesure que l’influence marine sténue[34,46,47]. Des efforts de recherche sont donmener dans le futur pour mieux ajuster ces indicestiques, qui ont été mis au points sur les milieux macôtiers, aux milieux estuariens et lagunaires.
H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990 989
rgapess lenus
t paérer
enturelesireue.po-
ce àble
aphy
Ne-80.ss-n of
on
ofe-helf
ntsBiol.
laypatioMa-
onntalga,
tur-Eco-
orth
l at-a-
x-1,
tairearo-77)
rines, Rec
m-34
ationcéa-
re-Mi-
uesce),99.po-17
gesare
que5–
ires
uxté de
ent
29
uc-res-fa,Es-
ras,n yds.),r. 11
côtepacti-
inin),
lishan00)
a-es-3)
nti-s inate
Ver-s: es-NW
L’étude de la macrofaune benthique de Merja Zesouligne l’intérêt de croiser les approches par grouécologiques avec celle des groupes trophiques danprogrammes de suivi écologique. Les résultats obteont révélé que les peuplements benthiques ne sonprofondément perturbés et semblent donc bien tolles pressions anthropiques actuelles. Le renouvellemrégulier des eaux de Merja Zerga, permis par l’ouverde la lagune sur l’océan, est un atout naturel limitantproblèmes d’eutrophisation liés à la production primaet l’accumulation sur place de la matière organiqNéanmoins, il serait nécessaire d’intégrer cette comsante dans le cadre d’un programme de surveillanlong terme du site pour parvenir à une gestion duraet à une bonne conservation du milieu.
Références
[1] B. Kjerfve, Coastal Lagoon Processes, Elsevier OceanogrSeries, vol. 60, Elsevier, Amsterdam, 1994.
[2] R.S.K. Barnes, Coastal Lagoons: The Natural History of aglected Habitat, Cambridge University Press, Cambridge, 19
[3] R. Reizopoulou, M. Thessalou-Legaki, A. Nicolaidou, Assement of disturbance in Mediterranean lagoons: an evaluatiomethods, Mar. Biol. 125 (1996) 189–197.
[4] G. Stora, A. Arnoux, Effects of large freshwater diversionsbenthos of a Mediterranean lagoon, Estuaries 6 (1983) 11.
[5] H. Le Bris, M. Glémarec, Marine and brackish ecosystemssouth Brittany (Lorient and Vilaine Bays) with particular refrence to the effect of the turbidity maxima, Estuar. Coast. SSci. 42 (1996) 737–753.
[6] A. Afli, M. Glémarec, Fluctuations à long terme des peuplememacrobenthiques dans le Golfe du Morbihan (France), Cah.Mar. 41 (2000) 67–89.
[7] H. Bazairi, La faune macrobenthique de la lagune de MouBousselham : Structure des peuplements et successions stemporelles, thèse, université Mohammed-V–Agdal, Rabat,roc, 1999.
[8] H. Bazairi, A. Bayed, M. Glémarec, C. Hily, Spatial organisatiof macrozoobenthic communities in response to environmefactors in a coastal lagoon of the NW African coast (Merja ZerMorocco), Oceanol. Acta 26 (2003) 457–471.
[9] D.F. Boesch, Diversity, stability and response to human disbance in estuarine ecosystems, in: Proc. First Int. Congr.logy, The Hague, The Netherlands, 1974, pp. 109–114.
[10] K.R. Tenore, Macrobenthos of the Pamplico River estuary, NCarolina, Ecol. Monogr. 42 (1972) 51–69.
[11] C. Carruesco, Genèse et évolution de trois lagunes du littoralantique depuis l’holocène : Oualidia, Moulay Bousselham (Mroc) et Arcachon (France), thèse d’État, université BordeauFrance, 1989.
[12] J.-C. Bidet, C. Carruesco, B. Gensous, Un milieu sédimenactuel : la lagune de Moulay-Bou-Salham (côte atlantique mcaine), Bull. Inst. Géol. Bassin d’Aquitaine, Bordeaux 22 (19189–230.
[13] J. Picard, Recherches qualitatives sur les biocoenoses mades substrats meubles dragables de la région marseillaiseTrav. St. Marine Endoume 52 (1965) 1–160.
s
s
t
-
.
[14] L. Quinghong, A model for species diversity monitoring at comunity level and its application, Environ. Monitor. Assess.(1995) 271–287.
[15] C. Chassé, M. Glémarec, Principes généraux de la classificdes fonds pour la cartographie bio-sédimentaire, J. Rech. Onogr. 1 (1976) 1–18.
[16] J. Grall, M. Glémarec, Biodiversité des fonds de maerl en Btagne : approche fonctionnelle et impacts anthropiques, Vielieu 47 (1997) 339–349.
[17] A. Afli, Variabilité temporelle des peuplements macrobenthiqde la partie orientale du golfe du Morbihan (Bretagne, Franthèse, université de Bretagne occidentale, Brest, France, 19
[18] K. Fauchald, P.A. Jumars, The diet of worms, a study oflychaete feeding guilds, Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev.(1979) 193–284.
[19] D. Maurer, L. Waltig, W. Leathem, P. Kiener, Seasonal chanin feeding types of estuarine benthic invertebrates from Delawbay, J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 36 (1979) 125–155.
[20] G. Bachelet, Données préliminaires sur l’organisation trophid’un peuplement benthique marin, Vie Milieu 31 (1981) 20213.
[21] Y. Luca, R. Roy, Sur la terminologie des régimes alimentades animaux, Bull. Soc. Zool. France 108 (1983) 347–363.
[22] C. Hily, Variabilité de la macrofaune benthique dans les miliehypertrophiques de la rade de Brest, thèse d’État, universiBretagne occidentale, Brest, France, 1984.
[23] J.-C. Dauvin, Structure et organisation trophique du peuplemdes sables grossiers àAmphioxus lanceolatus–Venus fasciatadela baie de Morlaix (Manche occidentale), Cah. Biol. Mar.(1988) 163–185.
[24] A. Sanchez-Mata, J. Mora, L.M. Garmendia, M. Lastra, Estrtura trofica del macrozoobentos submareal de la ria de ABentazos. I: Composicion y distribucion, in: A. Perez-RuzaC. Marcos-Diego (Eds.), Estudios del bentos marino, Publ.pec. Inst. Esp. Oceanogr. 11 (1993) 33–40.
[25] J. Tena, R. Capaccioni-Azzati, F.J. Torres-Gavila, R. PorAnélidos poliquetos del antepuerto de Valencia: distribuciocategorias troficas, in: A. Perez-Ruzafa, C. Marcos-Diego (EEstudios del bentos marino, Publ. Espec. Inst. Esp. Oceanog(1993) 15–20.
[26] J. Soyer, Bionomie benthique du plateau continental de lacatalane française. III. Les peuplements de copépodes harcoïdes (Crustacea), Vie Milieu 21 (1970) 337–511.
[27] J. Junoy, L.M. Viéitez, Macrozoobenthic community structurethe Ria de Foz, an intertidal estuary (Galicia, northwest SpaMar. Biol. 107 (1990) 329–339.
[28] A. Borja, J. Franco, V. Pérez, A marine biotic index to estabthe ecological quality of soft bottom benthos within Europeestuarine and coastal environments, Mar. Pollut. Bull. 40 (201100–1114.
[29] J.C. Marques, L.B. Rodrigues, A.J.A. Nogueira, Intertidal mcrobenthic communities structure in the Mondego estuary (Wtern Portugal): reference situation, Vie Milieu 43 (2–3) (199177–187.
[30] G. Bachelet, X. de Mountaudouin, J.-C. Dauvin, The quatative distribution of subtidal macrozoobenthic assemblageArcachon bay in relation to environmental factors: a multivarianalysis, Estuar. Coast. Shelf Sci. 42 (1996) 371–391.
[31] T. Ysebaert, P.M.J. Herman, P. Meirec, J. Craeymeersch, H.beeke, C.H.R. Heip, Large-scale spatial patterns in estuarietuarine macrobenthic communities in the Schelde estuary,Europe, Estuar. Coast. Shelf Sci. 57 (2003) 335–355.
990 H. Bazairi et al. / C. R. Biologies 328 (2005) 977–990
al-258.or-
ure,
thehine,
re ofts ofb.,
ms,
use
in972)
drassSci.
ds.),Ol-
phicoast.cta
af-lagesar.
dro-ues,
ea-blagestion,
e la986,
rs auèse,
[32] S.H.L. Sanders, Benthic studies in Buzzards Bay. I: Animsediment relationships, Limnol. Oceanogr. 3 (3) (1958) 245–
[33] D.C. Rhoads, D.K. Young, The influence of deposit-feedingganisms on sediment stability and community trophic structJ. Mar. Res. 28 (1970) 151–177.
[34] W.J. Wolff, The estuary as a habitat. An analysis of data onsoft-bottom macrofauna of the estuarine area of the rivers RMeuse and Scheldt, Zool. Verh. 126 (1973) 1–242.
[35] R.B. Whitlatch, Seasonal changes in the community structuthe macrobenthos inhabiting the intertidal sand and mud flaBarnstable harbor, Massachusetts, Biol. Bull., Mar. Biol. LaWoods Hole 152 (2) (1977) 275–294.
[36] G.F. Gause, The Struggle of Existence, Williams and WilliaHafnor, Baltimore/New York, 1934.
[37] R.T. Paine, Food web complexity and species diversity: itsand measure, Am. Nat. 100 (1966) 65–75.
[38] P.K. Dayton, R.R. Hessler, Role of biological disturbancemaintaining diversity in the deep sea, Deep-Sea Res. 19 (1199–208.
[39] C. Hily, M. Bouteille, Modification of the specific diversity anfeeding guilds in an intertidal sediment colonized by an eelgmeadow (Zostera marina) (Brittany, France), C. R. Acad.Paris, Ser. III 322 (1999) 1121–1131.
[40] J. Blondel, Biogéographie et écologie, Masson, Paris, 1979.
[41] J.S. Gray, Eutrophication in the sea, in: G. Colombo et al. (EMarine Eutrophication and Population Dynamics, Olsen &sen, Fredensborg, Danemark, pp. 3–13.
[42] D. Boaventura, L.C. da Foncesaca, C. Teles-Frreira, Trostructure of macrobenthic communities on the Portuguese cA review of lagoonal, estuarine and rocky littoral habitats, AOecol. 20 (4) (1999) 407–415.
[43] P.G. Cardosoa, M.A. Pardal, A.I. Lillebø, S.M. Ferreira, D. Rfaelli, J.C. Marques, Dynamic changes in seagrass assembunder eutrophication and implications for recovery, J. Exp. MBiol. Ecol. 302 (2004) 233–248.
[44] J.-P. Perthuisot, O. Guélorget, Morphologie, organisation hylogique, hydrochimie et sédimentologie des bassins paraliqVie Milieu 42 (2) (1992) 93–109.
[45] G. Bachelet, X. de Montaudouin, I. Auby, P.-J. Labourg, Ssonal changes in macrophyte and macrozoobenthos assemin three costal lagoons under varying degrees of eutrophicaJ. Mar. Sci. 57 (2000) 1495–1506.
[46] B. Robineau, Les peuplements benthiques de l’estuaire dLoire, thèse, université de Bretagne occidentale, Brest, 1330 p.
[47] H. Le Bris, Fonctionnement des systèmes benthiques côtiecontact d’estuaires : la rade de Lorient et la baie de Vilaine, thuniversité de Bretagne occidentale, Brest, 1988, 273 p.


















![[2015] „L'État, c'est le droit!“ Zur Aktualität der Staatslehre Hans Kelsens im Angesicht sich wandelnder Staatsgewalt](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63259acec9c7f5721c022b24/2015-letat-cest-le-droit-zur-aktualitaet-der-staatslehre-hans-kelsens.jpg)