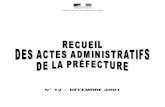L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
Transcript of L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
Luiz Eduardo Abreu
Programa de Mestrado e Doutorado em Direito. Centro Universitario de Brasilia, SEPN 707/907, Campus do UniCEUB, bioco Ill, sala 305, 70790-075, Brasilia OF- Brésil.
• Résumé Cet article examine les rapports entre le droit et la politique au Brésil. Pour comprendre ces rapports, il faut supposer un système fondé sur l'incohérence, la divergence et la distanciation entre ces deux champs sociaux. Ainsi, en effet, d'un côté, il y aurait les instruments normatifs et le discours institutionnel, où le droit se dit héritier d'une tradition européenne; et, de l'autre, les pratiques des coulisses du pouvoir, et parmi celles-ci, plus particulièrement, l'échange qui s'opère suivant le modèle du don. Cet article soutient que la rupture entre ces deux champs sociaux est le phénomène logiquement premier; c'est pourquoi, les rapports entre la norme institutionnelle et la pratique quotidienne de la politique doivent être compris comme une forme de dialogue qui les maintient, en même temps, à distance.
Don- Droit et politique- Langage- Norme juridique- Sociabilité.
• Summary State Against Society. Law and Gift in Brazil
The article's main thesis is that, in order to understand the relationship between law and politics in Brazil, one must assume a social system based on inconsistency, divergence, and distance. In the everyday life of Brazilian public institutions, two contradictory registers co-exist. One follows normative rules and a public discursive genre, which emphasizes our belonging to western values and democratie procedures; the other connects to a backstage channel where political players perceive their relationship as an exchange of gifts. This article sustains that the dialogue between those two registers is structured upon reciprocal strangeness and tension.
Gift- Language- Law and poli tics- Legal norm - Sociability.
Droit et Société 83/2013 11 137
L. E. ABREU
Sans doute est-il vrai que, dans nos sociétés contemporaines organisées autour de l'État, on ne peut comprendre le droit que par rapport à la politique. Une des notions qui justifient cette relation est la valeur mise dans la cohérence entre eux. Le droit n'établit pas seulement des normes à prétention universelle ; il représente aussi une forme de vie, une identité partagée par la plupart des citoyens. Cela ne signifie pas l'inexistence d'incohérences, d'inconsistances ou de contradictions. Au contraire, il y en aurait en toutes sociétés, mais elles y sont pensées comme dégradations de la cohérence, comme conséquences, peut -être inévitables autant que malheureuses, de la complexité de nos sociétés occidentales. La thèse de cet article est que l'on n'arrive pas, au Brésil, à déchiffrer les relations entre le droit et la politique, si l'on ne part pas de la supposition contraire : une sorte de système fondé sur l'incohérence, la divergence et la distanciation intentionnelles entre eux. Le droit se donne pour mission de conquérir notre sociabilité, de changer la manière dont les Brésiliens agissent entre eux. Dans la politique, au contraire, le droit n'est qu'un instrument qu'on utilise ou qu'on laisse tomber selon les circonstances, un détail qui sert, à la limite, à nuire à ses ennemis ou à faire des faveurs à ses amis. Il reste alors à reconnaître l'importance du don pour notre sociabilité en général, et pour la vie politique en particulier.
1. Le don et le droit Mauss considérait le don comme le fondement des sociétés qui ont précédé la
nôtre, et il y incorporait en même temps une sagesse sociale, une morale dans laquelle l'individu ne pense pas seulement à lui, mais fait usage d'un« sens aigu aussi bien de lui-même que des autres et de la réalité sociale», vers laquelle« nous voudrions voir se diriger nos sociétés», comme si le temps pouvait se retourner sur luimême et que «d'un bout à l'autre de l'évolution sociale, il n'y [eût] pas deux sagesses» I. L'expérience montre que le don, l'échange qui lie les biens, les personnes et les groupes, qui établit un droit, sans doute le plus ancien, n'a plus dans nos sociétés le même rôle qu'autrefois. Nous continuons à utiliser le don, surtout dans la vie privée. Nous restons libres de nous engager avec nos amis et nos voisins, avec qui nous souhaitons établir de bonnes relations, à condition que ces engagements n'atteignent en aucune façon le domaine public. Mais si ce type d'échange sort de la sphère privée pour atteindre les institutions du gouvernement et affecter la direction des affaires publiques, nous donnons à cet échange un autre nom, celui de corruption. Heidenheimer explique cette mentalité moderne : « Pour nous, dit- il, citoyens de l'élite occidentale, tout ce qu'on appelle corruption n'est qu'une sorte d'échange 2. » Apparemment, le développement social nous a poussés dans une direction contraire à celle que Mauss entrevoyait et même souhaitait voir se réaliser: il s'attristait de voir peu à peu s'éroder la part du don dans nos sociétés modernes, au point que sa quasi-disparition entraîne des tragédies.
l. Marcel MAUSS, Sociologie et anthropologie, Paris: PUF, coll.<< Quadrige», 2001.
2. Arnold]. HEIDENHEIMER, «Perspectives on the Perception of Corruption>>, in Arnold J. HEIDENHEIMER, Michael JOHNSON et Victor T. LE VINE (eds.), Political Corruption. A Handbook, New Brunswick: Transaction Publishers, 1989.
138 111 Droit et Société 83/2013
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
Voilà contre quoi l'exemple brésilien dans la vie sociale en général, et dans la vie politique en particulier, semble se rebeller. Nous allons présenter une configuration sociale où le don représente un mécanisme sociologique qui permet, dans les institutions publiques, non pas d'établir une sorte de corruption, mais bien de contrôler
individus. Ceux-ci, livrés à leur propre nature - selon ce que perçoivent aussi bien l'intuition empirique populaire que les Brésiliens en général-, pervertiraient le système politique. Selon cette idéologie politique, la corruption signifie que les individus ne sont pas soumis au contrôle d'un mécanisme sociologique que construit le don, en tant que système d'échange agonistique du tous contre tous (pour employer une métaphore bien appropriée). Il est vrai qu'en politique, les individus, qu'ils représentent ou non des collectivités, n'oublient jamais leurs intérêts, ni n'abandonnent leurs calculs au service de leurs objectifs, ni moins encore ne leur substituent des actions altruistes. Quand le don fonctionne, en effet, il assure le mélange d'intérêt et de désintérêt, des mots, des actions, du rituel et des votes, des propositions de loi et des fêtes, des personnes et des biens, enfin, de tout ce qui circule dans la vie politique, «même quand [ ... ] il n'y a que fiction, formalisme et mensonge social, et quand il y a, au fond, obligation et intérêt économique », pour paraphraser encore Mauss 3. Au contraire, quand ce mécanisme du don est subjugué par l'intérêt immédiat, et se transforme en un marché où l'action d'une personne politique est traitée comme une marchandise que l'on peut acheter, les conséquences en sont la tragédie collective, la crise politique, les démissions de ministres, les gros titres dans les journaux. La vie politique, au Brésil, par l'usage du don, résiste à cette transformation complète des relations entre les hommes en relations entre les hommes et les choses.
Quelle place le droit brésilien fait-il au don? La réponse du juriste est évidente et simple: il n'en fait aucune. Comme la plupart des droits occidentaux issus de la tradition romaine, notre droit fait de la distinction entre droit des personnes et droit des choses, la structure fondatrice de son savoir4. La conséquence en est une incompatibilité fondamentale entre don et droit. Au Brésil, la référence au don est implicite dans la majeure partie de la norme juridique et de la pratique judiciaire. Mais il faut savoir l'interpréter, sans se tromper sur l'apparente ignorance dont le droit fait preuve à dessein; tout se passe comme si son silence obstiné sur l'importance du don était le témoignage le plus criant d'un système social construit sur la distanciation, l'éloignement, la séparation entre le droit et l'expérience de la vie quotidienne. Ce silence ne vient donc pas de l'indifférence, mais d'une nécessité plus profonde : le droit ne peut pas reconnaître le don pour des raisons que nous ne sommes pas encore capables d'énoncer. Au Brésil, cette difficulté a des développements inattendus. Pour paraphraser Luiz T. Aragâo, l'on ne trouve pas entre le droit et la politique une « synthèse républicaine » capable de rassembler ces deux courants antinomiques dans l'espace social des grands récits de la nation 5. Au contraire, la caractéristique principale de ce système social est son « incapacité à
3. Marcel MAUSS, Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 147.
4. Nous remercions Eliardo Teles pour cette remarque.
5. Luiz Tarlei ARAGAO, « Apogeu e crise do estruturalismo », Folha de Sao Paulo, 8 septembre 1996.
Droit et Société 83/2013 111 139
L. E. ABREU
produire une articulation des différences et une totalisation du social, justement parce qu'il a vécu cette séparation ontogénique entre la domination (l'autorité, le droit) et la possession (l'immanence et la pratique)» 6. Nous y reviendrons.
Pour le moment, demandons-nous dans quel sens nous pouvons analyser les éléments de cette étrange et curieuse relation. On connaît bien le principe de la méthode sociologique selon lequel soit l'on part de l'ensemble pour expliquer les éléments (par exemple, des comportements), soit l'on reste dans un monde fragmenté que l'on n'arrive jamais à relier en un tout. Mieux encore, on n'arrive à reconstruire l'ensemble qu'à partir des représentations collectives du cadre que l'on utilise pour penser et pour se mettre en rapport avec les choses et les autres, même si, en raison des limites qui nous sont imposées par la nature de cette entreprise, il ne nous reste qu'à proposer des expressions métaphoriques, des invocations presque magiques, de fragiles intuitions 7. Les conditions objectives de la société brésilienne nous amènent à choisir la plus modeste solution, qui est de chercher, parmi les voix de notre tradition, un récit qui nous permette de penser la relation entre le don et le droit comme faisant partie d'un ensemble, même si cette relation est marquée par le silence, même s'il n'y a pas d'autres récits possibles. La formulation du problème nous fait chercher dans le droit lui-même un récit qui pourrait nous suggérer un ensemble de relations nécessaires.
Ce récit n'est pas difficile à trouver, puisqu'il est si puissant qu'on le retrouve chez les auteurs les plus différents, et qu'on peut le formuler ainsi: au commencement le récit montre chaque région livrée à son propre sort, progressivement opprimée par la guerre continuelle et permanente, parfois voilée, entre des factions opposées. Il en émerge le besoin d'un pouvoir central qui, dégagé de ces conflits, puisse redonner le sens de l'unité autour d'un projet commun, et s'oppose à l'érosion de la sociabilité livrée à son propre sort. Ainsi, pour éviter le chaos, le récit continue à contraindre les particularismes en imposant le sens de l'unité et l'universalité de la règle. L'État a donc l'ambition de réduire l'anarchie latente de la société et de modifier les comportements naturels des gens. Oliveira Vianna 8 est formel sur ce sujet: la société brésilienne, dit-il, est incapable de s'organiser par elle-même, et face à cette lacune, la tâche en revient à l'État à travers les hiérarchies qu'il impose. Tout le problème pour O. Vianna est de trouver l'organisation institutionnelle compétente. L'idée centrale de ce récit est que l'État se construit contre la société, ce qui ne justifie ni la suprématie d'une classe sur les autres, ni le maintien d'une situation d'inégalité. Ce qui justifie la construction d'un État, c'est de viser à transformer les hommes et leurs comportements. Certes, ce n'est pas le seul récit nous caractérisant en tant que société. Mais notre hypothèse est que ce récit est omniprésent dans le droit brésilien. Nous allons maintenant en présenter un exemple pour étudier ses rapports avec le don.
6. Luiz Tarlei ARAGAO, «Mère noire, tristesse blanche ''• Le discours psychanalytique, 4, 1990, p. 62 (revue de l'Association freudienne).
7. Nous pensons à Claude LÉVI-STRAUSS, «Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss», in Marcel MAuss, Sociologie et anthropologie, Paris: PUF, 1968; Louis DUMONT, Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, Paris: Gallimard, coll.<< La Bibliothèque des sciences humaines "• 1995.
8. Francisco José Oliveira VIANNA, Populaçàes meridionais do Brasil, Brasilia: Conselho editorial do Senado Federal, coll. << Ediçêies do Senado Federal», 2005.
140 1111 Droit et Société 83/2013
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
Il. Le grand récit et le grand silence Comme exemple paradigmatique, nous allons présenter l'Essai sur le droit ad
ministratif (Ensaio sobre o direito administrativo), de 1862, de Paulino José Soares de Sousa, vicomte d'Uruguay9. L'Essai a l'avantage de se trouver au centre du processus de formation des bases institutionnelles de l'État brésilien dans la discussion entre les libéraux, favorables à la décentralisation, et les conservateurs qui y étaient opposés. Au cœur des discussions se trouvait le pouvoir que les assemblées provinciales avaient reçu dans le but de créer les emplois nécessaires à la bonne marche des affaires publiques, et de légiférer sur leur nomination 10. L'analyse du Vicomte défend le fait que l'État et ses normes doivent être examinés à partir de l'usage qu'en font les administrateurs locaux, et que les institutions d'un pays doivent être cohérentes avec ce que nous appellerions aujourd'hui la réalité socioculturelle - et que le Vicomte nommait simplement« des coutumes » ; pour lui, ce sont leurs effets politiques qui servent de critères à l'application des principes juridiques, à la différence de la plupart des juristes brésiliens contemporains qui affirment la validité absolue de ces principes. En observant la réalité sociale, il constatait la guerre permanente, endémique dirait -on, entre des factions opposées : « L'un des partis qui divisaient nos provinces devait gagner les élections. La majorité de l'assemblée provinciale était à vous. D'accord, vous organisiez votre parti et, par exemple, après avoir nommé vos hommes aux emplois et aux postes de la Garde nationale, vous les nommiez à vie. Vous accumuliez les obstacles pour qu'à l'avenir l'autre parti ne pût pas gouverner 11. >> On connaît le résultat: « On édifiait une forteresse imprenable, à la fois par la minorité opprimée, mais aussi par le gouvernement central. En effet, ou bien le gouvernement central passait par les fourches caudines, en nommant le président imposé par la majorité, ou bien la lutte recommençait sous de plus grandes proportions 12. »
Le problème se trouvait, pour le Vicomte, dans notre «système administratif», qui était« une imitation imparfaite et bancale des institutions des États-Unis, sans, cependant, les circonstances et les moyens principaux et essentiels qui les intègrent à ce pays» 13. Mais« pourquoi ne fonctionnent-elles pas dans notre pays?» se demandait le Vicomte. Elles ne nous conviennent pas, parce que l'administration publique nord-américaine n'est pas fondée sur le principe de la hiérarchie: «La hiérarchie est l'ordre et la subordination des différents employés les uns par rapport aux autres. Cela suppose différents degrés de juridiction et une certaine tutelle 14. » Cela constitue «un correctif indispensable, surtout dans les pays où d'une façon générale ni l'éducation, ni les habitudes d'ordre et de légalité, ni le respect
9. Paulina José SOARES DE SOUZA, « Ensaio sobre o direito administrativo ''• in José Murilo CARVALHO (ed.), Visconde do Uruguai, Sào Paulo : Editora 34, coll. « Formadores do Brasil », 2002.
10. Instituée par la loi de l'interprétation de l'Acte additionnel du 12 août 1834 et par la loi de réforme du Code de procédure civile du 3 décembre 1841.
11. Paulina José SOARES DE SOUZA, « Ensaio sobre o direito administrativo >>, op. cit., p. 465.
12. Ibid.
13. Ibid., p. 497.
14. Ibid., p. 495.
Droit et Société 83/2013 11 141
L. E. ABREU
des droits, ni l'obéissance au devoir, ni enfin le sens pratique, n'ont encore pénétré les classes sociales» 15. C'est pour toutes ces raisons que le Vicomte soutenait que la centralisation administrative, fondée sur la hiérarchie, devait être un instrument d'universalisation et d'unité : elle devait servir à la répression des partis et de la guerre permanente qu'ils se livrent. Ainsi:« La mise en place des emplois, avance-t-il, qui est un moyen d'action et d'influence (et la question était, en grande partie, d'emplois par lesquels chaque dominateur veut se protéger dans son domaine), est passée aux mains d'un pouvoir plus éloigné, plus impartial, car il n'était pas engagé d'aussi près ni intéressé par les luttes et les passions personnelles et locales 16. »Le bon Vicomte conclut que « pour obtenir la liberté, il faut imposer la tutelle » ; ce qui aboutissait à une« solution de compromis», élaborée à partir d'idées qui, prises séparément, nous semblent aujourd'hui incompatibles, mais qui ensemble peuvent éclairer notre situation, leur coexistence pouvant même être imaginée comme nécessaire.
Mais ce récit est incomplet si l'on n'y reconnaît pas le dialogue implicite qu'il établit avec la réalité sociale. On le retrouve dans ce que le Vicomte acceptait comme évident, sans avoir besoin de le dire, ou que plus probablement il n'était pas capable de dire. Ce récit porte, en effet, des indications renvoyant à cet implicite, et surtout au rôle qu'y jouait le don. Tout se passe comme si le don, qui pour Mauss était fondamental, ne pouvait y jouer son rôle. Certes, le don y est présent, avec le droit qu'il établit, avec les hiérarchies qu'il reproduit, et la liaison entre les personnes et les biens. Toutefois, il en résulte non pas une totalité, ni une« totalisation du social », mais au contraire des « particularités » en guerre. Le don et tout ce qui l'accompagne sont bien présents, comme en témoignent maints rapports de l'époque, ainsi que d'abondantes survivances 17, mais sans aboutir à une sagesse sociale. Ceci ne veut pas dire que la complexité sociale élaborée autour du don n'existât nullement. On la retrouvait certes dans les partis, et sans doute dans ce qui était sans importance pour l'État, dans ce qui restait hors du pouvoir politique. De plus, la hiérarchie se retrouvait partout, au sens d'un ordre de préséance 18, par exemple entre les positions et le prestige relatif des membres d'un même groupe. Néanmoins, il n'existait aucun sens de la hiérarchie entre les partis: entre eux l'ordre n'était que le résultat imposé de l'extérieur par un mécanisme institutionnel venu d'outre-Atlantique.
Par ailleurs, le rapport du bon Vicomte exprime une intuition sociologique presque visionnaire. Pour certains anthropologues, la question fondatrice n'est pas celle du don, mais plutôt celle de la hiérarchie. Le don, en effet, exige une règle qui établisse ce qu'il est important d'échanger, et ce avec quoi il faut ou il est préférable d'échanger; or tel est précisément le rôle que joue la hiérarchie en tant que principe de segmentation du statut : elle différencie pour mettre en rapport, tandis que
15. Ibid. 16. Ibid., p. 464.
17. Voir, comme exemple tardif du système, Victor Nunes LEAL, Coronelismo, enxada e vota. 0 municipio e o regime representativo no Brasil, Rio de Janeiro: Ediçao Revista Forense, 1948.
18. Louis DUMONT, Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, op. cit.
142 liB Droit et Société 83/2013
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
l'égalité met tout sur le même plan, pour séparer ensuite 19. Or, au Brésil, peut-être a-t-il encore une curieuse combinaison: d'une part, se maintient la différence de
valeur entre les membres d'un groupe politique, certains valant plus que d'autres, malgré la possibilité toujours présente d'une incertitude et de bouleversements plus ou moins violents à l'intérieur du groupe; d'autre part, il existe aussi des séparations, des prétentions de symétrie égalitaire entre les hommes et les groupes caractéristiques d'une société où règne l'idéologie individualiste. Le problème est l'absence de synthèse entre les deux. Comme L. T. Aragao l'a souvent montré, la hiérarchie au Brésil n'arrive pas à organiser la société, comme l'existence d'autres configurations sociales nous a permis de le penser20. Le Vicomte avait-il eu la compréhension consciente et élaborée des propriétés sociologiques ainsi décrites ? Résultat de la réflexion pratique d'un homme d'action, ou exercice d'une intuition géniale, ou pur hasard, sa réflexion était inspirée par l'idée que la hiérarchie, sous la forme d'un ordre de gradation du statut, n'arriverait jamais à jouer son rôle traditionnel d'ordonnatrice du lien social, et qu'il faudrait alors y intégrer le sens moderne de la hiérarchie propre à l'idéologie individualiste, où l'autorité est remplacée par le pouvoir, et le don par la violence ; en un mot, pour agir sur la société, il faudrait ne plus la comprendre. La richesse de cette formule va éclairer le déroulement de ce grand récit jusqu'à nos jours.
Mais pourquoi le don reste-t-il silencieux? Pourquoi la réponse au « grand récit» est-elle un «grand silence»? C'est la nécessité méthodologique de notre démarche qui nous guide : si l'on ne comprend pas ce que signifie ce silence, l'on n'arrivera jamais à saisir la configuration de ce système, qui satisferait notre esprit, qui pourrait régler notre inquiétude. Nous sommes donc dans une situation difficile, nous étant engagés à dire quelque chose sur quoi nous manquent les mots et leurs références au monde. Il ne nous reste qu'à l'énoncer en utilisant une voie tortueuse. Imaginons une civilisation méditerranéenne transposée sous les tropiques, où elle trouverait une civilisation fondée sur d'autres principes. Clastres considérait que, dans les sociétés des Indiens sud-américains, la guerre était l'aspect central, l'échange restant secondaire. Il faisait toutefois une différence entre l'échange comme fondement de la société - la société comme échange des femmes, des mots et des biens - et l'échange comme forme de relation entre plusieurs sociétés dites primitives : dans ce deuxième sens seulement les sociétés dites primitives étaient des sociétés de guerre. La guerre y remplissait la fonction de maintenir l'indépendance des sociétés les unes vis-à-vis des autres, et avait comme résultat de ce même mécanisme sociologique, la fonction de maintenir l'indifférenciation entre leurs membres, ce qui pour Clastres signifiait l'absence de hiérarchie, du moins au sens moderne du concept. Ce mécanisme permettait en outre d'exorciser les périls de la constitution de l'État, dont la création exigerait la différenciation interne entre oppresseurs et opprimés. L'échange entre les groupes serait donc
19. Ibid.
20. Nous remercions Mireya Suarez d'avoir attiré notre attention sur cette conséquence politique de la pensée de notre ami.
Droit et Société 83/2013 Il 143
L. E. ABREU
un mouvement tactique: la guerre exige qu'on ait des alliés21, parce qu'on ne peut pas la faire avec tout le monde en même temps. Tout se passe comme si la société portugaise avait trouvé dans le Nouveau Monde un système de guerre entre les sociétés dites primitives, dont la stratégie était précisément d'éviter la création de l'institution issue du mode de vie des Européens, et qui représentait pour eux le sommet de leur civilisation, à savoir l'État. Ainsi cette rencontre entre les deux civilisations a été véritablement marquée par l'impossibilité de se comprendre, par l'extermination et le cannibalisme. Les sociétés dites primitives n'ont pas seulement été massacrées par les Portugais, elles ont aussi été cannibalisées. Si l'on prenait le ton de la littérature fantastique sud-américaine, on pourrait dire que quelque chose d'étonnant s'est passé : l'esprit de ces guerriers fantastiques s'est trompé ; en effet, leurs nouveaux ennemis menaient la guerre selon des habitudes tellement exotiques que les Indiens ne pouvaient pas comprendre que, pour ces étranges étrangers, la guerre n'assurait en rien la continuité de la structure sociale, ni n'empêchait la création d'un pouvoir séparé de la société, pour conjurer l'État. Ces «sauvages» n'avaient pas compris que les Portugais ne leur faisaient la guerre que pour les débusquer et conquérir leurs territoires, les Portugais, dans leur distraction, ayant oublié de le leur dire. Aussi l'esprit des Indiens suivit-ilia loi de la bonne civilisation, la leur bien sûr, selon laquelle la mort était la continuité de la vie selon d'autres modalités, confondant le génocide, ou l'extermination, et l'anthropophagie, ou l'assimilation, et par conséquent refusant l'oubli du monde.
Notre argument nous amène à un paradoxe. Nous nous sommes aperçus qu'un système, tel que celui que Clastres décrivait, complétait le récit du bon Vicomte. En outre, les raisons historiques pour l'adopter étaient fondées sur des suppositions fragiles et impossibles à étayer. Il ne nous est resté que le choix de l'énoncer comme hypothèse méthodologique en prenant des libertés au plan interprétatif. Dans cette perspective, et en supposant surmontables toutes les objections raisonnables contre notre façon de procéder, on peut comprendre les raisons pour lesquelles, tout en continuant à utiliser le don, on refuse de reconnaître son importance dans le fonctionnement de notre sociabilité : il reste pour nous silencieux. Le système des sociétés sud-américaines décrit par Clastres représente, justement, la tentative d'éviter l'émergence de l'État, même si l'État n'en est qu'une lointaine possibilité. Or, le système refuse cette possibilité, et il la refuse grâce à la guerre. La voix du don y est trop faible pour être entendue. D'ailleurs, nous avons, bien sûr, des différences, qu'il faut nommer, entre la guerre des sociétés dites primitives et ce que le Vicomte observait. La guerre entre les factions politiques dans les provinces de l'empire n'était pas faite non plus contre l'État, mais contre les autres partis, et utilisait l'État comme instrument- et dans ce sens elle réintroduisait tout ce que les sociétés pour la guerre voulaient exorciser : domination, différenciation, oppresseurs et opprimés. Il ne s'agissait point encore du résultat de la lutte de classes, puisqu'au contraire les classes naissaient du conflit. La voix du don non plus ne pouvait pas s'y distinguer pour des raisons similaires. Le don néanmoins demeurait
21. Pierre CLASTRES, Recherches d'anthropologie politique, Paris: Seuil, 1980.
144 1111 Droit et Société 83/2013
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
et demeure- primordial à la sociabilité. En suivant Clastres, on pourrait discerner don comme mouvement tactique, où il reste subordonné au conflit, et le don
comme fondement d'une sagesse sociale, où il n'est subordonné qu'à lui-même; c'est en ce second sens qu'il peut remplir le rôle exigé par le premier. L'ambiguïté que l'on trouve dans le traitement du don au Brésil apparaît à travers cette interprétation. Alors que le don est englobé par d'autres concepts, quand on parle des institutions politiques, « coronelismo » et « clientelismo » par exemple, qui révèlent une lacune dans nos habitudes politiques - « nous ne sommes pas encore arrivés à une véritable démocratie », dit -on-, le don reste le modèle de la bonne sociabilité, de ce qu'on doit faire et des obligations dont on ne peut se dégager qu'au risque de perdre la face. En conséquence et pour des raisons analogues, le don demeure silencieux: tous le pratiquent, mais nul n'en parle. Dans notre hypothèse cet ensemble de relations permet de comprendre le dialogue que le droit actuel entretient avec son contexte social, la politique et la tradition.
Ill. L'établissement de la distance entre le droit et la vie politique Le droit brésilien moderne a apparemment oublié ce que défendaient le bon Vi
comte et ses contemporains. Si, pour eux, la tradition était étonnante de possibilités et de choix, pour les juristes brésiliens actuels, c'est la proximité, la continuité et la conformité du droit brésilien avec la tradition juridique romaine. Pour les premiers il fallait examiner la réalité sociale, et partant de sa contingence, élaborer des solutions de compromis ; pour ces derniers, au contraire, il n'y a aucun compromis possible au niveau de la doctrine : on doit appliquer à la réalité sociale des principes qu'elle ne peut contaminer. En un mot, les juristes actuels ont modifié la façon de voir l'histoire ainsi que la relation entre le droit et le contexte social brésilien. Ainsi, les textes juridiques contemporains enseignent, et les cours de droit le répètent, que le droit brésilien est l'héritier du droit romain, perçu comme la grande tradition occidentale, spécifiquement la tradition romaine germanique, en opposition à celle de la Common Law. Leur récit prend une dimension historique qui l'inclut toujours et commence de préférence par le début des temps. Les périodes historiques n'ont que peu de rapports avec l'historiographie traditionnelle. Les livres de droit attribuent quelques lignes à chaque époque, pour suivre l'évolution de la civilisation dont nous sommes l'heureux aboutissement. Les principales sources de l'historiographie du droit sont dans d'autres manuels où les événements sont décontextualisés et où on leur donne des sens contemporains. Finalement, le sens d'un instrument ou d'un institut juridique n'est pas visible dans la société primitive, mais l'évolution historique en montre l'essence. On ignore totalement les différences, la multiplicité, les incongruités, les changements et tous les autres phénomènes qui caractérisent ce que d'autres savoirs comprennent comme histoire. L'on aboutit à un récit très étrange, dont le but est d'établir une distance entre le droit et la réalité sociale, soit par la négation de l'histoire, soit par le refus d'appartenir à la tradition brésilienne proprement dite. Quelle est la continuité entre cette forme moderne de voir l'histoire, et l'ensemble des rapports que décrit le récit du Vicomte ?
Droit et Société 83/2013 111 145
L. E. ABREU
Nous nous serions sévèrement trompés, si nous avions laissé des apparences nous conduire. Si l'on reste au niveau le plus immédiat de ce que disent les juristes, on comprend mal tout le reste. Notre hypothèse est que la négation et la distance, par lesquelles le droit brésilien moderne exprime son rapport avec son contexte social, sont le développement de relations similaires à celles que nous avons trouvées dans le récit du Vicomte. La doctrine nie notre identité et nos valeurs sociales ; cela constitue la partie d'une « conversation » qui se construit par l'éloignement et le distancement 22 ; une conversation qui peut se dérouler de différentes façons selon l'endroit d'où l'on« parle» et les instruments que l'on emploie pour le dire (la doctrine, l'attitude du juge, l'application de la loi, etc.). Partout, le dialogue a lieu dans l'implicite, le non-dit, dans ce qui n'est possible que sur le plan collectif, dans l'ensemble des rapports, dans le système. Mais pour s'en apercevoir, il ne suffit pas de faire attention au formalisme juridique, à la manière selon laquelle la doctrine, l'épistémologie et les opérateurs du droit articulent leur expérience en mots et dans la relation entre tout cela et un récit. En d'autres termes, les représentations conscientes ne sont pas suffisantes pour mettre en valeur les relations du système symbolique que les idées et les valeurs gardent entre elles. Si, d'après le récit du Vicomte, il fallait le chercher dans ce que l'auteur acceptait comme évident sans parvenir jamais à le dire, dans le cas actuel, il faut compléter notre stratégie : nous allons aussi faire attention à ce que dit le comportement, regarder la pratique judiciaire et la comprendre comme une parole. Le déterminant en est le sens que les mécanismes juridiques assument en mouvement, quand les normes juridiques sont interprétées et mises en relation avec d'autres normes. Il faut donc commencer par un exemple de ce dialogue.
Bien que la doctrine juridique nie le contexte social, dans la pratique, les juges cependant savent parfaitement comment opère le monde social où nous vivons, car ils ont une vision astucieuse de ces pratiques. Par exemple, ils savent que dire la vérité n'a pas, entre nous, la même valeur qu'ailleurs; et ils connaissent aussi l'importance des relations d'amitié, d'intimité, de parenté et de vie en commun. L'expérience leur montre que les témoins se fondent, non pas sur la vérité, mais sur leurs relations d'alliance: ils disent ce qui aide leurs proches. La loi permet au juge de ne pas accepter le témoignage de parents jusqu'au troisième degré, d'amis intimes et d'ennemis de n'importe laquelle des parties. Le juge demande alors au témoin s'il est déjà allé chez la partie, s'il buvait avec elle ou s'il la retrouvait chez le coiffeur, et autres questions du même genre. S'il répond affirmativement, le témoin est récusé; et c'est l'un des emplois de l'expression« ami intime» prise dans un sens plus large que celui que nous considérerions raisonnable. Ainsi la loi permet au juge d'entendre une personne qu'il a qualifiée d'« ami intime», voire de «parent» de l'une des parties, non pas comme« témoin», mais comme« informateur» 23. Toutefois, ceci ne semble pas très usuel car, au cours des audiences, l'objectif des questions du juge est de qualifier la plupart des témoins comme des amis intimes pour ne pas avoir à les entendre au
22. Paul RICOEUR, Du texte à l'action. Essais d'herméneutique, Paris: Seuil, coll.« Esprit ''• 1986.
23. Juridiquement, les témoins sont passibles de peines pour faux témoignage, mais non les informateurs.
146 1111 Droit et Société 83/2013
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
cours du procès: le temps est toujours court24. Les témoins, eux, imaginent souvent le contraire: s'ils ne connaissent pas la partie de près, le juge ne les prendra pas en compte car ils auraient moins d'informations concernant l'affaire. Si le témoin est accepté, le juge s'adresse à lui avec sérieux: seul celui qui incarne la justice a un devoir envers la vérité, et s'il ment ou s'il est en contradiction avec les autres témoignages, il ira en prison, avec d'autres menaces du même ton. Parfois, un témoin va vraiment tomber sous cette accusation; cependant, on doit reconnaître que les condamnations pour parjure sont presque inexistantes - et cela ne signifie pas qu'on croie que tous disent la vérité. L'effet sur le témoin est violent et immédiat : il a un trou de mémoire, il n'est plus aussi sûr qu'avant l'audience, sa voix tremble25. Et c'est là le résultat de la connaissance des pratiques sociales qui l'entourent: le juge sait que, même sans preuve, la relation entre le témoin et la partie peut exister et que les avocats préparent le témoin, lui font répéter son témoignage ; il a aussi conscience qu'en pratique, les faits par eux-mêmes, s'ils existent, se trouvent au-delà de la capacité du juge qui en général a accès à différentes versions.
Cet exemple du juge montre qu'en pratique le droit perçoit nettement l'existence du monde social, et ce n'est qu'en fonction de cette connaissance que l'attitude du juge a un sens. Le juge va certainement à l'encontre ce que l'on attend de quelqu'un qui se trouve dans une position supérieure : qu'il manifeste sa condescendance envers l'inférieur, qu'il joue sur cette scène son rôle selon lequel les différences ne comptent pas, et qu'il laisse intervenir les cordialités propres, attendues et chaleureuses de notre sociabilité. Si le juge enfreint ce «droit coutumier», s'il adopte un individualisme brutal qui, pour nous, se convertit en autoritarisme sans contraintes, il le fait afin d'assurer au droit les conditions minimales de sa réalisation. L'alternative serait de se laisser contaminer par la société et par ce qu'elle propose de plus fort : l'importance de l'échange, du don, de l'engagement personnel, de l'esprit de parti. C'est pourquoi la manière d'agir est, pour le juge, un devoir (ou, plus précisément, la façon selon laquelle il voit sa réalisation). Son attitude reprend, une fois de plus, le même point de vue, la même critique présents dans l'Essai sur le droit administratif, qui dit de la sociabilité: «ici, ceci ne peut prévaloir» ; et qui dit de la distanciation et de la rupture : « il vaut mieux qu'il en soit ainsi».
Mais il faut reconnaître des divergences importantes. À la différence du vicomte d'Uruguay, qui voyait dans la centralisation administrative une stratégie pour combattre le particularisme et le factionnalisme placés à une distance qui, dans l'empire du Brésil au XIXe siècle, était à la fois métaphorique et géographique, aujourd'hui, nous serions devant la situation contraire: l'identité sociale et les valeurs qu'elle professe, le don et la guerre entre les gens dominant l'État. Cette situation, d'ailleurs, est bien raisonnable et, en fin de compte, serait la plus probable: est-ce l'État qui contamine la société, en lui imposant une manière d'être qui n'est pas la sienne, ou la
24. Cela est plus évident dans le droit du travail et le droit civil ; en droit de la famille, il est courant d'écouter des «informateurs» et, dans le domaine pénal, la loi admet que les accusés mentent pour se défendre.
25. Voir Wellington HOLANDA MORAIS JûNIOR, <<Se meu fato falasse: um olhar etnogrâfico sobre a construçao dos fatos na audiência trabalhista », Universita Jus, 18, 2009.
Droit et Société 83/2013 11147
L. E. ABREU
société qui, lentement, retrouve son chemin en pénétrant dans les institutions, en prenant à bras-le-corps les situations réelles de la vie quotidienne? Pour s'adapter à ce que le savoir juridique comprend comme étant sa situation objective (l'invasion du don et du particularisme, la proximité de la sociabilité), il a fallu avancer dans la direction suggérée par le Vicomte : le droit doit se construire contre la société afin d'en freiner les impulsions, d'en dominer la nature et d'en encadrer le factionnalisme. Ce n'est que dans son éloignement d'avec la réalité sociale qu'il serait possible de réaliser cet objectif, même précairement. Il fallait donc créer, entre eux, une distanciation nécessaire, une rupture stratégique, tâche d'autant plus nécessaire et urgente que ce qu'il faut combattre est d'autant plus proche 26.
Mais quel est l'interlocuteur privilégié de ce dialogue, à qui est l'autre voix? La réponse est déjà présente dans le récit du Vicomte : c'était contre la politique locale, abandonnée à elle-même, que l'État devait construire ses mécanismes; mais maintenant nous ne pouvons compléter ce récit que dans la mesure où la politique - et pas seulement la politique locale- représente des valeurs et une façon d'être socialement importantes, bien que peu s'en rendent compte. En d'autres termes, la politique est le domaine de l'expérience sociale qui, dans un certain sens, cristallise ce qui est dispersé et immergé dans la complexité des sociabilités de notre société. Ici le don apparaît, avec la même ambiguïté, comme le mouvement du conflit où il joue un rôle semblable à celui de la guerre entre les sociétés primitives, et comme l'expression de notre sagesse sociale.
IV. Le besoin de l'échange À l'Assemblée nationale, les politiciens pensent non pas que leur praxis doive se
soumettre aux règles républicaines, mais que la vraie politique se trouve dans les coulisses du pouvoir, où les alliances politiques sont pensées en tant que prestations et contre-prestations, en suivant le modèle du don où se mêlent l'apparent désintéressement et l'obligation de rétribuer. Ce thème a déjà été abondamment traité, et ce n'est pas notre propos de reprendre ici tout le débat. Nous nous contenterons de trois observations.
Premièrement, l'échange comme don a un caractère synthétique. Il mêle des choses qui dans notre regard occidental n'appartiennent pas aux mêmes catégories et qui devraient rester séparées et distinctes: la personnalité et l'institution, l'individuel et le collectif, l'intérêt et le désintéressement, la gratuité et l'obligation, les personnes et les biens. Voici par exemple la déclaration du député Ricardo Fiuza: «Aucun président de la République, je l'en défie, aucun ministre d'État[ ... ], aucun gouverneur d'État, n'a le droit de dire que j'ai demandé une faveur (javor) personnelle. Je renonce à la vie publique et je donne tout ce que je possède s'il apparaît un homme public, dans ce pays, qui dise que je suis allé frapper à sa porte pour demander une
26. Même si la distance entre la doctrine juridique et la réalité sociale existe dans tous les systèmes romanistes (voir Yan THOMAS,« Fictio Legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales,,, Droits, 21, 1995, p. 17-63.), ce qui nous intéresse est qu'elle puisse avoir un sens différent pour chaque société.
148 11111 Droit et Société 83/2013
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
faveur ifavor) personnelle 27. » Ce ton emphatique est le résultat de sa condition d'accusé lors d'un des grands scandales de la décennie. Mais ce n'est pas ce qui nous importe, son destin politique non plus d'ailleurs: à l'audience, il a été innocenté de ces accusations, et réélu député deux législatures plus tard, mais sans jamais plus retrouver son influence politique antérieure. L'important est que le passage offre une apparente contradiction: demander une« favor »signifie solliciter un service de quelqu'un. Mais la « favor » a des implications bien particulières. C'est une prestation qui fait partie d'une relation d'échange comme don, et qui comprend toujours l'obligation de rétribuer. Plus encore, toute« favor »est personnelle : la personne garantit que la « favor » sera rétribuée - sa parole est sa caution ; inversement, on fait la « favor » au nom de celui qui la demande. Ce que le député a voulu dire est que les « favores » ne correspondaient pas à ses intérêts personnels, que les services qu'il sollicitait étaient pour les autres. Que cet altruisme soit sincère ou non, cela non plus ne nous intéresse guère. Ce témoignage donne simplement un exemple d'une règle de l'activité du Congrès: même quand on négocie des sommes institutionnelles, mouvement légitime au sein des institutions publiques, tout se passe comme si les hommes politiques échangeaient entre eux des faveurs. Dans ces circonstances, si l'on sépare le personnel de l'institutionnel, on risque de ne rien comprendre à l'action des hommes politiques au Brési128.
Tel est le rôle que la société brésilienne impose à ses hommes politiques: exercer cette capacité de mettre ensemble ce qui, pour la mentalité occidentale, ne doit aucunement avoir de rapport ni de relation, afin d'élaborer des synthèses apparemment impossibles. Que nul ne s'en étonne. En fin de compte, en opposition aux si nombreuses inégalités, différences, incompatibilités et contradictions qui sont les nôtres - dont l'éloignement et la distanciation que propose le droit -, il faut recréer l'unité, même provisoire ou fictive. Dans cette perspective, l'importance de l'échange, en tant que don à l'intérieur de nos institutions, n'est pas seulement le résultat d'un passé archaïque destiné à être progressivement remplacé au cours du développement historique par des attitudes plus modernes: il s'agit bien d'une nécessité de notre propre système.
Deuxièmement, ni le règlement, ni les arguments rationnels, ni l'intérêt, pour rester dans le cadre du Congrès national, ne sont capables, à eux seuls, de créer des majorités et des consensus, ni d'engendrer des mouvements institutionnels. Il faut compléter, leur ajouter quelque chose, leur donner, pour employer Claude Lévi-Strauss, une «quantité symbolique supplémentaire», ou, sur un plan, créer un mécanisme sociologique capable de combler ce manque. Comme l'échange est, entre autres choses, un système de droits, il parvient à jouer ce rôle. Mais la difficulté est que, comme système de droits, l'échange n'est pas intégré au droit positif; en d'autres termes, la norme juridique n'englobe ni n'incorpore
27. Déposition de monsieur José Carlos Alves dos Santos à la Commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur le budget du Gouvernement, 3 octobre 1993. Diario do Congresso Nacional, Ana L, Suplemento «A, ao n 4, 16 février 1995, p. 99 et suiv.
28. Luiz Eduardo Lacerda ABREU, «The Exchange of Words and the Exchange of Things: Poli tics and Language in the Brazilian Congress >>, Mana, 2, Selected ed., 2006.
DroitetSociété83!2013111149
L. E. ABREU
l'échange, dont elle ne sait que faire. La pratique, la pensée et le discours se struc~ turent donc à partir d'une dichotomie, d'une rupture, d'une opposition: côté, la norme juridique et les récits qui se construisent à partir des institution:;, ou à leur sujet; de l'autre côté dans les coulisses, les conversations, le secret, surtout l'échange et les obligations qu'ils induisent. La politique parlementain' est sans doute l'exemple le plus frappant de cette tension qui s'étend à toute l'activité politique 29.
Troisièmement, l'échange, en tant que don, se fonde sur une tension inévitable entre le désintéressement apparent et la liberté de donner, entre l'obligation rétribuer et la réciprocité, où réside l'intérêt. Pour que ce modèle du don soit effi~ cace, il ne doit pas être une farce. Les idées ont une force qu'il faut respecter. Ainsi « L'intervalle de temps qui sépare le don et le contre-don permet de percevoir qu'une relation d'échange est irréversible, toujours menacée d'apparaître et de s'apparaître comme étant réversible, c'est-à-dire, comme étant à la fois obligatoire et intéressée[ ... ]. C'est le temps qui sépare le don et le contre-don et autorise de se mentir, collectivement soutenu et approuvé, et constitue la condition du fonction~ nement de l'échange30. »C'est dans cet intervalle que se développent les stratégies, les dépendances, les prises de parti: «abolir l'intervalle, c'est aussi abolir la stratégie», dirait-on 31. Tout se passe d'une façon bien différente dans l'échange en tant que marché: on n'y trouve pas le besoin des démonstrations d'amitié ni des actes rituels d'attention et de considération personnelle. Il n'est pas nécessaire de cacher l'intérêt- au contraire, il se met au premier plan: on achète et on vend au nom de l'intérêt de chacun. De plus, l'échange comme marché n'implique pas un mélange d'éléments qui, pour notre pensée, sont contradictoires; le marché n'a pas besoin du caractère synthétique du don, et peut donc s'en passer. Enfin, l'échange en tant que marché n'est pas fondé sur l'intervalle de temps entre ce qui est donné et ce qui est rendu ; au contraire ces deux moments sont simultanés et réversibles, du moins idéalement. Mais quelle est l'importance pour notre démonstration, de la différence entre l'échange comme don et l'échange comme marché?
La différence entre le don et le marché permet de distinguer entre le don et la corruption, même si cela ne satisfait pas la mentalité occidentale dont parle Heidenheimer. Il y a, bien sûr, des échanges qui, dans notre système, relèvent de la corruption. Le cas indiscutable est celui de l'échange de votes à l'Assemblé nationale contre de l'argent. Cela correspond aux crimes de corruption passive du fonctionnaire public, et de corruption active de la part de celui qui offre l'argent. Un fonctionnaire qui occupe la position de celui qui fait la proposition agit en citoyen privé, dit le droit. Pour notre sujet, il n'est pas inutile de remarquer que l'incrimination de ces infractions détermine, comme un de leurs éléments constitutifs, que la corruption (passive ou active) est «la proposition des avantages indus», « indu» signifiant un avantage qui n'appartient pas aux institutions publiques et reste hors de l'État. Autrement dit, les prestations ou contre-prestations dont des avantages
29. Ibid.
30. Pierre BOURDIEU, Le sens pratique, Paris: Éditions de Minuit, coll.« Le sens commun», 1980, p. 179-180. 31. Ibid., p. 180.
150 11 Droit et Société 83/2013
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
"eraient « internes » (non pas « personnels » comme le défendait le député Ricardo Fiuza, cf. ci-dessus) ne sont pas érigées en acte d'infraction. Les infractions sont aussi «formelles», c'est-à-dire que, pour qu'elles soient considérées comme un crime, il suffit que quelqu'un en fasse la promesse (corruption active) et que le fonctionnaire l'accepte (corruption passive); en un mot, il suffit que l'on parle. L'usage des mots nous fournit ainsi une preuve supplémentaire de la différence entre le don et la corruption. Il s'agit de deux jeux de langage différents. Dans 1 'échange comme don, on demande une faveur en utilisant des justifications que !*autre peut accepter, même s'il sait que ce n'est qu'hypocrisie- la faveur est faite
nom du demandeur, mais n'est pas pour lui; dans l'échange comme marché, il fait pas de sens de demander une faveur en disant: «J'ai besoin que vous me
fassiez telle faveur, pour gagner 15%. » Cette manière de demander n'entre pas dans le jeu, l'on dira plutôt:« Si vous m'accordez ceci, je vous accorderai cela.»
Mais il y a plus. Dans la politique, l'échange en tant que marché apparaît comme la dégénérescence ou la corruption de l'échange en tant que don. Et ceci cache un présupposé moral, le scepticisme. Nul ne croit que les individus soient animés de principes éthiques ou moraux limitant leur action individuelle fondée sur l'intérêt: l'individu livré à lui-même est sans scrupules et prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire, jusqu'à se montrer dangereux et destructeur. Les limites et l'ordre sont le résultat de liens et d'obligations réciproquement consentis. Ainsi, pour participer à la politique, il faut demander des « favores » mais, ce faisant, les agents s'obligent mutuellement, ce qui les limite: ils ne peuvent pas non plus dire ou faire n'importe quoi. Certes, ils peuvent rompre ces liens, ce qu'ils font souvent; mais les rompre sans perdre ni faire perdre la face demande un grand art, bien de la patience et une certaine habileté, ce qui signifie qu'au-delà d'un système de domination de certains parlementaires sur d'autres, le don est un mécanisme de contrôle de la nature humaine, mécanisme socialement nécessaire afin d'en exorciser les dangers.
À la différence de la politique qui considère comme bonnes les décisions issues de cet univers d'échanges, dans le droit, au contraire, l'influence de l'échange dans les décisions judiciaires est perçue comme une contamination, une dégradation, et donc une abomination. Toutefois, le droit, on l'a vu, ne peut pas échapper à lasociété: il lui reste« le triste destin» d'être, d'une certaine façon, contaminé par elle. L'échange comme don, reparaît alors dans les relations entre pairs, dans les re connaissances réciproques, les invitations, les dîners, les places à table, la manière de s'adresser les uns aux autres, dans les demandes institutionnelles ou les compliments. Mais il faut souligner que, dans ce monde, l'échange se base sur des re lations fondées sur la segmentation institutionnalisée du statut, c'est-à-dire qui viennent de la norme: d'abord le juge du Tribunal suprême, puis celui du Tribunal supérieur de justice, ensuite les juges des tribunaux régionaux fédéraux, les juges ordinaires, les promoteurs etc. La position d'un avocat dépend de son capital sa réputation, sa clientèle, ses publications, les causes qu'il a gagnées, ses relations, ses amitiés politiques, etc. -, de la région du pays où il exerce (à Brasilia cela peut être différent de Sao Paulo) et elle peut varier de la plus insignifiante à la plus en
Droit et Société 83/2013 11 151
L. E.ABREU
vue. Sur ce plan, le groupe social n'aime guère être soumis aux normes écrites, et préfère être traité à partir de l'idée selon laquelle tout le monde est différent, chacun ayant droit à la reconnaissance de ses particularités, selon la place qu'il occupe. C'est un monde dans lequel, à la différence du peuple, on est quelqu'un. La hiérarchie comme principe de segmentation du statut sert de mécanisme de contention de la sociabilité laissée à elle-même, ce qui nous ramène d'une certaine manière aux idées du Vicomte. Les échanges y sont justifiables comme résultat d'un ordre de préséance et doivent rester dans les limites qu'imposent la vie en société et les règles de la bonne éducation.
La conséquence est savoureuse. Pour le droit, la sociabilité laissée à elle-même est l'empire des partis, et les partis sont incapables de construire l'universalité de la règle. Pour la politique, l'intérêt individuel désagrège, sépare, distingue; l'échange unit, crée des synthèses, des liens, des contraintes. La conséquence en est que l'échange comme don apparaît comme une partialité condamnée par les mécanismes juridiques au nom de l'universalité, alors qu'elle est utilisée pour se ressembler plus profondément. Le droit n'arrive pas à éliminer les valeurs ni l'identité qui caractérisent notre sociabilité, bien qu'il parvienne, d'une façon limitée, à les déguiser. L'échange dans la vie politique n'arrive pas non plus à éliminer l'intérêt sous toutes ses formes. Tout au plus, l'intérêt doit s'exprimer autrement, dans une autre langue, afin de se réaliser. Nous y trouvons une sagesse sociale à proprement parler: l'objectif du droit n'est pas de se superposer à la société pour éliminer ses formes spontanées, comme l'objectif du don n'est pas non plus d'en finir avec l'intérêt. Le droit et l'échange s'emploient à contrôler les avancées des particularités et des intérêts, à tempérer leurs élans, à leur imposer au moins une autre expression. Mais comment leurs différences se structurent -elles en dialogue ?
V. Le droit et la politique Notre intuition fondamentale est que le cas brésilien devient mieux compré
hensible si l'on oppose le don au droit, nos démarches méthodologiques nous ayant amené à y supposer un système. Mais que peut -on dire de leur relation ? Aucune totalité n'arrive à rassembler deux domaines qui ont l'intention de parler des langues différentes et étrangères l'une à l'autre. La caractéristique principale du mécanisme sociologique ici analysé est de maintenir le droit et la politique éloignés l'un de l'autre. Le droit n'a pas l'ambition de représenter la sociabilité en général, ni le don en particulier, mais de la limiter; le don, à son tour, à cause de son ambiguïté, à la fois sagesse et mouvement tactique, fondement et pratique subordonnée, justification de la sociabilité et déformation des procédures démocratiques, présent partout et silencieux, manque d'une voix suffisamment forte pour s'imposer au droit, en affirmant qu'« au cœur de notre identité sociale, nous trouvons le don>>; il n'y a donc pas entre eux de synthèse républicaine, élaborée à partir de principes qui, simultanément, seraient imaginés cohérents et consistants, et représenteraient une identité collective. La solution est alors d'accepter la rupture comme étant un fait logiquement premier, et d'en tirer les conséquences possibles.
152 Il Droit et Société 83/2013
L'État contre la société. La norme juridique et le don au Brésil
Les besoins de la vie sociale leur impose d'être ensemble, mais sans fournir aucune synthèse réalisable à un niveau supérieur. Il faudrait alors construire un mécanisme capable de relier ces deux domaines d'une certaine manière, non pas en une synthèse ni une totalité, mais d'une autre forme. Comme l'un n'englobe pas l'autre, leur relation y gagne un côté, disons, moderne : chaque domaine cherche à établir sur l'autre, une tutelle, une domination - ce qui, au fond, n'est que l'exercice de la violence et de la force. Le droit essaie de soumettre la politique aux normes juridiques. Le Tribunal fédéral suprême (le tribunal constitutionnel du Brésil) constitue un bon exemple de l'usage de cette force, par le contrôle de la procédure législative, de l'accusation des parlementaires, ou du contrôle des décisions prises par le Bureau de l'Assemblée. À l'origine, sa position était de ne rien faire, au nom de l'indépendance des pouvoirs, mais aujourd'hui il a changé, et multiplie ses interventions. La tentative aboutit parfois à des situations contradictoires ou même ridicules, comme si la Cour ne pouvait rien accepter au-delà du droit; mais ses catégories et ses instruments ne sont pas capables de bien le faire. La politique, au contraire, dit que le droit n'est qu'un détail, comme le professe la maxime:« tout aux amis, la loi aux ennemis » qui représente, au Brésil, une obsession constante du sens commun d'où découlent certaines conséquences pour notre identité sociale. Elle ne représente pas une évaluation particulièrement profonde de la pratique sociale, mais la prise de position d'un parti, l'affirmation de la prédominance d'un domaine sur l'autre; elle correspond certes à l'action des hommes politiques ou à leur tentative d'action pour soumettre les relations juridiques aux relations d'alliance. Mais, même dans ces cas, il faut prendre en compte ce que dit le droit, et n'accorder qu'un rôle dérivé au profit des amis et à la lutte contre les ennemis: ce n'est qu'en fonction de la force de la norme que prévaut la faveur de ne pas l'appliquer - et c'est pourquoi l'un des emplois de la norme est de créer des situations favorables à l'échange.
Ainsi, nous considérons que leur relation peut être pensée comme un dialogue fondé sur leur mise à distance. Ainsi, la réalité de la politique et les raisons du droit s'articulent en fonction des circonstances. Les solutions sont multiples et variées. Et nous retrouvons ici un autre point de vue du vieux Vicomte : il faut établir des « solutions de compromis >> entre les deux domaines, solutions nécessairement locales et contextuelles - dans la praxis, ce qui confirmera l'idée que le système se structure sur le dialogue. À tout moment donc, politiques et juristes font exactement le contraire de ce qu'ils disent faire: le politicien pense à ses actions et à ses stratégies, à partir du sens qu'il élabore des applications passées et possibles des normes juridiques, et de ce que l'on peut en faire. Il est très loin d'agir par rapport à la norme juridique comme si elle n'était qu'un détail, bien qu'il ne cesse d'affirmer que le sens des choses se trouve dans les coulisses du pouvoir, que c'est là que sont prises les décisions et que se fait la véritable politique. De leur côté, les juges considèrent la conjoncture et les développements possibles de leurs décisions dans la politique, c'est-à-dire comment leurs décisions seront utilisées, bien qu'ils répètent qu'elles ne visent que la doctrine et la norme juridique. Juges et juristes examinent la réalité sociale avec un soin extrême et ont un énorme travail à faire pour adapter
Droit et Société 83/2013 11153
L. E.ABREU
leurs instruments aux développements possibles de leur discours et aux pratiques sociales dans lesquelles ils sont immergés. Tel est en un mot le sens selon lequel la relation entre les deux domaines se structure en dialogue : un domaine voit dans l'autre- dans celui qui se trouve à distance et qui se constitue comme distanciation - ses possibilités à un moment particulier, l'un représentant les mondes possibles de l'autre. Cette herméneutique sociale nous impose une ontologie particulière: au lieu d'actualiser une tradition dans le présent, il faut interpréter, sur le plan synchronique, les différentes possibilités dont parlent les voix antagoniques du droit et de la politique. C'est dans l'espace créé par leur dissonance, où se développent les stratégies et les jeux, que l'on prend des risques pour les enjeux fondamentaux 32.
• L'auteur Luiz Eduardo de Lacerda Abreu est professeur d'anthropologie juridique au sein du programme doctoral de droit au Centre universitaire de Brasilia (UniCEUB). Ses travaux de recherche portent sur le droit brésilien en tant que tradition juridique locale. Parmi ses publications : -«Les différentes traditions juridiques», in Mireille DELMAS-MARTY et Kathia MARTINCHENUT (dir.), Les figures de l'internationalisation du droit. Amérique Latine, Paris: Société de législation comparée (à paraître) ; - « Riesgo en la polftica. Las instituciones en juego », in Marcelo DIAs VARELLA (ed.), Derecho, sociedad y Riesgos, Brasilia: UniCEUB, UNIT AR, 2007; -«The Exchange of Words and the Exchange of Things: Politics and Language in the Brazilian Congress »,Mana, 2, selected ed., 2006; -«Wittgenstein Lecture on Ethics and French Anthropological Tradition», in Rudolf Haller et Klaus Puhl (eds.), Wittgenstein and the Future of Philosophy. A Reassessment after 50 Years, Kirchberg/Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2001.
32. Nous remercions Ciméia Bevilaqua et Eliardo Teles pour leurs critiques. Traduction de Michel Guy Abes, correction de Jean-Jacques Chatelard.
154 11 Droit et 83/2013