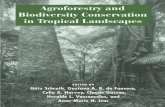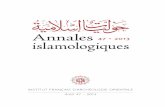Le constructivisme juridique - conclusion de l'ouvrage
-
Upload
univ-orleans -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le constructivisme juridique - conclusion de l'ouvrage
171
Conclusion
Vers une renaissance contemporaine
du constructivisme juridique ?
« S’il est vrai que tout, dans notre époque, est en crise, la crise concerne non moins profondément les principes et structures de notre connaissance, qui nous empêchent de percevoir et de concevoir la complexité du réel, c’est-à-dire aussi la complexité de notre époque et la complexité du problème de la connaissance. »
Edgar Morin1
Cet essai s’est ouvert sur une interrogation. Le construc-tivisme présent dans les autres sciences est-il absent de celle du droit comme semble l’attester la « théorie normale du droit »2 ? Une intuition s’est rapidement imposée. Si le constructivisme est une épistémologie qui représente la connaissance comme le fruit de la construction du cher-cheur, alors il doit être possible de le retrouver également en droit à l’époque de l’antiquité romaine où les juristes, en tant que chercheurs, ont bâti de toute pièce un droit privé, le ius.
1. E. Morin, La méthode, 3. La connaissance de la connaissance, Seuil, Points, coll. « Essais », 1986, p. 236.2. Sur cette expression, cf. l’introduction, section 3, §1.
172
Grâce à la richesse des travaux contemporains en histoire, en histoire du droit, en sociologie et en philosophie, cette intuition est devenue une hypothèse démontrée.
Le constructivisme juridique existe à Rome. Son étude détaillée précise son particularisme et révèle son universa-lisme. Dans un large mesure, le constructivisme juridique romain permet de caractériser synthétiquement le construc-tivisme juridique.
À l’issue de cet essai, le constructivisme juridique peut maintenant intégrer notre théorie du droit. Il s’agit d’une épistémologie qui justifie le droit en le déterminant par la science et en le légitimant par un discours axé sur les valeurs. Le constructivisme juridique se révèle ainsi être une épistémologie permettant de fonder le droit, c’est-à-dire de le déterminer et de le légitimer. En somme, le constructi-visme juridique permet d’élaborer un nouveau fondement du droit.
La notion proposée de fondement du droit (fig. 1 en annexe). La notion de fondement du droit apparaît ainsi dans son intégralité. Elle est plus large que l’utilisation réduite aux valeurs, et principalement à la valeur du juste, qui en est faite dans la « théorie normale du droit ». Elle recouvre l’entier domaine de l’épistémologie qui contient les valeurs, mais en outre, les idées, les concepts, les croyances, les intuitions, les méthodes, les techniques et les savoir-faire des juristes-chercheurs, autrement dit, tout ce qui façonne leurs représentations. Intégrer les trois dimensions de l’épis-témologie à la notion de fondement, dans le respect de la définition du terme dans les dictionnaires (cf. l’introduc-tion), permet de voir le lien entre le droit et la connaissance du droit et de confronter les juristes à leur savoir.
À l’issue de cette plongée dans la Rome antique, le constructivisme juridique apparaît comme une science de la connaissance du droit (Section 1) qui constitue un
173
modèle épistémologique pour fonder le droit (Section 2), et plus précisément, pour refonder le droit en période de crise majeure en opérant une révolution épistémologique (Section 3). In fine, étudier le constructivisme, c’est faire l’apport à notre théorie du droit de modèles qui structurent la pensée juridique au-delà de nos points de vue doctrinaux.
SECTION 1. LE CONSTRUCTIVISME JURIDIQUE, UNE ÉPISTÉMOLOGIE DU DROIT
Le constructivisme juridique caractérise la science romaine du droit à certaines périodes en raison du rôle particulier tenu par les juristes-chercheurs dans les sources du droit (§1). Leur travail scientifique sur le droit privé romain procède d’une épistémologie constructiviste singulièrement novatrice mais, sous couvert de la tradition , ce caractère novateur a été masqué par l’invention d’un discours de légitimation du droit. Ce discours est celui du jusnaturalisme qui replace le droit construit par la science dans l’ordre de la nature. L’épistémologie constructiviste légitime le droit par le jusna-turalisme (§2).
§1. L’épistémologie des juristes, sources du droit
Le rôle particulier des juristes romains. En quinze siècles d’histoire, le droit romain a beaucoup évolué. Il présente néanmoins un élément invariant : le rôle parti-culier des juristes dans son élaboration. Non pas que les juristes romains soient restés en dehors de l’histoire. D’abord pontifes , c’est-à-dire prêtres sous la Monarchie, ils deviennent progressivement des nobles laïcs sous la République et fina-lement des fonctionnaires sous l’Empire. Mais dans cette évolution, ils ont su maintenir leur rôle de premier plan dans l’édification du droit en se tenant tout à la fois au cœur et en amont des institutions.
174
Pour le dire simplement, le travail des juristes romains est à compter parmi les sources du droit, sources formelles dirait-on de nos jours.
La nature particulière du ius. Ce rôle particulier des juristes se reflète sur la nature du droit romain qu’ils contri-buent à élaborer. Le ius n’est pas réductible schématiquement à un droit imposé par un souverain ni à un droit délibéré par des assemblées, pas même à un droit secrété par une coutume. Le ius peut être le mieux défini comme un savoir construit par le travail d’une élite d’experts exerçant un monopole sur sa connaissance.
Le rôle des juristes et le constructivisme juridique. Le rôle des juristes est l’élément nécessaire et primordial qui explique et rend possible l’émergence du constructi-visme juridique. Les juristes romains sont avant tout des praticiens du droit. Ils résolvent des questions pratiques en consultation en rendant des responsa. Peu à peu, ces réponses juridiques forment un ensemble cohérent qui donne corps au ius. Et dans la mesure où les institutions aussi (roi, prin-ceps, magistrats, etc.) se tournent vers les juristes pour avoir connaissance du ius, les réponses élaborées au cas par cas seront regroupées dans des livres et constitueront le ius en un tout. La pratique élabore alors un savoir, et bientôt une science autonome et normative. Autrement dit, le praticien devient un savant, et en tant que tel, construit le ius. Or, le primat du sujet (à travers la personne du savant ici) dans la construction de la connaissance est la caractéristique essen-tielle d’une épistémologie constructiviste (cf. l’introduction). Cette caractéristique se retrouve pleinement à Rome dans le rôle des juristes.
Le constructivisme juridique se caractérise par un élément nécessaire à sa définition : le rôle normateur de ceux qui élaborent la connaissance par des constructions.
175
§2. Une épistémologie à l’origine du jusnaturalisme
Et pourtant, malgré cette caractéristique indiscutable, le constructivisme juridique ne se donne pas si facilement à voir… au point qu’il n’a jamais été décelé à Rome à notre connaissance ! L’élucidation de ce paradoxe est source d’une nouvelle découverte, celle du lien entre une épistémologie (le constructivisme) et un fondement (le jusnaturalisme).
Les époques du constructivisme et du jusnaturalisme (fig. 8 en annexe). Ce lien apparaît en retraçant la chronolo-gie des évènements. Le constructivisme juridique romain ne caractérise pas l’ensemble de l’histoire du droit romain. C’est un moment particulier, celui du Ier siècle av. J.-C. Ce moment précède de peu celui du jusnaturalisme. Or, ce dernier, ou plus exactement notre représentation du jusnaturalisme, a largement contribué à masquer le constructivisme. Pour des raisons qui tiennent essentiellement à l’hégémonie de la période impériale dans notre imaginaire collectif, période d’un droit privé romain arrivé à maturité et consacré par le Code Justinien qui inspirera le Code Napoléon, la « théorie normale » contemporaine du droit à tendance à assimiler le droit romain au stade auquel il est arrivé au moment de son fondement jusnaturaliste.
Restaurer l’historicité du jusnaturalisme déconstruit cet imaginaire. Le jusnaturalisme se déploie seulement après le moment constructiviste vers la fin de la République. Il émerge du travail des juristes romains d’acculturation des doctrines grecques du droit naturel datant du IIIe siècle av. J.-C, soit deux siècles auparavant ! (Cf. fig. 8). Ce recours au droit naturel venu de Grèce permet aux jurisprudents de justifier le caractère normateur de leur science du droit. Le droit naturel est une doctrine qui peut aisément s’intégrer à la représentation romaine traditionnelle du monde. Leur innovation scientifique est ainsi légitimée par une doctrine qui respecte la tradition . La tradition est respectée alors qu’elle est en réalité profondément modifiée.
176
La relation entre le constructivisme et le jusnatura-lisme. Il en résulte deux conséquences pour la théorie du droit. D’une part, le constructivisme se donne enfin à voir en arrière-plan du jusnaturalisme. C’est une épistémologie de juristes à l’œuvre pour fonder le droit tout en légitimant leur science à une époque où le droit et la science du droit sont indissociables. D’autre part, le jusnaturalisme apparaît pour ce qu’il est réellement : un système de valeurs , c’est-à-dire un discours de légitimation du droit élaboré par une épistémolo-gie (Cf. introduction). Naît ainsi, pour la première fois dans l’histoire, l’idée de fondement du droit dans un sens subs-tantiel qui ne quittera plus nos représentations juridiques.
Le constructivisme juridique délivre ainsi un autre ensei-gnement sur sa nature. Il s’agit d’une épistémologie dont le caractère innovant a besoin d’un discours de légitima-tion. Le jusnaturalisme pourvoit à cette tâche.
SECTION 2. LE CONSTRUCTIVISME JURIDIQUE, UN MODÈLE POUR FONDER LE DROIT
Le constructivisme juridique à Rome est une épistémo-logie qui tient un rôle important dans l’élaboration du ius. Par lui, la science construit le droit. En ce sens, le constructi-visme juridique est un modèle, c’est-à-dire une représentation intellectuelle qui a vocation à gouverner le réel, au sens litté-ral, à le modeler. Le constructivisme juridique romain est un double modèle de fondement du droit : un modèle pour fonder scientifiquement le droit (§1) et un modèle pour fonder socialement le droit (§2).
§1. Un modèle pour fonder scientifiquement le droit
Les termes épistémologie et constructivisme sont ceux du XXe siècle. En quoi correspondent-ils à une réalité de
177
l’Antiquité ? Autrement dit, sous quelle forme se présente le constructivisme juridique romain ?
L’émergence d’une science du droit. Le constructi-visme juridique est une qualification qui peut être apposée sur le travail des juristes romains notamment à l’époque du Ier siècle av. J.-C. Bien documentée, cette période est qualifiée d’âge d’or du rationalisme antique. Un tournant dans l’histoire s’effectue par le développement d’une pensée intellectuelle, abstraite, et conceptuelle qui fait appel à des modes de raisonnement dialectique rendus possibles par le perfectionnement de la langue latine. Techniquement, l’in-vention du livre sous forme de parchemin puis sous forme de codex rend possible cette transformation de la pensée. Tous ces éléments sont autant d’ingrédients qui engendre-ront la métamorphose du savoir traditionnel du droit en une science du droit.
Une littérature juridique émerge et avec elle les débuts d’une science. Les juristes romains ne vont plus seulement rendre des responsa ; désormais, ils les regroupent, les classent, et les relient dans des livres. Peu à peu la juxtapo-sition laisse place à une induction de règles plus générales. Par ce travail de reliance puis d’induction, le ius devient un ars , c’est-à-dire un ensemble ordonné d’éléments reliés et fondés par la raison. Le livre permet la création de théma-tiques juridiques qui le structurent et, en même temps, conceptualisent le ius. Autrement dit, des procédés litté-raires inventés par les juristes, ou que ces derniers ont repris de savants d’autres disciplines, construiront ration-nellement le ius par le développement d’un savoir de type scientifique. Les juristes se relisent entre eux, se citent, débattent et évaluent la pertinence de leurs écrits. Ainsi, à la fin de la République, le droit sera entièrement construit par des concepts, certes plus ou moins bien délimités en soi, mais d’une manière qui tranche singulièrement avec la constitution du ius de la Rome archaïque en formules divines, magiques et secrètes.
178
En quoi cette épistémologie est-elle constructiviste au sens où nous l’entendons au XXIe siècle ? La réponse à cette question tient dans le lien entre le rôle particulier des juristes, tout au long de l’histoire de Rome, et la construction d’une littérature scientifique, au cours du Ier siècle av. J.-C. D’un côté, la science des juristes est une source formelle du ius, de l’autre, ils représentent une source intellectuelle, ou doctrinale pourrait-on dire de nos jours. Or, à mesure que la littérature permet le développement d’une science du droit romaine, les juristes s’émancipent des institutions politiques. Leur science est autonome et normative.
Le schéma qui se dessine au Ier siècle av. J.-C définit indubitablement une épistémologie constructiviste. Tel le savant construisant son objet de recherche, le juriste romain édifie le ius à travers une science du droit.
Le constructivisme juridique romain est ainsi un modèle pour fonder le droit par la science. Il s’agit également d’un modèle pour fonder le droit dans la société.
§2. Un modèle pour fonder socialement le droit
Le développement de la littérature scientifique opère une transformation. Ce n’est plus l’aura divine des pontifes qui justifie la qualité de source formelle du droit des juristes. La science du droit est désormais la seule source du ius. Or, construire le ius par concepts ne consiste pas seulement à édifier le ius civile scientifiquement mais conduit également à encadrer les rapports sociaux comme la loi peut le faire dans les autres domaines juridiques.
L’invention d’un droit privé. L’autre grande invention des juristes romains réside en ceci : le droit privé constitue un ordonnancement de relations sociales qui échappe tota-lement à la logique du droit public et qui, pour autant, n’en est pas moins normatif. Les relations privées encadrées par le ius sont alors définies par la science juridique. Il s’agit
179
véritablement d’un état juridique de sociabilité des citoyens romains qui ne passe pas par le politique mais par le jeu des constructions scientifiques des juristes. Le sujet de droit privé est l’acteur de ce jeu de constructions juridiques autour de concepts de droit civil de plus en plus affirmés déclinant un grand nombre de formes contractuelles comme la vente, le prêt, le louage, mais également de notions extra-contrac-tuelles telles que l’autorité du pater familias et la dévolution successorale. Les romains y gagnent une identité sociale, celle d’un citoyen romain, propriétaire civil et sujet d’échanges marchands, qui le distingue nettement des barbares. Cette identité est le résultat de la construction scientifique du ius qui devient un droit civil.
Autrement dit, le constructivisme juridique romain est à l’origine d’un type particulier d’encadrement des rapports sociaux ; il permet de structurer la société dans les rapports privés des citoyens au travers des concepts juridiques construits par la science.
Une autre information sur le constructivisme juridique nous est délivrée. Celui-ci s’inscrit dans la société ; il permet de réguler les rapports sociaux émergents par des « construits scientifiques » ayant une portée normative.
Le constructivisme juridique se déploie ainsi au sein d’une pratique des juristes renouvelée à un moment particu-lier dans l’histoire de la cité romaine, celui d’une République en proie à une crise sociale majeure. L’épistémologie du constructivisme révèle alors une autre dimension. C’est une épistémologie de sortie de crise.
SECTION 3. LE CONSTRUCTIVISME JURIDIQUE, UNE RÉVOLUTION ÉPISTÉMOLOGIQUE DES TEMPS DE CRISE
Le constructivisme juridique des romains émerge indu-bitablement au Ier siècle av. J.-C. Caractérisera-t-il la science
180
romaine du droit jusqu’à la dissolution de l’Empire ? N’existait-il aucune autre épistémologie avant l’émergence du constructivisme ? Ces questions abordées au chapitre trois se sont révélées fécondes. Le constructivisme juridique du Ier siècle ne constitue pas une première dans l’histoire romaine qui voit tout à la fois la naissance d’une littéra-ture, d’une science et d’une épistémologie. Bien au contraire. Le constructivisme de cette période est déjà une révolution épistémologique .
S’intéresser à l’émergence du constructivisme précise sa nature de modèle épistémologique . Le constructivisme juridique des romains n’est pas vraiment une doctrine, une théorie élaborée consciemment. C’est un modèle spontané qui révèle une structure de la pensée des juristes.
Le constructivisme juridique se situe à deux niveaux : celui des doctrines intellectuelles et celui des structures de la pensée juridique.
Resitué dans l’histoire, le constructivisme juridique émerge d’un processus de refondation du droit se manifes-tant sous la forme d’une boucle. Cette boucle dans le temps décrit une révolution de l’épistémologie des juristes (§1) et éclaire sur le rôle du constructivisme dans la sortie des crises sociales les plus profondes que Rome ait connues (§2).
§1. La boucle épistémologique, le processus des révolutions épistémologiques du droit
La manière dont émerge le constructivisme juridique romain au Ier siècle av. J.-C révèle une forme particulière. Cette forme est celle d’une boucle dans le temps.
Le mouvement de boucle. Le constructivisme juridique romain n’est pas une épistémologie qui fait table rase du passé. Au contraire, l’étude de son apparition dans l’histoire
181
montre que le constructivisme juridique se développe à partir d’un outil récurrent.
En effet, au lieu de créer de nouvelles techniques, les juristes romains ont revisité le principal outil qui est le leur depuis les origines du ius : le responsum. Le développement de la littérature présidant à la transformation du savoir en science du droit s’effectue grâce au responsum. Alors qu’il semblait dépassé, cet outil à la disposition des juristes pour déterminer le droit est réemployé à une nouvelle fin : non plus celle permettant une interprétation de la Loi des XII Tables à l’adresse des magistrats dépassés par le modèle de la lex , mais celle conduisant à une consultation juridique ayant valeur scientifique pour édifier le droit dans son ensemble par la science juridique.
L’apparition de ce nouveau modèle épistémologique s’effectue dans un mouvement de retour. Le fil de l’épisté-mologie n’est pas celui d’une histoire linéaire. Au contraire, il est fait d’allers et retours dans le temps.
Or, le retour du responsum n’est pas propre au Ier siècle av. J.-C. En effet, il évolue substantiellement tout au long de l’antiquité romaine. Les principales phases de son évolution sont les suivantes. Réponse orale à une question concrète pour régler un conflit au début de la Monarchie, le responsum devient une interprétation de la Loi des XII tables au cours de la République, puis une consultation juridique ayant valeur scientifique à la fin de la République, et enfin un conseil juridique au princeps lors de l’avènement du fonc-tionnariat des juristes sous l’Empire. À l’amorce de chacune de ses évolutions, le responsum semble dépassé par d’autres techniques pour dire le droit : la lex , puis l’édit du préteur , le ius honorarium , et plus tard, les constitutions impériales. Et pourtant, le responsum revient encore et toujours alors même qu’il apparaît désuet. Il est comme « repêché » alors même qu’il devait disparaître. En somme, le responsum effectue des retours dans le temps.
182
La boucle, révolution de la connaissance. Or, le retour du responsum ne traduit pas seulement des emprunts au passé ni de simples va-et-vient. En effet, le réemploi du responsum ne conduit pas à une simple adaptation du savoir des juristes mais bel et bien à une nouvelle conception constructiviste de la connaissance du droit. Le retour dans le passé s’accom-pagne d’un progrès dans le présent. Une révolution a lieu sur le fond comme sur la forme. Autrement dit, le retour dans le passé et le progrès dans le présent délimitent un mouvement de boucle dans le temps.
L’émergence historique du constructivisme juridique romain est le fruit d’un mouvement de boucle dans le temps. Ce constructivisme juridique emprunte un outil méthodologique appartenant au passé et conduit à un progrès révolutionnaire de la connaissance dans le présent. Ainsi, la boucle est une forme qui manifeste la révolution de la connaissance du droit.
Les phases de la boucle épistémologique (fig. 3 en annexe). La forme de la boucle permet de comprendre qu’un retour dans le passé précède un dépassement du présent. La description d’une boucle révèle ainsi des phases de son déroulement dans le temps. L’évolution du responsum traduit un temps de bascule dans le passé (phase 1). La boucle se projette alors dans le passé en travaillant à un renouveau méthodologique permettant cette évolution du responsum (phase 2). Trois types de méthodes façonnent ainsi le ius au cours de son histoire : les rituels sacrés, la littérature scien-tifique et les textes légaux. Puis, une nouvelle conception de la connaissance s’élabore dans la mesure où les méthodes nécessitent une transformation du droit (phase 3). Enfin, la boucle opère un dépassement du présent par l’élaboration d’une nouvelle légitimation de la connaissance (phase 4). De nouvelles valeurs viennent justifier le progrès.
Ainsi, on retrouve les trois dimensions (méthodologique, gnoséologique et axiologique) qui constituent une épisté-
183
mologie mais resituées dans leur phase d’émergence. La boucle permet de montrer qu’il existe un ordre chronolo-gique dans leur élaboration. Un modèle épistémologique s’installe d’abord par un renouveau méthodologique, puis par une reconceptualisation et enfin par une nouvelle légitimation de la connaissance.
La boucle, rotation des épistémologie s (fig. 7 en annexe). Nous avons constaté plusieurs évolutions du responsum ; chacune d’entre elle manifeste une révolution de la connaissance du ius. Autrement dit, le mouvement de boucle s’anime plusieurs fois dans l’histoire ; il n’est pas propre au constructivisme mais commun à tous les modèles épistémologiques. Tout au long de l’histoire de Rome, trois types de boucles épistémologiques se succèdent ainsi les uns aux autres.
Dès lors, il est possible de retracer les boucles dans l’évo-lution du droit privé romain. Le ius a ainsi connu cinq boucles qui ont révolutionné sa connaissance, cinq boucles d’orientation idéaliste, matérialiste et constructiviste. Une boucle idéaliste décrit l’émergence d’une conception idéale de la connaissance, c’est-à-dire une connaissance révélée à l’homme qui s’impose à lui en tant que transcendance. Une boucle matérialiste, au contraire, manifeste une conception matérielle de la connaissance définissant celle-ci comme une donnée extérieure à l’homme s’imposant à lui en tant que réalité objective. Une boucle constructiviste met au jour, quant à elle, une conception créative de la connaissance qui s’impose à l’homme parce qu’elle est le fruit de sa repré-sentation subjective du monde. Ces trois boucles-types se sont manifestées plusieurs fois : deux fois pour la boucle constructiviste (IVe et Ier siècles av. J.-C) et deux fois pour la boucle matérialiste (IIIe siècle av. J.-C et IIe siècle ap. J.-C). La modélisation sous forme de boucle permet aussi de voir les périodes historiques qui ont manqué leur révolution épisté-mologique comme ce fut le cas au IIIe siècle ap. J.-C. où une boucle idéaliste a avorté.
184
La comparaison des boucles épistémologiques permet d’induire trois boucles-types. L’alternance de celles-ci manifeste la rotation des épistémologies dans l’histoire. Autrement dit, le constructivisme juridique, comme les autres modèles épistémologiques, est un modèle univer-sel qui s’incarne à certaines périodes historiques et dure autant que les conditions de son émergence perdurent.
La boucle, processus de refondation du droit. La boucle épistémologique exprime un lien très intime entre les fondements du droit et la connaissance du droit. C’est par une révolution de la connaissance juridique qu’émerge un nouveau fondement du droit. En ce sens, la boucle qui décrit un mouvement de révolution épistémologique est concrètement un processus de refondation du droit.
C’est par la révolution de leurs connaissances que les juristes romains élaborent de nouveaux fondements du droit.
La particularité de la boucle du constructivisme. Le processus de refondation constructiviste du droit a une particularité. Il développe une fonction épistémologique inédite. Il permet aux juristes romains de révolutionner leur épistémologie sous couvert du respect de la tradition . Alors que l’innovation est profonde, elle est totalement masquée. Le caractère scientifiquement construit de la connaissance du ius au Ier siècle av. J.-C est ainsi réinséré dans la tradi-tion par l’élaboration d’un discours de légitimation qui la respecte, celui du jusnaturalisme. La particularité porte ainsi sur la dimension axiologique de l’épistémologie des jurispru-dents : le discours de légitimation de la science repose sur un système de valeurs inédites permettant de mettre en récit le droit dans une continuité historique. Cette particularité appelle quelques précisions.
C’est par un mouvement d’évolution sans transgression de la tradition que les juristes écrivent un récit de la connais-sance qui recompose la chronologie historique dans le souci
185
de masquer les ruptures et d’afficher une continuité qui légitime le présent en l’enracinant dans un passé glorieux. La révolution constructiviste du ius est fondée à travers un récit historique totalement réécrit. C’est l’objectif de la dernière phase de la boucle, celle qui propose une nouvelle légitimation de la connaissance. Le propre de la légitimation du constructivisme réside dans l’élaboration d’un nouveau système de valeurs , celui du jusnaturalisme. Le mouvement de la boucle est comme effacé par la mise en récit de ces valeurs qui a pour fonction de conter une continuité histo-rique respectueuse de la tradition pour mieux masquer les innovations les plus fondamentales. Or, ce discours de légi-timation qui permet de fonder le ius à travers une révolution scientifique ne se retrouve pas dans les boucles suivantes. Le jusnaturalisme perdure ; aucune autre légitimation du droit n’est élaborée. En somme, le jusnaturalisme est un discours produit par la nouvelle épistémologie constructiviste afin de la légitimer en masquant son caractère révolutionnaire.
Cette expérience romaine délivre une nouvelle caracté-ristique du constructivisme juridique. Parmi d’autres modèles épistémologiques, le propre du constructivisme juridique est d’être un modèle de refondation axiolo-gique du droit. Autrement dit, la révolution scientifique opérée par le constructivisme juridique est la source d’un nouveau système de valeurs juridiques.
Qu’est-ce qui explique qu’on passe d’un modèle épisté-mologique à un autre ? Inscrites dans l’histoire, les boucles épistémologiques délivrent un dernier enseignement. Elles sont mues par le besoin de sortir d’un état de crise du droit .
§2. La révolution épistémologique du constructivisme, une réponse aux crises majeures du droit
Le savoir juridique romain a connu des révolutions au cours de son histoire antique. Les juristes ont éprouvé diffé-rents modèles pour fonder le ius. Le constructivisme juridique
186
est un modèle épistémologique parmi d’autres. Qu’est-ce qui déclenche le mouvement de boucle qui remplace un modèle par un autre ? Autrement dit, quels sont les ressorts qui initient le mouvement ?
Les ressorts de la boucle (fig. 4 et 5 en annexe). En tant que structure d’émergence épistémologique, la boucle est inséparable des ressorts qui président à son déroulement. C’est un modèle qui s’inscrit pleinement dans l’histoire. Or, ces ressorts convergent vers un diagnostic de crise.
En effet, pour chaque boucle, le savoir des juristes semble dépassé de toutes parts en période de crise sociale . Ce sont alors des ressorts extra-juridiques qui expliquent, en premier lieu, l’amorce d’une révolution scientifique du ius. La comparaison des cinq boucles permet d’identifier quatre principaux ressorts :
– l’instauration d’un nouveau régime ou de nouvelles institutions politiques,
– l’expansion du territoire romain,– le dépassement de la tradition , et– les sauts techniques (notamment du langage).
Ces ressorts ont une incidence directe sur le ius. Ce dernier semble incapable de régler les conflits et de réguler les comportements nouveaux. En second lieu, juridiquement, ce sont quatre autres principaux ressorts qui illustrent la crise du droit :
– la modification des sources du ius,– l’essor d’un pluralisme normatif,– l’ouverture disciplinaire du ius, et– la mutation du statut social des juristes.
Lorsque l’ensemble de ces ressorts convergent, une crise sociale se double d’une crise du droit et impose le besoin d’un renouvellement de sa connaissance. Autrement dit,
187
le passage d’une épistémologie à une autre est mû par un besoin de révolution épistémologique , et cette révolution est la réponse que les juristes romains élaborent pour sortir de la crise. Or, force est de constater que les crises les plus profondes qu’a connu le ius ont été à l’origine des réponses constructivistes. À cet égard, la description de la boucle du Ier siècle av. J.-C. dans le chapitre deux est sans équivoque.
La comparaison des modèles épistémologiques du ius laisse apparaître une dernière information sur le constructi-visme juridique. Il se révèle être une épistémologie de sortie de crise majeure du droit.
Le retour du constructivisme juridique ? Ces caracté-ristiques du constructivisme antique ont de quoi nourrir des interrogations pour nos temps contemporains. Des temps de crise. Des temps de mutation du droit et des ordres juri-diques. Des temps de créativité doctrinale…
Et si, d’aventure, il fallait reprendre les manuels d’intro-duction au droit qui ont tendance à assimiler l’idéalisme au jusnaturalisme, il le faudrait peut-être également pour le positivisme juridique qui se résume souvent au normati-visme. Cette présentation coutumière, assez binaire, n’est ni juste dans son contenu ni pertinente dans sa traduction de l’histoire des courants de pensée juridique. Elle ne tient pas compte du temps des épistémologies.
Alors apparaîtraient les grandes lignes d’une contre-histoire du droit. En la matière, il faut le reconnaître, beaucoup d’auteurs brillent par leur absence dans nos manuels. À commencer par Kant et le « criticisme » reposant sur le primat de la rationalité et sa prétention universelle. De même, Schmitt et son plaidoyer pour l’État total. C’est ainsi toute la période du XXe siècle qui est souvent passée sous silence, à l’exception de Kelsen qui semble régner en maître.
Cette histoire récente qui se compose de courants humanistes et anti-humanistes pourrait bien être celle de la
188
renaissance contemporaine du constructivisme juridique… La nécessité de répondre aux mutations actuelles du droit se fait sentir sous la plume de la doctrine de nombreux pays. Un nouveau fondement se cherche. Un nouveau fondement qui prendrait acte d’un droit sortant résolument de la modernité, soumis aux flux d’une économie et d’une politique radica-lement nouvelles. Un nouveau fondement à la hauteur d’un renouveau de l’État et de la démocratie, soucieux des droits subjectifs et des droits de l’homme sans pour autant se perdre dans leur démultiplication à outrance. Un nouveau fondement pour repenser au niveau plus global de toutes les normativités (éthique, technique, gestionnaire, juridique, etc.), les idéaux qui guideront nos comportements sociaux en conscience.
Comme si nous étions nous-mêmes dans un processus de refondation du droit…
189
Annexe
Huit figures
Fig. 1 : La notion de fondement du droit et les dimen-sions de l’épistémologie
Fig. 2 : La place du jusnaturalisme dans l’épistémologie juridique des romains
Fig. 3 : La boucle épistémologique, processus de refon-dation du droit
Fig. 4 : Les crises à l’origine de la boucle épistémologiqueFig. 5 : Les ressorts critiques de la boucle épistémologiqueFig. 6 : Un exemple de boucle épistémologique : la
seconde boucle constructivisteFig. 7 : Les trois types de boucles épistémologiquesFig. 8 : Apparition chronologique des doctrines grecques
du droit naturel, du jusnaturalisme et des modèles épistémo-logiques du ius (idéalisme, constructivisme et matérialisme)