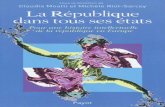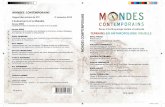La Liberté des contemporains, 2011 : introduction et conclusion
-
Upload
univ-grenoble-alpes -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La Liberté des contemporains, 2011 : introduction et conclusion
Présentation de l’ouvrage :
L’idée de république est en crise, car le projet politique de la modernité a
échoué. Il visait depuis le XVIIe siècle à unifier l’espace civique et à le penser
comme un vaste ensemble soumis à la même discipline. De plus, un soupçon
plane sur la référence républicaine exacerbée dans les discours actuels : dans le
contexte de l’érosion des souverainetés nationales sous l’effet de la globalisation
et de la construction de l’Union Européenne, cette référence apparaît au mieux
comme une incantation vers un passé rassurant mais défunt, au pire comme un
levier démagogique qui en appelle à la souveraineté toute puissante du
« peuple ». Il s’agit donc de savoir si l’on gagne à se passer ou si l’on peut
sauver quelque chose de cette référence ; l’auteur enquête à ce titre sur les
principes fondamentaux du discours républicain, tout en les situant dans
l’histoire concrète des évolutions politiques.
Si une certaine forme de républicanisme est périmée, le projet républicain
demeure d’actualité : créer les conditions de la communauté civique apparaît
même comme une nécessité pour la démocratie en voie de dépolitisation.
L’ouvrage s’attache à déterminer ce que signifie aujourd’hui cette perspective,
grâce à une confrontation entre le républicanisme et les autres courants de la
pensée politique moderne : marxisme et socialisme, libéralisme et
néolibéralisme. Il propose un nouveau concept d’intérêt général et indique
comment l’expérience collective de la culture offre un biais pour construire la
communauté civique dans le cadre de la société démocratique. Le moment est
venu de repenser la distinction cardinale entre « liberté des anciens » et « liberté
des modernes » qui enferme l’action politique dans un dilemme insoluble. La
liberté des contemporains offre l'opportunité de redonner au mot de « liberté »
son sens politique qui, de nos jours, n’est plus que formel ; une telle ambition est
possible grâce à un dialogue sans concessions entre le républicanisme et le
libéralisme politique.
Présentation de l’auteur (2011) :
Thierry Ménissier, né en 1964, est agrégé de philosophie, docteur de l'Ecole des
Hautes Études en Sciences Sociales (Centre Raymond Aron, Paris), et
actuellement maître de conférences de philosophie politique habilité à diriger les
recherches en science politique et en philosophie à l'Université Pierre Mendès
France – Grenoble 2. Il anime le réseau Recherches Philosophiques Franco-
Italiennes (RePFI), du centre de recherches Philosophie, Langages et Cognition
de cette université. Il préside depuis 2004 la Société alpine de philosophie, et est
également le fondateur et l’organisateur des Rencontres Philosophiques
d’Uriage.
Auteur d’une cinquantaine d’articles dans des revues académiques et de
chapitres d’ouvrages collectifs, il a également publié les livres suivants :
- Eros philosophe. Une interprétation philosophique du Banquet de Platon,
traduction du Banquet suivie d'un essai interprétatif, Paris, Kimé,
collection « Philosophie Épistémologie », 1996, 155 pages.
- Machiavel, la politique et l'histoire. Enjeux philosophiques, Paris, P.U.F.,
collection « Fondements de la politique », 2001, 270 pages.
- Machiavel, Le Prince ou le nouvel art politique (codirection avec Y.-C.
Zarka), Paris, P.U.F., collection « Débats philosophiques », 2001, 250
pages.
- Le vocabulaire de Machiavel, Paris, Ellipses Marketing, collection
« Vocabulaire de », 2002, 62 pages.
- L'idée de contrat social. Genèse et crise d'un modèle philosophique
(codirection avec J.-P. Cléro), Ellipses Marketing, collection « Philo »,
2004, 172 pages.
- Éléments de philosophie politique, Paris, Ellipses Marketing, 2005, 247
pages.
- Lectures de Machiavel (codirection avec M. Gaille-Nikodimov), Paris,
Ellipses-Marketing, 2006, 368 pages.
- L'idée d'empire dans la pensée politique, historique, juridique et
philosophique (direction), Paris, L’Harmattan, collection « La Librairie
des Humanités », 2006, 280 pages.
- Machiavel ou la politique du Centaure, Éditions Hermann, « Hermann
Philosophie », 2010, 548 pages.
Sommaire
Introduction
La faillite du Léviathan
Première partie
Le patrimoine théorique républicain et ses limites
Chapitre I : La république dans le projet moderne
Le legs de l’Antiquité
Le républicanisme moderne : réception ou invention ?
Volonté générale et discipline du citoyen
Chapitre II : Nation et peuple : les protagonistes de la communauté civique
Culture et communauté politique, un lien constitutif et problématique
Individu, culture et communauté politique dans le contexte de la globalisation
Identités ethniques et politiques dans la construction de l'Union Européenne
Chapitre III : Quelle théorie normative pour la république aujourd’hui ?
Théorie normative et spécificités de la démocratie
Scepticisme, démocratie et pluralité
Républicaniser la démocratie, une nécessité
Deuxième partie
Penser la « liberté des contemporains »
Chapitre IV : Sortir du dilemme des « deux libertés »
Une dichotomie, plusieurs enjeux
Constant et Berlin, pères de la conception moderne et négative
La dialectique de la liberté
Chapitre V : Généalogie du sujet de l’intérêt
La révolution hobbesienne
Intérêt et subjectivité dans la tradition libérale
La pluralité démocratique des intérêts
Chapitre VI : Le lobbyisme, mise en forme « intéressée » de la décision publique
L’action des groupes de pression
Le lobbyisme favorise-t-il une « représentation privée » ?
La nécessaire redéfinition de la partition privé / public
Troisième partie
Républicanisme et culture démocratique
Chapitre VII : « Recomposer » l’intérêt général
Modèles participatif et délibératif de la démocratie
L’étrange destin de la notion d’intérêt général
La composition des intérêts sociaux et de l’intérêt public
Chapitre VIII : La dynamique des lois et des mœurs
Passions dominantes et moralité civique
Eduquer aux vertus démocratiques
La question des jugements collectifs de goût
Chapitre IX : communauté civique et démocratie sociale
Repenser les fondements du droit individuel de propriété
Utilité sociale de la propriété et solidarité
Le chantier de l’égalité
Conclusion
Réinventer la république : élargir et approfondir la communauté civique
Introduction
La faillite du Léviathan
« But as the Inventions of men are woven, so also are they
ravelled out ; the way is the same, but the order is
inverted. »
Thomas Hobbes,
Leviathan, or The Matter, Forme & Power of a
Commonwealth ecclesiastical and civill, chap. XLVII,
Edited by C.B. Macpherson,
Londres, Penguin Books, 1985, p. 7101.
Avec cette remarque, Thomas Hobbes, le philosophe anglais qui composa son œuvre
vers le milieu du XVIIe siècle dans le contexte de la guerre civile, entend signifier que les
cadres politiques d'une société peuvent être défaits selon un processus symétrique de celui qui
les a faits. Il évoque donc une réalité susceptible d'engendrer un certain vertige : la
constitution civique de la société – processus délicat et souvent humainement coûteux –
apparaît toujours passible d’une pénible « déconstitution ». Si la métaphore du tissage
constitue depuis l’Antiquité une référence majeure pour désigner la tâche de l’art politique,
elle se trouve employée ici pour dire la régression provoquée par la crise des paradigmes qui
assuraient l’action humaine. Et derrière cette régression, elle évoque les dangers de la
désagrégation de l’investissement civique, jusqu’à la perte de ce qu’une autre éminente
philosophe politique, Hannah Arendt, nommait la perte du « monde commun ». En d’autres
termes, tandis que, selon le récit philosophique hobbesien fondateur de la modernité politique,
le patient travail de conception et de mise en œuvre de la chose publique a pour finalité
l’émergence et l’efficience du « grand Léviathan » capable, en régulant les passions humaines
1 « Mais les inventions des hommes se défont de la même manière qu’elles ont été tissées : le processus
est le même, l’ordre seul est inversé », Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la
république ecclésiastique et civile, chapitre XLVII, trad. J. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p. 705.
naturellement désordonnées, de conjurer la violence sociale, on ne doit jamais perdre de vue
l’échec éventuel de cette tentative. Avec lucidité, le philosophe de Malmesbury envisage la
faillite du Léviathan comme une possibilité toujours comprise dans le mouvement de sa
constitution.
Si notre époque semble moins agitée que l’était le XVIIe siècle, nous croyons qu’elle
correspond à une illustration possible de la sentence de Hobbes, et cela pour plusieurs sortes
de raisons. D’abord, pour des raisons historiques de long terme : le projet moderne du
Léviathan était celui d’une société politique adossée à la fondation rationnelle du pacte et
régie par un Etat parfaitement souverain ; or, ce projet a trouvé ses limites au sein même de
l’histoire des nations européennes, c’est-à-dire dans le cadre de ce qui en fut le laboratoire
privilégié : l’ensemble du XXe siècle porte le témoignage de la faillite de la forme étatique dès
lors qu’elle est trop radicalement entendue, qu’il s’agisse des énormes destructions guerrières
dues à l’exacerbation de l’Etat-nation ou des effroyables résultats des sociétés totalitaires, ces
deux modes d’assujettissement des individus citoyens par les cadres mêmes qui prétendaient
les émanciper. La réalité contemporaine peut même être comprise en fonction d’une double
rupture avec le projet hobbesien : au niveau mondial, d’une part, le développement de la
globalisation économique recompose les relations de pouvoir de telle manière que la structure
« verticale » du gouvernement – cette forme proprement moderne de la direction politique,
tout à la fois rationnelle, publique et stabilisée – est amenée à se redéfinir de manière
différente, à savoir en tant que gouvernance, autrement dit comme structuration immanente et
indéfinie des interactions complexes de pouvoirs fondamentalement hétérogènes2. Sous
l’influence grandissante de la forme de pensée néolibérale, toutes les constructions théoriques
classiques se trouvent de ce point de vue bouleversées et remises en question, qu’elles soient
issues du républicanisme ou du libéralisme politique. Sur un plan européen, d’autre part,
l’émergence progressive durant ces soixante dernières années du projet d’un vaste espace
commun post-national remet en question le modèle traditionnel de la souveraineté : la
perspective d’une société démocratique continentale riche de la culture des vingt-sept Etats
membres et reposant sur l’expression de plus de cinq cent millions d’eurocitoyens repose la
question de l’ajustement des volontés individuelles par le pacte civil en des termes alternatifs
2 Sur la globalisation, voir André Tosel, Un monde en abîme. Essai sur la mondialisation capitaliste,
Paris, Editions Kimé, 2008 ; et Saskia Sassen, La globalisation : une sociologie, trad. P. Guglielmina, Paris,
Gallimard, 2009.
par rapport aux cadres mentaux proposés par le penseur anglais.
Mais la manière dont la sentence de Hobbes concerne nos préoccupations directes
regarde surtout l’évolution préoccupante du thème de la république dans le paysage des
sociétés occidentales. Spontanément, la notion de république évoque un espace public apaisé
et clairement organisé ; elle symbolise également ce qui peut être considéré comme une des
finalités fondamentales de l’art politique : la création par des hommes de quelque chose de
commun. Or, si on la saisit dans le discours des politiques d’aujourd’hui, la référence
républicaine apparaît singulièrement brouillée, notamment en France, où, loin d’identifier
clairement une position univoque, elle est revendiquée aussi bien par la droite sarkozyste3 que
par le socialisme fortement marqué à gauche d’un Jean-Luc Mélenchon4. Appréhendée dans
une optique théorique, la notion de république n’offre pas davantage de garantie : depuis
plusieurs siècles elle constitue certes un thème de référence pour nos textes constitutionnels
ainsi qu’un axe cardinal pour nos manières personnelles de nous rapporter à l’activité
politique et pour nos rituels civiques collectifs ; toutefois, son évolution pose au philosophe
politique plusieurs problèmes originaux vis-à-vis desquels la maîtrise des concepts de la
tradition (proposés par une tradition intellectuelle qui court de Machiavel à Tocqueville)
constitue peut-être un outillage insuffisant. La crise que connaissent aujourd’hui un certain
nombre de concepts ou de réalités politiques fondamentaux pour cette dernière, tels que la
nation ou le peuple, l'égalité des droits, l’intérêt général, le système représentatif – tous
cardinaux dans la tradition de pensée républicaine – se complique du fait qu’ils constituent
encore la grammaire civique de nos sociétés. Comme de nombreux autres observateurs de
cette crise, nous avons été conduits à réfléchir à la signification de ces concepts qui, pendant
des dizaines d’années, ont permis d’inscrire le développement la démocratie dans l’horizon
républicain.
Quoique le mot puisse paraître galvaudé, la notion de république demeure d’une
complexité redoutable. Entendue dans son acception classique et quelles que soient les formes
variées qu’elle a revêtues, elle implique en premier lieu la mise en œuvre de la communauté
civique. Ainsi l’ont conçu les « pères fondateurs » des thématiques républicaines, Aristote et
3 Voir par exemple l’entretien donné au journal Le Monde par Henri Guaino, conseiller spécial du
Président Sarkozy, dans l’édition datée des 12 et 13 décembre 2010 et intitulé « Tout concourt insidieusement à
affaiblir notre modèle républicain ». 4 Voir Jean-Luc Mélenchon, La République sociale, Paris, L’Harmattan, 1992 ; et plus récemment,
Qu’ils s’en aillent tous ! Vite, la révolution citoyenne, Paris, Flammarion, 2010, chapitre I : « La refondation
républicaine », p. 21 sq.
Cicéron ; malgré leurs différences, Grecs et Romains s’accordaient à propos de la
représentation de la « chose politique commune » comme quelque chose de supérieur aux
individus qui y agissent ; quand on le réfère à son origine antique avec une terminologie
sociologique, le républicanisme est donc plutôt un holisme. Ensuite, dans sa version moderne
née en Italie vers le milieu du XVe siècle dans le contexte de l’humanisme civique, il évolue
vers un holisme d’un type particulier, presque contradictoire car, loin de dissoudre l’individu
dans les constructions sociales (comme le font, chacun à leur manière, le tribalisme
caractéristique des sociétés traditionnelles, et, pour la modernité, aussi bien les différents
conservatismes que les formes variées du marxisme), il reconnaît à ce dernier un rôle
fondamental, notamment en tant que citoyen dans l’espace public, comme tel coresponsable
avec les autres citoyens de son destin historique. A cet égard, on a même pu soutenir avec une
certaine pertinence la thèse a priori étonnante selon laquelle la pensée républicaine française
typique de la IIIe République constitue une variante du libéralisme politique
5. Ce qui n’est pas
faux, c’est que, compte tenu de la place qu’elle accorde aux choix des individus vis-à-vis du
groupe et bien qu’elle soit liée au socialisme, la version moderne du républicanisme a parfois
été plus proche du libéralisme que du marxisme6. Un degré de complexité supplémentaire
provient du fait que le courant républicain s’est trouvé impliqué, lors son affirmation
historique en Europe, dans le développement des nationalités, ou, mieux dit, dans le processus
d’institutionnalisation des nations sous la forme des États-nations. Les différentes formes du
républicanisme européen sont d’ailleurs reliées à cette fragmentation nationale, voire, dans
une large mesure, issues de ce mouvement. Enfin, ultime difficulté, en dépit de cette
fragmentation ou plus exactement dans son sein même, tout au long de son développement
historique le républicanisme s’est conçu comme un universalisme : les élaborations
philosophiques, juridiques et politiques « situées » issues des contextes nationaux ont à des
degrés divers (aux U.S.A., en France) été envisagés comme devant valoir pour l’humanité
toute entière. Avant qu’ils ne se développent selon une dynamique éthique propre,
l’expérience républicaine a promu les droits universels de l’homme comme droits politiques
5 Cf. Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique et société, Paris, Gallimard,
2009, p. 257-266. 6 Dans Le moment républicain en France (Paris, Gallimard, 2005), Jean-Fabien Spitz a montré que lors
d’un de ses points d’incandescence, en France au moment de l’affaire Dreyfus, le républicanisme correspondait
non pas, comme on le croit souvent, à l’apologie de l’Etat, mais à l’émergence d’une « société des individus »
pour laquelle la revendication d’égalité doit être considérée comme une des conditions de la liberté.
des citoyens7. Précisément, le lien entre la république et l’universel – un lien fondateur,
spécialement dans le cas de la France – se trouve aujourd’hui lui-même remis en question.
Les facteurs d’évolution mentionnés plus haut réapparaissent ici sous un autre angle de vue :
la montée en puissance de l’Union Européenne a impliqué une érosion constante de la
souveraineté nationale des États membres, et corrélativement une modification progressive de
leurs politiques publiques ; la globalisation des échanges contribue également à la
reconnaissance d’une pluralité qui s’avère contradictoire avec la volonté républicaine
d’incarner l’universel – en tant que « dé-limitation » du monde8, elle contrevient au principe
de territorialisation caractéristique de la souveraineté traditionnelle. Il apparaît donc
nécessaire de sonder la crise de la république, non moins que d’envisager si et à quelles
conditions une nouvelle façon de la concevoir peut permettre d’en sauver le principe : quelle
communauté politique, et quelles libertés civiques pour nos sociétés démocratiques plurielles,
prises dans des ensembles juridico-politiques aux frontières floues, et traversées par les effets
déstructurants de la globalisation ?
Avant d’examiner le sens de ces questions, il convient de caractériser en quelques
mots la démarche que nous voulons emprunter. Ce livre contient des arguments
philosophiques et s’inscrit dans une recherche théorique sur la culture politique de notre
époque. Cependant, l’auteur doit avouer certaines motivations plus proches de l’actualité.
Affirmer que le monde est entré dans une phase de globalisation signifie que chaque année,
davantage d’économies nationales se trouvent interconnectées dans le marché mondial. Et
constantes sont désormais les interactions entre les marchés, les politiques publiques, les
innovations scientifiques et technologiques. En d’autres termes, le mouvement même du réel
le rend terriblement difficile à penser. Notre monde est en quête des théories qui, parce
qu’elles sauront rendre compte de ce qui cause cette difficulté, nous permettrons d’y évoluer
avec davantage de justesse. Or, dans le même temps, plusieurs nations européennes, foyers de
républicanisme et terroirs de haute culture, se sont dotées de leaders politiques dont les faits et
gestes semblent les situer radicalement à contre-courant de cette entreprise : en France comme
en Italie, confrontés aux problèmes posés par de tels ensembles effarants de complexité, ces
7 Voir à ce propos cette déclaration emblématique de Condorcet : « Une constitution républicaine est la
meilleure de toutes. C’est celle où les droits de l’homme sont conservés, puisque celui d’exercer le pouvoir
législatif, soit par lui-même, soit par ses représentants, est un de ces droits » (Vie de Turgot, cité in Charles
Coutel, Politique de Condorcet, Paris, Payot & Rivages, 1996, p. 113.). 8 Cf. Daniel Innerarity, La démocratie sans l’Etat. Essai sur le gouvernement des sociétés complexes,
trad. S. Champeau, Paris, Climats/Flammarion, 2006, p. 169-170.
leaders répondent par une rhétorique simplifiée autour d’un culte archaïsant du « je » ;
sollicités par le désir d’autonomie des populations politiquement et moralement adultes, ils
offrent la solution d’une « hyperprésence » ; à leur volonté d’émancipation, ils objectent des
raisonnements hiérarchiques centrés sur des solutions bureaucratiques ; et comme si cela ne
suffisait pas, face à la revendication de la pluralité des cultures, ils imposent les vieilles lunes
de « l’identité nationale », agitant même le spectre de l’exclusion pour les citoyens « d’origine
étrangère ». Tout cela, en revendiquant pourtant haut et fort l'héritage républicain typique de
notre tradition : il ne passe quasiment pas une semaine sans que les leaders politiques les plus
divers ne s’en réclament. Bref, il est semble que nos sociétés démocratiques n’ont pas encore
rencontré les leaders qui seraient à la hauteur des défis qu’elles posent. Et non seulement il
règne une grande confusion quant à la signification du mot « république » aujourd’hui, mais
encore un légitime soupçon pèse désormais sur la référence à la république dans le discours
des politiques : au mieux, cette référence semble faire partie d'une rhétorique convenue, au
pire elle apparaît comme une incantation au sein d'un rapport magique au monde dont les
effets sont largement démagogiques. Ce livre, dans l’intention de fournir une analyse de
certains de ces défis, espère aussi clarifier le sens de la notion de république et par suite
participer au renouveau culturel dont a besoin la politique de notre époque.
C’est en vue d’un tel renouveau que nous convions le lecteur à un parcours sur les
chemins de la théorie politique. Notre démarche s’inscrit dans la perspective de la
connaissance conceptuelle caractéristique de la philosophie. Bien sûr, la république
correspond d’abord à une expérience vécue de la politique : il est même possible d’en
examiner les caractères à partir de l’étude des épisodes historiques qui, par le passé, ont vu
émerger un comparable processus de constitution d’une communauté civique9. Cela posé, il
est remarquable que, dans des contextes historiques variés, la notion de république a désigné
des régimes très divers, tour à tour révolutionnaires, modérés, socialement progressistes et
conservateurs10
. Cette variété tend à la faire apparaître comme un des termes les plus
9 Voir par exemple les épisodes de référence étudiés dans Claudia Moatti et Michèle Riot-Sarcey (dir.),
La République dans tous ses états. Pour une histoire intellectuelle de la république en Europe, Paris, Payot &
Rivages, 2009 : la République romaine, les communes italiennes du XIIIe au XV
e siècle, la République du
Consiglio Maggiore de Florence à partir de 1494, les Provinces-Unies et la Configuration helvétique au début de
l’époque moderne, l’Angleterre du milieu du XVIIe siècle, les cinq Républiques françaises (avec les dates
symboliques de 1792, 1848, 1871, 1940 et 1958) – expériences de référence auxquelles il est nécessaire d’ajouter
le moment de l’Indépendance et de la constitution états-uniennes à partir de 1776. 10
Dans une optique libérale, Philippe Nemo soutient que cette équivoque est ancienne et fondamentale
dans le paysage intellectuel de la politique française ; la République y apparaît à la fois comme Etat de droit
controversés du lexique de la théorie politique. Mais elle signifie simplement que la
république n’est ni une forme de régime, ni un type d’action gouvernementale, mais plutôt un
tour d’esprit politique, un « esprit des lois » particulier. Elle renvoie d’une part à l’affirmation
du politique entendu comme participation des citoyens à la « chose commune », et partant à la
création d’une communauté politique ; et de l’autre à la visée d’institutionnalisation du sujet
collectif qui en résulte. Par le premier aspect, elle se rapproche de l’expérience
révolutionnaire, par le second elle évoque la constitution de l’Etat moderne. Notion complexe,
philosophiquement articulée et « non sans paradoxes », la république peut donc également
être caractérisée comme une « idée », à savoir comme quelque chose qui prend son sens du
point de vue de l’abstraction, voire comme un idéal régulateur de la pratique politique selon
ce double aspect11. Parce que nous voulons penser la république, il nous faut donc considérer
à leur juste mesure, et c’est ce que nous ferons dans cet ouvrage, l’apport de la théorie
politique contemporaine, notamment telle qu’elle est issue du courant dit néo-républicain.
Plus précisément encore notre démarche se veut normative. Entendue d’une manière
générale, la théorie politique peut être descriptive, critique, ou normative. Certainement, en
fonction des attentes normalement exprimées vis-à-vis de la théorie, toute théorie est
descriptive : on attend évidemment d'une théorie qu'elle fournisse des séries de concepts
susceptibles de décrire adéquatement la réalité afin de mieux comprendre cette dernière et de
pouvoir y évoluer en connaissance de cause. De leur côté, les théories critiques sont
également descriptives, proposant par exemple (pour prendre des idées politiques aujourd’hui
répandues) des concepts tels que ceux, marxistes, d'aliénation et d'exploitation, ou ceux,
foucaldiens, de pouvoir disciplinaire et de biopouvoir. Les uns et les autres possèdent une
certaine valeur descriptive, et ils permettent de plus de mettre en question les réalités socio-
politiques constituées, ils les remettent en cause : les concepts marxiens visent à dénoncer le
marché de dupes dont les travailleurs sont victimes dans le schéma de production capitaliste ;
les notions foucaldiennes entreprennent de dénouer les liens étroits qui se tissent entre le
savoir et le pouvoir en vue d’exercer un contrôle tant sur les corps que sur les esprits. Dans le
cas de la théorie normative, enfin, la dimension descriptive se redouble de la capacité
explicitement formulée de réfléchir les thèmes majeurs de l'action collective au point de
démocratique et libéral, et comme projet de société étatiste et socialiste. Cette équivoque existerait depuis qu’en
1793 la Première République a mis à mal l’œuvre législative de 1789, qui était l’héritière des Lumières. Voir
Philippe Nemo, Les deux Républiques françaises, Paris, P.U.F., 2010. 11
Cf. Juliette Grange, L’idée de république, Paris, Pocket, 2008, p. 28.
donner prise aux citoyens sur leur existence par le biais de la décision politique. Même en
présentant aussi schématiquement les choses, on comprend de ce fait qu’une théorie
normative est doublement éclairante pour le jugement : elle oriente l'expérience et fournit
certains moyens pour y agir. Plus que toute autre forme de théorie, la théorie normative place
donc un certain espoir dans la dimension politique, domaine de l'agir commun. Plus
exactement, la normativité à laquelle peut espérer prétendre la théorie politique est fonction
de la possibilité même d'une action collective. Cette réflexion nous ramène directement à
notre objet principal d’étude, à savoir la république ; en effet, si toute théorie normative n'est
pas républicaine, du fait qu’elle invite les citoyens à réfléchir et à construire leur espace
commun, la doctrine républicaine est par excellence normative, ou bien, tout simplement, elle
n'est pas.
Comment s'exprime la normativité de la théorie politique ? Dit autrement, comment la
théorie peut-elle agir sur la réalité ? Ces questions, la philosophie les a toujours posées, mais
elles prennent un relief particulier depuis qu’elles sont formulées dans le contexte de nos
sociétés démocratiques, car il est devenu spécialement difficile d'y répondre du fait que, dans
ces sociétés, des systèmes multiples et variés (qu’il s’agisse d’instances de la décision
publique et privée, de sources de production des biens et des services, ou des foyers de
contestation) interagissent sans cesse pour composer la réalité sociale. Moins que jamais, nous
ne saurions trouver des réponses toutes faites à ces questions ; nous pouvons toutefois
suggérer une piste en évoquant le style d’une réponse possible – style qui concerne à au moins
deux titres les relations complexes entre le réel et le possible.
Premièrement, on peut faire l'hypothèse que la théorie normative a la compétence
nécessaire pour mener à bien une telle tâche. Dans l'ensemble des qualités requises pour la
recherche intellectuelle, la qualité spécifique pour la théorie politique consiste ainsi en une
capacité particulière d'invention conceptuelle : il s'agit pour elle de forger des concepts
inventifs, et de les mettre à l'épreuve des faits historiques et politiques afin de les constituer en
paradigmes utiles, principes futurs des règles juridiques et précieux appuis pour les décisions
collectives. Dans un monde contemporain sans cesse renouvelé par l’innovation
technologique, l’invention conceptuelle apparaît comme un impératif vital pour la philosophie
politique.
Deuxièmement, la théorie peut s’inscrire dans l'optique de ce que Robert Damien
désigne par les termes de « construction d'une rationalité du conseil »12
. Fort différente de la
figure de l'expert qui de nos jours a surinvesti la réalité politique, la figure du « conseiller »
n'est pas sans lien avec la dimension du possible évoquée avec la première orientation. Tandis
que l'expert s'attache à observer les faits grâce aux ressources de la science expérimentale et à
envisager l'avenir grâce à celles du calcul, le conseiller envisage le possible en exploitant des
ressources de type culturel. Aussi Damien, dans son archéologie politique de la rationalité
politique, décèle-t-il la genèse du conseil moderne dans la mise en œuvre des bibliothèques
d'Etat. Nulle conception patrimoniale des données culturelles dans cette manière d'envisager
la théorie normative par le biais de la rationalité du conseil : comme le ferait certainement un
Secrétaire florentin de notre temps, il est au contraire nécessaire de traverser les sources qui
sont mobilisées comme ressources, et d'agir sur elle avec la même précision mobile qui était
celle de Machiavel face au savoir politique des Anciens13
. De la sorte, si la lecture constitue le
ressort principal du conseil, « le lecteur est moins le substrat d'une conscience dépositaire d'un
universel que le support dynamique d'un affrontement des contraires »14
. De là un état d'esprit
extrêmement différent de celui qui préside à l'expertise : dans cette quête indéfinie du
judicieux point de vue pour le jugement conseiller, il est nécessaire de faire son deuil de l'avis
impeccable qu’on espère de la science experte, et de rompre avec toute conception totalisante
de la vérité en politique. Dans la mobilité structurelle qui consiste à parcourir des livres, « le
lecteur est une sorte de centaure mitoyen circulant dans plusieurs mondes. Toujours décalé
sinon souvent en porte-à-faux, il ne prétend pas pourtant habiter le point de vue de Dieu et
donner à voir le tout »15
. La tâche du conseil, tournée aussi bien vers les sources culturelles
fondatrices de la civilisation que vers les innovations de notre temps, est aussi longue et
périlleuse que l'action politique elle-même, dans une histoire commune à jamais ouverte ;
c’est elle qu’avec ce livre nous voulons reprendre et poursuivre.
Un livre de plus, donc, sur l’idée de république ? Peut-être, mais qui repose sur un
soupçon à la fois salutaire et inquiétant : l’inflation actuelle du vocable républicain est
12
Cf. Robert Damien, Bibliothèque et Etat, naissance d'une raison politique, Paris, P.U.F., 1995, et Le
conseiller du Prince de Machiavel à nos jours. Genèse d'une matrice démocratique, Paris, P.U.F., 2003. 13
Cf. la fameuse de lettre de Machiavel à Francesco Vettori du 10 décembre 1513, qui décrit la manière
machiavélienne de se recueillir « le soir » afin de s’interroger avec les maîtres anciens sur ce qui se passe « le
jour » (dans Nicolas Machiavel, Oeuvres, trad. sous la dir. de C. Bec, Paris, Robert Laffont, 1996, p. 1239), ainsi
que, dans l'épître dédicatoire du Prince à Laurent de Médicis, le passage qui induit la tension dialogique comme
matrice de l'intelligence politique (ibidem, p. 110). 14
Cf. Robert Damien, Le conseiller du Prince de Machiavel à nos jours, op. cit., p. 393. 15
Robert Damien, « Machiavel et le miroir brisé du conseil », dans Thierry Ménissier et Yves Charles
Zarka, Machiavel. Le Prince ou le nouvel art politique, Paris, P.U.F., 2001, p. 96.
corrélative de la crise de nos institutions, de la désaffection de la politique sous ses formes
traditionnelles, et, derrière la transformation du marché mondial sous l’effet du
néolibéralisme, de la crise du sens commun16
. Elle correspond si étroitement à ces
phénomènes qu’il est tentant de la considérer comme un symptôme, au sens psychanalytique
du terme, à savoir comme une représentation-écran vis-à-vis d’angoisses ressenties comme
insupportables. Le doute, lorsqu’il se propage, devient gênant. Mais avec le malaise qui en
résulte, l’opportunité nous est aujourd’hui offerte de savoir si l’on peut se passer de la
référence à la république, et également quel coût aurait le dépassement de cette référence. La
construction d’une société démocratique, où la liberté privée et publique ne relève pas d’une
incantation, en quoi saurait-elle s’émanciper du recours théorique à l’idée de la communauté
politique ? Ou alors, s’il convient d’en sauver quelque chose, que nous apporte aujourd’hui la
représentation d’une « chose commune », et comment l’entendre exactement vis-à-vis des
urgences et des contradictions de notre monde ?
16
Cf. Denis Sieffert, Comment peut être (vraiment) républicain ?, Paris, La Découverte, 2006 ; Monique
Boireau-Rouillé, « Les enjeux du retour de l’idée de république dans le débat politique et intellectuel français »,
dans Claudia Moatti et Michèle Riot-Sarcey (dir.), La République dans tous ses états, op. cit., p. 95-126.
Conclusion
Réinventer la république : élargir et approfondir la communauté civique
« Cependant il ne peut y avoir ni vraie liberté ni justice
dans une société si l’égalité n’y est pas réelle ; et il ne peut
y avoir d’égalité si tous ne peuvent acquérir des idées
justes sur les objets dont la connaissance est nécessaire à
la conduite de leur vie. L’égalité de la stupidité n’en est
pas une, parce qu’il n’en existe point entre les fourbes et
leurs dupes : et que toute société qui n’est pas éclairée par
des philosophes est trompée par des charlatans. »
Condorcet,
Journal d’instruction sociale. Prospectus17
Cette enquête sur les principes du républicanisme, nous l’avons conçue à la lumière de
la question de savoir si l’on devait aujourd’hui conserver à la fois le vocable et la grammaire
de la république, en soupçonnant, compte tenu des évolutions de notre monde, une usure
sémantique du premier et une possible péremption de la seconde. Nous pouvons conclure
cette enquête avec les résultats suivants : de fait, les notions cardinales de peuple, d’égalité, de
liberté politique, de légitimité de l’Etat ne peuvent plus valoir avec l’autorité que leur
conférait le discours républicain standard ; celles de peuple et de nation, plus particulièrement,
ne renvoient plus à une unité substantielle sur laquelle l’entendement pourrait compter afin de
déterminer aisément qui est le sujet politique légitime ; cette confusion des principes n’est en
soi nullement dramatique, du moins tant qu’il existe des cadres privilégiés pour un débat
public instituant, et pour des procédures qui transforment la pluralité conflictuelle en force de
proposition tangible pour la création des lois ; de plus, on remarque que, si le capitalisme
s’étend et offre au néolibéralisme la possibilité de s’imposer comme doctrine universelle
régissant les affaires, des dynamiques participatives apparaissent un peu partout sur la planète,
reflet d’une authentique aspiration à faire l’épreuve de la démocratie ; enfin, la recherche
17
Cité in Charles Coutel, Politique de Condorcet, op. cit., p. 38.
théorique concernant cette dernière n’a, dans l’histoire humaine, jamais été aussi massive ni
active. Une telle activité rejaillit sur le débat des anciennes questions républicaines, ainsi
qu’en témoigne le questionnement que leur adresse aujourd’hui le néo-républicanisme. En
d’autres termes, quand bien même la rhétorique républicaine de certains leaders politiques
d’aujourd’hui s’apparente effectivement à l’incantation magique ou à la manipulation
démagogique, si « république » signifie bien « expérience de la communauté politique »,
l’idée républicaine, ramenée à ses caractères essentiels, n’est pas encore devenue désuète car
elle peut s’appliquer à certains phénomènes importants de notre temps.
Nous avons montré, dans ce livre, à quelles conditions une telle possibilité nous
semble capable d’offrir ses ressources : il est nécessaire de contrer les effets du monisme
culturel et politique hérité de la tradition française du républicanisme, au profit d’une culture
de la participation et d’une pratique de la délibération qui, toutes deux, demeurent en
souffrance dans notre pays. Attitude qui revient à assumer les conséquences théoriques de
l’anthropologie « humaniste civique » (selon laquelle l’homme ne devient lui-même que
lorsqu’il œuvre à son émancipation par le biais de la participation civique), tout en ne
s’enfermant pas dans une conception substantielle de la morale civique. Les « valeurs de la
république », cette dernière doit les établir dans le mouvement même du débat qui constitue le
sujet collectif légitime. Actuellement, le débat existe sous deux formes : sous celle du débat
politique institutionnel, puisque dans les régimes démocratiques les élus, qui en ont reçu le
mandat, débattent au sein des assemblée afin d’établir les lois communes ; et sous celle du
débat public généraliste sur les questions politiques, sociales, culturelles et morales dans le
cadre des médias. Nous estimons que les évolutions actuelles rendent nécessaires un
déplacement des lignes structurant ces partitions, ainsi que la mise en œuvre d’une troisième
et d’une quatrième formes de débat, dont le déficit est aujourd’hui patent : il s’agit de créer les
conditions d’un débat politique généraliste préparant, pour certaines questions importantes,
un débat public institutionnel. En d’autres termes, nos démocraties formelles doivent
permettre à davantage d’individus particuliers de participer, pour autant qu’ils le souhaitent, à
un questionnement commun qui les responsabilise et qui éventuellement leur fournisse un
accès plus direct aux procédures de la décision collective. L’esprit du débat politique
gagnerait à devenir comme la seconde nature de nos sociétés, car les procédures actuelles
d’expression (élection des représentants et referendum) apparaissent insuffisantes, et l’activité
politique relativement confisquée. Si l’on veut donner ou redonner du sens au système actuel,
il est impératif que les citoyens se réapproprient directement une part de la délibération et de
la décision. Ainsi peut se produire un phénomène de réaffiliation à la chose publique, mais
surtout une publicisation des questions sensibles, et, par le biais de la discussion tumultueuse,
une élévation du niveau culturel et intellectuel général, selon une logique dont nous avons,
dans cet ouvrage, précisé les modalités18
. La responsabilité partagée du sens, telle est de ce
point de vue la signification ultime de la république.
Nous espérons de ce fait avoir établi que, lorsqu’on la débarrasse des scories de
l’histoire, il y a dans l’expérience républicaine un noyau dur sur lequel il est possible de se
fonder pour en renouveler l’exigence, si l’on veut échapper aux illusions dangereuses tendues
par un rapport magique au monde et par la démagogie. Cependant il ne s’agit pas de
« rénover » la république (comme on le dit d’une construction ancienne qui menace de
s’écrouler), mais bien de la « réinventer » par la promotion et la mise en forme des forces
susceptibles de régénérer la communauté civique. Nous estimons que cette réinvention peut
consister à la fois en un élargissement et en un approfondissement de celle-ci.
L’élargissement est possible par le biais par une utilisation publiquement intelligente
et politiquement active des nouvelles technologies. L’approfondissement – qui donne son sens
à l’élargissement – s’appuie sur le fait que le républicanisme se distingue du libéralisme et
plus encore du néolibéralisme en ce qu’il propose une conception de la vie bonne.
Ce serait l’objet d’un autre travail que de préciser quelles technologies d’information,
d’expression et de communication peuvent avoir des effets stimulant pour la « publicité »
démocratique et véritablement innovants sur la pratique républicaine de la politique. Nous
pouvons, dans les lignes suivantes, simplement esquisser quelques pistes. De nombreuses
analyses documentées et sans concession mettent en valeur le fait qu’Internet favorise
effectivement l’effervescence typique de la démocratie19
. En effet, tandis que la presse
classique semble perdre continuellement de l’influence, la Toile s’avère un extraordinaire
instrument de démultiplication et de variation de l’information ; grâce à ce médium si typique
de la pluralité démocratique, l’expression personnelle prend des formes d’une variété infinie ;
le savoir est renouvelé dans ses modes de présentation et même d’intelligibilité ; la
participation civique évolue également et se reformule par le biais des nouvelles technologies.
18
Voir supra, chapitres VII et VIII. 19
Voir notamment Nicolas Vanbremeersch, De la démocratie numérique, Paris, Presses de Science Po,
2009 ; Henri Oberdorff, La démocratie à l’ère numérique, Grenoble, P.U.G., 2010 ; Dominique Cardon, La
démocratie internet. Promesses et limites, Paris, Editions du Seuil et La République des Idées, 2010.
Dans sa variété même, le nouveau monde médiatique suit une logique dont on a montré
depuis quelques temps déjà qu’elle impliquait un ensemble de conduites capables de remettre
en question les comportements politiques traditionnels20
. Si, la démocratie est bien un espace
où le sens s’autoinstitue21
, Internet ouvre des perspectives remarquables pour la pratique
publique de la parole et pour la promotion de la vérité. Ces nouvelles Lumières
technologiques expriment d’ailleurs un fort désir de mise en commun. Fondamentalement
contributif, le web 2.0 connaît des formes variées de communauté, depuis les réseaux sociaux
plus ou moins ouverts jusqu’aux sources documentaires sans cesse enrichies par la
multiplicité des approches. Ces évolutions nous inspirent deux remarques. Premièrement,
l’ethos néolibéral dominé par la conduite intéressée trouve dans l’économie numérique à la
fois un développement et un contrepoint qui donne à penser que la fin de l’histoire n’est pas
encore à l’ordre du jour : tant sur le plan économique que politique, des évolutions relatives
au désir contemporain de communauté sont possibles, qui sont susceptibles de bouleverser la
psyché contemporaine. Deuxièmement, nous ne confondons pas la fraternité révolutionnaire
et « l’amitié » des membres du réseau Facebook lorsque nous évoquons la modification
apportée par Internet à la pratique de la communauté ; souvent superficielle, la relation
interindividuelle par le biais du premier réseau social mondial n’est probablement pas le levier
direct d’un renouveau de la communauté civique. Toutefois, très empathique, l’échange
électronique participe bel et bien d’une re-émotionnalisation du rapport à autrui et tend à
constituer une « société des semblables » (pour employer une expression volontairement
ambigüe) aux contours indéfinis, mais qui fournit à l’humanité le sentiment d’être une en
dépit de ses différences culturelles, politiques, religieuses et morales. Entendue au sens vague
du terme, la communauté humaine s’élargit, même si Internet n’est pas la conscience-monde
qu’une nouvelle forme de républicanisme pourrait considérer comme son principe moteur.
Cependant, cet élargissement n’a aucun sens politique tant qu’on ne l’a pas pensé en
fonction d’un approfondissement de ce que signifie « communauté civique ». Un des points
centraux abordé par notre enquête à travers les différentes formes de républicanisme réside
dans la réponse à la question de savoir ce qui peut être commun dans l’expérience de la
20
Voir Manuel Castells, La galaxie Internet, trad. P. Chemla, Paris, Fayard, 2002 : chapitre V « La
politique d’Internet I », p. 171-205 ; et Cass Sunstein, Republic.com, Princeton, U.P., 2001. 21
Voir Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France,
Conclusion : « Les voies nouvelles de la souveraineté du peuple », Paris, Gallimard, 2000, p. 440 : « Le but de la
démocratie est […] de substituer un principe d’auto-institution du social à tous les pouvoirs antérieurs imposés
de l’extérieur ».
république. Le républicanisme n’est ni tout-à-fait un individualisme, ni tout-à-fait un holisme,
il est un « individualisme participatif » pour lequel la délibération et la prise de décision
collective sont vecteurs de sens pour l’humain. Et mieux encore, parce qu'il est cela, le
républicanisme implique un engagement éthique qui le distingue de la « neutralité » libérale.
C’est à partir de ce souci éthique que la question du commun est posée par tous les auteurs
républicains. C'est pourquoi une des propositions finales de Philip Pettit dans Républicanisme,
par laquelle cet auteur invite à « civiliser la république »22
, prend un relief tout particulier : il
est en effet conforme au projet républicain depuis ses origines de penser la « civilité », c’est-
à-dire de proposer aux citoyens un rapport non-utilitariste aux lois communes qui, derrière
l’idéal de mœurs harmonieuses, se confond avec une certaine idée de la civilisation. Nous
souscrivons à une telle perspective, et tout en développant dans les pages qui suivent des
considérations personnelles nous la reprenons volontiers à notre compte.
Aujourd’hui, dans le contexte de la globalisation du monde, la question du commun
est reposée à une toute autre échelle, et il s’agit de savoir ce qui peut être commun entre des
hommes toujours séparés selon l’espace et de par leurs cultures mais tout de même reliés
grâce aux liens du commerce. Or, bien que, du point de vue moral, nous puissions concevoir
l’humanité comme un ensemble, la communauté civique mondiale n’existe pas encore, et il
n'est d'ailleurs pas certain qu'une telle entité puisse exister un jour. Mais on pourrait dire que,
sous l'effet de la globalisation, il doit se produire une nécessaire convergence entre les
thématiques républicaines et le point de vue du cosmopolitisme. Dans cette configuration, il
semble possible de concevoir un concept médian qui guide la convergence. Ce concept, c’est
celui de dignité, et, bien que d'origine morale plutôt que politique, il est susceptible de jouer
un rôle essentiel non seulement en faveur d'une telle convergence, mais également pour
rappeler la signification de la notion de communauté civique dans un monde comme celui
d’aujourd’hui, lorsqu’il s’agit de répondre à la question : « de quoi peut-il y avoir
communauté ? ».
Cette notion de dignité repose sur une ambiguïté majeure : si étymologiquement elle
renvoie à la dignitas latine, et renvoie au rang social occupé par une personne, elle évoque
également le respect qui s’attache à la même personne, considérée d’un point de vue moral.
Cette dernière signification est au cœur de la construction moderne des droits de l’homme,
pour lesquels toutes les personnes humaines possèdent une part de dignité, car on estime qu’il
22
Voir Philip Pettit, Républicanisme, op. cit., chapitre VIII, p. 323-362.
se trouve par nature attachée à elles une qualité impliquant la considération d’autrui, voire
suscitant en lui l’empathie23
. Nous disons que la dignité peut servir à réinventer la
communauté civique, en l’approfondissant, car elle apporte un début de réponse à la
question contemporaine : « que mettons-nous en commun dans la république ? », et cela de
trois manières différentes.
D’abord, le monde « globalisé » est régulièrement traversé par des expériences
d’indignation collective – expression de protestations empathiques disant que quelque chose
d’indigne se produit d’un point de vue humanitaire ou politique. Certes, l’indignation est
mauvaise conseillère, car elle peut aisément être suscitée par les démagogues, et de plus cet
affect négatif ne saurait suffire à donner sens à l’idée d’une véritable communauté civique.
Mais cela signifie que, très nombreux dans le monde, nous ressentons la violation de dignité
comme un affect fondamental, sinon comme la base d’une émotion collective qui ne s’épuise
pas dans la défense de telle ou telle cause. Cette émotion dessine, même si c’est de manière
vague, les contours d’une communauté humaine fondée sur l’égalité de dignité entre tous les
êtres humains susceptibles de souffrir.
Ensuite, et plus fondamentalement, la notion de dignité humaine apporte au projet de
communauté civique dans un monde globalisé une perspective très stimulante. Une des
limites du républicanisme standard, nous l’avons montré dans le chapitre II, réside dans le fait
qu’il a part liée aux ensembles « nationaux », ethniques et étatiques. Double limite en vérité,
puisque le républicanisme a présidé à la construction des logiques nationalistes dans le
moment de constitution de l’Etat-nation, puis se trouve amoindri par la remise en question du
niveau étatique et national dans le mouvement de la globalisation. Ces deux phénomènes
renvoient au même problème de l’enfermement du républicanisme standard dans la
communauté civique entendue comme particularité ethnique, culturelle, idéologique ou
politique – cela, même si la conception de la république issue des Lumières (sensible en
particulier dans les œuvres de Condorcet et de Kant) a toujours intimement mêlé la
représentation de l’Etat de droit et la considération des droits de l’homme. L’idée de dignité
humaine relève quant à elle d’une logique, tout différente, de l’universalité de ces droits, et
23
Cette détermination « subjective » ou éthique de la notion de dignité recouvre elle-même une ambiguïté
importante, du fait que, ainsi que le montre Jean-Yves Goffi à propos de la question topique de la fin de vie
volontaire, le même argument d’une qualité intrinsèquement attachée à la personne peut servir aussi bien les
défenseurs de l’euthanasie que ceux qui la condamnent. Voir Jean-Yves Goffi, Penser l’euthanasie, Paris,
P.U.F., 2004 : chapitre V, « Arguments déontologiques à propos de l’euthanasie : dignité humaine et droits », p.
88-98.
par conséquent pointe leur caractère non- ou supra-politique. De sorte que la dimension de la
dignité fournit pour la notion de communauté civique un moyen remarquable d’en préciser les
limites.
Quelle communauté voulons-nous, ou pouvons-nous espérer, pour le monde qui est en
train de se faire ? Question qui apparaît idéaliste, il est vrai, si on la pose en dehors de toute
considération matérielle (économique, sociale et technologique), mais qui n’en demeure pas
moins pertinente au plan d’une philosophie à la fois entendue comme théorie normative et
valable pour aujourd’hui. Elle réinterroge en effet un des thèmes cardinaux du républicanisme
que nous avons évoqué dans les deux premiers chapitres, celui du patriotisme : tandis que cet
affect, étroitement caractérisé ou envisagé selon le nationalisme typique de la modernité,
désigne pour le citoyen un attachement à sa communauté de coutumes, de culture et de
valeurs, la question est posée de savoir à quel niveau il peut de nos jours se situer sans outrage
pour la dignité humaine. Dans certains contextes tendus que l’histoire connaît souvent et que
les flambées nationalistes recréent à loisir, le patriote peut légitiment être soupçonné de
négligence envers les droits de l’homme, et symétriquement l’humaniste des droits de
l’homme peut aisément passer pour quelqu’un qui n’aime pas sa patrie. Il existe par
conséquent un véritable dilemme, qui met en tension l’amour des siens et l’amour des
hommes24
.
On pourrait trouver dans l’œuvre d’Arendt des éléments pour sortir du dilemme entre
une communauté « patriotique » étroite (fondée sur un attachement sensible des citoyens car
basée sur le partage de la langue, des habitudes, des représentations et des valeurs) et une
communauté « universelle » (dont la portée morale est basée sur l’idée d’humanité, mais qui
peine à se constituer politiquement faute d’une histoire et de passions communes à l’ensemble
des hommes). La communauté humaine – horizon ou ressort de la communauté civique, la
chose apparaît finalement indécidable chez Arendt – se fonde pour l’auteur de The Human
Condition sur la prise en compte de la culture ; un patriotisme de type culturel rappelle aux
individus l’importance du registre du sens, par lequel les affaires humaines sont sauvées du
risque de l’oubli. D’après Arendt, en effet, les hommes agissent politiquement à partir du
moment où – et dans ce moment se joue leur dignité, c’est-à-dire rien moins que la
24
Pour une discussion de ce dilemme et de la valeur éthique du patriotisme dans le contexte
contemporain, voir Alasdair MacIntyre, « Le patriotisme est-il une vertu ? », dans André Berten, Pablo Da
Silveira et Hervé Pourtois, Libéraux et communautariens, op. cit., p. 286-309.
consistance de leur existence – ils prennent conscience de leur fragilité commune et en dépit
de leurs différences ils se rassemblent pour agir collectivement25
.
Enfin, c’est dans la perspective d’une philosophie politique appliquée que nous
pouvons envisager les ressources de l’idée de dignité. A cet égard, la réflexion d’Avishaï
Margalit nous apporte un éclairage considérable sur ce qu’elle peut signifier pour une
communauté civique aujourd’hui. Dans son examen du concept de la « société décente »,
Margalit avance qu’une telle organisation se définit comme « une société dont les institutions
ne violent pas la dignité des gens qui se trouvent dans son orbite »26
, au sens où elles
n’humilient pas les personnes placées sous l’autorité de l’administration. S’il paraît fort
délicat à préciser, le concept d’humiliation peut lui-même être pensé à partir de la
problématique de la reconnaissance, soit à partir d’un concept intersubjectif de l’autonomie
emprunté à la théorie critique27
. Ainsi le couple constitué par la visée de la « société décente »
et par la considération de la « reconnaissance » contribue à établir des conditions concrètes
favorables à la dignité. La tâche de veiller à ces conditions recouvre le périmètre d’action
d’une communauté civique d’aujourd’hui. Envisagée de cette manière, la communauté
civique de la république adaptée à notre temps consacrerait en effet une attention particulière
au fait que les citoyens soient considérés à égalité de dignité : respectés au sein de la « société
décente » et égaux dans la prise de parole (aidés en cela par la volonté publique d’éduquer et
d’enrichir culturellement ceux qui sont en souffrance), ceux-ci apporteraient à la délibération
la variété de leur expérience, et seraient guidés par des responsables politiques dont l’attitude
ne serait jamais indigne (est digne le leader qui, par sa conduite, contribue à donner ou à
redonner à chacun l’idée de sa propre dignité).
Le républicanisme, ainsi requalifié comme théorie politique adaptée à notre temps,
trouve donc dans la dignité partagée par tous le « commun » qui fonde la chose publique. Et
au-delà de ce constat, ainsi que nous espérons l’avoir montré, dans les pratiques innovantes
d’une communauté civique réinventée par les significations variées de la dignité réside la
possibilité d’une authentique liberté publique.
25
Voir Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., chapitre V, p. 241, sur « le réseau des
relations humaines qui existent partout où les hommes vivent ensemble ». 26
Avishai Margalit, La société décente, trad. F. Billard, Paris, Flammarion, 2007, p. 57. 27
Voir Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, trad. P. Rusch, Paris, Le Cerf, 2000.




























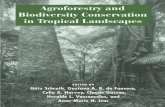



![[J.-C. Zancarini & L. Baggioni] Dulcedo libertatis. Liberté et histoire à Florence. XIVe-XVIe siècles](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323f30a3c19cb2bd106c183/j-c-zancarini-l-baggioni-dulcedo-libertatis-liberte-et-histoire-a-florence.jpg)