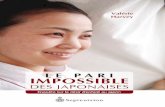Le risque de la religion ou le pari de la liberté
Transcript of Le risque de la religion ou le pari de la liberté
153
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
10
LE RISQUE DE LA RELIGION OU LE PARI DE LA LIBERTÉ
Benoît Bourgine
Entre christianisme et religion, s’élève un différend séculaire, toujours pendant. Le texte qui suit prend parti sur les enjeux théologiques s’y référant.
Par souci de clarté, on adopte pour toile de fond le contraste entre religion et révélation – religion étant entendue comme relation de l’homme à Dieu à l’initiative de l’homme, et révélation comme relation de Dieu à l’homme, instaurée à l’initiative du Dieu biblique. Ce contraste, trop simple mais commode, sous-entend que la religion peut à tout moment devenir idolâtrique et déboucher sur une relation biaisée, parce que le vrai Dieu est évité ou qu’un faux dieu lui est substitué. La révélation du Dieu biblique est alors, selon ce schéma, le salut de la religion, non pas à la manière d’un deus ex machina qui court-circuiterait le lieu de la religion, mais comme le travail discret, patient, persévérant du Dieu de l’Évangile qui se donne tel qu’il est, sous couvert d’approximations et de corrections successives au sein de la dimension religieuse1.
S’il y a ainsi subversion évangélique de la religion, il faut aussi lucidement envisager la subversion religieuse du christianisme. La transcendance ne se frotte pas à l’immanence sans courir un risque – un risque nécessaire dès lors qu’elle entend rejoindre l’homme là où il est. Dans l’acte de se révéler, Dieu ne s’épargne ni l’ambiguïté
1 On renvoie ainsi de manière schématique à la proposition de Karl BARTH, Dogmatique, §17, vol. I, t. 2**, trad. Fernand Ryser, Genève, Labor et Fides, 1954.
dieu au risque_20_8.indd 153 20/08/2014 16:52:56
154
Dieu au risque de la religion
du monde, ni l’ambivalence du religieux. Se donner dans l’immédiateté, tout entier et en une fois, eût été à la fois plus simple et plus direct, sans risque de brouillage ni de détournement. Mais comment s’adresser à l’homme sans traverser son épaisseur, sans habiter son temps et son lieu, sans s’aventurer dans ses zones d’ombre ? Dieu se révèle avec puissance, certes, mais en s’interdisant brusquerie ou raccourcis, dans un respect infini de la liberté.
La liberté de l’homme vaut bien un détour ; la réserve et le retrait de Dieu ménagent, sous le voile du religieux, le jeu nécessaire au libre consentement du croyant. Le clair-obscur de la foi est préféré au plein soleil d’une révélation indubitable. Par la médiation religieuse, le choix de Dieu s’humanise. Un libre consentement peut-il vraiment prendre corps dans l’instant de la décision et sous l’éblouissement de l’évidence ? Une foi est-elle réellement libre, d’une liberté authentiquement humaine, en s’épargnant le temps du mûrissement, l’opacité du rituel et le poids d’une pratique quotidienne ? Or le temps, c’est aussi l’incertitude du lendemain et les aléas d’un parcours de vie, la possibilité de la mémoire et de l’oubli ; le rite, c’est aussi l’équivoque du signe, le flou du sacré ; l’action à reprendre au jour le jour, c’est aussi une volonté rebelle et fragile, exposée à la lâcheté et à l’erreur.
La liberté est décidément pleine de dangers, ceux-là mêmes auxquels s’expose la révélation biblique. En prenant le risque de la religion, Dieu fait le pari de la liberté. Pour le manifester, un parcours est à entreprendre. Il s’agit en effet d’une histoire en train de s’écrire dans laquelle Dieu assume librement, jusqu’au bout, le risque de la liberté humaine. C’est un homme libre qu’il souhaite rencontrer, non un esclave ou un fantoche. Plutôt que de forcer son obéissance ou le contraindre à la soumission, c’est son désir qu’il veut enflammer afin de le tourner vers la communion ; c’est sa vie qu’il veut convertir – « retourner » – pour s’unir à lui, intimement.
Voilà pourquoi dans l’histoire biblique la révélation de Dieu va de pair avec la libération de l’homme. C’est bien de libertés, celle de Dieu et celle de l’homme, qu’il y va dans ce risque pris par Dieu de rencontrer l’homme au lieu de la religion. Une logique d’incarnation est à l’œuvre, respectueuse de l’humanité telle qu’elle est, avec ses failles et ses pesanteurs, son désir et son inconstance. Le Dieu biblique assume de la sorte l’instance religieuse, en la travaillant de l’intérieur, sans s’épargner désillusions, refus, échecs. En ce lieu de la religion, l’homme se révèle tel qu’il est – inconstant : Dieu peut-il
dieu au risque_20_8.indd 154 20/08/2014 16:52:56
155
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
donc réellement s’étonner que là aussi, là surtout, ses dons soient détournés, ses appels ignorés ? En dépit de tout, contre vents et marées, l’offre est maintenue, relancée, inlassablement : au lieu de la religion, Dieu se révèle lui aussi tel qu’il est – fidèle. Loin de suivre une trajectoire linéaire, cette histoire déjoue les prévisions ; elle est faite de parole tenue autant que de trahison, d’aveuglement, voire d’aliénation volontaire. Dieu maintient sa Parole : les reculs sont prétextes à avancées décisives et les refus tournés en occasion de surenchérir sur l’offre, démesurément. Dans l’Évangile, c’est vers le pécheur que Jésus fait le premier pas et l’ultime parole qu’il prononce, en tant qu’Envoyé du Père, est celle de la miséricorde ; il enclenche de la sorte le processus de conversion que l’Esprit de Pentecôte, le vivificateur, ne cesse de dynamiser au cœur de l’Église et du monde.
C’est donc un itinéraire qui sera proposé, rythmé par trois moments : le premier rappelle la misère et la grandeur de la religion (1. La religion pour le meilleur et pour le pire) ; le deuxième décrit le point de vue évangélique sur la tradition religieuse qui le porte, la tradition d’Israël, et la subversion qu’opère l’Évangile sur ce dispositif religieux (2. La subversion évangélique de la religion) ; le troisième moment, enfin, apprécie l’ampleur du risque pris par une transcendance qui refuse de se priver d’un lieu d’immanence (3. Subversion religieuse du christianisme ?).
1. La religion, pour le meilleur et pour le pire
Le premier moment entend dégager l’ambiguïté des phénomènes religieux, mais aussi la grandeur de la dimension religieuse.
Misère de la religion
L’ambiguïté de la religion est d’abord sémantique : aucune définition ne s’impose, il faut dire à chaque fois de quoi l’on parle2. Le terme
2 Le jugement porté sur les religions, ou sur la sphère religieuse comme réalité anthropologique et sociologique, dépend de la définition que l’on adopte. Or d’innombrables définitions de la religion ont été proposées, sans qu’aucune ne s’impose – signe qu’avec la religion, nous avons affaire à une réalité qui échappe à une saisie simple et à un point de vue
dieu au risque_20_8.indd 155 20/08/2014 16:52:56
156
Dieu au risque de la religion
« Religion » est pris ici en deux sens distincts : le phénomène historique des religions, d’une part, pour dire son ambivalence ; la dimension religieuse, d’autre part, pour rappeler le poids d’humanité qu’elle représente. Ces deux significations ne s’identifient pas tout à fait, mais on ne peut les disjoindre, tellement elles sont enchevêtrées. La dimension religieuse ne peut prendre corps hors des religions concrètes, où elle trouve forme et pérennité. Pourtant il y a beaucoup plus dans les religions historiques qu’une réponse pure et simple à la dimension religieuse comprise comme quête de sens et ouverture à la transcendance. La distinction est donc nécessaire même s’il serait trop simple de vouer les religions concrètes aux gémonies pour mieux exonérer la dimension religieuse de toute ambivalence.
Les religions historiques nous apparaissent, aujourd’hui plus que jamais, caractérisées par leur ambiguïté. Marqueur d’identité individuelle et collective pour la majorité des sept milliards d’hommes et de femmes qui peuplent notre planète, l’affiliation religieuse correspond à ce qu’ils ont de plus précieux et de plus élevé : être religieux, c’est, en règle générale, adopter un ethos et une certaine vision du monde, c’est trouver sens à son existence, c’est appartenir à une communauté et trouver une filiation symbolique en s’inscrivant dans la continuité d’une tradition. Matrice de civilisation, la religion inspire l’organisation et les représentations collectives ; elle détermine les modes de vie et de pensée en tant que source de sens et de valeurs.
Mais ce qui fait la prégnance existentielle et sociale des religions est aussi ce qui les rend problématiques.
Volontiers portées à l’immobilisme parce qu’enracinées dans une tradition séculaire, quand elles ne s’adossent pas carrément à l’immutabilité d’un passé mythique, les religions sont lentes à enregistrer les évolutions anthropologiques. Elles font régulièrement obstacle à des progrès, et des progrès au-dessus de tout soupçon : obstacle au savoir scientifique et à la liberté politique, obstacle aux valeurs de respect et de tolérance, par-delà les croyances, obstacle aux valeurs d’égalité entre humains indépendamment du sexe. Pesanteur des religions, quand elles n’encouragent pas elles-mêmes à prendre
unique. On s’efforcera dès lors de préciser ce que l’on désigne par « reli-gion » aux différentes étapes du parcours. Sur la difficulté à définir la religion, voir François BOESPFLUG, « Une notion sur la sellette : “la reli-gion” » Revue théologique Louvain, 36 (2005), p. 476-507.
dieu au risque_20_8.indd 156 20/08/2014 16:52:56
157
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
les armes. Mais là, le danger vient aussi du dehors, du politique en particulier. Source d’identification symbolique, la religion revêt ipso facto une portée politique : enjeu de pouvoir, elle devient aussi nécessairement source d’abus de pouvoir et lieu de conflits. Il est si tentant pour le pouvoir politique d’instrumentaliser cette ressource symbolique. Il est si tentant pour le pouvoir religieux d’empiéter sur le registre politique. Le politique et le religieux – ces deux modalités essentielles de la socialité, ces deux « existentiaux » de la communion humaine condamnés à se rencontrer, avec plus ou moins de sérénité, dans l’espace public tout autant que dans la conscience individuelle des citoyens. Dans le meilleur des cas, à tout le moins : cela suppose, en effet, qu’on distingue entre religieux et politique, même pour en transgresser les domaines ; cela suppose dès lors une tradition politique que ne partagent pas toutes les civilisations. De cette distinction et de cette transgression, le totalitarisme politique comme le modèle théocratique affranchissent pour leur part définitivement et le citoyen et le fidèle, mais en les privant dans le même temps de toute liberté politique et religieuse. La religion donc, pour le pire, comme l’atteste aujourd’hui le sort réservé aux chrétiens et aux autres minorités religieuses en tant de pays musulmans. Il arrive aux desseins en apparence les plus saints d’enfanter le pire. Invoquer le sacré, c’est prendre le risque de poursuivre, protégés par l’incognito, des intérêts, des visées, des projets qui n’ont à voir avec lui. À ceux qui mettent le religieux à la remorque d’autres pathos : science, art, morale, socialisme, jeunesse, communauté nationale, État, la funeste association « religion et… », Barth prédit que la perversion est proche.
Essentiellement ambiguë et ambivalente, telle apparaît la religion à nos yeux d’occidentaux, au temps de la sécularisation. La religion qui, d’un côté, concerne en profondeur l’identité des individus et des peuples, en façonnant un idéal à habiter au quotidien, se révèle, d’un autre côté, un redoutable accélérateur de passions humaines, capable de cristalliser les énergies avec une force toute particulière, pour le meilleur et pour le pire.
Sans doute notre histoire européenne – la mémoire des guerres de religion, en particulier – a-t-elle la vertu de nous prémunir efficacement contre tout retour de la barbarie à visage religieux. Peut-être que, dans notre nouvel horizon, celui d’un humanisme où aucun but n’est à poursuivre au-delà de l’épanouissement humain, la question qui se pose est plutôt de savoir de quoi la religion est signe et demeure le gardien.
dieu au risque_20_8.indd 157 20/08/2014 16:52:56
158
Dieu au risque de la religion
Grandeur de la religion
Est ici visée l’ouverture au religieux comme dimension anthropologique, mais peut-être est-il utile de ne pas rester dans le vague, tant il est risqué de prétendre à l’universalité en ce domaine. Max Weber et Jürgen Habermas se sont déclarés dépourvus de toute disposition au religieux comme on peut se dire dépourvu de toute aptitude à la musique (religiös unmusikalisch). Le nombre de nos contemporains qui se reconnaissent dans cette attitude est croissant, dans le cadre du « changement d’horizon » qui s’est opéré dans nos sociétés sécularisées. Voilà une première limite à l’universalité de la dimension religieuse. Il est une autre raison de ne pas rester dans le vague et de ne pas prétendre à l’universalité : c’est la diversité infinie des formes du religieux selon les temps et les lieux. Aussi, comme le fait Charles Taylor dans son étude de l’ère de la sécularisation, partons ici d’une définition de la religion, suffisamment large mais suffisamment typique de l’occident, afin de mieux l’opposer à l’humanisme séculier, devenu l’option par défaut dans nos sociétés3. Selon cette définition, la religion y est structurée par la distinction entre immanence et transcendance, entre la vie humaine et un hors d’elle-même où cette vie est censée trouver sa plénitude. Pour les religieux, pris en ce sens, il y a un bien supérieur au seul bien-être humain, au nom d’une foi en une transcendance qui fait espérer une vie par-delà les limites de la naissance et de la mort.
Si, en ce sens large, l’on entend par religion ce par quoi l’homme passe infiniment l’homme (Pascal), si l’on désigne par religion cette dimension de la hauteur, ouverte par un désir absolu, qui met l’homme en relation avec un invisible, comme avec l’altérité du Très-Haut (Levinas), si l’on vise par religion une signification ultime qui donne sens à l’existence et l’oriente vers une destinée (Tillich), alors la mémoire de ce mot mérite d’être entretenue. Si tel est le cas, la religion désigne en l’homme ce qui fait signe vers un excès qui lui fait éprouver les limites de l’immanence. Cet excès habite le dynamisme de son action, de sa pensée et de sa vie, s’il est vrai qu’en lui « ce qui veut et ce qui agit demeure toujours supérieur à ce qui est voulu et fait »4. La religion, prise en ce sens, met l’homme face à une question absolue ; elle définit l’homme lui-même comme question – question
3 Charles TAYLOR, L’âge séculier, trad. Patrick Savidan, Paris, Seuil, coll. « Les livres du nouveau monde », 2011.
4 Maurice BLONDEL, L’action (1893), Paris, PUF, 1950, p. 323.
dieu au risque_20_8.indd 158 20/08/2014 16:52:56
159
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
sur le tout de l’être, sur le tout de l’existence, question sur lui-même. Mais la religion prise en ce sens désigne aussi bien, en tout acte de connaissance et d’amour que l’homme pose, un manque, une blessure, une béance qui le donne à lui-même en le mettant en mouvement, une tension qui l’invite à se dépasser en direction d’une origine et d’une fin – l’énigme de l’origine d’où chacun se sent obscurément provenir, le mystère d’un chez-soi vers où le porte une secrète motion (Rahner).
Définie de la sorte, la possibilité religieuse porte un double témoignage : d’une part, le témoignage d’une transcendance à l’intime de l’homme lui-même, telle la trace de l’haleine qu’un dieu aurait insufflée en Adam comme son principe vital, qui lui signifierait aussi sa grandeur sans égale ; d’autre part, le témoignage d’une transcendance vers laquelle l’homme se porte de lui-même comme l’horizon vaste, immense, infini, le seul à la mesure de la démesure de son désir. Ce double témoignage parle de l’homme et de sa dignité, inaliénable, incommensurable, et il rend compte du désir qui l’habite et le pousse sans cesse tantôt en avant de lui, tantôt au-dedans de lui ; il signifie à lui seul un manifeste et un interdit – un manifeste : l’homme lui-même est transcendance ; un interdit – l’interdit d’interdire l’accès à une transcendance.
Un manifeste est par là adressé à ceux qui voudraient réduire l’homme à ses capacités neuronales, à sa rentabilité économique ou à son empreinte écologique. Comment dire le caractère sacré de toute vie humaine sans employer le vocabulaire religieux de la transcendance ? Par quel sortilège, les droits de l’homme tiendraient-ils face à la réduction du monisme scientifique, aux calculs cyniques du capitalisme ou aux nouveaux impératifs de la conscience collective ? À s’en tenir à l’orthodoxie du scientisme, impossible de ne pas réduire la vie à ses processus biologiques ; à s’en tenir à l’orthodoxie du capitalisme, impossible de ne pas chiffrer le coût d’une vie ; à s’en tenir à l’orthodoxie du nouveau dogme social, impossible de ne pas mesurer la vie humaine au poids qu’elle fait peser sur la planète. Le témoignage de la religion, du moins dans l’acception qu’on a définie, oppose aux idéologies post-humanistes une protestation, un avertissement, peut-être même un cran d’arrêt, en tout cas une justification puissante à la maxime kantienne selon laquelle l’humanité est à traiter toujours comme fin en soi, et jamais simplement comme moyen. Même sécularisé, le message religieux du christianisme a une force dont on serait mal avisé de se passer.
dieu au risque_20_8.indd 159 20/08/2014 16:52:56
160
Dieu au risque de la religion
La possibilité religieuse est donc un manifeste opposé à quiconque réduit l’homme à moins que l’homme ; elle signifie également un interdit opposé à qui, d’autorité, assignerait l’homme à l’immanence. Lourd est le soupçon pesant sur le chercheur de sens qui regarde au-delà de l’utilité sociale, de l’urgence humanitaire ou du bien-être personnel : sourcier d’arrière-mondes (Nietzsche), sujet aux illusions de son désir (Freud) ou victime d’addiction à de vaines consolations (Marx), peu importe les noms d’oiseau dont on l’affuble, celui qui se pose sérieusement la question suivante : « Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens, et l’homme a-t-il une destinée ? »5, et qui se la pose non pas sur le mode du passe-temps, ni en fonction de l’impératif de l’épanouissement individuel, mais avec l’angoisse du salut, celui-là ne trouvera pas sur sa route que des alliés. Or en se posant sérieusement cette question, il se peut fort bien que l’ici-bas de l’immanence le laisse sans réponse et que se lève en lui l’appel insistant d’un ailleurs, et que vibre en lui l’écho de la transcendance. « Transcendance ici veut dire ce qui nous emporte de loin et au loin, mais pour nous reconduire à nous-même »6.
Un manifeste est produit en faveur de la transcendance de l’homme et contre la réduction de l’homme à moins que lui – témoignage de son inestimable valeur ; un interdit est opposé à ceux qui voudraient river l’homme à l’immanence et obstruent le chemin de la transcendance comme quête de sens – témoignage de la noblesse d’une recherche de ce qui le dépasse et pourrait le sauver : tel est, à l’âge de l’humanisme séculier, le double témoignage par lequel, en dépit de son ambiguïté, la religion, pour le meilleur, préserve l’homme de l’enfermement de l’immanence.
2. La subversion évangélique de la religion
Avec ce deuxième moment, on en vient à l’Évangile comme instance critique de la religion, une religion comprise cette fois, non d’abord comme dimension anthropologique, mais au sens d’une religion historique, avec ses pratiques et ses croyances, ses clercs et ses fidèles, ses textes et ses rites. Le christianisme a en effet une réputation
5 BLONDEL, L’action (1893), p. VII.6 Adolphe GESCHÉ, Dieu pour penser, t. 5 : La destinée, Paris, Cerf, 2004,
p. 11.
dieu au risque_20_8.indd 160 20/08/2014 16:52:57
161
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
de n’être pas tout à fait chez lui dans le monde des religions. Un double constat nuance cette impression : l’Évangile, même lorsqu’il insinue un déplacement vis-à-vis de la pratique de la religion d’Israël, opère sur fond d’une confirmation de cette tradition religieuse ; l’Évangile, même lorsqu’il subvertit la pratique des courants contemporains du judaïsme, s’appuie sur la tradition prophétique de cette religion. Illustrons-le.
Confirmation de l’alliance et critique prophétique
On peut partir du tableau que rapporte l’évangéliste Luc au chapitre 4 : Jésus inaugure son ministère à la synagogue de Nazareth, là où il fut élevé, là où il vient de manière habituelle le jour du sabbat, précise l’évangile. Jésus, pratiquant de la religion juive. Luc ne fait pas que raconter, il nous fait voir les différentes actions de Jésus, presque cinématographiquement, comme s’il voulait insister sur leur séquence, il nous rend contemporains de l’événement comme si la mémoire devait en être gardée : Jésus entre, se lève pour faire la lecture, on lui donne le livre, il le déroule et il tombe sur Isaïe qu’il lit ; puis roule le livre, le rend au servant et s’assied. Jésus, observant du judaïsme. Annonce-t-il un autre Dieu, une autre écriture, un autre culte ? Non, de cette écriture, il proclame l’accomplissement, en sa personne, dans l’événement de la lecture : « cette écriture est accomplie aujourd’hui à vos oreilles », dit Jésus (Lc 4,21). Et les auditeurs de s’émerveiller de ses paroles de grâce. Difficile de mieux confirmer la religion d’Israël ! Et pourtant l’évangéliste Luc, sans d’ailleurs se soucier de vraisemblance ni de cohérence narrative, anticipe à ce moment même le refus qu’auront à essuyer les communautés pauliniennes de la part d’un certain nombre de Juifs lors de la première prédication chrétienne, ainsi qu’il le racontera dans les Actes des Apôtres. Tout d’un coup, l’assistance est retournée, de louangeuse elle devient homicide et veut précipiter Jésus dans le ravin. Jésus se réclame alors de l’exemple d’Élie et d’Élisée, des prophètes majeurs du judaïsme, pour stigmatiser le rejet qu’il subit de la part des siens.
Il faudrait citer d’innombrables exemples pour confirmer et affiner ce double constat, mais le principe est acquis. D’une part, le Nouveau Testament confirme, sans ambiguïté aucune, la fidélité du Dieu d’Israël à son peuple, à son élection et à sa promesse ; Jésus ne pouvait mieux exprimer sa confiance dans la pratique de la religion
dieu au risque_20_8.indd 161 20/08/2014 16:52:57
162
Dieu au risque de la religion
d’Israël qu’en la vivant lui-même au lieu de la synagogue, le jour du sabbat, dans la lecture et l’interprétation de l’écriture. Dans l’épisode scénarisé par Luc, il y a coïncidence entre la vérité de l’alliance vécue dans la religion d’Israël et la venue de Jésus, l’Envoyé proclamant l’année de grâce. D’autre part, en plein accord avec l’Ancien Testament, le Nouveau confirme également la liberté du Dieu d’Israël veillant à l’accomplissement de sa parole, que nul ne peut confisquer ni domestiquer – liberté que Dieu met en œuvre en particulier lorsque vient à faillir le partenaire à l’alliance ; au lieu même de cette coïncidence entre religion d’Israël et manifestation du Messie, Jésus renvoie ses auditeurs au message prophétique selon lequel la bienveillance divine se reçoit et ne se possède pas ; ce qui est donné librement par amour demande d’être reçu librement et par amour.
La critique de la religion est donc d’abord une invention prophétique qui oppose la liberté de Dieu à l’instance religieuse, d’elle-même idolâtre, c’est-à-dire tentée de se refermer sur elle-même, de se sauver elle-même par sa propre justice, au point d’annuler l’altérité de Dieu, préférant une idole muette et sans vie à un Dieu libre et vivant – beaucoup moins facile à gérer, il est vrai. L’idolâtrie, c’est « faire de Dieu une chose parmi les choses de son monde »7, dans la tentative dérisoire de piéger la transcendance de Dieu dans l’immanence de la religion. Selon l’heureuse expression de Calvin, « l’esprit de l’homme est une boutique perpétuelle et de tout temps pour forger idoles »8. Pour sortir de la prison que se construit volontiers l’homme religieux, les prophètes font le départ entre ce qui vient des hommes et ce qui vient de Dieu, entre religion et révélation, entre d’un côté la relation de l’homme à Dieu qui relève plus de l’homme que de Dieu et, de l’autre, la relation de Dieu à l’homme, soit la parole que Dieu adresse à l’homme et que l’Évangile appelle aussi grâce, cadeau, beauté – don gratuit, bienveillance inconditionnelle. Et en effet, Jésus proteste contre la confiscation de la parole de Dieu au nom de la tradition des hommes ; dans le plus pur style prophétique, il dénonce l’hypocrisie religieuse prompte à inverser la transcendance en immanence, prête à confondre entre pratique extérieure et sincérité du cœur, prête à
7 Karl BARTH, L’épître aux Romains, trad. Pierre Jundt, Genève, Labor et fides, 1972, p. 236 (trad. modifiée). « Er macht Gott zu einem Ding unter Dingen in seiner Welt » ; Karl BARTH, Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922, heraugegeben von Cornelis van der Kooi und Katja Tolstaja, GA II, Zurich, Theologischer Verlag, 2010, p. 336.
8 Jean CALVIN, Institution de la religion chrestienne, Livre Premier, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 1957, p. 129.
dieu au risque_20_8.indd 162 20/08/2014 16:52:57
163
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
inverser le don de Dieu en domination d’autrui et à sacrifier l’essentiel à l’insignifiant : voilà en quoi consiste filtrer l’insecte et avaler le chameau (Mt 23,24). Jésus s’inscrit là dans la lignée des prophètes9 ; c’est une critique virulente de la religion juive, mais sans quitter le lieu de la religion. Par cette prédication prophétique, Jésus débarrasse le sanctuaire de ce qui l’encombre mais sans le mettre à bas. De fait, Jésus commande à ceux qu’il a guéris d’accomplir ce qu’impose leur religion en pareil cas ; il commande d’obéir à la parole des responsables religieux mais sans suivre leur exemple : Faites ce qu’ils disent, mais pas ce qu’ils font, car ils disent mais ne font pas (Mt 23,3). Le mot d’ordre est en quelque sorte un « chemin du milieu » : c’est ceci qu’il fallait faire, sans négliger cela (Mt 23,23). Pour Jésus, la transcendance du Dieu d’Israël requiert l’immanence de la pratique de la Loi et de la parole de ses interprètes patentés. La critique est sans concession, mais elle n’est pas un procès en légitimité de la religion.
Évangile et subversion du religieux
Or l’Évangile comporte davantage : pas seulement une critique prophétique, mais une subversion décisive de la religion. L’événement même de la présence de Jésus, actualisant la parole et l’alliance, lui qui est plus qu’un prophète, fait passer à une autre ère, l’ère de l’accomplissement : la présence de l’époux fait passer à un vin nouveau exigeant de nouvelles outres ; mais c’est l’événement pascal qui subvertit de fond en comble le lieu de la religion, en poussant à la limite la crise entre religion et révélation. Tel est bien le sens du signe du temple : détruisez ce temple et, en trois jours, je le relèverai ; lui parlait du temple de son corps (Jn 2,19.21). La résurrection corporelle de Jésus fait passer à un autre régime du religieux. En conséquence ce n’est ni à Jérusalem ni aucun autre lieu religieux qu’il convient d’adorer, mais c’est en esprit et en vérité, qu’il faut adorer Dieu qui est esprit (Jn 4, 23-24) ; d’ailleurs la Jérusalem céleste est une Cité qui n’a pas de temple, puisque Dieu est son temple, ainsi que l’Agneau (Ap 21,22) – l’immanence de la religion s’est effacée au profit de la transcendance. La réalité de l’accomplissement, c’est le corps crucifié du Ressuscité d’où l’Esprit est répandu sans mesure. La mort de Jésus manifeste une fin de la religion : le Messie est condamné en exécution d’une sentence prononcée conformément à la Loi de Moïse, par les responsables religieux qui l’accusent de blasphèmes et
9 Voir à titre d’illustration : Mt 15,3-9 ; 23,1-36.
dieu au risque_20_8.indd 163 20/08/2014 16:52:57
164
Dieu au risque de la religion
de paroles contre le temple. Cela fait beaucoup sur la balance de la religion ! Il y a donc dans l’événement de la croix comme un terme mis à la religion. Le voile de temple se déchire, selon les évangiles (Mt 27,51) ; le Christ est fin (telos) de la loi, selon Paul (Rm 10,4). Telle est en effet pour Paul la révélation décisive opérée par la mort du Christ en application de la Loi : « Le péché, afin de paraître péché, se servit d’une chose bonne pour me procurer la mort » (Rm 7,13). La suppression de la religion à la croix porte au paroxysme la division intérieure en chaque conscience humaine, puisque la loi sainte de Moïse a fait éprouver en ce lieu toute la puissance de cette autre loi, la loi du péché qui enchaîne et qui a montré là son vrai visage – le visage de l’injustice et de la mort. La suppression de la religion à la croix fait aussi connaître l’universalité de l’état de désobéissance : à l’ombre de la croix, Juifs et Gentils apparaissent également sous l’emprise universelle du péché (Rm 1,18 – 3,20). La croix est révélation de l’extrême du péché. L’homme religieux, seul, sait que le péché habite en lui. « Ce n’est pas l’homme d’argent, le jouisseur ou le potentat qui le dit mais bien l’homme consacré à Dieu »10. La religion, comme la Loi, donne la connaissance du péché ; mais à la croix, la religion à travers la Loi a poussé le péché à son comble ; c’est là aussi que ce péché a été condamné en vue de notre libération (Rm 8,3). Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Un autre régime se met en place : au régime de la religion par laquelle l’homme cherche Dieu sans l’atteindre, se substitue un régime de donation – le don d’un Esprit ouvrant à une liberté nouvelle, la liberté de la gloire des enfants de Dieu (Rm 8,20-21). Comment se produit cette rencontre entre le cœur fatigué par la religion et le don que Dieu a résolu de lui offrir ? Quel point d’intersection entre religion et révélation ? L’événement de la Pentecôte met à jour une logique de conversion produite sous l’effet d’un choc, l’annonce d’un incommensurable excès de bonté. Le récit décrit l’ébranlement intérieur des auditeurs des apôtres s’opérant à l’annonce du don de l’Esprit que Dieu envoie en réponse à la mort de son Envoyé. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité (Ac 2, 23.32). À l’extrême de l’injustice humaine et religieuse, Dieu répond en se donnant lui-même. D’entendre cela ils eurent le cœur bouleversé (Ac 2,37). L’ébranlement même des Zachée, Matthieu et autres publicains et prostituées au-devant desquels Jésus se pressait en signe de la miséricorde gratuite du Père, sans exiger de repentir préalable
10 BARTH, L’épître aux Romains, p. 362.
dieu au risque_20_8.indd 164 20/08/2014 16:52:57
165
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
– l’urgence de l’amour fait sortir du droit commun –, voilà ce que fait éprouver à ses auditeurs le discours de Pierre au jour de la Pentecôte. En ceci Dieu prouve son amour envers nous : Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs (Rm 5,8). Le cœur en est bouleversé et ainsi rendu perméable au don de l’Esprit. La relation de Dieu à l’homme ou révélation a pris le pas sur la relation de l’homme à Dieu ou religion.
Le tableau évangélique est donc nuancé : il reconduit la critique prophétique du religieux ; il subvertit aussi la signification de la religion en inaugurant une ère du salut dans laquelle la relation entre Dieu et son peuple prend la figure d’une communion vitale, plénière, immédiate. Devant cette réalité, non encore présente mais en train d’advenir, la religion s’efface. En attendant l’accomplissement final, quelle place accorder au religieux dans la condition chrétienne ?
3. Subversion religieuse du christianisme ?
Poursuivons avec deux questions et une figure. La première question, d’abord : le christianisme peut-il se passer de la religion ? La seconde, ensuite : Le christianisme est-il condamné à l’ambiguïté du religieux ? La figure, enfin, celle du Grand Inquisiteur.
L’hypothèse d’un christianisme non-religieux
Le christianisme peut-il se soustraire à la religion ? Le christianisme doit-il renoncer à se comprendre au sein du monde des religions, comme une religion à côté d’autres ? Il y a de bonnes raisons de répondre positivement. Étant donné le déplacement qu’opère l’Évangile au lieu de la religion, n’est-on pas autorisé à échapper aux pesanteurs du religieux et à prendre ses distances de phénomènes religieux compromettants ? En outre, la « sortie de la religion » (Gauchet) et le « changement d’horizon » (Taylor) de nos sociétés sécularisées ne recommandent-ils pas l’émergence d’un christianisme non religieux, comme l’a envisagé Dietrich Bonhoeffer, de manière à entrer en dialogue avec l’humanisme séculier majoritaire depuis la position d’un humanisme évangélique ? Ce sont des arguments de poids.
Mais le christianisme ne le peut pas, pour des arguments qui pèsent encore plus lourd. Le risque est grand, en effet, de sacrifier la
dieu au risque_20_8.indd 165 20/08/2014 16:52:57
166
Dieu au risque de la religion
transcendance à l’immanence. Priver le christianisme de son fonds religieux, ce serait l’amputer d’une dimension constitutive, à savoir l’ouverture à l’altérité de la transcendance qui distingue la proposition chrétienne de tout autre humanisme autosuffisant. Qu’on y pense : un christianisme non-religieux reviendrait à priver la transcendance d’un lieu d’immanence. Sevrer le christianisme de ses formes rituelles, de ses normes doctrinales, de ses autorités instituées, ce serait poser une âme sans corps et un esprit sans la lettre qui le porte11. Autant retirer le christianisme du monde et les chrétiens de l’humaine condition. Le christianisme peut-il renoncer à courir le risque de l’immanence que Dieu lui-même a pris dans sa révélation ? L’Église n’y est nullement autorisée. Même J. Moingt affirmant à propos de l’Église que « la religion n’est pas son essence » concède qu’« il lui est nécessaire d’être religion pour exister en tant qu’institution porteuse de l’Évangile du Christ »12. Le contraire reviendrait à prétendre s’affranchir des conditions d’existence où la religion demeure une possibilité humaine – la plus haute des possibilités et la plus ambiguë.
Il y a une raison positive tout à fait décisive de ne pas couper les ponts avec la religion : ne pas se soustraire à la sphère religieuse, c’est faire l’expérience de la limite. Karl Barth explore cet aspect dans son fameux Commentaire de l’épître aux Romains (1922) où, contrairement à une rumeur persistante, il ne se contente pas d’opposer brutalement foi et religion. La religion, c’est le lieu où l’homme se révèle à lui-même en faisant l’épreuve de sa mort et de son péché, c’est le lieu aussi où l’homme s’interroge sur ce qu’il est en vérité.
11 Dans L’Action, Blondel a parlé avec éloquence de la nécessité de la pratique littérale. « La lettre c’est l’esprit en action » (p. 404), écrit-il. « Ce qui est vrai de toute intention particulière, forcée qu’elle est de chercher dans l’opération qui la réalise son vivant commentaire, l’est donc davantage encore de l’aspiration religieuse. Où tend-elle, sinon à faire passer à l’acte l’homme tout entier, et à produire en lui la plénitude d’une vie nouvelle, comme si, pour être achevée, toute action devait être une communion ? Or cette communion nécessairement convoitée ne peut s’opérer que par la pratique ; car la pratique seule est capable de relier entre eux deux ordres qui semblaient incommunicables ; et c’est dans les actes seulement que Dieu, apportant l’immensité de son don, peut prendre pied en nous » (p. 409-410) – ce qui est impossible à une religion seulement intérieure et à un sentiment délié de toute pratique.
12 Joseph MOINGT, Dieu qui vient à l’homme, t. 2 : De l’apparition à la naissance de Dieu, II. Naissance, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio Fidei, 257 », 2007, p. 984.
dieu au risque_20_8.indd 166 20/08/2014 16:52:57
167
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
Car elle est la possibilité qu’a l’homme de se souvenir qu’il nous faut mourir, la possibilité de ne pas oublier Dieu. Elle est, au sein du monde du temps, des choses et de l’homme, le lieu où s’exprime, d’une manière insupportable, la question : Qui donc es-tu ?13
Comment prétendre s’épargner cette expérience qui dispose à connaître le Tout-Autre dans son altérité ?
Car la vraie crise, dans laquelle se trouve la religion, consiste en ce que l’homme, non seulement est incapable de se défaire d’elle, aussi longtemps qu’il vit, mais encore a le devoir de ne pas s’en défaire non plus, justement parce qu’elle est un trait si caractéristique de l’homme en tant qu’homme (de l’homme de ce monde !), justement parce qu’en elle les possibilités humaines sont limitées par la possibilité divine, et parce que, conscients que Dieu n’est pas ici, mais que nous ne pouvons non plus faire aucun pas de plus, nous sommes contraints de faire halte et de persévérer auprès de cette possibilité humaine afin de rencontrer Dieu au-delà de la limite marquée par elle14.
Qui reconnaît ce qu’il a voulu dans ce qu’il a fait ? Cela est vrai par excellence en matière de religion. C’est au meilleur de lui-même, c’est-à-dire dans la possibilité religieuse, que l’homme est aussi capable du pire. Voilà ce qui ressort de tout vécu religieux où s’attestent mieux qu’ailleurs nos limites. Mais dans cet aveu d’impuissance et dans ce constat d’absence au cœur de l’expérience religieuse, il y a un appel authentique, une prière secrète et forte, peut-être même irrésistible – l’attente d’une relation vraie avec l’absolu.
Le christianisme non-religieux est une impasse ; cela ne veut pas dire que tout christianisme non-religieux soit illégitime. L’Évangile, en devenant christianisme, a ensemencé les cultures qu’il a rencontrées. L’Évangile n’appartient pas qu’aux chrétiens. Pour ce qui regarde notre culture, les valeurs évangéliques sécularisées imprègnent le projet moderne de rationalité ; c’est en grande partie ces valeurs, reçues par les Lumières européennes, qui ont rendu possible le meilleur de nos sociétés : la rationalité et la défense des droits de l’homme, la liberté et l’égalité des individus, l’impératif de la justice et de la solidarité.
13 BARTH, L’épître aux Romains, p. 367-368.14 BARTH, L’épître aux Romains, p. 235.
dieu au risque_20_8.indd 167 20/08/2014 16:52:57
168
Dieu au risque de la religion
La révélation comme salut de la religion
La deuxième question peut se formuler ainsi : le christianisme est-il condamné à l’ambiguïté de la religion ? Le christianisme historique est-il à la hauteur de l’ère nouvelle du salut qu’il proclame ? Est-il retombé de la religion ? Il est aisé d’esquiver la question en décidant de s’en tenir à l’Évangile et de se laver les mains des réalisations historiques du christianisme. Mais l’Évangile lui-même écarte cette échappatoire : la vérité de l’Évangile est une vérité à faire !
Il n’y a pas une pure vérité du Dieu de Jésus-Christ à laquelle nous pourrions renvoyer en nous lavant les mains de ce que nous faisons nous-mêmes. Si le chrétien n’est pas conforme dans sa vie à sa vérité, il n’y a plus de vérité15.
Pas de vérité hors de celle qui prend corps dans la vie. C’est là un point essentiel : comme l’a dit pour sa part Adolphe Gesché, la vérité du christianisme ne se prouve pas, elle s’éprouve. C’est affaire d’existence, d’expérience, de témoignage.
Le verdict de l’histoire est mitigé : ni tout blanc ni tout noir, tant de pages glorieuses mais aussi des pages sombres. À la suite de Jacques Ellul, il est nécessaire de se pencher sur la subversion religieuse du christianisme. En tant d’occasions, l’Église et les chrétiens n’ont pas su protéger des compromissions la force libératrice de l’Évangile. Au plan religieux, Ellul invoque l’influence néfaste de l’islam sur le christianisme s’agissant de la guerre sainte et de l’esclavage16. Mais le christianisme a-t-il vraiment besoin de l’islam pour s’enfermer dans l’immanence de la religion ? Nul mieux que J. Moingt n’a décrit le processus conduisant l’Église du second millénaire à occulter la signification de son message et à brouiller le sens de sa mission17. Autant d’essais, parfois dérisoires, parfois tragiques, pour mieux contrôler l’action de Dieu. Et ce n’est pas la dernière « querelle des rites », ordinaire ou extraordinaire, qui peut nous convaincre que le temps d’une dialectique sereine avec la sphère religieuse est arrivé dans la chrétienté catholique. Le christianisme, comme phénomène humain, ne saurait échapper à la logique du
15 Jacques ELLUL, La subversion du christianisme, Paris, Seuil, coll. « Empreintes », 1984, p. 13.
16 Pour l’islam, notamment esclavage (dans la mesure où la traite arabe a devancé la traite atlantique) et guerre sainte.
17 Voir MOINGT, Dieu qui vient à l’homme, t. 2 : De l’apparition à la nais-sance de Dieu, II. Naissance.
dieu au risque_20_8.indd 168 20/08/2014 16:52:57
169
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
péché portée à son comble au lieu de la religion.
Si l’ambiguïté de la religion est le lot du christianisme, le Christ nous a libérés des servitudes de la religion, au sens de pratiques censées produire le salut. Il y a une tension irréductible entre religion et révélation, où sans cesse la religion doit attendre son salut de la grâce. Le salut chrétien, c’est Dieu se donnant librement par amour pour être reçu librement et par amour. Comme le Verbe a assumé la chair, la révélation assume la religion. C’est une logique d’incarnation qui est à l’œuvre dans cette assomption de la religion par la révélation. Et l’Église est le lieu de la vraie religion dans la mesure – et cette mesure seulement – où elle vit de la grâce de Dieu18. « L’homme aspire à faire le dieu : être dieu sans Dieu et contre Dieu, être dieu par Dieu et avec Dieu, c’est le dilemme »19.
L’ombre du Grand Inquisiteur
Au terme de ce parcours, mentionnons la figure littéraire du Grand Inquisiteur. Ce passage des Frères Karamazov de Dostoïevski met en récit l’hypothèse-limite d’un christianisme qui s’est érigé en système autosuffisant et prétend mener les hommes au bonheur, en toute sûreté, à condition qu’ils renoncent à leur liberté. « L’action se passe en Espagne, à Séville, aux plus sinistres jours de l’Inquisition, lorsque pour la gloire de Dieu des bûchers flambaient chaque jour dans le pays et que
En de magnifiques autodafés On brûlait les méchants hérétiques »20.
Le Christ décide alors de visiter son peuple souffrant, mais le Grand Inquisiteur veille ; il le fait saisir et le condamne au bûcher. La veille de l’exécution, le vieil inquisiteur, « un vieillard presque nonagénaire, grand et droit au visage décharné, aux yeux creux mais où l’éclat brille encore comme une étincelle »21, visite son prisonnier ; il lui reproche d’avoir pris la liberté d’une visite imprévue : « Tu es venu nous déranger et tu le sais bien », mais surtout d’avoir respecté la liberté des hommes en proposant le salut sans l’imposer.
18 BARTH, Dogmatique, §17, vol. 1, t. 2**, p. 89.19 BLONDEL, L’action (1893), p. 356.20 Fedor DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov, trad. Elisabeth Guertik, Paris,
Le livre de Poche, 1972, p. 285.21 DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov, p. 286.
dieu au risque_20_8.indd 169 20/08/2014 16:52:57
170
Dieu au risque de la religion
Ce n’est à première vue « qu’un poème absurde d’un étudiant absurde qui n’a jamais écrit deux vers »22. Il est en réalité la parabole d’un Dieu exposé au risque mortel de la religion – non pas la religion comme telle, il est vrai, mais une religion qui annule le pari de la liberté. La force du poème tient à ce qu’il met face à face le Grand Inquisiteur, représentant d’une religion dévoyée, et le Christ lui-même, médiateur de la révélation, revenu incognito sur terre. Dostoïevski personnalise ainsi de manière incomparable la tension entre religion et révélation, qui nous a servi de toile de fond. Le long monologue par lequel l’Inquisiteur expose à son Prisonnier, muet et sans défense, les motifs de son exécution prochaine, comporte un seul et unique argument, que Dostoïevski ne craint pas de développer à satiété, multipliant les répétitions : la révélation a pris un risque inconsidéré en faisant une telle place à la liberté dans la réponse humaine ; une religion, qui veut garantir le bonheur de l’humanité, doit corriger cette révélation en confisquant cette liberté.
Le poème illustre donc puissamment la thèse que nous avons voulu accréditer dans les propos développés jusqu’ici, à savoir que le risque couru par Dieu lorsqu’il choisit le lieu de la religion pour y rencontrer l’homme n’a d’autre fin que de ménager l’espace sacré de sa liberté. Le risque ultime de la religion, c’est la possibilité qu’elle recèle de profaner ce sanctuaire de la liberté qui en fait le prix. N’est-ce pas là le propre de la liberté, en ses conséquences extrêmes et paradoxales, que de pouvoir librement démissionner, se démettre, se “défaire” d’elle-même ? Le danger ne vient donc pas de la religion comme telle, mais d’une religion qui déjoue le pari divin de la liberté.
L’insistance de Dostoïevski sur la liberté ménagée par la révélation christique étonne. Du récit évangélique des tentations, il livre un impressionnant commentaire selon lequel le Christ renonce aux voies qui léseraient la libre réponse des hommes23. À ce respect
22 DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov, p. 301.23 « Mais tu n’as pas voulu priver les hommes de la liberté, et Tu as
repoussé l’offre, car où sera la liberté, as-Tu jugé, si l’obéissance est achetée au prix des pains ? » « Au lieu de T’emparer de la liberté humaine, Tu l’as accrue et Tu as accablé à jamais le domaine spirituel de l’homme des souffrances de cette liberté. Tu as souhaité le libre amour de l’homme pour qu’il Te suivît librement, séduit et captivé par Toi. Au lieu de l’ancienne loi solide, l’homme devait désormais décider lui-même d’un cœur libre ce qui est le bien et ce qui est le mal, n’ayant pour seul guide que Ton image devant lui » ; DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karama-zov, p. 290.292.
dieu au risque_20_8.indd 170 20/08/2014 16:52:57
171
Le risque de la religion ou le pari de la liberté
inconditionnel de la liberté, l’Inquisiteur oppose l’efficacité d’un système qui épargne aux hommes la souffrance d’être libres et leur procure le bonheur, infailliblement24. Au fond, l’Inquisiteur explique au Christ qu’il a tout simplement commis une erreur anthropologique en se faisant une trop grande idée de l’homme – l’excès encore !
… « jamais ils ne pourront être libres, car ils sont chétifs, dépravés, médiocres et rebelles (…). Tu avais soif de foi libre et non pas inspirée par le miracle. Tu désirais ardemment un amour libre et non les extases serviles de l’esclave devant la puissance qui l’a terrifié une fois pour toutes. Mais là encore Tu Te faisais une trop haute idée des hommes, car ce sont certes des esclaves, quoiqu’ils aient été créés rebelles »25.
Le poème d’Ivan, « imaginé avec passion »26, vise expressément le catholicisme romain, accusé de substituer l’illusion d’un bonheur sans liberté à la vérité de l’Évangile de liberté. Le Cardinal Inquisiteur s’adresse à Jésus, qui ne dit mot tout au long du poème : « Tout a été confié par Toi au pape, et tout est donc maintenant entre les mains du pape, quant à Toi, Tu ne peux plus venir du tout, ne nous dérange pas, du moins pas avant l’heure »27. Difficile de reconnaître le catholicisme actuel dans la caricature imaginée par Ivan. Il n’échappe cependant à personne qu’elle fait écho aux graves distorsions de la théologie catholique du XIXe siècle, où la centralisation romaine le disputait à la dénonciation des libertés civile, politique et religieuse. On peut même encore souhaiter que ces pages figurent dans les séminaires, les sacristies et les évêchés du monde entier tant il est vrai qu’une propension à restreindre le champ de la liberté de jugement des fidèles, dans des matières pourtant éloignées de l’Évangile, au même moment où la revendication légitime d’une prise en compte de cette liberté ne s’est jamais fait plus distinctement entendre, ne laissent pas de conférer au poème d’Ivan une nouvelle actualité. Si l’on en croit Paul qui la défend avec une virulence passionnée, la liberté chrétienne est cet espace de salut qui a été ouvert par la résurrection du Crucifié
24 « Il n’est rien de plus séduisant pour l’homme que la liberté de sa conscience, mais rien n’est plus douloureux non plus » (…) « est-il pos-sible que Tu n’aies pas prévu qu’à la fin il rejettera et contestera même Ton image et Ta vérité, si on l’accable sous un fardeau aussi terrible que la liberté du choix ? » ; DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov, p. 292.
25 DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov, p. 290.293.26 DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov, p. 282.27 DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov, p. 287.
dieu au risque_20_8.indd 171 20/08/2014 16:52:57
172
Dieu au risque de la religion
et où l’Esprit ne cesse de conduire les fidèles : elle appartient au cœur du message évangélique. Une telle liberté inclut le devoir mutuel de la correction fraternelle, mais elle exclut un régime de liberté surveillée.
Si ce poème peut sans doute aussi préfigurer les ravages de l’idéologie communiste, cette religion séculière qui, sept décennies durant, affligera sans merci les compatriotes de Dostoïevski, sous prétexte de faire leur bonheur, tout en les privant de liberté et en persécutant le christianisme, il rappelle surtout à quiconque revendique le nom de chrétien une vérité première et dernière contenue dans cette parole du Christ : Hors de moi, vous ne pouvez rien faire (Jn 15,5).
dieu au risque_20_8.indd 172 20/08/2014 16:52:57





























![“Le Monde à son image: le cinéma et le mythe d’Icare [Guest Lecture].”](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633d5f5ad0a2f101870ab50b/le-monde-a-son-image-le-cinema-et-le-mythe-dicare-guest-lecture.jpg)