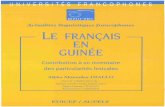Le fidèle lecteur dans le palais des glaces de "The dark tower"
"Le développement d'une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes: l'exemple...
Transcript of "Le développement d'une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes: l'exemple...
RECHERCHE155
Marième N’Diaye
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes : l’exemple de l’Association des juristes sénégalaises (AJS)
En Afrique subsaharienne, la mobilisation juridique reste un répertoire d’action marginal au sein du mouvement des femmes. Dans un contexte de concurrence entre différents ordres normatifs (étatique, coutumiers et/ou religieux), les obstacles à l’appropriation du droit sont nombreux et expliquent le décalage important entre droit formel et droit réel, permettant ainsi de comprendre pourquoi le droit est resté un outil sous-utilisé par les militantes. Néanmoins, certaines associations ont tenté de s’en saisir pour faire avancer les droits des femmes tant sur le plan législatif que sur le terrain judiciaire. À partir de l’étude du cas de l’AJS (Association des juristes sénégalaises), cet article se propose de montrer comment s’est construite et a évolué cette mobilisation juridique qui tend à s’imposer progressivement comme un mode d’action légitime parmi les militantes de la cause des femmes.
Après avoir été éclipsée par le paradigme néo-patrimonial puis traitée de manière dépolitisée à travers l’entrée « société civile », la question des mouvements sociaux et de l’action collective connaît un renouveau dans la littérature africaniste 1. Si les formes et modalités de luttes sont plurielles, les mobilisations juridiques 2 restent encore marginales en Afrique subsaharienne, notamment en comparaison de la situation au Maghreb 3. Plusieurs travaux
1. R. Banégas, M.-E. Pommerolle et J. Siméant, « Lutter dans les Afriques », Genèses, n° 81, 2010, p. 2-4. 2. Une mobilisation juridique consiste à se saisir du droit pour faire avancer l’action sociale. Le droit peut alors être utilisé pour définir les structures d’opportunités globales ou comme ressource dans les luttes de positions. M. W. McCann, « How Does Law Matter for Social Movements ? », in B. G. Garth et A. Sarat (dir.), How Does Law Matter ?, Evanston, Illinois, North-western University Press, 1998, p. 76-108. 3. Le droit joue en effet un grand rôle dans les mouvements sociaux maghrébins comme en témoignent les mobilisations autour des droits des femmes (avec la réforme du code marocain de la famille en 2004 et, actuellement, la mobilisation des Tunisiennes pour la défense de la laïcité et des droits acquis), pour la reconnaissance des droits culturels (exemple du mouvement amazighe au Maroc) ou encore en faveur du respect des droits constitutionnels. Voir par exemple l’article d’É. Gobe, « Les avocats, l’ancien régime et la révolution. Profession et engagement public dans la Tunisie des années 2000 », Politique africaine, n° 122, mars 2011, p. 179-198.
RECHERCHE156
s’attachent néanmoins à analyser ce type de mobilisations 4, notamment dans les domaines des droits sociaux 5 et des droits des femmes 6, contribuant ainsi à légitimer le postulat selon lequel le droit peut être un outil d’analyse du social en Afrique. Ce postulat a longtemps été décrédibilisé par l’échec global des transferts juridiques dans un contexte de concurrence entre différents ordres normatifs 7, ce qui a contribué à creuser un fossé important entre « droit réel » et « droit formel » 8 et ainsi empêché l’émergence d’une conscience juridique 9 sur laquelle fonder une mobilisation sociale.
On peut faire le constat de la sous-utilisation du droit comme répertoire d’action dans le cas du militantisme en faveur de la cause des femmes 10. En effet, si la promotion du « gender mainstreaming » 11 dans les pays du Sud a contribué à la multiplication et au renforcement des associations féminines et à la création d’institutions dédiées à la cause des femmes, l’approche
4. Pour une introduction à l’émergence des mobilisations juridiques et des pratiques populaires du droit, voir notamment l’ouvrage de P. Huyghebaert et B. Martin, Quand le droit fait l’école buissonnière. Pratiques populaires du droit, Paris, Éditions Descartes & Cie, 2002. 5. Plusieurs travaux à ce sujet portent sur le cas sud-africain : voir notamment Jackie Dugard, « Civic Action and the Legal Mobilisation : The Phiri Water Meters », in J. Handmaker et R. Berkhout (dir.), Mobilising Social Justice in South Africa : Perspectives from Researchers and Practitioners, La Haye, ISS and Hivos, 2010, p. 71-99. 6. Les travaux historiques offrent à cet égard un éclairage intéressant et permettent de montrer que bien qu’encore marginal, le recours au droit dans la défense de la cause des femmes existait déjà à l’époque coloniale. Voir notamment M. Rodet, « Genre, coutumes et droit colonial au Soudan français (1918-1939) », Cahiers d’Études Africaines, n° 187-188, 2008, p. 583-602 et A. Yade, « Stratégies matrimoniales au Sénégal sous la colonisation. L’apport des archives juridiques », Cahiers d’Études Africaines, n° 187-188, 2008, p. 623-642. 7. Cette question renvoie à celle du pluralisme juridique en Afrique qui a fait l’objet de nombreux travaux, notamment en anthropologie juridique (M. Alliot, J. Vanderlinden, É. Le Roy), mais égale-ment en science politique (D. Darbon). 8. G. Kouassigan, « Culture, famille et développement », Revue sénégalaise de Droit, n° 21, juin 1977, p. 101-141. 9. Concept développé par les Legal Consciouness Studies qui axent leur problématique sur : « la manière par laquelle le droit fait l’objet d’expérience et est compris par les citoyens ordinaires, dans la mesure où ils choisissent d’invoquer la loi, évitent de le faire ou lui résistent » : citation tirée de P. Ewick et S. Silbey, « Conformity, Contestation and Resistance : An Account of Legal Consciousness », New England Law Review, vol. 26, 1992, p. 731-749. Ce courant s’est d’abord développé aux États-Unis autour des travaux de la Law and Society Association (1964). Sur l’histoire de ce courant, voir J. Pelisse, « A-t-on conscience du droit ? Autour des Legal Consciousness Studies », Genèses, n° 59, juin 2005, p. 114-130.10. « On pourra définir a minima la cause des femmes comme un ensemble d’idées orientées vers l’action, fondées d’une part sur la reconnaissance d’une injustice, l’oppression des femmes et les inégalités qui en découlent et, d’autre part, sur la certitude que ces inégalités peuvent être réduites sinon résorbées » : citation tirée de A. Latourès, « “Je suis presque féministe mais…’’. Appropriation de la cause des femmes par des militantes maliennes au Forum Social Mondial de Nairobi (2007) », Politique africaine, n° 116, décembre 2009, p. 143. 11. J. True et M. Mintrom, « Transnational Networks and Policy Diffusion : The Case of Gender Mainstreaming », International Studies Quarterly, vol. 45, n° 1, 2001, p. 27-57.
157
Politique africaine n° 124 - décembre 2011
juridique reste peu utilisée. Néanmoins, la ratification par de nombreux États de normes juridiques internationales en faveur de l’égalité entre les sexes a créé une opportunité intéressante pour les militantes de la cause des femmes, notamment au Sénégal où l’État a intégré sans réserve les principales conventions internationales et régionales relatives aux droits des femmes. En s’appuyant sur ces normes juridiques, certains entrepreneurs de cause ont fait le choix de défendre une approche par le droit pour améliorer les conditions de vie des femmes sénégalaises. C’est le cas de l’Association des juristes sénégalaises (AJS) qui, depuis sa création en 1974, tente de faire du droit une « arme » 12 entre les mains de toutes les femmes en menant de front un combat pour le renforcement et la vulgarisation des droits. Nous allons nous intéresser à la manière dont cette association a conçu et construit dans le temps une mobilisation par le droit pour essayer de comprendre, sur un plan plus général, la place croissante que prennent progressivement les mobilisations juridiques dans les mouvements féminins en Afrique 13. Cette étude s’inscrit donc dans la continuité des travaux sur les usages du droit dans les mobilisations sociales et vise plus spécifiquement à montrer, à travers son objet (une association de défense des droits des femmes), comment le droit s’intègre dans le répertoire d’action du mouvement de femmes sénégalaises pour devenir un outil utile à la remise en question des rapports sociaux de sexe 14.
En nous appuyant d’abord sur un portrait détaillé de l’AJS et de ses militantes, nous analyserons ensuite les obstacles à la popularisation de l’approche juridique au sein du mouvement des femmes. Nous verrons enfin comment l’association a su tirer partie de ses échecs pour développer une stratégie centrée sur l’accès au droit, lequel contribue progressivement à réduire le fossé entre droit formel et droit réel et ainsi à légitimer le recours au droit comme arme pour le mouvement des femmes 15.
12. L. Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 9.13. Notre approche des mobilisations sociales par le droit s’inscrit dans l’hypothèse selon laquelle le droit constitue bien un « processus social intimement lié à la construction des sociétés », qui prend la forme d’un jeu construit par l’interaction entre les normes juridiques et les interprétations et utilisations que les acteurs en font, y compris en Afrique, où il est présent sous forme « ecto-plasmique » ; « sa forme est visible et socialement active dans les représentations et la définition des comportements mais sa substance est absente, ce qui en fait une nouvelle réalité sociale, bien différente de celle qui était postulée » ; citations tirées de D. Darbon, « Ruser avec le droit : les rebonds de la normativité », communication au Colloque « La raison rusée », Université de Louvain-la-Neuve, 28-30 mars 2001. 14. L. Bereni, A. Debauche, E. Latour, K. Lempen et A. Revillard (dir.), « Le droit à l’épreuve du genre : les lois du genre », Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, n° 2, 2009.15. Le travail présenté repose principalement sur des données empiriques collectées, d’une part lors d’entretiens réalisés avec treize membres de l’association (sur une quarantaine réellement actives) choisies parmi les membres fondatrices et les militantes actives aujourd’hui ; d’autre part,
RECHERCHE158
L’AJS : des professionnelles du droit au service de la cause des femmes
Constituée exclusivement de femmes juristes, l’AJS se définit d’abord comme une association professionnelle. Néanmoins, en faisant du droit de la famille puis des droits des femmes de manière générale le cœur de son combat, l’AJS apparaît comme une association de militantes de la cause des femmes. Le caractère élitiste de l’association, ainsi que son positionnement idéologique modéré, en ont fait un interlocuteur de choix pour l’État et les bailleurs de fonds. Mais ils ont également contribué à rendre plus complexes ses rapports avec le mouvement des femmes 16 au sein duquel elle apparaît en retrait.
Genèse de l’association : l’expertise juridique au service des droits
des femmes
Le droit de la famille occupe une place centrale au sein de l’association puisqu’elle s’est constituée autour de ce combat : « Nous étions un petit noyau à nous regrouper par rapport à la législation du code de la famille parce qu’elle contenait des dispositions contraires aux droits des femmes et à l’égalité constitutionnelle 17 ». Le code de la famille adopté en 1972 repose en effet sur un système d’options en matière de mariage et de succession, qui permet à chaque individu de choisir de se voir appliquer le « droit moderne » ou la « coutume wolof islamisée 18 ». Par conséquent, plusieurs dispositions du texte contiennent des discriminations à l’encontre des femmes contraires à la constitution mais légitimées au nom du respect des croyances coutumières et religieuses 19. Ce système à la carte montre bien que le consensus l’a emporté
lors d’un travail d’observation au sein de la boutique de droit, des maisons de justice et des tribunaux (Dakar et ses banlieues de Pikine et des Parcelles Assainies, Rufisque, Thiès, Kaolack et Mbacké). Nous avons complété nos données grâce aux archives de l’association. Ces données ont été recueillies au cours de plusieurs terrains fractionnés, effectués dans le cadre de notre thèse : juin 2007, juin-août 2008, février-avril 2009, février-mars 2010 et juin 2010. Certaines militantes ont fait de la préservation de leur anonymat la condition de la réalisation de l’entretien. C’est pourquoi nous ne citerons que les noms des militantes nous ayant autorisé à les publier.16. Défini comme « l’action collective de femmes organisées explicitement pour effectuer des demandes dans la vie publique fondées sur leurs identités liées à leur genre en tant que femmes », citation tirée de A. G. Mazur, « Les mouvements féministes et l’élaboration des politiques dans une perspective comparative », Revue française de science politique, vol. 59, n° 2, avril 2009, p. 332. 17. Entretien avec Dior Fall Sow, membre fondatrice de l’AJS, Dakar, 11 juin 2010. 18. Termes employés par le législateur. 19. Y. N’Diaye, « Le nouveau droit africain de la famille », Éthiopiques, n° 14, 1978, disponible sur : <ethiopiques.refer.sn >
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes159
sur la volonté de faire du code un outil de la modernisation et du changement social 20. Les femmes juristes ont donc décidé de s’en saisir pour en faire l’outil d’une justice de genre 21 et un véritable symbole de la modernité.
L’association a ensuite élargi et pérennisé son action en faveur des droits des femmes grâce à l’investissement de ses membres fondatrices, mais sans doute aussi en raison des positions importantes qu’elles occupaient par ailleurs, comme en témoignent les exemples suivants. La première présidente de l’association, Mame Madior Boye, a fait carrière dans la magistrature avant de devenir Garde des Sceaux (avril 2000 – mars 2001) puis première femme Premier ministre du Sénégal (mars 2001 – avril 2002). Dior Fall Sow et Mame Bassine Niang ont été respectivement les premières femmes procureure de la République et avocate du Sénégal. Renée Baro a quant a elle été magistrate avant de devenir présidente de la chambre à la Cour d’Appel puis à la Cour de Cassation. Ces membres fondatrices restent d’ailleurs aujourd’hui une caution morale et symbolique très forte pour l’association 22.
La première génération de femmes juristes a donc construit une association au service du « développement du droit en général et de la promotion de la femme en particulier » 23. L’objectif des militantes était bien de montrer que le droit n’est pas qu’une « institution contraignante » mais qu’il peut aussi constituer une « construction sociale partiellement malléable » permettant aux femmes de s’en saisir comme d’une arme dans leur combat pour l’égalité 24. Afin de réaliser ses objectifs, l’AJS a systématiquement placé le droit au cœur de son discours militant. Pour autant, elle n’a pas véritablement investi l’arène judiciaire pour défendre la cause des femmes, alors qu’il s’agit, en général, d’une stratégie centrale dans une mobilisation juridique 25. L’agenda de l’AJS s’est en fait principalement concentré sur les stratégies de réformes par voie législative. Au-delà de son action en faveur de l’harmonisation du droit interne avec les conventions internationales, l’AJS s’est limitée à l’information juridique
20. A. Diaw, « Les intellectuels entre mémoire nationaliste et représentation de la modernité », in M.-C. Diop (dir.), Le Sénégal contemporain, Paris, Éditions Karthala, 2002, p. 549-574. 21. A. Revillard, « Le droit de la famille : outil d’une justice de genre ? Les défenseurs de la cause des femmes face au règlement juridique des conséquences financières du divorce en France et au Québec (1975-2000) », L’Année sociologique, vol. 59, n° 2, 2009, p. 345-370. 22. Dans les entretiens avec les militantes actuelles de l’AJS, on a remarqué que la référence aux « grands noms » de l’association revenait régulièrement, notamment pour témoigner de la compétence mais aussi du poids de l’association dans les débats politiques et sociaux autour des droits des femmes. 23. AJS, Le Droit au service de la justice, Dakar-Abidjan, Les nouvelles éditions africaines, 1975. 24. L. Israël, L’arme du droit…, op. cit., p. 9.25. Voir P. Burstein, « Legal Mobilization as a Social Movement Tactic: the Struggle for Equal Employment Opportunity », The American Journal of Sociology, vol. 96, n° 5, 1991, p. 1201-1225.
RECHERCHE160
(interventions dans les médias, organisations de conférences et dîners-débats, formations, publications) et au conseil, par le biais de consultations juridiques gratuites organisées ponctuellement.
Pour mener à bien leurs actions centrées sur les textes juridiques, les membres de l’AJS se sont appuyées d’abord et avant tout sur leur statut de professionnelles du droit. L’association devait en effet réussir à se constituer un profil d’experte lui permettant de se construire une légitimité et de pouvoir être consultée par les autorités publiques. Or un tel profil ne concerne qu’une minorité de femmes dans un pays où la majorité d’entre elles n’a pas accès aux études supérieures.
L’AJS dans l’espace public sénégalais : un positionnement d’entre-deux
Le profil de juristes des militantes fait donc la spécificité de l’AJS, composée uniquement de femmes issues d’une élite intellectuelle et socio-professionnelle. Ce caractère élitiste de l’association lui a permis de développer des relations privilégiées avec les autorités politiques, mais a nui à ses relations avec un mouvement des femmes beaucoup plus populaire. C’est pourquoi, afin de se créer une légitimité auprès de ce mouvement, l’AJS a fait le choix d’« africaniser » son discours, c’est-à-dire de le distinguer du discours féministe occidental.
Les statuts de l’association précisent que pour devenir membre active, il est nécessaire d’être titulaire d’une maîtrise en droit. L’AJS, qui compte aujourd’hui près de 200 membres, présente donc un profil de militantes relativement homogène. La maîtrise constitue le bagage minimum, la plupart des membres ayant obtenu par la suite un DESS ou un DEA avant de s’engager dans les métiers du droit. Sur les huit militantes travaillant bénévolement à la « boutique de droit » de l’association 26, trois seulement ont fait leurs études au Sénégal contre quatre en France, où la dernière a poursuivi ses 2e et 3e cycles. Le fait d’avoir étudié en France constitue un indice de la situation sociale des militantes, issues des classes moyennes voire de milieux plus aisés 27. Les militantes interrogées, qui vivent et travaillent toutes dans la capitale Dakar, évoquent par ailleurs un entourage personnel généralement compréhensif à l’égard de leur engagement. En effet, si certaines évoquent le fait qu’on les « taquine » sur leurs « positions féministes », aucune ne fait état de réactions
26. Voir infra. 27. Si les carrières et postes occupés par les militantes de la première génération permettent d’inférer un haut niveau d’éducation qui leur a permis de s’élever socialement, cette question a été plus difficile à appréhender en ce qui concerne les jeunes militantes, le sujet s’étant révélé délicat à aborder en entretien.
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes161
de rejet, plusieurs d’entre elles évoquant au contraire une tradition militante (souvent politique) dans leur entourage. Chez les membres fondatrices en particulier, la transmission des valeurs et une socialisation familiale militante ont joué un rôle primordial dans leur engagement. Elles sont pour certaines les héritières directes de la première génération de femmes instruites du Sénégal comme le souligne Dior Fall Sow : « Ma mère faisait partie des pionnières de l’école Germaine Le Goff 28. J’ai grandi avec elles, avec tata Annette D’Erneville, tata Aminata Diop du Mali… Je les voyais faire et elles nous ont transmis ça. Elles nous ont servi d’exemples 29 ».
L’association se caractérise donc d’abord et avant tout comme l’association d’une élite socio-professionnelle, celles des femmes juristes, ce qui ressort clairement des entretiens avec les membres à propos des ressorts de leur engagement au sein de l’AJS. En effet, en majorité, les militantes ont d’abord évoqué leur profil de juriste. L’opportunité en termes de formation, d’inscription dans des réseaux professionnels et de constitution de clientèle est d’ailleurs parfaitement assumée par certaines jeunes militantes :
« L’AJS a une vraie hauteur et fait un gros travail qui est bien apprécié. Mon maître de
stage [dans un cabinet d’avocats] m’a encouragée dans ce sens parce qu’il considérait
que ça contribuait à renforcer mes capacités, notamment à travers les consultations
juridiques. Ça a toujours été un plus pour moi 30 ».
L’engagement pour la cause des femmes n’est souvent évoqué qu’en second lieu et généralement élargi à la famille et aux enfants. On peut également noter que plusieurs des jeunes membres n’ont pas d’autre engagement associatif relatif à la cause des femmes, ce qui tend à confirmer l’importance des rétributions escomptées au travers de l’engagement dans une asso- ciation de juristes professionnelles. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’en Afrique le droit constitue un savoir inégalement distribué et contribue donc à la délimitation d’arènes d’expertise et à la formation de carrières professionnelles 31. Ce type d’association constitue ainsi souvent pour les
28. École Normale de Rufisque. Créée en 1938, cette école a été mise en place pour former la première génération de femmes instruites en AOF qui ont constitué des « figures de l’entre-deux », prises entre leur milieu traditionnel et de nouvelles aspirations suscitées par les perspectives que leur offrait l’instruction. Voir P. Barthélémy, Africaines et diplômées à l’époque coloniale (1918-1957), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. 29. Entretien avec Dior Fall Sow, Dakar, 18 juin 2010. 30. Ibid. 31. J. Siméant, « L’enquête judiciaire face aux crises extrêmes : modèles d’investigation, registres de la dénonciation et nouvelles arènes de défense des causes », Critique Internationale, vol. 3, n° 36, 2007, p. 9-20.
RECHERCHE162
militantes « un passage obligé qui leur [permet] de se faire connaître 32 », une sorte de tremplin pour leurs futures carrières.
L’importance des rétributions escomptées par les membres de l’AJS en termes d’insertion dans des réseaux professionnels nourrit les critiques à leur encontre. D’anciens soutiens déçus dénoncent le côté carriériste des femmes juristes alors que les islamistes du Circofs (Comité islamique pour la réforme du code de la famille sénégalais) les taxent de « féministes dans leur tour d’ivoire 33 ». Les membres de l’AJS assument néanmoins leur statut d’élite et le revendiquent même comme un atout : « Oui, il y a de l’élitisme puisque nous avons fait des études. Mais nous pouvons ainsi mettre une expertise à disposition des femmes qui en ont besoin et c’est un véritable plus 34 ». Au-delà, c’est leur discours sur les droits des femmes – en ce qu’il se veut distinct du féminisme occidental - qui constitue l’argument central des femmes juristes pour légitimer leur action et contrecarrer les critiques.
Le discours officiel de l’AJS se veut en effet mesuré, basé sur le modèle de ce que l’association appelle un « féminisme à l’africaine », dont l’identité serait fondée sur la complémentarité des rapports entre les sexes 35, expression explicitement revendiquée dans le domaine familial comme en témoigne l’ouvrage fondateur de l’association, Le droit au service de la justice (1975). Sa présidente y rappelle aux hommes qu’ils « doivent surtout comprendre qu’il ne vient à l’idée d’aucune femme en Afrique, au Sénégal en tout cas, de chercher à renoncer à son identité propre, où à envoyer l’homme à la cuisine » et que les femmes entendent bien conserver leur rôle de « mère affectueuse » et d’« épouse fidèle », parfaitement compatible avec la revendication d’être reconnue comme citoyenne. L’une des membres fondatrices a confirmé cette position au cours de notre entretien, considérant que la complémentarité entre les sexes n’est pas incompatible avec l’égalité sur le plan juridique et résumant le défi de l’association ainsi : « Nous recherchons une égalité parfaite, mais sans pour autant nous acculturer. C’est là toute notre difficulté 36 ».
La défense des droits des femmes n’est ainsi pas revendiquée au nom du féminisme, terme qui divise les militantes, lesquelles peuvent néanmoins y adhérer à titre individuel, sans engager l’association. Un nouveau clivage
32. A. Boigeol, « Le genre comme ressource dans l’accès des femmes au “gouvernement du barreau’’ : l’exemple du barreau de Paris », Genèses, n° 67, 2007, p. 66-88. 33. Nous nous fondons sur les entretiens que nous avons pu avoir avec des groupes islamistes, des professionnels du droit, des associations de femmes et des personnalités politiques. 34. Entretien, Dakar, 6 juillet 2007.35. On retrouve ici le même argumentaire que celui développé par les féministes maliennes et analysé par A. Latourès dans « “Je suis presque féministe mais…’’ », art. cit. 36. Entretien, Dakar, 11 juin 2010.
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes163
entre générations apparaît ici : les anciennes assument en général un posi-tionnement féministe alors que chez les plus jeunes, plusieurs réfutent ce qualificatif qu’elles associent à un combat spécifique à l’Occident 37. L’incapacité des principaux textes de lois, fondés sur le principe universel de l’égalité entre les sexes, à modifier concrètement la situation des femmes sénégalaises, a vraisemblablement contribué au désenchantement et à la prise de distance des jeunes militantes par rapport au discours féministe occidental. Une des membres émet d’ailleurs des craintes face à cette évolution : « Beaucoup d’étudiantes viennent travailler à l’association mais elles ne sont pas toutes féministes, loin de là […]. Elles viennent parce que l’AJS bénéficie d’une image très positive. Contrairement aux femmes d’âge mûr, les jeunes n’ont pas d’intérêt pour le féminisme 38 ». Un entretien mené avec deux étudiantes de l’AJS confirme cette ambiguïté. En effet, lorsqu’on évoque la proposition des islamistes d’instaurer un code du statut personnel basé sur la charia, un débat s’amorce entre elles. Si l’une s’offusque de leur proposition de restaurer la répudiation, l’autre tente de dédiaboliser cette procédure et d’en faire ressortir le caractère pragmatique, défendant ainsi indirectement l’une des propositions du Circofs auquel l’AJS s’est pourtant fermement opposée 39. Les divergences idéologiques que révèle cet exemple ne donnent néanmoins pas lieu pour l’instant à un débat de fond à l’échelle de l’association dont les positions restent clairement orientées autour de la défense des droits des femmes dans le cadre de l’État laïque.
De manière générale, la plupart des militantes récusent néanmoins le féminisme à l’occidentale et donnent une définition de leur engagement en utilisant des termes négatifs ou euphémisants 40 : « Je suis féministe, oui, mais pas au sens péjoratif. Juste pour la cause des femmes » ; « Je n’aime pas utiliser le terme de féministe. Je n’aime pas le terme parce que je n’aime pas l’opposition a priori 41». C’est pourquoi, si les revendications de l’AJS autour du droit de la famille ont été et sont toujours nombreuses, des sujets comme la polygamie – une pratique bien ancrée dans la société sénégalaise – ne constituent pas une priorité de son combat : « Dès lors que les femmes ne sont pas toutes d’accord, nous avons estimé qu’il fallait en faire une question personnelle 42 ». Le risque
37. C. T. Mohanty, “Under Western Eyes : Feminist Scholarship and Colonial Discourses”, Feminist Review, n° 30, 1988, p.65-88.38. Entretien, Dakar, 17 juin 2010. 39. En 2002, le Circofs a proposé l’abrogation du code de la famille et l’instauration d’un code de statut personnel basé sur la charia. 40. On retrouve ici les mêmes stratégies que celles observées par A. Latourès dans son étude sur les féministes maliennes, « “Je suis presque féministe mais…’’ », art. cit. 41. Entretiens avec des militantes, Dakar, 9 et 11 juin 2010. 42. Entretien, Dakar, 3 mars 2009.
RECHERCHE164
de division est en effet déjà présent au simple niveau de l’association puisque plusieurs militantes vivent dans des ménages polygames, ce qui n’est pas sans créer un certain malaise, comme en témoigne cette anecdote :
« On a été à une conférence internationale il y a deux ans. Dans la délégation on était deux
monogames, deux polygames [rires]. Il y a une Américaine qui nous interrogeait sur la
polygamie. J’ai dit à A : “Je n’ose pas leur dire que vous êtes polygames, c’est des histoires
de l’Antiquité’’ 43 ».
La ligne officielle modérée de l’association tente ainsi de composer avec les différents modes de vie de ses militantes et réfute tout caractère radical, comme en témoigne son opposition par le passé au Yewwu Yewwi (YY), seule association à s’être jamais déclarée ouvertement féministe au Sénégal 44. Si les deux associations partageaient le même objectif de voir réformé le code de la famille, les stratégies et justifications ont pu être en opposition. Évoquant par exemple une autre conférence internationale à laquelle les deux associations participaient, une militante de l’AJS nous a fait part d’une querelle publique qui avait surgi entre son groupe et Awa Thiam, membre du YY et auteur de l’ouvrage La Parole aux Négresses, au sujet de l’excision : « On lui a carrément dit de se taire. Car il fallait peut-être d’abord penser à convaincre les gens sur le terrain. On lui a dit qu’elle ne représentait aucune Négresse et qu’elle ferait mieux de changer le titre de son ouvrage 45 ». Contestant la représentativité du YY, l’AJS fait pourtant l’objet du même type de reproche, notamment en raison de sa collaboration étroite avec l’État et les bailleurs de fonds, mais également de ses rapports souvent difficiles et distants avec les autres associations de femmes.
Une insertion problématique au sein du mouvement des femmes
Historiquement, l’AJS s’est effet d’abord investie prioritairement dans des partenariats internationaux, s’inscrivant notamment dans différents
43. Idem.44. L’association Yewwu Yewwi, créée en 1984 et aujourd’hui disparue, constituait le seul groupe véritablement radical dans le champ associatif féminin. Dénonçant les mécanismes sociaux de subordination et l’oppression des femmes dans les espaces public et privé, les membres de YY revendiquaient le féminisme comme philosophie et doctrine politique, n’hésitant pas à mettre en cause religions et traditions pour porter leur combat en faveur de l’égalité entre les sexes. Le YY n’envisageait pas des combats sectoriels comme la majorité des associations, mais défendait une approche globale dont l’objectif premier était la conscientisation des femmes. 45. Entretien, Dakar, 8 juin 2010.
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes165
réseaux de femmes juristes, aussi bien au niveau continental (Fédération des juristes africaines) qu’international (Fédération internationale des femmes de carrière juridique) 46. La dynamisation de l’association a ainsi clairement été favorisée par ces échanges avec l’extérieur. Les membres de l’AJS participent par ailleurs à de nombreuses conférences internationales qui leur ont permis de se familiariser avec les théories féministes puis sur le genre. Néanmoins, l’une des membres fondatrices considère que l’association a investi de manière démesurée son temps et son énergie dans ces réseaux 47 et ainsi perdu le contact avec le terrain 48. Cette inscription dans les réseaux a en tout cas orienté les formes du militantisme vers plus de professionnalisation et d’expertise, favorisant ainsi la collaboration avec les autorités politiques auprès desquelles l’AJS apparaît comme un interlocuteur légitime.
L’association a en effet développé plusieurs projets et partenariats avec les autorités gouvernementales. Les membres de l’AJS sont consultées en tant qu’expertes au sein de différentes commissions parlementaires, par exemple pour la réforme du code pénal (2006) ou encore celle du droit de succession (2010). Le président Wade leur a d’ailleurs attribué le statut d’organe consultatif auprès du chef de l’État et leur confie à ce titre des missions, comme par exemple la participation à la délégation sénégalaise au sommet organisé par les Nations unies pour l’évaluation de Pékin+10 à New York en 2004 49. En échange, l’association bénéficie du soutien technique et institutionnel de l’État pour organiser ses différentes manifestations. Il n’y a cependant pas de subventions directes de l’État, l’association étant financée principalement par les cotisations des membres 50 et les contributions des « partenaires au développement » sur certains projets 51. Par ailleurs, la collaboration n’exclut pas les conflits. Le ministère de la Famille est par exemple vivement critiqué
46. Créée à Paris en 1928, la Fédération internationale des femmes de carrière juridique a pour but de « promouvoir la paix et l’égalité entre les êtres humains ». Cette fédération a ensuite inspiré de nouvelles organisations poursuivant les mêmes buts mais fondées sur des bases régionales, à l’image de la Fédération des juristes africaines mise en place en 1979. 47. Dans son mémoire L’émergence d’un mouvement féministe au Sénégal. Le cas du Yewwu Yewwi, 2007, Hawa Kane constate aussi que l’investissement des militantes à l’international a pris progres-sivement beaucoup d’ampleur au point de créer des tensions entre les militantes concernant le fait de savoir lesquelles représenteraient l’association au cours des rencontres internationales.48. Entretien, Dakar, 17 juin 2010. 49. Du 28 février au 11 mars 2004, une réunion s’est tenue dans le cadre de la 49e session de la Commission de la condition de la femme afin de faire le bilan des efforts entrepris pour faire progresser l’égalité entre les sexes depuis la conférence de Beijing (1995). 50. Fixées à 25 000 francs CFA (environ 40 euros) par an. Plusieurs membres donnent plus car elles en ont les moyens. 51. Actuellement, l’AJS collabore principalement avec la coopération italienne qui finance sa boutique du droit.
RECHERCHE166
par une femme juriste qui considère qu’on y fait « que ce qui ne gêne pas : […] Pour moi ce ministère, c’est le ministère de l’alimentaire avec les sacs de riz et le micro-crédit 52 ».
C’est pourquoi, si la plupart des membres reconnaissent avoir globalement de bons rapports avec les autorités, elles insistent sur le fait qu’elles sont indépendantes et tiennent à le rester : « On est société civile très clairement. On ne se positionne pas par rapport aux partis politiques. On donne notre avis mais en tant qu’expertes 53 ». L’engagement politique de plusieurs de ses membres, s’il ne constitue pas un empêchement pour intégrer l’association, a dans les faits créé des conflits entre les militantes quand l’une d’elles a été nommée présidente de l’AJS alors qu’elle exerçait par ailleurs des responsabilités politiques. Une de ses critiques évoque ainsi cet épisode : « Moi j’étais prête à démissionner. On était vingt ans après la création de l’association et on ne voulait vraiment pas de ça. Elle a dû se démettre après une semaine 54 ». Si l’investissement au sein de l’AJS s’accommode difficilement d’un enga- gement partisan, la collaboration avec l’État reste très étroite, ce qui fragilise l’inscription de l’association au sein du mouvement des femmes.
L’insertion de l’AJS dans le mouvement de femmes a en effet été d’autant plus difficile que l’association tient à afficher son indépendance, y compris par rapport aux autres associations féminines. Ainsi, l’AJS a fait le choix de ne pas être membre de la Fédération des associations féminines du Sénégal 55 et ne collabore que ponctuellement avec d’autres associations. La première génération de militantes a justifié cette prise de distance par le fait que, composée de juristes, l’association ne pouvait se permettre d’adopter n’importe quelle stratégie et devait se limiter au droit. En réalité, les luttes de pouvoir entre les dirigeantes associatives expliquent pour beaucoup ce manque de coordination, comme l’admet à regret une militante : « Je me suis rendue compte que chacun donne la priorité à son association. L’association passe avant la cause en fait et ça me pose vraiment problème 56 ». Au-delà de la compétition avec les autres associations elles-mêmes « d’élites », l’AJS a souffert d’une « mauvaise réputation » auprès des associations de la base, dont beaucoup sont situées hors de Dakar : « Elles ont dans l’idée qu’on les prend de haut, qu’on se croit sorties de la cuisse de Jupiter 57 ». Le caractère à la fois
52. Entretien, Dakar, 17 juin 2010. 53. Entretien, Dakar, 9 juin 2010. 54. Entretien, Dakar, 8 juin 2010. 55. Créée en 1977, la FAFS regroupe plus de 400 associations dans tous les départements du Sénégal. Elle est actuellement dirigée par Abibatou Ndiaye, membre d’une association de femmes enseignantes. 56. Entretien, Dakar, 17 juin 2010. 57. Entretien, Dakar, 15 juin 2010.
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes167
professionnel et élitiste de l’AJS a ainsi constitué un obstacle à l’obtention d’une « attestation de représentativité » 58 auprès d’un mouvement des femmes au sein duquel l’outil juridique est d’ordinaire très peu mobilisé.
Les difficultés de l’AJS à populariser son approche juridique de la cause des femmes
Bien que l’AJS ait été créée en 1974, l’approche par le droit est longtemps restée minoritaire dans le mouvement associatif féminin. Malgré l’accrois-sement et le renforcement des droits des femmes dans plusieurs domaines, les militantes de l’AJS peinent à convaincre de la pertinence de la mobilisation juridique, principalement en raison du fossé entre droit formel et droit réel qui réduit fortement la portée des victoires obtenues sur le plan législatif. Jusque récemment, le manque d’activisme de l’AJS sur le terrain judiciaire n’avait pas permis de combler cet écart.
C’est sur le terrain de l’acquisition de nouveaux droits que l’AJS a été la plus performante. Les pressions internationales, combinées au lobbying de l’AJS et des associations de défense des droits humains, ont permis des avancées notables. Sur le plan du droit international, outre son adhésion à la Cedef (1985) 59 et au Protocole facultatif à cette convention (2000), l’État sénégalais est également signataire des principales conventions internationales et régionales relatives aux droits des femmes. Ces textes constituent la norme juridique de référence et facilitent le plaidoyer des associations. Elles peuvent ainsi passer outre le débat idéologique sur la place et le statut de la femme dans la société pour revendiquer, d’un point de vue purement technique, l’harmonisation de la législation sénégalaise avec le droit international. Concernant le droit interne, la loi de pénalisation de l’excision (1999), la réforme de la loi sur la sécurité sociale (2006), la loi sur la parité (2007) et la réforme de la loi relative à la fiscalité (2008) constituent sans doute les avancées les plus significatives. Ces victoires juridiques auxquelles a participé l’AJS ont cependant une portée limitée.
D’abord, elles ne touchent quasi exclusivement qu’aux droits des femmes dans l’espace public et ne s’attaquent pas à la sphère privée. Ainsi, le droit de la famille, pourtant cheval de bataille de l’association depuis sa création, apparaît comme le bastion imprenable. Le vote de la nouvelle loi sur la parité,
58. M.-E. Pommerolle et J. Siméant, « Voix africaines au forum social de Nairobi. Les chemins transnationaux des militantismes africains », Cultures et Conflits, n° 70, 2008, p. 129-149. 59. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes.
RECHERCHE168
le 14 mai 2010, est venu souligner un peu plus le caractère intouchable du statut des femmes dans l’espace privé comme le constatait une femme juriste député :
« À la tribune, le ministre de la Justice a adressé un message aux hommes, en les enjoignant
à voter la loi sur la parité parce qu’il ne s’agissait pas d’une parité sociale, encore moins
d’une parité familiale, mais bien d’une parité politique. C’était une manière de les rassurer
en leur disant qu’aucun de leurs avantages au niveau sociétal ne serait touché 60 ».
Ensuite, ces nouveaux droits n’ont pas fait l’objet d’une mobilisation populaire importante. Si l’on se penche sur les domaines juridiques dans lesquelles le lobbying de l’AJS a été efficace (équité fiscale, sécurité sociale, parité), force est de constater qu’il s’agit de droits qui profitent d’abord et avant tout aux femmes qui travaillent hors du secteur informel ou qui peuvent avoir accès à des postes de décision, autrement dit à une minorité d’entre elles. Or, comme Anne Revillard l’a montré dans le cas du Québec, le succès d’une réforme portée par des juristes militantes est conditionné au soutien massif du mouvement associatif féminin 61. Au Sénégal, le manque de conver-gences des priorités entre femmes juristes et mouvement des femmes constitue un handicap dont ont bien conscience les membres de l’AJS : « Pour chaque catégorie de femmes, il y a des droits plus appropriés ou en tout cas prioritaires par rapport à d’autres. Par exemple pour les femmes intellectuelles, qui travaillent, le combat pour l’équité fiscale va être fondamental car elles sont plus imposées. Mais ce combat va être sans intérêt pour la femme rurale qui, elle, fait face à des problèmes de divorce et de répudiation 62».
Enfin, le manque d’appropriation du droit par les femmes et par les associations féminines n’a pas permis de tirer partie de ces réformes en raison d’une conscientisation juridique très faible. Celle-ci s’explique par un fossé très important entre « ordre juridique formel » et « ordre juridique réel », particulièrement marqué dans le domaine du droit de la famille où le droit étatique est concurrencé par les normes coutumières et religieuses.
Les normes du droit de la famille n’ont en effet été que très faiblement incorporées par une large majorité de la population, ce qui permet de comprendre pourquoi des pratiques comme les mariages de mineures ou les mariages forcés restent d’actualité 63. Il en va de même de pratiques désormais
60. Entretien, Dakar, 15 juin 2010. 61. A. Revillard, « Le droit de la famille… », art. cit. 62. Entretien, Dakar, 9 juin 2010. 63. Il n’existe pas de données précises à ce sujet. Nous nous basons ici sur les entretiens au sein d’associations de défense des droits des femmes, avec des avocats et des magistrats.
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes169
interdites par la loi - ainsi la répudiation - qui perdurent, beaucoup de femmes ignorant encore qu’il s’agit d’un acte illégal. La non maîtrise du droit par une majorité de femmes a pour effet pervers de voir les mesures à leur avantage se retourner contre elles. Une femme « répudiée » peut ainsi être poursuivie devant les tribunaux par son époux qui demande le divorce au motif de l’abandon de famille ou du domicile conjugal. Dans un tel contexte, on peut se demander quel intérêt auraient les femmes à obtenir plus de droits alors qu’elles ne sont même pas en mesure de faire s’appliquer ceux qu’elles détiennent déjà ?
Par ailleurs, des victoires juridiques comme la loi de criminalisation de l’excision ne conduisent pas non plus nécessairement au développement de la conscience juridique des associations de femmes. Ainsi, alors que les membres de l’AJS se félicitent des déclarations d’abandon de l’excision, les associations en région dénoncent une situation aggravée du fait d’un travail qui a porté uniquement sur le texte 64 : « Moi je suis pour des lois qui favorisent le progrès […]. Mais une loi se prépare et s’accompagne […]. Et ce qui se passe maintenant c’est plus grave car c’est clandestin […]. Mais qui est au courant ? Personne ! Les ONG, les organisations de femmes…, personne n’est là 65 ».
De manière générale, les associations de base reconnaissent le travail de l’AJS en matière de promotion des droits, mais le jugent peu utile à la cause des femmes en raison de l’incapacité d’une majorité d’entre elles à utiliser le droit comme ressource pour défendre et améliorer leurs conditions de vie.
En filigrane, c’est donc le manque d’investissement de l’AJS sur le terrain qui est mis en cause. Pourtant, dès sa création, l’AJS insistait sur l’importance de la sensibilisation des populations au droit, mais dans les années qui ont suivi la création de l’association, son action se limitait à l’organisation de consultations juridiques gratuites à la chambre de commerce de Dakar. Progressivement, des cliniques mobiles du droit ont néanmoins été mises en place pour toucher un nouveau public en région. Par exemple, entre 2004 et 2008, cinq journées ont été organisées à Dakar, St Louis et Pikine et ont permis d’enregistrer un millier de demandes, la plupart relatives au droit foncier, au droit du travail et au droit de la famille 66. Bien que le nombre de cas traités sur ces quatre années ne soit pas très important, l’une des membres historiques
64. Cette loi avait suscité des résistances très fortes dans le débat public, poussant certaines associations à demander un report de l’application du texte qui n’a pas été obtenu. Les craintes étaient fondées puisque en guise de représailles, 120 fillettes ont été excisées dans la région de Kédougou en décembre 1998.65. Entretien avec des militantes de l’Aprofes (Association pour la promotion de la femme sénégalaise), Kaolack, 20 avril 2008. 66. Selon les cas, l’AJS a simplement donné des conseils juridiques ou procédé à un accompagnement plus poussé dans les démarches auprès des tribunaux.
RECHERCHE170
nous confiait sa satisfaction de voir ce type d’activités se décentraliser. Les jeunes juristes confirment cette évolution pragmatique : « Les anciennes étaient surtout dans la réflexion intellectuelle […] Il n’y avait pas autant cette ouverture aux populations 67 ».
Une nouvelle approche centrée sur l’accès au droit
Le rajeunissement de l’association et le renouvellement du discours sur le droit comme outil de développement aux échelles nationale et internationale ont néanmoins et récemment créé un contexte favorable à la réorientation des stratégies de l’association autour de la thématique de l’accès au droit. Cette nouvelle politique qui vise à rendre le droit accessible au profane se traduit par un renforcement des consultations juridiques gratuites, notamment via la boutique de droit, et par la mise en place d’une assistance judiciaire. Cette nouvelle stratégie semble porter ses fruits au regard du succès des structures de médiation et de l’intérêt que les autres associations de femmes y portent, comme en témoigne leur collaboration plus poussée avec l’AJS.
Une approche renouvelée de l’outil juridique : rendre le droit accessible
au profane
Cette inscription progressive de l’association dans une logique de terrain tient d’abord au renouvellement des générations au sein de l’association. Les jeunes militantes ont désormais plus de moyens à disposition pour investir dans une politique d’accès au droit. En effet, au moment de sa création, l’AJS n’avait pas autant de partenariats qu’aujourd’hui et ne bénéficiait donc pas des mêmes ressources. Par ailleurs, les militantes n’étaient pas aussi nombreuses et n’avaient donc pas les mêmes possibilités de s’organiser et de se rendre disponibles sur le terrain. Mais cette évolution pragmatique tient aussi et surtout à l’évolution du rapport au droit des nouvelles générations militantes. Dans le contexte post-indépendance dans lequel la loi apparaissait comme l’outil de la modernisation et de la construction nationale, sa capacité à emporter l’adhésion par sa propre force 68 apparaissait sans doute acquise à des femmes juristes formées à l’école du droit positif. Mais le manque d’appropriation du droit par les populations l’a rendu souvent inefficace voir
67. Entretien, Dakar, 9 juin 2010. 68. J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 2004 (2e édition « Quadrige »).
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes171
ineffectif, conduisant à une forme de désenchantement à l’égard de ses potentialités et donc à un changement d’approche et de stratégie au sein de l’AJS. Cette réorientation des stratégies de l’association doit cependant être reliée à l’évolution du discours des acteurs internationaux sur le droit. Après avoir été marginalisé dans les années 1980 69, le droit apparaît en effet à nouveau comme un outil indispensable aux politiques de développement. À partir des années 1990, la promotion du genre par les agences onusiennes se fonde en effet sur l’idée de la nécessaire complémentarité des approches juridique et économique pour agir de manière transversale sur les inégalités entre les hommes et les femmes 70. À la même période, la Banque mondiale et le FMI ont également réinvesti le champ juridique à partir de la promotion de la « rule of law » qui vise à créer, par la mise en place d’un État de droit, les conditions favorables à une « bonne gouvernance », devenue le critère d’appréciation majeur dans la détermination de l’aide au développement 71. Au vu de la manne financière que cela peut potentiellement représenter 72, les États bénéficiaires de l’aide ont mis en place un certain nombre de réformes sur le plan juridique 73.
Au Sénégal, l’État a ainsi ouvert en 2005 le chantier de la réforme de la justice en collaboration avec la coopération française. Le Pasej (Programme sectoriel justice) vise à mettre en place « un service public de qualité et de proximité au service des justiciables ». L’accès au droit constitue l’un des axes centraux du projet 74. À cet effet, des maisons de justice ont été créées pour informer les populations sur leurs droits, accueillir les victimes et procéder à des médiations pour régler les conflits. Au vu du succès rencontré par les trois sites pilotes installés dans la banlieue de Dakar, cinq autres maisons ont été installées, dont quatre en région. Ces structures permettent d’offrir
69. L’approche juridique restait marginale par rapport à une approche économique centrée sur l’amélioration des conditions de vie des femmes. Avec la crise des années 1980, les limites de cette approche sont apparues : les changements au niveau économique n’ont pas engendré de réelles transformations du statut des femmes ou de remise en question des logiques patriarcales dans l’organisation des rapports sociaux. Voir J. True et M. Mintrom, « Transnational Networks…», art. cit. 70. H. Ryckmans et P. Maquestiau, « Population et développement : égalité de genre et droits des femmes », Mondes en développement, vol. 2, n°142, 2008, p. 67-82. 71. G. Hermet, « Démocratisation, droits de l’homme et gouvernance », in P. Favre et al. (dir.), Être gouverné. Études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 301-313. 72. Les quatre cinquièmes des conditions posées par la Banque mondiale pour obtenir des prêts concernent des modifications du droit. T. Delpeuch, « La coopération internationale au prisme du courant de recherche “droit et développement’’ », Droit et Société, vol. 1, n° 62, 2006, p. 119-175. 73. On peut citer les travaux de S. Lefranc qui, notamment à travers l’exemple de la « justice transitionnelle » en matière pénale, montrent la circulation des usages du droit au niveau inter-national. Voir S. Lefranc, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et Société, vol. 3, n° 73, 2009, p. 561-589. 74. Site de l’Ambassade de France à Dakar : <ambafrance-sn.org/spip.php?article788>
RECHERCHE172
un appui permanent aux populations qui n’en bénéficiaient jusque là que ponctuellement via l’organisation d’audiences foraines qui correspondaient à des journées de délocalisation du tribunal de Dakar dans les banlieues.
Les organisations de défense des droits humains investissent également dans la mise en place de structures pérennes et dans la formation de para-juristes. C’est d’ailleurs la création de la boutique de droit de l’AJS en décembre 2008 qui a véritablement marqué le tournant décisif de l’association vers une politique de terrain. D’autres associations ont suivi le mouvement. Ainsi, à l’instar de l’AJS, l’ONDH (Organisation nationale des droits de l’Homme) a fait des boutiques de droit l’un de ses principaux chantiers.
L’AJS travaille à la promotion de l’accès au droit de deux manières. Dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Justice, l’association collabore avec la maison de justice des Parcelles Assainies (banlieue de Dakar). L’AJS fournit une assistance judiciaire et les avocates membres ont, en 2010, pris en charge quarante dossiers devant les tribunaux dont la moitié relatifs au droit de la famille 75. Cet appui est apprécié des médiateurs de la maison de justice : « Souvent j’envoie beaucoup de cas à la boutique de droit des femmes juristes. Car entre femmes, il y a plus de solidarité je pense 76 ». Mais le plus gros projet de l’AJS est constitué par sa boutique de droit, installée depuis 2008 dans le quartier populaire de la Médina à Dakar. L’AJS revendique la paternité de ce type de structure, justifiant la mise en place tardive de sa boutique par la difficulté à trouver des fonds. Celle-ci a été financée grâce à la coopération italienne et par la mise à disposition de locaux par la mairie de la Médina. La boutique symbolise véritablement le changement de l’AJS, qui cherche désormais à faire du potentiel justiciable un sujet de droit, c’est-à-dire à le faire passer d’une « attitude légaliste passive » à une « démarche légitimiste active 77 ».
La première mission des juristes est de donner des conseils juridiques et d’assister les justiciables auprès des tribunaux s’ils choisissent d’intenter une action. La véritable nouveauté réside bien dans l’assistance judiciaire même si l’AJS ne peut pas prendre en charge autant de dossiers qu’elle le souhaiterait. En général, l’association tente de faire remonter les cas les plus problématiques - par exemple quand la médiation a échoué ou encore lorsqu’apparaissent des situations dramatiques lors des consultations en région. En ce sens, les femmes
75. Elles sont rétribuées par la coopération française. 76. Entretien, Dakar, 8 mars 2010. 77. C’est-à-dire que l’individu « passif », se considérant comme incompétent et qui subit le droit élaboré en dehors de lui, doit se transformer en « actif », autrement dit « apprendre à connaître le droit, le rapporter à son quotidien, l’utiliser et le modifier », P. Huyghebaert et B. Martin, Quand le droit fait l’école buissonnière…, op. cit., p. 14.
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes173
juristes s’inscrivent progressivement dans une logique de « cause lawyering », concept qui renvoie aux usages militants du droit par les professionnels du droit 78. Dans ce nouveau registre, les femmes juristes suscitent la méfiance des avocats qui considèrent pour certains qu’elles empiètent sur leur domaine réservé : « Certains ne sont pas contents car ils considèrent qu’on vole leurs clients. Mais nous on n’a pas de vocation lucrative 79 ». Et les militantes entendent bien poursuivre dans cette voie car, après les déceptions engendrées par les faibles retombées de leur combat législatif, l’investissement des arènes judiciaires apparaît véritablement comme le nerf de la guerre :
« La nouvelle stratégie doit consister à aller directement devant les tribunaux pour
demander aux juges d’appliquer les conventions. Par exemple la puissance maritale. C’est
le mari qui choisit la résidence du couple et si la femme n’est pas d’accord et qu’elle n’a
pas de bonnes raisons de s’y opposer alors le divorce va être prononcé à ses torts. Si on a
le cas, on va désormais la défendre en disant que la femme est libre en vertu des conventions
internationales et qu’elle n’a pas à demander. On va sans doute être confronté à un refus,
alors il faudra faire appel, aller jusqu’à la Cour Suprême et jusqu’à la Cour de justice de
la Cedeao s’il le faut. C’est vrai, c’est un long parcours qu’une femme peut ne pas vouloir,
mais c’est la seule voie possible car les politiques ne nous sont d’aucune utilité 80 ».
Au-delà de sa mission juridique, la boutique de droit nécessite de la part des bénévoles une vraie prise en compte de l’aspect psychologique de leur travail. À propos des personnes qui viennent demander de l’aide, une militante parle de « déclic » : « C’est comme si les populations n’attendaient que [la création de la boutique] pour venir s’épancher […]. Elles avaient tellement peur du prétoire et de la justice qu’en réalité elles se retrouvaient pratiquement sevrées de leurs droits 81 ». Pour les mettre en confiance, il est nécessaire d’instaurer un rapport qui dépasse le formalisme de la relation avocat/client. C’est pourquoi les militantes sont formées à la médiation. Cette option est privilégiée par les femmes juristes et, de manière générale, par tous les programmes visant à établir une justice de proximité. En effet, le ministère de la Justice et les acteurs de la société civile partagent l’idée que la médiation est sans doute mieux adaptée aux perceptions africaines 82 de la justice parce
78. L. Israël, L’arme du droit…, op. cit.79. Entretien, Dakar, 9 juin 2010. 80. Entretien, Dakar, 18 mars 2010. 81. Entretien, Dakar, 11 mars 2009. 82. Selon É. Le Roy, la conception africaine de la modernité judiciaire fait primer le règlement des conflits au sein du groupe dans un souci de préservation du tissu social ; voir « Présentation. De la modernité de la justice contemporaine en Afrique francophone », Droit et société, vol. 2, n° 51-52, 2002, p. 297-301.
RECHERCHE174
qu’elle n’est pas « une simple technique de gestion des conflits » mais bien « une autre approche de la régulation des conflits qui met l’accent sur la nécessité de reconstruire le tissu social 83 ».
L’investissement de l’AJS sur le terrain et la promotion d’une politique globale d’accès au droit ont-ils permis une progression de la saisine du droit par les populations, en particulier les femmes ?
L’intégration progressive du droit dans le quotidien des populations
Six mois après son ouverture, le bilan chiffré de la boutique de l’AJS montre qu’elle n’est pas une coquille vide et que les populations s’en saisissent : en effet, 751 personnes sont venues consulter les 19 juristes mobilisées à la boutique 84. Le droit de la famille représente 62,9 % des cas soumis à l’asso-ciation avec essentiellement des affaires de divorce (214 cas), de réclamations (contributions aux charges du ménage, pension alimentaire, 205 cas) et de succession (54 cas) 85. Pour les membres de l’AJS, ce bilan a favorisé une amélioration des relations avec les autres associations : « Depuis qu’on a ouvert la boutique, les associations de défense des droits des femmes et des enfants se tournent vers nous […]. Elles nous voient vraiment comme des partenaires et ce parce qu’on est vraiment dans les problèmes très pratiques 86 ». Ce rapprochement est confirmé par une militante de l’Afeme (Association des femmes de la Médina) : « L’AJS est notre alliée et collaboratrice […]. À chaque réunion, on rappelle aux femmes que cette boutique existe et que les consultations sont gratuites 87 ».
Grâce au développement de ce type de collaboration, l’AJS bénéficie d’un soutien qui lui faisait jusqu’alors défaut parmi les associations de base. Forte d’un meilleur ancrage sur le terrain, l’association peut, au-delà de l’aide juridique qu’elle apporte aux justiciables, relancer certaines batailles législatives qui n’ont pas abouti. C’est notamment le cas du combat pour la réforme du code de la famille. Lors du symposium sur le droit de la famille et du dîner-débat sur l’autorité parentale, respectivement organisés en juin et juillet 2009, les femmes juristes se sont appuyées notamment sur le bilan de la boutique pour insister sur la nécessité de rendre le droit plus accessible
83. N. Schmutz, cité par P. Huyghebaert et B. Martin (dir.), Quand le droit fait l’école buissonnière…, op. cit., p. 188. 84. AJS, Compte-rendu annuel de la boutique de droit, Dakar, 2008/2009. 85. Les résultats de la boutique ont été jugés encourageants par la coopération italienne qui a prolongé le financement du projet. 86. Entretien, Dakar, 9 juin 2010. 87. Entretien avec une militante de l’Afeme, Dakar, 17 avril 2009.
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes175
à travers sa traduction en langues nationales, la simplification des procédures, le renforcement des mesures d’accompagnement ou encore la réduction du coût de la justice. Bien que leurs revendications n’aient pas encore abouti, la mobilisation du droit sert au moins à faire émerger un problème dans l’espace public, quelle que soit l’issue des affaires sur le plan juridique 88.
Néanmoins si l’action de l’AJS dans la capitale lui permet de dialoguer et de promouvoir son approche auprès des autres associations, elle reste absente dans les régions. Les femmes juristes se justifient en évoquant des financements limités et une difficulté à recruter des femmes juristes hors de la capitale. Ici apparaît une des limites majeures de leur action, c’est-à-dire l’incapacité à créer un mouvement et un débat au niveau national, malgré l’augmentation des interventions délocalisées. Dans les régions isolées, les juges se plaignent d’ailleurs d’être souvent sollicités comme conseils, ce qui leur pose un pro-blème déontologique évident. Les femmes sont donc démunies face à un juge d’une part inapte à les conseiller, d’autre part souvent conservateur dans ses positions 89. Afin d’atteindre plus de femmes en zone rurale, les femmes de l’AJS ont donc choisi d’investir dans la formation de parajuristes, choisies parmi des « militantes féministes, enseignantes et actrices du développement », qui ont l’avantage d’avoir un ancrage local : « Les parajuristes peuvent donner le b.a.-ba du droit, éteindre la peur que les gens ont du tribunal. C’est un moyen d’être un relais communautaire 90 ».
Par ailleurs, le fait que l’AJS réussisse à sensibiliser progressivement les populations par l’intermédiaire de sa boutique n’implique paradoxalement pas qu’elle touche un public essentiellement féminin. Bien que la sensibilisation des femmes constitue l’un des principaux objectifs de la boutique – ce qui en fait d’ailleurs sa spécificité par rapport aux maisons de justice –, elle reste également ouverte aux hommes. Ainsi, le bilan d’étape réalisé six mois après l’ouverture de la boutique faisait apparaître que le public était composé d’une courte majorité d’hommes. Les membres de l’AJS se disent heureuses de pouvoir rendre service de manière globale, mais en réalité le problème est récurrent : le groupe dominé, à savoir les femmes, se saisit moins du droit. Se dessine ici la problématique de l’identité du justiciable. Si, théoriquement, le droit doit être un outil accessible à tous, il reste l’apanage de populations qui ont les capacités et les ressources pour s’en saisir. Au-delà des clivages urbain/rural et hommes/femmes, le taux important d’analphabétisme
88. L. Israël, « Usages militants du droit dans l’arène judiciaire », Droit et Société, vol. 3, n° 49, 2001, p. 793-824. 89. Nous avons réalisé des entretiens avec 17 magistrats à Dakar et en région. 90. Entretien, Dakar, 11 mars 2009.
RECHERCHE176
constitue un autre obstacle de taille à la saisine du droit 91, de même qu’une longue tradition qui veut que les conflits se règlent au sein du cercle privé et familial. Cette distance avec le droit vécue par certaines catégories de la population traduit la difficulté à voir émerger et vivre une citoyenneté pleine et entière, validant ainsi la dichotomie entre une minorité de « citoyens » aptes à mettre en œuvre et à faire respecter leurs droits, et des « sujets » qui ignorent le droit ou le subissent faute de pouvoir le maîtriser 92. Néanmoins, la situation semble évoluer concernant la saisine du droit par les femmes. Si nous ne disposons pas d’un bilan plus récent de la boutique de droit, notre enquête au sein de deux maisons de justice en 2010 permet de voir un changement se dessiner : les femmes sont en effet les plus nombreuses à les saisir en matière familiale. En effet, sur les 42 % de cas relatifs aux affaires familiales, 78 % sont des requêtes déposées par des femmes et ont principalement pour objet des questions de divorce/répudiation, garde d’enfants et défaut d’entretien/pension alimentaire 93. À la boutique de droit, les membres de l’AJS soulignent par ailleurs que si les femmes restent encore légèrement minoritaires par rapport aux hommes dans leur boutique, celles qui viennent sont issues de toutes les couches sociales.
Dans un pays anciennement colonisé où le droit étatique est en concurrence avec d’autres ordres normatifs, l’usage de « l’arme du droit » ne va pas de soi. À travers le cas de l’AJS, nous avons tenté de montrer comment les entrepreneurs de cause se saisissent du droit et d’expliquer la manière dont celui-ci peut s’en trouver modifié ou mieux approprié. En focalisant d’abord principalement son action autour du lobbying pour l’obtention de nouveaux droits, l’AJS n’a pas réussi à populariser son approche juridique auprès des populations. La réorientation de ses stratégies vers une politique d’accès au droit a permis de renforcer la vulgarisation et d’intervenir sur le terrain de l’activisme judiciaire. La saisine plus fréquente du droit par les populations issues des milieux urbains montre que ce changement d’approche a contribué à une transformation des attitudes à l’égard du droit : d’un comportement majo-ritairement « contre le droit » voire « hors du droit », on passe à une attitude de jeu « avec le droit » qui traduit son appropriation progressive 94. Ces
91. 58,2 % de la population est analphabète, les femmes étant les plus touchées (67,1 % de femmes contre 47,9 % d’hommes). Chiffres de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANDS) sur l’année 2005-2006 : <www.ansd.sn>92. M. Mamdani, Citoyen et sujet. L’Afrique contemporaine et héritage du colonialisme tardif, Paris, Karthala, 2004. 93. Statistiques que nous avons établies à partir des procès-verbaux des années 2007 à 2010. 94. P. Ewick et S. Silbey, « Conformity, Contestation and Resistance… », art. cit.
Politique africaine
Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes177
évolutions ouvrent de nouvelles perspectives pour les associations féminines qui considèrent désormais le droit comme un répertoire d’action légitime, à défaut d’être central. Cette légitimation du droit comme « arme » contribue au rapprochement entre les associations de professionnelles du droit et les organisations populaires et profanes. En cela, elle peut favoriser une plus grande cohésion du mouvement des femmes et lui donner ainsi plus de poids dans les débats politiques qui l’oppose à certains courants religieux intégristes qui, dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne et du Maghreb, mettent en cause les acquis juridiques des femmes !
Marième N’Diaye
Les Afriques dans le monde (LAM)
IEP de Bordeaux/Université de Bordeaux
AbstractLegal mobilization and women’s cause : the case of the Association of Senegalese Women Lawyers (AJS) In Sub-Saharan Africa, legal mobilization still appears as an unconventional
repertoire of contention regarding the women’s movement. In a context of competition between different normative orders (state, customary and/or religious orders), it is difficult for people to become acquainted with the law and there is an important gap between legal and actual orders. Thus, it is easier to understand why law has rarely been a tool used by activists. Nevertheless, some associations have tried to mobilise the law in order to improve women’s rights in both legislative and judiciary fields. Through the case study of the Association of Senegalese Women Lawyers, this paper intends to show how this legal mobilization was built and has evolved to gradually appear as a legitimate tool to advance the women’s cause.