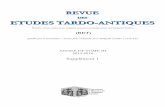Des Amis des rois aux amis des Romains, RPhil LXXII 1998, 65-86
Norme visible et norme invisible. Le traitement des canadianismes et des québécismes dans certains...
Transcript of Norme visible et norme invisible. Le traitement des canadianismes et des québécismes dans certains...
DizionariDictionnairesDictionariesPercorsi di lessicografiacanadese
a cura diSergio Cappello e Mirella ConennaFORUM
Estratto
Sara Vecchiato
Norme visible etnorme invisible.Le traitement descanadianismes etdes québécismesdans certainsdictionnairesfrancophones duQuébec
Collana di studi delCentro di Cultura Canadese, 2Udine, Forum 2010ISBN 978-88-8420-335-7
5
Indice
Introduzionedi Sergio Cappello e Mirella Conenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7
Sergio Cappello Dizionari bilingui franco-amerindi del XVII secolo: il Dictionaire de la langue Huronne (1632) di Gabriel Sagard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11
Carla MarcatoLessicografia bilingue dell’inuktitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27
Anna Pia De LucaCanadian Speech, Canadian Dictionaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37
Deborah SaideroCanadian English Dictionaries and the Lexicographic Mapping of Cultural Identity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47
Chiara MolinariLes dictionnaires franco-québécois : enjeux sociolinguistiques et perspectives interculturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 55
Annick FarinaL’utilisation des marques lexicographiques au Québec : un choix politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75
Sara VecchiatoNorme visible et norme invisible. Le traitement des canadianismes et des québécismes dans certains dictionnaires francophones du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 97
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 5
Indice
Mirella ConennaLe québécois dans la valise : les dictionnaires à usage touristique . . » 127
Jean-Paul DufietL’altérité indienne dans les dictionnaires québécois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141
Gerardo AcerenzaDictionnaires français et romans québécois : chronique d’une “ haine ” annoncée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 159
André DugasUn dictionnaire comparé d’emplois verbaux pour l’anglais et le français ou Who are you going to wake up next to ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 171
Michele De GioiaSyntaxe et dictionnaires du français du Québec : le cas des adverbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 185
Maria Gabriella AdamoPour un dictionnaire plurilingue de locutions figurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207
Raffaella BombiLa terminologia anglofona della linguistica del contatto e del plurilinguismo: riflessi lessicografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 225
6
imp dizionari - DIctionnaires 2-12-2010 11:07 Pagina 6
97
Norme visible et norme invisibleLe traitement des canadianismes et des québécismes danscertains dictionnaires francophones du Québec
Sara Vecchiato*
1. Introduction
1.1. L’illusion de la norme objective
Le dictionnaire constitue un objet culturel fort familier auprès du grand public,pour lequel il représente un répertoire des mots de la langue accompagnés dece qu’il convient de savoir à leur propos. Comme il appartient au genre didac-tique, il garde tous les caractères du discours pédagogique qui en font sansdoute le répertoire linguistique, auquel le locuteur fait référence pour s’expri-mer correctement1.
Il est ainsi possible que les lecteurs moins avertis aient tendance à considérercomme un ouvrage infaillible ce qui n’est qu’un objet empirique. Un mot qui n’apas “ droit de cité ” dans le dictionnaire devient, pour la conscience linguistiquedes parlants, incorrect, voire inexistant : “ Pour beaucoup de locuteurs aussi naïfsque natifs, un mot n’est ‘ français ’ que s’il figure au dictionnaire2 ”.
L’idée d’un dictionnaire-bible est nécessairement illusoire. En effet, pour desimples raisons d’ordre pratique, le lexicographe ne peut décrire le discourstout entier et donc tous les usages, mais il utilise une sélection de discours pourdécrire les usages. Autrement dit, aucun dictionnaire ne peut refléter unenorme complètement objective, malgré les intentions de son auteur :
L’objet-langage ne peut se percevoir convenablement que sous trois éclairages (aumoins) : les discours et leurs conditions de production (stratégies de la parole et de l’écri-
* Università degli Studi di Udine.1 Cf. Jean DUBOIS, Claude DUBOIS, Introduction à la lexicographie. Le dictionnaire, Paris,
Larousse, 1971, p. 49 ; Michel ARRIVÉ, Françoise GADET, Michel GALMICHE, La grammaired’aujourd’hui, Paris, Flammarion, 1986, p. 225.
2 Alain REY, “ Normes et dictionnaires (domaine du français) ”, dans La norme linguistique,Édith BÉDARD, Jacques MAURAIS (ed.), Québec-Paris, Conseil de la langue française – LeRobert, 1983, p. 566.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 97
Norme visible et norme invisible
ture), les usages, donc (géographiques, chronologiques, sociaux, peut-être culturels,idéologiques), et enfin, très abstraitement, le système de la langue. De même, l’objet queconstitue la norme langagière est triple : pluralité sociale évidente des “ normes objec-tives ” ou usages, pluralité conflictuelle des “ normes évaluatives ” (jugements de valeur),unicité ou plutôt tension vers l’unicité de la “ norme prescriptive ” (lanorme, pour paro-dier Jacques Lacan).La première “ trichotomie ” devait être rappelée ici, parce que le dictionnaire se situeavec précision en elle. Comme je pense l’avoir montré (Rey, 1977), le dictionnaire dit “ delangue ”, et avec lui le dictionnaire hybride (encyclopédie), ne décrit nullement le systè-me abstrait, il en exemplifie des actualisations, ce qui est bien différent. Non plus, il nedécrit “ le ” discours, tâche inachevable, mais utilise une sélection de discours à ses finspropres, qui sont – enfin – de décrire des usages, avec leurs dimensions sémantiques, prag-matiques, et culturelles. Cette description intensément sélective d’usages construit une“ image ” (et non pas un modèle scientifique, et non pas une photo fidèle) d’où peut, à tra-vers les conflits des normes évaluatives, se dégager ou non la figure d’une norme unique3.
Du point de vue opératif, cette problématique concerne plusieurs facteurs.Les décisions préalables à la rédaction d’un dictionnaire concernent toujours lavariation et la norme dans la langue en question : une fois établis le nombre etla nature des variantes et leurs relations avec la forme standard, les lexico-graphes doivent décider lesquelles des ces variantes ils veulent englober dansl’ouvrage, et ensuite quel type de dictionnaire ils souhaitent rédiger4. Les dic-tionnaires pouvant être de langue ou encyclopédiques, historiques ou synchro-niques, conservateurs ou “ branchés ”…, ils traitent de façon différente les motsarchaïques, techniques, nouveaux.
En nous bornant au dictionnaire monolingue, nous pouvons mentionner :(i) le choix des sources du corpus, qui est censé être représentatif de la pro-
duction écrite et/ou orale de la communauté linguistique ;(ii) l’inclusion vs. exclusion de mots du corpus ;(iii) le choix des mots-vedettes, qui devient difficile avec les assemblages de
mots (chemin de terre, chemin de fer…) ;(iv) la marque d’usage (dialectal, familier, littéraire, poétique, populaire, recher-
ché, vulgaire…), qui donne des informations sur les contextes d’emploi dumot, et véhicule au même temps l’attitude normative du lexicographe ;
98
3 A. REY, art. cit., p. 542. Dans le texte, REY fait référence à son étude de 1977, Le lexique, ima-ges et modèles : du dictionnaire à la lexicographie, Paris, Armand Colin.
4 Ladislav ZGUSTA, Manual of Lexicography, The Hague-Paris, Mouton, 1971, p. 222.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 98
Sara Vecchiato
(v) la définition et les exemples illustratifs de l’emploi du mot, qui contri-buent souvent à la valorisation d’un modèle culturel.
Pour ce qui est de la lexicographie française contemporaine, nous avons repé-ré bien des études sur le traitement de mots tabous ou porteurs de connotationsracistes, sexistes, homophobes5. Cependant il semble exister un accord de fond surce qui constitue le corpus du dictionnaire de langue française, puisque la discus-sion concerne des zones plus ou moins “ marginales ” du lexique. Le modèle delangue est traditionnellement, pour le français écrit, celui des auteurs littéraires lesplus appréciés ; pour l’oral, celui de la bourgeoisie cultivée de Paris6.
99
5 Nous mentionnons, à titre d’exemple, la contribution de Jean-Claude BOULANGER, dénonçantle révisionnisme lexical issu de la political correctness anglophone, qui remplace aveugle avecmalvoyant : “ Un épisode du contact de langues : la néobienséance langagière et le néodiscourslexicographique ”, dans Français du Canada – français de France, Marie-Rose SIMONI-AUREMBOU (ed.), Tübingen, Niemeyer, 2000, p. 307-324. Cf. en outre les remarques de JeanPRUVOST à propos du traitement du “ mot de Cambronne ” dans les dictionnaires Larousse etRobert, dans son étude “ À la recherche de la norme : sa représentation lexicographique et dic-tionnairique chez Larousse et Robert et la triple investigation ”, Langues et sociétés, 39, 2002,p. 139-170).
6 Une hypothèse, appuyée jusqu’à récemment, est que le français trouve son origine justementdu dialecte de l’Île-de-France, le francien, qui aurait établi sa primauté sur les autres variétésde l’Hexagone à partir du XIe siècle, au fur et à mesure que la royauté étendait son pouvoir.Ensuite, on a mis en discussion le fait même que le francien ait existé, et on a théorisé que lestranscriptions anglo-normandes des cycles épiques chevaleresques auraient donné lieu à unevariété écrite commune. Quoi qu’il en soit, il semble qu’à partir du XIIIe siècle, le roi de Frances’installe effectivement à Paris et qu’une variété commune commence à être diffusée, grâce àla centralisation politique et au prestige culturel associé à la Cour (Ferdinand BRUNOT,Histoire de la langue française des origines à nos jours, Tome I, nouvelle éd., Paris, ArmandColin, 1966 ; Bernard CERQUIGLINI, “ P comme Paris, la langue d’un État et de sa capitale ”,dans Le français dans tous ses états, Bernard CERQUIGLINI et al. (ed.), Paris, Flammarion, 2000,p. 231-242). Il existe également une tradition selon laquelle c’est le français de Tours qui constitue la normedu français. Cette attribution a été répandue par la grammaire de Palsgrave et par des guidesde voyage allemands, hollandais et anglais du XVIe siècle ; elle a été entretenue par la réputa-tion des écrivains de la Pléiade, qui étaient pour la plupart originaires de la Touraine. Certainslinguistes affirment que cette tradition n’a pas raison d’être, parce qu’elle confond la situationactuelle avec celle d’il y a cinq siècles, les Tourangeaux ayant depuis longtemps adopté lanorme parisienne (Fernand CARTON et al., Les accents des Français, Paris, Hachette, 1983, p.37). D’autres pensent que Tours n’a jamais influencé Paris mais que, bien au contraire, c’est leparler tourangeau qui a été francisé plus tôt que d’autres dialectes, ce qui facilitait les contactsavec les étrangers qui s’approchaient de l’Île-de-France (Henriette WALTER, Le Français danstous les sens, Paris, LGF, [1988] 1996, p. 19-20). Le tourangeau est étudié encore aujourd’huicomme représentant la centralité linguistique francophone (Nicole GUEUNIER, ÉmileGENOUVRIER, Abdelhamid KHOMSI, “ Les Français devant la norme ”, dans La norme lingui-stique, cit., p. 763-788 ; Gudrun LEDEGEN, Le bon français. Les étudiants et la norme linguisti-que, Paris, L’Harmattan, 2000).
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 99
Norme visible et norme invisible
Ce tableau est loin de la situation du Canada français, et du Québec en par-ticulier, dont la production lexicographique prolifère de “ dictionnaires defautes ” et de listes d’interdits. L’auto-dépréciation de la variété locale québé-coise est une vexata quæstio, à laquelle s’ajoutent des éléments de nouveauté.
Dans cet article, nous allons parcourir brièvement le débat sur la norme lin-guistique au Québec (§ 1.2) ; la situation lexicographique franco-canadienne etquébécoise, pour tâcher de définir deux notions qui nous paraissent utiles, àsavoir celles de norme visible et norme invisible (§ 1.3) ; nous allons essayerensuite d’appliquer ces notions dans une étude sur le traitement de canadia-nismes et québécismes dans un corpus lexicographique canadien-québécois (§2) : les catégories sensibles sont les archaïsmes (§ 2.1), les périphérismes (§ 2.2),les amérindianismes (§ 2.3), les mots tabou (§ 2.4), les innovations (§ 2.5) et lesanglicismes (§ 2.6).
1.2. À la recherche d’une norme
Dans le Canada français, et notamment au Québec, il existe une situation debilinguisme français/anglais qui touche un grand pourcentage de population. Il
100
Les réflexions de Malherbe et de Vaugelas, aussi bien que l’institution de l’Académie françai-se au XVIIe siècle, peuvent servir de repère pour dater le moment où a commencé le débat surla norme en France. Le langage de la Cour, ou plus précisément de la partie “ dégasconnée ”de la Cour, voire “ la plus saine partie de la Cour ”, devient le sommet d’une hiérarchisationsociolinguistique qui présente une structure analogue à celle de la hiérarchie sociale (BernardCERQUIGLINI, “ H comme Histoire. Le français : un créole qui a réussi ”, dans Le français danstous ses états, cit., p. 109-124). Pour ce qui est du français contemporain écrit, Lothar WOLF
a observé que “ la plus saine partie de la Cour a été remplacée par les bons auteurs ”, bien quedes grammairiens, comme Grevisse, prennent ce modèle avec prudence, puisque la littératureexploite désormais le langage argotique (Lothar WOLF, “ La normalisation du langage enFrance. De Malherbe à Grevisse ”, dans La norme linguistique, cit., p. 105-137). Pour ce quiest de la norme phonétique à l’oral, la situation paraît encore plus en évolution. Jusqu’au XXe
siècle le modèle unique de prononciation était le français parisien cultivé, mais dans les années60 il cède le pas au français standard, système élaboré dans la capitale aussi par des locuteursnon natifs de l’Île-de-France. Dans les années 80 le modèle central parisien est en crise. Onélabore un concept de norme dite standardisée, définie comme la somme des traits communsaux prononciations régionales : le français standardisé est une prononciation non marquée, nisocialement ni géographiquement. Aujourd’hui, on parle de français international, définicomme l’ensemble des façons de parler le français dans le monde à partir d’une langue com-mune (Enrica GALAZZI, “ Dal ‘ français parisien cultivé ’ al ‘ français international ’ : evolu-zione della norma fonetica nel XX secolo ”, dans Europa plurilingue. Comunicazione e didatti-ca, B. CAMBIAGHI et al. (ed.), Milano, Vita e Pensiero, 2005, p. 137-144). Sur ce dernier con-cept, cf. la note 12.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 100
Sara Vecchiato
est bien connu que, depuis longtemps, les anglicismes sont indiqués comme lamenace la plus concrète à la survie du bon français au Québec7.
Aussi croyons-nous pouvoir parler de diglossie entre une variété locale defrançais et une variété alignée sur le français international8. La notion de diglos-sie employée ici renvoie et à l’inégalité de statut des deux variétés, et à leurusage concurrent selon le contexte situationnel. Par exemple, du registre fami-lier au populaire, les locuteurs québécois peuvent utiliser le mot dîner au lieude déjeuner ; la forme interrogative On peut-tu… ? pour Peut-on… ? ; la pro-nonciation [swεf] au lieu de [swaf] pour le mot soif :
Les Québécois instruits possèdent une espèce d’empan sociolinguistique plus large quece n’est généralement le cas pour les Français ou pour les Anglais : leur usage familier dela langue est souvent éloigné de leur usage public ou soutenu et ils passent facilementd’un niveau de langue à l’autre. […] Les différences entre le français du Québec et lefrançais de France sont importantes au niveau de langue populaire, mais le français qué-bécois soutenu se tient assez près du français “ international ”9.
Après des années où on prônait l’alignement du français du Québec sur lefrançais de France, en 1985 l’Office Québécois de la Langue Française (OQLF)– organisme responsable de l’aménagement linguistique au Québec – a défini leprincipe d’autonomie normative du Québec par rapport aux autres pays fran-cophones. Ce principe a été affirmé, entre autres, à cause de la prise deconscience que le simple calque de la terminologie française ne remplaçait pasles anglicismes en usage, mais il créait de la confusion auprès des locuteurs. Eneffet, plusieurs termes proposés étaient devenus ambigus, voire inutilisables, à
101
7 Cf. Gilles BIBEAU, “ Le français québécois : évolution et état présent ”, dans Langue et iden-tité – Le français et les francophones d’Amérique du Nord, Noël CORBETT (ed.), Québec, PUL,1990, p. 11-18.
8 Dans son article de 2004 dans le quotidien montréalais “ Le Devoir ”, L. MENEY utilise leterme “ triglossie ” pour décrire l’alternance et l’imbrication, dans le code linguistique québé-cois, de l’anglais, de la variété locale, et du français standard (Parler français comme un vraiQuébécois ?, “ Le Devoir ”, Montréal, le 7 janvier 2004). En revanche, il serait déroutant dedésigner la variété locale québécoise par le mot joual. Ce terme désigne avec mépris la langueparlée par les prolétaires et sous-prolétaires montréalais, mais comme le met en évidenceAndré DUGAS, il s’agit d’un jugement qui n’a jamais été vraiment défini de manière objectivesur le plan socio-linguistique (André DUGAS, “ Littérature québécoise et langue populaire :mythes, réalités, identité ”, dans L’identità negata. Spazio reale e spazio immaginario nelQuébec, Maria Gabriella ADAMO (ed.), Messina, Lippolis, 1999, p. 31-63).
9 Cf. G. BIBEAU, art. cit., p. 14.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 101
Norme visible et norme invisible
cause de leur opposition avec les termes franco-canadiens. Il existe ainsi desunités linguistiques locales qui ont le statut de standard au même titre que lefrançais international : les mots courriel, binette et dépanneur en opposition àmél, frimousse et bazarette adoptés en France10.
De plus, on affirme de plusieurs côtés une corrélation entre variété nationa-le – État-nation – légitimité linguistique. Une norme endogène est bien ressentiecomme une nécessité par beaucoup d’intellectuels, dont certains travaillentpour l’un de deux organismes gouvernementaux, à savoir le déjà nommé OfficeQuébécois de la Langue Française (OQLF) et le Conseil Supérieur de la LangueFrançaise (CSLF). Entre autres, nous mentionnons Monique Bisson ; HélèneCajolet-Laganière ; Pierre Martel ; Claude Verreault et Robert Vézina11. Cettenorme endogène serait donc autonome par rapport au français international12.
A présent, auprès de l’Université de Sherbrooke est en cours un projet appe-lé FRANQUS, dirigé par Hélène Cajolet-Laganière et Pierre Martel et financé par
102
10 Pour une synthèse de la politique linguistique québécoise et de ses résultats sur le plan du statutet du corpus de la variété locale, nous renvoyons à nos articles “ L’autonomie du Québec enmatière de norme linguistique et ses retombées sur la francophonie ”, dans Scrivere e Pensare ilCanada, Giovanni DOTOLI (ed.), Fasano di Puglia, Schena, 2003, p. 63-85 ; “ La pianificazionelinguistica del Quebec: status e corpus ”, dans Le lingue e l’economia – Atti del convegno,Università degli Studi di Brescia, 5-6 dicembre 2002, Marco CIPOLLONI (ed.), sous presse.
11 Pierre Martel a été président du CSLF, tandis que Robert Vézina et Monique Bisson travaillentcomme terminologues dans la Commission de Terminologie de l’Office de la langue française(CTOLF). Dans le rapport du CSLF de 1989-1990, Martel avait préconisé encore une fois ladescription exhaustive du français du Québec ainsi que de son modèle valorisé de bon usageau moyen d’un dictionnaire général, non-différentiel, du français québécois (CONSEIL DE LA
LANGUE FRANÇAISE, L’aménagement de la langue : pour une description du français québécois,Rapport et avis au Ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française,Québec, 1990, p. 62).
12 Les dictionnaires différentiels ne traitent que les écarts québécois par rapport au françaisinternational, tandis que les dictionnaires non différentiels regroupent tous les emplois encours au Québec, en faisant une somme des écarts et des emplois communs Québec/fran-cophonie internationale et en laissant de côté les emplois qui ne sont propres qu’à d’autreszones de la francophonie, y compris la France. À son tour, ce français dit “ international ”coïncide pratiquement avec les grammaires et les dictionnaires rédigés en France, bien quel’ouverture récente aux régionalismes ait permis l’accès à des formes non originaires de l’hexa-gone (Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE, Pierre MARTEL, Le français québécois. Usages, standard etaménagement, Québec, PUL, 1996, p. 18). Un essai de définition extensionnelle du françaisinternational est offert par le projet BFQS (cf. infra). Aussi le projet Métadif (CNRS – Universitéde Cergy-Pontoise) suit-il, entre autres, la lexicographie et la dictionnairique des aires fran-cophones et créolophones, cf. le site : http://www.u-cergy.fr/rech/labo/equipes/mvd/dico_creolo_franco/creolo/dico_creoles. htm.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 102
Sara Vecchiato
les ministères de la Recherche et de la Culture. L’équipe se propose de décrirele français standard en usage au Québec :
Le standard correspond à tout mot, sens ou expression que les Québécois tendent à uti-liser dans leurs échanges écrits et oraux quand ils veulent s’exprimer de façon correcte(niveau neutre ou non marqué dans le dictionnaire). Au-dessus de cet usage standard setrouvent les registres soutenu et littéraire, et en-dessous, les registres familier et très fami-lier. S’ajoutent les emplois critiqués et les recommandations d’organismes officiels13.
Le projet même n’a pas manqué de susciter les premières critiques. Le débatdemeure virulent, sans doute parce qu’on craint que difficilement le Québecsera en mesure d’imposer un bon usage alternatif à celui de la France, sur lemodèle des Etats-Unis par rapport à la Grand-Bretagne – faute d’une puissan-ce démographique et socio-économique comparable. Le risque redouté par lesopposants du “ bon français d’ici ” est que le Québec s’isole du reste de la fran-cophonie14.
Cette situation fait ainsi qu’au Québec le rapport de tout dictionnaire avecl’objet-langue est toujours remis en question. Il nous semble que, au-delà desmots adoptés ou créés par la Commission de Terminologie, les opinions diver-gent sur le traitement de bien des mots et de tournures locales. Ce qui n’est passans conséquences sur la perception que la communauté linguistique québécoi-se a de sa langue. Bien au contraire, le dictionnaire devient en quelque sorte un“ révélateur d’insécurité linguistique ”15.
103
13 Groupe de recherche FRANQUS, Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE, Pierre MARTEL, Franqus(FRANçais Québécois: Usage Standard), Université de Sherbrooke, cf. le site :http://franqus.usherbrooke.ca.
14 Nous nous referons en particulier aux articles de deux linguistes et lexicographes, LionelMENEY et Claude POIRIER – articles parus en 2004 et 2005 dans le quotidien “ Le Devoir ”.Dans son premier article (Parler français comme un vrai Québécois ?, art. cit.), MENEY a prisposition contre la création d’une norme québécoise ; dans le deuxième (Un autre dictionnairequébécois, pourquoi?, “ Le Devoir ”, Montréal, le 7 janvier 2005) contre le projet FRANQUS.Claude POIRIER a publié sur le même journal deux répliques, où il a réfuté la “ supposée ghet-toïsation ” du Québec (Le français des Québécois - Notre différence est devenue un atout, “ LeDevoir ”, Montréal, le 16 janvier 2004) et défendu le projet du dictionnaire (Finie la quaran-taine pour les lexicographes québécois!, “ Le Devoir ”, Montréal, 26 janvier 2005).
15 Cf. Lionel BOISVERT et al., “ Le dictionnaire comme révélateur d’insécurité linguistique ”,Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain, 19, “ L’insécurité linguistique dans les com-munautés francophones périphériques ”, 1994, p. 187-198.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 103
Norme visible et norme invisible
1.3. Norme visible et norme invisible
D’après Annick Farina16, nous pouvons regrouper la production lexicogra-phique franco-canadienne en trois groupes, à savoir les “ dictionnaires decurieux ”, les “ dictionnaires d’éducateurs ” (ou de puristes), les “ dictionnairesde lexicographes ”. Leurs buts étant différents, leurs choix dictionnairiques lesont également.
Depuis 1985, date du colloque sur la lexicographie québécoise tenu àl’Université Laval17, la production de dictionnaires de langue française auQuébec a connu un essor remarquable18. Nous enregistrons, entre autres, laparution de rééditions de recueils correctifs d’anglicismes tels le Colpron ; denouveaux recueils de locutions comme celui d’André Dugas et de BernardSoucy, ou celui de Pierre Desruisseaux ; de nouveaux répertoires différentiels,tels que celui de Gaston Dulong et celui de Lionel Meney. En outre, nous pou-vons mentionner la mise en ligne de la banque de données terminologiques del’OQLF dans Le grand dictionnaire terminologique19.
104
16 Annick FARINA, Dictionnaires de langue française du Canada, Paris, Honoré Champion, 2001.17 Les actes du colloque ont été édités par Lionel BOISVERT, Claude POIRIER, Claude VERREAULT :
La lexicographie québécoise, bilan et perspectives, Québec, PUL, 1986. Il faut notammentsignaler l’intervention de Franz Josef HAUSMANN (“ Les dictionnaires du français hors deFrance ”, p. 3-21) : l’auteur défend l’idée que les régionalismes intérieurs de la France ne peu-vent être mis sur le même plan que les particularités des français hors France. Les unités géo-linguistiques telles que le Québec ou la Belgique wallonne, de par leur souveraineté nationa-le, ont le droit à la dénomination de pays autant que la France. Le phénomène de variantenationale du français, d’après Hausmann, mérite d’être décrit par une production lexico-graphique à part entière, tout comme il arrive déjà pour d’autres langues. Cette position a étéreprise maints fois par les spécialistes qui prônent la description des variétés nationales dufrançais, dont le québécois.
18 Cf. Claude VERREAULT, “ Inclusion, reconnaissance et identification des francismes dans lesdictionnaires québécois : problèmes et méthodes à la lumière de l’expérience du Dictionnairequébécois d’aujourd’hui ”, dans Français du Canada – Français de France, Thomas LAVOIE (ed.),Tübingen, Niemeyer, 1996, coll. “ Canadiana Romanica ”, 12, p. 199-208. Le numéro 63 de larevue Circuit, de l’Ordre des traducteurs et interprètes agréés du Québec, est consacré juste-ment à un “ Tour du jardin lexicographique ”. Son directeur, Betty COHEN, présente la pro-blématique dans l’éditorial “ Please translate into Canadian French ”, Circuit, 63, 1999, p. 1.
19 Constance FOREST, Denise BOUDREAU, Dictionnaire des Anglicismes – Le Colpron, Laval,Beauchemin, 1999 ; André DUGAS, Bernard SOUCY, Le dictionnaire pratique des expressionsquébécoises, Montréal, Logiques, 2000 ; Pierre DESRUISSEAUX, Dictionnaire des expressionsquébécoises. Nouvelle édition, Saint Laurent (Québec), Bibliothèque québécoise, 1990 ;Gaston DULONG, Dictionnaire des canadianismes. Nouvelle édition revue et augmentée, Sillery(Québec), Septentrion, 1999 ; Lionel MENEY, Dictionnaire Québécois/Français, Montréal,Guérin, 1999 ; OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, 2005, Le grand dictionnaire terminologique,Québec, OLF-Convera Canada inc., cf. le site : http://www.granddictionnaire.com.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 104
Sara Vecchiato
Jusqu’à présent, seulement deux dictionnaires ont paru présentant unenomenclature non-différentielle et descriptive du français du Québec, à savoir leDictionnaire du français plus dirigé par Claude Poirier, et le Dictionnaire québé-cois d’aujourd’hui par Jean-Claude Boulanger. Les deux sont partis de deux dic-tionnaires français, respectivement du Dictionnaire Français Hachette et duPetit Robert. Cependant, les critiques à certains choix lexicographiques ontdécouragé leur réédition, tandis que le Multidictionnaire de Marie-éva deVillers, dictionnaire non-différentiel mais normatif, a été bien accepté20.
Des projets universitaires sont également en cours : le déjà cité Franqus parHélène Cajolet-Laganière et Pierre Martel ; le Dictionnaire canadien bilingueanglais-français dirigé par Roda P. Roberts ; la Banque de données lexicales pan-francophone par Claude Poirier ; le Laboratoire de lexicologie et lexicographiequébécoises (LexiQué) sous la responsabilité de Claude Verreault, LouisMercier et Thomas Lavoie ; le projet BFQS, qui consiste en la rédaction d’un dic-tionnaire de locutions figées en quatre variétés du français (Belgique, France,Québec, Suisse)21. Pour l’instant, seulement quelques échantillons de leur tra-vail ont été rendus disponibles.
Examinons la situation dans laquelle peuvent se trouver deux locuteursfrancophones, l’un Français et l’autre Québécois, lorsqu’ils désirent vérifier unmot de leur langue quotidienne dans un dictionnaire.
Prenons le mot party : anglicisme non intégré, il est entériné dans le Trésorde la langue française sous le mot-vedette partie, comme “ petite réception chezun particulier ” ; dans le Grand Robert c’est bien un mot-vedette, marqué
105
20 Claude POIRIER (dir.), Dictionnaire du français plus – à l’usage des francophones d’Amérique,Montréal, Centre éducatif et culturel inc., 1988 ; Jean-Claude BOULANGER (dir.), Dictionnairequébécois d’aujourd’hui, supervision par Alain REY, Montréal, Dicorobert, 1992 ; Marie-ÉvaDE VILLERS, MULTIdictionnaire de la langue française, Montréal, Québec Amérique, 1997.
21 H. CAJOLET-LAGANIÈRE, P. MARTEL (dir.), Franqus (FRANçais Québécois: Usage Standard), cit. ;Roda P. ROBERTS (dir.), Dictionnaire canadien bilingue – Projet de lexicographie comparée dufrançais et de l’anglais au Canada, Ottawa University, cf. le site : http://www.dico.uottawa.ca ;Claude POIRIER et al. (dir.), Base de Données Lexicographiques Panfrancophone, Trésor de lalangue française au Québec, Trésor des vocabulaires français, Université Laval, AgenceUniversitaire de la francophonie, cf. le site : http://www.tlfq.ulaval.ca/bdlp ; ClaudeVERREAULT, Louis MERCIER, Thomas LAVOIE (dir.), Laboratoire de lexicologie et lexicographiequébécoises (LexiQué), Université Laval, cf. le site : http://www.lexique.ulaval.ca. Pour uneintroduction au projet BFQS, cf. Jean René KLEIN, Corinne ROSSARI, “ Figement et variationen français de Belgique, de France, du Québec et de Suisse ”, Lingvisticæ Investigationes, 26(2), 2003, p. 203-214.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 105
Norme visible et norme invisible
“ anglicisme ”, défini comme “ 1. Réunion, réception mondaine. – Partie 2.Réunion occasionnelle de personnes dans un but immédiat déterminé ”.
Au Québec, le mot party est enregistré par le Dictionnaire québécois d’au-jourd’hui et par le Dictionnaire de canadianismes avec la marque “ angl. ” ; leColpron et le MULTIdictionnaire le sanctionnent, l’un par le fait même de l’in-clure dans la liste de mots à proscrire, l’autre en le marquant d’un astérisque quisignifie “ forme fautive ”.
Le grand dictionnaire terminologique exploite une démarche plus discrète :grâce à un mécanisme de renvoi par hypertexte, il corrige insensiblement l’inter-naute ayant commis l’erreur de chercher party dans le champ “ langue française ”.
Un mot à expulser, donc, mais qui réapparaît tout naturellement dans lesdictionnaires de locutions imagées. En effet, briser le party et être un casseux departy sont enregistrées par Desruisseaux et par Dugas – Soucy22. Elles fontdonc… partie de l’héritage linguistique québécois, le jugement sur leur statutétant apparemment suspendu.
106
22 A. DUGAS, B. SOUCY, op. cit. ; P. DESRUISSEAUX, op. cit.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 106
Sara Vecchiato
Il est aisé de récupérer la distinction, opérée par Rey23, entre le ton du diction-naire et la construction de son modèle normatif. Nous considérons normevisible la présence d’un élément linguistique (mot, tournure, acception) dans letexte du dictionnaire – pour l’entériner ou bien pour y porter une condamna-tion explicite – et norme invisible son exclusion, car l’exclusion, comme nousle verrons, est susceptible de signaler au lecteur que l’élément linguistique enquestion n’a pas “ droit de cité ” dans la langue.
2. Traitement de québécismes. Étude de cas
Nous avons choisi un corpus de mots qui nous paraissait “ sensible ”, à savoirles québécismes étudiés par Annette Paquot, qui tâchait de
déterminer dans quelle mesure le caractère régional des canadianismes est connu deslocuteurs québécois d’expression française, quelles sont leurs attitudes et leurs opinions— principalement évaluatives et normatives — à leur égard, quelle est l’image qu’ils sefont de leur comportement langagier en ce qui concerne ces mots, quelle est la disponi-bilité relative de ces derniers et des mots “ français ” de même signification et, enfin,quelles sont leur valeur stylistique et leur fonction sociolinguistique24.
Les mots choisis par Paquot ne figuraient pas dans les dictionnaires usuelsdu français contemporain sinon, dans quelques cas, avec la mention vx, région. oucanad. Certains de ces mots ont ensuite été acceptés, voire recommandés parl’OQLF, et certains rejetés. Étaient exclus les mots officiels et administratifs (“ sta-talismes ”), vulgaires et/ou très familiers. À ce corpus d’une centaine de mots nousen avons ajouté cinq qui nous paraissaient intéressants, entre autres des motstabou. Ceux-ci ne pouvaient évidemment pas faire partie de l’enquête de Paquotà cause de leur registre, qui aurait entraîné une réaction négative chez les per-sonnes interviewées. Par contre, certains analystes décrivent jurons et blasphèmescomme des particularités caractéristiques du français du Québec25. Nous avonsdonc été poussée à nous intéresser de leur traitement lexicographique.
107
23 A. REY, art. cit.24 Annick PAQUOT, Les Québécois et leurs mots. Étude sémiologique et sociolinguistique des régio-
nalismes lexicaux au Québec, Québec, PUL, 1988, p. 2.25 Cf. entre autres Jean-Pierre PICHETTE, “ Jurons franco-canadiens : typologie et évolution ”,
dans Michel AMYOT, Gilles BIBEAU (ed.), Le statut culturel du français au Québec, Actes ducongrès Langue et société au Québec, tome II, Québec, Conseil de la langue française, 1984 ;rediffusé sur le site : http://www.cslf.gouv.qc.ca/ Publications/PubF112/F112A8.html.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 107
Norme visible et norme invisible
Nous avons remarqué des différences de classement par rapport aux caté-gories utilisées par Paquot, à savoir archaïsmes/dialectalismes ; périphérismes26 ;amérindianismes ; innovations ; anglicismes, en gardant le classement originaltout en signalant les divergences.
Les dictionnaires pris en compte sont des ouvrages de large diffusion :Dictionnaire des expressions québécoises de Desruisseaux, abrégé en DEX ;Dictionnaire québécois d’aujourd’hui de Boulanger, abrégé en DQA ; leMULTIdictionnaire de la langue française par de Villers, abrégé en MUL ; leDictionnaire des canadianismes de Dulong, abrégé en DUL ; Dictionnaire desAnglicismes – Le Colpron de Forest – Boudreau, abrégé en COL ; DictionnaireQuébécois/Français de Meney, abrégé en MEN ; Le dictionnaire pratique desexpressions québécoises de Dugas – Soucy, abrégé en D&S ; Le grand dictionnai-re terminologique de l’OQLF, abrégé en GDT ; la Base de Données Lexico-graphiques Panfrancophone de Poirier et al., abrégé en BDLP27.
Quelques observations sur ces dictionnaires : alors que DQA et MEN enre-gistrent tous les usages, DUL essaie visiblement de combiner le souci descriptifavec l’exigence d’une norme : presque tous les québécismes du corpus sontattestés, mais avec des orientations pour l’utilisateur28. En revanche, le MUL
essaie tout d’abord de donner le plus possible d’informations normatives au lec-teur, dans un souci déclaré de correction. Les mots que le lexicographe consi-dère inacceptables sont marqués par une étoile, ce qui signale, de notre pointde vue, que le dictionnaire normatif “ cède ” face à l’usage. Le Grand diction-naire terminologique étant une forme de service linguistique en-ligne del’OQLF29, il est continuellement mis à jour. Il est possible donc de comparer les
108
26 Le périphérisme n’est plus employé dans le centre innovateur de la langue, mais se maintientdans les régions périphériques. Le dialectalisme se distingue du périphérisme en ce qu’il n’estpas employé dans d’autres zones que celle considérée.
27 Cf. les notes 18 et 19.28 NOLF indique qu’il s’agit d’un terme normalisé par l’OQLF ; ROLF signifie que le terme a fait
l’objet d’une recommandation par le même organisme. Le symbole # signifie “ à déconseil-ler ”, et Ø “ à proscrire ”. En revanche, nous avons fait abstraction des données relatives à lafréquence et à la disponibilité, voire de la diffusion géographique des mots en question – varia-bles certes importantes dans le traitement lexicographique ; nous avons donc ignoré les mar-ques utilisées dans le DUL “ partout au Québec ”, “ presque partout au Québec ”, “ ici et làau Québec ” (DUL, p. XII-XIV).
29 Cf. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Politique de l’officialisation linguistique,Québec, 2004, rediffusé sur le site : http://www.olf.gouv.qc.ca/ ressources/bibliotheque/offi-cialisation/politique_officialisation_20080425.pdf.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 108
Sara Vecchiato
changements d’évaluation à propos de certains termes. Une certaine prudencedoit être gardée pour la BDLP, dont les fiches sont publiées sur la toile au fur età mesure qu’elles sont prêtes, et pour les récoltes d’expressions figées, puisquel’idiosyncrasie inhérente au phénomène du figement empêche de prévoir quelmot sera dans quelle expression.
2.1. Archaïsmes et dialectalismes
Dans cette catégorie entrent vingt-six mots. S’ils étaient enregistrés comme“ acceptés ” déjà chez Paquot30, ils reçoivent aujourd’hui un traitement trèshomogène. En effet, ils sont attestés tous sans marque négative, et sont absentsdu COL, ce qui donne un tableau cohérent. C’est le cas de blé d’inde ; bleuet ;cretons ; tourtière31.
D’autres n’ayant reçu “ aucun jugement normatif ” d’après Paquot font l’ob-jet d’un traitement disparate. Tous sont attestés sauf répliqueux, sans doute troprare. S’appareiller, corporence et frette ne sont enregistrés que par DUL et MEN,bien que frette génère des expressions telles que prendre ça frette, faire l’estomacfrette. Boucane, encabané, niaiseux, placoter sont enregistré, sans marque néga-tive, dans davantage de dictionnaires.
Les mots classés comme “ rejetés ” chez Paquot sont les cas d’oppositionplus forte parmi les modèles normatifs proposés. Quelques discordances se fontremarquer entre le MUL et le GDT : si achaler, s’adonner, garrocher trouventplace dans le MUL e non pas dans le GDT, on peut penser qu’il s’agit de mots dela langue commune, et non pas de termes. En revanche, le GDT atteste cham-plure, claque, enfargé, à la différence du MUL, qui les exclue. Bas (“ chausset-te ”), lastique, venir (“ devenir ”) sont enregistrés par le DQA, DUL et MEN, tan-dis que MUL et GDT les éliminent du corpus. Pour piler, le MUL opte pour unecondamnation explicite de la forme par une étoile – condamnation exploitéepar DUL avec bas et lastique (à déconseiller).
De nouveau, nous remarquons la présence de mots exclus des dictionnairesdans les recueils d’expressions figées : arriver avec une claque puis une bottine ;s’enfarger dans ses idées ; piler sur son orgueil ; venir en âge.
109
30 A. PAQUOT, op. cit.31 Tourtière est toutefois absente du DQA et reçoit la marque région. dans la BDLP.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 109
Norme visible et norme invisible
2.2. Périphérismes
Les mots classés comme “ périphérismes ” ne sont que quatre. A l’époque oùPaquot a mené sa recherche (1988), trois avaient été rejetés par les autorités lin-guistiques. Le jugement a changé sur un terme (mitaine), qui résulte aujour-d’hui entériné. En revanche, rester n’avait reçu à l’époque aucun jugement nor-matif ; il est aujourd’hui dans le MUL mais non pas dans le GDT, sans douteparce qu’il ne s’agit pas d’un terme technique. Le mot votation est le premierpour lequel nous enregistrons une différence de classement, car nous le trou-vons attesté chez COL.
Le terme dactylo fait l’objet d’un traitement très différent dans les diction-naires consultés : le MUL dépense une recommandation au lecteur d’ordre lexi-co-morphologique (“ ne pas confondre le ou la dactylo ”), tandis que le GDT
opte pour la même technique de renvoi que nous avons observé plus haut pourparty. La recherche du mot dactylo aboutit en effet à trois types de fiches : appel-lation de personne ; bureau ; hébergement et tourisme. Ce n’est que dans ladeuxième que l’acception “ machine à écrire ” est considérée. Cependant le moten tête résulte, justement, machine à écrire, le mot dactylo étant plus en bas dansun renvoi avec la marque “ terme à éviter ”.
Mitaine et rester entrent également dans des expressions figées (aller à quel-qu’un comme une mitaine, rester le diable au vert).
2.3. Amérindianismes
Les amérindianismes constituent la partie du corpus la mieux acceptée par lesautorités en matière de langue, et celle qui présente le moins de contradictionsdans le traitement. Paquot ne relève que des jugements positifs, ou bien uneabsence de jugements, ce qui se reflète dans l’entérinement de tous ces termesdans les dictionnaires de langue examinés, avec ou sens la marque “ québécis-me ”. Deux mots (babiche et carcajou) forment aussi des expressions figées (seserrer/tirer la babiche, faire un saut de carcajou).
2.4. Mots tabou
Les mots tabou tels que les jurons et les gros mots subissent un traitement lexi-cograhique ambivalent.
Le DQA enregistre tous les sept mots que nous avons choisis, avec la marquefamilier ou très familier ; MEN n’utilise guère les marques, s’efforçant de pro-
110
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 110
Sara Vecchiato
duire un équivalent du même registre linguistique dans la traduction en fran-çais standard. Le MUL exclut tous les sept, le DUL en exclut quatre32, sauf don-ner un renvoi implicite sous un nom dérivé (tabarnaco “ surnom donné auxQuébécois francophones par les Mexicains, surnom dans lequel on reconnaît lejuron bien québécois tabernacle prononcé tabarnac ! ”) et il n’utilise aucunemarque dépréciative. Les récoltes d’expressions figées signalent que les juronsentrent dans un paradigme productif d’expressions figées de registre familiersignifiant “ être en colère ” (être en câlisse/ciboire/hostie/tabarnacle).
Dans le MEN on remarque un traitement du mot hostie laissant supposer qu’enfrançais du Québec, l’acception originaire s’est complètement perdue : “ en fran-çais standard, le mot ‘ hostie ’ désigne, pour les chrétiens des églises catholiqueslatines, une petite rondelle de pain de froment […] ; elle représente le Christ ”.
2.5. Innovations
Chez Paquot nous comptons un total de vingt-cinq mots. Les neuf mots“ acceptés ” reçoivent un traitement homogène d’entérinement, à quelquesexceptions près. Batture, beigne, bordée, poudrerie, tire, tuque sont enregistrésdans tous les dictionnaires généraux et entrent également dans des expressionsfigées (être dans les battures de quelqu’un, passer en poudrerie etc.). Le MUL et leGDT emploient pour la majorité d’eux les marques “ québécisme ”/“ Canada ”.
En revanche, il est des mots forgés par l’OQLF qui n’ont pas obtenu unconsensus unanime, comme hambourgeois : il n’est attesté ni dans le DQA nidans le MUL ; son échec est enregistré par une remarque à marge dans le MEN ;de plus, dans le DUL il suscite un commentaire sarcastique de la part du lexico-graphe – commentaire qui prend la place de la définition (hambourgeois “ tra-duction ridicule du hamburger ”). Un autre terme proposé par l’OQLF qui nes’est pas implanté est moufflet. En effet, le mécanisme de renvoi correctif quenous avons examiné à propos de party et de dactylo est utilisé, mais en privilé-giant cette fois l’anglicisme muffin, qu’on n’a pas réussi à déraciner.
Vivoir, au contraire, n’a pas été inventé par l’OQLF mais par l’abbéBlanchard au début du XXe siècle, pour contrer living-room. Comme l’expliqueDUL, dans son commentaire à la définition, “ le mot […] ne fait que vivoter ”.Son absence du MUL nous paraît la confirmation de cet échec.
111
32 Le mot hostie est absent comme juron, tandis que DUL en signale une possible acception argo-tique “ sous-verre ”.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 111
Norme visible et norme invisible
Quatre des mots examinés n’avaient fait l’objet d’aucun jugement normatifd’après Paquot33 et sont traités de façon très diverse. Bicycle à trois roues n’estattesté que dans le DQA, DUL, MEN et dans ce dernier il appelle une remarquemétalinguistique (“ bel exemple de démotivation du signifiant ”) ; pitonnage aeu plus de succès, étant attesté par tous les dictionnaires de langue générale,parfois avec les marques “ québécisme ” et “ familier ” ; plain-pied est sansdoute celui qui reçoit le traitement le plus surprenant, étant attesté dans le DQA
et le MUL, mais pas dans les autres dictionnaires ; traite en revanche est bienattesté partout, mais avec des marques négatives telles que “ anglicisme ”,“ familier ”, “ forme fautive ”, “ à proscrire ”, “ à éviter ”.
Douze mots avaient été “ rejetés ” à l’époque de Paquot. Ils sont presquetous traités de la même façon, à savoir : attestés par le DQA, sans marque ou avecla marque “ familier ” ; attestés dans le MEN ; non attestés dans le MUL, ou bienattestés avec la marque “ forme fautive ” ; non attestés dans le GDT, ou bien s’ilssont attestés, le sont avec la marque “ à éviter ”. C’est le cas de balayeuse ;cadran ; carrosse ; efface ; signaler ; support ; supposément. Sortent de ce schémaaiguisoir, en ce qu’il n’est pas attesté par le DQA ; crémage en ce qu’il est mar-
112
33 A. PAQUOT, op. cit.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 112
Sara Vecchiato
qué “ forme fautive ” dans le MUL et entériné dans le GDT avec la marque“ Canada, familier ” ; partisan(n)erie est absent du MUL et marqué “ Canada ”dans le GDT ; prélart, au contraire, est marqué “ québécisme familier ” dans leMUL et blâmé comme “ à éviter ” dans le GDT ; vidanges, pareillement à prélart,est attesté dans le MUL et marqué “ à éviter ” dans le GDT.
DUL s’éloigne considérablement des jugements des autres dictionnairesquant aux mots “ rejetés ” : il atteste dix mots sur douze (sont absents signaleret supposément) et marque ceux-ci de l’indication géographique “ partout auQuébec ”. Deux mots portent la marque “ à déconseiller ” (aiguisoir, efface), etun “ à proscrire ” (vidanges).
2.6. Anglicismes
Les mots qui entraient dans l’enquête de Paquot étaient vingt-huit. Nous enavons ajouté cinq (chanceux, checker, chum, party, sloche), pour un total de tren-te-trois termes. Le point de référence pour le choix des éléments en plus a étéleur présence chez COL. En revanche, il est important de remarquer que dansdes ouvrages récents, certains mots du corpus de Paquot ne sont pas toujoursclassifiés comme anglicismes34.
Le DQA de 1992 a été sans doute le dictionnaire le plus accusé d’avoir enté-riné les anglicismes parmi les dictionnaires de français au Québec35. Ce qui fai-sait sans doute la nouveauté était le choix de ne pas insérer de marque pour cer-tains d’entre eux. En effet, de notre corpus le DQA en enregistre vingt-deux.Huit ne portent aucune marque (breuvage, chanceux, fun, occupation, patrona-
113
34 Entre autres, le jugement semble avoir tout à fait changé pour sous-marin. En effet, il n’est plusattesté dans le COL et est entériné par le MUL et le GDT.Malle et piastre sont classés comme fautifs, mais en tant qu’archaïsmes dans le MUL, et dansles fiches du GDT, datées 2002, on renvoie l’internaute aux termes courrier et dollar, bien quedans une note on affirme qu’“ Au Canada, le terme malle relève d’un niveau de langue fami-lier et est assimilé à l’anglais mail ” et que “ Au Québec, surtout dans la langue parlée, on uti-lise souvent piastre, qui est d’un registre familier, à la place de dollar ”. Malle continue d’ail-leurs à paraître dans le dictionnaire d’anglicismes COL et est classé comme calque de l’anglaisdans le MEN. En effet, il est attesté par le Trésor de la langue française avec le sens de malle-poste, tandis que la Base de données lexicographiques panfrancophones donne mail car commeorigine du nom char de la malle. Le terme continue d’ailleurs à paraître dans le dictionnaired’anglicismes COL et est classé comme calque de l’anglais dans le MEN.
35 Cf. Éric POIRIER, Solange LAPIERRE, “ La lexicographie suscite-t-elle encore parti pris etméfiance ? ”, entrevue de Jean-Claude Boulanger, Circuit, 63, 1999, p. 11-13.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 113
Norme visible et norme invisible
ge, soubassement, sous-marin, voteur) ; sept reçoivent le seul “ familier ” au lieud’“ anglicisme (familier) ” (brassière, comté, coutellerie, engagé, pamphlet,piastre, position) ; la marque “ anglicisme ” est employée pour cheap, checker,chum, malle, party, sloche, split-level.
Le MUL atteste vingt-et-un mots, dont seize marqués par l’étoile “ forme fau-tive ”, qui signale visuellement leur statut d’exclusion idéale de la langue. Troismots, bien qu’enregistrés, ne sont pas pour autant considérés comme des angli-cismes. C’est le cas de chanceux, anglicisme d’après COL, entériné sans aucunemarque ; de sous-marin, entériné comme “ québécisme ” ; de malle et de piastre,considérés comme des archaïsmes. Entre autres, le MUL exclut clip et enregistrecoutellerie, à l’inverse du GDT, qui atteste le premier et refuse le second.
Le DUL enregistre vingt-sept termes. Nous observons que la marque“ (angl.) à proscrire ” utilisée pour dix-huit mots correspond à la note “ à évi-ter ” ou à l’exclusion du GDT. Inversement, d’autres mots absents de la nomen-clature sont marqués “ à éviter ” dans le GDT (canceller, clip, occupation) ou bienen sont exclus (clotche, engagé). Malle et piastre sont les seuls à porter la marque“ à déconseiller ”. Un jugement moins fort, qui correspond à la marque“ Canada/Québec familier ” du GDT. Breuvage est défini comme “ vieux ” enfrançais et remis en circulation à cause de l’influence de l’anglais beverage.
Le COL agit en juge, en déterminant par la seule attestation d’une forme sonexclusion idéale du bon usage. Les mots qu’il enregistre sont vingt-huit ; tandisque brassière, comté, piastre, soubassement, sous-marin et steady ne sont pasattestés. Pour les cas de brassière, comté et piastre c’est sans doute l’origine fran-çaise de ces mots qui a été prise en compte, bien que l’influence de l’anglais aitdéterminé leur survie dans le français du Québec.
Le MEN atteste tous les trente-trois termes, en observant quasiment toujoursleur origine par des remarques historiques ?
Le GDT enregistre vingt-trois mots, dont dix-sept avec la marque “ à éviter ”et deux avec la marque “ terme non retenu ”. Le jugement est moins tranchantpour les mots malle et piastre, attestés avec la marque “ Canada, familier” oubien “ Québec, familier ”.
Il est intéressant de trouver bien des expressions figées contenant des motséliminés des dictionnaires de langue : avoir les nerfs en bicycle ; faire cheap ; chec-ker/tchéquer ses claques ; jumper son chum ; avoir du fun/fonne ; être dans lepatronage etc.
114
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 114
Sara Vecchiato
3. En guise de conclusion
La recherche d’une norme se fait typiquement en s’accordant sur un modèlesocio-linguistique – modèle qui est perçu comme tel pour des raisons à la foissocio-économiques et culturelles. Dans le cas du Québec, ce modèle n’a pasencore été trouvé, les élites économiques et culturelles étant parfois accusées demal s’exprimer36. Il nous semble, en revanche, qu’une norme québécoise est entrain de se construire en négociant le statut de chaque mot.
Parmi les différentes sections du lexique, les amérindianismes ont été enté-rinés le plus tôt avec le moins de difficulté, comme “ canadianismes de bonaloi ”. Les archaïsmes, les périphérismes et les mots tabou font l’objet de trai-tements disparates, changeant selon les principes inspirateurs du dictionnaireset les décisions de chaque lexicographe. Parmi les innovations, on enregistre,entre autres, l’échec de certaines propositions terminologiques de l’OQLF. Lesanglicismes sont normalement rejetés, si reconnus comme tels, par les diction-naires qui ont un but pédagogique.
Dans tout cela, il persiste à notre avis une forme d’ambivalence. D’un côtéon exclut les mots qui “ ne devraient pas exister ” de la nomenclature, ou bienon les marque d’un symbole qui leur nie idéalement le droit de cité dans lalangue. De l’autre, ces mots, sortis par la porte, rentrent par la fenêtre des dic-tionnaires de locutions, qui offrent un goût de l’héritage linguistique propre auQuébec et suspendent au même temps le jugement sur le statut des formes enquestion.
115
36 Cf. Gerardo ACERENZA, dans ce volume.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 115
Norme visible et norme invisible
116
Tabl
eau
1. A
rcha
ïsm
es e
t dia
lect
alis
mes
.Ve
dette
Paqu
ot
DQ
AM
UL
DU
LCO
LM
ENA
BDLP
GD
TD
EXD
&S
1988
1992
1997
1999
1999
1999
2005
2005
1990
2000
1ac
hale
r “im
port
uner
, re
jeté
fam
.qu
éb.
part
out a
u-
fam
.fa
m.
-ne
pas
êtr
e ne
pas
êtr
e en
nuye
r”
fam
.Q
uébe
cac
halé
acha
lé2
adon
ner (
s’) “
se
reje
téfa
m.
québ
. pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
fam
.-
-s’a
donn
er
trou
ver
par
hasa
rd”
fam
.Q
uébe
cav
ec q
qn3
appa
reill
er (s
’) au
cun
--
part
out a
u-
(att
esté
)-
--
-“
se p
répa
rer
”ju
gem
ent
Qué
bec
4ba
rrer
reje
té(a
ttes
té)
(att
esté
)pa
rtou
t au
-fa
m.
-(a
ttes
té)
avoi
r le
se b
arre
r l
“fe
rmer
à c
lef
”Q
uébe
cco
rps
barr
ées
mâc
hoir
es5
bas
reje
té-
-à
-(a
ttes
té)
--
être
en
pied
s al
ler
en p
etits
“ch
auss
ette
”dé
cons
eille
rde
bas
etc.
bas
etc.
6bl
é d’
inde
acce
pté
(att
esté
)qu
éb.
part
out a
u -
(att
esté
)-
(att
esté
)en
voye
r un
av
oir
des
“m
aïs
”Q
uébe
cbl
é d’
inde
etc.
coto
ns d
e bl
éd’
Inde
; man
ger
un b
lé d
’Inde
etc.
7bl
euet
“ba
ie b
leue
ac
cept
é(a
ttes
té)
(att
esté
)pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
-av
oir
l’air
ou
noi
re d
’une
pla
nte
Qué
bec
bleu
etde
s ér
icac
ées
”8
bord
reje
té(a
ttes
té)
(att
esté
)pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
--
se g
arro
cher
êt
re s
ur
“cô
té”
Qué
bec
d’un
bor
d à
l’aut
re b
ord;
l’a
utre
etc
.lo
uche
r du
bor
dde
qqn
etc
.9
bouc
ane
aucu
n fa
m.
(att
esté
)pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
-Q
uébe
cpe
llete
r de
pe
llete
r de
la“
fum
ée”
juge
men
tQ
uébe
cla
bou
cane
bouc
ane
10ca
ler
reje
té(a
ttes
té)
(att
esté
)pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
-Q
uébe
c-
-“
s’en
fonc
er”
Qué
bec
11ch
ampl
ure
reje
téfa
m.
-pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
fam
.Q
uébe
c,
--
“ro
bine
t”
Qué
bec
fam
ilier
12ch
audi
ère
reje
téfa
m.
(att
esté
)pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
(att
esté
)Q
uébe
cm
ouill
er
être
rou
ssel
é “
seau
”Q
uébe
cco
mm
e de
s co
mm
e un
ch
audi
ères
fond
de
chau
diè-
re r
ouill
é
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 116
Sara Vecchiato
117
13cla
que
reje
té(a
ttes
té)
-(a
ttes
té)
-(a
ttes
té)
-Q
uébe
car
rive
r av
ec
arri
ver
avec
“
caou
tcho
uc”
une
claq
ue p
uis
une
claq
ue
une
botti
ne e
tc.
puis
une
botti
ne14
corp
oren
ce
aucu
n -
-pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
--
--
“co
rpul
ence
”ju
gem
ent
Qué
bec
15cr
eton
s “pâ
té
acce
pté
(att
esté
)qu
éb.
part
out a
u -
(att
esté
)-
(att
esté
)-
gele
r co
mm
e de
por
c ha
ché
et
Qué
bec
un c
reto
nde
pan
ne”
16en
caba
né “
enfe
rmé
aucu
n (a
ttes
té)
(att
esté
)pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
--
-êt
re e
ncab
anné
chez
soi
”ju
gem
ent
Qué
bec
17en
farg
é “
pris
(dan
s re
jeté
(att
esté
)-
part
out a
u -
(att
esté
)-
Qué
bec,
s’e
nfar
ger
dans
s’e
nfar
ger
dans
ch. q
ui e
mpê
che
Qué
bec
fam
ilier
ses
idée
sle
s fle
urs
du
d’av
ance
r) ”
tapi
s et
c.18
frette
au
cun
--
part
out a
u -
(att
esté
)-
-pr
ends
ça
fair
e l’e
stom
ac
“fr
oid
”ju
gem
ent
Qué
bec
fret
te!
fret
te e
tc.
19ga
rroc
her
reje
téfa
m.
québ
. pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
--
se g
arro
cher
se
gar
roch
er
“la
ncer
, jet
er”
fam
.Q
uébe
cd’
un b
ord
à d’
un b
ord
à l’a
utre
l’aut
re20
last
ique
-
fam
.-
à dé
cons
eille
r-
défo
rm.
--
--
“él
astiq
ue”
popu
lair
e21
niai
seux
au
cun
(att
esté
)qu
éb.
part
out a
u -
(att
esté
)-
--
-“
niai
s, so
t”
juge
men
tfa
m.
Qué
bec
22pi
ler
reje
té(a
ttes
té)
form
e pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
--
-pi
ler
sur
son
“m
arch
er (s
ur) ”
faut
ive
Qué
bec
orgu
eil
23pl
acot
er
aucu
n fa
m.
québ
. pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
--
-fa
ire
du
“ba
vard
er, m
édir
e”
juge
men
tfa
m.
Qué
bec
plac
otag
e24
répl
ique
ux “
qui
aucu
n -
--
--
--
--
répo
nd e
n s’
bstin
ant
”ju
gem
ent
25to
urtiè
re “
pâté
à
acce
pté
-(a
ttes
té)
(att
esté
)-
(att
esté
)ré
gion
.Q
uébe
c-
-ba
se d
e vi
ande
de
porc
hac
hée
”-
26ve
nir “
deve
nir
”au
cun
fam
.-
à dé
cons
eille
r-
(att
esté
)-
--
veni
r en
âge
juge
men
t
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 117
Norme visible et norme invisible
118
Tabl
eau
2. P
érip
héri
smes
.Ve
dette
Paqu
ot
DQ
AM
UL
DU
LCO
LM
ENBD
LPG
DT
DEX
D&
S 19
8819
9219
9719
9919
9919
9920
0520
0519
9020
001
dact
ylo
reje
téfa
m.
ne p
as
(att
esté
)-
(att
esté
)-
à év
iter
--
“m
achi
ne à
écr
ire
”co
nfon
dre
le o
u la
da
ctyl
o2
mita
ine
reje
té(a
ttes
té)
québ
.pa
rtou
t -
(att
esté
)(a
ttes
té)
(att
esté
)al
ler
com
me
alle
r à
qqn
“m
oufle
”au
Qué
bec
une
mita
ine
com
me
une
etc.
mita
ine
etc.
3re
ster
au
cun
(att
esté
)qu
éb.
part
out a
u -
(att
esté
)-
--
rest
er le
dia
ble
“ha
bite
r”
juge
men
tfa
m.
Qué
bec
au v
ert
4vo
tatio
n “
élec
tion
” re
jeté
--
-(a
ttes
té)
(att
esté
)-
--
-(v
oteu
r“
élec
teur
”)
Tabl
eau
3. A
mér
indi
anis
mes
.
Vede
ttePa
quot
D
QA
MU
LD
UL
COL
MEN
BDLP
GD
TD
EXD
&S
1988
1992
1997
1999
1999
1999
2005
2005
1990
2000
1ba
bich
e “
peau
non
au
cun
(att
esté
)qu
éb.
pres
que
-(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
se s
erre
r la
se
ser
rer
la
tann
ée d
écou
pée
juge
men
tpa
rtou
t au
babi
che
babi
che
etc.
en la
nièr
es”
Qué
bec
2ca
rcaj
ou “
espè
ce d
e gl
outo
n ac
cept
é(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
-(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
-fa
ire
un s
aut
d’A
mér
ique
du
Nor
d”
de c
arca
jou
3m
aski
nong
é “
pois
son
d’ea
u ac
cept
é(a
ttes
té)
québ
.pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
--
douc
e d’
Am
ériq
ue d
u N
ord
Qué
bec
appa
rent
é au
bro
chet
”4
ouan
anic
he “
saum
on d
’au
acce
pté
(att
esté
)qu
éb.
norm
alis
é-
(att
esté
)(a
ttes
té)
Can
ada
--
douc
e d’
Am
ériq
ue d
u N
ord
”5
ouao
uaro
n “
gren
ouill
e ac
cept
é(a
ttes
té)
québ
.pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
--
géan
te d
’Am
ériq
ue d
u N
ord
”Q
uébe
c
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 118
Sara Vecchiato
119
Tabl
eau
4. M
ots
tabo
u.
Vede
ttePa
quot
DQ
AM
UL
DU
LCO
LM
ENBD
LPG
DT
DEX
D&
S 19
8819
9219
9719
9919
9919
9920
0520
0519
9020
001
câlic
e [j
uron
]-
très
-
(att
esté
)-
très
fam
.-
--
être
en
(bea
u)fa
m.
câlis
se2
câlif
e [j
uron
]-
fam
.-
—-
alt.
euph
. de
«câl
ice»
-
--
-3
cibo
ire [j
uron
]-
très
-
--
Dan
s la
rel
igio
n ca
thol
ique
,-
-êt
re e
n -
fam
.le
mot
«ci
boir
e» d
ésig
ne
cibo
ire
un v
ase
sacr
é où
l’on
co
nser
ve le
s hos
ties c
onsa
crée
s po
ur la
com
mun
ion
4go
sses
-
fam
.-
part
out a
u Q
uébe
c-
regi
stre
vul
g.-
-av
oir
des
avoi
r de
s “
test
icul
es”
goss
es e
tc.
goss
es5
gido
une
-tr
ès
-pa
rtou
t au
Qué
bec
-(a
ttes
té)
--
--
“fe
mm
e fa
cile
”fa
m.
6ho
stie
[jur
on]
-tr
ès
-ar
got «
sous
-ver
re»
-[e
n fr
ança
is s
tand
ard,
le m
ot
--
être
en
host
ie
être
en
host
iefa
m.
«ho
stie
» dé
sign
e, p
our
les
(est
ie, e
stiq
ue,
chré
tiens
des
égl
ises
cat
holiq
ues
etc.
) fam
.la
tines
, une
pet
ite r
onde
lle d
e pa
in d
e fr
omen
t (…
); el
le
repr
ésen
te le
Chr
ist]
7ta
bern
acle
-
très
-
(tab
arna
co«s
urno
m
-ta
barn
ac!;
taba
rnak
!; ta
barn
aque
!-
--
être
en
[jur
on]
fam
.do
nné
aux
Qué
béco
is
[mot
de
la r
elig
ion
cath
oliq
ue,
taba
rnac
lefr
anco
phon
es [
...]
dans
qu
i dé
sgne
une
«pe
tite
arm
oire
le
quel
on
reco
nnaî
t le
ferm
ant à
clé
[...
]» p
ron.
dia
l. et
ju
ron
bien
qué
béco
is
pop.
de
«tab
erna
cle»
ave
c ch
ute
ta
bern
acle
pron
oncé
de
la c
ons.f
inal
e]ta
barn
ac!»
)
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 119
Norme visible et norme invisible
120
Tabl
eau
5. I
nnov
atio
ns.
Vede
ttePa
quot
D
QA
MU
LD
UL
COL
MEN
BDLP
GD
TD
EXD
&S
1988
1992
1997
1999
1999
1999
2005
2005
1990
2000
1ai
guiso
ir re
jeté
-fo
rme
faut
ive
à -
(att
esté
)(a
ttes
té)
--
-“
taill
e-cr
ayon
”(a
rch.
)dé
cons
eille
r2
bala
yeus
e re
jeté
fam
.fo
rme
faut
ive
part
out a
u -
(att
esté
)-
à év
iter
--
“as
pira
teur
”(im
prop
r.)Q
uébe
c3
battu
re
acce
pté
(att
esté
)qu
éb.
part
out a
u-
(att
esté
)-
Can
ada
joue
r/êt
reêt
re
“po
rtio
n du
Qué
bec
dans
les
(joue
r)
riva
ge q
ue le
ba
ttur
es
dans
les
jusa
nt la
isse
à
de q
qnba
ttur
es
déco
uver
t”
de q
qn4
beig
ne
acce
pté
atte
sté)
québ
.pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
(att
esté
)Q
uébe
cse
paq
uete
r av
oir
les
“pâ
te fr
ite
Qué
bec
le b
eign
e ye
ux e
nen
form
e de
et
c.tr
ous
de
cour
onne
”be
igne
etc.
5bi
cycle
à tr
ois
aucu
n fa
m.
-(a
ttes
té)
-be
l exe
mpl
e -
--
-ro
ues
juge
men
tde
dém
otiv
atio
n “
tric
ycle
”du
sig
nifia
nt...
6bo
rdée
ac
cept
é(a
ttes
té)
québ
.pa
rtou
t au
-di
al. b
ordé
e-
Qué
bec
-co
urir
des
“ch
ute
Qué
bec
«gra
nde
bord
ées
abon
dant
e qu
antit
é»(d
e ne
ige)
”7
cadr
an
reje
téfa
m.
form
e pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
--
bras
ser
le
bras
ser
le
“ré
veill
efa
utiv
e Q
uébe
cca
dran
à
cadr
an à
-m
atin
”(im
prop
r.)qq
n et
c.qq
n et
c.8
carr
osse
re
jeté
(att
esté
)fo
rme
part
out a
u -
(att
esté
)(a
ttes
té)
à év
iter
--
“vo
iture
fa
utiv
e Q
uébe
cd’
enfa
nt”
(impr
opr.)
9cr
émag
e re
jeté
(att
esté
)fo
rme
(att
esté
)-
(att
esté
)-
Can
ada,
c’
est l
e êt
re le
“
glaç
age
”fa
utiv
e fa
mili
ercr
émag
e cr
émag
e (im
prop
r.)su
r le
su
r le
gâ
teau
!gâ
teau
10ef
face
re
jeté
(att
esté
)fo
rme
part
out a
u -
(att
esté
)-
à év
iter
pass
er
pass
er
“go
mm
e”
faut
ive
Qué
bec,
àl’e
fface
l’effa
ce(im
prop
r.)dé
cons
eille
r
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 120
Sara Vecchiato
121
11ha
mbo
urge
ois
acce
pté
--
trad
uctio
n -
prop
osé
par
-(a
ttes
té)
--
“ha
mbu
rger
”ri
dicu
le d
u l’O
LF; i
l a
ham
burg
erpr
ovoq
ué b
ien
des
sarc
asm
es
et s
a di
ffusi
on
rest
e ré
duite
12m
ouffl
et
acce
pté
--
--
--
L’O
LF a
pro
posé
-
-“
muf
fin”
mou
ffle
tpou
r re
mpl
acer
muf
fin.
Cep
enda
nt, c
e te
rme
n’a
pas
réus
si à
s’im
plan
ter
dans
l’us
age.
13pa
rtisa
n(n)
erie
re
jeté
(att
esté
)-
part
out a
u -
infl.
de
l’agl
. -
Can
ada
--
“es
prit
de p
arti
”Q
uébe
c«p
artis
ansh
ip»
14pi
tonn
age
aucu
n fa
m.
(pito
nner
, pa
rtou
t au
-en
qué
béco
is,
-fa
m.
--
“fa
it d’
actio
nner
juge
men
tqu
éb. f
am.)
Qué
bec
le m
ot «
pito
n»
les
touc
hes
d’un
si
gnifi
e «b
outo
n»cl
avie
r”
15pl
ain-
pied
au
cun
(att
esté
)(a
ttes
té)
--
--
--
-“
mai
son
de
juge
men
tpl
ain-
pied
”16
poud
rerie
ac
cept
é(a
ttes
té)
québ
.pa
rtou
t au
-(a
ttes
té)
-C
anad
apa
sser
en
pass
er e
n“
neig
e fin
e et
Q
uébe
cpo
udre
rie
poud
reri
esè
che
soul
evée
pa
r le
ven
t”
17pr
élar
t re
jeté
(att
esté
)qu
éb.
part
out a
u -
ext.
de s
ens
-à
évite
r-
-“
linol
éum
”fa
m.
Qué
bec
18sig
nale
r re
jeté
fam
.fo
rme
-(a
ttes
té)
(att
esté
)-
à év
iter
--
“co
mpo
ser
faut
ive
(un
num
éro
(impr
opr.)
de té
léph
one)
”19
supp
ort
reje
téfa
m.
form
e (a
ttes
té)
-(a
ttes
té)
--
--
“ci
ntre
”fa
utiv
e (im
prop
r.)
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 121
Norme visible et norme invisible
122
20su
ppos
émen
t re
jeté
(att
esté
)fo
rme
-(a
ttest
é)m
ot a
bsen
t des
-
--
(êtr
e “
cens
émen
t”
faut
ive
– C
et
dict
ionn
aire
s su
ppos
é ad
verb
e n’
est
fran
çais
; l’a
ngla
is
fair
e pa
s co
nsig
né
dit “
supp
osed
ly”
qqch
)da
ns le
s di
ctio
nnai
res.
On
empl
oier
a pl
utôt
hypo
thét
ique
men
t21
tire
“si
rop
acce
pté
(att
esté
)qu
éb.
part
out a
u“
pneu
”(a
ttes
té)
(tôl
e Q
uébe
c-
-d’
érab
le tr
ès
Qué
bec
à tir
e)ép
aiss
i, ay
ant
la c
onsi
stan
ce
du m
iel
”22
traite
au
cun
angl
. fo
rme
à pr
oscr
ire
(atte
sté)
l’ang
l. di
t -
à év
iter
paye
r la
pa
yer
la
(pay
er la
trai
te)
juge
men
tfa
m.
faut
ive
“to
trea
t tr
aite
à
trai
te à
“
paye
r un
so
meb
ody
nqq
nve
rre
”; f
ig.
(=of
frir
/pay
er“
entr
eten
ir,
qqch
. à q
qn);
gâte
r”
“th
is is
my
trea
t”
[...]
23tu
que
acce
pté
(att
esté
)qu
éb.
part
out a
u-
(att
esté
)-
Can
ada
-av
oir
la“
bonn
et
Qué
bec
tuqu
ede
lain
e”
droi
te24
vida
nges
re
jeté
(att
esté
)(a
ttes
té)
part
out a
u -
(att
esté
)-
à év
iter
--
“or
dure
s Q
uébe
c,
mén
agèr
es”
à pr
oscr
ire
25vi
voir
acce
pté
(att
esté
)-
Le m
ot v
ivoi
r-
(att
esté
)(a
ttes
té)
Can
ada
--
“sa
lle d
e m
is d
e l’a
vant
sé
jour
”pa
r l’a
bbé
Blan
char
d en
19
12 p
our
cont
rer
livin
g-ro
om n
e fa
it qu
e vi
vote
r.
Tabl
eau
5. I
nnov
atio
ns.
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 122
Sara Vecchiato
123
Tabl
eau
6. A
nglic
ism
es.
Vede
ttePa
quot
D
QA
MU
LD
UL
COL
MEN
BDLP
GD
TD
EXD
&S
1998
1992
1997
1999
1999
1999
2005
2005
1990
2000
1ap
plic
atio
nre
jeté
-fo
rme
part
out
(att
esté
)ca
lque
de
-à
évite
r-
fair
e (f
aire
app
licat
ion)
fa
utiv
e au
Qué
bec
l’ang
l. ap
plic
atio
n“
post
uler
”(a
nglic
.)(a
ngl.)
à
“ap
plic
atio
n”
pros
crir
e2
bras
sière
re
jeté
fam
.fo
rme
part
out a
u in
fl. d
e fa
m.
à év
iter
--
“so
utie
n-fa
utiv
e Q
uébe
c -
l’ang
l. go
rge
”(a
nglic
.)(a
ngl.)
à
“br
assi
ere
”pr
oscr
ire
3br
euva
gere
jeté
(att
esté
)fo
rme
vx e
n fr.
(att
esté
)m
oy.fr
.; in
fl.
(att
esté
)à
évite
r-
-“
bois
son
”fa
utiv
e de
l’an
gl.
(ang
lic.)
“be
vera
ge”
4ca
ncel
(l)er
re
jeté
-fo
rme
-(a
ttes
té)
anc.
et m
oy.fr
.; -
à év
iter
--
“an
nule
r”
faut
ive
l’ang
l. di
t cou
r. (a
nglic
.)“
to c
ance
l”
5ch
ance
ux
-(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
fam
.-
-êt
re
“qu
i a d
e la
ch
ance
ux
chan
ce, q
ui
com
me
unpo
rte
chan
ce”
boss
u et
c.6
char
ger
reje
té-
form
e pa
rtou
t au
(att
esté
)(a
ttes
té)
-à
évite
r-
-“
dem
ande
r fa
utiv
e Q
uébe
c (e
n pa
iem
ent)
”(a
nglic
.)(a
ngl.)
à
pros
crir
e7
chea
p au
cun
angl
ic.
form
e pa
rtou
t au
(att
esté
)em
pr. d
ir. à
-
-êt
re (f
aire
) fa
ire
chea
p;
“bo
n m
arch
é”
juge
men
tfa
m.
faut
ive
Qué
bec
- l’a
ngl.
chea
pfa
ire
filer
(a
nglic
.)à
pros
crir
eqq
n ch
eap
8ch
ecke
r -
angl
ic.
form
e à
pros
crir
e(a
ttes
té)
(che
cker
, ché
quer
, -
à év
iter
Tchè
que
tes
chec
ker
ses
“co
ntrô
ler
”fa
m.
faut
ive
tché
ker,
tché
quer
, cl
aque
s!
claq
ues
pis
(ang
lic.)
tchè
quer
) em
pr.d
ir.
Tchè
que
tes
arri
ver
en
à l’a
ngl.
claq
ues
puis
vi
lle,
arri
ve e
n vi
lle !
tché
quer
se
s cl
aque
s
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 123
Norme visible et norme invisible
124
Tabl
eau
6. A
nglic
ism
es.
9ch
um
-an
glic
. fo
rme
part
out a
u (a
ttes
té)
empr
. dir.
à-
-jo
mpe
r so
n ju
mpe
r so
n “
pers
onne
ave
c
fam
.fa
utiv
e Q
uébe
c,
l’ang
l.ch
umch
umqu
i on
est e
n
(ang
lic.)
à pr
oscr
ire
rela
tion
d’am
itié
”10
clip
aucu
n -
--
(att
esté
)em
pr. d
ir. à
l’an
gl.;
-em
prun
té
--
“tr
ombo
ne”
juge
men
ten
fr. s
tand
ard,
leà
mot
“cl
ip”
est m
asc.
l’ang
lais
11clo
tche
reje
té-
--
(att
esté
)(c
lutc
h, c
lotc
he)
--
--
“em
bray
age
”em
pr. d
ir. à
l’an
gl.
12co
mté
ac
cept
éfa
m.
form
e à
pros
crir
e-
calq
ue d
e l’a
ngl.
-à
évite
r-
-“
circ
onsc
ript
ion
faut
ive
“co
unty
”; e
mpr
. él
ecto
rale
”(a
nglic
.)à
l’anc
. fr.
“co
nté
”(le
terr
itoir
e d’
un c
omte
)13
cout
elle
rie
reje
téfa
m.
form
e à
pros
crir
e(a
ttes
té)
infl.
de
l’ang
l. -
--
-“
serv
ice
de
faut
ive
“cu
tlery
”co
uver
ts”
(ang
lic.)
14en
gagé
reje
téfa
m.
form
e -
(att
esté
)(li
gne
enga
gée)
, -
--
-“
occu
pé”
faut
ive
calq
ue d
e l’a
ngl.
(ang
lic.)
15én
umér
ateu
rre
jeté
--
(ang
l.) à
(a
ttes
té)
calq
ue d
e l’a
ngl.
-à
évite
r-
-“
rece
nseu
r”
pros
crir
e“
enum
erat
or”
16fu
n re
jeté
(att
esté
)fo
rme
part
out a
u (a
ttes
té)
(fun
, fon
ne) e
mpr
. fa
m.
-av
oir
du
avoi
r du
“
agré
able
, fa
utiv
e Q
uébe
c di
r. à
l’ang
l.fo
nne
etc.
fun
etc.
plai
sant
”(a
nglic
.)(a
ngl.)
à
pros
crir
e17
jum
per
aucu
n -
-pa
rtou
t au
(att
esté
)em
pr. d
ir. à
l’an
gl.
viei
lli-
jom
per
son
jum
per
le
“sa
uter
, ju
gem
ent
Qué
bec
“to
jum
p”
chum
trai
n et
c.bo
ndir
”no
rmat
if(a
ngl.)
à
pros
crir
e18
long
ue-d
istan
ce
reje
té-
form
e (a
ngl.)
à
(att
esté
)(v
. dis
tanc
e)
-à
évite
r-
-“
appe
l fa
utiv
e pr
oscr
ire
calq
ue d
e l’a
ngl.
inte
rurb
ain
”(c
alqu
e)“
long
dis
tanc
e”
19m
alle
“po
ste
”re
jeté
angl
ic.
form
e (a
ngl.)
à
(att
esté
)ca
lque
de
l’ang
l.vi
eilli
Can
ada,
--
(cha
r de
la m
alle
)fa
m.
faut
ive
déco
nsei
ller
fam
ilier
(arc
haïs
me)
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 124
Sara Vecchiato
125
20oc
cupa
tion
reje
té(a
ttes
té)
--
(att
esté
)ca
lque
de
l’ang
l. -
à év
iter
--
“pr
ofes
sion
, “
occu
patio
n”
mét
ier
”21
pam
phle
t re
jeté
fam
.fo
rme
part
out a
u (a
ttes
té)
calq
ue d
e l’a
ngl.
--
-“
broc
hure
; à
évite
rfa
utiv
e Q
uébe
c “
pam
phle
t”
dépl
iant
”(a
nglic
.)(a
ngl.)
à
pros
crir
e22
party
-
angl
.fo
rme
(ang
l.)(a
ttes
té)
(att
esté
)(a
ttes
té)
non
bris
er le
br
iser
le
“fê
te”
faut
ive
part
out a
u re
tenu
part
ypa
rty;
êtr
e (a
nglic
.)Q
uébe
cun
cas
seux
de p
arty
23pa
trona
ge
reje
té(a
ttes
té)
form
e pa
rtou
t(a
ttes
té)
calq
ue
-à
évite
rêt
re d
ans
être
dan
s le
“
favo
ritis
me
faut
ive
au Q
uébe
cde
l’an
gl.
le p
atro
nage
patr
onag
epo
litiq
ue”
(ang
lic.)
(ang
l.) à
pr
oscr
ire
24pi
astre
re
jeté
fam
.fo
rme
part
out a
u-
(att
esté
)fa
m.
Qué
bec,
en
man
quer
fa
ire
la
“do
llar
faut
ive
Qué
bec,
àfa
mili
erpo
ur s
a pi
astr
e pi
astr
e et
c.ca
nadi
en”
(arc
haïs
me)
déco
nsei
ller
etc.
(app
ella
tion
popu
lair
e et
en
per
te d
e vi
tess
e du
do
llar
cana
dien
)25
posit
ion
reje
téfa
m.
form
e (a
ttes
té)
(att
esté
)ca
lque
de
l’ang
l.-
à év
iter
--
“si
tuat
ion,
fa
utiv
e em
ploi
, pos
te”
(ang
lic.)
26pr
ofes
sione
l re
jeté
--
(att
esté
)(a
ttes
té)
calq
ue d
e l’a
ngl.
-à
évite
r-
-“
pers
onne
qui
“
prof
essi
onal
”ex
erce
une
pr
ofes
sion
lib
éral
e”
27slo
che
-an
gl.
-sl
ush,
slo
che,
(slu
sh)
(slu
sh, s
loch
e, s
lutc
h,em
ploi
te
rme
-“
neig
e sl
udge
(ang
l.)sl
otch
, slo
tche
,cr
itiqu
éno
n fo
ndan
te”
pres
que
slot
tche
)re
tenu
part
out a
u Q
uébe
c, à
pr
oscr
ire
-
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 125
Norme visible et norme invisible
126
Tabl
eau
6. A
nglic
ism
es.
28so
ubas
sem
ent
reje
té(a
ttes
té)
-(a
ttes
té)
-in
fl. d
e l’a
ngl.
-à
évite
r-
-“
sous
-sol
”“
base
men
t”
29so
us-m
arin
ac
cept
é(a
ttes
té)
Qué
beci
sme
--
calq
ue d
e l’a
mér
. (a
ttes
té)
(att
esté
)-
-“
sort
e de
“
subm
arin
e”
sand
wic
h”
30sp
lit-le
vel
aucu
nan
gl.
-(a
ngl.)
à
(att
esté
)em
pr. d
ir. à
l’an
gl.
-à
évite
r-
-“
mai
son
dont
ju
gem
ent
pros
crir
ele
s di
vers
es
norm
atif
part
ies
sont
am
énag
ées
à de
s ni
veau
x di
ffér
ents
”31
stea
dy
reje
té-
-pa
rtou
t au
-(s
tead
y, s
tead
é,
--
--
“ré
gulie
r”
Qué
bec
sted
dé) e
mpr
. dir.
(ang
l.) à
à
l’ang
l.pr
oscr
ire
32sw
itche
r re
jeté
--
(ang
l.)
(att
esté
)em
pr. d
ir. à
l’an
gl.
--
--
“ét
ablir
les
à pr
oscr
ire
conn
exio
ns”
33vo
teur
“re
jeté
(att
esté
)-
rare
en
fr.(a
ttes
té)
l’ang
l. di
t “vo
ter
”-
à év
iter
--
élec
teur
”
imp dizionari - DIctionnaires 28-09-2010 11:33 Pagina 126