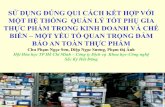Des carrosses qui en cachent d’autres. Retour sur certains incidents qui marquèrent l’ambassade...
Transcript of Des carrosses qui en cachent d’autres. Retour sur certains incidents qui marquèrent l’ambassade...
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 1 -
DES CARROSSES QUI EN CACHENT D’AUTRES.
Retour sur certains incidents qui marquèrent l’ambassade de Lord Denzil Holles à Paris, de 1663 à 1666.
Il n’y a rien dont l’Ambassadeur doive estre si jaloux, que des droits & de la dignité de
son Prince : & principalement du rang qu’il tient parmy les autres Princes ; afin de le luy conserver dans les ceremonies, & dans les Assemblées publiques. C’est dont il ne se peut dispenser, pour quelque cause, ou pour quelque consideration que ce soit : & il n’y peut manquer qu’aux dépens de son honneur & de sa vie.
A. DE WICQUEFORT, L’Ambassadeur et ses Fonctions, Cologne, 1690, vol. I, p. 343.
L’étude qui va suivre s’inscrit dans le droit fil d’une communication délivrée au printemps dernier, laquelle a permis d’évoquer en long la figure d’un certain Lord Denzil Holles, diplomate anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle resté assez méconnu, et que d’aucuns auraient voulu réduire à une sorte d’ours mal léché1. Beaucoup sans doute a déjà été dit à cette occasion, mais il y avait une logique naturelle à revenir quelque peu sur le personnage dans le cadre de ce séminaire sur l’incident diplomatique, car l’ambassade qu’il conduisit à Paris entre 1663 et 1666 fut marquée par une cascade d’incidents, découlant d’une fameuse querelle initiale, l’une de ces querelles de préséance dont la diplomatie de l’époque moderne avait le secret. Ainsi peut-on dire que cette ambassade tourna au fiasco, et ceci d’autant plus que rarement le contexte international avait paru plus favorable.
Si nous considérons en effet un instant la scène européenne en ce début des années 1660,
il semble qu’une remarquable fenêtre pacifique se soit ouverte dans le ciel des relations franco-anglaises. Nous l’expliciterons plus loin avec davantage de détails, mais rappelons d’ores et déjà que l’Angleterre de cette époque est demandeuse de l’alliance française, ou tout au moins d’une bienveillante neutralité de la part de Louis XIV, en prévision d’une nouvelle guerre contre sa rivale maritime, la Hollande, avec laquelle tous les jours ses relations ne cessent de se dégrader. Telle est donc en peu de mots la situation au début de l’été 1663, lorsque Lord Denzil Holles, nouvel ambassadeur britannique, débarque sur le sol français. Sa mission ? De manière toute classique, il était officiellement chargé de resserrer les liens entre les deux pays, en complétant les accords déjà existants par un nouveau traité d’amitié et de commerce2. Si nous survolons ses instructions, ses objectifs sont on ne peut plus iréniques :
Vous assurerez Sa Majesté de Notre désir et dessein [...] de vivre avec Elle et de l’aimer comme un bon Voisin et bon Frère ; de renouveler et ratifier tous les Traités précédents de Concorde et d’Amitié qui ont été passés entre les deux Couronnes ; et afin de poursuivre dans une union plus étroite encore de nos Conseils et Intérêts, de
N.B. : Nous utiliserons les abréviations usuelles suivantes : N.A., S.P. 78 = National Archives (Londres), série State Papers, sous-série France ; M.A.E. = archives historiques du ministère des Affaires étrangères (Paris), où l’on réfère aux séries Mém. et Doc. = Mémoires et Documents ainsi que Corr. pol. = Correspondance politique ; B.N.F. (Richelieu ou Arsenal) = bibliothèque nationale de France, site Richelieu ou bibliothèque de l’Arsenal ; C.S.P.D. Charles II = Calendar of State Papers (Domestic series) of the Reign of Charles II, éd. M. A. E. GREEN et al., 1860-1939, 28 vol. ; C.S.P. Venice. = Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs, Existing in the Archives and Collections of Venice and in other Libraries of Northern Italy, éd. Rawdon BROWN et al., 1864-1947, 38 vol. Les passages soulignés le seront toujours par nos soins. Par commodité, nous désignerons Sir Henry Bennet sous son titre à venir et mieux connu de comte d’Arlington. On rappelle enfin que le calendrier anglais de l’époque avait dix jours de retard sur le calendrier grégorien : dans le corps du texte, toutes les dates seront données par rapport à ce dernier calendrier. 1 Cette communication eut lieu en Sorbonne le 28 avril 2006, dans le cadre du séminaire du Pr. Bély. Elle était intitulée : « Un ours à la cour de Louis XIV ? Lord Denzil Holles, ambassadeur d’Angleterre à Paris (1663-1666). » 2 Il existait en fait un ancien traité plusieurs fois renouvelé depuis le temps d’Henri IV et du roi Jacques, mais en ces années 1662-1663 chacun des deux partenaires voulait le remettre à plat, pour différentes raisons : Colbert souhaitait des avantages commerciaux, les relations entre les deux pays étaient compliquées de plusieurs problèmes coloniaux.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 2 -
faire tout ce qui peut augmenter cet Amour et cette bonne Entente, sans rien désirer qui y cause une interruption3.
Or qu’advint-il ? Presque d’emblée une querelle homérique. Tout se passa comme si le milord Holles, à peine débarqué, avait pris un malin plaisir à saboter sa propre ambassade, en soulevant des difficultés intempestives. Ce constat de bêtise peut sembler suspect, à juste titre, à nos esprits désabusés par l’étude des subtilités diplomatiques, et il est bien plus probable que les incidents qui éclatèrent furent le symptôme de maux plus profonds, non perceptibles au premier coup d’ œil. Telle a été pourrait-on dire notre hypothèse de travail.
Il nous semble que pour tenter de comprendre la partie qui s’est réellement jouée dans
cette ambassade, l’on peut avantageusement convoquer deux contextes, l’un et l’autre peu visibles au premier abord, dont les effets se conjuguèrent. Ainsi distinguerons-nous en premier lieu un contexte étroit, inhérent à la mission de Holles, où se nouèrent un certain nombre de tensions, à la fois personnelles et internationales : cette convergence, nous le verrons, rassemblait bien des ingrédients favorables à la survenue d’incidents. Mais ce n’est pas tout. Au-delà de la simple personne du diplomate et de sa mission, il nous faudra envisager ensuite un horizon bien plus large et diffus : nous observerons alors que si ce contexte large n’a peut-être pas autant que le premier contribué à faire éclore des incidents, il ne fut certainement pas étranger à la forme qu’ils adoptèrent. Car le moment est venu de le signaler, les querelles dont il va être question eurent aussi ceci de singulier qu’elles se fixèrent, comme par prédilection, sur des objets précis : des carrosses. C’est ce que nous commencerons par constater en détail, dans une première partie de ce propos, qui aura pour simple ambition de rappeler les faits, tels qu’on peut les reconstituer sans réel recul4.
I – Les faits en surface : une querelle et ses séquelles 1/ Déclenchement
Lorsque Lord Holles passa d’Angleterre en France, pendant l’été 16635, il est probable qu’à l’époque aucun observateur ordinaire des relations internationales n’aurait pu songer que son ambassade allait si mal tourner : ni la conjoncture ni la personnalité du nouveau-venu ne pouvaient le laisser présager, c’est ce qu’il nous faut commencer par constater.
Pour ce qui est de la conjoncture, elle paraissait vraiment favorable6 : tandis que de ce
côté-ci le jeune Louis XIV savourait les premières années de son règne personnel, à l’issue d’une enfance mouvementée et à l’ombre d’un tout-puissant ministre, de l’autre côté de la Manche, l’un peu moins jeune Charles II, au terme d’un long exil, venait tout juste de récupérer le trône de ses pères et d’y être restauré dans la liesse. A une espèce de parallélisme dans la situation personnelle
3 N.A., S.P. 78, vol. 117, f° 104 r° et v° : “You shall assure his Majty: of Our desire & purpose (as it hath pleased God to give Us Our lotts one by an other) so to live wth him & love him as a good Neighbour & Brother ; to renue & ratifye all former Treatys of Amity & Friendship which have past between ye two Crowns & to enter into a yet straighter union of Councells & Interests to do all wch may increase this Love & good Agreemt: & not willingly any thing to give an Interruption to it.”. Pour quelques commentaires critiques sur certains points des instructions cf. W.L. GRANT, « A Puritan at the Court of Louis XIV », Bulletin of the Departments of History and Political and Economic Science in Queen's University (Kingston, Ontario, Canada), n° 8 (juillet 1913), p. 2-3. 4 Notamment à travers la correspondance de Holles, conservée pour sa plus grande part aujourd’hui aux National Archives de Londres, sous la cote N.A., S.P. 78, vol. 116 à 123. 5 Sa première dépêche de France est datée de Dieppe, le 11/21 juillet 1663 (N.A., S.P. 78, vol. 117, f° 96). De nombreux contretemps survinrent qui différèrent le début de ses négociations jusqu’à l’automne. 6 Entre autres ouvrages généraux, le tableau suivant s’appuie sur L. BÉLY, Les relations internationales en Europe : XVIIe - XVIIIe siècles., collection « Thémis Histoire », Paris, 1992, chap. 7, ainsi que sur le livre vieilli mais non remplacé de Sir K. G. FEILING, British Foreign Policy, 1660-1672, Londres, 1930, chap. 1 et 2. Pour un témoignage ancien, cf. e.g. J. DU MONT, Mémoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de l'histoire de la paix de Ryswick, La Haye, 1699, vol. I, pp. 222-223 : « [Charles II restauré] rechercha la paix avec les puissances voisines, & comme la France étoit sans contredit celle qui pourroit le plus lui nuire & le plus traverser son nouveau rétablissement, ce fut aussi celle dont il rechercha l'amitié avec le plus d'empressement. Le Roy T. C. de son côté fit toutes les demandes que Sa Majesté Britannique auroit pû désirer. »
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 3 -
des deux monarques répond alors le fait que chacun d’eux recueillit l’héritage de la politique étrangère de son défunt « protecteur » : c’est ainsi que l’alliance franco-anglaise, conclue par Mazarin et Cromwell sur le dos d’une Espagne affaiblie, semblait destinée à se perpétuer et même, selon toute apparence, à se consolider. Bientôt en effet, en 1661, Monsieur épousa Henriette d’Angleterre, la délicieuse sœur du roi Charles II. Qui mieux dès lors que Madame allait incarner la bonne intelligence des deux couronnes ? Quant au roi d’Angleterre, s’il ne se maria pas avec une princesse française — on avait même songé un instant à une nièce du cardinal Mazarin —, il convola dès l’année suivante avec Catherine de Bragance : cette alliance, ardemment supportée par la France, offrait en fait à Louis XIV le moyen de continuer en sous-main, malgré la paix des Pyrénées, son aide au Portugal révolté contre l’Espagne. Reste enfin à considérer un dernier accord qui prit place à la fin de l’année 1662 : le comte d’Estrades, dépêché à Londres, avait réussi une belle opération en négociant l’achat aux Anglais de Dunkerque, cette place forte espagnole que Cromwell avait occupée et qui formait, mutatis mutandis, comme un nouveau Calais, une tête de pont menaçante sur le continent. Il en coûta cinq millions de livres à Louis XIV, mais c’était une bonne affaire7. Pour toutes ces raisons, sans compter l’intérêt évident qu’avait l’Angleterre à cultiver la France, au cas bien envisageable où les hostilités reprendraient entre elle et la Hollande, de mémoire d’homme les relations entre les deux monarchies avaient rarement semblé si cordiales. L’on voit mal comment un Lord Holles aurait pu tout gâter.
Examinons donc un instant la personnalité du nouveau-venu telle qu’elle pouvait être
perçue : certes, dans sa jeunesse, notre ambassadeur avait été un homme flamboyant, il avait fait même beaucoup parler de lui dans les premiers temps de la Révolution anglaise, où on l’avait compté parmi les chefs de file des révoltés à la chambre des Communes8. Mais depuis lors, sous Cromwell, il avait connu l’exil, en Normandie, et s’était rapidement rallié à la cause de Charles II. Mobilisant les restes de ses réseaux parlementaires, il avait joué un rôle notable, à son échelle, dans la restauration de la monarchie. Sa récompense fut un titre de baron et une place au Conseil privé du roi. En ce mois d’août 1663, l’ambassadeur qu’envoyait Charles II offrait donc les apparences d’un sexagénaire rangé, expérimenté, respectable. Quelle difficulté particulière aurait-il pu soulever ? Aussi étrange que cela puisse sembler, la querelle de préséance que déclencha Holles survint pourtant avant même le début officiel de son ambassade : elle portait sur le cérémonial de son entrée, et voilà qui va mériter toute notre attention.
Il est bien connu qu’à cette époque le premier souci de tout ministre arrivant dans une
capitale étrangère était d’organiser son entrée et sa première audience solennelle. Or, quand l’introducteur des ambassadeurs vint instruire Holles des pratiques de la cour de France en la matière, notre diplomate manifesta aussitôt sa surprise et son déplaisir, en découvrant qu’on attendait de lui que son carrosse cédât le passage à tous ceux des princes du sang. De quoi s’agissait-il plus précisément ? C’était l’usage, en France comme dans d’autres monarchies, qu’à chaque entrée solennelle d’un ambassadeur nouvellement arrivé, les autres ambassadeurs déjà présents sur place, les grands princes et hauts dignitaires, envoient leurs carrosses (vides en général, ou occupés par quelques membres de leurs maisons) pour former un cortège de courtoisie, en plus de la foule des spectateurs, toujours énorme en ce genre d’occasion9. A titre
7 Monsieur épousa Henriette d’Angleterre le 31 mars 1661 ; Charles II, Catherine de Bragance le 21 mai 1662 ; le traité de cession de Dunkerque à Louis XIV fut signé le 17 octobre 1662. 8 Sur Holles, outre les ouvrages généraux sur la première Révolution anglaise, on pourra consulter la biographie de référence, par Patricia CRAWFORD, Denzil Holles, 1598-1680 : A Study of His Political Career, collection « Studies in History series », n°16, Londres, 1979. Pour un point de vue ancien et laudatif, cf. les articles « Denzil Holles » de la Biographia Britannica (Londres, 1747, vol. IV, pp. 2645-2647) et du Dictionary of National Biography ; Fr. GUIZOT, Portraits politiques des hommes des différents partis : parlementaires, cavaliers, républicains, niveleurs, collection « Études sur la Révolution d'Angleterre », Paris, 1874, pp. 1-48 ; ainsi que Arthur COLLINS, Historical Collections of the Noble Families of Cavendishe, Holles, Vere, Harley, and Ogle, with the Lives of the most Remarkable Persons, Londres, 1752, pp. 100-162. Pour un point de vue moins ancien et très critique cf. W. L. GRANT, art. cit. supra note 3, en plus de l’article « Denzil Holles », dû à John MORRILL, dans le récent Oxford Dictionary of National Biography (en cours, sur internet). 9 Cf. e.g. A. de WICQUEFORT, op. cit. supra en exergue, vol. I, pp. 198 et suivantes ; aussi C. G. PICAVET, La Diplomatie française au temps de Louis XIV (1661-1715) : institutions, mœurs et coutumes, Paris, 1930, pp. 98 et suiv.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 4 -
indicatif, lors d’une entrée précédant immédiatement celle de Holles, les gazettes chiffrent le nombre de carrosses présents à 2 000 ou 3 000, mais il s’agit là de carrosses de spectateurs, le nombre de piétons devait être infiniment plus élevé10. L’entrée était donc une cérémonie à grand spectacle, très importante par son retentissement dans l’opinion. Revenons cependant au cortège proprement dit : l’ambassadeur qui faisait son entrée prenait place en tête bien sûr, mais dans un carrosse du roi, et il envoyait son propre carrosse avec ses gens, les familiers qui l’accompagnaient, prendre place à l’arrière. Le désaccord entre Holles et les Français porte donc sur l’ordre des voitures qui suivent le carrosse royal accueillant l’ambassadeur. Pour les Français, les carrosses des princes du sang doivent venir immédiatement. Pour Holles, représentant d’une tête couronnée, il convient que son carrosse à lui passe aussitôt derrière ceux du roi et de la reine, donc devant ceux des princes du sang, qui se trouvent ainsi relégués avec le tout venant des dignitaires et ambassadeurs de second rang11... Pour entrer à présent dans le détail des faits, Holles plaida une indisposition subite afin de gagner du temps, et écrivit à Londres qu’on lui envoyât des ordres précis.
Son interlocuteur à la cour de Charles II, le comte d’Arlington, secrétaire d’Etat anglais en
charge des relations avec la France, lui adressa bientôt une réponse pour le moins laconique, où pointe déjà comme une once de surprise ou d’agacement :
Quant à la question du rang de votre carrosse, [...] nous ne pouvons y répondre autrement qu’en vous disant que vous devez vous soumettre aux règles qui sont en vigueur là où vous êtes12. (22 oct. 1663.)
Mais notre ambassadeur s’entêta dans ses demandes d’informations. Il n’hésitait pas à employer les grands mots, se jurant prêt à tout plutôt « que mon Maître ne pâtisse d’aucun de mes actes, et j’espère plutôt que Dieu me donnera le courage de mourir »13. Arlington lui aussi s’obstina, et l’agacement ne tarda pas à se muer en franche exaspération :
Depuis ma dernière dépêche j’ai reçu celles de V. E. en date du 10 novembre et du 17 novembre par lesquelles je perçois que vous n’avez pas encore fait votre Entrée. Par conséquent vous avez eu assez de temps pour être informé de ce point de céder la préséance aux carrosses des princes du sang. Cette situation a occasionné beaucoup de discours ici, comme en Hollande, et fait naître maints récits, d’après lesquels vous auriez reçu quelque affront à votre Entrée, comme si elle avait déjà eu lieu. Une envie m’en a pris d’en parler à Mylord Saint Albans [un homme dont nous aurons à reparler, et qui avait accompli diverses missions en France], mais il a fait la sienne d’une manière qui ne peut être un précédent pour personne d’autre. J’ai cherché à savoir comment Mylord Leycester [autre diplomate que nous retrouverons bientôt] se conduisit dans la même circonstance, mais je ne puis l’apprendre de quiconque. Aussi il ne me reste rien d’autre à dire à ceux qui sont agités par cette question, sinon que Votre Excellence a ordre de suivre les Règles en vigueur. Et je n’ai aucun doute que vous y veillerez avec grand soin, puisque c’est tellement votre affaire14. (26 nov. 1663.)
On pensera qu’après de tels courriers Holles avait compris le message et n’avait plus qu’à obtempérer. Tel aurait pu être le cas. Mais il put compter sur un renfort inattendu, venu de Hollande. Sur ces entrefaites, l’envoyé anglais à La Haye, Sir Georges Downing, se mit en effet assez rapidement à relayer une rumeur publique odieuse, comme quoi les Français allaient réussir à duper les Anglais. Vu la rivalité entre l’Angleterre et la Hollande, il n’en fallait sans doute pas plus pour faire sortir le roi Charles II et ses sujets de leurs gonds. Ainsi Arlington fut en quelque
10 T. BOREL, Une Ambassade Suisse à Paris, 1663. Ses Aventures et ses Expériences, Paris, 1910, pp. 108-109. Cf. Gazette de France, 1663, n°134 et n°135. 11 Il semble néanmoins que Holles n’ait pas disputé la préséance à Monsieur. Cf. infra note 27, p. 7, et texte afférent. Il est vrai que Philippe d’Orléans avait rang supérieur de « fils de France » et de même Madame était fille de roi. 12 N.A., S.P. 78, vol.117, ff. 152-153, extrait de lettre d’Arlington à Holles, datée du 12/22 octobre 1663 : “As for the Ranke of your Coach, at your goeing to your first audience, we can answer it noe otherwise, that you must submit yourself to the Rules, which are in practice there.” 13 Ibid., ff. 208-209, dépêche de Holles à Arlington, datée du 22 novembre/2 décembre 1663 : “[c’est un de mes devoirs] that my Master suffer not by any act of mine, & I hope God will give me the courage to dye rather then he should”. Cf. la citation de Wicquefort que nous donnons en exergue : « …il [l’ambassadeur] n’y peut manquer [à la défense des prérogatives honorifiques de son maître] qu’aux dépens de son honneur & de sa vie. » 14 Ibid., ff. 202.3, extrait de lettre d’Arlington à Holles, datée du 16/26 novembre 1663 : “Since my last I received your Excellcies of 31/10 octob/novemb & 7/17 novemb whereby I perceive you have not yet made your Entry, & consequently have had time enough to be informed in that point of yielding precedency to the Princes of the Blood their Coaches, which hath occasioned much talke here as well as in Holland, and begotten many reports of your having received some affront at your entry (as if it were already made). This hath given me the hint of speaking to my Lord St Albans, who made his in such a manner as it cannot be a precedent to anybody else. I have endeavered to know how my L. Leicester behaved himself in the like occasion, but cannot learne it from anybody, soe that nothing is left me to those that are inquisitive after this matter, but that your Excie hath order to follow the Rules in practice, which I make noe doubt but you will carefully looke into, since t’is soe much your business.”
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 5 -
sorte forcé de s’intéresser à la question et de tenir Charles II au courant. Le voici qui clairement esquisse un revirement :
Cette dépêche est occasionnée par ce que Sir George Downing écrit de la Haye, à savoir l’étonnement là-bas, que vous soyez obligé en France à votre Entrée de souffrir que les carrosses des Princes du Sang précèdent les vôtres. Et ceci m’a fait consulter mon ancienne dépêche pour vous à ce sujet, où j’écrivis ces mots : « nous ne pouvons y répondre autrement qu’en vous disant que vous devez vous soumettre aux règles qui sont en vigueur là où vous êtes ». Or j’en ai rendu compte depuis [...] à Sa Majesté et à Son Altesse Royale [le duc d’York], là-dessus tous deux m’ont demandé si ces règles étaient en usage précédemment envers nos Ambassadeurs15. (15 nov. 1663.)
Dès ce moment, l’on peut considérer que la mécanique d’emballement était enclenchée. Dans une dépêche ultérieure, l’on voit bien qu’Arlington, qui aurait pu être la voix de la modération, est obligé de céder à la surenchère :
J’ai reçu ce soir deux lettres de Votre Excellence […] il y a un instant, si bien que je n’ai pas eu le temps de les montrer à Sa Majesté. Mais par chance Monseigneur le Chancelier [Clarendon, qui faisait office de Premier ministre] se trouvait là dans mes appartements pour leur ouverture et leur lecture. Il a été ébahi, tout comme moi, des récits que vous nous faites des usages suivis par les ambassadeurs dans cette cour16. (3 déc. 1663.)
Ainsi tout le monde est au courant et s’esclaffe. En quelques semaines, ce qui n’était qu’une lubie ou un malentendu devint, grâce à l’obstination de Holles et au renfort de Downing, un objet de fixation générale, une affaire d’État. C’est alors que chacun mena son enquête, aiguisa ses arguments et les présenta à la partie adverse, et c’est tout ce qu’il nous faut tenter de démêler à présent. 2/ Echanges d’arguments
La question était vraiment épineuse, car les anciens envoyés de Cromwell à la cour de Louis XIV ne pouvaient prétendre sérieusement au rang et aux privilèges des ambassadeurs de têtes couronnées, et pour cause : la leur avait été tranchée. Le problème protocolaire ne s’était plus donc posé depuis quelque vingt ans. Il fallait chercher des vétérans d’avant 1640, qui eussent assisté aux ambassades sous Louis XIII, ou mieux, qui s’y fussent rendus comme ambassadeurs eux-mêmes. En Angleterre, les « oiseaux rares » s’appelaient Lord Leicester et Lord Scudamor, mais ils s’avéra très difficile de les retrouver. Peut-être le secrétaire d’État Arlington n’y mit-il pas non plus la meilleure volonté. Pendant ce temps-là, à Paris, Lord Holles restait, comme il l’écrit lui-même, « dans le noir »17, prolongeant indéfiniment sa maladie diplomatique. Les négociations pour le renouvellement du traité de paix et d’amitié étaient bien entendu au point mort.
Dans ce genre d’affaire, il est assurément délicat de juger sur le fond. Côté français, les
arguments ne semblent pas très probants. On s’indigna, on clama très haut des pétitions de principe18. Ainsi Hugues de Lionne, dans cette lettre du 30 décembre 1663 :
[Milord Holles] s’est mis en tête de renverser un ordre établi depuis des siècles entiers en cette cours, et tous les jours pratiqué, ce qu’il n’ignore pas, par tous les ambassadeurs des têtes couronnées19.
Mais lorsqu’il s’agit de trouver des précédents précis et suffisamment anciens, remontant par exemple au règne de Louis XIII, l’embarras fut certain, et les Français en furent réduits à se
15 Ibid., f° 185, extrait de lettre d’Arlington à Holles, datée du 5/15 novembre 1663 : “This is occasioned by what Sr : George Downing writes from the Hague of ye wonder there, that you should in ffrance at your Entry suffer the Princes of Blood their Coaches to preceed yours. And this hath made me consult my former dispatch to you upon this subject ; where in I writ those words, we can answear it noe otherwise then that you submit your selfe to the Rules that are in practice there ; which I have since upon this occasion reported to his Matie & his Royall Highness, upon wch. they both asked me whether those Rules were in practice formerly towards our Ambrs.” 16 N.A., S.P. 78, vol.117, f° 211, Arlington à Holles, le 23 nov./3 déc. 1663 : “I have this evening received two of your Excellencys of ye 24/14 & ye 28/18 instant & but just now soe that I have not had time to show them to his Matie., by good luck my Ld. Chancellor was here in my Lodgings with me at ye opening & reading of them, who was amazed with me at the tale you tell us, of what usage Ambs: have in that Court, both of us beleving the King our Master will not be directed by what the Spanish Ambr. doth or suffers there.” 17 Ibid., f° 208, Holles à Arlington, le 2 déc. 1663 : “Give me leave to say you leave me as much in the dark for what I have to doe as I was before, saying I must follow the rules in practice.” Pour une explication de la mauvaise volonté éventuelle d’Arlington, cf. infra p. 14. 18 Quand l’usage n’était pas clair, c’était souvent l’attitude jugée la plus raisonnable. Cf. un mot de l’archevêque d’Embrun, ambassadeur de France à Madrid contemporain de Holles, duquel il sera question infra : « C’est une maxime generalle qu’il ne fault jamais tesmoigner aucun doubte de son droit en ces matieres la » (M.A.E., Corr. pol., Espagne, vol. 49, ff. 169-170, Embrun à Lionne, le 26 mars 1664). 19 Lionne au comte de Comenges, ambassadeur de France à Londres, le 30 déc. 1663, lettre tirée des archives historiques du M.A.E., transcrite dans Fr. GUIZOT, op. cit. supra note 8, pp. 26-27.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 6 -
référer à un cas antique et un peu nébuleux, livré par le Cérémonial de Godefroy (édition de 1649) : on n’avait pas trouvé mieux que l’entrée dans Paris de la reine Marie d’Angleterre, d’éphémère mémoire, ultime épouse de Louis XII, en 1514. Il semble bien qu’à cette occasion les ducs de Valois, Bourbon et Alençon avaient eu la préséance sur les ambassadeurs d’Angleterre qui étaient présents, en tout cas lors d’un grand banquet20. En réalité l’exemple ne pesait guère, et Holles eut beau jeu de le montrer : car il s’agissait de l’entrée non pas d’un ambassadeur d’Angleterre, mais d’une reine de France, et non pas tant d’une entrée que d’un banquet. D’ailleurs nulle part ces ducs n’étaient qualifiés de princes du sang par le texte original, c’est seulement une annotation marginale de Godefroy qui les désignait comme tels21. La vérité, me semble-t-il, c’est Hugues de Lionne qui l’avoue lui-même, sans en démordre d’ailleurs, au détour d’une lettre à l’ambassadeur de France à Londres, afin de le tenir au courant de la controverse : la place des princes du sang n’était pas bien définie protocolairement avant le XVIIe siècle, tout simplement parce que la notion même de prince du sang n’était guère codifiée. Il écrit :
Avant Henri III, les princes du sang en France ne tenaient point de rang s’ils n’étaient pairs, et ne le prenaient que suivant l’ancienneté de leur pairie, en sorte que souvent d’autres princes les précédaient22.
A plus forte raison, ajoutera-t-on sans peine, les ambassadeurs de têtes couronnées. La position française se trouva d’autant plus fragilisée que, côté anglais, on finit bien par
remettre la main sur les « oiseaux rares » — les ambassadeurs vétérans que Charles Ier avait envoyés à Louis XIII. Et Lord Leicester était absolument catégorique dans son témoignage, le voici retranscrit par les soins du secrétaire d’État Arlington :
Il [Lord Leicester] dit qu’un Maréchal de France fut envoyé avec les carrosses du roi et de la reine à Saint-Denis, afin de l’emmener dans la ville où il se rendit dans le carrosse du Roi, le sien à la suite de celui de la reine. […] C’est dans cet ordre qu’il fut mené à son hôtel, et ni le carrosse du cardinal de Richelieu ni celui du prince de Condé ne prirent part à la cérémonie. Quelques jours après, la cour se trouvant alors à Fontainebleau, le duc de Chevreuse ramena les carrosses du roi, et le conduisit là-bas à première audience. Et il insiste sur le fait que c’est un droit des ambassadeurs d’Angleterre d’y être mené par un prince, comme celui-ci qui était de la maison de Lorraine. De plus Milord Leicester dit qu’il rendit visite au prince de Condé, qui se trouvait là, mais prit la main sur lui dans sa propre demeure, et le prince alla à sa rencontre à la sortie de son carrosse, nonobstant le fait que lui, ambassadeur, fût le premier qui, par agrément des deux rois, eût traité le Prince d’Altesse. Tel est le récit que fait Milord Leicester23. (6 décembre 1664.)
20 Th. et D. GODEFROY, Le Cérémonial François recueilly par Théodore Godefroy, Conseiller du Roy en ses Conseils, et mis en lumière par Denys Godefroy, Advocat en Parlement & Historiographe du Roy, Paris, 1649, pp. 745-746. Voir notamment p. 746, description du banquet en question par transcription d’un récit ancien : « du costé des Requestes estoit la table où ont esté assis au souper lesdits ducs de Bretagne et de Valois, d'Alençon et de Bourbon, de Suffolc, & ledit Marquis [il s’agit d’un second ambassadeur anglais, en plus de Suffolk] ». Les personnalités peuvent avoir été citées dans un ordre de préséance, mais ce n’est pas très clair. De plus les ducs français ne sont pas qualifiés de princes du sang. C’est seulement en annotation marginale qu’il est écrit : « les princes du sang en rang plus honorable que les ambassadeurs d'Angleterre. » 21 Voir note précédente pour cette annotation marginale. On trouvera la contre-argumentation développée par Holles in B.N.F. (Arsenal), ms. 5422 (recueil Conrart, tome XIII), pp. 843-852 : « Lettre de M. Hollis, Ambr. Extraord. d'Angleterre en France à M. de Lyonne Secr. d'Estat sur la difficulté qui lui a esté faite de donner rang à son carrosse ». Au sujet de l’annotation marginale, Holles remarque avec pertinence, p. 846, que le texte qui lui correspond « est un foible fondement pour cette remarque, & montre plutôt la volonté de l'auteur que la vérité de son annotation ». Et il trouve quant à lui d’autres précédents chez Godefroy pour soutenir ses propres prétentions. 22 Lionne au comte de Comenges, le 30 déc. 1663, transcrit in Fr. GUIZOT, op. cit. note 8, p. 28. Sur cette question, A.. de Wicquefort est plus clair encore. Si l’on réunit plusieurs de ses remarques éparses, il apparaît que pour lui la haute position protocolaire des princes du sang est un phénomène récent : « Les princes du sang en France ne font point de difficulté de traiter les ambassadeurs d’Excellences, quoy que depuis quelque temps ils ne leur veuillent point céder la place d’honneur. » (A. DE WICQUEFORT, L’Ambassadeur et ses Fonctions, Cologne, 1690, I, p. 267.) « Le Lord Holles, Ambassadeur d’Angleterre, et l’Ambassadeur de Venise, ne vouloient pas céder en lieu tiers au Prince de Condé. Je ne veux pas dire qu’ils aient eu raison. Au contraire, j’estime qu’en France on doit quelque chose aux Princes du Sang. Je dis quelque chose ; mais non tout ce que le Roy leur a donné depuis peu. » (Ibid, I, p. 276.) « Il est vrai, qu’en ce temps-là [jusque vers 1640 au moins] les Princes du Sang cedoient la main & le pas aux Ambassadeurs ; & non seulement à ceux des Testes Couronnées, mais aussi à ceux des Républiques. » (Ibid., I, p. 277.) « Depuis quelques années le Roy a désiré, que les Princes du Sang en usassent autrement, & qu’ils prissent chez eux tous les avantages sur les Ambassadeurs : mais comme les Princes n’ont point de part aux affaire de l’Estat, je ne pense pas que les Ambassadeurs, qui ont fait difficulté de leur céder en lieu tiers […] se tuent pour voir M. le Prince chez lui, afin d’y recevoir un affront. » Et Wicquefort de conclure subtilement : « C’est une politique raffinée de ceux, qui voulant éloigner les Princes du Sang de toutes sortes d’affaires, leur ostent aussi la communication qu’ils pourroient avoir avec les Ministres estrangers. » (Ibid., I, pp. 277-278.) Voir aussi N.A., S.P. 78, vol. 307, ff. 155-156, un mémoire datant sans doute du début du règne de Louis XIV et soutenant la préséance « indubitable » des princes du sang sur « tous les princes du monde », mais qui n’en avoue pas moins, paradoxalement, qu’Henri III en son temps avait décidé de leur faire céder le pas au chef de la maison de Lorraine. 23 N.A., S.P. 78, vol. 117, f° 219, extrait d’Arlington à Holles, en date du 26 nov. / 6 déc. 1663 : “He saith a Marshall of ffrance was sent with ye King & Queens Coaches to St: Dennis, to bring him into towne, whither he went in the Kings Coach his owne following the Queens[...], in this manner, he was brought to his lodging neither ye Cardinal de Richelieus nor the Prince of Condé’s Coach haveing any part in the Ceremony. After some days the Court being then at Fountainbleau the Duke of Chevereus brought ye Kings Coaches, and conducted him thither to his first audience, which he insisted upon as a Right of ye English Ambass: to be carryed thither by a Prince as he was of ye house of Lorraine ; besides my Lord of Leycester saith that he visited ye Prince of Conde being there, but tooke ye hand of him in the Princes house, where he was met (?) by
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 7 -
A lire ce récit circonstancié, il semble donc que décidément la position protocolaire des princes du sang s’était beaucoup renforcée depuis une vingtaine ou trentaine d’années. Et telle est exactement la conclusion à laquelle parvenait Holles de son côté24.
On imagine bien que dans ces recherches fébriles de précédents notre vieil ambassadeur
ne demeura pas en reste. Bien entendu il mena son enquête dans les grimoires, mais aussi, et ceci est plus intéressant encore, Holles recueillit la mémoire vivante, parmi ses homologues étrangers, et ainsi nous percevons qu’au début du règne de Louis XIV le protocole est encore matière extrêmement plastique :
Il m’a semblé approprié d’aller parler d’abord avec l’ambassadeur de Hollande, de qui je pensais pouvoir apprendre quelques détails plus précis sur la manière dont leurs ambassadeurs ici avaient été traités. [...] Je suis [donc] allé voir M. Boreel, qui me dit que les derniers ambassadeurs de Hollande — pense-t-il — cédèrent effectivement le pas, mais les précédents ne l’avaient pas fait ; et il ajouta que c’est l’ambassadeur d’Espagne (celui d’avant celui qui se trouve ici à présent) qui fut le premier à céder la préséance, et que depuis on attend la même soumission de tous les autres ambassadeurs. En partant de chez lui, je me rendis chez l’ambassadeur de Venise, qui est particulièrement aimable avec moi, et je l’interrogeai. Il me répondit qu’il avait ordre de procéder comme le nonce, lequel, pour montrer l’humilité de l’Eglise, ne voulait prendre la place de personne, si bien que tous les carrosses, à la fois ceux des princes et des autres prenaient place devant, et le sien en dernier : voilà donc l’usage qu’il suivait, et ce que les autres faisaient, il protesta qu’il ne le savait pas. Tout ceci me rendit un peu perplexe sur ce qu’il fallait faire25. (24 nov. 1663.)
Effectivement, étant donné l’ accumulation d’arguments de part et d’autre, et notamment côté anglais, il se faisait urgent de sortir de la crise, au moins provisoirement, en proposant un expédient.
3/ Un piteux triomphe
Après plusieurs mois de rebondissements et d’atermoiements, sur lesquels il deviendrait fastidieux de s’appesantir, rendons-nous directement au dénouement, en mars 1664. Grâce à l’entrée en scène de Madame et à ses bons offices, grâce probablement aussi à ceux de Turenne, Louis XIV se résolut à un compromis. On délocalisa subrepticement la cour à Saint-Germain pour un voyage éclair, les princes du sang furent comme par enchantement déclarés tous absents, et Holles, au lieu de faire une entrée spectaculaire à Paris, dut se contenter d’une cérémonie quelque peu champêtre, « une espèce d’entrée26 » selon ses propres dires. Mais écoutons-le crier victoire dans une lettre à son homologue en poste à Madrid, Sir Richard Fanshaw :
J’ai eu enfin une très juste audience, et n’ai rien perdu des anciens privilèges des ambassadeurs du roi d’Angleterre : ce roi étant à Saint-Germain envoya le 20 mars un maréchal de France avec son propre carrosse, ceux des deux reines, de Monsieur et de Madame, pour me transporter depuis ma demeure jusque dans cette ville. Il pourvut à mes besoins cette nuit-là et au dîner du jour suivant, au matin duquel je fus conduit à mon Audience par un prince, le comte d’Armagnac, fils du comte d’Harcourt, et dans l’après-midi, je retournai à Paris. J’ai eu depuis une autre audience dans cette ville, et m’en vais à présent suivre la route ordinaire des
him ye Prince to his Coach, notwithstanding that he the Ambr: was ye first who by ye agreement of both ye Kings, treated the Prince with Altesse. This is ye Story my Ld: of Leycester tells.” Sur l’ambassade de Leicester, cf. les travaux de Loïc BIENASSIS. 24 Voir aussi l’avis instructif d’A. de WICQUEFORT, cité supra note 22. 25 N.A., S.P. 78, vol. 117, f°196 Holles à Arlington, le 14/24 nov. 1663 : “In the afternoone I went to Mr Boreel who told me their last Ambassadors he thought did give place, but that the former ones did not ; and said that the Spanish Ambassador (before this now here) was the man began it, & that since they expect to have it from all Ambassadors : from him I went to the Venitian who hath a particular kindnes for me, and asked him ; he said that he had order to doe as the Nuncio, who to shew the humility of the Church, would take place of none, but all coches both of Princes and others to goe before & his to come last, which course he followed, & what others did he protested he knew not. This did a little stumble me what to doe.” Il est intéressant de constater que cette enquête de Holles est largement corroborée par les affirmations d’Hugues de Lionne : « Comme les exemples récents peuvent être moins contestés ou révoqués en doute, on lui a fait voir les derniers du comte de Fuensaldagna, du marquis de la Fuente, du comte de Tott et de l’ambassadeur extraordinaire de Danemark, et ceux des sieurs Nani, Grimani et Sagredo, ambassadeurs de Venise, qui sont d’ordinaire les plus exacts en matière de cérémonies pour se tenir toujours dans le rang des couronnes. Ledit sieur Holles convient de la vérité des exemples ; mais il dit qu’ils ne peuvent servir de règle à un ambassadeur d’Angleterre : à quoi on a la civilité de ne rien répondre… » (Lionne au comte de Comenges, le 30 déc. 1663, transcrit in Fr. GUIZOT, op. cit. supra note 8, pp. 27-28.) 26 Holles à Fanshaw, le 18/28 juillet 1664 [datation douteuse] : “a kind of Entry”, transcrit in Sir R. FANSHAW, Original Letters Of his Excellency Sir Richard Fanshaw, During his Embassies in Spain and Portugal : Which, together with divers Letters and Answers from The Chief Ministers of State of England, Spain and Portugal, contain the whole Negociations of the Treaty of Peace between those Three Crowns, Londres, 1701, pp. 204-205.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 8 -
affaires. Quant aux princes du sang, je n’entendis rien dire d’eux, aussi je ne fus pas du tout gêné par des disputes au sujet de leur prétendu droit de préséance27. (5 avril 1664.)
Derrière ce discours claironnant, la réalité était beaucoup moins brillante, et Holles n’était pas assez naïf pour penser que les choses allaient en rester là. Il semble bien que ses dépêches à Arlington aient adopté un ton nettement plus désabusé, car ce dernier crut bon de le réconforter et l’encourager à ne pas se laisser aller à des vapeurs, comme l’on disait. Mais Holles s’expliquait :
Donnez moi la permission de vous dire que vous vous méprenez de penser que c’est la mélancolie qui me pousse à souhaiter le traité déjà conclu et moi-même de retour au pays. C’est que je crois que ma personne n’est pas très appréciée ici et donc moins capable d’accomplir son office : voilà, je le proteste devant Dieu, la principale raison qui me rend mélancolique, et non pas quelque acte qui puisse être fait ici contre moi. Leur bonne ou mauvaise volonté, tant que j’accomplirai mon devoir, ne me pèsera guère, mais si vous vous rappelez bien, Monsieur, je vous écrivis sitôt après mon Audience que j’étais certain que l’affaire des Princes [du sang] ne me serait jamais pardonnée, c’était mon opinion alors, cela l’est encore, et le sera toujours28. (4 juin 1664.)
Dans ses pronostics et son inquiétude, il ne se trompait pas. Nous ne rentrerons pas dans le détail des avanies qui s’abattirent sur le diplomate anglais,
ceci excéderait par trop notre sujet29. Le reste de l’ambassade de Holles fut une véritable descente aux enfers, ponctuée de vexations variées. Bientôt les Français cherchèrent à le court-circuiter par tous les moyens : c’est dès cette époque que Louis XIV mit en selle Madame pour essayer de traiter directement avec Charles II30. Objet de toutes sortes de médisances, dessaisi de toute mission importante, l’ambassadeur fit alors une figure ridicule, sur laquelle chacun put se défouler à loisir. On lui refusait le titre d’Excellence. Il s’en plaignit avec hauteur. Peut-être était-ce une coïncidence, mais Molière, sur ces entrefaites, créa justement une pièce où un intermède mettait en scène un ours mal léché, qu’il fallait calmer en le traitant de Monseigneur et d’Altesse31. Toutes ces piques ne constituaient-elles pas, en elles-mêmes, une accumulation de micro-incidents ? C’est ce que ne manquèrent point de considérer certains observateurs attentifs, comme l’ambassadeur de Venise Alvise Sagredo, témoin de tout ceci :
Il me semblerait donc que […] Lord Holles n’a pas obtenu la plus petite satisfaction de cette cour. Ainsi les jours se suivent-ils, avec peu de contentement, et l’on dirait qu’on est en train de procéder soigneusement à une accumulation de nombreuses choses, que le temps et les circonstances rendront plus apparente32. (2 juin 1664.)
Sur cette toile de fond, rien d’étonnant en tout cas que soient venus se greffer des événements plus graves ; c’est alors que nous retrouvons des carrosses, au cœur de deux nouvelles affaires.
27 Ibid. pp. 51-2, Holles à Fanshaw, le 26 mars/5 avril 1664 : “I have at last had a very fair Audience, and lost nothing of the Antient Priviledges of the King of England's Ambassador ; this King being at St. Germains, did the twentieth of March, send a Mareschal of France with his own Coach, the two Queens, Monsieurs and Madames, to fetch me from my House in this Town, treated me that Night, and the next day Dinner, that morning I was fetch'd to my Audience by a Prince, the Count of Armagnac, Conte Harcourt's Son, and in the afternoon I return'd to Paris ; I have since had an other Audience in this Town, and am now going on in the ordinary track of business ; of the Princes of the Blood I heard nothing, so was not at all troubled with the dispute of their pretended right of Precedency.” Cf. Gazette de France (n°35, en date du 22 Mars 1664), qui contient un entrefilet laconique : « Le Mesme jour [19], le maréchal de Clérambaut, & le Sieur de Bonneüil Introducteur des Ambassadeurs, vinrent prendre ici, Milord Hollis, Ambassadeur Extraordinaire du Roy de la Grand'Bretagne, & le conduisirent dans les carrosses de Leurs Majestez, à S. Germain, au Logis qui lui estoit préparé. » 28 N.A., S.P. 78, vol.118, f° 190 r° et v°, Holles à Arlington, le 25 mai / 4 juin 1664 : “Give me leave to tell you you are mistaken to thinck it proceeds from melancholy, my wishing ye Treaty here well ended & myself at home, because I believe my person not very acceptable here & so lesse capable of doeing service, it is I protest before God the chief reason, & not any thing that can be done here to me to make me melancholy ; their good or their bad will as long as I doe my duty I shall not much weigh, but if you remember Sr I did write to you soone upon my Audience that I was confident ye busines of ye Princes would never be forgiven me, it was my opinion then & is still & ever will be.” 29 Cf. le récit plus étoffé que j’en ai donné dans mon étude « Un ours à la cour de Louis XIV ». 30 Voir notamment M.A.E., Corr. pol., Angleterre, vol. 84, f° 71 : « Billet donné par le Roy a Madame » (la copie en a été envoyée au comte de Comenges, ambassadeur de France en Angleterre, le 11 octobre 1664). On y lit : « Le Sr. Hollis ayant mis entre les mains de Lionne un escrit sur le proiet du traittez ou j'ay remarqué que mesme sur divers articles qu'on avoit donnez à M. de Cominges en Angleterre & que j'ay accordez il a changé et adiousté plusieurs choses, je crois bien que [si] on continue à négotier comme on a fait depuis pres de deux ans, l'affaire ne finira point, et comme j'en souhaitte fort la conclusion j'ay pensé a un moyen qui me paroist fort prompt et aysé qui est que sans nous arrester à tant de negociations et de negociateurs nous jurions de part et d'autre l'extention des traitez que je juray en l'an 1644… » 31 Cette entrée en scène de l’ours se trouve dans La Princesse d’Élide, deuxième intermède, scène II. Il n’est pas indifférent de préciser que cette pièce a été représentée pour la première fois le 8 mai 1664 à Versailles lors de la grande fête dite « des plaisirs de l’isle enchantée ». (Voir par exemple le contre-rendu qui en est donné dans le n°69 de La Gazette de France, daté du 22 mai 1664.) In N.A., S.P. 78, vol.118, f° 203, Holles évoque une “Play at Court, wch hath made so much noise, a beare is brought upon ye stage very froward & unruly, till he be stroked wth ye name of Altesse” (Holles à Arlington, le 5/15 juin 1664). D’autres exemples du ridicule qui frappa Holles sont donnés par GRANT et GUIZOT, op. cit. supra note 8. 32C.S.P. Venice, vol. 34, p. 22 : Alvise Sagredo au doge et au sénat, 2 juin 1664 : “So it would seem to me that even on some other private request of his Lord Holles has not had the smallest satisfaction from here. Thus one day follows another with little content, and it looks as if they were carefully making an accumulation of many things which time and circumstance will cause to become more apparent.”
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 9 -
De la première, Holles se tira sans trop d’embarras. Elle survint un beau jour de juin
1665, lors d’une visite de courtoisie qu’il était en train de rendre à l’une de ses compatriotes en séjour en France, la comtesse Holland. Il semble qu’alors son carrosse, resté stationné devant l’entrée du logis, se soit trouvé pris à parti par un groupe de laquais et de cochers. C’est ce qui ressort de plusieurs récits, dont un d’Hugues de Lionne, qu’on ne pourra taxer de partialité en faveur du propriétaire de la voiture en question :
Mr de Bonneuil [c’est-à-dire l’un des introducteurs des ambassadeurs de la cour de France] vint hier matin avertir le Roi que Mr. l'Ambassadeur d'Angleterre estant chez Mme la Comtesse Holland où étoient aussi quelques seigneurs françois & entre autres le Marquis de Benac, qui doit estre quelque jeune homme puisqu'il n'a point l'honneur d'estre connu de Sa Majesté, leurs gens qui les attendoient dans la rue se prirent de paroles, sur ce que l'on vouloit faire avancer un des carrosses ; que le cocher y resista ; & que lui même étant descendu & ayant pris le parti de ses gens comme il était bien juste, non pas peut-être bien prudent de se commettre à descendre & exposer la dignité de son caractère, le dit marquis lui dit quelque paroles fascheuses, comme serait à dire qu'il le trouvait bien emporter pour un vieillard. C'est jusqu'ici tout ce qu'on a su car Mr. l'Ambassadeur ne s'explique de rien. […] Ce sont incidents que toute la prudence humaine ne saurait prévenir33. (3 juin 1665.)
Les sources nous apprennent que Louis XIV réagit finalement très vite, en faisant enfermer Benac à La Bastille et ses gens au Fort l'Evêque. Après avoir été dûment supplié par la famille du prisonnier, Holles eut alors la satisfaction de pouvoir lui faire grâce et obtint du roi qu’on le relâchât. L’incident était clos. Il n’en reste pas moins qu’il demeure étrange que des domestiques de gens d’une noblesse au fond assez peu notoire, en visite qui plus est chez une dame de la haute aristocratie anglaise, aient pu méconnaître qu’ils pouvaient effectivement avoir affaire à l’ambassadeur d’Angleterre, et ne lui aient pas cédé le pas spontanément. Sous ce jour, la mention finale de Lionne — « Ce sont incidents que toute la prudence humaine ne saurait prévenir » — sonnerait presque faux. Quoiqu’il en soit, d’une toute autre conséquence fut la mésaventure suivante, survenue au début septembre 1665.
Cette fois-ci, il s’agit d’une affaire qu’en première approche l’on pourrait qualifier de « refus caractérisé de priorité », dans Paris. Un jour que Madame, duchesse d’Orléans, avait convié Lady Holles à l’accompagner visiter la reine au Louvre, lui offrant à cette occasion une place auprès d’elle dans son carrosse, tandis que celui de l’ambassadrice devait suivre immédiatement derrière, chemin faisant survint un troisième carrosse, qui s’avéra appartenir à la princesse de Carignan, lequel carrosse força le passage, afin de s’interposer entre les deux premiers. Mais laissons la parole à l’époux de l’ambassadrice, puisqu’il eut l’occasion de s’en plaindre directement à Louis XIV, en exposant bien des circonstances aggravantes :
Madame […] avoit fait honneur à ma femme de la prendre dans le sien [son carrosse] et de la mener avec elle voir la Reyne. Ce carosse de Made. de Carignan les rencontrant dans la ruë, n'estant point de la compagnie, s'arrest et attend que celuy de Madame fût passé, puis ses laquais se jettent sur mes chevaux sans rien dire, les arrestent à coups de baston, et font passer leur carosse devant le mien ; apres cela se meslent avec mes laquais une douzaine, dit-on, de ceux-là avec de gros bastons, préparés, ce me semble, pour une telle affaire ; les miens n'estoient que cinq ou six et n'avoient rien en leurs mains que quelque petite baguette, de sorte que la partie n'estoit nullement égale, neantmoins ils se battirent, et ces laquais furent si opiniâtres à maltraitter les miens, que les Gardes de Madame eurent de la peine à les faire cesser et ils n'en pûrent venir à bout qu'apres qu'ils les eurent menacés de tirer sur eux. En suite ils se mirent a braver et a dire qu'il y avoit douze carosses en France qui avoient droit de marcher devant celuy de l'Ambassadeur, et que le leur en estoit un. Et tout le temps que mon carosse fut au Louvre attendant que ma femme en sortît, le cocher fut tellement injurié et menacé, qu'a son retour il m'en fit sa plainte, et me dit qu'il n'y osoit plus retourner, parce qu'il craignoit qu'on ne se jetât sur luy et qu'on ne le mît en pieces34.
A entendre ce récit, nous comprenons bien que l’ambassadeur n’a aucune preuve, cependant l’organisation minutieuse de l’assaut sent indéniablement le guet-apens. Précisons en outre, ce qui n’est pas dit explicitement, que la princesse de Carignan était en effet une princesse du sang, mais
33 M.A.E., Corr. pol., Angleterre, vol. 84, ff. 261-262 et suivants : minute et copie de lettre de Lionne au duc de Verneuil, au comte de Comenges et à Honoré Courtin, ambassadeurs en Angleterre, datée du 3 juin 1665. Cf. N.A., S.P. 78, vol. 120, ff. 177-179, où Holles donne sa version des faits en explicitant les « quelques paroles fâcheuses » qu’il essuya : « Et comment ! un homme de vostre aage battre mon laquay ! » Mais la réplique du Britannique ne se fit pas attendre : « Je suis tousiours assez jeune pour vous faire raison quand vous voudrez si vous en estes offensé. » 34 M.A.E., Corr. pol., Angleterre, vol. 84, ff. 388 r° et v° : « Mémoire présenté au Roy par le milord Hollis ambr. d'Anglre. après le retour de Mrs. les ambrs. extraordres. de France ». Ce texte constitue probablement celui qui a été lu lors de l’audience de congé de Holles.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 10 -
pas de premier plan : elle était donc en position idéale pour représenter les intérêts de sa caste35. A-t-elle osé donner la main à une machination ? Est-ce ses serviteurs qui ont tout organisé ? Autant de questions embarrassantes. Mais le plus grave encore, aux yeux de Holles, fut que Louis XIV n’imposa pas à ladite princesse d’excuses officielles, et l’ambassadeur ne manqua pas de lui en adresser les reproches les plus amers :
Voilà, Sire, l'état d'une affaire qui méritoit assurément qu'on m'en fit satisfaction. Et je puis dire que le moindre gentilhomme de Paris la pouvoit attendre de la part de qui que ce fût, et que le plus grand Prince qui soit devoit avoir châtié ses gens pour estre venus de gayeté de cœur se fourrer en une compagnie ou ils n'avoient que faire, pour faire un affront à un gentilhomme et pour l'offenser ; néanmoins on n'en a pas usé ainsi envers un Ambassadeur du Roy de la Grande Bretagne36.
C’est qu’en ne bougeant pas, Louis XIV rendait un arbitrage implicite en faveur des princes du sang. Il est vrai, cependant, qu’en cette fin d’année 1665 l’heure ne se prêtait plus à ménager l’Angleterre, encore moins son ambassadeur opiniâtre.
Le roi de France avait fini en effet par prendre son parti et se rangeait du côté de la Hollande, la guerre était imminente. Holles ne tarda pas à être rappelé dans son pays. Il obtint son audience de congé le 26 décembre et en profita pour étaler ses rancœurs dans un discours fleuve, en anglais, devant une assistance qui n’y comprenait goutte, et en un sens tant mieux. Une version française fut lue peu après, et les observateurs remarquèrent alors que Louis XIV manqua perdre son sang froid : « [je n’ai] jamais tant ouï dire d’impertinences », aurait-il laissé échapper37. Les coups d’éclat n’étaient pourtant pas finis : comme il était de tradition, et malgré les aigreurs, un présent diplomatique fut adressé à Holles avant son départ, il s’agissait en l’occurrence d’un portrait du souverain rehaussé de pierres précieuses. Audace assez inouïe, notre ambassadeur eut le front de le retourner à l’expéditeur, arguant du fait qu’il ne pouvait pas accepter un présent d’un souverain qui ne lui faisait pas justice sur le point des préséances38. Pour toutes ces raisons, l’on comprend que Louis XIV dut garder un très désagréable souvenir du Britannique, et ainsi s’explique qu’il lui ait réservé les honneurs d’un royal commentaire dans ses Mémoires :
Ollis ne revint point, et, à dire le vrai, je n'en était pas fort fâché, parce que dans le séjour qu'il avait fait auprès de moi comme ambassadeur, j'avais remarqué dans son esprit une rudesse mal propre à négocier un accord39.
Au terme du récit qui vient d’être délivré, la tentation peut donc être grande de désigner Holles comme seul et unique responsable, à la fois de ses déboires personnels et des échecs de la diplomatie anglaise. Sa propre correspondance, sur laquelle nous nous sommes largement appuyé, ne l’accable-t-elle pas en effet ? N’avons-nous pas affaire à une personnalité roide, butée ? N’est-
35 Sur la princesse de Carignan princesse du sang cf. e.g. E. SPANHEIM, Relation de la cour de France en 1690, Paris, 1900, pp. 175-176 : « Les princes et princesses du sang qui sont présentement en France se réduisent aux enfants des deux frères, les feus princes de Condé et de Conti et à la princesse de Carignan, veuve du prince Thomas de Savoie et sœur du comte de Soissons mort à la bataille de Sedan, en l'an 1641. » 36 M.A.E., Corr. pol., Angleterre, vol. 84, f°388 r° et v° : « Mémoire présenté au Roy par le milord Hollis ambr. d'Anglre. après le retour de Mrs. les ambrs. extraordres. de France ». 37 D’après une lettre d'Élie Richard à Bouhéreau, datée de Paris, le 3 janvier 1666 : « L'ambassadeur d'Angleterre eut son audiance de congé il y a quatre ou cinq jours, ou il parla fort arrogamment au Roy. Il est constant qu'il n'étoit pas encore esloigné de trente pas pour s'en aller que le Roy dit a ceux qui estoient aupres de lui qu'il n'avoit jamais tant oui dire d'impertinances. Ce sont ses propres paroles. » (Transcription in N. J. D. WHITE, « Gleanings from the Correspondence of a Great Huguenot : Elie Bouhéreau of La Rochelle », Proceedings of the Huguenot Society of London, vol. IX, n° 2, 1910, p. 27. L’original est consultable à la Marsh’s Library de Dublin.) Cf. C.S.P. Venice, vol. 34, p. 236, dépêche de Marc Antonio Giustinian au doge et au sénat, le 29 déc. 1665, résumée ainsi : “Lord Holles took leave of the king last Saturday. He spoke English and with much gravity, his behaviour being remarked as very proud. He dilated upon the ill feeling which was begun by the seizure of divers merchant ships, carried out by the French fleet, without their having offered any compensation here. He complained of the connivance shown on this side which he called an infallible argument of their lack of good feeling towards the British crown. He went on to complain of the succour afforded to holland. He then spoke of the sinister incidents which had occured at this Court for which no satisfaction had been given, but contemptuous treatment had rather been encouraged and they studied to lower English prestige. He ended by saying that he had instruction from his king to take leave of that Court which had placed itself side by side with his enemies, and in view of the many attempts at hostilities from this side the British crown found itself obliged to take the just and convenient steps. He took consolation from the fact that England had not been the first to take steps to interrupt the ancient and friendly correspondence and the world would approve the action taken by his king. He ended very mildly and left a copy of his speech in a memorial in French. When this had been read the king replied briefly : that the unfortunate encounters at sea were not by his wish ; he had attempted, as was well known, the reconciliation of the Dutch with England ; that he favoured friendship with that crown. Finally he expressed himself as satisfied with the ambassador's service. After Lord Holles had gone the king said : ‘This man struck me as very indiscreet (quest'uomo m'e riuscito molto indiscreto). It is not known if this was because of the office or in the way in which he carried himself, which is universally condemned as too harsh and austere.” 38 Cf. M.A.E., Corr. pol., Angleterre, vol. 87, f°146 r° rapport de Gomont à Lionne, le 1er juin 1666 : « le peu d'egard qu'on a eu a l'affaire qui fut faite par les gens de Madame la Princesse de Carignan […] est cause qu'il n'avoit point accepté le présent de Sa Majesté. » Pour ce qui est du désintéressement de Holles, cf. aussi infra note 40. 39 Jean LONGNON (éd.), Mémoires de Louis XIV. Le métier de roi, 1978, p. 205.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 11 -
ce pas lui qui, en jetant sur le tapis une question de préséance ridicule, à laquelle peut-être personne n’aurait pris garde d’ordinaire, a lancé une mécanique infernale ? Peut-être aurait-il dû soupeser que les circonstances, la position de l’Angleterre, nécessitaient davantage de souplesse. Telles sont les réflexions qui condamnent Holles en quelque sorte. Mais d’autres observations incitent à infiniment plus de circonspection. Ce sera tout le propos des analyses qui vont suivre, où nous commencerons tout d’abord par dégager un contexte étroit plus propice aux incidents que nous ne l’aurions cru.
II - Un contexte étroit : ces tensions qu’on ne saurait voir. 1/ Lord Holles responsable ?
Pour aller au-delà de la surface des événements, impossible de faire l’économie d’un début de réhabilitation de Lord Holles comme diplomate. L’on peut toutefois aller à l’essentiel, en s’appuyant sur deux observations.
La première concerne la suite de ses aventures. Après tout ce qui a été dit, on ne
trouverait pas étonnant qu’un accueil glacial lui eût été réservé pour son retour en Angleterre, en attendant la disgrâce. Eh bien ce n’est pas du tout ce qui advint. Holles réintégra apparemment sans encombre sa place à la chambre des Lords et au Conseil privé, et demeura un personnage central de la vie politique britannique. Dès l’année 1667 d’ailleurs, c’est lui que Charles II nomme plénipotentiaire au congrès de Bréda, en compagnie de Henry Coventry. L’Angleterre se trouvait alors à bout de force, accablée, aussi bien par la peste, que par l’incendie de Londres, et bien incapable de continuer la lutte contre coalition franco-hollandaises. Dans ces circonstances vraiment difficiles, les deux émissaires passent pour avoir obtenu le maximum qu’on pouvait espérer. A leur retour, ils furent donc salués avec honneur. Holles, qui se faisait pourtant âgé, n’en continua pas moins sa carrière politico-parlementaire et fut actif pratiquement jusqu’à son dernier souffle, en 1680. Les ambassadeurs de France, à cette époque Colbert de Croissy puis Courtin et Barrillon, le fréquentèrent assidûment et le recensèrent parmi les personnalités d’un poids certain40. Ceci se mesura en particulier pour ses funérailles, à l’abbaye de Westminster, qui prirent des allures d’apothéose : une foule immense s’y pressa41. Les thuriféraires n’en finirent pas de lui tresser des couronnes. Plus tard, on ne manqua pas de lui élever un monument funéraire, avec une longue épitaphe. Celle-ci mérite d’être citée, car elle contient une remarque assez édifiante sur le passé diplomatique du personnage, ou sa transfiguration :
Il fut dépêché comme ambassadeur extraordinaire auprès de Louis, le roi de France, qui n’admira pas moins la noblesse avec laquelle il soutint la dignité de son caractère, qu’il ne craignit cette vertu qu’il ne parvint à corrompre par ses magnifiques présents, lesquels furent plus royalement refusés qu’ils n’avaient été offerts42.
Notre deuxième observation concernera sa personnalité. Sans doute pourrait-elle donner
lieu à de longs développements, car elle est riche43. Mais pour rester simple, disons que certes 40 Cf. Dictionary of National Biography, art. « Holles » et M.A.E., Corr. pol., Angleterre, vol. 101-138 passim. Voir aussi H. FORNERON, Louise de Kéroualle, duchesse de Portsmouth, 1649-1734, Paris, 1886, p. 163, et p. 184, où il est question, dans les mots mêmes de Barrillon, d’une « boëte destinée pour milord Holles ». Corruption ? Tentative de corruption ? 41 Cf. e.g. P. CRAWFORD, op. cit. supra note 8, p. 215 : “Morrice, his former chaplain, said that ‘As great respects and honour [were] paid to his memory by the town and country as hath ever been known, and more coaches and horsemen attended his corpse out of the City than (as it’s said) has ever been seen’.” 42 Épitaphe transcrite notamment chez Arthur COLLINS, op. cip. note 8, p. 158 : « [il fut ambassadeur auprès de] Lewis, the French King, who no less admired the Generosity whereby he maintained so high a Character, than he dreaded that Virtue he was not able to corrupt by his magnificent Present, which were more princely refused, than offered. » Si Holles fut inhumé à Westminster, le monument funéraire fut érigé dans l’église Saint Peter de Dorchester, dans le comté d’Oxford : voir à ce sujet l’Oxford Dictionary of National Biography, art. « Holles ». Pour ce qui est du désintéressement de Holles, cf. aussi supra note 40.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 12 -
nous avons affaire à un personnage malcommode, vétilleux, n’ayant pas froid aux yeux. Pourtant, quand on juge ce tempérament comme on doit le juger, c’est-à-dire à l’aune de ses pairs, les autres diplomates de l’époque, l’on s’aperçoit qu’il ne détonne pas du tout. Du côté des ambassadeurs français contemporains, il suffit de citer les noms de Créqui à Rome ou de d’Estrades en Angleterre, qui ont créé une agitation autrement plus considérable sur des points de préséance. L’historien et diplomate Jules Jusserand avait trouvé une formule qui sonne très juste pour décrire ce type d’hommes dont l’armure affleurait sous les dentelles, et que nous ne croisons plus guère aujourd’hui, mais qui étaient fréquents jadis dans certains milieux : c’était des hommes qui, lorsqu’ils se tenaient droit, se tenaient fort roide, et quand ils s’inclinaient, s’inclinaient fort bas44. Du côté des ambassadeurs anglais de l’époque, on trouve aussi des exemples bien plus excessifs, pour peu qu’on y songe : Sir George Downing à La Haye, que nous avons croisé tout à l’heure, avait, non sans raisons, la réputation d’un boutefeu. Trumbull, à l’époque de la révocation de l’édit de Nantes, eut des discours et une conduite particulièrement désagréables au gré de Louis XIV45. Goodrick, qui fut en poste à Madrid vers la fin des années 1670, défraya la chronique pour un autre motif : il se lança dans le prosélytisme protestant, au point de déclencher des émeutes46. L’on ne poursuivra pas davantage cette litanie. Pour un peu, Holles apparaîtrait presque comme mesuré.
Une dernière façon, enfin, de le considérer à l’aune de ses collègues, c’est aussi de
chercher les témoignages que ceux-ci ont pu nous laisser de lui pendant son séjour à Paris. L’on perçoit alors rapidement que si le Britannique était persona non grata à la Cour, il n’était pas pour autant un pestiféré, et sa résidence n’avait rien d’un camp retranché47. Nous avons en particulier un témoignage précieux, celui de l’ambassadeur de Venise, Alvise Sagredo : les deux hommes semblent s’être tout de suite appréciés et se sont fait maintes confidences. Sagredo, dans ses dépêches, relate sans cesse ses visites chez Holles, ou celles que lui rendent l’ambassadeur d’Angleterre et son épouse. Holles lui-même écrivit un jour à une de ses relations, au sujet de Sagredo, qu’il était tout à fait son ami, et qu’il le trouvait « très anglais »48. On ne pouvait certainement trouver adjectif plus flatteur sous sa plume. Mais la sympathie semble avoir été tout à fait réciproque chez Sagredo, qui n’hésita pas à présenter Holles en ces termes au Sénat :
Ce gentilhomme, qui est sur le second versant de son âge, en plus de sa naissance, de sa fortune et des très nobles relations qu’il possède à Londres, jouit de la réputation d’être l’un des cavaliers les plus sages et les plus écoutés, y compris dans les conseils de cette cour [d’Angleterre]49. (4 sept. 1663.)
Ainsi peu à peu, à mesure que l’on prend quelque recul, Holles n’apparaît plus tant comme le diplomate farfelu qu’on avait cru. Et ceci ouvre le chemin pour considérer, à présent, une autre personnalité, celle de Charles II50.
Ce dernier avait sans doute bien des défauts, mais il avait au moins une qualité royale, que
tous ses biographes lui reconnaissent, en plus de ses capacités de dissimulation : c’était un excellent connaisseur de la nature humaine, et il savait choisir avec soin ses serviteurs en fonction de ses desseins. Si bien qu’en définitive, on doit cesser de considérer Holles comme un simple
43 Outre les ouvrages cités supra note 8, je renvoie à mon étude, « Un ours à la cour de Louis XIV ? ». 44 J. JUSSERAND, A French ambassador at the Court of Charles II, Le Comte de Comenges, from his Unpublished Correspondence, New York, 1892, p. 15 à propos de Comenges : “when he bowed, he bowed very low, and according to rule; when he stood, he stood very stiff: men of this sort — a somewhat rare sort now — were then numerous; they wore ribbons on their cuirasses.” 45 Sur Trumbull cf. C. PASCAL, « Un ambassadeur désagréable à la cour de Louis XIV », Bulletin Historique et Littéraire de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, nos4, 5 et 6, pp. 169-82, 271-77 et 81-97 (avril, mai et juin 1894). 46 Le cas a été étudié récemment par Stéphane JETTOT. 47 Cf. e.g. Dr. Ed. BROWNE dans son Journal of a Visit to Paris in the Year 1664, Londres, 1923 : p. 9, bien reçu à l’ambassade d’Angleterre à Paris ; p. 34, rencontrant Holles lors d’une soutenance de thèse en Sorbonne. 48 Holles à Fanshaw, le 16 oct. 1664 : “The Venetian Ambassador here (who is much an Englishman)...” in Sir R. FANSHAW, op. cit. supra note 26, p. 274. 49 C.S.P. Venice, vol. 33, p. 261, dépêche d’Alvise Sagredo au doge et au sénat, en date du 4 sept. 1663, résumée ainsi : “This gentleman, who is on the side of advanced years, besides his birth, fortune and most noble connections which he has in London, enjoys the reputation of being one of the wisest and most accredited cavaliers, as well in the counsels at that Court when in the late troubles he proved himself on the royal side, not only generous but unchangeable in undertaking service later in foreign wars.” 50 On peut consulter la biographie de J. MILLER, Charles II, Londres, 1991.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 13 -
maladroit, mais plutôt comme un choix, un choix qui en lui-même pourrait bien être révélateur. Car certes, Charles II n’a guère laissé de confidences sur ses pensées profondes, mais cela n’interdit pas de formuler des hypothèses, et quand l’on veut bien y réfléchir un instant, l’on s’aperçoit que l’envoi de Holles n’a rien d’illogique : à condition par exemple de tenir compte de certaines divisions internes, d’une part, déchirant la politique britannique, et d’autre part de malentendus externes, se développant entre Londres et Paris. 2/ Divisions dans la politique britannique
En ce début des années 1660, le microcosme politique britannique peut être décrit comme partagé entre plusieurs factions. On distinguera ainsi en premier lieu une coterie dite « francophile »51 : l’expression désigne un petit groupe, qui réside d’ailleurs essentiellement en France, et qui a gravité longtemps autour de la reine-mère Henriette-Marie, la veuve de Charles Ier. S’y rencontre d’abord une sorte de factotum, peut-être un amant, voire un époux morganatique, le comte de Saint-Albans : celui-ci campe un personnage d’abord très sympathique, excellent courtisan, et totalement acculturé français. On y croise aussi l’inévitable aumônier, un Abbé Walter Montagu, qui comme l’indique son patronyme est le rejeton d’un grand lignage aristocratique de l’Angleterre, celui des Sandwich. Passons sur les autres personnages qui gravitent autour de ce noyau, mais n’ayons garde de négliger Madame, qui s’y rattache largement, et en est au fond l’héritière, on l’oublie souvent52. Tous les membres de cette cabale sont catholiques, partisans avoués de l’absolutisme en Angleterre, partisans aussi d’une alliance inconditionnelle avec la France. Depuis le temps qu’ils vivent sur le continent, ils ont leurs réseaux, leurs grandes et petites entrées à la cour, où on les goûte particulièrement. Saint-Albans par exemple sera employé plusieurs fois, de manière épisodique, comme ambassadeur, quand l’Angleterre aura besoin de s’assurer de relations particulièrement cordiales avec la France, et il a déjà servi comme tel à une occasion : c’est lui que Charles II a dépêché pour le mariage de Madame. Mais les Français, tant ils sont habitués au « Milord Germain », comme ils l’appellent, en viennent un peu à oublier qu’il ne représente presque rien de l’Angleterre53. Quant à Charles II, il a bien des raisons de se méfier de lui et de la coterie des francophiles dans son ensemble : ils risquent de brader ses intérêts, en tout cas de créer des remous dans l’opinion publique de son royaume, toujours sourcilleuse, au pire de braquer le Parlement. Ainsi, d’une certaine manière, Holles est l’antidote à Saint-Albans : Charles II sait que le vieux leader parlementaire ne se laissera pas corrompre par les sirènes de la cour de Louis XIV et veillera scrupuleusement à ses intérêts ; et comme Holles est très influent et respecté aux Communes de Westminster, on peut parier qu’il ne causera pas de problèmes de ce côté-là non plus. En revanche, il est très vraisemblable que Henriette-Marie, Saint-Albans, l’Abbé Walter Montagu et même Madame, eurent des raisons de se sentir un peu floués par le choix de Holles, et partant ne lui ont pas forcément rendu que des services54.
Par opposition, pour désigner une autre coterie, plutôt basée à Whitehall celle-là, il serait
alors tentant de parler d’une cabale « hispanophile »55, mais à cette époque en Angleterre, force est de reconnaître que c’est l’opinion publique en général, par passion plus que par raison, qui est traditionnellement hispanophile ; c’est là l’un des corollaires de la francophobie invétérée du peuple de ce pays. Pour être plus juste nous parlerons donc tout simplement de la coterie
51 Sur cette coterie « francophile », cf. Sir K. FEILING, op. cit. supra note 6, p. 29-31. 52 Cf. au sujet de Madame ce mot de Sir K. FEILING, ibid., p. 56 : “This rare picture could not easily be fitted into an English frame”. 53 Saint-Albans a pour patronyme Jermyn, d’où son surnom francisé de « milord Germain ». 54 Cf. e.g. N.A., S.P. 78, vol. 117, ff. 129-130, Holles à Arlington, le 15/25 août 1663 : “I am very much beholding to the Abbot [Montagu], for his very greate care & readiness to help me in every thing, which I am sure is in relation to my employment & to the King service, not so much for my particular.” 55 Sir K. FEILING, op. cit. supra note 6, p. 32.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 14 -
d’Arlington, le secrétaire d’Etat56. Celui-ci était partisan d’une politique complexe : sans beaucoup s’avancer, peut-être s’approchera-t-on de la vérité en suggérant que ce qui comptait pour lui était de sortir d’une dépendance trop excessive à l’égard de la France, ce qui supposait un rapprochement avec l’Espagne. Mais dans le même temps ce rapprochement devait être nuancé, afin de ne pas braquer les Français, et parce que l’Espagne demeurait dans une trop grande position de faiblesse pour être une alliée sure. Tout ceci donne une politique ondoyante, opportuniste, où il est difficile de voir clair dans les desseins à long terme. Toujours est-il qu’Arlington passait pour très pro-espagnol, depuis une longue ambassade à Madrid qu’il avait assumée pour le compte de Charles II, à la fin du protectorat de Cromwell ; et il est vrai qu’à cette époque-là le roi proscrit parvenait à vivoter grâce à l’argent de Philippe IV. Pour en revenir à Holles, on s’aperçoit donc qu’il est non seulement l’antidote à Saint-Albans, mais aussi à Arlington. Or justement, surprise supplémentaire, à examiner les sources avec soin il semble bien qu’avant que le choix royal ne se fixât définitivement sur Holles, c’est au contraire Arlington qui avait été pressenti par Charles II pour se rendre à la cour de France ! La preuve en est, ou du moins un indice sérieux, que sitôt que Louis XIV eut vent de cette rumeur du choix d’Arlington « l’Espagnol » pour se rendre auprès de lui, il dépêcha ses instructions à son ambassadeur à Londres (à cette époque le comte d’Estrades), afin d’empêcher à tout prix cette nomination :
Commencez à faire tous vos offices auprès du Chancelier, & s'il est nécessaire auprès du Roi, pour empêcher que le Chevalier Benet [alias Arlington] ne succède au Comte de Saint Alban en l'Ambassade auprès de moi. Je sçai bien que je n'ai pas droit d'exiger du Roi mon Frère, qu'il jette les yeux plutôt sur une personne que sur une autre pour cet Emploi ; celui qui le remplira doit être de son choix, & non pas du mien ; mais comme je ne voudrois pas lui envoyer un Ambassadeur qu'il m'eût témoigné lui être suspect, je crois qu'il me voudra bien traiter de même, & d'autant plus qu'il n'ignore pas les raisons que j'ai de ne pouvoir pas prendre confiance audit Chevalier Benet ; [...] outre son long séjour en Espagne, & les gratifications extraordinaires qu'il y reçut à son départ57. (12 février 1662.)
Ironie du sort, c’est donc peut-être pour complaire à Louis XIV que le choix du souple Arlington fut écarté au profit du roide Holles. Mais, si tel est le cas, le ton volontiers aigre-doux de la correspondance entre l’ambassadeur et son secrétaire d’Etat, qui a pu étonner tout à l’heure, apparaît sous un nouveau jour : il y avait une sorte de contentieux entre eux. Peut-être même Arlington laissait-il sciemment Holles dans le noir pour le pousser à la faute58. Il reste enfin à évoquer une dernière coterie, qui est celle à laquelle se rattache Holles lui-même. Elle est menée par le chancelier Clarendon59, qui, en ce début des années 1660, joue le rôle de Premier ministre, mais se trouve progressivement en perte de vitesse par rapport à Arlington. Elle rassemble une poignée de personnes qui sont des partisans d’une alliance résolue avec la France, mais d’une alliance de raison60. Leur position prend acte de l’affaissement irrémédiable de l’Espagne, de la nécessité d’une alliée contre l’essor de la puissance hollandaise, et du danger qu’il
56 Sur Arlington, l’ouvrage de référence reste V. BARBOUR, Henry Bennet, Earl of Arlington, Secretary of State to Charles II, Oxford, 1914. Voir aussi R. HUTTON, “The Making of the Secrret Treaty of Dover”, The Historical Journal, vol. 29, n°2 (1986), pp. 297-318, et plus anciennement Maurice D. LEE Jr., “The Earl of Arlington and the Treaty of Dover”, The Journal of British Studies, vol. 1, n°1 (1961), pp. 58-70. 57 Comte G. d’ESTRADES, Lettres, mémoires et négociations de M. le Comte d'Estrades, Londres, 1743, vol. I, p. 237 : Louis XIV à Estrades , Paris, 12 février 1662. 58 Voir supra p. 4. 59 Sur Clarendon, l’ouvrage de référence reste T. H. LISTER, Life and Administration of Edward, first Earl of Clarendon ; with Original Correspondence, and Authentic Papers never before Published, Londres, 1837-1838, 3 vol. 60 Dès l’époque, Holles n’a pas toujours été perçu comme un proche de Clarendon et un partisan de l’alliance anglo-française, ce qu’il était pourtant assurément. Comme il retardait son retour en Angleterre dans les premiers mois de 1666, et que Louis XIV s’apprêtait peut-être à l’expulser du sol français, Turenne n’hésita pas à intervenir pour le lui rappeler. Voir à ce sujet C.-G. PICAVET, Documents biographiques sur Turenne (1611-1675), 1914, p. 117-118, billet de Turenne à Lionne, daté « ce jeudi matin », année 1666 : « Vous vous souvenez bien que, quand on parla devant le Roi de l'ambassadeur d'Angleterre, qu'il témoigna du chagrin de quoi il débauchoit des Irlandais, et il me semble qu'il dit qu'il lui avait fait dire de se retirer ; je pense que Sa Majesté ne trouverait pas mauvais que l'on lui dit que cela changerait présentement la pensée qu'il a eue, et que cela tournerait l'esprit à cet homme, qui agirait fort bien et plus dans la pensée du chancelier que dans celle de Bennet. Turenne. » Cf. P. CRAWFORD, in op. cit. supra note 8, qui remarque p. 107 que Charles II “thought him well affected to the proposed alliance between England and France”. Cf. aussi D’ESTRADES, op. cit. supra note 57, vol. I, p. 263, d’Estrades à Louis XIV, fin février 1663 : « Tout ce que j'ai pû faire en négociant sous main avec le Chancelier, a été de donner l'exclusion à Bennet sur l'Ambassade de France, & de le porter à faire un choix qui ne fût pas suspect à Votre Majesté. Le Roi me déclara dans cette audience, qu'il avoit jeté les yeux pour cela sur Mylord Holis, qui est tenu dans cette Cour pour n'être d'aucune cabale que de celle du Chancelier, & nullement attaché aux intérêts de l'Espagne : il me témoigna qu'il avoit en lui la dernière confiance, & qu'il prioit Vôtre Majesté de l'y prendre toute entière. » Cf. ibid., p. 271, d’Estrades à Louis XIV, le 6 mars 1662 : « [Holles] est tout-à-fait ami du Chancelier, & le Roi d'Angleterre prend en lui une entière confiance. »
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 15 -
y aurait à laisser les liens se dégrader avec Louis XIV, qui pourrait facilement renouveler ses contacts avec d’anciens réseaux cromwelliens ou contestataires et aider à la déstabilisation de la monarchie encore fragile. D’un autre côté, si alliance française il doit y avoir selon eux, il ne faut pas qu’elle se réduise à une vassalisation : cette entente doit défendre les intérêts commerciaux anglais et ne pas porter ombrage à la restauration du prestige royal. Tout cela forme un programme qui a sa logique, mais difficile à mener, et qui, au fond, n’est pas totalement étranger non plus au développement de tensions entre Paris et Londres.
3/ Malentendus franco-anglais
Il faut convenir d’abord que dans la présentation que nous avons faite plus haut de l’état des relations anglo-françaises en 1663, en nous en tenant à des signes bien visibles, nous avons quelque peu simplifié la réalité, en étant trop superficiel61. Certes, rarement l’entente paraît avoir été aussi bonne qu’à cette date, mais cela tient pour beaucoup à la faiblesse de l’Angleterre jusqu’ici, et à des arrangements qui ne se reproduiront plus, comme celui de Dunkerque, où Charles II était allé à l’extrême limite de ce que pouvait tolérer son opinion publique.
En fait, il y avait bien volonté d’alliance plus étroite de part et d’autre, mais elle était
fondée sur de grands malentendus, des objectifs divergents (et cela sans compter diverses frictions coloniales ou périphériques) : d’une part, si l’Angleterre cherche plus que jamais une alliance plus étroite avec la France, c’est aussi on l’a dit au détriment de la Hollande, or au contraire la France veut la paix entre ses deux alliés anglais et hollandais ; d’autre part, le pouvoir français souhaite des accords plus poussés avec Londres pour des raisons commerciales. C’est là en effet qu’il faut rappeler que cette époque voit aussi se déployer les grands efforts de Colbert, la France essaie de se développer comme puissance négociante, elle recherche des débouchés à l’étranger, la baisse des droits qui entravent la pénétration de ses produits et de ses marchands dans les autres pays. Mais l’Etat anglais, déjà financièrement aux abois, n’est pas le moins du monde prêt à entrer dans ce jeu, et en outre les Britanniques protestent que la France a déjà beaucoup obtenu du temps de Cromwell, un usurpateur. Dans ces conditions les négociations ne sauraient que languir, et c’est ce qu’on observe en fait, depuis la fin 1662 et le rachat de Dunkerque, et même dès avant.
L’on remarque mieux encore : puisque les négociations languissent, de manière tout à fait
symptomatique ce sont les problèmes de préséance et de personne qui passent sur le devant de la scène. Ainsi, dès la fin 1661 le maréchal d’Estrades, en poste à Londres, en était venu à des revendications agressives, totalement contraires à l’atmosphère de bonne entente qui aurait dû prévaloir. Qu’est-ce à dire ? Il avait réclamé que le roi d’Angleterre se démît désormais du titre de roi de France, auquel il prétendait toujours, depuis la guerre de Cent Ans, dans sa titulature officielle. Il avait aussi revendiqué que dorénavant sur mer les Anglais saluent le pavillon français les premiers, et non plus l’inverse62. Que penser de ces exigences ? En quelque sorte, les cérémonies semblent être devenues un lieu de compensation par rapport à des négociations qui n’avançaient plus, et un lieu de test par la même occasion : on verrait bien ainsi la bonne ou mauvaise volonté de la monarchie anglaise à l’égard de la France, et sa faiblesse ou sa force. Mais le jeu était dangereux, dans la mesure où ces matières étaient particulièrement odieuses à Charles II et ses sujets. A la suite de d’Estrades arriva un autre ambassadeur français, le comte de Comenges, qui ne monta sans doute plus sur de si grands chevaux, mais avec qui au final les relations ne s’avérèrent pas meilleures. Charles II ne manqua d’ailleurs pas d’exprimer à Madame son déplaisir à l’égard de ce nouveau-venu. Il est assez curieux de le constater par exemple dans la lettre où précisément il lui annonce l’envoi prochain de Holles :
61 Voir supra p. 2. 62 Sur ces questions voir e.g. Sir K. FEILING, op. cit. supra note 6, p. 67.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 16 -
J’espère qu’avant cette lettre vous avez pleinement satisfait le roi mon frère en lui exposant la sincérité de mon désire de conclure une étroite alliance avec lui, mais je dois en user librement avec vous, en vous apprenant que je ne pense pas que son ambassadeur ici, Monsieur de Cominges, soit vraiment très entreprenant dans l’affaire. Je ne puis dire les raisons qui le rendent ainsi, mais il soulève à toutes les occasions tant de difficultés que je n’ai d’autre choix que de conclure que nous ne pourrons pas beaucoup avancer dans cette matière avec lui, c’est pourquoi je hâte le départ de Mylord Holles avec toute la diligence possible, afin de faire voir au roi mon frère qu’il n’y aura point de retard de mon côté à conclure cette amitié pleine et entière que je désire tant ; ma femme m’envoie juste chercher pour aller danser, aussi je dois terminer et ne puis qu’ajouter que je suis etc63. (11 mai 1663.)
Quand on aura lu et relu cette lettre, le ton badin, les protestations d’amitié et de bonne volonté n’interdiront peut-être pas de penser, avec quelque vraisemblance, qu’en choisissant Lord Holles Charles II savait qu’il confiait les négociations à un vrai partisan de l’alliance française sans doute, mais aussi à un homme qui serait de taille à le défendre sur le terrain des préséances, voire qui saurait rendre à Louis XIV la monnaie de sa pièce. D’ailleurs les instructions remises à Holles faisaient au moins une allusion aux récentes tensions :
Concernant [le fait d’ôter le titre de roi de France de notre titulature], vous exprimerez un déplaisir à la mesure d’une chose dont vous ne pouvez entendre parler et d’une chose que vous ne pouvez imaginer nous être un jour ôtée64.
Cela dit, on protestera encore que Holles a largement outrepassé ses ordres en déclenchant une querelle inédite et intempestive avec les princes du sang. Voilà justement ce qu’il nous reste à examiner maintenant. Car si l’on confronte diverses sources avec soin, l’on s’aperçoit qu’en ce début des années 1660, les préséances en matière de carrosses constituent une étrange préoccupation, au point que l’idée viendrait, pour un peu, d’évoquer une sorte de guerre, par carrosses interposés.
III – Un contexte large : une autre guerre louis-quatorzienne
Au seuil de cette dernière partie de notre propos, il convient de se garder de deux tentations. La première consisterait à réduire les faits que nous avons décrits à des exceptions : nous avons pu croire en effet les querelles de Holles isolées, originales, presque uniques en leur genre. En menant cette petite enquête, il m’a semblé que tel n’était pas du tout le cas, et la suite le montrera. Mais à l’inverse, il ne faudrait pas non plus banaliser ces affaires. Je veux dire par là qu’il est bien entendu qu’à l’époque moderne les conflits de préséance étaient monnaie courante, sur les carrosses comme sur le reste. De plus, il est bien certain que des conflits d’ordre parmi les États dans les cortèges des entrées des ambassadeurs surgissaient régulièrement, avec plus ou moins de fréquence et de virulence. Mais c’était le lot en particulier des puissances secondaires de l’échiquier européen : Gênes, Florence, Malte… Parmi les puissances de premier rang, les conflits de ce type semblent avoir été beaucoup plus sporadiques, limités65. Or au contraire, ce qui frappe en cette décennie 1660 c’est leur concentration et leur importance. Dans l’état actuel des investigations, je distinguerais au moins six épisodes principaux, et plusieurs autres mineurs, qui font autant d’affrontements, de victoires, et de défaites, au fur et à mesure desquelles se dessine 63 M.A.E., Mém. et Doc., Angleterre, vol. 26 (Lettres de Charles II à Madame), ff. 39-40, Charles II à Madame, le 11 mai 1663 : “I hope you have, before this, fully satisfied the King my brother of the sincerity of my desire to make a strict alliance with him, but I must deal freely with you, in telling you that I do not think his ambassador heere, Monsieur de Comminges is very forward in the businesse. I cannot tell the reasons which make him so, but he findes upon all occasions, so many difficultyes, as I cannot chuse but conclude, that we shall not be able to advance much in the matter with him, therefore I am hastening away my Lord Holles with all possible speede, to let the King my brother see that there shall nothing rest, on my parte, to the finishing that entier friendship I so much desire ; my wife sends for me just now to dance so I must end, and can only add that I am entirely yours.” 64 N.A., S.P. 78, vol. 117, f° 105 v° : “[si l’on voulait ôter] yt title Out of Our Stile, [...] you will express such a dislike, as of a thing you cannot hear, & as a thing, wch. you cannot imagin can ever be moved to Us.” 65 Sur ce point je puis cependant me tromper : c’est le sentiment que j’ai acquis, il faudrait étendre assez largement les recherches pour s’en assurer. Les conflits entre les puissances mineures étaient en tout cas fréquents, et le roi d’Espagne se servit précisément de cet argument lorsqu’il tenta d’interdire les cortèges des ambassadeurs en juin 1664 (sans succès comme l’on verra infra p. 21). Cf. e.g. M.A.E., Corr. pol., Espagne, supplément, vol. 6, f°263, Don Blasco de Loyola à Embrun, juillet 1664 : « Haviendo tenido por conveniente, y necesario ocurrir con tiempo a evitar qualquier embararo que en su Real Corte se pueda offrecer en orden a las pretensiones de precedencia que tienen los embasadores de Polonia, y Dinamarca, los de Florençia, Genova, y Malta, tubo Su Mgd por bien de haçer la prevencion General que ha hecho de su parte. »
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 17 -
un conflit à rebondissements, impliquant les principaux Etats d’Europe occidentale. Il ne s’agit pas ici de narrer ce conflit dans le détail, simplement d’en rendre compte d’une manière globale, et de montrer comment les mésaventures de Holles s’y insérèrent. A cette fin, le mieux m’a semblé de reprendre tour à tour brièvement les six épisodes majeurs retenus pour l’instant, en nous attardant davantage simplement sur les derniers. Car, nous le verrons, bien que ceux-ci demeurent peu connus et de prime abord totalement étrangers aux déboires de Holles à Paris, il s’inscrivent en réalité dans leur sillage.
Le premier acte de notre « guerre des carrosses », jusqu’à plus ample informé, serait à
situer à Madrid, durant l’été 1661. Il se trouve que l’ambassadeur de France nouvellement arrivé sur place — à cette époque un prélat de choc, Georges d’Aubusson de La Feuillade, archevêque d’Embrun — réussit un véritable petit coup de force. Alors que traditionnellement les cérémonies étaient très réduites dans la capitale espagnole66, où pour ainsi dire il ne se pratiquait rien de comparable à une grande entrée à la française, mais seulement un vague défilé à travers les rues de la ville pour la première audience au palais, il parvint à obtenir une véritable entrée solennelle. Sur ses instances, un carrosse du roi lui fut envoyé dans une petite localité sise à quelques lieues au nord de la ville, et on ne s’opposa pas à ce qu’il conviât les autres ambassadeurs à l’accompagner. Comme le remarque l’historien Morel-Fatio, à la suite de Louis XIV lui-même : « On dérogeait à la coutume et [l’archevêque d’Embrun] fut reçu à Madrid avec des honneurs qui n’avaient jamais été rendus même au nonce ou au ministre de l’Empereur67. » Triomphe français donc. Mais ce succès ne s’explique que par l’extrême faiblesse de l’Espagne, toujours sous le choc de la paix des Pyrénées et engluée dans la guerre portugaise, et bien des « patriotes » castillans pouvaient s’en désoler. Il y a même fort a parier que leur orgueil national piqué se devait de trouver une revanche. Dans ces conditions, la survenue rapide d’un nouvel incident ne paraîtra peut-être pas si fortuite.
66 A. de WICQUEFORT précise, in op. cit. supra note 22, I, p. 199 : « On n’en fait pas trop [i.e. de cérémonies pour l’arrivée d’un ambassadeur nouveau] en Espagne présentement ; et c’est là où l’on en faisoit le plus autrefois. » La suite de son propos, par les exemples cités, montre qu’il entend par « autrefois » une époque antérieure à Charles Quint. Il ajoute d’ailleurs quelques pages plus loin dans un contexte légèrement différent : « [Les] occasions extraordinaires ne font point de regle : particulierement en Espagne, où on ne change pas facilement les anciennes coustumes qui y sont establies depuis le regne de Charles V. » (vol. I, p. 201.) Voir aussi les paroles de Philippe IV, d’après le témoignage de Lady Fanshaw, citées infra note 80. Cf. enfin M.A.E., Corr. pol., Espagne, vol. 39, f°301 r° et v° pour un témoignage de provenance hollandaise daté de 1660, et Bodleian Library, ms. Eng. Lett. c. 328 (papiers de Francis Parry, représentant anglais au Portugal), ff. 227-228 pour un document intitulé « Advertencias y estilo que tienen los Embaxadores que vienen a espana con forme sea estilado asta estos anos de [16]66 », qui semble témoigner d’une évolution vers davantage de cérémonies, au milieu des années 1660. 67 A. MOREL-FATIO, Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française, Espagne, t. 1, p. 164. Cf. M.A.E., Corr. pol., Espagne, vol. 41, f°46 r° et v°, Louis XIV à l’archevêque d’Embrun, le 31 août 1661 : « J'ay esté bien aise d'apprendre […] les honneurs qui ont estés rendus à vostre caractère dans toute l'Espagne, et qu'à vostre entrée et reception dans Madrid ils ayent encore esté augmentez bien au dela de tout ce qui avoit jamais esté pratiqué pour aucun Nonce du Pape ou Ambr. de l'Empereur ; en quoi je recognois que le Roy mon frere a voulu m'obliger, me distinguant de tous les autres Potentats. » Voir aussi le récit glorieux de cette journée donné dans la Gazette de France, 1661, n°117 : « Le 5 de ce mois [de septembre 1661], l'Archévesque d'Ambrun Ambassadeur de France, fut conduit à son Audiance publique, avec beaucoup de magnificence et de cérémonie. L'un des Major-Domes du Roy, avec l'Introducteur des Ambassadeurs, & vingt Gentils hommes, l'alla prendre en son logis : & lui ayant présenté trente chevaux de l'Escurie de Sa Majesté pour sa Personne & pour sa Suite, à cause que cette première marche au palais, se fait en forme de Cavalcate, par les Ambassadeurs, suivant la coûtume de cette Cour, il lui présenta aussi un carrosse de Sadite Majesté, pour le conduire & le r'amener qui est un honneur particulier qu'Elle lui voulut faire. Estant donc, monté, en Camail & Rocher, sur un cheval couvert d'une housse de velous noir, il marcha à la droite du Major-Dome, précédé de la Maison du Roy & de ses domestiques, avec plus de cent Gentilshommes François, lestement vestus & montez, & environné de 8 Pages & 16 Estafiers, dans la plus magnifique livrée qui se soit encor vüe ici, en pareille occasion. Le carosse de Sadite Majesté venoit apres, avec trois de l'Ambassadeur : le premier, à l'Espagnole, de velous en broderie, enrichi par le dehors, de plaques dorées, & l'Impériale garnie de pommes & bouquets pareillement dorez : le second à la Françoise, l'un & l'autre tirez par de forts beaux chevaux gris pommelez : & le troisième, de campagne, encor, à l'Espagnole, attelé des plus belles mules du Païs. Ils estoyent suivis de plusieurs autres carosses des Ambassadeurs qui sont ici, & d'une foule prodigieuse de Peuple, qui remplissoit les rües, les fenestres & les balcons : tesmoignant une joie extraordinaire de voir un Ambassadeur de France, pour la confirmation de cette charmante Paix, qui réünit les deux premières Couronnes d'Europe. »
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 18 -
Carte sommaire des incidents notables
impliquant des diplomates et leurs carrosses,
vers le début des années 166068.
C’est alors, à l’automne 1661, qu’il nous faut justement passer au deuxième épisode que nous avons cru distinguer : rien moins que le heurt — la « bagarre » selon le mot de Brienne le Jeune — qui opposa le comte d’Estrades et le baron de Watteville à Londres69. De toutes ces affaires de carrosses, c’est la seule restée célèbre. De quoi s’agissait-il déjà ? Rappelons-le en quelques mots. L’occasion de la querelle fut fournie par l’entrée solennelle de l’ambassadeur de Suède : le Français et l’Espagnol se disputèrent aussitôt au sujet de l’escorte, à qui ferait passer son carrosse le premier. D’Estrades, il est vrai, avait conseillé la prudence à Louis XIV, et Charles II avait favorisé les expédients. Mais le roi de France, tout à son désir d’affirmer sa gloire, avait insisté pour que son ambassadeur menât la lutte jusqu’au bout. Le résultat en est bien
68 Nous nous proposons de compléter cette carte et de l’expliciter, notamment en ce qui concernent les « autres incidents ou tensions signalés », dans des travaux ultérieurs. 69 F. BARRIÈRES (éd.), Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, secrétaire d'Etat sous Louis XIV, publiés sur les manuscrits autographes, Paris, 1828, vol. II, pp. 220-223. Sur cette « bagarre » de Londres, les témoignages ne manquent pas. On consultera entre autres les Mémoires de LOUIS XIV, la Correspondance du comte D’ESTRADES (op. cit. supra note 57), le Journal de PEPYS, le compte-rendu commandé par le roi Charles II à J. EVELYN, et délivré à Sir Joseph Williamson (résumé in C.S.P.D. Charles II, 1661-1662, p. 105), le témoignage des diplomates vénitiens (C.S.P. Venice, vol. 33, notamment pp. 24, et 54-55). Voir aussi l’article de L. LEMAIRE, « L’ambassade du comte d’Estrades à Londres en 1661. L’affaire ‘‘du pas’’ », Annuaire-bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1934, pp. 181-226. En toile de fond du conflit franco-espagnol sur les préséances, se déroulaient aussi de grandes manœuvres pour le mariage futur de Charles II, à l’issue desquelles la candidature de l’infante de Portugal, supportée par la France, l’emporta, au détriment de l’Espagne. La personnalité de Watteville joua enfin un rôle certain.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 19 -
connu : une bataille sur les quais de la Tamise avec, à l’issue, une défaite ignominieuse pour les Français, et le carrosse espagnol qui s’engouffre derrière le Suédois sous les vivats de la foule... Cependant Louis XIV, en menaçant Philippe IV de représailles, transforma cette déconfiture sur le terrain en succès diplomatique. Ainsi aboutit-on au printemps suivant, le 24 mars 1662, à la fameuse audience des excuses d’Espagne. On insiste d’habitude sur la gloire engrangée par Louis XIV à cette occasion. Mais l’on oublie souvent deux choses : d’abord qu’un tel désordre dans sa capitale ne pouvait guère avoir été goûté par Charles II, et peut-être même le roi d’Angleterre en conçut-il dans le secret de son cœur un profond ressentiment, il ne tarda pas en tout cas à interdire dorénavant aux ambassadeurs d’envoyer leurs carrosses pour toute entrée à venir70 ; ensuite que Watteville eut toujours beau jeu de pouvoir se vanter d’avoir obtenu cette interdiction. De retour à Madrid, il ne manqua pas de faire tinter cette musique aux oreilles de qui voulait l’entendre. Et l’archevêque d’Embrun, ambassadeur de France en Espagne, ne put que s’en faire l’écho dans ses dépêches :
Batteville m’a dit qu’il croyoit avoir plus servy son Maistre en [cet ordre] qui fut donné en Angleterre, qu’en l’avantage qu’il obtint dans l’action par l’effet de l’adresse et de la bonne fortune : car comme il ne pretendoit que l’egalité, il mit les affaires en estat qu’il n’y avoit point moyen de prendre sa revanche71. (7 mai 1664.)
Le triomphe de Louis XIV n’était donc pas si complet qu’il y paraissait. Ceci ne fut pas sans conséquence. On le constate dès la venue de l’ambassadeur qui succède à d’Estrades à Londres, un homme que nous avons déjà évoqué, particulièrement désagréable à Charles II, le comte de Comenges72.
Celui-ci arrive dans la capitale britannique au tout début de 1663. A vrai dire, pour ce
troisième épisode, il est difficile de parler de véritable incident, dans la mesure où il n’y eut pas d’éclat. Parlons plutôt de tension ou de guerre d’usure. Car il fut très laborieux de trouver un accord pour organiser l’entrée. Charles II n’en démordait pas de sa décision d’interdire la présence des ambassadeurs tiers dans les cortèges, et Louis XIV cachait mal son mécontentement de ne pouvoir déployer à la face du monde son droit de préséance. Circonstance aggravante, en janvier de la même année une ambassade moscovite fut justement accueillie à Londres avec des honneurs extraordinaires, ce qui faisait craindre à Comenges que la comparaison ne serait pas à son avantage73. En mars, l’entrée n’avait toujours pas eu lieu, mais Louis XIV, tournant ses pensées vers la postérité, se cramponnait à un dernier espoir :
Comme nous sommes tous mortels, et que peut être, de soixante ans, le cas n’arrivera, je serai bien aise de laisser au Dauphin cette marque qu’il pût faire voir de la justice et de la bonne volonté du Roi de la Grande Bretagne74. (14 mars 1663.)
A la fin pourtant, il lui fallut bien se résoudre à une cérémonie allégée75. On comprend donc que dès ce moment les relations franco-anglaises sont quelque peu empoisonnées par cette affaire, et le problème du cortège lors des entrées est devenu un point de fixation, un sujet de friction sensible entre les deux couronnes. Doit-on s’étonner alors qu’à Paris, un peu plus de six mois plus tard, Lord Holles se soit à son tour embourbé ? 70 C.S.P.D Charles II, 1661-1662, p. 104 : “Order by the King in Council, — on account of the great disorder and bloodshed caused by contests between the servants of certain foreign ambassadors for precedence, at the entry of the Swedish Ambassador into London, — that henceforth none but the coaches of His Majesty and his own subjects shall accompany any public minister at his reception or audience, and that the Lord Chambberlain signify this order accordingly.” 71 M.A.E., Corr. pol., Espagne, vol. 49, f°222, Embrun à Lionne, le 7 mai 1664. 72 Sur cet homme et son ambassade, voir Jean-Jules JUSSERAND, A French Ambassador at the Court of Charles II : le Comte de Comenges, from his Unpublished Correspondence, 1892. 73 Ibid., annexe, pièce n°23. Louis XIV à Comenges, le 21 janv. 1663 : « Pour ce qui est d’éviter, comme vous proposez une entrée publique dans Londres, je ne le puis approuver par diverses raisons, dont je ne vous marquerai que la principale, qui est que, si vous évitez cette cérémonie […] cet exemple s’introduira bientôt et bien facilement pour tous les autres ambassadeurs, et quand il y aurait à l’avenir un ambassadeur d’Espagne à Londres et que l’occasion de pareilles fonctions n’arriverait plus, je n’aurais plus les moyens de faire voir au public qu’il cède le rang au mien sans le contester et ne concourt plus avec lui, en exécution de l’accommodement qui a été fait entre moi et le Roi mon beau père sur l’insulte de Watteville. Quant à l’inconvénient que vous alléguez que votre entrée ne se pourra faire si honorablement que celle des Moscovites, je le tiens de nulle considération, eu égard à l’autre plus grand qui en arriverait, de ne pouvoir plus trouver d’occasion de faire abstenir des fonctions publiques les ambassadeurs d’Espagne. » 74 Ibid., annexe, pièce n°41, Louis XIV à Comenges, le 14 mars 1663. 75 Ibid., annexe, pièce n°60, Comenges à Lionne, 19 avril 1663. Cf. C.S.P. Venice, vol. 33, p. 244, Pietro Ricardo Neostad à Alvise Sagredo, le 16/26 avril 1663 : “Mons. di Comenges the French ambassador made his public entry on Saturday, accompanied by the Court coaches, those of the foreign ministers being excluded by the king's order, to avoid quarrels. On the Monday following he had private audience of his Majesty.”
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 20 -
Voici naturellement le quatrième tome de notre guerre rampante. Nous ne reviendrons
pas sur les déboires du Britannique face au « lobby » des princes du sang, sinon pour dire qu’ils passent en fait au second plan. Quand on lit en effet les correspondances diplomatiques avec attention, l’on finit par percevoir que le principal souci des dirigeants français n’était pas leur sort. Ainsi Hugues de Lionne l’avait écrit très clairement, au plus fort de la dispute, à un moment où l’on avait songé à dispenser Holles de toute entrée :
Outre que la suppression de cette cérémonie ferait perdre ici pour jamais une coutume qui est de quelque lustre dans les cours des princes, comme l’exemple en serait d’abord infailliblement suivi dans toutes les autres cours, il se trouverait enfin que cet expédient n’aurait abouti qu’à faire au roi [de France] l’un des plus grands préjudices qu’il puisse recevoir, qui serait de lui avoir ôté les moyens de prendre et de continuer la possession de la préséance que le roi d’Espagne lui a cédée76. (30 déc. 1663.)
D’où « l’espèce d’entrée » à laquelle on se résolut pour Holles à Saint-Germain77. Mais cette cérémonie avait à peine eu lieu qu’un nouvel incident était signalé à La Haye.
Ce cinquième épisode retenu nous projette au printemps 1664 dans la capitale des Provinces-Unies. Nous y retrouvons le comte d’Estrades, dans un nouveau poste. Par exception, il ne s’agit pas cette fois-ci d’une entrée, mais d’une querelle survenue sur une grande promenade, où les personnes de qualité se rendaient volontiers en carrosse. Toutefois il y avait un sens de parcours, et un côté de la promenade considéré comme plus prestigieux que l’autre. Un beau jour, le chemin du comte d’Estrades y croisa tout bonnement celui du jeune prince d’Orange, lequel refusa absolument de lui céder le passage. Le grand pensionnaire de Witt dut se transporter d’urgence sur les lieux, il fallut faire évacuer le prince, à pied, par une allée latérale, et cet exploit eut un retentissement certain sur la scène internationale78. Le roi d’Angleterre lui-même se sentit concerné au premier chef : il était oncle et tuteur du jeune prince orphelin. C’est à cette occasion qu’il écrivit à Madame, sa sœur, une lettre fort intéressante, car elle suggère que le lien existait évidemment dans son esprit entre toutes ces affaires de carrosses :
C’est une étrange chose qu’au moment même où les princes du sang en France ne veulent pas céder le pas à mon ambassadeur là-bas, que l’Ambassadeur de France à La Haye sorte de son chemin pour engager une dispute avec mon neveu. Je serais heureux de connaître votre opinion sur cette affaire, car elle vous concerne, à tous égards, autant que moi79. (19 mai 1664.)
76 Lionne à Comenges, le 30 déc. 1663, transcrit dans Fr. GUIZOT, op. cit. supra note 8, p. 31. 77 Il est du reste très possible que Charles II ait assigné comme objectif secret à Holles de tout faire pour amoindrir la cérémonie en France. J’ai développé cette hypothèse dans mon étude « Un ours à la cour de Louis XIV ? ». Elle repose notamment sur une dépêche de l’ambassadeur de Venise révélant une confidence que lui fit Holles tout au début de son ambassade : « Mé dyre il Signor Ambasciatore [Holles], come teneva ordine dal Re di non far publico ingresso, mentre in Londra per gli inconvenienti seguiti non voleva la Maesta Sua acconsentire che si facessero simili funtioni, nelle quali è inevitabile alecion sconcerto. » (B.N.F. (Richelieu), ms. italien 1856, f°2 : Sagredo au doge et au sénat, le 4 septembre 1663. Cf. transcription anglaise in C.S.P. Venice, vol. 33, pp. 261-262.) Dans cette perspective, la querelle avec les princes du sang, survenue après cette confidence, pourrait donc n’être qu’un prétexte saisi par Holles pour arriver à ses fins véritables. 78 Sur cette affaire voir D’ESTRADES, Correspondance, op. cit. supra note 57, t. II, passim et notamment pp. 429-430, dépêche de d’Estrades à Louis XIV du 8 mai 1664 : « Avant-hier après-midi revenant chez moi, je rencontrai Monsieur le Prince d'Orange tête pour tête ; & comme mes gens m'avertirent que son Cocher serroit la barriére pour tenir la place d'honneur qui est occupé en ce lieu, mon cocher, qui a ordre d'en user ainsi dans toutes rencontres, fit la même chose, je donnai ordre en même tems à tout ce qui accourut de mon logis, qui est proche de-là, & à tous mes amis qui me vinrent joindre, de ne venir à aucune action de main, pour éviter un désordre qui eût été infaillible & très-grand, à cause de la grande affluence de peuple qui se rangea auprès du Prince, & qui se trouva dans une place joignante, où se tient la foire qui est présentement à la Haye. Nos Carosses étant ainsi arrêtez, Monsieur de Wit survint et m'aborda. Je lui dis, que je ne sçavois ce que vouloient dire les gens du Prince par une telle contestation ; que jusqu'à présent j'avois ignoré que Messieurs les Etats eûssent un Souverain qui pût prétendre le pas sur les Ambassadeurs de Vôtre Majesté ; que je lui en faisois mes plaintes. Il me témoigna désapprouver ce procédé, passa auprès du Prince, qui envoya soudain un Gentilhomme vers Madame la Princesse Doüairiére [sa grand-mère, car le prince d’Orange est orphelin], lui proposer le conseil que lui donnoit Monsieur de Wit, qui étoit de descendre dans l'allée qui étoit enfermée de la barrière, & faire retourner son Carosse, ce qui fut exécuté après le retour du Gentilhomme ; si bien que mon Carosse passa dans le rang qui m'étoit dû. Je fis sçavoir par une personne tierce ce procédé à Madame la Doüairiére, & je lui fis entendre, qu'étant obligé de rendre compte à Vôtre Majesté de cette action, j'étois bien aise, pour ne point nuire au Prince, de sçavoir si elle devoit être imputée à la méchante conduite de son Gouverneur. Elle répondit que c'étoit au Roi d'Angleterre de se mêler de cela ; qu'elle lui en laissoit le soin, mais qu'elle n'approuvoit point ce procédé. » La suite de la dépêche n’est pas indifférente pour celle de notre propos : « Je ne sçai si l'on s'étoit mis dans la tête de lui faire soûtenir cette contestation comme petit-fils d'Angleterre ; je la trouverois bien nouvelle dans un Paîs étranger. Je crois être obligé en cet endroit de faire part à Vôtre Majesté d'une nouvelle [... l’on m’a appris] que Fanchon [Fanchaw] avoit ordre du Roi son Maître de disputer à Madrid le pas à Monsieur l'Archevêque d'Embrun. » 79 M.A.E., Mém. et Doc., Angleterre, vol. 26, f°78, Charles II à Madame : “I have ben all this afternoon playing the good husband, haveing been abroade with my wife, and 'tis now past twelve a clocke, and I am very sleepy. I thought I should have had a word from you, about this accident which fell out betweene our nephew and Monr d'Estrades at the Hage ; the secretary I cannot well tell what to say upon the matter, but methinkes hath written both to my Lord Hollis and Mr Montague about it. It is a strange thing, that at the same time that the Princes of the blood in France, will not yeelde the place to my ambassadore there, that the french ambassadore at the Hage should goe out of his way, to make a dispute with my nephew. I would be glad to know your opinion upon this businesse, for it concernes you, in all respects, as much as me.” Charles II semble
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 21 -
Le sixième et dernier acte repéré de cette étrange saga, qui nous retiendra quelque peu,
se situerait enfin à Madrid, entre juin et septembre 1664. Dans la capitale castillane, nous retrouvons notre fier archevêque d’Embrun, presque un familier des coups d’éclat. Mais celui qu’il provoqua le 18 juin 1664 pour la première audience de Sir Richard Fanshaw, ambassadeur d’Angleterre nouvellement arrivé, se présenta de prime abord sous un jour bizarrement amical ; en tout cas à l’égard du Britannique, car le roi d’Espagne en fit les frais, on pouvait s’y attendre. Suivant l’exemple anglais, Philippe IV venait en effet d’interdire expressément aux ambassadeurs étrangers d’envoyer leurs carrosses pour les défilés menant aux premières audiences solennelles, afin d’éviter tout incident. Qu’à cela ne tienne, en ces matières M. d’Embrun refusa de recevoir d’autres ordres que ceux de son maître. Ayant rassemblé tous ses gens, il brava donc l’interdiction royale et fit accompagner Fanshaw jusqu’au palais, poussant la civilité jusqu’à l’escorter à son retour, ce qui ne s’était jamais vu. Le tout, sous les yeux impuissants des serviteurs du roi d’Espagne et de la foule madrilène admirative : l’on crut rêver. Sir Richard Fanshaw, d’abord assez interdit nous disent les dépêches, s’avoua finalement ravi de ce renfort inattendu qui venait rehausser son prestige80. Etait-ce donc à un brusque réchauffement des relations franco-anglaises que l’on assistait, et cela peu de mois après les tempêtes déchaînées par Holles à Paris ? En août, tout change de face. Le roi Philippe IV, soumis à une intense pression française, révoque son interdiction et permet la reconstitution des cortèges : dans cette circonstance, les Anglais découvrent avec horreur le dessein de la « courtoisie » de l’archevêque d’Embrun, le piège qu’elle constituait. Comme un nouvel ambassadeur de Venise venait d’arriver et s’apprêtait à se rendre à sa première audience, les Français attendaient évidemment de deux choses l’une : soit que les Britanniques s’abstinssent de la cérémonie, soit qu’ils les rejoignissent dans le cortège, mais en passant cette fois-ci derrière eux, manifestant dans les deux cas au yeux du monde la préséance de la monarchie des lys81… Ce qui arriva alors n’est pas encore bien éclairci. L’on ne sait au fond si Sir Richard Fanshaw ne médita pas à son tour un coup de force, en recrutant quantité de soldats : c’est ce dont il ne parle pas dans ses dépêches, mais l’archevêque d’Embrun le prétend dans les siennes. Il va sans dire que ce dernier, fort de son expérience, n’avait pas négligé de son côté de battre le rappel des troupes. Grâce au renfort de quelques dizaines de soldats déguisés en civils, qu’on avait spécialement dépêchés de France, grâce aussi au patriotisme du petit peuple de travailleurs français résidant alors à Madrid — notamment les fameuses colonies d’Auvergnats —, il s’assura de toute façon une supériorité numérique écrasante sur son rival anglais. Mais laissons donc, pour terminer, la parole au prélat, lorsqu’il en vint à adresser à Louis XIV le rapport de ses hauts faits :
Enfin mon carosse sortit fort bien atelé de bons chevaux sur les neuf heures et demie acompagné de mes huit hommes a cheval, de vint pages ou Laquais de ma livrée, et d’environ 300. artisans françois dont la pluspart ont esté soldats, pour aller au logis de Mr. l’Ambassadeur de Venise ; et ils se campèrent devant sa porte quoy que je leur pusse faire dire auparavant pour les en empescher ; apprehendant tousiours de gaster une bonne affaire par
signaler à mots couverts que si les ambassadeurs de France prennent désormais le pas sur les petits-fils de roi (le prince d’Orange était petit-fils de Charles Ier d’Angleterre), ils prendront bientôt le pas sur les fils et filles de roi, donc sur Madame elle-même. 80 Sur ce coup d’éclat de juin 1664, voir 1/M.A.E., Corr. pol., Espagne, vol. 49, passim, et spécialement ff. 296-309 : dépêche de l’archevêque d’Embrun à Louis XIV, le 20 juin 1664 ; 2/Sir Richard Fanshaw, op. cit. supra note 27, p. 106-110 (Fanshaw à Holles, le 10/20 juin 1664) et p. 116-120 (Fanshaw à Arlington, le 25 juin 1664) ; 3/ Béatrice MARSHALL (éd.), The Memoirs of Ann Lady Fanshawe, Wife of Sir Richard Fanshawe, Bt., Ambassador from Charles II. to the Courts of Portugal & Madrid, Written by Herself, Containing Extracts from the Correspondence of Sir Richard Fanshawe [édition électronique “Gutemberg” disponible sur internet] : “On Wednesday the 18th of June, my husband had his audience of his Catholic Majesty; who sent the Marquis de Malpica to conduct him, and brought with him a horse of his Majesty's for my husband to ride on, and thirty more for his gentlemen, and his Majesty's coach with the guard that he was captain of. No Ambassador's coach accompanied my husband but the French, who did it contrary to the King's command; who had before, upon my husband's demanding the custom of Ambassadors accompanying all other Ambassadors that came into this Court at their audience, replied, that although it had been so, it should be so no more; saying, it was a custom brought into this Court within less than these twenty-five years, and that it caused many disputes, for which he would no more suffer it. To this order all the Ambassadors in this Court submitted but the French, whose Secretary told my husband, at his coming that morning, that his Master, the Ambassador, said that his Catholic Majesty had nothing to do to give his Master orders, nor would he obey any of them; and so great was this work of supererogation on the part of the French, that they waited on my husband from the palace home, a compliment till that time never seen before.” 81 Sir Richard FANSHAW, op. cit. supra note 26, p. 199-203, Fanshaw à Arlington, le 2/12 août 1664 : “The design of the French Courtesie in my Publick Audience, even then perceivable and perceived is now full blown, that the King hath in Person Expostulated with the Spanish Ambassador at Paris, why the King his Master would offer by an innovation in the Spanish Court at that time to bereave him the said French King of an opportunity of vindicating his just Precedence of the King of England.”
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 22 -
la maniere d’agir : Les quatre gardes [c’est-à-dire quatre soldats français déguisés en civils] se meslerent negligemment entre eux pour moderer un peu leur ardeur. Les Carosses de Mr. le Nonce et de Mr. l’Ambassadeur de l’Empereur arriverent aussitost avec leurs familles : Et comme celuy de Mr. l’Ambassadeur d’Angleterre ne venoit point les Auvergnats commençoient a crier qu’il falloit aller bruller sa maison ; et ils tiroient de temps en temps quelques coups de carabine. Mr. l’Ambassadeur d’Angleterre envoya deux gentilshommes a luy fort bien montés qui vinrent devant la porte de Mr. l’Ambassadeur de Venise pour reconnoistre cette foulle, et l’on vit en mesme temps deux de ses Carosses, l’un proche de la maison de l’Ambassadeur de Venise ; et l’autre sur le passage du Palais pour voir s’il en pourroit faire passer quelqu’un au dessus du mien. L’on sceut aussy qu’il tenoit chez luy cachés environ cent hommes Anglois, ou Portugais ; et entre eux cinquante Bandoleros Valencianos, qui ont tousiours sur eux quatre ou cinq bocas de fuego, et qui sont des Assassins pour de l’argent, qu’il avoit fait entre secretement dans la ville le jour precedent. Les officiers qui estoient encore cachez dans une chambre se jetterent deça et dela dans les rues pour voir ce qui se passeroit et je ne pus pas empescher les six mousquetaires de monter a cheval pour la mesme curiosité. [Il s’agit encore de soldats français mis à disposition de l’archevêque d’Embrun.] Mais comme les gens de Mr. l’Ambassadeur d’Angleterre luy allerent faire rapport qu’il y avoit deux mille françois dans les rues pour soustenir mon Carosse, qui tailleroient d’abord en pieces tout son monde, il ordonna, estant bien conseillé, que l’on ne fist aucun effort : Et ces gens épars ça et la parurent seulement spectateurs dans les rues. Le Mayordome de la Maison du Roy arriva avec les gentilshommes de Sa Majesté au logis de Mr. l’Ambassadeur pour le mener au Palais. Le Cortege commença à deffiler, et mon Carosse fut tousiours accompagné devant et derriere er aux costez, de mes Pages et de mes Laquais et d’environ trois cent françois, au milieu desquels marchoient comme gens detachez de crainte d’estre recognus les gardes ou chevaux legers pour empescher le desordre leur disant : « Enfans tenés seulement vos rangs, mais ne donnés point que vous ne nous voyiez charger les premiers. » Toute cette foulle demeura devant le Palais, et mes gens a cheval y entrerent seulement pour accompagner Mr. l’Ambassadeur aux appartements du Roy et de la Reyne, qui n’avoient aucuns pistolets sur eux suivant un ordre tres exact que je leur en avois donné de crainte des accidens. Il n’y avoit nul péril au retour qui est un temps ou les cortèges de séparent : ce menu peuple voulut tousiours suivre mon Carosse ; et il l’amena jusqu'à mon logis, ou estant arrivé ils firent une descharge de trante ou quarante coups de diverses armes a feu devant ma porte.
Ayant narré l’épreuve de force, l’archevêque-diplomate tire alors des leçons, qui à défaut d’être objectives illustrent bien l’importance que pouvaient revêtir ces cérémonies pour tout un chacun, y compris le peuple :
Il y a bien Sire, des reflexions a faire sur ce destail ; dont la principalle est une Influence Secrete de Dieu qui preside a toutes les actions qui regardent la gloire de V. M. ; et qui est soustenue par une tres haute reputation dans l’esprit de ses subjets autant de loin que de pres, de maintenir ceux qui la servent ; […] Ce qu’il y a encore de plus considérable est que les Espagnols gens de condition et autres qui voyoient au moins quinze cent françois armés, ou de ceux du Cortege ou de ceux qui estoient dans les passages des rues, estoient prests de se déclarer en ma faveur et qu’ils ont tousiours dit a hautes voix, plus justes et plus politiques asseurement en ce poinct que Mrs. du Conseil d’Estat : « francia a siempre precedido Inglaterra ; no ay que dos Reyes en el Mundo, un Rey de francia, y un Rey de españa. »
Et de conclure sur une note pathétique à l’égard de Philippe IV : J’allay voir le 21e. le Roy Cath. a l’occasion du jour de la Naissance de la Reyne, a qui je fis mon Compliment autant au nom de toute la France qu’en celuy de V. M. pour la félicité que Sa Majesté y causoit par ses vertus. Le Roy le receut fort bien et il me dit quelques parolles obligeantes : « estimo mucho el afecto que mostrais para todos nosotros. » Je creus que je ne debvois pas perdre le temps de luy faire mon remerciement pour le restablissement de la Ceremonie qui avoit esté faite deux jours auparavant, en attendant que V. M. en pust estre advertie ; et je l’asseuray que le tout s’estoit passé avec grande paix. Sa Majesté me respondit : « hare siempre todo lo que pudiere por la satisfacion del Rey82. » (25 sept. 1664.)
Tout ceci mériterait d’être étudié avec davantage de détail. Mais l’on peut d’ores et déjà considérer en vraie grandeur, à travers ce dernier épisode espagnol, l’obsession qu’avaient fini par constituer ces affaires de carrosses.
* * *
82 M.A.E., Corr. pol, Espagne, vol. 50, ff. 47 v°-50 v°, Embrun à Louis XIV.
Des carrosses qui en cachent d’autres
- 23 -
Au terme de cette étude, plusieurs réflexions semblent pouvoir être formulées. A propos tout d’abord des incidents qui marquèrent précisément l’ambassade de Holles, nous observons une fois de plus qu’ils ne furent que la face émergée de l’iceberg. Ce qui est original ici, c’est la réunion d’un certain nombre de circonstances qui rendirent la face cachée d’autant plus difficile à distinguer : une personnalité d’ambassadeur assez haute en couleur pour pouvoir égarer l’observateur ; deux monarques qui cherchent à s’entendre quitte à fermer les yeux sur des divergences profondes et à faire de leurs diplomates respectifs des boucs émissaires ; une « guerre des carrosses » en arrière-plan, que la dispersion des champs de bataille, des acteurs et — pendant longtemps — des archives, concourut à masquer. Aussi bien cette « autre guerre louis-quatorzienne » mériterait d’être explicitée davantage, et interprétée dans le cadre plus global de ce que les historiens ont appelé les « préludes de munificence », ces actions d’éclat entreprises par le jeune Louis XIV et largement médiatisées. Que pourrait-elle donc bien signifier au sein d’un tel ensemble ? Un symptôme parmi d’autres de l’affirmation d’un nouvel ordre européen dominé par la France, sans doute ; mais aussi de réelles résistances à la mise en place de cet ordre. Et tout cela à travers les préséances.
Concernant justement les incidents de cérémonial en général à l’époque moderne, cette
étude nous montre une nouvelle fois que nous ne sommes pas dans le domaine de la broutille83. A cette époque, au sein d’une société traditionnelle, structurée par les hiérarchies, qui s’exprimaient par les cérémonies, on peut considérer qu’il y avait certes un phénomène bien naturel de projection des rapports humains et de leurs obsessions sur le jeu diplomatique. Mais il faut aussi considérer très prosaïquement un monde où il n’est pas question de classer les États par les performances économiques, par les effectifs, par les rencontres sportives, et à peine par la puissance militaire, difficilement quantifiable hors des champs de bataille. Dans ces conditions, n’est-il pas logique que le protocole devienne un enjeu primordial, comme lieu de fixation du patriotisme, et plus fondamentalement encore comme indicateur du rapport de force entre les États ? Que le roi d’Espagne, dans sa propre capitale, cède à la France sur le plan des cérémonies, sa faiblesse saute aux yeux de l’Europe entière. Le moral national d’une part accusera inévitablement le coup. Vis-à-vis de ses partenaires internationaux d’autre part, sera-t-il un allié fiable ? Le discrédit ne le guette-t-il pas ? Ce ne sont là que quelques réflexions esquissées. Qu’il nous soit permis cependant de songer que Lord Holles ne les aurait peut-être pas totalement désavouées, lui qui, méditant sur ses avanies, en vint jusqu’à tracer ces mots amers :
Ceremony is substance, and who carries it in that will carry it in the essentials. All in this world is but grimace84.
83 Voir L. BÉLY, Dictionnaire de l’Ancien Régime, 2003, art. « Cérémonies publiques, cérémonial », qui introduit son propos en reprenant les mots d’Y.-M. BERCÉ : « Les sociétés modernes avaient un sens aigu des préséances et des hiérarchies symboliques et formelles : “Une préséance cérémonielle impliquait une prééminence politique. Un pas cédé dans une procession pouvait engager l’avenir, créer un précédent, compromettre une prise de parole dans un débat politique brûlant ” (Yves-Marie Bercé). C’est dire si de telles préoccupations étaient présentes sur la scène internationale de l’ancienne Europe. » Cf. W. ROOSEN, « Early Modern Diplomatic Ceremonial: A Systems Approach », The Journal of Modern History, vol. 52, n° 3 (sept. 1980), pp. 452-476. 84 « Le cérémonial est substance, et celui qui en vient à bout, viendra à bout de l’essentiel. Tout en ce monde n’est que grimace. » Cité par P. CRAWFORD, op. cit. supra note 8, p. 201, par Sir K. FEILING, op. cit. supra note 6, p.65, et par J. MORRILL art. cit. supra note 8. Ce dernier juge de manière très tranchée :“Holles’s comment that ‘ceremony is substance, and who carries it in that will carry it in the essentials’ (PRO, SP 78/119, fol. 110) was simply absurd in view of the calculated informality of Charles’s own court and the king’s own style.”