Ces mots anglais "qui ne vont pas de soi"
Transcript of Ces mots anglais "qui ne vont pas de soi"
Università degli Studi di Macerata
Heteroglossia
Quaderno della Sezione Linguistica del Dipartimento di Studi su Mutamento Sociale, Istituzioni Giuridiche e Comunicazione n.7 (2001)
Comitato di Redazione
Hans-Georg Griining Antonella Leoncini Bartoli Danielle Lévy Graciela N. Ricci
L'illustrazione della copertina è tratta da: Athanasius Kircher, "Tabula Combinatoria", in Turris Babel.
(Bibl. Munic. Bordeaux)
CES MOTS ANGLAIS "QUI NE VONT PAS DE SOl"
Lorella Sini
Abstract
Questo studio analizza un certo numero di enunciati di parlanti francesi soprattutto orali, nei quali l'enunciatore dopo avere pronunciato con qualche esitazione o, per lo meno, con reticenza, una parola inglese o anglosassone, circoscrive il suo dire con un intervento metalinguistico "riparatore" che va dalla traduzione vera e propria a un commento "autonimico". L'enunciatore sembra volere in qualche modo sminuire o eliminare l'eterogeneità del discorso segnalando, con questi commenti, all'interlocutore che sta "controllando" il proprio messaggio. Questo studio si ispira anche ali' analisi di Jacqueline AuthierRevuz sulle tipologie di eterogeneità o di non-coincidenza tra enunciatore e interlocutore, o del discorso con se stesso. Questa strategia di "évitement" (dovuta anche a un meccanismo di double-bind per la necessità di usare una parola francese anche se questa non è immediatamente disponibile per vari motivi) può dare luogo a una certa forma di ironia il cui meccanismo verrà analizzato.
173
INTRODUC"TION
Dans celte étude je voudrais analyser certaines productions surtout orales dans lesquelles l' énonciateur utilise un mot anglais ou américain et adjoint à son énonciation un commentaire ou bien se mb le distancer celte énonciation par une attitude d'hésitation, la faisant précéder d'une pause ou l'accompagnant d'une marque d'affectation. Nous allons d'abord analyser le cadre énonciatif dans lequel se développe celte forme particulière d'énonciation puis, après avoir identifié les mots susceptibles d'etre incriminés, nous allons dresser un tableau des différents cas de figure de réflexion autonymique1
• Une fois dit, le lexème incriminé, subit une intervention réparatrice sous la forme d'une glose ou d'un commentaire qui s'accompagne souvent d'un effet ironique. Celte forme de modalisation corrective n'est pas toujours viable et peut mener à une impasse autrement appelée double-contrainte.
LE CADRE ÉNONCIATIF
On peut distinguer au moins deux cadres énonciatifs à l' intérieur desquels se situent ces occurrences. Un cadre faiblement "endogène" mais exophile: on est entre soi et on utilise le vocabulaire jargonnant propre à un certain secteur (par exemple le vocabulaire de la musique, des médias, celui des sciences et des techniques); dans ce cadre, l'énonciateur peut s'exprimer sans réticence. La pression normative sociale ne semble pas exercer une influence déterminante. L'énonciateur accepte la "globalisation" et le "marché mondial" des mots qui sont bien en fait, comme le disait l'un des fondateurs du pragmatisme (William James), des monnaies d'échange (exactement comme des billets de banque) qui ont cours tant qu'ils sont acceptés.
Le second, qui est celui qui nous intéresse plus particulièrement ici, peut etre classifié comme fortement "endogène" mais "exophobe" dans la mesure où il est générateur de sentiments anglophobes ou américanophobes; le terme étranger n'est pas englobé dans un discours neutre mais il est isolé par une marque d'extériorité. Ce contexte renforce le sentiment d'appartenance à un groupe social, une nation ou une langue. Le discours s' adresse à un public moins circonscrit et la pression de la doxa se fait plus prégnante. Le mot est victime de rejet parce qu'il appartient à la langue et à la culture dominantes de l'autre: on prete alors au mot l'arrogance de celte culture et on accuse de vanité peti te-
174
bourgeoise ceux qui s'en accomodent sans résistance et qui participent ainsi au processus insidieux d'hybridation de la langue française. C'est contre la culture McWorld (comme le disait Benjamin R. Barber dans un article du Monde Diplomatique2 ) et le triomphe consumériste que s'érigent plus ou moins directement les "censeurs" puristes et autres gardiens de la langue (généralement ce ne sont pas des Iinguistes3 ).
Mais c'est une anglophobie diffuse que nous avons détectée dans ces constructions langagières proches du tic de langage. Très perceptible ces dernières années (IO années environ), celte attitude de défense d'une langue française idéalement pure et bien enracinée dans son terroir, consci ente de son identité (la traduction des terrnes anglais relatifs au tennis par exemple a été imposée sous le prétexte plus ou moins déclaré qu'il s'agissait d'un sport originairement français) s'incarne dans ce qui pourrait etre c1assé comme un jeu de langage au sens de Wittgenstein et qui pourrait s'énoncer comme suit: "trouver le correspondant français ou la traduction française au mot anglosaxon".
Celte analyse du cadre énonciatif doit parallèlement etre complétée par une autre distinction, celle du registre écrit et du registre oral; en effet les forrnes de discours y sont sensiblement différentes pour une raison essentielle qui est celle de la saisie cognitive des mots et du temps opératif que la pensée exige pour mettre en action le langage. L'expression orale permet la matérialisation de conflits surgissant dans ce laps de temps qui s' écoule entre la virtualité de l'intention (le temps de l'à-dire) et la réalité du discours (le temps du dit)4: dans la hiérarchie énonciative à l'oral, c'est le mot anglo-saxon qui, en apparaissant le premier, vient surprendre l' énonciateur comme si le mot n' avait pas été choisi par lui ce qui a pour conséquence essentielle de brouiller la linéarité du discours. Le discours écrit, quant à lui, inverse la saisie puisque le mot anglais n'est énoncé que dans un second temps et que, parfaitement maitrisé,le discours reste pour ainsi dire "fidèle à lui-meme" et ne montre qu'une faible discordance avec l'intention de ]'énonciateur qui le produit.
IDENTIFlCATlON DES MOTS AFFECTÉS
Il ne s'agit pas de tous ces emprunts "achevés" ressentis comme "allant de SOi"5 parfaitement intégrés à la langue française com me par exemple un certain
175
nombre de mots en "-ing" (,'jogging", "lifting", ou plus anciens encore "camping", "parking") ni des emprunts naturalisés, pourrait-on dire, comme "opportunité" (pour "occasion"), "armes conventionnelles" (pour "armes c1assiques"), "agrément" (pour "accord"), dont on n' identifie plus l'origine anglo-saxonne.
Il s'agit souvent d'un lexème anglais ou américain (donc porteur de "sens plein") généralement d'introduction récente (parfois meme très récente et dont on ne peut prévoir la durée de vie qui sera peut-etre éphémère). Le rejet peut également s'appliquer à un nom propre qui est ressenti comme un perturbateur du flux verbal plutot que comme un véritable envahisseur, du moins dans un premier temps li Cependant la présence de n' importe quel mot à sonorité anglo-saxonne est susceptible d'etre signalée comme indésirable.
LE SIGNIFlANT PERTURBANT ET LES EMPLOIS IRONIQUES
L'importation et la production de tout mot étranger (Iexème ou nom propre) exigent une transposition des phonèmes ce qui a un effet déstabilisateur du flux verbal. La dissonance introduite est interprétable alors comme une impureté malvenue dans un discours que l' on ten~ naturellement à homogénéiser. C'est ainsi que le seuI fait de prononcer un mot en anglais suscite une réaction d'auto-évaluation sur son propre dire et de remise en cause du signifiant meme:
176
(I) A- "ça s'appelle l'access prime time. B- "Vous etes bien informé!" A- "Bof .. .je vous dis pas que je le prononce comme il faudrait mais ... " (Radio Bleue, 19-2-1999)
(2) "Le 'curade' [kyrad'] ou le • curade' [kjureid'], bonjour la prononciation, ce bateau irlandais perpétue la tradition" (joumal de 20 h., France 2, 4-8-1998)
(3) [II s'agit d'une émission de bricolage et l'animateur présente une
machine à percer] ..... alors ça s'appelle Impulse Lprels'], alors on va dire "Impulse" ipyls'l en français. c'est une machine à impulsions ... " (Radio Bleue. 22-6-1999)
L'énonciation du mot à consonance anglaise fait naitre dans un premier temps et instinctivement donc un doute sur la justesse de la prononciation. En s'excusant de leurdéfaillance, les énonciateurs font don c implicitement référence à une prononciation idéale (entendez "authentique" ou "à l'anglaise'') alors que, en me me temps et contradictoirement une telle prononciation serait impossible sans susciter un décrochement du flux verbal qui déstabiliserait la communication par son incongruite. Celte contradiction (à la fois l'impossibilité de prononcer le mot de manière juste et le sentiment de culpabilité face à ce qu'on perçoit comme une incapacité à bien dire) peut-etre à l'origine de l'attitude d'autodérision, que l' on perçoit dans les commentaires auto-réflexifs des énoncés (1) et (2). Dans (3) la transposition est facilitée par la présence du meme signifiant dans les deux langues.
Or celte incapacité est d'une part inhérente aux règles de production naturelle de la langue française Ge ne suis pas sure que ce soit le cas pour d'autres langues, l'italien par exemple) et, d'autre part, elle semble également relever d'un habitus culturel partagé qui se reflète dans les règles implicites de discrétion et de modestie que le Français se doit d' adopter, dans la conversation courante, vis-à-vis du mot anglais lui-meme et vis-à-vis de ses interlocuteurs qui guettent le faux-pas (la mauvaise prononciation ou la trop bonne prononciation)K. En effet, dire un mot anglais ou américain sans gene est interprété au mieux comme du snobisme9
, au pire comme un comportement audacieux voire irrévérencieux (com me cela apparait dans (4) et dans le commentaire de B.Pivot sur l'usage abusif du mot "challengé" dans (5».
(4) "Certains de vos confrères ont essayé de me hasbeener, si i'ose dire" (G.Bedos, J.T. de 20h, France 2, 5-3-1999)
(5) [Il s'agit d'un commentaire de Bemard Pivot sur une interview de M-
177
F.Pisier protagoniste du film présenté au Festival de Cannes 1999, "Le temps retrouvé"] Bemard Pivot: "Marie-France Pisier a déclaré ceci à M.M. qui la questionnait sur son réalisateur." Marie-France Pisier: Il m'a dit un tmc qui m'a beaucoup ... challellgée ... , enfin, il m'a dit défend-Ie [le film] à l'américaine!'' Bemard Pivot: "Alors vous avez entendu: «il m'a beaucoup challengée». Alors ça c'est une formule totalement inédite, loufoque et ridicule. Alors d'abord, je me suis beaucoup amusé et puis après je me suis rappelé, quand meme, que Mme Verdurin était une bouQ:eoise riche. excentrique. snob et un peu bébete ... et, au fond ... un Marcel Proust d'aujourd'hui pourrait lui faire dire la meme chose. Alors, ... au fond ... , Marie-France Pisier avait continué d'interpréter son role, de jouer les Mme Verdurin devant les caméras de France 2. Et alors, je me suis dit: ça, c'était vraimenl de la bonne promotion, c'était subtil, c'était raffiné. Donc, bravo Marie-France Pisier .... si vous l'avez fait exprès! (mouvement réprobateur du doigt)"
Le snobisme est une attitude extreme parfois perçue comme ridicule et qui prete à sourire. C'est ainsi qu'on utilise parfois de manière délibérément effrontée un mot ou une expression anglaise pour mettre exagérément en relief un caractère particulièrement présent dans l'air du temps en caricaturant son coté exceptionnel, mondain ou "branché". Dans ce cas l'utilisation de l'expression anglo-saxonne (accompagnée d'un signe d'affectation el/ou d'admiration) est une marque de modalité évaluative également appelée axiologique:
178
(6) [Sifflement d'admiration de l'intervieweur devant la personne interviewée qui montre une crevette] "Alors ça, it is de la Royale de Madagascar ... oui Monsieur!" (Télématin, France 2, 18-3-1999)
(7) "C'est très bien écrit, y a du style [stail] comme vous dites Valérie" (Tout le monde en parI e, France 2, 1-5-1999)
L'ironie nalt ainsi de la connivence que l'énonciateurétablit entre lui et ses interlocuteurs présents ou fictifs lll qu'il entend impliquer en parodiant ceux qui utilisent abusivement les mots anglais par excès de conformisme (pour "fai re plus sérieux", par snobisme avons-nous dit); cette stratégie énonciative a pour effet, en réalité, d'amenuiser la force argumentative de l'énonciation: en disant "il is de la Royale de Madagascar", on veut bien consentir au caractère exceptionnel de la crevette mais on relativise sa marque laudative en la forçant outre mesure (il ne s'agit que d'une crevette). De meme dans l'énoncé (7), la marque est doublement laudative (l'utiIisation du mot anglais plus la prononciation du la! postérieur), ce qui a paradoxalement pour effet d'affaiblir le jugement qui s'applique en fait à un ouvrage sur les banlieues écrit par un jeune beur banlieusard et qui ne saurait relever de la grande Iittérature.
LEs COMMENTAIRES RÉPARATEURS
L'ironie disparai't dans certains cas de figure, au profit de la seule rétlexion autonymique (c'est-à-dire la rétlexion sur le mot explicitement marqué comme dire d'un Autre ou emprunté à un "ailleurs discursif'): les mots affectés sont plus ou moins bien installés dans notre langue (mots nouveaux ou appartenant à un jargon particulier mais aussi des mots bien intégrés tels que "Iook", "remake", "week-end"). Le signal autonymique peut se manifester par l' adjonction d'un commentaire réparateur qui peut prendre la forme d'un "mieux dire" par une traduction:
(8) "C'est très difficile d'atterrir, il n'y a qu'une seule piste, il n'y a qu'un seuI taxi way, c'est-à-dire un chemin de roulement..." (RMC, 14-4-1999)
Ainsi la reformulation corrective s'avère nécessaire afin d'améIiorer la qualité de l'expression grace à un terme plus transparent que le lexème anglosaxon dont le signifié risque d'etre inaccessible. Ce type de structure est très fréquent dans le registre écrit avec, nous l'avons dit, une saisie inversée.
(9) [II s'agit d'un article du Nouvel Observateur intitulé "Horizon world
179
bouffe" où est interviewé le patron de McDonald's Monde] N.O.- "Les Français disent qu'i1s vous détestent, mais les enfants sont vos meilleurs c1ients. Comment l'expliquez-vous?'' J.Greenberg.- I1s adorent nos frites, les menus spéciaux (happy meals) que nous avons conçus pour eux. [ ... ]" (Nouvel Observateur, 4-10 février 1999)
(IO) "Au départ, papa Newman se méfiait des produits bio (organic en anglais)." (Nouvel Observateur, 1-7 avri11999)
Dans un contexte faiblement exogène, l'al/tre mot est alors respecté dans sa différence, sans sentiment de culpabilité ni réaction fortement anglophobe: on a recourt au terme anglo-saxon sans autre commentaire pour relater une situation ou un événement Iié aux cultures ou aux pays anglophones. Le phénomène d'empathìe peut également jouer dans le processus d'énonciation à travers le choix du mot: celui d'Ailleurs est préféré à celui d' Ici car on moule son discours dans la langue de l'autre par rnimétisme. Le mouvement empathique est centrifuge (il va de soi vers l' autre) et l' énonciateur peut meme aller jusqu' à se passer de la traduction et des guillemets (cf. I I):
(1 )
"Mais à la différence des Américains, les dramaturges britanniques n'aiment guère les happy ends." (Le Monde, 21-1-1999)
Les signes de l'hétérogénéité sont plus explicites lorsque l'énonciateur signale l'expression anglo-saxonne comme intrus "non invité" par le discours. Le surgissement du terme identifié, après coup, comme un anglicisme, pourrait susciter la réprobation d'un interlocuteur présent ou fictif.
Nous avons vu que ces intrus br~uillent le f1ux du discours dans leur signifiant meme car ils obligent l'énonciateur à un effort de prononciation, un effort qui ne sera jamais entièrement satisfaisant puisque celle-ci sera de toute façon imparfaite. Cette imperfection obligée est sans doute à l'origine du dénigrement-rejet de ce mot responsable de la perturbation; il devient alors coupable d'etre présent dans la langue française. L'énonciateur qui, dans un
180
premier temps, "l fiche" le mot anglais comme "malgré lui", se dédouble en une autre voix énonciative et prend sa propre énonciation comme objet de son discours. Ainsi dans des commentaires mis en incise du type "comme vous dites", "comme i1s disent", "com me disent les Anglais", "comme disent les Américains", "comme on dit là-bas", etc., l' énonciateur se distancie de sa propre énonciation; il attribue l'usage du terme à l'Autre ou le signale comme venu d'Ailleurs:
(12) A-"Voilà, oui, c'est important ce qu'elle a fait, c'est peut-etre risqué mais c'est..." B-"Vous l'avez vécu comment justement, quand elIe a fait son .... coming out' , comme disent les AméricainsT A-"Moi je trouve ça génial" (ça se discute, France 2, 7-4-1999)
(13) "Bon, on va vous voir en prime time, comme on dit, hein, à une heure de grande écoute?" (Radio Bleue, 5-7-1999)
(14) '~On va avoir un tie break, comme on dit là-bas, ... un jeu décisif' (Finale de Wimbledon, France 2, 3-7-1998)
Cette attitude de surplomb par rapport à son propre dire a une double fonction. Celle d'ajusterune représentation positive de soi au regard d'une norme sociale, une norme "évaluative"" : il s'agit d'une activité de régulation de l'interaction verbale, d'appel au consensus qui consiste, après avoir laissé le mot s'échapper par une inadvertance (feinte), à l'arrimer au discours, à l' encapsuler (pause pré-énonciative et commentaire post-énonciatif) pour mieux le faire passero L' autre fonction est le déni d' intention de l'énonciateur: il soustrait sa responsabilité à ce dire en le mettant en scène pour s'en désolidariser.
L'énonciateurest souvent pris de nouveau ici dans une double-contrainte: d'une part, le mot anglais est le seuI mot disponi bI e (dans (12) et (13» qui se réfère à tel ou tel signifié, à une réalité extérieure ou à un concept déterminé qu'il est obligé de nommer par lui; d'autre part, la pression de la doxa ou de la
181
norme l'induit à polisser son énonciation pour mieux la faire accepter; il désinvestit le mot de son pouvoirunivoquement référentiel et déstabilise par là l'évidence du dire (qui s'opacifie, dirait JacquelineAuthier-Revuz) en le signalant comme inadéquat au référent: le "Xanglo-saxon, comme on dit" appelle implicitement un "mais on devrait dire Yfrançais" et, d'autre part, traçant une brèche dans la cohésion idéale du discours qui devient dès lors non co"incident à lui-meme le "Xanglo-saxon, comme on dit" est aux antipodes d'un "je dis bien X". Ainsi dans (15) en disant "Xfrançais, je n'ai pas dit Yanglo-saxon", l'énonciateur déclare assurer son dire, y souscrire totalement et "sans faille", tout en ouvrant au lieu-meme de celte assurance un doute sur l'adhérence du discours à lui-meme:
(15) "C'est moi qui présidais du c6té de l'Europe les négociations avec les Américains et quand nous nous somme mis d' accord avec le Président des États-Unis lui-meme, mon correspondant américain, le ministre américain, qui était mon vis-à-vis - je n'ai pas dit apposite Ilumberm'a dit Jean-François, ce n'est qu'un arrnistice et pas la paix entre les États-Unis et l'Europe" (J-F.Deniau - Le Cercle de Minuit, France 2, 3-3-1999)
PROBLÉMATIQUES SÉMANTIQUES
N'en déplaise à ceux qui recherchent désespérément l'orthonyme (le mot juste) et à ceux qui s'attachent de manière utopique à l'univocité de la signification, les mots étrangers comme les mots français sont des signes arbitraires et la transparence désignative n'est pas un critère de bonne fonnation ni de bonne compréhension. Ainsi les mots étrangers au meme titre que les mots "autochtones" subissent une élaboration sémantique donc culturelle. Et c'est, lestés de ce poids sémantique parfois trop encombrant qu'ils arrivent dans la bouche de l'énonciateur et, rétroactivement à son oreille (ou à nos oreilles). Comparons les deux énoncés suivants où le jugement de l'énonciateur sur l'emploi d'un mot français (dans le premier cas) et d'un mot anglais (dans le second), est équivalent à cause justement de l'incidence de leur sème sur la transmission du message:
182
( 16) "Vous allez entendre un medley ou un pol pourri comme on dit, mais le mot n'est pas trèsjoli en français" (Radio Bleue, 15-7-1998)
(17) [à propos de l'expression "Iobby juif' que EMitterand aurait prononcée, selon les révélations de Jean D'Ormesson] "Oui ... bon ... 'lobby', il vaut mieux dire groupe de pression, ça passe mieux" (EMillon, Tout le monde en parle, France 2, 9-1999)
Dans le premier énoncé, c'est la lexie française "pot pourri" qui enclenche un jugement négatif sur l'usage du mot à cause des sèmes inhérents convoqués par l'adjectif "pourri"; dans le second énoncé, ce sont les sèmes afférents 12 qui suscitent la réticence du locuteur: en effet le mot anglo-saxon "Iobby" associé au lexème "juif' se charge, rétroactivement, de certains traits sémantiques qu'il n'a pas hors de ce contexte; c'est que le mot "Iobby", au me me titre que tout mot français, a acquis une héritage sémantique et une histoire; il a été contaminé par des phraséologies du type "Iobby mondialiste" ou "Iobby franc-maçon" véhiculant l'idéologie d'extreme-droite qu'il évoque en écho; "Iobby" est en outre assimilé à trafic d'influence, activité répréhensible et susceptible de poursuites judiciaires dans notre pays. Les commentaires réparateurs du type "c'est plus joli", "ça passe mieux" révèlent la volonté de l'énonciateur de maitriser le sens (que le signifiant soit anglais ou français) en l'allégeant au besoin.
AUTRES ASPECTS DE LA DOUBLE CONTRAINTE
Ma]gré ce que l'énonciateur semb]e insinuer en creusant un vide par des é]éments intonatifs, des si]ences ou des réticences lJ comme cela apparait dans (19) par exemple, qui appelleraient chez ]'inter]ocuteur une activité interprétative pour comb]er ce manque, il n'existe souvent aucun autre mot français interchangeab]e avec ]e mot ang]0-saxon I4 • Et, meme si c'était le cas (cette présence n'est parfois due qu'à]a recommandation officielle et i] est peu usité dans ]a ]angue standard), c'est ]e mot ang]ais ou américain qui est p]us immédiatement disponib]e parce qu'i] est ]e p]us saillant dans ]a mémoire
183
discursive au sens large de l'énonciateur. C'est le cas par exemple pour débriejing (dont le correspondant français serait "débreffage" selon mes informations) dans les deux énoncés qui suivent:
(18) [II s'agit d'un otage qui a été Iibéré] "Vous avez bénéficié d'une aide à la réadaptation, on appelle ça un débriejing, c'est ça?" (dit le présentateur en se tournant vers le spécialiste, un psychologue qui acquiesce d'un geste) (ça se discute, France 2, 2-6-1999)
(19) "Le stress est aussi important pour les sauveteurs que pour les personnes secourues. Il parait qu'on participe à un ... Idébriefing psychologique après tout sauvetage." (Revue de Presse de Pascale Clark, France-Inter, 26-2-1999)
Dans (18), le dire de l' énonciateur est suspendu à l' aval du spécialiste qui devrait autoriser l'utilisation du mot anglophone (mais la question n'est peut-etre qu'une stratégie rhétorique); dans (19), l'énonciation est soulignée d'une marque intensive équivalant aux guillemets à l'écrit: on ouvre le fragment par une pause et un coup de glotte (noté I) et le mot est prononcé sur une intonation légèrement plus élevée que les éléments qui l'entourent l5 •
Bref, toujours pris ici dans des instructions contradictoires ou paradoxales entre, d'une part, l'obligation de nomination ("ce qu'il est obligé de dire en utilisant le mot anglo-saxon") et, d'autre part, le veto de la norme sociale d'usage ("ce qu'i1 est bienséant de dire") mais ce qu'il est bienséant de dire, c'est un mot français qui n'existe pas ou qui n'est pas immédiatement disponible; ou bien encore "ce qu'i1 est bienséant de dire" ce peut-etre à la rigueur le mot anglo-saxon mais sa prononciation est indécidable, l'énonciateur recourt alors, comme par réf1exe conditionné, à des expressions figées proches du stéréotype (par exemple, "parlons français", "pour parler français", "restons français" (20) et (21». Ces forrnes idiosyncrasiques peuvent également s' incamer dans les habitudes de jugement sur la beauté de la langue française et,
184
accessoirement, sur sa c1arté. Ces jugements stéréotypés fortement endogènes et exophobes refoulent par contre-coup l'autre langue dans sa laideur et son opacité (22):
(20) "Yous avez remarqué le ... nouveau Ilook, pour parler français, d'Alice Dona?" (P.Sevran, France 2, 9-3-1999)
(21 ) "L'établissement s'est ouvert aux professionnels du spectac1e. Nous avons des script girls ... oh, pardon, il faut dire des scripts maintenant, parlons français ... " (Radio Bleue, 13-4-1999)
(22) -"Alors, quand on vous écoute et qu'on entend tous ces hommes que ... vous ... Irelookez entre guillemets (rire) qui est un très très vilain mot; vous, vous dites 'conseil en image', hein?" -"Qui, conseil en image ... " (M.Dumas, La vie à l'Endroit, France 2, 25-5-1999)
Si nous nous référons à l'analyse que l'École de Palo Alto développe sur le processus du double-bind'6. les énoncés (20) et (21) i lIustrent bien cette forme de paradoxe: I) le message affirme quelque chose; 2) le message affirme quelque chose sur sa propre affirmation; 3) ces deux affirmations s'excluent. Quant à l' énonciateur de (22), il semble proposer un équivalent français au verbe "relooker" alors que la lexie "conseil en image" ne saurait le substituer, en particulier à cause de sa catégorie grammaticale qui ne se superpose pas à celle du terme franglais.
185
CONCLUSION
Nous l'avons vu, les mots anglais, anglicismes, américanismes, ou autre franglais, sont sous haute surveillance et J'introduction continuelle de nOllveaux lexèmes déstabilisent l'assise de la langue française menacée dans son identité. La pression des campagnes conduites par les pourfendeurs d'anglomanie est diffuse et affecte quotidiennement la manière passablement embarrassée que nous avons d' appréhender les termes venus d'ailleurs (mais les mots non anglo-saxons ne provoquent pas, généralement, le meme type de réaction). Les arretés et les lois (comme la loi Toubon), les réformes (de J'orthographe par exemple) suscitent des deoats parfois houleux comme s'il y allait d'un bien que les Français se partagent démocratiquement (nul n'est besoin d' etre un spécialiste pour avoir son mot à dire sur lajustesse ou la correction de l'emploi d'un terme). Les interventions politiques influent sur le choix de nos mots mais eli es modifient également les modalisations de nos discours. Ces formes modalisatrices caractérisent la langue française et sont donc susceptibles de réveiller notre curiosité. On pourrait analyser de manière analogue les hésitations, les réticences et les conflits que suscite actuellement la réforme sur la féminisation des noms de profession: ne dit-on pas "Madame la Ministre" lorsqu'i1 s'agit d'un (d'une?) ministre de gauche et "Madame le Président" lorsqu'i1 s'agit du Président (de la Présidente?) d'un parti politique de Droite mais là il est peut-etre encore tot pour analyser la nature des différentes problématiques pragmatico-sémantiques qui naitront de ces tensions énonciatives.
186
Notes
I Selon le lerme de Jacqueline Aulhier-Revuz qui définil ainsi la posilion métaénonciative de "dislance" ou d' extériorité par rapport à scs mots pris comme objets. Cf. AUTHIER-REVUZ Jacqueline, Ces mots qui Ile \'Ol/t pa~ de soi - Boue/es réflexives et 11011 coiilcidellces du dire - 2 tomes, Larousse, Paris, 1995; p. 25 el suiv. 2 BARBER Benjamin: "Culture McWorld conlre démocralie" in Le MOl/de Dip/omatique, aout 1998, pp. 14-15. 1 Je pense aux différenls minislres, aux membres de~ différenles associalions de défense de la langue française el à ceux qui mènenl des campagnes contre r emploi de lei ou lei anglicisme. ~ Voir à ce sujet l'analyse d'inspiration guillaumienne de BRES, Jacques et GARDESMADRAY Françoise: "Ralages et lemps de l'à-dire" in Le sens et ses hétérogénéités (sous la direclion de Herman PARRET), Editions du CNRS, 1991, pp. 93-104.
, Cf. AUTHIER-REVUZ Jacqueline, op.cit. , p. 404.· h "Ce qu'on appelle un anglicisme" nous dit Claude Hagège, "ce n'eSI rien d'aulre qu'un mot dont on identifie encore l'origine anglaise ou américaine" (HAGÈGE Claude, Le Frallçais et /es Sièe/es, Odile Jacob, 1987, p. 62). 7 En fail, nous nous rendons bien compie qu'il est presque impossible d'adopter une prononciation anglaise à l' inlérieur d'un discours produit en français sauf si l' énoncialeur esi anglais lui-meme, auquel cas il lui serail bien difficile d'articuler un mol de sa langue malemelle avec les habiludes parfois fanlaisistes de la prononcialion française. K L'idéal ne serail-il pas, com me le préconisail un organisme beIge, "que chaque utilisateur se sente surveil/é à tout instant; et devienlle /e surveil/ant de son voisill"?; cf. KLINFENBERG Jean-Marie, "Les niveaux de langue elle filtre du 'bon usage'" in Le Français Modeme, I, 1982, pp. 52-61. 9 Un joumaliste sportif très connu pour ses inlerviews dans un anglais parfail est devenu une caricature des Guignols de l'Info sur Canal Plus. IO Selon l'analyse polyphonique de l'ironie avancée par l' école d'Oswald DUCROT, un /ocllteur L qui produit un énoncé ironique présente son énonciation comme l'expression du point de me d'un énonciateur E dOIlf il se distancie. L est responsable de /'énonciation mais pas du point de vue exprimé dans /'énoncé qui est ce/ui de E. (cf. MOESCHLER Jacques, REBOULAnne, DictiOlmaire Encyc/opédique de Pragmatique, Seui I, Paris, 1994, p. 329). Il Selon WilIiam Labov, la norme dite "évaluative" s'oppose à la norme dite "objective" fondée sur les statistiques. Celle norme évaluative esi oblenue en faisant répéler la réponse à la question simple qu'on a posée. Celle répétilion véhicule la pluparl du lemps des modificalions comportant une plus grande correclion et une plus grande emphase. cf. LABOV WilIiam, Sociolinguistique, Les Editions de Minuil, Paris, 1976.
187
Il Je reprenùs ici la distinclion ùe François Rastier entre Ics sémes inhérenls qui soni ceux ùonl le mol hérilc par défaul ùe la sémie-type et les sèmes aftèrents qui sont actualisés par une instruction contexluelle et qui sont socialemenl normés (voir entre aUlres, RASTIER François, SémamilJlle et recherches cogllitives, PUF, Paris, 1991). D Le commentaire signalanl le mol com me "pas à soi" peut etre considéré com me une forme de rélicence à dire. I~ Voir l'entretien ave c Jean-Pierre COLIGNON, responsable ùu service de correction ùu Monde: "La conscience linguistiquc du journal Le Monde" in Le Français Moderne, LXVI, n02, 1998. l' C'est ainsi que Jacqueline Authier-Revuz ùécrit le schéma inlonatif d'opacification ùe X (cf. AUTIlIER-REVUZJacqueline, op.cit., p. 134) etqui pourcertains signifierail: "je sais que j'assassine la langue mais je m'en lave les mains" (rapporté par Claude HAGÈGE dans Le Frallçais et [es sièc/es, op.cit., p. 88). 16 Cf. WATZLAWICK Paul et al., Une logiqlle de la commullication, Editions du Seuil, Paris, 1972, p. 213.
188
Exemplier
"Ces mots anglais qui ne vont pas de soi" Xénophilie /xénophobie et diffusion des langues - Paris-15-18 décembre 1999-(I) A- "ça s'appelle /'access prime rime. B- "Vous etes bien informé!" A- "Bof...je vous dis pas que je le prononce comme il faudrait mais ... " (Radio Bleue,19-2-1999) (2)
-"Le 'curade' (kyrad'] ou le 'curade' (kjureid'], bonjour la prononciation, ce bateau irlandais perpétue la tradition" Uoumal de 20 h., France 2, 4-8-1998) (3) [II s'agit d'une émission de bricolage et l'animateur présente une machine à percer] ..... alors ça s'appelle lmpulse (ipcels'], alors on va dire "Impulse" [Opyls'] en français, c'est une machine à impulsions ... " (Radio Bleue, 22-6-1999) (4) "Certains de vos confrères ont essayé de me hasbeener, si j'ose dire" (G.Bedos, 1.T. de 20h, France2, 5-3-1999) (5) [II s'agit d'un commentaire de Bemard Pivot sur une interview de M-F.Pisier protagoniste du film présenté au Festival de Cannes 1999, "Le temps retrouvé"] Bemard Pivot: "Marie-France Pisier a déclaré ceci à M.M. qui la questionnait sur son réalisateur". Marie-France Pisier: "II m'a dit un truc qui m'a beaucoup ... challengée ... , enfin, il m'a dit défend-Ie (le film] à l'américaine!" Bemard Pivot: "Alors vous avez entendu: «il m'a beaucoup challengée». Alors ça c'est une formule totalement inédite, loufoque et ridicule. Alors d'abord, je me suis beaucoup amusé et puis après je me suis rappelé, quand meme, que Mme Verdurin était une bourgeoise riche. excentrique. snob et un peu bébete ... et, au fond ... un Marcel Proust d'aujourd'hui pourrait lui faire dire la meme chose. Alors, ... au fond ... , Marie-France Pisier avait continué d'interpréter son role, de jouer les Mme Verdurin devant les caméras de France 2. Et alors, je me
189
suis dit: ça, e'était vraiment de la bonne promotion, e'était subtil, c'était raffiné. Done, bravo Marie-France Pisier .... si vous l'avez fait exprès! (mouvement réprobateur du doigt)" (6) [Siftlement d'admiration de l'intervieweur devant la personne interviewée qui montre une crevette] "Alors ça, ~ de la Royale de Madagac;car ... oui Monsieur!" (Télématin, France 2, 18-3-1999) (7) "C'est très bien écrit, y a du sty/e [stai I] comme vous dites Valérie" (Tout le monde en pari e, France 2, 1-5-1999) (8) "C'est très difficile d'atterrir, il n'y a qu'une seule piste, il n'y a qu'un seui taxi way, c'est-à-dire un chemin de roulement..." (RMC, 14-4-1999)
. (9)
[II s'agit d'un artici e du Nouvel Observateur intitulé "Horizon world bouffe" où est interviewé le patron de McDonald's Monde] N.O.- "Les Français disent qu'ils vous détestent, mais les enfants sont vos meilleurs c1ients. Comment l'expliquez-vous?'' -J.Greenberg.- I1s adorent nos frites, les menus spéciaux (happy meals) que nous avons conçus pour eux. [ ... ]" (Nouvel Obs., 4-10 février 1999) (IO) "Au départ, papa Newman se méfiait des produits bio (organic en anglais)." (Nouvel Obs., 1-7 avril 1999) (lI) "Mais à la différence des Américains, les dramaturges britanniques n'aiment guère les happy ends." (Le Monde, 21-1-1999) (12)
A-"Voilà, oui, c'est important ce qu'elle a fait, c'est peut-ètre risqué mais c'est..." B-"Vous l'avez vécu commentjustement, quand elle a fait son .. . "comillg out", comme disent les Américains?" A-"Moi je trouve ça génial" (ça se discute, France 2, 7-4-1999) (13)
"Bon, on va vous voir en prime time, comme on di t, hein, à une heure de grande écoute?" (Radio Bleue, 5-7-1999)
190
(14)
"On va avoir un tie hreak, comme on dit là-bas, ... un jeu décisif' (Finale de Wimbledon, Fance 2, 3-7-1998) (15) "C'est moi qui présidais du c6té de l'Europe les négociations avec lesAméricains et quand nous nous sommes mis d'accord avec le Président des Etats-Unis luimeme, mon correspondant américain, le ministre américain, qui était mon visà-vis - je n'ai pas dit opposite lIumber - m'a dit Jean-François, ce n'est qu'un armistice et pas la paix entre les Etats-Unis et l'Europe'' (J-F.Deniau - Le Cercle de Minuit, France 2 , 3-3-1999) (16) "Vous allez entendre un medley ou un pot pourri comme on dit, mais le mot n'est pas trèsjoli en français" (Radio BIeue, 15-7-1998) (17) [à propos de l'expression "Iobby juif' que EMitterand aurait prononcée, selon les révélations de Jean D'Ormesson] "Oui... bon ... "/obby", il vaut mieux dire groupe de pression, ça passe mieux" (EMillon, Tout le monde en parle, France 2, 9-1999) (18) [II s'agit d'un otage qui a été libéré] "Vous avez bénéficié d'une aide à la réadaptation, on appelle ça un débriefing, c'est ça?" (dit le présentateur en se tournant vers le spécialiste, un psychologue qui acquiesce d'un geste) (ça se discute, France 2, 2-6-1999) (19) "Le stress est aussi important pour les sauveteurs que pour les personnes secourues. Il paralt qu'on participe à un ... /débriefing psychologique après tout sauvetage." (Revue de Presse de Pascale Clark, France-Inter 26-2-1999) (20) "Vous avez remarqué le ... nouveau Ilook, pour parler français, d'Alice Dona?" (P.Sevran, France2, 9-3-1999) (21) "L'établissement s'est ouvert aux professionnels du spectac1e. Nous avons des script girls ... oh, pardon, il faut dire des scripts maintenant, parlons français ... " (Radio Bleue, 13-4-1999)
191
li
I i i !
I I




























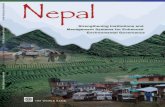





![[mga-nvr ru]-ces-5 0](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c012dd5372c006e043975/mga-nvr-ru-ces-5-0.jpg)








