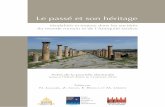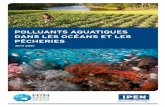"Représentation et expression des pouvoirs dans les communes d'Italie centrale (XIIIe-XIVe...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of "Représentation et expression des pouvoirs dans les communes d'Italie centrale (XIIIe-XIVe...
Jean-Claude Maire Vigueur
Représentation et expression des pouvoirs dans les communesd'Italie centrale (XIIIe-XIVe siècles)In: Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984).Rome : École Française de Rome, 1985. pp. 479-489. (Publications de l'École française de Rome, 82)
RésuméDans leurs dépositions en justice à propos d'une affaire où le juge pontifical est conduit à enquêter sur les pouvoirs desprincipales magistratures à l'intérieur de la commune de Viterbe, au milieu du XIIIe siècle, milites et pedites, c'est-à-dire les deuxcatégories de la population qui se disputent l'hégémonie au sein de la commune, montrent leur capacité à concevoir l'exercice dupouvoir en termes de concurrence et d'antagonisme. L'analyse d'un autre type d'énoncé - une déclaration faite par le podestatd'Orvieto en 1232, au nom du principal conseil de la commune - confirme cette forme de représentation des pouvoirs, interprétéeici comme une reconnaissance de l'autonomie du politique à mettre en relation avec le caractère fortement novateur, « moderne», des structures et pratiques administratives qui caractérisent le régime populaire.
Citer ce document / Cite this document :
Maire Vigueur Jean-Claude. Représentation et expression des pouvoirs dans les communes d'Italie centrale (XIIIe-XIVesiècles). In: Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984).Rome : École Française de Rome, 1985. pp. 479-489. (Publications de l'École française de Rome, 82)
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0000-0000_1984_act_82_1_2832
JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR
REPRÉSENTATION ET EXPRESSION DES POUVOIRS DANS LES COMMUNES D'ITALIE CENTRALE
(XIIIe-XIVe SIÈCLES)
Je partirai d'un document assez exceptionnel : les dépositions, recueillies sur ordre d'un juge pontifical, de 36 témoins présentés par la commune de Viterbe, au cours d'un procès qui l'oppose à un seigneur du contado à propos d'un village déserté dont tous deux se disputent la propriété1. Litige de nature apparemment patrimoniale mais qui en réalité met en cause la souveraineté même de la commune sur une portion du territoire qu'elle considère comme partie intégrante de sa juridiction et qui représente aussi pour elle une source de richesse importante puisque la commune afferme à des prix élevés ces terres dont elle dit détenir la propriété directe. Nous sommes en 1263; cela fait plus de vingt ans que le litige a été porté devant les tribunaux mais la commune a pris depuis quelques années une série de mesures qui prouvent sa détermination à faire valoir ses prérogatives que ce soit par la force, sur le terrain même, ou devant les cours de justice et c'est à coup sûr sous la pression des dirigeants communaux que le délégué pontifical a décidé d'entendre des témoins. Ceux-ci répondent à une liste de questions établies à l'avance, selon la procédure appliquée dans ce genre de procès. Parmi celles-ci, un certain nombre porte sur les magistratures communales, dans la mesure où la commune fonde sa thèse, pour une part, sur le fait que ses fonctionnaires ont exercé, au cours des dernières années, leur autorité sur le territoire du village déserté de Silva Pagana. Le juge pontifical fait son travail avec une grande méticulosité
1 Archivio comunale di Viterbo, parch. 164; Ν. Kamp, Istituzionali comunali in Viter- bo nel Medioevo. I. Consoli, Podestà, Baiivi e Capitani nei secoli XII e XIII, Viterbe, 1963, a publié tout ce qui, dans les dépositions, concernait les institutions comunales et qui par conséquent intéresse l'objet de cette comunication.
480 JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR
et pose des questions, qui n'ont pas à nous retenir ici, sur la durée des magistratures, les dates et les lieux de prise de fonction, etc. Ce qui nous intéresse au premier chef en revanche, ce sont les attributions que les témoins reconnaissent aux magistrats, la manière dont ils se représentent le fonctionnement des institutions communales et dont ils conçoivent le partage des compétences entre les deux magistratures détentrices de la puissance publique, le podestat ou les consuls d'une part, le capitaine d'autre part.
Il y aurait beaucoup a dire sur la spontanéité de ces représentations. Les témoins tout d'abord ne se rendent pas spontanément devant le juge; ils ont été choisis par la commune qui les a sans doute chapitrés et informés du contenu des questions qui allaient leur être posées2. D'autre part nous n'avons pas affaire à un échantillon quelconque de la population locale. Si l'on écarte en effet les treize témoins originaires des villages entourant le territoire du village déserté et qui fournissent en général des réponses très évasives aux questions qui touchent aux magistratures communales ou qui sont même incapables d'y répondre, tous les autres appartiennent, comme on pouvait s'y attendre, au cercle des notables communaux, sur lesquels nous possédons par ailleurs et sauf exception des renseignements nombreux3, qui nous informent en particulier sur leurs prises de position dans les luttes qui opposent alors, dans la commune de Viterbe comme dans toutes les communes de l'Italie centrale à cette époque, deux catégories de la population citadine, les milites et les pedites. Nous sommes donc en présence d'un personnel qui a l'expérience du pouvoir et des luttes politiques, qui a certainement reçu pour consigne de faire valoir les prérogatives de la commune mais qui, pour le reste, conserve la liberté d'exprimer comme il l'entend sa vision de l'ordre politique communal. Je réserverai à ce type d'énoncé le terme de représentation par opposition aux formes d'expression plus élaborées que constituent par exemple la littérature
2 L'interrogatoire des témoins se termine généralement par des questions touchant la personne même du témoin : sa richesse, son statut juridique, sa réputation en matière de religion, ses voyages et la durée des absences qu'ils ont pu entraînées, et aussi la sincérité de son témoignage : toujours confirmée par le témoin, bien sûr, qui ajoute cependant avoir été missus a suo comuni ut diceret veritatem de hiis quod sciret (cf. par exemple témoin n° 1).
3 Grâce en particulier à l'ouvrage de N. Kamp lui même, qui signale dans les notes toutes les informations qu'il a pu rassemblées sur les témoins à partir des différents fonds d'archives viterbais.
REPRÉSENTATION ET EXPRESSION DES POUVOIRS DANS LES COMMUNES D'ITALIE 481
militante, la chronique, la réflexion juridique, etc. Non pas tant que j'y voie plus de spontanéité mais en raison plutôt du moindre souci de mise en forme, de conceptualisation auquel obéit ce type d'énoncé, qui se prête mal du reste à un repérage systématique dans la mesure où, précisément, il n'appartient à aucun des corpus documentaires qui résultent d'une forme d'expression dûment codifiée. On peut cependant admettre que les énoncés de ce genre trouvent leur terrain d'élection dans les documents qui touchent directement à la pratique du pouvoir comme par exemple les sources judiciaires, les procès-verbaux ou registres de délibérations conciliaires, etc.
Revenant à notre texte, nous observerons tout d'abord que les témoins fournissent des réponses absolument identiques quand on leur demande de décrire les compétences des deux grandes magistratures, de définir les attributions des consuls ou du podestat et du capitaine. Elles peuvent certes différer les unes des autres par leur longueur, dans la plus ou moins grande précision des indications d'ordre chronologique ou topographique, par la connaissance plus ou moins fine des procédures d'élection ou de nomination aux charges communales, mais les deux officia qui se partagent l'exercice du pouvoir dans la commune sont perçus et définis d'une manière identique par les deux camps qui se disputent la suprématie politique dans la commune. Servire justi- tiam, regere et adguidare civitatem et districtum, c'est en ces termes que les témoins décrivent les devoirs du podestat ou des consuls (les deux magistratures alternent à Viterbe jusqu'au début des années 1270), ce en quoi ils ne font certes qu'exprimer une opinion commune à tous les esprits d'Occident pour lesquels gouverner c'est d'abord administrer la justice, seul moyen d'assurer la paix4. À vrai dire les témoins de Viterbe se gardent bien de toute spéculation sur la notion d'État et quand ils mettent au premier rang des tâches du podestat l'administration de la justice, c'est au juge dans l'exercice concret de ses fonctions répressives qu'ils pensent, au juge punissant les criminels et tenant tribunal dans un lieu public5. Quant au capitaine, il est, toujours d'après les témoins, investi d'une double mission : d'abord redresser les torts commis par le podestat; à quelles occasions? principalement sans doute dans l'exercice de la justice puisque celle-ci demeure la tâche primordiale du podes-
4 B. Guenée, L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, Paris, 1971, p. 139. 5N. Kamp, Istituzionali comunali in Viterbo. . ., cit., p. 117 (témoin n°5), p. 127 (t
émoin n° 13), p. 133 (témoin n° 20); ACV, parch. 164, témoin n° 27.
482 JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR
tat, mais la formule la plus fréquemment utilisée (intendere ou bien audire omnia gravamina que inferuntur per potestates et officiales) est assez vague pour désigner toute espèce d'abus commis par le podestat, voire même pour reconnaître au capitaine le droit de modifier, d'annuler ou de corriger toute décision ou mesure prises par le podestat. Dans sa formulation la plus succincte, l'autre mission du capitaine consiste à protéger, à garantir les droits de la cité au-dedans et au-dehors (manu- tenere omnia jura ipsius civitatis intus et extra civitatem); un nombre assez important de témoins précise toutefois ce qu'il faut entendre par jura et l'on constate alors qu'il s'agit d'une part des biens et des possessions communales, comme justement le territoire de Silva Pagana qui constitue l'enjeu du procès, d'autre part de toutes les conquêtes susceptibles d'accroître la puissance de la commune dans son contado6. Quelques-uns des témoins enfin substituent dans leur formulation aux droits de la commune ceux du peuple (regere populum et tueri jura ipsius) ou juxtaposent les deux formules7.
Presque tous les témoins savent par ailleurs que le choix du capitaine relève de la compétence exclusive des représentants des corporations, c'est-à-dire des chefs des Arts, alors que leurs réponses traduisent souvent un certain embarras quand on leur demande de qui dépend le choix du podestat. Il est vrai que la procédure est dans ce cas plus complexe puisqu'il appartient à des mediani, qui ont été eux-mêmes désignés par le conseil restreint, de choisir un podestat ou des consuls; la plupart des témoins cependant attribue directement ou indirectement au conseil restreint l'élection du podestat, certains ajoutant que le capitaine assiste et, semblent-il dire, pas toujours les bras croisés, au choix du podestat8.
Aucun des témoins ne songe à nier la suprématie du capitaine par rapport au podestat, suprématie qui réside moins, pour la grande majorité d'entre eux, dans le contrôle plus ou moins strict que le premier peut exercer sur le choix du second, que dans le fait que toute décision du podestat peut, dans deux domaines aussi essentiels que la justice et la tutelle des biens communaux, être remise en cause par l'intervention du capitaine. Distinguons : en matière judiciaire, c'est une sorte de droit
6N. Kamp, Istituzionali comunali in Viterbo. . ., cit., p. 121 (témoin n°8), p. 125 (témoin n° 11), p. 126 (témoin n° 12), etc.
7 Ibid., p. 124 (témoins n°9 et n° 10), p. 125 (témoin n° 11). 8 Ibid., p. 113 (témoin n° 1), p. 114 (témoin n°2), p. 115 (témoin n°3), etc.
REPRÉSENTATION ET EXPRESSION DES POUVOIRS DANS LES COMMUNES D'ITALIE 483
d'appel qui est reconnu au capitaine; avec les droits et biens communaux, en revanche, c'est tout un immense secteur des prérogatives communales qui passe sous la responsabilité directe du capitaine même si le podestat reste chargé de la gestion courante du contado et des propriétés collectives.
Toutefois ce rapport de subordination, que nul, je le répète, ne songe à nier parmi les témoins même quand nous connaissons par d'autres sources leur acharnement à défendre les privilèges des milites, se double d'un rapport de concurrence entre les deux magistratures, du fait même que leurs pouvoirs se superposent dans tous les domaines de la vie communale et en tout cas, si nous nous en tenons à ce que disent explicitement les témoins, dans les deux secteurs de la vie communale où les conflits entre milites et pedites sont les plus aigus : la justice et l'administration des propriétés communales. Seuls, notons-le bien, trois des témoignages révèlent le fond des choses et désignent le motif de la compétition à laquelle se livrent les deux magistratures : face au podestat et aux consuls dont il apparaissait superflu de définir l'appartenance politique, le capitaine est chargé de défendre les intérêts d'une catégorie bien précise de la population, le Popolo. Les trois témoins qui donnent cette indication font-ils eux-mêmes partie du Popolo? Il est permis de le penser, mais les informations qu'il est possible de rassembler sur leur compte sont trop maigres sur ce point pour qu'on puisse l'affirmer sans réserve. Peu importe du reste : ce que fait bien ressortir, me semble-t-il, l'ensemble des témoignages, c'est la position concurrentielle des deux magistratures et la capacité des contemporains à concevoir l'exercice du pouvoir sous le signe de l'antagonisme entre deux institutions, antagonisme qui renvoie, nous le savons grâce à quelques-uns des témoins mais surtout grâce à tout ce que nous savons par ailleurs de l'histoire communale, au conflit qui oppose deux forces politiques, deux camps, deux classes, deux catégories de la population - la terminologie utilisée n'a pour le moment aucune importance - : les milites et les pedites, ou encore la granditia et le Popolo9.
Chose assez rare pour l'Italie centrale, nous avons conservé pour Viterbe des statuts contemporains des épisodes les plus vifs de la lutte entre les deux camps: soit une version partielle des statuts de 1237-38
9 Sur le rôle primordial de ces conflits dans l'histoire communale de l'Italie centrale, cf. J.-Cl. Maire Vigueur, Comuni e signorie nell'Italia centrale (Marche, Umbria, Lazio), sous presse.
484 JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR
et une autre, complète, des statuts de 1251-52 10. De l'un à l'autre texte, on suit aisément la progression du Popolo et sa présence grandissante dans les organes de gouvernement qui reproduisent aux différents échelons la situation de concurrence et de dédoublement dont témoignent les dépositions de 1263. Il n'est pas nécessaire de s'attarder ici sur les mesures qui, dans les statuts de 1237-38, assurent au Popolo quelques garanties fondamentales puis dans ceux de 1251-51 sanctionnent sa nette suprématie politique. Ce que je veux en revanche souligner, c'est que les mêmes statuts font ressortir d'une manière flagrante que les terrains sur lesquels les deux forces politiques se sont affrontées correspondent aux domaines dans lesquels le pouvoir communal a fait, sous la pression des revendications «populaires», ses premières expériences étatiques, les domaines je veux dire dans lesquels est apparu un nouveau mode de gestion, caractérisé par un embryon de centralisation et de bureaucratisation ci, plus fondamentalement encore, par l'émergence de la notion d'intérêt public et le souci de lui subordonner les intérêts privés. Je n'irai pas jusqu'à dire que toute victoire des pedi- tes et du Popolo a immédiatement été suivie par la mise en place d'une structure administrative de type moderne, apportant ainsi sa pierre à l'édification d'un appareil d'État moderne. Le cas de la justice est là pour illustrer la prégnance et l'enraciment des modèles féodaux; le Popolo se montre en effet incapable, tout au long du XIIIe siècle, me semble-t-il, d'innover d'une manière radicale en ce domaine; sans doute élabore-t-il des normes de plus en plus précises visant à réprimer les usages et comportements caractéristiques du style de vie aristocratique et guerrier des milites mais les tribunaux dont il obtient la création viennent se juxtaposer à l'appareil ancien, dont ils corrigent tout au plus certains abus sans aboutir à une profonde reformatio du système judiciaire; échec qui se mesure du reste à l'hostilité longtemps nourrie par la catégorie socio-professionnelle des juges à l'égard des régimes populaires. C'est certainement dans le domaine de la fiscalité et de la gestion des biens communaux que les victoires politiques du Popolo débouchent le plus vite sur des structures nouvelles, accompagnées de pratiques radicalement neuves, telles que l'administration centralisée des biens communaux, l'inventaire systématique des patrimoines, la prise en charge par la collectivité de l'indemnisation des milites, etc. Ces innovations sont en général bien connues encore que selon moi des
10 V. Federici, Statuti della provincia romana, Rome, 1930, p. 28-282 {Fonti per la storia d'Italia, n° 69).
REPRÉSENTATION ET EXPRESSION DES POUVOIRS DANS LES COMMUNES D'ITALIE 485
pans entiers des luttes et des réalisations populaires restent, sinon à découvrir, du moins à étudier d'une manière quelque peu approfondie. En ce qui concerne le problème des biens communaux par exemple, objet de multiples conflits dans les communes de l'Italie centrale tout au long du XIIIe siècle, véritable moteur, à mes yeux, de l'histoire communale au cours de cette période, rien pratiquement n'a été fait depuis les travaux de Falco, vieux de soixante ans et plus11; un sujet voisin mais tout aussi brûlant, celui de Yemendatio equorum ou encore la rétribution due aux milites pour leurs prestations et pertes militaires, n'avaient pour ainsi dire jamais été pris en considération avant que John Grundman ne montre l'importance de ces questions dans les luttes entre noblesse et Popolo à Pérouse durant la première moitié du XIIIe siècle et le rôle qu'elles ont joué dans la formation d'une fiscalité de type moderne (encore faut-il ajouter que la thèse de Ph. D. de J. Grundman, restée inédite, n'a connu qu'une diffusion très limitée12).
Ces quelques exemples suffisent, je l'espère, à convaincre que, dans un cas comme le nôtre, l'étude de l'idéologie ne peut se dispenser d'un détour par la pratique qui consiste non pas à comparer, secteur par secteur, institutions et représentations mais à rechercher les rapports qu'entretiennent la lutte politique et l'ensemble des représentations et des énoncés que la formation sociale considérée est alors capable de formuler et d'élaborer. Je crois en effet avec beaucoup d'autres que l'idéologie n'est pas qu'un tissu d'opinions et de représentations plus ou moins consciemment formulées; elle comporte aussi une part d'implicite et de non-dit d'autant plus essentielle qu'elle constitue en fait l'armature invisible de l'ensemble des représentations et dont il convient de rechercher les traces ou l'expression dans la pratique, au sens marxiste du terme, mais aussi dans les manières de faire et, faut-il ajouter depuis Bourdieu, dans le goût et les styles de vie13. Dans le cas qui nous
11 G. Falco, / comuni della Campagna e della Marittima, dans Archivio della Società romana di storia patria, 42, 1919, p. 537-605, 47, 1924, p. 117-187, 48, 1925, p. 5-94, 49, 1926, p. 127-302.
12 J. Grundman, The Popolo at Perugia (1139-1309), Ph. D., Saint-Louis Missouri, 1974 (exemplaire dactylographié).
13 Bien qu'en la matière il soit tentant d'ouvrir largement le parapluie des auctorita- tes, je me contenterai de trois références : N. Poulantzas, Pouvoir politique et classes sociales, Paris, 1968; L. Dumont, Homo aequalis. Genèse et épanouissement de l'idéologie économique, Paris, 1977; P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, 1979.
486 JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR
occupe, ce détour par la pratique me paraît seul capable de faire apparaître le rapport de congruence et de complémentarité qui existe entre:
1 - La représentation concurrentielle et antagoniste des pouvoirs communaux qui s'exprime dans les dépositions rapportées par le document de 1263.
2 - La nature de classe des conflits qui opposent à cette époque et depuis le début du XIIIe siècle deux catégories de la population communale qualifiées par le binôme milites-pedites puis par le binôme granditia-populus, et par conflit de classe je veux simplement dire - mais c'est déjà beaucoup - que ces deux catégories défendent sur des points précis mais convergents des intérêts opposés.
3 - Le caractère fortement novateur des structures et pratiques administratives mises en place par la commune au fur et à mesure que le Popolo gagne du terrain sur les milites.
Je prétends que seul ce détour par la pratique permet d'interpréter correctement la représentation des pouvoirs concurrentiels et antagonistes et d'y voir non pas la superposition et l'enchevêtrement des pouvoirs qui caractérisent les structures politiques du monde féodal mais l'une des formes d'expression possibles de l'expérience vécue que représente, pour le personnel politique communal, la genèse d'une nouvelle forme d'État. En d'autres termes, la capacité des contemporains à intégrer dans leur représentation du pouvoir l'antagonisme et la compétition m'apparaît comme le signe d'un éveil de la conscience civique, un peu comme la naissance du politique, qui suppose l'objectivation du pouvoir par rapport à ceux qui l'exercent et peuvent se le disputer.
À l'appui de mon interprétation, je pourrais alléguer d'autres formes de représentation et d'expression du pouvoir qui tout en mettant au premier plan le caractère indivisible de l'autorité publique n'en illustrent pas moins la possibilité pour les contemporains d'y associer l'existence de forces antagonistes, voire même d'institutions concurrentielles. Je me contenterai ici d'un seul exemple, tiré d'un acte public qui enregistre, sans doute à la demande du légat pontifical, un épisode des négociations qui se déroulent entre le légat et la commune d'Orvieto en vue de mettre fin aux hostilités entre Orvieto et Sienne. L'épisode se déroule en 1232, à une époque où sans avoir acquis la suprématie, le Popolo représente déjà une force politique avec laquelle doit composer l'aristocratie des milites. Insatisfait de la manière dont le podestat avait accueilli ses propositions, le légat demande à communiquer directe-
REPRÉSENTATION ET EXPRESSION DES POUVOIRS DANS LES COMMUNES D'ITALIE 487
ment avec le Popolo. Réponse du podestat : «Cela n'est pas nécessaire - ou cela est inutile (Quod non opportet), parce que le conseil ici réuni représente le populus entier, du fait qu'il est composé du petit et du grand conseil : ici sont réunis tous les chefs des arts et les représentants des quartiers et ce sont eux qui gouvernent la ville et tout ce qui est fait par eux a force de loi et toutes les paroles que vous nous adressez ici, c'est au peuple entier que vous les adressez, et tout ce que nous vous répondons, c'est au nom du peuple que nous vous le répondons. . ,»14. Texte admirable, qui résonne de prime abord comme un manifeste révolutionnaire en faveur de la souveraineté populaire. En fait les choses ne sont pas aussi simples. Car dans un premier temps le podestat ne parle pas un langage différent de celui du légat et montre au contraire qu'il partage sa vision dualiste du pouvoir communal : sans doute le podestat s'identifie-t-il personnellement avec la commune mais manifestement pas avec le peuple qu'il identifie avec une partie bien précise de la population, conduite par les chefs des arts et des quartiers et dont il ne nie pas du reste qu'ils participent eux aussi à l'exercice du pouvoir. C'est à ce moment là justement qu'il se produit une rupture, comme si le podestat prenait soudain conscience que l'autorité publique, indivisible, ne pouvait être partagée, qu'il lui fallait par conséquent s'identifier également avec le Popolo, sans qu'il faille d'ailleurs exclure tout à fait que le podestat joue dans ce finale sur le double sens du mot populus qui avant de s'appliquer à une force politique désignait, à l'aube du régime communal, la partie du corps social qui se reconnaissait dans les institutions communales. Il n'est pas exclu non plus que la présence du légat, mandataire d'une autorité dont l'universalisme n'est mis en doute par personne, même si elle s'exerce sur un autre registre, ait favorisé cette prise de conscience. Mais quelles que soient les raisons qui poussent le podestat à mettre en avant au dernier moment l'indivisibilité du pouvoir communal, on reconnaîtra que la notion fait bon ménage dans son esprit avec la représentation d'un pouvoir partagé et divisé.
14 L. Fumi, Codice diplomatico della città d'Orvieto, Florence, 1884, p. 136 : «Quod non oportebat, quia Consilium hic adunatum gerit vicem totius populi, quia constat et minori et maiori Consilio : hic sunt omnes offitialium artium et anteregiones congregati, et per istos regitur civitas, et quicquid per eos fit, firmum habetur et ratum, et quid nobis hic congregatis dicitis, toti populo dicitis, et quid nos respondemus vobis, pro toto populo respondemus. . . ».
488 JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR
Est-ce à dire qu'on assiste là à l'émergence de la notion d'État, à la dissociation entre l'idée de pouvoir et l'idée de puissance publique, à la version en quelque sorte communale du processus de dépersonnalisation du pouvoir décrit par Kantorowicz15, la question doit bien évidemment être posée mais je ne crois pas qu'on puisse y répondre immédiatement, pas en tout cas avant d'avoir saisi les raisons d'un autre processus au terme duquel, un siècle plus tard, à partir selon les endroits du milieu ou de la fin du XIVe siècle, les esprits se révèlent incapables de penser la compétition pour le pouvoir et l'existence des conflits politiques autrement que sous la forme d'une lutte entre le vice et la vertu, le bien et le mal, le légitime et l'illégitime16. C'est à mon avis chez les spécialistes de la réflexion politique et dans la littérature militante que cette incapacité se révèle avec le plus d'éclat : je citerai pour ma région Bartolo et son traité sur les guelfes et les gibelins et plus encore celui sur la tyrannie17; je renvoie pour ce qui est de la littérature militante au poème publié par Salvatorelli, qui date de la fin des années 40 et dans lequel la situation interne de Pérouse est décrite en des termes dont la connotation est exclusivement morale18. Mais les formules de chancellerie en assignant comme but à l'action du pouvoir la sauvegarde du rpnus status de préférence au renforcement de la puissance publique (honor et utilitas, disaient les actes officiels de la période précédente), traduisent un revirement analogue qui se manifestent dans les formes de gouvernement par un raidissement suspicieux des institutions. Le temps est bien fini en effet où les institutions s'ajustaient sans délai au rythme des luttes politiques et en particulier des succès populaires. Désormais la nature du régime, sa permanence et sa stabilité absorbent toute l'énergie qui avait permis au siècle précédent l'émergence d'une
15 E. Kantorowicz, The King's Two Bodies: a study in Medieval Political Theology, Princeton, 1957.
16 La très volumineuse littérature sur Γ« humanisme civique» florentin a largement exploité ce thème. Pour une approche plus originale, qui montre en particulier comment le changement qui s'opère dans le champ des idées politiques se traduit aussi dans le style de vie, les genres littéraires cultivés, le public auquel il s'adresse, cf. A. Petrucci, Coluccio Salutati, Rome, 1972, p. 65-81.
17 D. Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), Florence, 1983.
18 L. Salvatorelli, La politica interna di Perugia in un poemetto volgare della metà del Trecento, dans Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, 50, 1953, p. 5- 109.
REPRÉSENTATION ET EXPRESSION DES POUVOIRS DANS LES COMMUNES D'ITALIE 489
nouvelle forme d'État - ce qui, soi-dit en passant, me laisse penser que les signes de révérence, furent-ils d'inspiration laïque, dont l'exercice du pouvoir aime de plus en plus à s'entourer au cours du XIVe siècle, ne sont pas forcément de bon augure pour le renforcement de la notion d'État.
Mon idée principale est donc que la conception du pouvoir qui finit par prévaloir au XIVe siècle conduit à une négation du politique. Du processus inverse était née au XIIIe siècle la puissance de la commune et avec elle une nouvelle forme d'État, ou l'ébauche d'une nouvelle forme d'État. Faut-il attribuer à cette négation du politique l'origine des phénomènes d'involution auxquels on assiste en de nombreux domaines au cours" du XIVe siècle et qui n'épargnent pas les structures de la cité- État?19 Je me garderai bien ici d'aller aussi loin mais il vaudrait la peine, me semble-t-il, de vérifier la pertinence du renversement que je crois saisir dans la représentation du pouvoir entre le XIIIe et le XIVe siècle : ce n'est encore qu'une hypothèse de travail dans l'étude de la genèse de l'État moderne, une espèce de variation sur le thème des rapports entre la notion de pouvoir et la forme de l'État, reposant sur un dossier que je crois solide pour le XIIIe siècle mais qui est à peine ébauché pour le XIVe siècle.
École française de Rome Jean-Claude Maire Vigueur
19 Pour une vue d'ensemble de ce phénomène, cf. Ph. Jones, Economia e società nell'Italia medievale : il mito della borghesia, dans Economia e società nell'Italia medievale, Turin, 1980, p. 3-189; J.-Cl. Maire Vigueur, Comuni e signorie. . ., cit.