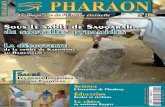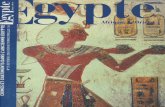Le testament dans l'Egypte ancienne
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le testament dans l'Egypte ancienne
ARISTIDE THÉODORIDÈS
Le testament
dans l'Egypte ancienne
Extrait de la « Revue Internationale des Droits de l'Antiquité »
3" SERIE — TOME XVII — 1970
Le testament dans TÉgypte ancienne ̂ ' (essentiel lement d ' après le Papyrus Kahoun VII, 1,
la Stèle de Sénimosé e t le Papyrus Turin 2 0 2 1 )
p a r A R I S T I D E T H é O D O R I D è S
(Bruxelles).
Sommaire j
1 / La not ion de testament e t le problème de son existence d a n s l 'Égypte pharaonique .
I I / Le Papyrus Kahoun VII, 1,
qui por te le t i t r e d '« imyt-per » censé désigner un « t e s t a m e n t » en égyptien. A l 'analyse, le papy rus se révèle ê t re une donat ion-p a r t a g e ; ma i s on s'y réfère à un « imyt-per » a n t é r i e u r qui devait , lui, avoir la valeur d 'un tes tament , puisqu ' i l n ' ava i t pas encore obtenu force exécutoire, le d i sposan t é t a n t t o u j o u r s vivant .
I I I / L'acte égyptien (Z\< imyt-per ».
I l f a u t se ga rde r de t r a d u i r e ce terme, sous l ' influence de son étymologie possible, p a r « inventa i re » ; il p e u t s ' appl iquer à divers modes de mu ta t i on y compris l ' a l iénat ion à t i t r e onéreux.
(1) Cet te é t u d e a f a i t l 'objet d'une conférence à l a F a c u l t é de D r o i t de P a r i s ( I n s t i t u t de D r o i t R o m a i n ) , l e 30 j a n v i e r dernier, en é tant centrée sur « Le t e s t a m e n t de Sén imosé » ; n o u s l 'avons dévelopi)ée en p r é s e n t a n t a n a l y t i q u e m e n t l es t ex tes , en a j o u t a n t d 'autres documents a u x q u e l s il a é t é f a i t a l lus ion lors de la d iscuss ion, e t en a p p u y a n t sur la n a t u r e de l 'acte d'« i m y t - p e r » ( = é tymolog iquement « i n v e n t a i r e » ) , qui e s t propre à l 'Égypte ancienne.
118 ARISTIDE T H é O D O R I D è S
Le premier ac te de fonda t ion de Nekankh rend évident que depuis l 'Ancien Empi re , les Égypt iens pouvaien t organiser l'aven i r (ne fût-ce que pour ce qui concernai t leur culte) , en prévoyant le moment où ils s'en i ra ien t « v e r s l ' O u e s t » . Ce qui renforce l ' adopt ion p a r eux de disposi t ions à cause de mor t .
« Imyt-per » est un te rme générique, don t il y a in t é rê t à explorer le champ d 'appl icat ion. Un t e s t amen t peu t ê t re d i t « imyt-per », ma i s par fo i s s implement .ss (un « écr i t »).
I V / La Stèle de Sénimosé,
ou de la révocabil i té d 'un acte de disposi t ion à va leur de testam e n t : l 'acte a été cassé t ro is fois p a r son au teu r .
On examinera au passage la question de VAppel an Roi en ma t i è r e civile.
V / Le Papyrus Turin 2021,
ou de l ' un i la té ra l i t é d 'un acte de disposi t ion « mor t i s causa », ma lgré la présence de la famil le lors de sa confection et le dialogue qui s 'engage, mais qui ne concerne que la légalité du legs.
V I / Conclusions.
1. — Concernant le t es tament .
On ne peu t me t t r e en doute qu'en Égypte la volonté d 'un par t i culier a i t pu p rodu i re des effets de d ro i t pour le moment où il ne se ra i t plus.
2. — Concernant l '« imyt-per ».
Loin de n ' ê t re qu 'un « inventaii-e » dans une civil isat ion où l 'hérédi té a u r a i t été un i fo rmément imposée, l ' ac te d'« imj ' t -per » désigne au cont ra i re tou te man i fes t a t ion de volonté personnel le qui modifie la dévolution légale des biens.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 119
CHAPITRE I : La notion de testament et le problème de son existence dans l'Égypte pharaonique.
Le tes t ament , de l 'avis du Pro fesseur René DEKKERS^ es t peut-ê t re « l ' ac te qui a p p a r a î t le p lus t a r d dans le d ro i t des peuples ». C'est pourquoi nombre d ' en t re eux qui on t p o u r t a n t « m a r q u é dans l 'h is to i re », n ' on t j ama i s a t t e i n t le s tade de cet te conception jur id ique . P a r m i eux figurent les Égypt iens (̂ ) ! . . .
E t l ' au t eu r de définir l 'essence du t e s tament de cet te man iè re éminemment significative : « acte un i la té ra l , . . . souvent sol i ta i re , qui do r t t a n t que vit le t e s t a t eu r et qui ne s'éveille que quand le t e s t a t e u r s ' endor t ; sor te de renaissance, de résur rec t ion , prolongat ion de la volonté au-delà de son existence même » (').
I l se comprend a isément que « cette espèce de magie jur id i que » a i t échappé a u x « peuples p r imi t i f s », car c 'é ta i t une « créat ion t r o p audacieuse pour leur faible en tendement » C) : « Les p r i m i t i f s . . . qui ne pa r l en t qu ' au présent , ignoren t forcémen t des no t ions qui ne se r é fè ren t pas au présent , ma i s à l'aven i r : la not ion d 'obligat ion, p a r exemple, ou celle de tes tament , ... »
Le t e s t a m e n t d 'a i l leurs , n 'a pu germer qu 'à l 'époque où l ' individu s 'est sent i la force de se dé tacher de la fami l le : aupa ra vant , il n ' é t a i t r ien, vu qu' i l se pe rda i t « dans le groui)e famil ia l »
Eugène KEVILLOUT, qui a enseigné et la langue égypt ienne e t le d ro i t égyptien à l 'École du j jouvre tou t au débu t de ce siècle, expr ima i t une opinion exactement semblable; il a s s u r a i t que « l 'acte de volonté réglant , pour le t emps où l 'on ne sera i t plus, l a
(2) R e n é DEKKEKS, Le droit privé des peuples : caractères, destinées, dominantes (Bruxel les , 1053), p. 381.
(3) Ihid., p. 373. (4) nid., p. 376. (5) Ibid., p. 366 : « Ces not ions n 'apparaissent qu'assez tard dans la v ie
des peuples. On i)eut m ê m e dire qu'elles permettent de juger de leur maturité jur id ique ».
(6) Ibid., p. 376.
120 ARISTIDE T H é O D O R I D è S
t r ansmiss ion de ce qu'on possède, est resté jusqu'au bout étranger à l'Égypte » (').
Une disposi t ion t e s t amen ta i r e qui puisse changer « les dro i t s de succession na tu re l l e » (') est inconcevable dans ce pays, car c 'est « l 'hérédi té légit ime légale » qui « domine t o u t » (').
Admet t r e , spécialement après la découverte des p a p y r u s de Kahoun , à la fin du siècle dernier , que l 'acte appelé « imyt-per » a i t organisé « une vraie cession de biens », d 'une man iè re « analogue à un t e s t amen t » serai t , aux yeux du même au teu r , f a i r e « u n énorme contre-sens ju r id ique » ('"). Ce qui a existé, aff irme-t-il, ne représente que « cer ta ines disposi t ions mor t i s causa f a i t e s sous fo rme d'inventaires, du temps de la X I I " dynas t ie » (").
Si de parei l les disposi t ions qu' i l reconnaî t lui-même avoir été pr i ses « mor t i s causa » ne peuvent f a i r e penser à des disposit ions tes tamenta i res , c'est parce que l 'h is toire nous apprend que « le t e s t amen t su r l 'hérédi té » es t né en Grèce du t emps de Solon, e t un iquement « pour ceux qui n ' ava ien t p a s d ' e n f a n t s », e t que c 'est Kome qui en a général isé l 'usage dans la loi des X I I Tables ('2).
Au surplus , le t e s t amen t est un acte qui de sa n a t u r e e s t « secret », et qui révèle « l 'omnipotence de l ' individu su r ses biens » ("). Aussi , ne peut-on le concevoir d a n s le d ro i t égyptien puisque, là, l ' é t a t des biens est res té « essent ie l lement famil ia l » C*), et qu'en ver tu de cet é t a t « les enfan t s , fils ou filles, ava ien t tous d ro i t à une égale p a r t » ('^).
(7) E u g è n e REVILLOUT, La propriété,*ses démembrements, la possession, et leurs transmissions en, droit égyptien comparé aux autres droits de l'Antiquité (Paris , 1897), p. 337.
(8) IMd., p. 152. (9) Ibid., p. 201. (10) Précis du Droit égyptien comparé aux autres droits de l'Antiquité
(Paris , 1903), p. 14. (11) M ê m e p a g e ; n o u s a v o n s soul igné. I l s 'ag i t en g r o s du début du
2" m i l l é n a i r e a v a n t J.-O. (12) IMd., p. 14. (13) IMd., p. 760. (14) IMd., p. 760. (15) IMd., p. 761.
LE TESTAMENT DANS L'ÉGYPTE ANCIENNE 121
Ces idées on t influé longtemps sur les vues des égyptologues en la mat ière , et le Professeur Michel MALININE écr ivai t encore t o u t récemment dans le même sens ('^) : « ... I l n ' é ta i t donc p a s nécessaire de recour i r au t e s t amen t pour a s su re r la t r ansmiss ion des p ropr ié tés famil ia les . E t , en f a i t , l 'Égypte ne nous a pas l ivré jusqu ' à p résen t de documents ju r id iques comparables au t e s t ament , tel qu ' i l es t défini pa r le d ro i t romain et moderne, c'est-à-dire un acte de dernière volonté qui ne p rend effet qu ' au décès. On en a donc conclu que le f a i t de disposer de ses biens mortis causa é ta i t , non seulement inconnu du droi t successoral égyptien, mais aussi con t ra i re aux pr inc ipes mêmes de la législat ion qui le ca rac té r i sen t ».
La tou te dern ière opinion sur le su je t est donnée p a r Tycho MRSICH, qui conclut auss i p a r la négative, mais en ne v isant que l 'Ancien Empi re , car cette période seule a const i tué, de sa p a r t , l 'objet d 'une invest igat ion fouillée : « Insowei t is t d a m i t schon im Al ten Reich der Begriff ' Tes tament ' f u r Imyt-pr abzu-lehnen » (").
ICt p o u r t a n t , en scrutant en p ro fondeur les données ins t i tu t ionnelles et ju r id iques fourn ies pa r l 'Égypte dès le début du 111° mi l lénai re a v a n t J . - C , J acques PIKENNE a opposé a u x opin ions de cet te n a t u r e un rad ica l démenti : il ne peut faire de doute, selon lui, pour ce qui concerae en par t i cu l ie r le t e s tament , que cet ac te é t a i t cou ran t e t qu'en É g j p t e le legs é ta i t permis , dès l 'Ancien E m p i r e
J a c q u e s PIKENNE a in tégré l ' é tude des actes de disposi t ion d a n s la descr ipt ion générale des ins t i tu t ions de l 'Ancien Emp i r e ; il a donné un ample développement à ses recherches, de sor te qu' i l nous a f a i t comprendre les actes t e s t amen ta i r e s comme é t a n t la conséquence na ture l le du s t a t u t des personnes
(16) Michel MAI.ININE, Partage testamentaire d'une propriété familiale, d a n s R. d'égyptol., X I X (1967), p. 68.
(17) T y c h o MRSICH, IJntersuchungcn zur Eausurkunde des Alten Rei-ches : Ein Beitrag zum altdgyptischen Stiftungsrecht (Berl in, 1968), p. 177.
(18) J a c q u e s PIBEîJNE, Histoire des Institutions et du Droit Privé de l'ancienne Égypte, I I (1934), p. 302.
122 ARISTIDE T H é O D O R I D è S
à cet te époque, a ins i que de l ' é t a t de la propr ié té , a t t r i b u t de la personne.
Le t e s t amen t est un acte de m u t a t i o n à sa place dans un régime ofi la propr ié té pouvai t j u s t emen t f a i r e l 'objet de tou tes les m u t a t i o n s (") ; car la p ropr ié té é t a i t v ra imen t individuelle e t dépenda i t exclusivement de son p ropr i é t a i r e (^'').
Dès lors que le d ro i t de fami l le se mon t r e « indiv idual i s te », le t e s t amen t a p p a r a î t comme « normal » (^') : et de f a i t chaque Égypt ien dispose l ibrement de ses biens « p e n d a n t sa vie e t même après sa mor t pa r t e s t amen t » (^). Cet é t a t du d ro i t en t r a îne comme corollaire « que la femme mar iée a i t possédé comme son m a r i la pleine capaci té de tes te r » (^).
Les d ro i t s des individus su r leurs biens é ta ien t à ce po in t puiss an t s qu ' i ls pouvaient , lors de la cession de ces biens, les imprégner de leur volonté en créant , p a r exemple, des fonda t ions dotées de s t a t u t s perpétuels {^̂ ). Des personna l i t és pouva ien t a ins i se prolonger pa r delà la mor t et peser su r des biens passés à a u t r u i conventionnel lement ou sous forme de legs (^).
Chaf ik CHEHATA (^') a, de son côté, auss i f a i t un minu t i eux examen des textes et des commenta i res qui en ont été donnés, e t i l en a dédui t qu'on ne peut n ier , dans l 'Êgypte ancienne, l'existence d 'un acte p rodu i san t des effets conformes à ceux que nous a t t e n d o n s d 'un t e s t amen t (^'j.
(10) Jhi<}., i>. .339. (20) Ilid., i>. 339 ; cf . p. 303 : « Le t e s t a m e n t a p p a r a î t c o m m e l 'expres
s ion f o r m e l l e et i rrévocable de la vo lonté du tes tateur , c 'est un ' ordre ', oudj, dont l 'autor i té es t semblable à ce l l e d e s a r r ê t é s r o y a u x e u x - m ê m e s ».
(21) Ibid., p. 302. (22) Ibid., p. 391. (23) Ibid., p. 302. (24) Ibid., pp. 3 2 4 ; 3 5 2 ; 3 9 1 ; .. . (25) Ibid., p. 365. (26) Chafilv CHEHATA, Le testament dans l'Êgypte pharaonique, d a n s
It. hist. Droit frç. et étr., N.S., X X X I I (1954), pp. 1-22. (27) Ibid., p. 8 : « Il demeure d'ores et dé jà é tabl i que, sous l 'Ancien
Empire , une déc larat ion u n i l a t é r a l e de vo lonté p o u v a i t produire s e s e f fe t s à l a m o r t du déc larant . Cette e f f i cac i té emporta i t t a n t ô t l ' ins t i tut ion de prê tres f u n é r a i r e s ou d'hérit iers , t antô t la dévo lut ion de cer ta ins b iens ».
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É O Y P T E A N C I E N N E 123
I l a conclu en ces ternies d o n t i l convient de méd i t e r la décisive t o n a l i t é lorsqu 'on é tud ie l a c ivi l i sa t ion p h a r a o n i q u e : « le d r o i t égypt ien . . . a u r a connu (grâce au t e s t a m e n t ) l ' une des i n s t i t u t i o n s considérées jusqu ' ic i comme les pu re s inven t ions d u génie roma in » (^).
11 nous f a u t d i re à l 'act if des égyptologues qu ' i l s ne son t p a s t ous opposés à r e c o n n a î t r e l 'exis tence d u t e s t a m e n t d a n s l 'Égyp te anc ienne .
I J C t r è s r e g r e t t é P r o f e s s e u r J a r o s l a v C E R N Y n ' a j a m a i s hés i té p o u r sa p a r t à p a r l e r de « t e s t a m e n t » (^') ; e t son éd i t ion d u « t e s t a m e n t de N a u n a k h t e » ( '̂') a é té cap i ta le à cet égard , en ce sens que le P r o f e s s e u r E r w i n S E I D L ^ qui ava i t exp r imé des rét icences q u a n t à l 'exis tence du t e s t a m e n t en Égypte , a a d m i s que cet ac te r e n f e r m a i t des d ispos i t ions t e s t a m e n t a i r e s : « Inso-f e r n liaben w i r t a t sach l i ch ein ' T e s t a m e n t ' vor uns , a b e r die Ver-f û g u n g scheint noch auf solche Pe r sonen besch rank t zu sein, d ie a u c h ohne U r k u n d e e rbberech t ig t wiiren » ('^).
C 'es t un des mér i t e s de I I E L C K - O T T O (̂ )̂ d 'avoir , d a n s l eu r p e t i t d i c t i onna i r e qui é t ab l i t la syn thèse des g r a n d s t r a i t s de la civili-
(28) Jbid., I). 22. (29) J . ôERN*, d a n s J. Eg. Arch. X X X I (1&45), p. 42, n . 3-4. (30) The Will of NaiinaJchtc and the rclated Documents, J. Eg. Arch.
X X X I ( 1 9 4 5 ) , i)p. 2 9 - 5 3 ; pU. V I I I - X I I . (31) E r w i n SEIDL, Einfïthrung in die auvi>tischc Rcchtsgcschichte J)is
ziim Ende de» Neucn Reiches ( G l i i c k s t a d t , 2' éd. , 1 9 5 1 ) , p. 62. (32) I l e s t à n o t e r t o u t e f o i s , à p r o p o s d e l a r e s t r i c t i o n d u P r o f e s s e u r
E . SEIDL, q u e d a n s l ' a c t e d e f o n d a t i o n d 'un D i g n i t a i r e d e l a C o u r d e K l i e p h r e n ( s o u s l a I V d y n a s t i e ) , u n e c l a u s e i n t e r d i t d ' a l i é n e r à n'importe qui l e s b i e n s d e l a f o n d a t i o n , p a r a c t e d'« im.vt-per » o u -à t i t r e o n é r e u x . S i l e f o n d a t e u r d o i t l ' i n t e r d i r e , c o n n u e c o n s é q u e n c e d e l ' i n d i v i s i o n d u f o n d s , c ' e s t q u e c ' é ta i t , s i n o n , l é g a l e m e n t p o s s i b l e . Q u a n t a u Papyrus Turin 2021, i l n o u s r a p p e l l e l a lo i d e P h a r a o n q u i a u t o r i s e c l i a c u n à f a i r e ce qu' i l d é s i r e d e s e s b i e n s ; n o u s en t r o u v o n s u n e a p p l i c a t i o n , d a n s l e d o c u m e n t l u i - m ê m e , l o r s q u e l e V i z i r i^récise q u e l e d i s p o s a n t p o u r r a i t râi ht.f, « d o n n e r s e s b i e n s », a v e c l e s e n s i n d i s c u t a b l e d e « f a i r e u n legs », e n f a v e u r m ê m e d ' u n e c o n c u b i n e s y r i e n n e o u n u b i e n n e ( I I I , 11 -12 ) .
(33) HELCK-OTTO, Kleines Wôrterbuch dcr Aegyptologie ( W i e s b a d e n , 19.56).
124 ARISTIDE T H é O D O E I D è S
sa t ion de l ' É g j p te ancienne, réservé un a r t i c le a u « testam e n t » {^), puisque la possession d 'une telle not ion ca rac té r i se v ra imen t le s t a t u t intel lectuel e t ins t i tu t ionne l d 'un peuple.
I l impor te aussi , et ce en r a p p o r t précisément avec les Papyrus de Kahoiin que nous avons évoqués, e t en r a p p o r t avec la définit ion que KEVILLOUT a assignée à l ' ac te d i t d '« imyt-per », que nous ci t ions K u r t SETHE. Phi lologue de tou te première valeur , il n ' é t a i t sans doute pas ju r i s t e de profession, ma i s a y a n t vécu dans une famil le de jur i s tes , il a donné d a n s les « Er l aû te -rungen » pour les textes contenus dans ses Lesestiicke de lumineux commenta i res marqués d 'une t r è s péné t r an t e vision des choses.
E t p o u r t a n t dans ce domaine, nous ne pouvons pas le suivre incondi t ionnel lement . I l a désiré isoler le t e rme égypt ien qui correspondî t à « t e s t amen t », et il l 'a t rouvé dans cet « imyt-per » auquel nous nous référ ions, et il a in t i tu lé tous les ac tes des Papyrus de Kahoim qu' i l a r ep rodu i t s « Tes tamen t s » (^').
N o u s a l lons voir qu' i l f a u t nuance r l ' i n t e rp ré t a t ion du t e n n e « imyt-per », et afin d ' a r r ive r à en ceraer le sens jur id ique , nous a l lons nous repor te r au Papyrus Kahoun VII, 1, c'est-à-dire à un de ces documents que REVILLOUT a expliqués comme des actes de cession mortis causa, mais qui ne se ra ien t en définit ive que des « inventa i res » hétérogènes au t e s tament . Ajou tons , sans e n t r e r d a n s d ' au t r e s détai ls pour l ' ins tan t , qu '« inventa i re » il y a, parce que, é tymologiquement , ce sera i t le sens de l 'égyptien « imyt-per » ( tout à f a i t l i t t é ra lement : « ce qu'i l y a dans la maison »). Nous essayerons d 'é tabl i r , après avoir donc examiné l 'acte annoncé, ce qu ' i l f a u d r a penser de ces apprécia t ions .
(34) IMd., pp. 371-372 ; ce qui n'emi>êclie nu l l ement qu'il y a i t d e s é l éments à met tre au point.
(35) F. Ll. GRIFFITH, The Pétrie Papyri : Hieratic Papyri from Kahun and GuroJ) (Londres, 1898).
(36) K. SETHE, Aegyptische Lesestiicke (Leipzig, 1928), pp. 90-92.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 125
CHAPITRE I I : Le Papyrus Kahoun VU, 1 (").
A) Au VERSO (= étiquette) {^') :
ACTE D ' « I M Y T - P E R » Q U ' A D R E S S é (irt.n) LE « PHYLARQUE » ( " )
{mty-n-&}) MERYSAïNTEF EN I-'AVEUR DE SON F I L S INTEFSAMERY, SUR
NOMMé lOUSENBOU.
B) Au RECTO.
1/ La date :
< X I , 1 5 > L 'an X X X I X (d 'Amenemliat I I I O ?), le 4"= mois de (la saison) « akhe t », le 19" jour .
(37) Papyrus Kahoun VII, 1 [= F. lA. GRIFFITH, Hicratic Papyri from Kahun and Gurob, pp. 20 -31; e t pl. X I , 15 sqq. = SETHE, Lesestiicke, 90, 1-11] ; c f . F . Ll . GRIFFITH, Wills in ancient Egypt, d a n s Law Quartcry lieview ( L U I , 1898) , p. 4 ; E. REVILLOUT, Supplément aux données juridiques des inscriptions de Rexmara sur les transmissions héréditaires [= R. égyptol., V I I I (1897) ] , pp. 173-174; G. MASPERO, Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes, IV [ = liihl. Égyptol., V I I I ( 1900 ) ] , pp. 435-438; EBMAN-RANKE, Aegypten und àgyptisches Lehen im Altertum (Tubiugeu , 1923) , p. 165 [ = trad . f ranç . d e Ch. MATHIEN, p. 193 ] ; P . I.A-CAU, Une stèle juridique de Karnak (Le Caire, 1949) , pp. 23-24; E r w i n SEIDL, Einfilhrung in die âgyptische Reohtsgesohichte bis zum Ende des Ncuen Rciches (2' éd., 1951) , pp. 2 3 ; 4 0 ; 5 3 ; 5 9 ; Cl ia f ik CHEIIATA, Le testament dans l'Égypte pharaonique, d a n s R. hist. Droit fr. et étr., X X X I I , pp. 10-11; Ar. THéODOKIDèS, La donation conditionnelle du Vizir Ay, d a n s R. intern. droits Antiquité (= RIDA), 1958, pp. 38-42.
(38) L ' i n d i c a t i o n que porte le verso j o u e le rôle d 'une é t iquet te , m a i s e l l e e s t é c r i t e à m ê m e le p a p y r u s ; ce lui-c i é t a n t roulé, ce la d o n n a i t a i n s i u n apergu du c o n t e n u de la p ièce s a n s que l'on dût dérouler le papyrus .
(39) U n mty-n-ii é t a i t u n chef , d i rec teur d'un groupe de prê tres appe l é « p h y l ê » à l ' époque grecque , d'où pour son chef le t i t r e d e « p l iy larque ». P . LACAU (Une stèle juridique de Karnak (Le Caire, 1949) , p. 23) prend l e s t r o i s t r a i t s qui c o m p l è t e n t à^, d a n s l e t ex te , non pour l ' ind ice d'un co l l ec t i f , m a i s pour u n p l u r i e l ; et i l t r a d u i t en c o n s é q u e n c e mty-n-sjio par « chef des co l l èges de prê tres ». Cf. sur ce t te c h a r g e qui d e v a i t donc ê tre importante , e t qui é ta i t , ."i l 'époque, patr imonia l i sée , puiscpie son détent eu r eu d i s p o s e c o m m e d'une i jropriété s t r i c t e m e n t pr ivée : H . BONNET, Reallexikon dcr âgyptischen Religionsgeschichte (Ber l in , 1952) , pp. 600 a ; 602 b - 603 a ; H . KEES, Die Phylen und ihre Vorsteher im Dienst der Tcmpel und Totenstiftungcn, d a n s Orientalia, X V I I (1948), pp. 71-90.
(40) I n u t i l e de d ire que la d a t e e s t b ien i n c o m p l è t e puisqu' i l lu i m a n q u e
126 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
I I / L'intitulé de l'acte :
< 1 6 > A C T E D'« I M Y T - P E E » Q U ' A D R E S S É L E « P H Y L A R Q U E » M E -
R Y S A Ï N T E P ^ S U R N O M M É K E B I ^ E N F A V E U R D E < 1 7 > S O N F I L S I N T E F -
SAMERY, SURNOMMÉ lOUSENBOU.
I I I / Les dispositions prises par Merysaîntef :
a) La clause fondamentale ou « imyt-per » A.
— « J e donne {livA hr rdlt) mon < 1 8 > ' p h y l a r q u a t ' (*') {psy.l mty-n-é}) à mon fils In t e f saméry , su rnommé lousen-bou, à charge {*̂ ) de m 'ê t r e un ' bâ ton de vieillesse ' (^')
l ' essent ie l , l e n o m du S o u v e r a i n régnant . D e s cr i t ère s p a l é o g r a p h i q u e s p e r m e t t e n t d 'a t tr ibuer le t e x t e à la fin de la X I I " dynas t i e , e t la l o n g u e u r d u règne, d è s lors, n o u s au tor i s e à po inter s a n s h é s i t e r l e n o m d ' A m e n e m h a t I I I ( 1 8 5 0 - 1 8 0 0 ) ; c f . F . L l . G B I F F I T H , op. cit., p . 2 9 ; G . M A S P E R O , op.
cit., p. 436 e t n. 3. Ce d o c u m e n t qui pour d 'autres ra i sons que n o u s e x a m i n e r o n s p lus l o i n
e s t u n e e x p é d i t i o n d'acte, a pu ê tre e x t r a i t d'un reg i s t re d a n s lequel on n ' ind iqua i t p a s c h a q u e j o u r le nom du Roi ; à m o i n s que le scr ibe qui a d é l i v r é c e t t e ex i jédi t ion n'ai t p a s reprodui t ce nom, car il d e v a i t a l l er d e sol , é v i d e m m e n t , qu'à ce m o m e n t on v i v a i t s o u s l e r è g n e d ' A m e n e m h a t I I I !
(41) L i t t é r a l e m e n t « m o n mty-n-é^D, l e n o m d e ce lu i qui e x e r c e u n e c h a r g e es t ident ique , en égypt ien , à ce lu i d e la c h a r g e e l l e -même (cf. K. SETHE, Die Einsctzung des Veziers mter âer 18. Dynastie (Leipzig , 1009) , p. C, n. 12, e t p. 3 9 ; A. GARDINER, Grammar\ p. 330, n. 5 ) . I l e s t probab le qu'une v o c a l i s a t i o n s p é c i a l e d i f f érenc ia i t l e s d e u x e m p l o i s d u m o t (P. LACAU, Une stèle juridique de Karnak (Le Caire, 1949) , p. 25) .
(42) L i t t é r a l e m e n t « pour (être) m o n b â t o n d e v i e i l l e s s e ». (43) N o u s a v o n s d i s c u t é a i l l e u r s (La donation conditionnelle du Vizir
Ay, d a n s RIDA, 1958, p. 40, n. 31) le s e n s d e c e t t e expres s ion , en quoi K. SEïHE (Erlàutcrungen zu den àf/yptischen Lesestiicken, p. 150) v o u l a i t vo ir u n « c o a d j u t e u r et succes seur présompt i f » d u f o n c t i o n n a i r e en i ) lace; u n e p a r e i l l e in t erpré ta t ion n e c o n v i e n t c e r t a i n e m e n t p a s ici , puisqu' i l e s t s t r i c t e m e n t s t ipu lé d a n s l 'acte que la ce s s ion sera i n s t a n t a n é e .
L e père p l a ç a i t en f a i t sa f o n c t i o n en rente v i a g è r e ; G. JIASPERO a b ien sa i s i qu'il s ' ag i s sa i t d'une c h a r g e Imposée à la d o n a t i o n (« I l ne m e t à c e t t e c e s s i o n qu'une cond i t ion u n i q u e » {op. cit., p. 4 3 8 ) ) , m a i s il a f fa ib l i t la pert i n e n c e d e l ' expl icat ion , en a j o u t a n t : « l e fils q u e l 'on qual i f i e de la sor te é t a i t ce lu i qui e n t r e t e n a i t son i)ère flgé, a ins i que la loi l'exigeait » (nous
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 127
(r ' indw-i3w W), < 1 9 > pour la raison que je suis infirme (hft ntt wi tn.kw.i).
« Qu' i l en soit investi i n s t an t anémen t (Iml dhn.t(w).f m t3 3t).
b) Les autres clauses ou « imyt-per » B C*).
— « < 2 0 > Q u a n t à l 'acte d " imyt-i>er ' (îr ts Imyt-pr) que j ' ava i s dressé en f aveur de sa mère {Irt.n.l n tsy.f mwt), a u p a r a v a n t {hr li}t), qu' i l soit révoqué {(rdX.tc) 83 r.é) («).
a v o n s sou l igné ) ; l e père n ' a u r a i t p a s d û e x p r e s s é m e n t s t ipu ler c e t t e condit ion, d a n s son propre a c t e d e ce s s ion d e la fonc t ion , s i la loi pharaoni -iiue i m p o s a i t a u x e n f a n t s d e s o u t e n i r l e u r s pères, ou l e u r s p a r e n t s e n g é n é r a l (cf. à ce propos Ar. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1966, pp. 60-6) . Ce (lue MASPEKO écr i t encore sur la m ê m e m a t i è r e est t h é o r i q u e m e n t fondé , m a i s n 'es t p a s a p p u y é par l e s d o n n é e s d u t e x t e : « la p h r a s e é t a i t l ' express ion j u r i d i q u e par laque l l e on qual i f ia i t son ( = du flls) devo ir e t l'engagement qu'il prenait d e l e r e m p l i r » ( m ê m e p a g e ; n o u s a v o n s s o u l i g n é ) . I l n'y a e f f e c t i v e m e n t a u c u n e t r a c e d'« e n g a g e m e n t » d a n s l 'ac te que n o u s f a i t c o n n a î t r e la Papyrus Kahoiin. VII, 1, e t c e p e n d a n t la m e n t i o n d e c e t engag e m e n t , ou c o n s e n t e m e n t , s e r a i t j u r i d i q u e m e n t requise d a n s u n e d o n a t i o n à charge . N o u s r e v e n o n s sur ce point i m p o r t a n t d a n s le c o m m e n t a i r e .
(44) L e s e n s d e tn\ s era e x a m i n é p l u s loin. (45) Ces c l a u s e s sont s e c o n d a i r e s par rapiKjrt à la d o n n é e f o n d a m e n t a l e
de l 'ac te d e s t i n é a u fils l o u s e n b o u ; i l y a Ici rappel d'un a u t r e ac t e dont le c o n t e n u a tourné à son d é s a v a n t a g e . D ' o ù l 'ut i l i té i n s t i t u t i o n n e l l e d e rechercher l e s r a i s o n s de la présence de ces c l a u s e s Ici.
(46) N o u s é c r i v o n s « imyt -per » B, p u i s q u e sur ce p a p y r u s r « Imyt-i>er » (|ul v a ê t r e rappe lé su i t r « imyt -per » A; m a i s c h r o n o l o g i q u e m e n t B e s t a n t é r i e u r à A, s a n s que n o u s n e p u i s s i o n s ê tre p l u s précis . I l f a u d r a e s s a y e r d'établ ir pourquoi l'a imyt -per » antérieur n'a p a s é t é r é v o q u é p l u s tôt, et pourquoi il l 'est ic i d a n s un a c t e d e s t i n é a u flls qui n 'es t p a s bénéf ic ia ire de B.
(47) L ' e x p r e s s i o n s'3 r.é e s t e l l ip t ique (A. GARDINER, Grammar^, p. 411, n. 2) ; e l l e e s t é c r i t e pour rditv «3 r.ii, « que le dos so i t t o u r n é c o n t r e ce la », o u « contre lu i » (l'a imyt -per » c i té) ; c f . R. CAMINOS, Late-Egyp-tian Misccllaniea (Londres , 1954) , pp. 27 ; 137. Voir sur la r é v o c a t i o n : E. SEIDL, Einfuhriing in. die (igyptischc Rcchtsgeschichte {2" éd., Gluck-s tadt , 1951) , p. 59.
128 A R I S T I D E T H É O D O K I D È S
« < 2 1 > E t (*) pour ce qui concerne ma maison (îr p3y.l pr), sise dans le domaine (?) (nty m ditt (?)) de Houtme-det (?), elle est pour mes < 2 2 > e n f a n t s ilw.f n nsyX n hrdtv ...), qui me sont (?) nés ("') de Satnebethenounesou, la fille du garde de conseiller de d i s t r i c t (™) < 2 3 > Sobek-emhat {{hrdw) m6y{w) ni \n 8., sst Imy-S3 knhty n tv S.), avec t ou t ce qu'elle cont ient » (/m*̂ ntt nbt Im.f) ('').
(48) D a n s !'« iniyt-per » B, le père a v a i t disposé de sa mai son et de son mobi l ier en f a v e u r de la mère du fils eess ionnaire de !'« imyt-per » A. Il le f a i t ici autrement , m a i s c'est des mêmes biens qu'il doi t s'agir. Le tout es t de savoir pourquoi il en est quest ion ici (voir le commenta ire ) .
(49) « Q u i me sont n é s » (msyiio) n.l In . . . ) : l i t téra lement « m i s a u monde pour moi par... » ; ce qui n'offre pas de di f f icul té en soi, n 'éta i t l a quest ion de savo ir à quel t emps du part ic ipe apimrt ient la f o r m e msy{w). El le est toujours interi)rétée comme un perfect i f , m a i s morphologiquement , e l le pent ê tre un prosi)ectif, avec le sens de : « (enfants ) qui na î tront », ou « vont na î t re », ou « pourront na î tre », ou « iwurra ient (me) na î t re ». N o u s comparerons d a n s l e commenta ire l e s ra i sons qu'il y aura i t de pencher pour un temps plutôt que pour l 'autre.
(50) Voir sur l'tmy-s^ n knhty n w : W i l l i a m C. HAYES, A Papyrus of tlie Late Miûdle Kingdom (1955), p. 69 ; W. HEIXK, Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reich (1958), p. 239.
(51) I^e pr, « ma i son » (car ici ce t e rme a cer ta inement conservé son sens premier) , et « ce qui e s t en e l le » correspondent concrètement à l 'éty-molog ie de imyt-pr, m a i s cet te express ion, devenue abs tra i t e e t technique, a dépassé dans son appl icat ion e t son ex tens ion le re levé m i n u t i e u x d'objets se t rouvant d a n s un pr, au point de dés igner donc tout ac te de mutat ion, et par voie de conséquence d'exiger cer ta inement d a n s la pratique l 'adjonction, à l 'acte de dévolut ion ou de donation, d'un relevé, d'un inventaire a u sens str ict du terme. On se rappel lera à ce propos l ' introduct ion a u x Contrats d 'Hâpidje fa où le f o n d a t e u r d i t à son prêtre - funéra ire : « . . . afin que tu ve i l l es sur toutes les choses que j 'ai p lacées sous ta direct ion ; vois, e l les te sont présentées par écri t » {m.k ét hft hr.k m si) ; « par écri t », c'est-à-dire sûrement dans un acte que nous présumons être un « imyt-per » accompagné d'un relevé.
A. MoRET semble y avoir pensé pour ce qui concerne l e Papyrus Kahoun VII, 1, m a i s en déplaçant l 'argument, lorsciu'il r é sume l 'acte en ces t ermes : « u n vérif icateur d'une ' c las se ' de prêtres dresse un inventa i re de ses b iens pour son fils, à qui il d<mne sa fonct ion . . . » (Le Nil et la civilisation égyptienne (2" éd., Paris , 1937), pp. 307-308). Si « inventa ire », en effet, il y a eu (et il e s t très probable qu'il y en a i t eu) , ce ne f u t cer ta inement p a s à l 'usage du fils qui obtenai t la fonct ion paternel le comme part d'héritage.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 129
I V / Les témoins :
< 2 4 > Lis te nominat ive des témoins qui on t ass is té à l a confect ion du p résen t ac te d '« imyt-per » (imy-rn.f mtrw iry Imyt-pr tn r gs.én) : ( t ro is noms).
I l es t man i f e s t e que l 'acte que nous avons appelé « imyt-per » A ne r empl i t p a s les condit ions d 'un t e s t ament , puisque son a u t e u r exige qu' i l produise ses effets ins tan tanément . La fo rmule qui l ' indique {m t} 3* : « à l ' i n s t an t ») ('^) a été jugée p a r Gas ton MASPERO comme é t a n t « la p lus impérieuse de celles que la langue égypt ienne connaî t » (").
Ce t te cons ta ta t ion v iendra i t appuyer l 'opinion de s avan t s qui ne reconnaissent pas l 'existence du t e s t amen t en Égyp te ; ma i s la simple présence de la fo rmule en quest ion — qui es t celle d 'une donat ion — est un indice sérieux en f aveur d 'un po in t de vue opposé : s 'il f a u t en effet p rescr i re ca tégor iquement l ' ins tant ané i t é du t r a n s f e r t , c 'est que t ou t ac te égyptien de m u t a t i o n ne l ' impl iqua i t pas , e t que p a r t a n t une a l iénat ion ne s'opéi*ait p a s indispensablement comme une dona t ion en t re vifs (^).
Mais le problème est encore p lus complexe qu' i l a p p a r a î t r a i t à première vue.
T o u t d 'abord , concernant le Papyrus Kahoun VII, 1, on a a f fa i re à une incontes table donat ion , ma i s avec charge, puisque le d i sposan t s t ipule à son profi t une ren te viagère (^') ; a u surp lus , il jus t i f ie son exigence ou son a t t i t u d e en se déc la ran t tnl.
Ce verbe est t o u j o u r s t r a d u i t p a r « vieillir » ou « ê t r e vieux », ma i s il ne p rocu re ra i t ici comme disent les collègues anglo-saxons, qu 'un « poor-sense ». L'expression « bâton de vieillesse »
(52) Papyrus Kahoun VII, 1, X I , 19 [ = SETIIE, Lesestiicke, 90, 6 ] . (53) G. MASPEBO, d a n s Bibl. Égyptol., V I I I , p. 438. (54) Cf. P . W . PESTMAN, Marriage and Matrimonial Property in Ancient
Egypt (Leyde, 1961), p. 1 3 8 : « I t i s exp l i c i t ly s ta t ed t h a t t h i s o f f i c e i iumedia te ly p a s s e s to t h e son, s o w e niay a s s u m e t h a t such a transm i s s i o n h a s no i m m é d i a t e e f f e c t in other cases ».
(55) Papyrus Kahoun VII, 1 (XI , 18) : « . . . à c h a r g e de m'être im bâ ton de v i e i l l e s se ».
9
130 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
la isse dé jà en tendre que le d isposant n 'es t pas précisément jeune, et si tnl s ignifiai t « ê t re vieux », il ne p o u r r a i t que renforce r cet é ta t , et cependant no t re mty-n-és se p ré tend ap t e à fonder une nouvelle famil le ! C'est pourquoi II y a p lu tô t lieu d 'accorder à tnl le sens de « ê t r e infirme », comme nous le m o n t r e en par t icul ier u n e x t r a i t du « P r ince Prédes t iné » (^).
La donat ion enfin est complétée p a r la révocation d 'un acte an té r ieur .
A cet égard, on f e r a observer qu'on a u r a i t pu s ' a t t endre à ce que la révocation de cet acte-là eû t dû s 'effectuer a v a n t la rédact ion du nouvel acte. On a u r a i t pu même concevoir qu ' i l n ' eû t p a s fa l lu la f a i r e du tou t , cette révocation, vu que le dern ier acte a u r a i t ipso fac to annu lé le précédent .
C 'est donc qu'ici les deux actes ne cont iennent p a s de disposit ions incompat ibles : l 'un n 'es t pas condi t ionné p a r la non-existence de l ' au t re , e t inversement. E t si nous y p rê tons a t t en t ion , nous relèverons que l '« imyt-per » que nous avons sous les yeux (le p résen t acte) es t en effet dressé en f aveur du fils("), a lors que l ' au t re , l 'acte révoqué, l ' é ta i t en f aveur de la mère(^*). Mais a lors pourquoi en est-il question ici ?
L'essentiel à dégager de cet é t a t de choses pour l ' i n s tan t , est que l ' ac te a n t é r i e u r n ' ava i t p a s été exécuté, e t qu ' i l n ' ava i t sûremen t pas été pourvu d 'une clause de t r ans l a t ion immédia te : un * imyt-per » n ' incarne pas p a r n a t u r e une donat ion en t re vifs, à moins que, comme nous le soupçonnions p lus hau t , une clause expresse n 'y soit insérée à cet te fin.
Des « imyt-per » peuvent donc ê t re compris d i f féremment , et engendre r des effets différents .
Apparemment , l '« imyt-per » révoqué ava i t valeur de testam e n t ; sa révocabil i té le carac té r i se ra i t , e t il r e s t a i t soumis à la volonté de son a u t e u r jusqu ' à la mor t de ce dernier .
(56) « Inf irme » clans l e s e n s d' impotent , e t non de « to become décrép i t », c o m m e le s u g g è r e A. GARDINER, The Wilbovr Papyrus, I I (Oxford , 1948) , p. 2 9 , n. 1 .
(57) Papyrus Kahonn VII, 1, V ; R° 17 ; 18 ; 19. ( 5 8 ) Id., 2 0 .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T B A N C I E N N E 1 ^
Sans doute, la révocation peut-elle, en principe, af fecter auss i une donat ion . Mais le d i sposant ne peut la f a i r e un i l a t é ra l emen t ; les causes en sont légales. Bien que nous n 'ayons p a s rencont ré en Égypte d ' ac te de donat ion révoqué, on peu t considérer que ce f û t possible, dès le moment qu'i l y ava i t des donat ions avec charge, pour les cas où les condit ions imposées n ' au ra i en t pas été respectées C ) .
Pu i sque nous en sommes t o u j o u r s aux observat ions qne susci te no t r e document , fa i sons remarquer , sans plus t a rde r , qu'à iiropos d 'une donat ion même grevée d 'une condit ion comme ici, le t ex te ne r en fe rme pas l 'expression d 'un accord de la p a r t du dona ta i re . Nous ne fa i sons que noter la chose, nous p roposan t d 'y revenir un peu p lus loin.
P a r a i l leurs , puisqu ' i l n 'y a pas d ' incompat ib i l i té en t re les deux « imyt-per » (nous avons jugé qu ' i ls pouvaient coexister) , on est en dro i t de se demander pourquoi il y a eu révocation. E t au demeuran t , a-t-elle v ra iment existé ?
Comme le d i sposant se remarie , on sera i t por té à croire que sa première femme est morte , e t l ' in tervent ion de sa volonté pour révoquer l 'acte semblerai t i nu t i l e ; celui-ci en effet a u r a i t été rendu inefficace pa r la mor t même de la destinat<aire.
Mais jus tement , comme il n 'y a pas eu de cause de caduci té , et qu ' i l a donc a p p a r t e n u au d isposant de rompre l 'eff icacité de sa première volonté, la légata i re de l '« imyt-per » a n t é r i e u r n ' é t a i t peut-être pas mor t e ! ...
Faud ra i t - i l a lors supposer que la femme eû t été répudiée (sans que nous n ' en t r ions ici dans aucune a u t r e considérat ion concern a n t la dissolut ion du mar iage en Égypte "^*) ? I l se ra i t peu compréhensible, en cas de dissolut ion bru ta le du mar iage , que le mar i n ' eû t pas — à ce qu'il ressor t du texte — annu lé a u moment même la l ibéral i té qu'i l ava i t consentie à son épouse.
(59) Cf. RIDA, 1960, p. 99, n. 224. (60) Cf . Ar. TiiÉODORiDÈs, La répudiation de la femme en. Égypte et
dans les droits orientaux anciens, d a n s B. Soc. Fr. Égyptol., 47 (1966), pp. 0 .sqq.
132 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
Le problème demeure ent ier , si ce n 'es t qu ' i l ne peu t ê t re mis en doute que le m a r i a personnel lement et un i l a t é ra l emen t révoqué l 'acte an té r i eu remen t dressé p a r lui en f aveu r de cet te f e m m e ; problème, disons-nous, parce qu'i l f a u t de tou te façon expl iquer pourquoi c 'est dans un acte dest iné a u fils que le père annu le l 'acte qui é t a i t dest iné à la mère de ce fils.
Ce ne peu t v ra iment ê t re que parce que le flls é t a i t touché p a r la décision pr i se en f aveur de sa mère : il f a u t comprendre p a r là qu ' i l é t a i t l 'hér i t ie r subst i tué , le père a y a n t réglementé la dévolut ion d 'une pa r t i e de ses biens dans ce sens (^'). L ' immeuble avec le mobil ier n ' au r a i en t été remis à la mère que comme u n fldéicominis don t elle a u r a i t jou i j u squ ' à la fin de ses jours , sans pouvoir en disposer à son tour , sans exercer sa p rop re volonté s u r l ' o r ien ta t ion f u t u r e de ces biens.
Son fils, l 'appelé, é t a i t le bénéficiaire réel de la l ibéral i té , ce qui explique que, quel qu 'a i t été le sor t de la mère, la val idi té de l ' ac te (l'« imyt-per » B) f u t demeurée entière.
Mais une nouvelle femme est en t rée dans la vie du d i s p o s a n t ; tel le est, du moins, l ' impression que l 'on éprouve à voir I t soin qu ' i l p rend à donner l ' ident i té détai l lée de cet te dame, don t i l v ient d 'avoir , ou . . . va avoir , des enfan ts .
L a fo rme par t ic ip ia le mi<y{w) a t o u j o u r s été p r i se pour un passé (^^), ma i s r ien n 'empêche gi-ammaticalement de la considérer comme par t ic ipe passif prospectif (") ; on se r é fé re ra pour l ' idée à une des clauses de l'« imyt-per » du Papyrus Kahoun I , 1 où la fo rme verbale, mise à l 'ac t i f , devient un relatif pros-
(61) Comparer la subs t i tu t ion d a n s la Stèle Juridique de Karnalc, e t à ce propos, n o t r e Donation conditionnelle du Vizir Ay, d a n s RIDA 1958, pp. 3 3 sqq.
(62) A. GARDLN'ER, Egyptian Grammar\ p. 278, n. 1 0 ; G. LEFEBVRE, Grammaire de l'Égyptien Classique^, § 449 : « l e s e n f a n t s m i s au m o n d e pour moi i^ar... ». Voir la n. 49.
(63) B i e n q u e B . GUNN n e l 'a i t p a s r e t e n u d a n s s e s Stiidies in Egyptian Syntax (Par is , 1924) , pp. 26 sqq.
(64) Papyrus Kahoun 1,1 [ = GBIFFITH, Hieratic Papyri from Kahun and Giiroh, pl. X I I , 9-10 = K. SETHE, Lesestucke, 90, 24 - 91, 1 ] ; c f . Ar. THéODOHIDèS, A propos du relatif prospectif, d a n s Annuaire Inst. Or. Univ. Bruxelles, X I V (1954-1957), pp. 91-92; La vente à crédit du Papyrus Kahoun I, 2, et ses conséquences, d a n s RIDA 1961, pp. 45-46.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 183
pectif : « . . . et elle ( = ma femme), elle r eme t t r a (ces biens que je lui lègue) à celui quel qu ' i l soit qu'elle p ré fé re ra p a r m i ses e n f a n t s qu'elle me donnera {ms{y).é n.V) » ('').
Aussi dans le cas du Papyrus Kahoim VII, 1, nous faudra- t - i l envisager les deux faces de l 'a l ternat ive .
Si les e n f a n t s sont dé jà nés, il p o u r r a i t p a r a î t r e é t r ange qu ' i ls ne f u s s e n t pas, sinon nommés, du moins dénombrés ('^). I l y a u r a i t eu en ou t r e un r isque cer ta in de les voir pr ivés de tou te p a r t de l 'hér i tage pa te rne l ("), si leur père é t a i t m o r t su r ces en t re fa i t e s ; il se ra i t impensable que leur mère eût accepté cet te pré judic iab le s i tua t ion .
On est condui t p a r conséquent à se figurer que les e n f a n t s ne sont pas encore nés, et que le père exprime une espérance d a n s ce sens, à moins que ce ne soit une réal i té qu'i l sai t , lui, ê t r e prochaine.
C'est donc l 'explication prospective de la fo rme mîtyyw) qui se ra i t adéqua te à ces considérat ions. Nous discernons tou te l 'incidence d 'une fo rme verbale su r l ' i n te rp ré ta t ion ju r id ique de l ' ac te ; elle f e r a i t a p p a r a î t r e la clause comme ne recevant son exécut ion que dans l 'avenir , c'est-à-dire, à d é f a u t d ' au t r e indica t ion , au moment de la m o r t du disposant .
Nous aur ions , pour l 'ensemble, a f fa i re à un t e s t amen t qui comp o r t e r a i t une donat ion immédiate.
Toutefois (il nous f a u t effectivement ten i r compte des moindres détai ls) , nous pour r ions achopper a lors — quoi qu'en pensen t les g rammai r i ens qui la t r a d u i s e n t p a r le f u t u r («e l l e appar t i e n d r a à mes e n f a n t s » ('*)) — su r la fo rme lic.f n, « e l l e est
(05) Cf. B . GiNN, op. cit., p. 9 e t n. 1. (66) V o i r l e « T e s t a m e n t de S é n i m o s é » [ = SETHE, Urk. lY, 1070, 4 ] :
« . . . 1" imyt -per ' que j 'a i f a i t en f a v e u r d e m e s quatre e n f a n t s ». (67) I l n'y a a u c u n e t race d a n s la d o c u m e n t a t i o n d e ce t te pér iode d 'une
r é s e r v e d e s e n f a n t s sur l e s b i ens des parents . D e s r e c o u p e m e n t s n o u s autor i s e n t h l ' a d m e t t r e pour l 'époque r a m e s s i d e (dernier quart du 2" m i l l é n a i r e av. J.-C.) ; c f . Ar. THéODOBIDèS, A propos de la loi dans VÉgyptc pharaonique, d a n s RIDA 1967, pp. 142-143.
(68) G. LEFEBVRE, Grammaire^ § 1 5 5 : « Q u a n t à m a m a i s o n , . . . e l le a p p a r t i e n d r a à m e s e n f a n t s ; ou : m e s e n f a n t s l ' auront » ; cf . A. GARDINER, Granimar^, p. 88, n. 10.
134 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
pour », « elle a p p a r t i e n t à », en p a r l a n t ici de la maison. Cet te fo rme sera i t l ' indice d 'un déplacement immédiat de la propr ié té , exac tement para l lè le à ce qui est décidé pour la fonct ion de mty-n-s3 d a n s la première p a r t i e de l 'acte (« qu' i l en soit invest i immédia tement »). Nous serions en définit ive en présence d 'une incontes table donat ion en t re vifs.
Mais le père se dépoui l lant de t ou t son avoir , pouvait-i l décemm e n t vivre avec sa nouvelle épouse ? I l n 'es t pas impossible qu' i l a i t eu la jouissance des biens donnés a u x e n f a n t s en a t t e n d a n t que ceux-ci a ien t a t t e i n t leur major i t é , et de tou te façon, le fils a îné s 'est obligé à lui a l louer une ren te viagère, comme il y a lieu d ' i n t e rp ré t e r l 'expression « (être) un bâton de vieillesse (pour quelqu 'un) ».
I l res te cependant à f a i r e une remarque fondamenta le pour la procédure, à pi'opos de cette condit ion imposée au fils. S' i l est, comme nous l 'avons noté, peu admissible que les e n f a n t s dé jà nés ne soient pas nommés, n i dénombrés, il l 'est encore moins de ne p a s r encon t re r dans l 'acte l 'expression de l 'acceptat ion du donata i re , d ' a u t a n t p lus que, répétons-le, la donat ion se f a i t avec charge.
Des ind ica t ions f o n t dé fau t comme celle qui concerne les en fan t s , e t celles, d 'ordre admin i s t r a t i f , qui devra ien t nous a p p r e n d r e la da te de l 'acte avec précision, et le bureau où le docum e n t a été enregis t ré (^') ; mais la p lus grave des omissions es t celle du consentement du donata i re .
L 'expl icat ion peu t en ê t re simple : comme souvent, t r o p souvent, nous n 'avons pas devant nous l 'acte lui-même sous forme de minu te ou de copie conforme. I l s 'agi t d 'une expédit ion incomplète délivrée p a r l ' admin i s t ra t ion à la pa r t i e intéressée (™), en
(G!)) Voir, par exemple , l ' iuclication de ce g e n r e m e n t i o n n é e d a n s le Papyrus Kahoun I, 1 [= GEITFITH, X I I , 5 = K. SETHE, Lesestiicke, 90, 18-19] ; cf . W. IlELCK, Zur Venvaltung des Mittleren und Neucn Reichcs, pp. 241 ; 243 ; Ar. ïHéODOBIDèS, d a n s RIDA, 1961, p. 44.
(70) Cf . M. MALINEœ, Notes Juridiques, d a n s B. Inst. Fr. Arch. Or. X L V I (1947), p. 96 : « C e n e sont, en effet , v r a i s e m b l a b l e m e n t , que so i t d e s n o t e s d 'aud ience p r i s e s a u cours d e procès ou d 'opérat ions j u r i d i q u e s ( lue lconqnes e t qui p o u v a i e n t s erv i r de broui l lon pour f a c i l i t e r la rédac-
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 135
l 'occurrence le fils aîné. Cet te expédi t ion cont ient l 'essentiel , l 'essentiel pour le point de vue de celui qui l 'a réclamée. Mais hélas, quelles diff icul tés n'engendre-t-elle pas pour nous, qui devons recons t i tuer l 'h is toire des ins t i tu t ions de l 'Égypte ancienne, et en indu i re la procédure, à p a r t i r de bribes souvent dispara tes . On a ment ionné en gros les enfan t s , sans au t r e s précisions, le po in t u t i l e pour le fils é t a n t de savoir que tou te une pa r t i e de l 'avoir pa te rne l a l la i t lui échapper ; cette par t ie , elle, elle es t spécifiée : « la maison avec t ou t ce qu'elle cont ient ».
Q u a n t au consentement , va-t-on objecter , comment pourra i t - i l ne pas êti-e ment ionné, a lors qu' i l est un élément const i tu t i f de l 'acte ?
IMais ju s t emen t l 'existence même de l 'acte a t t e s te ce consentement , l 'acte n ' a u r a i t pas pu ê t re p a r f a i t sans l u i ; que le fils à qui é ta i t dest inée l 'expédit ion d 'ac te que forme pour nous le Papyrus Kahoiin VII, 1, a i t expr imé son accord, il devai t pert inemment le savoir ; aussi , su r une pièce devant servir à son usage, peut-on comprendre que cet accord n ' a i t p a s été reprod u i t ; ce qui pe rme t évidemment d ' a j ou t e r que d ' a u t r e s expédit ions du même acte au ra i en t pu comporter d ' au t r e s éléments, e t avoir été rédigées d ' au t r e s manières .
On dédu i t de ces données que r « imyt-per » B, tel qu ' i l a été rédigé, ne peu t se comprendre sans la not ion égypt ienne de « test a m e n t » : c 'é ta i t un acte un i l a t é ra l r endu exécutoire à la m o r t du d isposant , puisqu ' i l a été révoqué p a r lui ; ma i s l ' ac te même, qui énonce cet te révocation, n 'es t pas un tes tament .
t i on dé i în l t i ve d e s a c t e s a u t h e n t i q u e s correspondants , é tab l i s sur p a p y r u s ; so i t de s i m p l e s e x t r a i t s de ces a c t e s dé l i vrés a u x p a r t i e s in téressées . L a r é d a c t i o n d e ces d o c u m e n t s e s t t ou jours très concise , l a t â c h e d u scr ibe é t a n t é v i d e n u n e n t de f ixer l 'essent ie l , s a n s se souc ier d 'aucun déta i l . C'est a ins i que le f o r m u l a i r e développé, consacré par l 'usage, que p o s s é d a i e n t l e s scr ibes pour la rédac t ion d e s a c t e s au thent iques , y f igure s o u s u n e f o r m e très a b r é g é e ; à te l po int que l e s t e r m e s p r i n c i p a u x c a r a c t é r i s a n t u n e opérat ion d o n n é e à l aque l l e l e d o c u m e n t s e rapporte , y m a n q u e n t quelq u e f o i s tout à f a i t . Le l a c o n i s m e de l ' express ion y a t t e i n t p a r f o i s u n degré s i c o n s i d é r a b l e que le t e x t e d e v i e n t u n e sor te d 'a ide -mémoire personne l qui res te i n c o m p r é h e n s i b l e à t o u t e p e r s o n n e au tre que son a u t e u r ».
136 ARISTIDE T H é O D O K I D è S
Nous in te rpré te r ions donc l 'ensemble du Papyrus Kahoun VII, 1, comme une donation-pai-tage ; ou, comme G. MASPERO l 'avai t r emarquab lemen t exposé (") à la fin du siècle dernier , ce sera i t , conformément à l 'ancienne nomencla ture , une « démission de biens », puisque le père s'en remet à son a îné du soin de l 'entret en i r , t o u t en con t inuan t de l ' au t r e côté à vivre dans ses meubles et sa maison.
Voilà pour le contenu.
I l impor te m a i n t e n a n t que nous nous a t t ach ions un i n s t a n t à la terminologie en f ixant spécialement le te rme imyt-pr. I l désigne d a n s le même document l ' ac te de donat ion en t re vifs, e t l 'acte t r ans la t i f de propr ié té qui n ' a u r a i t p rodu i t ses effets qu ' à la m o r t du père.
I l n ' eû t p a s fa l lu que le fils a îné se p réva lû t de l 'acte antér ieur , dressé indi rec tement pour lui, parce qu' i l a u r a i t été f a i t p a r le moyen de la subs t i tu t ion , l 'hér i t ie r de t o u t l 'avoir paternel. P o u r ce qui concerne la maison e t le mobilier, le père a donc révoqué l 'acte, afin d'en disposer d 'une a u t r e manière .
Le père r é p a r t i t ses biens ('^), et l ' ac te qui organise cette nouvelle r épa r t i t i on e t qui est r endu immédia temen t exécutoire, po r t e le même nom que l 'acte qui a été révoqué : Imyt-pr. I l en ressor t sans conteste que nous avons a f fa i re à un t e rme générique.
(71) G. MASPERO, d a n s Bibl. Éqypt., V I I I , p. 437. (72) C'est pourquoi n o u s par lons de donat ion-partage , v u que le père
f a i t lu i -même et dès m a i n t e n a n t l e p a r t a g e de ses b i ens en tre son fi ls a îné, qui obt ient l a f o n c t i o n de mty-n-é}, e t l e s a u t r e s e n f a n t s i ssus , ou il na î t re (?) de sa seconde union, à qui e s t réservé l ' immeuble a v e c son mobi l ier . Ces derniers b iens rev iendra ient a u x d i t s e n f a n t s par par t s é g a l e s ; e t d a n s l ' éventual i té où il n'y a u r a i t p a s d ' en fant du tout, le f i ls a î n é sera i t appe lé à hér i ter de ces biens.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' K G Y P T E A N C I E N N E 137
CHAPITRE I I I : L'acte f/ '« imyt-per ».
Étymologiquement , Xmyt-pr (") s ignif ierai t « ce qu' i l y a dans la maison », « ce qui est dans la maison » ('''), pr é t an t p r i s au sens p rop re de « maison » Ç^), ou au sens p lus large de « domaine » C^). Ce t e rme composite a u r a i t donc désigné le mobil ier en
(73) Cf. Gas ton MASPEEO, Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, IV (liibl. Égyptol., V I I I (Paris , 1900), p. 435) , a v e c l 'essent ie l de la b ib l iographie du x i x ' s. ; A l e x a n d r e MOEET, Donations et fondations en droit égyptien, d a n s i fec . Trav., X X I X (1907), pp. 72 et 8 0 ; J a c q u e s PI-BENNE, Histoire des Institutions et du Droit Privé de l'ancienne Égypte, I I (Bruxe l l e s . 1934), pp. 301 sqq. ; B. GRDSELOFF, Deux inscriptions juridiques de l'Ancien Empire, d a n s Ann. Serv. Ant., X L I I (1943), pp. 3 0 sqq.; P i erre LACAU, Une stèle juridique de Karnak (Le Caire, 1949), pp. 7, 9, 20, 23, 25, 35, 41-42; E. SEIDL, Einfiihrung in die àgyptische Rechtsgeschichte his zum Ende des neuen Reiches (Juristischer Teil), 2° éd. (Gli ickstadt , 1951), pp. 22 sqq., 57 sqq.; du même, Zum juristi.ichen Wortsehatz der nltcn Acgypter, d a n s Festsclirift Franz Dornseiff (I^eipzig, 1953), i)p. 320 sqq.; C h a f i k CHEHATA, Le testament dans l'Égyptc pharaonique, d a n s R. hist. Droit fr. et étr., X X X I I (1954), pp. 3 sqq.; I. HARARI, Portée de la Stèle Juridique de Karnak : Essai sur la terminologie juridique du Moyen Empire égyptien, d a n s Ann. Serv. Ant., L I (1951), pp. 280, 284, 293, 2 9 6 ; du môme. Nature de la Stèle de donation de fonction du Roi Ahmosis à la Reine Ahmes-Nefertari, d a n s An)i. Serv. Ant. LVI (1959), pp. 179-199; W i l l i a m C. HAYES, A papyrus of the Laie Middle Kingdom in the Brooklyn Muséum (n° 35.1446), T h e B r o o k l y n Muséum (1955), pp. 114, 116, 122, 143; A. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1957, p. 3 4 ; 1958, pp. 42 sqq.; 1962, pp. 52 sqq. ; F r a n ç o i s DAUMAS, La Civilisation de l'Égyptc pharaonique (Paris , 1965), pp. 148, 196; T y c h o MRSICH, Untersuchungcn eur Haus-nrkunde des Alten Reiches : Ein Beitrag zum altagyptisvhen Stiftungs-recht (Berl in , 1968), pp. 1 sq(i.
(74) Ou a u s s i d'après l 'é tude e x h a u s t i v e qu'en f a i t T y c h o MRSICH, op. cit., p. 35 : « d a s - w a s - d a s - H a u s - a u s m a c h t (repri lsentlert) ».
(75) Voir d a n s T y c h o MRSICH, op. cit., pp. 25-26, pr e t l ' évo lut ion du terme, pour about ir (p. 35) à « f u n d u s », « f a m i l i a » : « Dabe i i s t ' H a u s ' . . . e in K o m p l e x e r B e g r i f f . . . der s ich anf l ' ersoneu und Vermogen er-s treckt ».
(76) E t de là, parfo i s , l'« h é r i t a g e » en g é n é r a l ; a ins i d a n s l e s Textes des Pyramides, 1219 d : « . . . comme H o r u s reçut la m a i s o n de son père des m a i n s du f rère de son père, Seth, en présence de Geb ». C'est l e d o m a i n e de l 'État qui représente ici, en réal i té , r « hér i tage paterne l ».
R a p p e l o n s ce qu'a écr i t à ce suje t Al. MORET (DU caractère religieux de la Royauté pharaonique (Paris , 1902), pp. 14-15) : « Q u a n d un fils
138 A R I S T I D E T H É O D O K I D È S
général . L ' ad jonc t ion comme déterminat i f du signe d u rouleau de p a p y r u s prouve qu ' ayan t évolué, il s 'est appl iqué à l'écrit su r lequel avaient été consignés les obje ts du mobilier, de là le sens d '« inventa i re », et enfin comme l ' a t t e s t en t les emplois qui en sont fa i t s , les actes réguliers , au thent iques , à l 'occasion de la rédact ion desquels un « inventa i re » é t a i t vra isemblablement exigé. E t « imyt-per » a pu acquér i r de la sor te l 'acception général isée d 'ac te de muta t ion , quels qu 'a ien t été les modes de t ransf e r t prévus pour la p ropr ié té ("). De tou t e façon, « p r o p r i é t é privée » il devai t y avoir, et, con t ra i rement à ce qui a été souvent p ré tendu , cette p ropr ié té avai t pour carac tère d ' ê t re mobile, puis-
p o s s é d a i t d e p le in dro i t u n b ien v e n a n t d e son père, on d i s a i t qu'i l é t a i t « é t a b l i » {smen) sur ce bien en qua l i t é d'« hér i t i er » (Iw'^w) : c 'est proprem e n t la f o r m u l e j u r i d i q u e qui a t t e s t e la propriété . Le dro i t h l 'hér i tage s ' a p p u y a i t le p l u s s o u v e n t sur u n « i n v e n t a i r e - t e s t a m e n t » (imyt-pr) (lit . : « ce qui e s t d a n s la m a i s o n ») ; l e p è r e l e r é d i g e a i t e t l e f a i s a i t enreg i s t rer a u g r e f f e d u noniarque par d e v a n t t émoins . L ' i n v e n t a i r e - t e s t a m e n t d o n n a i t l a descr ip t ion d é t a i l l é e d u bien transmis , a v e c sa contenance , et, s'il y a v a i t l ieu, l e n o m b r e des ma i sons , d e s c h a m p s cu l t ivés , d e s arbres , d e s sources , des s e r f s d e la glèbe, qui y é t a i e n t compris . L e s É g y p t i e n s imagi n è r e n t que l i a , le premier roi d'Égypte, a v a i t l é g u é son h é r i t a g e à P h a raon s u i v a n t la f o r m e légale , par « i n v e n t a i r e - t e s t a m e n t » ; on le sa i t par u n t e x t e d u t e m p l e d ' E d f o u dont l ' imixirtance n'a p a s é t é s u f f i s a m m e n t remar(iuée. On vo i t sur le m u r e x t é r i e u r du temple , l e « g r e f f i e r d iv in » ï l i o t , r o u l e a u de p a p y r u s en main , s 'adresser au d i eu H o r u s (et au Pto -l é m é e qui s ' ident i f le à H o r u s ) , e t lu i d i r e : « J e t e d o n n e l 'écri t invent a i r e - t e s t a m e n t de ton p è r e ». S u i t l e t e x t e d e l ' i n v e n t a i r e : « A c t e d'étab l i s s e m e n t (smen) d e s t erres c u l t i v é e s d e l 'Êgypte e n t i è r e ; e l l e s sont « é t a b l i e s » pour Horus , à perj iétuité , d e p u i s E l é p h a n t i n e jusqu'i l B o u t o » . . . t a n t d 'aroures en t erres cu l t ivées , t a n t o c c m w e s par le N i l en largeur , e t t a n t d 'aroures en p r o f o n d e u r ».
L e s t y l e i>eut ê t r e f o r t e m e n t imagé , a u po int que d a n s l e s Textes des Pyramides, 687 d, n o u s l i s o n s imyt-pr.k i i.t(i) ; s i c e t t e f o r m e verba le prov i e n t b ien de hcr c o m m e il l'a é t é e x p l i q u é (K. SETHE, Kommcntar, I I I , p. 2 5 9 ; S a m u e l A .B . MERCEB, Tlie Pyramid Texts, I I , p. 337) , n o u s o b t i e n d r o n s l i t t é r a l e m e n t pour la propos i t ion : « ton [myt-pr e s t (physio lo-g i q u e m e n t ) conçu », a v e c le s ens probable de « tu a s un hér i t i er ».
(77) C'est a i n s i que Gerhard FECHT (Der Mabgierige ttnd die Maat in der Lehre des Ptahhotep (Gl i ickstadt , 1958) , p. 42) t i 'aduit « i m y t - p e r » d a n s Ptahhotep, 314, par « e ine V e r m o g e n s r e c h t l i c h e V e r f i i g u n g » (une d i s p o s i t i o n régul ière , ou jur idique , d e la f o r t u n e ) , s a n s a u t r e spéc i f icat ion .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 139
que des actes é ta ient dressés devant , et par , les pouvoirs publ ics pour en g a r a n t i r les déplacements.
La mobil i té du bien des pa r t i cu l i e r s est d 'a i l leurs a t t e s t ée depuis l 'aube de l 'h is toire égyptienne p a r la Pierre de Paler-me qui nous f a i t siivoir que, à interval les régul iers — tous les deux ans , au début — l ' admin i s t ra t ion égypt ienne procéda i t a u recensement de l 'or e t des champs.
I l f a u t en tendre p a r « or » les objets évalués en o r ; le t e rme se r a p p o r t e donc aux valeurs mobilières en général ; e t parallèlement , les « champs » aux biens immobiliers. Ce déta i l est à relever pa rce qu' i l a été d i t en fonct ion de l 'étymologie a t t r ibuée à Imyt-pr que les biens mobil iers f o rma ien t seuls la p rop r i é t é reconnue à l 'époque aux su je t s des pha raons La preuve de ce t te a f f i rma t ion n 'a pas été fourn ie , et elle se t rouve en contrad ic t ion avec les données de la Pierre de Palerme.
T o u j o u r s est-il que, pour les besoins de la définition philologique de l 'expression, des égyptologues on t i-econnu l 'existence d 'une p ropr ié té privée en Égypte, ce qui es t bien loin d ' ê t re touj o u r s le cas.
Mais puisque nous par lons de philologie e t d 'étymologie, terminons ce chapi t re en n o t a n t qu'i l ne f a u d r a i t peut-ê t re pas a p r io r i é l iminer l ' au t r e aspect possible de l 'étymologie d'hnyt-pr (^), à savoir : « ce ( = un substant i f du féminin ou le n e u t r e t o u t à f a i t généralisé) en quoi est la maison (ou le domaine) », a u même t i t r e que hny-rn.f signifie « (l 'écrit , ou le papj-rus, ou le livre) dans lequel es t le nom d 'un tel », ce qui revient à d i re : la l is te nominat ive (*') ; et pour « imyt-per » : le registre .
(78) J. BKEASTED, Ancient Records, I, §§ 1 3 ô ; 1 3 7 ; . . . ; J. PIRENNE, Histoire des Institutions et du Droit Privé de l'ancienne Égypte, I (1932) , l>p. 122-123 ; l&i ; V i t tor io GU STOLISI, La ' Pietra di Palermo ' e la crono-loi/ia dell Antico Rajno, d a u s Sicilia Archcologica, 4 (19(58), pp. 5-14; 5 (19G9), pp. 38-55 ; C (19G9), pp. 21-38.
(79) G. MASPEKO, d a n s Bibl. Ét/yptol., V I I I , p. 4 3 5 ; A. MOKET, Le Nil et la civilisation, égyptienne, p. 307, n. 2.
(80) Cf. T y c h o MRSICII, op. cit., pp. 31 sqq. (81) G. LEFEBVRE, Grammaire^, § 179; A. GARDIKER, Grammar^, pp. 286,
11. 2 ; 294, II. 5. Voir l ' exemple du Pap. Kahoiin VII, 1,1.24.
140 A R I S T I D E T H É O D O R I D B S
A ce compte, la p ropr ié té privée a u r a i t été représentée évidemm e n t auss i bien p a r les immeubles que p a r les meubles, et « i m j t-per » a u r a i t pu f a i r e allusion a u x regis t res du cadas t re , e t acquér i r progress ivement l 'acception d 'ac te au then t ique de mu ta t ion , puisque toutes les m u t a t i o n s devaient ê t r e enregis t rées p a r l ' admin i s t r a t ion centra le du royaume.
Toutefois , les graphies {'̂ ) subséquentes du mot « imyt-per » mon t r en t que les scribes l 'ont bien compris — mais souvent les i n t e rp r é t a t i ons u l té r ieures ne sont pas fondées h i s to r iquement — comme signif iant « ce qui es t dans la maison », é t a n t en tendu , comme l 'écri t MASPERO^ que « ce qui es t dans la maison » ava i t fini p a r désigner la propriété de tout genre avec le titre qui l a consacre
MASPERO a j o u t a i t que le « carac tère ju r id ique de cet te sor te d 'ac te es t t o u j o u r s un peu douteux ». I l en est encore a insi à l 'heure actuel le !
Certes , sous l 'Ancien Empi re , d ' ap rès des passages bien connus d 'ac tes de fonda t ion , une d is t inc t ion é t a i t a p p a r e m m e n t établie en t r e les cessions à t i t r e onéreux et les cessions « p a r Iniyt-pr ». Ains i d a n s cet e x t r a i t de l 'acte d 'un Dign i t a i r e de la Cour de Khephren (^) ( I V dynast ie) :
« . . . < 8 > J ' i n t e r d i s à t ou t p rê t r e - funéra i r e de ma fondat ion d 'a l iéner (H rdl.n.Çi) shm lim-k} nb dt m rdlt),
à n ' impor te qui (n rmt nb),
les champs {3ht), les gens (rmt), [ou les biens quelconques] {[ht nb]), [que je lui ai const i tués (en fonda t ion) pour que] m [ e soient f a i t e s des o f f randes f u n é r a i r e s < 9 > ] p a r ce moyen {[Irt.n.l n.f r prt-hrw w].(i) Im),
( 8 2 ) C f . T y c h o M R S I C H , op. cit., p p . 3 8 s q q .
(83) G. MASPERO, clans Bibl. Égyptol., V I I I , p. 43û (nous avons soul igné) . ( 8 4 ) L i g n e s 8 - 1 0 [ = K . S E T H E , Urk., I , 1 2 , 9 s q q . ] ; c f . A . M O R E T - L . B O U -
LARD, Donations et fondation» en droit égyptien. (Paris , 1907), pp. 19 sqq.; J. PiRENKE, Histoire des Institutions..., I I , pp. 207 sqq.; 335-330; Tycho-M R S I C H , op. cit., p p . 4 8 s q q .
t
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 141
à t i t r e onéreux (r létc),
ou pa r ' imyt-per ' ( . . . m rdlt m Imyt-pr n mit nh).
« Mais [il devra en f a i r e la t r a n s j m i s s i o n [à un sien fils un ique] {wpw-hr d\[d\.f n ss.f iv'^{iv)]), < 1 0 > celui à qui reviendra sa p a r t (des f r u i t s de la fonda t ion) avec ( = af férente à) la charge de p rê t re - funéra i re . . . (n{y) p-ist.f hn'^ lim-ki ...) ».
I l se p o u r r a i t que, d is t ingué d 'une opéra t ion à t i t r e onéreux, l '« imyt-per » eû t spécialement désigné un acte de disposi t ion (donat ion en t re vifs, t es tament ) . Mais quel que f û t le mode d'aliéna t ion considéré, il é t a i t en tendu qu'i l pouvai t se f a i r e « en f aveur de n'importe qui ». La mobil i té des biens n ' é t a i t donc nullement l imitée au milieu fami l i a l ("').
I l a été t e n t a n t de fa i r e un pas de p lus e t de réserver à' « imyt-per » le sens d 'ac te spécialement t es tamenta i re , vu que ce t e rme se ra i t opposé à une « donat ion » comme telle, dans u n a u t r e acte de fonda t ion d 'Ancien Empire , celui de Neliankh, ou du moins dans ce que nous en possédons. Le texte qui n ' es t connu que p a r une inscr ip t ion sur la paroi d 'ent rée d 'une tombe, n ' a pas été r ep rodu i t en ent ier . I l nous f a u t p ro fondément r eg re t t e r de n 'avoi r qu 'un abrégé de t o u t le d é b u t ; la seconde pa r t i e du tex te est formée d 'une clause répétée qui donne l ' impression de redi te , et qui of f re un moindre in té rê t pour nous, qui dés i rer ions ê t re mieux in formés sur les condit ions de créat ion de l a d i t e fonda t ion . Mais nous devons ê t re assurés que des membres de l a fami l le ava ien t est imé u t i le de la f a i r e reprodui re ainsi , pour des ra i sons qui leur é ta ien t propres (**) :
(85) V o i r la n. 32. (86) G. LEFEBVRE-A. MORET, Nouvel acte de fondation de l'Ancien Em
pire à Tehnèh, d a n s R. égyptol., I (1919), pp. 30 sqq. ; J . PIRENNE, Histoire des Institutions II , pp. 3(>4 sqq. ; 372-373; I. HARARI, La fondation cultuelle de N.K.WI.ANKH à Tehnèh : Notes sttr l'organisation cultuelle dans l'Ancien Empire égyptien, d a n s Ann. Scrv. Ant., lAV (1957), pp. 317 sqq. ; T y c h o MRSICH, op. cit., pp. 70 sqq. N o u s n o u s s o m m e s a u s s i s e r v i d 'une t r a d u c t i o n du t e x t e f a i t e par B . GUNN, e t qui e s t c o n s u l t a b l e d a n s l e s a r c h i v e s d u GrifEith I n s t i t u t e d 'Oxford, s o u s l e n° BO/Nl I (g) . T e x t e d a n s SETHE, Urk., I, 102, m a i s n o u s s u i v o n s ce lui qu'a é tab l i HAKARI. Voir la n. 3 3 8 .
142 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
< 1 > « D i s p o s i t i o n (wdt-mdt) [qu ' a p r i s e (Irt.n) le «Connu d u Roi» N e k j a n k h , < 2 > c o n c e r n a n t son d o m a i n e (m pr.f), de sa bouche v ivante (»i r3.f ''nh{'w)).
< 3 > « Q u a n t à t ous mes e n f a n t s (Ir 7néw.{l) nh), en véri té , ce que j ' a i cons t i tué [pou r ] eux en f a i t de p a r t d o n t i ls j o u i r o n t (lr*.w.(l) [n].én m hrt wnm.én), j e déf e n d s à quiconque d ' en t r e eux de le d o n n e r {n rd\.{n.\) éhm nty (?) un m rd\{t) lr(t).n.{i) f>.f), p a r ac t e d " imyt-p e r ' ou p a r dona t ion (??) (m Imyt-pr m rd\(t) {?)), à n ' i m p o r t e lequel de ses proches (n ndrw.f ni), < 4 > si ce n ' e s t a u fils qui lu i adv i end ra e t à qui i l (en) f e r a la t r ans miss ion {wpy-r Jjpr S3.f dl.f n.f) (*').
« I l s a g i r o n t sous l ' a u t o r i t é de mon fils a îné Çirr.m hr 83.(1) émsw), comme i ls me f e r a i e n t mon p r o p r e service (ml Xrr.én w.(l) /li.(l) ds(i)), car j ' a i i n s t i t u é un h é r i t i e r (înfc \r{w) luc'^w) p o u r le j o u r où je m'en i r a i vers l 'Oues t ( r hrw lipy.{l) \m r Imntt), le p l u s t a r d i v e m e n t possible {wdf.tÇi)).
< 5 > « Ces p r ê t r e s - funé ra i r e s < G > que j ' a i constit u é s C") sous son a u t o r i t é {hm(w)-k3 ipf irw.n.{l) hr '^.f), < 7 > lui, i l les r e q u e r r a (âiot ip sn) p o u r mon o f f r a n d e j o u r n a l i è r e (m prt-hrw.Ç\) n nh), au p r e m i e r du mois, à la moi t i é du mois, e t à chaque f ê t e de l ' an , m a i s je lu i
(87) L e fir< e s t « en p a r t i c u l i e r l e r e v e n u q u e l e p r ê t r e d e ou l e prop h è t e d 'un dieu, t i re d e s b i e n s f u n é r a i r e s ou d e s o f f r a n d e s pour son u s a g e personne l , e t qui c o n s t i t u e s o n t r a i t e m e n t » (A. MORET, Chartes d'immunité dans l'Ancien Empire égyptien, I I I (1917) , p. 414) ; c f . l a t r a d u c t i o n d 'E. EDEL, Altàff. Gr., § 830 : « w a s a i l e m e i n e K i n d e r a n g e h t , v ie l n iehr d a s w a s i c h i h n e n a l s V e r n i o g e n g e g e b e n h a b e z u m N i e s s b r a u c h (eig. d a m i t s i e a s s e n ) ».
(88) P a s s a g e c o m p l i q u é ; vo ir l e c o m m e n t a i r e . (89) I l s e m b l e b i en q u e l e f o n d a t e u r i m p o s e ic i l a c l a u s e de la pr imo-
g é n i t u r e m a s c u l i n e (cf . l a s u i t e i m m é d i a t e du t e x t e ) . (90) N o u s n o u s s o m m e s insp iré d e la t r a d u c t i o n de B . GU.NN : « T h o s e
A"a-servant(s) w h i c h I b a v e c o n s t i t u t e d under h i s d irec t ion , h e s h a l l l iold t h e m r e s p o n s i b l e . . . ». L e P r o f e s s e u r E. EDEL p r e n d \rw pour u n p a r t i c i p e (Altiiff. Gr., § 873, 3 ) . Cf. T. MRSICH, op. cit., pp. 7 4 - 7 5 : « J e n e Toten-p r i e s t e r . . . d i e Ich s e l n e r G e w a l t (' u n t e r s e l n e n A r m ') u n t e r s t e l l t (konst i -t u i e r t ) h a b e . . . ») .
LE TESTAMENT DANS L'ÉGYPTE ANCIENNE 143
i n t e r d i s d ' ex iger d ' eux u n e p r e s t a t i o n quelconque {n rdi.n. (i) shm.f n ( = m) Itt.sn r k}t nbt) en dehors de mon o f f r a n d e j o u r n a l i è r e (aux d a t e s indiquées) (?i3W prt-hrw.il) n r" nb).
< 8 > « S ' i l exige d'exix u n e p r e s t a t i o n que lconque (Ir It.f én (r) k3t nbt) qui ne s e r a i t pas , en f a i t , une o f f r a n d e p o u r moi Çiwt prt-hrw n.(l) Is pw), j e lu i i n t e r d i s d ' ex ige r de ces p r ê t r e s - f u n é r a i r e s une p r e s t a t i o n en deho r s de l ' o f f r a n d e (qu ' i ls devront ) me f a i r e (w rd\.ii.{i) shm.f m lt{t) hmw-ks Ipn r kst nbt h3w prt-hrw.{l)) ».
N o u s n o u s é t ions a u t r e f o i s d e m a n d é si p a r compara i son avec l ' ac te de f o n d a t i o n du D i g n i t a i r e de la Cour de Kl iephren , il ne f a l l a i t p a s c o m p r e n d r e que t o u t e cession de biens é t a i t i n t e r d i t e p a r ac te d '« imyt -per » auss i bien qu ' à t i t r e o n é r e u x ; I b r a h i m HARARI a , de son côté, f a i t la même suppos i t ion ( ' ' ) . Mais le t ex t e ne p o r t e p o u r ce t te de rn i è r e express ion que m rdl a u l ieu de m rdlt r léw. I n t e r p r é t e r l ' express ion comme u n e a l i é n a t i o n à t i t r e oné reux ne p e u t donc se f a i r e q u ' a u p r i x d ' u n e cor rec t ion , en t a b l a n t s u r u n e i n a d v e r t a n c e du scr ibe !
E n o u t r e , cet ac te qu 'on a t e n d a n c e m a i n t e n a n t à p l ace r sous la V I " d y n a s t i e ('^), se d i s t i ngue de celui de la IV^ d y n a s t i e p a r le f a i t que la f o n d a t i o n f u n é r a i r e revêt , comme l 'a exp l iqué J a c ques P i R E N N E (") , la f o r m e d ' u n e « société de f a m i l l e » en vue de conserver a u x m e m b r e s de la f a m i l l e les r evenus du fonds . I l p o u r r a i t se t r o u v e r dès lo r s qu 'on eû t exclu d 'off ice l ' idée d ' u n e a l i éna t i on à t i t r e onéreux .
Si, d ' a u t r e p a r t , on p r e n d le passage à la l e t t re , comme l ' on t f a i t l es p r e m i e r s éd i t eu r s , G. LEFEBVEE et A. MORET ('"•), su ivis
(91) I. HARARI, op. cit., p. 324 : « L e d i sposant in terd i t deux f o r m e s d 'actes jur id iques , Yimit-per, e t une a u t r e f o r m e qu'il ne m e n t i o n n e pas, e t qui s 'oppose a p p a r e m m e n t ; n o u s pouvons, en base des c l a u s e s paral lè les, qual i f ier ce t te dernière d'acte à t i tre part icul ier , ou Uw ». D 'où la traduct ion de HARARI pour ce p a s s a g e : « . . . de donner tout bien que je l eur ai a f fecté par ac te de d i spos i t ion à t i tre col lect i f , ou par ac t e de disposi t ion (Cl t i t re s ingul ier) ».
( 9 2 ) T y c h o M R S I C H , op. cit., p . 8 9 .
(93) J. PiRENNE, Histoire de» Institutions II , pp. 364 ; 373. ( 9 4 ) G . L E F E B V R E - A . MORET, op. cit., p . 5 . . •
144 ARISTIDE THÉODORIDÈS
p a r J . P i R E N N E e t aussi , en quelque maniè re p a r le l ' rofes-seur EDEL qui en se p laçan t au point de vue philologique est condui t à expliquer rdl comme un substant i f [rdlic : die «(îabe»), il y a u r a i t une différenciat ion à in t rodu i re en t re cet te « donat ion » et l'imyt-pr dont on r e s t r e ind ra i t le sens, en l ' app l iquan t essent iel lement au tes tament .
Mais loin que rdl (verbe ou subs tan t i f ) puisse u t i lement nous a ider à in t e rp ré t e r un texte, c 'est l ' inverse qui se passe généralement , vu le ca rac tè re polyvalent du terme. C'est en fonct ion du contexte, ou d ' au t r e s indices, que t r o p souvent on a r r ive à é tabl i r approx imat ivement le sens de rdl. Or le contexte nous invite, p a r exemple, dans le Papyrus Turin 2021 ("), à t r a d u i r e rdl p a r « léguer », c'est-à-dire p a r p rendre une cer ta ine disposi t ion testamenta i re . E t il n 'y a p a s lieu de dou te r qu ' i l en p û t ê t re dé jà a ins i sous l 'Ancien Empi r e an té r ieurement .
I l est une troisième manière d 'envisager rdl d a n s ses r a p p o r t s avec « imyt-per ». Nous l 'avons rencontrée il y a nombre d 'années dans la t r aduc t ion qu'en a établie B. GDNN^ et qui est conservée dans les archives d 'Oxford ('*). I l se t rouve que Tycho MRSICH vient d ' abou t i r au même r é su l t a t C ) , cons i s tan t à opposer l'aliéna t ion p a r acte au then t ique (Imyt-pr), à la cession comme telle, f a i t e s implement de la main à la main . Mais ins t i tu t ionnel le-ment , ce n 'es t pas recevable puisqu ' i l s ' ag i t d 'un f o n d s érigé en f o n d a t i o n ; on ne pou r r a i t en concevoir la moindre a l iénat ion sans pièce officielle é m a n a n t du cadas t re .
Aussi , a lors que nous nous efforçons d 'é lucider ces documents de la p ra t ique concernant lesquels nous n 'avons conservé aucun exposé théorique, ne pouvons-nous donner que l ' impression de piét i ne r !
( 9 5 ) J . P iRENNE, o p . cit., I I , p p . 3 4 6 , n . 2 ; 3 7 3 .
(96) E. EDEL, AUag. Grammatik, § 460. (97) Papyrus Turin 2021, I I , 11 ; I II , 11-12. (98) B. GuNîi (Grif f i th Inst i tute , BG/Vl/1 (g ) ) : « I do n o t a l low [ a n y ]
one (of them) to have power [ to g lve a w a y w h a t ] I h a v e [ c o n s t i t u t e d ] f o r h lm lohether convcyance, or as a freegift, to a n y re la t ive of h i s ».
(99) T y c h o MRSICH, op. cit., p. 178 : « D i e Ver f i i gung durch H a u s u r k u n -de i s t e ine besonders ges ic l ierte R e c l i t s f o n n des ' Gebens ' (rdî vi îmyt-pr), die w i e e s sche int m i t der F o r m des schlichten Oebens konkurr i er t ».
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 145
I l y a tou te fo is un poin t positif à dégager du dern ier tex te : c 'est que les Égypt iens , con t ra i rement à ce qui a été af f i rmé, ava ien t une réelle force de f acu l t é proversive, qui les f a i s a i t se p ro je te r dans l 'avenir de manière à le façonner e t le régi r : « j ' a i ins t i tué , déclare no t re disposant , un hér i t ie r {iw'^w} pour le t emps où je m'en i ra i vers l 'Ouest ( = la cité des mor ts ) », et , explique-t-il en substance, le culte f u n é r a i r e que j 'o rganise à mon avantage , me sera rendu pa r mes en fan t s placés sous la direct ion de mon fils aîné.
C'est lui qui l 'édicté a in s i ; l 'aînesse p a r conséquent, n ' es t donc pas légalement établie à cette époque (""').
D ' a u t r e pa r t , nous t r adu i sons liv^w p a r « h é r i t i e r » , ma i s i l f a u t se représen te r qu'i l ne s 'agi t pas, dans le chef du d isposant , d ' i n s t i t ue r un hér i t i e r con t inua teu r de sa personne ; il s ' ag i t d ' un successeur à une p a r t dé terminée de biens, en l 'occurrence u n domaine érigé en fonda t ion , don t le fils a u r a l ' admin i s t r a t ion pour une fin déterminée et s t r i c tement l imitée : l ' en t re t ien d u cul te du fonda teu r . Le culte est personnel en Égypte : il n 'y a pas de « sacra » don t l 'hér i t ie r se ra i t tenu, dès l ' i n s t an t qu ' i l se ra i t f a i t hé r i t i e r ; car il n 'y a pas de « sacra ». A l 'occasion de l 'o rganisa t ion de son culte à lui, le père crée une communau té de fami l le a s t r e in te à ce cu l t e ; ma i s ce cul te n ' ex i s t e ra i t p a s sans la disposi t ion expressément prise à cette fin.
I l n 'en ressor t pas moins du document , malgré l ' é t a t elliptique de sa t ransmiss ion , qu' i l a pu y avoir en Égypte , et ce dès l 'Ancien Empi re , des disposi t ions vér i tablement t e s t amen ta i r e s pr ises p a r des pa r t i cu l i e r s ; l 'acte d i t d '« imyt-per » a servi à les au thent i f ie r , ma i s il n ' é t a i t pas réservé au tes tament .
Voir dans l '« imyt-per », comme cela a été f a i t , et comme nous l 'avons répété ici même, un acte de muta t ion , est correct , ma i s non p le inement sa t i s fa i san t , car la vente se f a i t p a r ac te de
(100) J . PiRENNE, Histoire des Institutions II , pp. 304 sqq. ; c f . p. 378 : « La d i f f érence qui e x i s t e en tre l e s t a t u t j u r i d i q u e donné à ce s d e u x g r o u p e s d ' e n f a n t s p r o u v e q u e l 'a îné n e j o u i t encore, a u d é b u t de la V d y n a s t i e , d 'aucun p r i v i l è g e l éga l e t qu'il n e doi t s a s i t u a t i o n priv i l é g i é e (iu'i\ l a vo lonté d e son père, e x p r i m é e par t e s t a m e n t ».
fO
146 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
« sounet », lequel acte, qui est aussi au then t ique , n 'exc lu t pas l ' ac te d'hnyt-pr, comme le prouve la Stèle J u r i d i q u e de Kar-nak (""). C'est dans cette voie qu ' i l f a u d r a œuvrer , de façon à cerner p lus r igoureusement encore la va leur j u r id ique d 'un « i m y t p e r » . Nous y reviendrons dans la conclusion de la présente étude.
Nous t e rminons ces observations, en r é p é t a n t que « imj-t-per » es t un vocable qui peut s 'appl iquer à des in s t i t u t ions di f férentes (d 'après nos catégories jur id iques) , et que p a r m i elle figure l 'acte de disposi t ion à cause de m o r t ; et en s igna lan t enfin, comme corollaire, que l ' inverse est aussi vrai . Au même t i t r e qu 'un « imyt-per » peut correspondre à un « t e s t a m e n t », un t e s t amen t n ' es t p a s nécessai rement expr imé p a r le mot Imyt-pr :
a / il a r r ive que les Égypt iens se con ten ten t de d i re ss, «écri t». I l en es t a ins i sans conteste dans les Textes des Pyramides, 475 a C"̂ ) ; et nous sommes convaincu que cache semblable-m e n t un Imi/^-pr dans le décret de Koptos VIII {^^), dans l ' in t roduc t ion aux con t r a t s d ' H â p i d j e f a (""), ... et dans la première section du Papyrus des Adoptions, où nous l isons C"*) :
— « Nebnefer , mon mar i , a f a i t un ' écr i t ' (ss) en m a faveur , (moi) la musicienne de Soutekh, N é n u f a r : il s 'est f a i t une fille de moi, en me l éguan t t o u t ce qui é t a i t sien ( l i t té ra lement : en écrivant pour moi au su j e t de tous ses
(101) V o i r no tre Acte de « sounet » (vente) dans la Stèle Juridique de Karnalx, d a n s RIDA, 1959, pp. 107 sqq.
(102) « I l e s t appauvr i l ' i iérit ier pour qui il n ' e x i s t e p a s d'écri t ( testam e n t a i r e ) (^t03 \w'^w n wnt hr.f sK) ; m a i s N. en f e r a u n a v e c l a r g e s s e » ( l i t t é r a l e m e n t m dl><^ wr, a v e c son grand doigt , que n o u s i n t e r p r é t o n s a u f iguré : d 'une l a r g e m a i n ) . Cf. S a m u e l A .B . MERCER, The Pyramid Texts, II , p. 223 : « T h e d e t e r m i n a t i v e w i t h sis i n d i e a t e s s o m e t h i n g m o r e in t h i s connec t ion t h a n penci l or paper, b u t t h a t w h i c h m a y b e prepared by t h e u s e of penci l and paper, n a m e l y a document, in our c a s e a testament ».
(103) S a n s ê t r e t o u t e f o i s un « t e s t a m e n t », d a n s Koptos VIII, n i d a n s H â p i d j e f a .
(104) Koptos VIII, 11 [ = K. SETHE, Lescstiicke, 98, 24 ] . (105) Siut, I, 272 [ = K. SETHE, Lcsestiicke, 92, 2 1 ] . (106) A. GARDINER, d a n s J. Eg. Areh., X X V I (1940) , pp. 2 3 sqq. ; I.M.
LouRiÉ. Esquisses de droit égyptien ancien, pp. 16(5-167 ; Ar. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1965, pp. 81-82.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 147
biens) {Iw.f sS n.l n (= m) p3 hot nb), n ' a j ' a n t p a s de fils ou de fille en dehors de moi-même ( = puisqu ' i l me f a i t sa léga ta i re universelle, ' fils ' et ' fille ' a y a n t le sens de successeurs a u x biens) » ;
b / l 'acte p a r lequel N a u n a k h t e exhérède cer ta ins de ses e n f a n t s ne peu t pas ne p a s ê t re un tes tament , e t il po r t e le t i t r e de : « Pièce enregis t rée C^icty hrwyt ("")) qu 'a [dressée] (\.\rt) [la ' c i t a d i n e ' N a u n a ] k h t e concernan t (ses) biens {n (= m) Ijt.i) » ; « imyt-per » ne figure nulle p a r t dans l 'acte ;
c / enfin, le t e s t amen t d ' Imenkhâou (ou Papyrus Turin 2021) que nous examinerons p lus loin n 'es t non p lus appelé hnyt-pr. Sans doute, n'est-il pas conservé complètement et t o u t le débu t nous échappe-t-il, mais nous ne serions pas é tonné qu' i l se f û t appelé ac te de fiJjr (« plan », « p ro je t », « disposit ion ») à voir le Vizir dans la pa r t i e finale, là où il a u r a i t pu donner des instruct ions su r l ' enregis t rement de l ' « i m y t p e r » , s 'expr imer en ces t e rmes ('"*) :
— « Que cette disposition que j ' a i ' sanct ionnée ' so i t consignée (Iml mn p3y éhr l.lr.î) su r un ' r e g i s t r e ' . . . On en fit une copie pour la Grande KnM ( = le dépai-tement viziral à Thèbes, où tous les actes de mu ta t i on sont conservés) ».
* * •
\
P i e r r e LACAU é ta i t pa r f a i t emen t au couran t des d i f fé ren ts sens que peut acquér i r , dans no t re opt ique jur id ique , le t e rme égypt ien \myt-pr. Mais nous ne pouvons le suivre lorsqu' i l par le de « dona t ion écri te » à propos de l'« imyt-per de Sénimosé ». E t c 'est à f o u r n i r la preuve de no t re in t e rp ré t a t ion de cette pièce que nous a l lons nous appl iquer .
( 1 0 7 ) J . C E R N * , d a n s Eg. Arcli., X X X I ( 1 9 4 5 ) , p p . 3 2 - 3 3 ; A r . T H é O -
DORiDÈs, d a n s RIDA, 1066, p. 34, n. 17. (108) Papyrus Turin 20.21, IV, 2-3.
1 4 8 ARISTIDE T H é O D O R I D è S
CHAPITRE IV : La Stèle de Sénimosé ("").
1 / Texte du cintre de la stèle. La date : L'ati XXI de Thoutmosis III
{première moitié du XV" s. avant J.-C).
< 1 > L 'an X X I , le 3 ' mois de (la saison) « pere t », le 25, sous la Majes té du Koi de H a u t e et Basse Égypte [Men-kheper rê ] , < 2 > le F i l s de l i é : Thoutmosis-Neferkheperou, puisse-t-il vivre é ternel lement et à j a m a i s ».
Intitulé de l'acte.
Acte d '« imyt-per » [qu 'a dressé le p r é c e p j t e u r ("") (Imyt-pr Ir.n mn'^y) < 3 > du F i l s roya l Ouadjmosé , Sénimosé, en f aveur de sa femme (n hmt.f) e t [de ses enf a n t s ] ( '") don t voici [la l i s te] < 4 > nomina t ive {[Imy-] rn.f Iry) :
sa femme {hmt.f) H o u d j a r , [son fils (S3 . / ) Seâa ] , < 5 >
sa fille ( s 3 * . / ) T a ï r [ y ] , [sa fille (sst.f) Sa t imen] , < 6 > [sa fille ] ("^).
(109) S tè l e Caire J .E . 27815 [ = SEïIIE, Vrk., IV, 1065-1070] ; cf . P. LA-CAu, Cat. gén. Caire, N° 34.016 (pl. X ) , e t Une stèle juridique de Karnak, pp. 3 et n. 3 ; 18 ; 19 ; 2 0 ; 21 ; 22 ; 34 ; 42-43.
(110) Ou « père nourric ier ». Cf. P . LACAU, Une stèle juridique de Karnak, p. 3 : Sén imosé « qui a p lacé d a n s l e t emple f u n é r a i r e du pr ince O u a d j m o s é (dont il a v a i t é t é d 'a i l leurs le père nourric ier) u n e s t è l e port a n t le résumé de la donation écrite ... qu'il a v a i t f a i t e en f a v e u r de s a f e m m e e t de s e s e n f a n t s » (nous a v o n s sou l igné ) .
(111) R e s t i t u é par SETHE {Urk., IV, 1066, 13) d 'après Urk., IV, 1068, 7 : lirdic.f, « l e s e n f a n t s de lui » qui prouve que l e s e n f a n t s sont c e u x que Sén imosé a e u s d'une union antér ieure . H o u d j a r n'est j a m a i s d i t e ê t re l eur m è r e : on en in fère l ég i t imement qu'elle es t l eur bel le-mère, ce qui n 'es t non p lus j a m a i s indiqué. E l l e deva i t ê t re n e t t e m e n t p lus j e u n e que Sénimosé , puisqu' i l é ta i t conva incu qu'el le a l l a i t lu i survivre .
(112) R e s t i t u t i o n f a i t e par SETHE, Urk., IV, 1066-1067, 1, d 'après 1068, 14 et 1067, 11-12.
(113) On cons ta te que la l éga ta i re e s t a s s i m i l é e par le d i sposant à s e s e n f a n t s . L' idée s'en t rouve exp l i c i t ement d o n n é e d a n s le Pap. Turin 2021,
LE TESTAMENT DANS L'ÉGYPTE ANCIENNE 149
I I / Texte de la stèle proprement dite ("'').
A) Première section : Extraits d'un acte, qui n'est pas celui annoncé par l'intitulé du cintre.
< 1 > — « [Moi, Sénimosé, je lègue (?) (rdi) t ous ("^) mes biens (ht.i nht) p a r l]m[yt-pr (? ) ] à ma f emme Hou-d ja i ' d a n s son t e m p s de vie {m p3{y).s hrw n '^nh), m a i s s ans p e r m e t t r e ( '") p a r là {mi rdlt Im) < 2 >
qui sera é t u d i é p lus loin, e t où l'on l i t a u x l i gnes II , 7-8 : « après qu'e l le e u t ag i c o m m e u n e fille pour moi , à l ' ins tar très e x a c t e m e n t des e n f a n t s de m a première f e m m e , qui é t a i e n t d a n s ma maison, s a n s avo ir nég l igé (?) a u c u n dés ir que j 'a ie ( jamais ) f o n n é ».
(114) Ce t e x t e offre un n o y a u narrat i f m i s d a n s la bouche de S é n i m o s é lu i -même c o m m e n o u s a l l ons le voir et l 'expliquer, il e s t encadré (dans l e h a u t et d a n s l e bas ) par des e x t r a i t s d 'actes qui, pour le f o n d ne sont i>as c o n f o r m e s à l 'ac te a n n o n c é d a n s l e c intre tout en a y a n t connue a u t e u r S é n i m o s é a v e c u n e m ê m e préoccupat ion : régler sa success ion. M a l g r é l 'état de g r a v e détér iorat ion de la s t è l e et l 'a l lure f o r c é m e n t hypothét i -(lue de p a s m a l de res t i tu t ions proposées, tout l ' intérêt d e la p ièce résidera d a n s l es d ivergences qu'accusent les e x t r a i t s d'actes . I l y a a s sez d 'é l éments r e s t a n t s pour a t t e s t er qu'Us s 'ag i t d'un m ê m e document plus i eurs f o i s r e m a n i é ; c 'est ce qu'il importe de re lever a v a n t toute a u t r e chose .
(115) L a c u n e h y p o t h é t i q u e m e n t comblée par n o u s en n o u s insp irant de Vrk., IV, 1 0 6 8 , 5 .
(116) D ' a p r è s l ' int i tulé de l 'acte a n n o n c é d a n s le c intre, H o u d j a r a u r a i t é té f a i t e l é g a t a i r e à t i t re part icul ier . Ici, e l le l 'est pour tous l e s biens , m a i s à t i t re temporaire .
(117) C'est-à-dire : t a n t qu'el le es t en vie. I l lui e s t interdit , par l a vo lonté de Sénimosé , d'en d i sposer pour l e temijs où e l le ne sera p l u s en vie, pu i sque S é n i m o s é lu i -même y pourvoi t !
(118) L 'express ion hrw n '^nh e s t à t raduire tout à f a i t l i t t é r a l e m e n t « j o u r de v i e » . Voir S t a t u e de Neferpert , 16-19 [ = Caire 42121 = SETHE, Vrk., IV, 1021, 4-6] : « I l s (ces b iens) s eront sous t a d irect ion d a n s ton t emps de v ie {m hrw.k n ^nh), e t après ta propre v ie i l lesse , i l s s e transmet t ront par vo ie de pr imogén i ture m a s c u l i n e (îr m-ht y^w n.k-im-y, Iw.to m «3 n ,93 iw'^w n iw'^w) » ; cf. sur ce t e x t e : W. HELCK, Matcrialien sur Wirtsohaftsgeschichte des Ncuon Seiches, I (1961), p. (95) ; I I I (1963), p p . ( 4 7 3 ) , ( 4 7 7 ) , ( 4 8 6 ) ; A r . T H é O D O R I D è S , d a n s R. d'Ég., X I X ( 1 0 6 7 ) ,
pp. 116-118 ; S h a f i k ALLAM, d a n s Ilibl. Oricntalis, X X I V (1967), p. 20. (119) Cf. l ' introduct ion a u x contra t s d ' H â p i d j e f a {Siut, I, 272 = SETHE,
Lesestiicke, 92, 21-23) : « Ces b i ens rev iendront à un t ien flls seul , ce lui
150 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
[qu'elle dispose (?) de ces biens, si ce n 'es t (?) pour pa j ' e r (??) u n ] p rê t r e r i tua l i s t e {br{y)-[h]b) C^").
« E t après la vieillesse ('^') de ma femme H o u d j a r (Ir m-ht hwy n hmt.l H.), [ tous ('^) mes biens] s e [ ron t < 8 >
q u e tu p r é f é r e r a s parmi t e s e n f a n t s e t qui f e r a pour m o i l e prê tre - funéra i re (après to i ) , en t a n t qu'w u s u f r u i t i e r » (m wnm-71 sbin.n.f) e t s a n s p e r m e t t r e (nn rdlt) qu'i l n e l e s p a r t a g e en tre s e s e n f a n t s » ; c f . G.A. REISNER, d a n s J. Ey. Arch., V (1918), p. 8 2 ; K. SETHE, d a n s Z. dg. Spr., L X I (1926), pp. 77-78; I. HARARI, d a n s Ann. Serv. Ant., L I V (1957), pp. 322-324 ; Ar. THéODOBIDèS, d a n s RIDA, V I I I (1961) , p. 46, n. 23.
(120) I l s e m b l e r a i t qu'el le f û t t o u t a u p l u s a u t o r i s é e à couvr ir que lques f r a i s f u n é r a i r e s . I l e s t m a n i f e s t e que, c o n t r a i r e m e n t à ce qu'i l a é t é prétendu, l 'hér i tage n ' é ta i t p a s en É g y p t e ré servé à l ' e n f a n t ( l 'aîné, préc ise-t-on) qui a v a i t la c h a r g e d 'enseve l i r se s a s c e n d a n t s . Cf . Ar. THéODOBIDèS, d a n s RIDA, 1967, pp. 118-120 ; 1969, pp. 159-100.
(121) Cet te e x p r e s s i o n é g y p t i e n n e s o u v e n t e m p l o y é e (cf . p a r ex . t/Yfc., IV, 1800, 1 7 ; 1951, 1 8 ; Amarna ( S a n d m a n ) , 93, 2) r e v i e n t à d i re « à la m o r t », ce qui n e s igni f ie n u l l e m e n t que le t e r m e « m o r t » so i t s y s t é m a t i q u e m e n t é v i t é ; voir par e x e m p l e d a n s le l'ap. des Adoptions, l i gnes 6-7 : « (Quant à ce lui ) de m e s f r è r e s e t s œ u r s (qui lu i f e r a i t ) opposi t ion, à ma mort (m p^yA mwt), ou u l t ér i eurement , e t qui d i r a i t : ' R e m e t t e z -(moi) la part (d'nA(t)) (qui m e rev ient ) de m o n f r è r e . . . ', (qu'on l e d é b o u t e ) » (A. GARDINER, Adoption extraordinary, d a n s J. Eg. Arch., X X V I (1940) , pp. 23-24; pl. V ; Ar. THéODOBIDèS, d a n s RIDA, 1965, p. 83) . Cf . a u s s i pour l ' express ion « après l e t e m p s d e v i e ou d ' e x i s t e n c e », l a S t a t u e sté lé-phore C a i r e Jfi.ZOH ( X X I I " d y n a s t i e ) , où u n père, d a n s s o n imyt-pr, avant a g e s p é c i a l e m e n t une d e s e s filles, en s t i p u l a n t qu'e l le aura , en outre , u n dro i t régu l i er sur l e r e s t a n t : « A u c u n a u t r e flls o u fille n e pourra d i re ' donne-moi la pare i l l e ' ! T u n e l eur p e r m e t t r a s p a s ( le d i s p o s a n t s 'adresse , ii l'épo(iue, a u d i eu A m o n pour que so i t a s s u r é l ' e x é c u t i o n de ses vo lontés ) de l ' écarter d u s u r p l u s d a n s m a m a i s o n après mon temps d'existence {hr-x^ lu-w.{i)'^h'^w). T u lu i r e m e t t r a s sa i>art d e t o u t e s ce s c h o s e s (iw.k r dit pSJ m ht tn nb), e t après cela , s e m b l a b l e m e n t à s e s e n f a n t s , a v e c u n e p a r f a i t e e x a c t i t u d e . . . » (A. DE BUCK, Ecn yelukkige Famtlie f d a n s J. Ex Oriente Lux, V I I (1940), pp. 294-298; J. CAPABT, Personnalités égyptiennes, d a n s Chr. d'Eg., X X / 3 9 - 4 0 (1945), pp. 64-67; E. OTTO, Die Uogra-phischen Insehriften der agyptischcn Spdtzeit, Leyde , 1954, pp. 3 1 ; 5 1 ; 80-8 1 ; 83-84; 8 5 ; 139-143; J. PIRENNE, Histoire de la Civilisation de l'Égypte Ancienne, I I (1963), p. 1 4 ; Ar. THéODOBIDèS, d a n s RIDA, 1964, pp. 63-64; 1965, p. 131, n. 205 ; 1966, p. 38, n. 34) .
(122) R e s t i t u é u n e nouve l l e f o i s d 'après Urk., lOGS, 5.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T B A N C I E N N E 151
p a r t a g é s ('") {k3.[tw psë.tw ht.l nbt]) [ en t re mon fils Seâa ] ([n S3.1 S.]), ma fille (s3t.i) Ta ï ry , ma fille (sst.l) Sa t imen, et [ma fille] < 4 > [ ].
[ I l s a u r o n t a ins i tous (?) mes biens (?) après le t emps de vie (?) de ma f em]me et mon (propre ?) t emps d [ e vie] (^«•^ P3{y).i hrw [n '^nh]), ».
B) Deuxième section : Exposé narratif fait par Sénimosé lui-même ('^*) et suivi d'indications d'ordre administratif {^^).
1. — In te rven t ion de t iers , membres de la famille de I l o u d j a r , en f aveur de cette dernière ('^).
< 5 > « ('2')
[ . . . ] a été b a t t u (hkw.tw), e t on s 'est e n f u i
(123) L e l e g s s e f a i t donc s o u s condit ion, puisqu' i l y a u r a i t o b l i g a t i o n pour e l l e d e t r a n s m e t t r e i n t é g r a l e m e n t t o u s l e s b i e n s de S é n i m o s é a u x e n f a n t s de celui-ci , pour ê t r e p a r t a g é s à é g a l i t é en tre eux .
(124) L ' e x p o s é e s t f a i t par S é n i m o s é lu i -même. Es t - ce u n e s y n t h è s e d e t o u t l e d é r o u l e m e n t d e l ' a f fa i re a v e c s e s s u r p r e n a n t s r e b o n d i s s e m e n t s qu'on a m i s e d a n s s a bouche, post-eventum, a u m o m e n t d e l 'érect ion d e l a s t è l e ? N o u s p e n s o n s plutôt , pour no tre part , que n o u s a v o n s a f f a i r e à d e s e x t r a i t s d u procès -verbal d e la dern ière s é a n c e où ont é t é a c t é e s l e s disp o s i t i o n s d e Sén imosé , c 'est-à-dire où lui -même, e x c é d é par l e s p r e s s i o n s e n s e n s d i v e r s qu'i l a v a i t sub ie s e t après s e s t erg iversa t ions , i l a dés i ré e n reven ir i r r é v o c a b l e m e n t à ses premières volontés .
(125) I n d i c a t i o n s re la t i ve s à la procédure s u i v i e ; en d ' a u t r e s t ermes , n o u s s o m m e s c o n v a i n c u que la s t è l e de S é n i m o s é e s t « a r r a n g é e », m i s e e n f o r m e , pourra i t -on dire, m a i s a u m o y e n d ' e x t r a i t s d u t e x t e a u t h e n t i q u e qui a figuré d a n s le procès-verbal d e la séance . L e cons idérab le in térê t d u Pap. Turin 2021, q u e n o u s a n a l y s o n s p lus loin, ré s ide d a n s le f a i t qu'i l n o u s procure , lui , l e t e x t e m ê m e d u procès-verbal , m a l h e u r e u s e m e n t a m p u t é d e son début , i n d é p e n d a m m e n t bien e n t e n d u d e s d o n n é e s qu'il n o u s f o u r n i t en par t i cu l i er sur la c o n s t i t u t i o n d e Va a v o i r c o n j u g a l », s o u s la X X " d y n a s t i e .
(126) E t ce la af in de l ' amener à m i e u x protéger l e s i n t é r ê t s d e c e t t e dernière . L a l o n g u e l a c u n e d e la s t è l e en cet endro i t n o u s f a i t ignorer l e s c o n d i t i o n s d a n s l e s q u e l l e s a é t é rédigé le premier imyt-pr. T o u j o u r s est - i l qu'il a s o u l e v é d e s oppos i t ions .
(127) On n e peut p a s é v a l u e r l ' é t endue de ce t te lacune, car il e x i s t e
152 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
('^h'^.n îD^rw) ; on s 'est a lors remis à dénoncer {'^h''.n hr tvhm
smlt) < G > [mon Imyt-pr (?) ] et [ ]meshy( '^ ' ) ( ?) [est in te rvenu] en ces t e rmes (r dd) :
— « Remettez tous les biens (Iml ht nM) de Séni-mosé sous les pieds ('^') [hr rdwy) < 7 > [de sa femme . . . ] . [ E t après la vieillesse de la femme de Séni jmosé , ses biens ( = de Sénimosé) seront partagés en t re ses e n f a n t s [ks.tw pss.tw ht.f n hrdw.j) < 8 > [ ] n .
2. — In te rven t ion des e n f a n t s de Sénimosé, vra isemblablement à l ' ins t iga t ion de l ' a îné et de sa femme.
— « J e n'(en) ai pas l ' in tent ion ( ?) {nn 15.1) ; je n ' a i p a s été un e n f a n t ('^') à lui {n Ir.l mé(y ?) n.f Imy)
u n e s o l u t i o n de cont inu i t é e n t r e l e s l i g n e s n u m é r o t é e s 4 e t 5 par SETHE. N o u s p r é s u m o n s que la s u b s t a n c e d e la p a r t i e m a n q u a n t e a u r a i t é t é celle-c i : l o r s q u e j ' eus dres sé V'myt-pr c o m m e j e l ' a v a i s f a i t , j 'a i s u s c i t é d e s m é c o n t e n t s qui s e sont e x p r i m é s p a r f o i s a v e c u n e v i o l e n c e t r è s v i v e !. . .
(128) I l r e s t e c e t t e p a r t i e du nom propre d 'un h o m m e , qui é t a i t vrai s e m b l a b l e m e n t m e m b r e d e la f a m i l l e de H o u d j a r .
(129) Le s e n s d e v r a encore f a i r e l 'objet d 'une recherche préc i s e ; l ' express i on « m e t t r e d e s b i e n s sous l e s p i eds d e que lqu'un » e l l e n e figure p a s d a n s l e s d i c t ionna ires . Seu l H e n r i SOTTAS, à no tre c o n n a i s s a n c e ( d a n s La préservation de la propriété funéraire dans l'ancienne Épypte (Par is , 1913) , p. 131, n. 3) , en a d o n n é u n e e x p l i c a t i o n en s u p p o s a n t qu'e l le s i gn i f i era i t m e t t r e « e n t i è r e m e n t en (le) pouvo ir » du bénéf i c ia i re dés igné . Ce t t e expl i c a t i o n n 'es t p a s acceptable , vu que j u s t e m e n t l e t e x t e de S é n i m o s é m a l g r é t o u t e s s e s l acunes , p r o u v e que l e l e g s e s t f a i t s o u s cond i t ion (puisqu' i l l ' es t a v e c fidéicommis).
(130) L a l a c u n e n o u s e m p ê c h e peut -ê tre d e rencontrer u n e p h r a s e de ce genre-c i : « C'est ce que j 'ai f a i t , c o m m e l ' a t t e s t e l e n o u v e l a c t e que j 'ai d r e s s é ». I l s e t r o u v e que l e s e x t r a i t s de cet acte , qui n 'es t p a s c o m p a t i b l e pour l e f o n d a v e c le contenu d u premier « imyt -per », d 'après l ' in t i tu l é q u e n o u s en a conservé l e c in tre de l a stèle , on t é t é r e p r o d u i t s sur l a s t è l e a v a n t l ' exposé narra t i f ou p lutô t la « d é c l a r a t i o n » d u d i s p o s a n t : « [Moi , S é n i m o s é , j e l ègue (?) tous m e s b iens par Umlyt-pr ( ? ) ] à m a f e m m e Houd j a r d a n s son t e m p s de vie... E t après la v i e i l l e s s e de m a f e m m e H o u d j a r , [ t o u s m e s b i e n s ] s e [ r o n t p a r t a g é s en tre m o n fils S e â a ] , m a fille T a ï r y , m a flUe . . . ».
(131) Voir la n. 190.
L E T E S T A M E N T D A N S I / É G Y P T E A N C I E N N E 153
pour a t t e ind re cela (??) (r ph ml kd.w) ('̂ ^) < 9 > D i [ r e n t (dd) ] t o u s s e s [en]îants ([hr]dw.f nh).
J e poursuiv is ( ?) en d i san t à mon flls Seâa {iic &mé.i hr dd n S3.1 S.) e t sa femme (/m*̂ hmt.f) < 1 0 > « [ p r j e n e z ga rde qu 'un écr i t ("^) ne soit f a i t cont re vos cr imes {^^) {[s]3w Ir.tw sS r itswt.tn) ».
Mais ils ont répondu d 'une < 1 1 > [seule] bouche {'^h'^.n.én hr dd m r j [w'^]) :
— « [Évite C^') que soit f a i t en lapis-lazuli a r t i j f l -ciel ( [m rdl Xr.tw m hsbd lry]t), et f a i s (au cont ra i re ) que ce soit f a i t en lapis-lazuli vér i table ( '") (Iml ir.tw m, hsbd msH) ».
(132) A. GARDINER écr i t fi propos d e m\ Ifd.w : « a s s u b s t a n t i v e in ter -e s t i n g a n d p e r h a p s u n i q u e », e t il t r a d u i t ( A r c h i v e s d 'Oxford , A H ( ? / 3 2 . 2 7 , p. 7) : « . . . in order to r e a c h t h e l i k e » , c e qui r e v i e n t à d i re {ihid., p. 3) « . . . t o be t r e a t e d t h u s ». V o i r l a n. 190.
(133) A u t r e m e n t d i t : « q u e j e ne d é p o s e u n e p l a i n t e en r è g l e d e v a n t l e s a u t o r i t é s » !
(134) L e t e r m e e s t t r è s f o r t v i s a n t p r o b a b l e m e n t d e s a t t i t u d e s grave m e n t i r r e s p e c t u e u s e s à son é g a r d qu'i l va j u s q u ' à qua l i f i er d e . . . c r i m i n e l l e s !
(135) C'es t -à -d ire « u n a n i m e m e n t ». (136) L e t e x t e e s t u n e f o i s d e p l u s f o r t e m e n t e n d o m m a g é ; l a r e s t i t u
t ion de SETHE es t a d m i r a b l e ; e l l e of fre u n e a l l u r e de p r o v e r b e qu i s e m b l e p a r f a i t e m e n t c a d r e r a v e c l e c o n t e x t e .
(137) L a p i s - l a z u l i vra i s e d i t en é g y p t i e n liihd wi3<̂ (cf . Urk., IV, 951, 17) , m a i s ic i »i3<^ e s t é c r i t mi^t e x a c t e m e n t c o m m e s'il s ' a g i s s a i t d e l'ent i t é « V é r i t é - J u s t i c e » (M3H). I l n e p e u t ê t r e ques t ion , d 'après le c o n t e x t e , d e s t a t u e t t e d e M a â t en l ap i s - l azu l i (cf . héhd rpt M^'^t : R i c a r d o A. CAMI-Nos, The Chronicle of PîHncc Osorkon (Rome, 1958) , § 201) , n i de l a n o t i o n a b s t r a i t e d e V é r i t é - J u s t i c e , c o m m e é t a i t d i s p o s é à l ' a d m e t t r e A. GARDINEK (Arch ives , A 0 / 3 2 . 2 7 , p. 8 ) , en p r o p o s a n t u n e i n t e r p r é t a t i o n m é t a p h o r i q u e de l ' e x p r e s s i o n : le « l a p i s d e j u s t i c e » s e r a i t à c o m p r e n d r e c o m m e s e r é f é r a n t à l a « p u r e t é d e l a j u s t i c e », ou à « l a p l é n i t u d e » de c e t t e jus t i c e : « Le t i t be d o n e a c c o r d i n g to t h e f u l l n e s s of j u s t i c e (??) » (ihid., p. 4 ) . I l e s t c o m p r é h e n s i b l e , d a n s l a réa l i té , q u e l e d de l ' o r i g i n a i r e liéhd se so i t a f f a i b l i en d, p a s s é e n s u i t e à t, e t c o n f o n d u a ins i par u n scr ibe n o n s p é c i a l e m e n t i n f o r m é , a v e c l a t e r m i n a i s o n t du f é m i n i n . Or j u s t e m e n t , d 'après t'rk., IV, 701, 2, l ap i s - l azu l i ar t i f i c ie l s e d i t héhd îryt (cf . J . R . HARKIS, Lcxicographical Studies in Ancient Egyptian Minerais (Ber l in , 1961) , p. 128) , e t d e t o u t e f a ç o n , hihd m^'^, n 'es t p a s r é s e r v é a u s eu l p a s s a g e d e
154 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
3. — In te rven t ion de H o u d j a r
Mais elle m 'a a lors d i t {'^h'^.n.s hr dd ni) :
— « I l n 'exis te pas de carac tè re < 1 2 > [qui (?)] ... {nnlçd [ . . . ] ) [Rappelle-toi (?) le N é h a r i j n a ('*>) (?) [où j ' a i vécu (?) ] , dans un village (m dmi w'^), avec t o i ; moi, qui suis nubienne {Ink ("") n}),sy), et toi, syrien [ntk hsrw), < 1 3 > ...
Sénimosé [= Urk., IV, 1069, 2 ] ; voir par e x e m p l e : J .R . IIARRIS, op. oit., p. 127, n. 19 ; Fr . DAUMAS, La civilisation de l'Égypte pharaonique (Par is , 1 9 6 5 ) , f i g . 1 4 8 .
(138) I l e x i s t e u n h i a t u s e n t r e ce qui v i e n t d'être d i t e t qui e s t m i s d a n s la b o u c h e d e s e n f a n t s ( s inon d e tous, d u m o i n s d u fils e t d e s a f e m m e ) , qui s e m b l e n t se méf ier de leur bel le-mère, e t l e p a s s a g e s u i v a n t où il n e p e u t ê t r e n ié que l e s m o t s '^l.i'^.n.s hr âd n.i («elle m'a d i t » ) introdui s e n t sa propre in tervent ion d a n s le débat , e n c r é a n t u n e n o u v e l l e pér ipé t i e d a n s l ' é laborat ion de l"miyt-pr déf in i t i f d e S é n i m o s é . C'est s a n s t r a n s i t i o n q u e l e t e x t e de la s t è l e n o u s f a i t p a s s e r à ce t te n o u v e l l e p h a s e d e la narrat ion ; i l e s t c u r i e u x de c o n s t a t e r q u e pour d e s r a i s o n s i n s t i t u t i o n n e l l e s qui s e r o n t d o n n é e s d a n s le commenta ire , c 'est ici, en c o n c l u s i o n d e l ' intervent ion d e s e n f a n t s , que do ivent t rouver p lace l e s e x t r a i t s d 'acte qui c lôturent t o u t e l 'h i s to ire e t qui encadrent , c o m m e n o u s l ' avons s igna lé , la p a r t i e n a r r a t i v e par le bas. Uimyt-pr en ques t ion , c o m m e n o u s l 'apprend l e t e x t e ( l i gnes 16-19 = Urk., IV, 1070, 1-8 = P. LACAU, Une stèle juridique de Karnak, p. 18) a é té dressé en f a v e u r e x c l u s i v e m e n t d e s « q u a t r e e n f a n t s », H o u d j a r é t a n t donc é l i m i n é e d e la success ion . I l e s t d è s l o r s a i s é d e s e figurer qu'e l l e -même c e t t e fo i s , v i e n n e à la c h a r g e : « E t (ou ' m a i s ') e l l e a a l o r s d i t (ou déc laré . . . ) ».
(139) A. GARDINER a t r a d u i t (Arch ives d 'Oxford, AHG/32.28, p. 4) : « I t i s not [ m y ] n a t u r e [ I c a n n o t l i v e ( ? ) ] in one t o w n vvith thee. I a m a negress , t h o u art a S y r i a n ». N o u s c o n j e c t u r o n s qu'e l le a pu s ' e x p r i m e r p l u s ou m o i n s en ce s t e r m e s : « I l n ' e x i s t e p a s d e c a r a c t è r e a s s e z f a i b l e qui a c c e p t e r a i t de p le in g r é d'être dépoui l l é , a lors que des i n t e n t i o n s n e t t e m e n t f a v o r a b l e s s ' é ta ient r é v é l é e s . . . ».
(140) N o u s s u p p o s o n s la présence d u t o p o n y m e « N e h a r i n a », é c r i t e x a c t e m e n t ( c o m m e e n Urk., IV, 711, 5) nhryn^, a v e c l e s d é t e r m i n a t i f s N 36 e t A' 25.
(141) L e pronom \nk e s t é c r i t a v e c l ' h o m m e accroupi ( s igne A 1) au l i e u du s i g n e de la f e m m e (K 1 ) , qu'il a u r a i t f a l l u ici, s i v r a i m e n t c 'est H o u d j a r qvii par l e : « e t elle a d i t a l o r s ». I l en es t de m ê m e pour le déter-m l n a t i f d e nlj^éy (« nubien ») qui s u i t \nk. L 'erreur e s t f a c i l e m e n t exp l i c a b l e il par t i r de l 'h iérat ique , so i t que le scr ibe a i t n é g l i g é de m e t t r e dis-
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 155
4. — Ul t ime décision de Sénimosé. I l demande au Souverain l ' au to r i sa t ion de r ep rendre les t e rmes de son premier acte.
— « [ ] ga rde au Pa la i s {s3w r pr-'^s) depuis Âakhe-pe rka rê ( = Thoutmosis I r ) •— puisse-t-il vivre éternellem e n t — je suis au service de mon Maî t re C*̂ ) ( = le Roi r égnan t ) (Iw.i hr ëms p3{y).l ni) ; or (hr), < 1 4 > [ j ' adresse ( ?) à mon Maî t re une requête ( ?) en ces te rmes] :
« [Puisse]-t- i l ê t re o r [donné ] de me f a i r e
t i n c t e m e n t l e po int d iacr i t ique qui do i t d i f férencier le s igne f é m i n i n d u s i g n e mascu l in , so i t que l e lapic ide n'y a i t p a s prêté a t tent ion . Cf. Horus et Seth, 7, 4 [A. GARDINEB, Late-Eyyptian. Storics, 46, 2 ] : « J ' a i m i s a u m o n d e pour lui un e n f a n t mflle », où le su je t je e s t écr i t avec le s i g n e d u m a s c u l i n ! N o u s s igna lerons à t i tre documenta ire (car il nous semble a l l er d e soi qu'il f a u t considérer, d a n s ce texte , 'mk comme un pronom fémi n in) , que J e a n SAINTE FARE GAKNOT, d a n s u n e le t tre écr i t e en 1962, consécut ive à un entre t i en <pie n o u s a v i o n s consacré à la s t è l e de Sén imosé , s 'es t d e m a n d é si le père, remarié , ne t ra i t era i t p a s de « syr i en » le f i ls qu' i l a u r a i t eu d'une i)remière f e m m e . M a i s sûrement le c o n t e x t e ne s 'y prête pas, n 'é tant p lus quest ion en ce t endroi t d 'une d i scuss ion entre Sénim o s é et s e s e n f a n t s . I l se t r o u v e que déjà E. REVILLOUT (Précis du droit égyptien, Par i s , 1903, p. 1408), s'en tena i t à la l e t tre du t e x t e : « M o i , j e s u i s un néhsi (un nègre, un é th iop ien) ; toi, tu es un syr ien », e t il e n d o n n a i t u n e e x p l i c a t i o n jur id ique (ibid., p. 1408, n. 2) : « C'est u n e form u l e d 'abdicat ion de parenté a n a l o g u e à ce l l e s que n o u s t rouvons en dro i t cha ldéen , a l o r s que l e père d i sa i t à son fi ls : ' tu n'es p a s mon fi ls ', e t que le f i ls d i s a i t à son père : ' tu n'es pas mon ijère ', . . . ». Mai s la prat ique de l 'abdicat ion de parenté n'est p a s a u t r e m e n t a t t e s t é e en Égypte.
(142) S é n i m o s é aura i t é té garde au Pa la i s , m a i s il s emble qu'il so i t d e v e n u m e m b r e de la g a r d e personnel le du Ro i (voir la l i gne 15). C'est c o m m e f o n c t i o n n a i r e du P a l a i s qu'un recours lui aura i t é té ouvert directem e n t a u Roi . N o u s rev iendrons sur ce point d a n s le commenta ire , en n o u s e f forçant d'en dé terminer la s igni f icat ion ins t i tut ionne l le .
(143) « Puisse- t - i l ê tre ordonné », ou « puisse-t-on. ordonner », é t a n t e n t e n d u que « on » peut dés igner le Roi . C'est le Ro i d 'a i l l eurs qui a v a i t dé jà « ordonné » la première fo is , c 'est-à-dire lors de la première i-édac-t ion de l 'acte t e s tamenta i re , de sor te qu'on e s t en droi t de se d e m a n d e r en quoi il y aura i t eu d a n s le chef de Sén imosé a u t o n o m i e de la volonté. Ce point cap i ta l de la proc-édure avec la recherche des dro i t s e f f ec t i f s d e s part i cu l i ers es t d i scuté d a n s le conunenta ire (sous la rubrique : le Prob lème de l 'Appel au Roi (notes 196 sqq.) .
156 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
([l/i wd].tw rdlt) app l ique r (Iry.l) ce q u ' a v a i t o rdonné mon Ma î t r e (p3 wdt.n ('•") p3(y).l nb) en p remie r lieu {m sp tpy) ».
5. — Sa t i s f ac t ion lu i es t donnée, e t le P rés i d e n t du Consei l n o t a r i a l du P a l a i s t r a n s m e t la décision a u Viz i r p o u r son exécut ion .
Le P r é s i d e n t du Con[se i l n o t a r i a l C^TtP.n imy-rs rw[yt]) < 1 5 > (du Pa la i s ) ("") a a lo r s o r d o n n é (?) ("«) qu ' i l soi t f a i t selon le dés i r (?) du g a r ] d e de P h a r a o n V.S .F . {[s3]w n pr-'^}). E t ce f u t p résen té a u Viz i r Ouser ( ' ' " ) en vue d e
(144) Que .ie « f a s s e » ou « re- fasse » (que j 'accomplisse , que j 'exécute) m e s d ispos i t ions init iales .
(145) P o u r ce qui concerne l 'aspect grammat i ca l de ce t te forme, A. GAR-DiNER juge le t sui)plétif (Orammar^, p. 417, n. 14) parce que w(U.n e s t précédé de l 'art ic le mascul in pj . Mais c o m m e cet wit.n e s t u n e f o r m e re lat ive per fec t ive f é m i n i n e employée pour l e neutre e t que l e neutre en néo-égypt ien es t du genre mascul in (A. ERMAN, Neuâgyptische Oratnmatik, § 85), on i)eut logiquement concevoir cet te jux tapos i t i on de P3 et d 'une f o r m e comme wdt.n ; de toute façon, e l le n'est pas la seu le du g e n r e ( A . ERMAN, op. cit., § 3 8 1 ) .
(146) Le sens général du p a s s a g e es t : J e so l l ic i te de l 'adminis trat ion roya le une mesure a u x termes de laquel le j e pu i s se reprendre la t eneur de mon premier Imyt-pr.
(147) L'express ion \my-r3 rwyt devra encore ê tre minutieu.sement étvi-diée. Notre a n a l y s e des documents nous a f a i t retenir, ici, l ' expl icat ion proposée par W. HAYES (Ann. Serv. Ant., X X X I I I (1933), p. 12), m a i s a v e c d e u x préc is ions essent ie l l es :
a) c'est d a n s le mi l ieu du P a l a i s Roya l qu'il f a u t s i tuer le ressort et la compétence du mag i s t ra t en quest ion ;
b) ricyt en déf init ive dés ignerai t un « Consei l », un « Col lège », c o m m e lynM, ou dsû^t, ce qui rev ient à dire à fonc t ions mult iples , pouvant prendre s an s doute des mesures judiciaires , m a i s par fo i s a u s s i de portée adminis trat ive , ou notariale , comme le montre notre texte .
(148) I l e s t assez év ident que l e Prés ident du Consei l qui s 'est réuni d a n s le P a l a i s m ê m e du Roi a s ta tué au nom du Consei l sur la recevabil i té de la requête, sans que le Roi n'ait eu à intervenir (voir dé ta i l s d a n s l e commenta ire ) .
(149) Cf. sur l e Vizir Ouser : W. HELCK, Ziir Yerwaltung des Mitt-Icren und Neuen Rcichcs (Leyde, 1958), pp. 290-293 ; 436-437.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' K G Y P T E A N C I E N N E 157
l 'exécution ('™) de t ou t ce qui ava i t été décidé ('^') (m.fc rdi.t(w) m li,r (''^) tsty wsr r \rt ddt nbt).
C) Troisième section.
E x t r a i t s d 'un nouvel ac te (''^).
(150) L e s d é c i s i o n s s o n t s i g n i f i é e s a u V i z i r af in d'en a s s u r e r l ' e x é c u t i o n , pu i squ' i l e s t le chef d e l ' A d m i n i s t r a t i o n en g é n é r a l e t q u e c 'es t son départ e m e n t en p a r t i c u l i e r qui c e n t r a l i s e t o u s l e s a c t e s de m u t a t i o n d u Koj'au-uie (en v u e de l e u r e n r e g i s t r e m e n t et l e u r c o n s e r v a t i o n ) : « T o u s l e s a c t e s d e m u t a t i o n {imyt-pr) d o i v e n t ê t r e apportés , c a r c 'es t lu i qui l e s s c e l l e » (Obligations du Vizir, 19 [ = K. SETHE, Urkunden, IV, 1111, 0-7 = J . BREASTED, Anoient Records, I I , § 688 = G. FABINA, Le fumioni del visir faraonico sotto la XVIII dinastia (Rome, 1917) , § 6 = N . d e G. DAVIES, The Tomh of Rckh-Mi-Rê at Thches ( N e w York, 1943) , I, p. 9 2 ; II , pl . C X X = A . GARDINER, Orammar\ p p . 3 6 2 - 3 6 3 = W . H E L C K , Zur Vcrwal-
tung des Mittlcren iind Neuen Rcichs, p. 3 5 ] ; cf . I'. LACAU, Une stèle juridique de Karnalc, p. 2 0 ; E. SEIDI-, Einfûhrung in die àgyptische Reohts-yeschichte Ms zum Ende des Neuen Iteichs, 2* éd. (1951) , p. 2 3 ; Ar . THéO-DORiDÈs, Le rôle du Vizir dans la Stèle juridique de Karnalc (RIDA, 1 9 6 2 ) , p p . 8 6 - 8 7 ) .
(151) L ' e x p r e s s i o n ddt nht d é s i g n e ic i tout ce qui a v a i t é t é « d i t », o u « d é c l a r é », c e qui r e v i e n t à d i re « déc idé », ou « v o u l u » ( p u i s q u e l e s dern i è r e s « v o l o n t é s » d u p a r t i c u l i e r s o n t « d é c l a r é e s » d e v a n t l e Conse i l com-I)étent qui l e s a c t e ) . D a n s l e c o n t e de « V é r i t é - M e n s o n g e » ( II , 3) l a m ê m e f o r m u l e s e r a p p o r t e a u x p r é t e n t i o n s d 'un d e m a n d e u r en j u s t i c e : îun. i» [ ' 3 ] ps'lt [ f tr ] \rt mi i.dd.f nblt], « L ' E n n é a d e a f a i t dro i t à t o u t e s s e s e x i g e n c e s » (G. LEFEBVRE, Romans et Contes égyptiens de l'époque pharaonique (Par i s , 1949) , p. 164, t r a d u i t t r o p l i t t é r a l e m e n t : « E t l ' E n n é a d e fit c o n f o r m é m e n t à t o u t ce qu'i l a v a i t d i t ») .
(152) M ê m e f o r m u l e a u p a s s i f i m p e r s o n n e l : rdi(w) ... m hr n, d a n s l a Stèle Juridique de Karnalc, 11. 20 -21 ; c f . 1 2 ; 18 (P. LACAU, Une stèle juridique de Karnalc, pp. 2 2 ; 33-34 ; 37 ; Ar . THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1957, pp. 43-44 ; 1962, p. 107 ; s u r l ' e x p r e s s i o n e l l e - m ê m e : Th. DEVERIA, Le Papyrus Judieiaire de Turin, d a n s Journal Asiatique, 1865-1868 [ = liibl. Égyptol., V ] , p. 130 (note I I , 1) ; Ar. TIIéODOBIDèS, d a n s RIDA, 1957, p. 44, n. 5 1 ) .
(153) C o m m e on p e u t s'en r e n d r e c o m p t e à la l e c t u r e d u d o c u m e n t , i l a é t é d r e s s é p a r S é n i m o s é en f a v e u r u n i q u e m e n t d e s e s « q u a t r e e n f a n t s », s a n s a u t r e siJéciflcation. 11 n'y e s t p a s q u e s t i o n de f e m m e l éga ta ire , n i d ' e n f a n t ( s ) a v a n t a g é ( s ) ou d é s a v a n t a g é ( s ) : n o u s n o u s t r o u v o n s d o n c e n p r é s e n c e de la s i m p l e a p p l i c a t i o n d e l a d é v o l u t i o n l é g a l e du patr i m o i n e . D è s lors , s i S é n i m o s é é t a i t m o r t « a b - i n t e s t a t », l ' e f fe t a u r a i t é t é l e m ê m e , c e qui s ign i f i e en d ' a u t r e s t e r m e s q u e V\myt-pr dont n o u s a l l o n s
<
1 5 8 ' ' A R I S T I D E T H É O D O R I D Ê S
Le contenu n'en est pas conforme aux données du cintre, ni à celles du haut de la stèle
— « P a r la vie < 1 G > [du ' k a ' ( " ' ) r oya l ] de Menkhe-p e r r ê ( = Thou tmos i s I I I ) [et p a r la vie d 'Amon-Kê, le M a î t r e de K a r n a ] k ("^),
s ' i l v ient quelque flls ou quelque fllle (ir hv S3 nb S3t nht), quelques f r è r e s ou quelques s œ u r s (snw ni snt nbt), ou n ' impor t e quel homme de m a p a r e n t é (s nh n h3wX) ('58), < 1 7 >
p o u r con tes te r (la va leur de) cet a c t e d " imyt-per ' ( r mdt [w C^') t'\3 \myt-pr) que j ' a i d ressé en f a v e u r de mes q u a t r e e n f a n t s Çir{t).n.\ n p3{y).\ hrdic .^),
l i r e d e s e x t r a i t s n'a p a s d e r a i s o n d'être jur id ique . E t p o u r t a n t II e s t là ! I l i m p o r t e par c o n s é q u e n t de jus t i f i er la pré sence d 'une te l l e d i spos i t i on t e s t a m e n t a i r e , qui n e déroge pas a u x prescr ip t ions l é g a l e s en la m a t i è r e .
(154) Ce p a s s a g e m i e u x c o n s e r v é e t o f f rant u n s e n s p a r f a i t e m e n t cohérent a dé jà é t é c i t é e t commenté , en tre a u t r e s p a r : H . SOTTAS, La préservation de la propriété funéraire dans l'ancienne Ègyptc, p. 165, n. 5 ; P. LACAU, Une stèle juridique de Karnak, p. 18 ; Ar . THéODORIDèS, d a n s R. d'égypt., X I X (1967), p. 1 2 0 ; S c h a f i k ALLAM, Zweî Sclilussklauseln zur Obcrtragung eines Redits im Alten Âgyptcn, d a n s Bihl. Oricntalis, X X I V (1967) , p. 19.
(155) Ce (}ui r e v i e n t à d ire « i iar la v i e d e la p e r s o n n e r o y a l e ». (156) L e t e x t e a é t é r e s t i t u é d e la sor te p a r K. SETHE d 'après l e s
i n f i m e s t r a c e s de la s t è l e c o n s e r v é e s en cet endro i t . N o u s a c c e p t o n s t e l l e que l l e c e t t e re s t i tu t ion en t é m o i g n a g e d ' a d m i r a t i o n pour la persp icac i t é d e l 'auteur , t o u t en ne c a c h a n t p a s qu'i l n o u s p a r a î t r a i t é t r a n g e d e rencontrer u n s e r m e n t d a n s u n ac te à v a l e u r d e t e s t a m e n t , p u i s q u e ce s e r a i t i n c o m p a t i b l e a v e c le pr inc ipe d e la révocab i l i t é d e l 'acte . I l f a u t observer t o u t e f o i s que ce n 'est p a s l e Conse i l n o t a r i a l d u P a l a i s qui a d é f é r é l e s e r m e n t a u d i s p o s a n t (rien n e n o u s le f a i t croire, d u m o i n s ) . C'est l e disp o s a n t l u i - m ê m e qui s ' expr ime s p o n t a n é m e n t d e c e t t e m a n i è r e pour b ien f a i r e e n t e n d r e qu'il e s t déc idé à n e p lus j a m a i s modi f i er s e s c l a u s e s tes tam e n t a i r e s .
(157) L e s m o t s « f r è r e s » e t « s œ u r s » por tent la m a r q u e d u i>luriel sur la s tè le .
(158) A d é f a u t de c o l l a t é r a u x i m m é d i a t s , n ' importe quel m e m b r e de s a p a r e n t é p o u v a i t ê t re appe lé à la success ion .
(159) SETHE (Urk., IV, 1070, 3) a re s t i tué hr a u l i eu d e m, e t P . LACAU l'a s u i v i {Une stèle juridique p. 18) ; m a i s c 'est b ien tndw (ou mdt) m qui e s t l ' expres s ion consacrée pour « c o n t e s t e r » ; c f . Pap. Mook (ou Pap. Munich 809), II , 2-3 : « P o u r ce qui e s t d e s r e d e v a n c e s d u e s à la d é e s s e
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 1 5 9
qu' i l soit défendu de leur p rê te r a t t en t ion {m rdi édm.tw n.én) dans < 1 8 > tou t [ g r e f j f e royal (»i [hs] nh n nsw), où ils s ' adressera ient (éprJn r.f).
« E t si cet acte d " imyt-per ' souf f ra i t du r e t a r d dans sa mise à exécution ( i [ r <3 Imyt-pr icdf C^^) Ir.tiv hft.s), qu ' i l soit défendu < 1 9 > à quiconque ('") de le modifier à j a m a i s (m rdl hnn.twJ In mit iihf r nlih) ».
( = le T e m p l e de Gebe le in s y m b o l i s é par la dées se H a t h o r , à qui il e s t c o n s a c r é ) , qui a v a i e n t f a i t l 'objet d 'une enquê te à l 'époque de Menkhe-perrê V .S .F . ( = T h o u t m o s i s I I I ) , e t c o n c e r n a n t [ l e s q u e l l e s l e demandeur ( ? ) ] a v a i t é t é s e m b l a b l e m e n t débouté (h^d) en f a v e u r d e la d é e s s e il qui e l l e s appar t i ennent , qu'i l so i t d é f e n d u d e l e s contes ter (m rdi mdt.tw UnJn) . . . » (W. SPIEGELBEBO, Em OerichtsprotokoU ans dcr Zeit Thut-mosis' IV, d a n s Z. àg. Spr., L X I I I ( 1 9 2 8 ) , p p . 1 0 5 s q q . ; W . HEI .CK, Mate-
rlalicn zur Wirtschaftsffeschichte des Neuen Reiches, I I (1961), pp. (262)-(263) ; I .M. LouRiÉ, Esquisses de droit égyptien ancien (en russe , Len ing r a d , 1 9 6 0 ) , p p . 1 5 5 - 1 5 6 ; A r . T H é O D O R I D è S , d a n s RIDA, 1 9 6 7 , p . 1 2 6 ) .
(160) L e Wôrterbuch, h l ' ar t i c l e é<îm n (IV, 385, 14 : « a u c h jur i s t i s ch , d e m K l a g e r k e i n Gehor s c h e n k e n = ihn abvv'eisen ») c i t e no tre t e x t e {Vrk., IV, 1070) , m a i s non ce lu i de N é f e r p e r t (Urk., IV, 1021, 9 ; Ar. THéODORIDèS, De la prétendue expression juridique pn'^ r mdt {renoncer à une convention), d a n s R. d'égyptol., X I X (1967), pp. 117-118) . On p e u t y a j o u t e r l ' e x e m p l e de la Stèle Juridique de Kamak ( X V I I " d y n a s t i e ) , l i g n e 8 (P. LACAU, Une stèle juridique de Kamak, p. 15 ; Ar. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1962, pp. 62-63; 1964, p. 79, n. 9 9 ; 1965, p. 83, n. 21 ) , et, p l u s a n c i e n encore , c e lu i du Pap. de B r o o k l y n éd i t é par W. HAYES, A Papyrus of the Late Middle Kingdom (1955), p. 117.
(161) C'est b i en a i n s i qu'il f a u t couper e t ré tabl ir l e t ex te , c o m m e P. LACAU s i g n a l e {Une stèle juridique p. 21, n. o) qu'il l ' ava i t f a i t d a n s Stèles du Nouvel Empire (Cat. Gén. du Caire), p. 35. M a i s SETHE s 'é ta i t d é j à corr igé l u i - m ê m e {Urk., IV, p. 1226 : Berechtigungeti).
(162) P o u r wdf d a n s c e t t e construct ion , cf . Ar. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1962, p. 65, n. 64.
(163) E n s o u s - e n t e n d a n t que lu i seul , c o m m e a u t e u r de l 'acte, a ce dro i t . (164) S u r le t e r m e hnn, pour lequel P. LACAU {Une stèle juridique
p. 22) , pi-opose d e p r é f é r e n c e le s e n s de « d é t r u i r e » , voir Ar. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1962, p. 97 : « hnn p a r a î t d o n c b ien pos séder l 'accept ion g é n é r a l e de trouble (cf. Wôrt., I I I , 383 : « s t o r e n » ) , p lu tô t que d e « s u p press ion », quo ique sous l 'ang le des i n s t i t u t i o n s l e l i en entre c e s d e u x m o t s so i t re s serré : « troubler » une s t ipu la t ion rev ient à la « s u p p r i m e r » d a n s sa t e n e u r o r i g i n a l e » ; cf . T y c b o MRSICH, Untersuchungen zur Hausurkun-de des Alten Reiches : Ein Beitrag eum altàgyptischen Stiftungsrecht (Berl i n , 1 9 6 8 ) , § § 2 3 9 e ; 2 4 2 .
160 A R I S T I D E T H Ê O D O K I D B S
I I I / La formalité terminale.
[Ce f u t scellé] {htm{iv)) p a r le bureau viziral {In h3 C^) n tsty), [en] ce jour ( [ m ] hrw pn) ( '") , devant le
(165) « N o u s avons , e x p l i q u e P. LACAU {Une stèle juridique p. 20 ) , e n p a r l a n t de la s t è l e de Sén imosé , « u n ' imyt-per ' fait en présence d u Viz i r ». E n fa i t , l e verbe e s t d a n s la l a c u n e e t n o u s p r é f é r o n s pour no t re p a r t la r e s t i tu t ion de K. SETHE : « [Ce f u t s c e l l é ] par le b u r e a u d u Vizir . . . ([htrn(w)\ in h3 n. t^ty . . . ) ». L e t e x t e e s t c la i r à ce t égard , v u qu'i l différenc ie t rès n e t t e m e n t ce qui s 'est f a i t au P a l a i s roya l p r o p r e m e n t d i t de ce qui s 'est f a i t a u bureau v i z i ra l : l 'acte A'imyt-pr modi f i é a é t é t r a n s m i s a u V iz i r pour son exécut ion . E t là il a c o m m e n c é par ê t r e « sce l l é » af in d 'ê tre c o n s e r v é d a n s l e s a r c h i v e s d 'une m a n i è r e t e l l e qu'on n e p u i s s e y toucher . C'est ce que prévo i t l e s OMiijations du Vizir, l i g n e 19, rappe lé à la n o t e 150. E . REVIIXOUT s ' e x p r i m a i t en ce s t e r m e s s u r c e t t e mat i ère , tout a u début d u s i èc l e : « I l ( = S é n i m o s é ) a l l a t rouver u n e p r e m i è r e f o i s l e roi T h o u t m è s I " , qui rend i t un éd i t — ou p l u t ô t u n rescr i t — sur c e t t e ques t ion , puis , une seconde fo i s , un roi dont le n o m n e n o u s e s t p a s donné , e t qui renvoya l'affaire à la cour d u t^ty, j u g e s u p r ê m e ( sauf décis i on contra i re d u roi) des a f f a i r e s d 'hérédi té . . . » (Précis du droit égyptien, p. 1407 ; n o u s a v o n s s o u l i g n é ) . W. HELCK écr i t d e son cô té (Zur Ver-waltung des Mittleren und Neuen Reiclis (1958) , p. 61) : « D i e V o r s c h r i f t , T e s t a m e n t e vor d e m A'ezir ini Vezirbi iro a u f z u s e t z e n , b e s t e h t a u c h noch i m N e u e n l i e i ch , w i e d a s l e ider s tark z e r s t o r t e T e s t a m e n t d e s ènj-msw e r k e n n e n li isst. H i e r s c h e i n t aber d a s i jersonl iche E r s c h e i n e n vor d e m Ve-z i r n i c h t m e h r n o t w e n d i g g e w e s e n zu se in . . . ».
(166) C'est-à-dire ce lu i d u b u r e a u qui d a n s l e « d é p a r t e m e n t » v iz ira l e s t a f f ec té à ce service . Le t erme {13, e f f ec t i vement , e s t t r a d u i t par « ha l l » (Wôrt., m , 221) , « b u r e a u » ou « o f f i c e » (W. SPIEGELBERO, Studien und Materialien zum Rcchtswcsen pp. 52-53; P .E . NEWBERRY, The word (nhsr), a ' diwan' or 'office', d a n s F8BA, X X I I (1900), pp. 99-105; W . HAYES, a Papyrus of the Late Middle Kingdom, pp. 158-159; s .v . ) , ce qui correspond s o u v e n t a u s e n s e x i g é p a r le c o n t e x t e , c o m m e d a n s l e c a s d e r « Off ice d e s é c r i t s (des arch ives ) 11 : h} n sstv (Wôrt., I I I , 221, 4 ; on p e u t y j o i n d r e l ' exemple d e A.M. BLACKMAN, The Stela of Shoshenk, d a n s J. Eg. Arch., X X V I I (1941), p. 89) . M a i s n 'oubl ions p a s que le h} d u Vizir, dont i l s e r a f a i t d e n o m b r e u s e s ment ions , p e u t dés igner t o u t u n c o m p l e x e d e p ièces . A ins i , c 'est d a n s le I13 du Viz ir (où ce dern ier t i e n t a u d i e n c e : éim) q u e s e t r o u v e u n e « l a r g e s a l l e », u n e wiht, qui p o s s è d e « l e s [ é c r i t s ] d e [ t o u s ] l e s j u g e m e n t s » (Installation du Vizir, 18 [ = K. SETHE, Die Einsctziing des Vesters p. 27 = d u même , Urkunden, IV, 1092 X. DE GAKIS DAVIES, The Tomb of Itekhmirê at ThcVes, 1, p. 8 8 ; I I , pU. X V e t C X V I I I = A. GARDINER, Grammar^, p. 185, n. 6 = R.O. FAULKNER, d a n s J. Eg. Arch., X L I (1955), pl. II , pp. 22-23 e t n. 5 4 ] ) . N. DE GABIS
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 161
Direc t eu r de Ville et Viz i r {m-hih. \my-r3 nXwt, t s t y )
< 2 0 > le Di rec teur de Ville e t Vizir , [et ce f u t enregis t ré (?) . . . ] p a r le scribe H o r i (In ss H.), ("*) fils du Di rec teu r de Ville ( ?).
Le « Tes tament de Sénimosé » nous est connu p a r une stèle conservée au Musée du Caire ('^'). Le texte gravé sur p ie r re ne r ep rodu i t p a s l 'or iginal , loin de là ("") ; en outre , la stèle es t détériorée, au po in t que le vide y mange le plein !...
La pièce est in t i tu lée « imyt-per » ; elle nous f a i t conna î t r e l ' ac te de disposi t ion qu 'a dressé Sénimosé, qui é t a i t en fonct ion a u P a l a i s royal , au 15" siècle a v a n t J . - C , et don t la seconde femme ava i t nom H o u d j a r . Les qua t re e n f a n t s de Sénimosé sont des e n f a n t s qu ' i l a eus de sa première femme.
Vu l ' é ta t de la stèle, nous en sommes rédu i t à f a i r e de nombreuses conjectures , qui a f fec teront su r tou t , e t pa r fo i s grandement , les por t ions na r r a t i ves ; la stèle conserve en revanche assez
DAVIES a c o m b l é l a l a c u n e p a r hr [mâ-Bwt], ( l e s « d o c u m e n t s » ) , e t R.O. FAULKNER p a r hr IsSw], ( les « é c r i t s » ) , c e qui r ev i en t a u m ê m e : t o u s l e s proc"ès-verbaux d e s j u g e m e n t s r e n d u s sont donc c o n s e r v é s d a n s u n e p i è c e s é p a r é e d u /i.3 v iz ira l . On s e r a p p e l l e a u s s i l e Pap. Abbott, V I I , 16 [ = PEET, The Great Tomb-Robberies, p. 4 2 ; pl. I V ] : « O n en c o m p o s a u n r a p p o r t ; 11 s e t r o u v e d é p o s é a u b u r e a u d e s a r c h i v e s v i z i r a l e s {ét mn(w) m h3 n sSw n t^ty) ». D ' a u t r e part , on i n f è r e d e s Obligations du Vizir q u e r« arâyt », o ù ce h a u t M a g i s t r a t e x e r c e sa j u r i d i c t i o n i j éna le e t a d m i n i s t r a t i v e , s e t r o u v e t o u t a u t a n t d a n s son (Obligations du Vizir, en c o m p a r a n t l e s l i g n e s 9-11 e t 12-13 [ = Vrk., IV, 1107, 5 ; 1108, 4 ; 1108, 13-15 = J. BREASTED, Ancient Records, I I , §§ (i81-682 = G. FARINA, Le funzioni del viair §§ 17-19 = N. DE GARIS DAVIES, op. cit., I, pp. 90-9 1 ; I I , pl i . C X I X - C X X = W. HELCK, Zur Verwaltung pp. 3 2 - 3 3 ] ) . C'es t p o u r q u o i n o u s r e n d r i o n s v o l o n t i e r s l e du V i z i r p a r « d é p a r t e m e n t » v i z i ra l , m a i s c o m m e la t r a d u c t i o n « b u r e a u » s 'es t i m p l a n t é e , n o u s c o n t i n u o n s à l'eini>loyer.
(167) « E n c e j o u r », c 'es t -à-dire à la d a t e i n d i q u é e en t ê t e d u d o c u m e n t ; ici, d a n s l e c i n t r e de la s tè le .
(168) S u r ce scr ibe H o r i e t sa p a r e n t é p o s s i b l e a v e c l e V i z i r Ouser , c f . W . HELCK, Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs, p. 293.
(169) A u x i n d i c a t i o n s b i b l i o g r a p h i q u e s d o n n é e s p a r P. LACAU, Une stèle juridique de Karmk, p. 3, n. 3, on a j o u t e r a p. ex. , E. REVILLOUT, R. égyptol., X , pp. 171-173.
(170) L e c o n t e n u en e s t e s s e n t i e l l e m e n t n a r r a t i f .
11
162 A R I S T I D E T H É O D O K I D È S
de f r a g m e n t s de fondement ins t i tu t ionne l ("') qui nous p rocuren t chaque fois de solides amarres , pour que nous ne soyons p a s en t ra înés p a r le couran t de la fanta is ie . E n d ' au t r e s termes, les r e s t i t u t i ons na r r a t i ves sont inévi tablement hypothét iques , ma i s le contenu des ex t r a i t s ju r id iques g a r a n t i t le sens généra l des recons t i tu t ions proposées.
La stèle ne r ep rodu i t p a s le procès-verbal de la rédac t ion d 'un « imyt-per », ma i s nous of f re un aperçu des pér ipé t ies de cet te rédac t ion avec toutes les t r ibu la t ions fami l ia les qui en ont résul té , et les conséquences qu'elles ont eues su r le contenu défini t i f de l 'acte.
L 'ensemble des indica t ions es t disposé dans un cer ta in ordre, qu ' i l a plu à l ' au t eu r de l 'acte, ou à un de ses successeurs, ou enfin, a u scribe ou au lapicide, de donner de la re la t ion des rédac t ions t es tamenta i res .
De tou te façon, l 'ordre des pa r t i e s que nous présente la stèle n 'es t ni logique, n i chronologique.
Le corps même de la stèle est comme encadré p a r deux ex t r a i t s d 'ac tes qui ne sont pas à leur place et qui sont incompat ib les en t re eux : ils proviennent de deux rédac t ions d i f fé rentes des disposi t ions t e s t amen ta i r e s pr ises p a r Sénimosé; et ils ne concordent pas avec l ' in t i tu lé de l 'acte contenu dans le c in t re ("^).
E n nous exp r iman t ainsi , nous avons dévoilé l ' o r ien ta t ion générale de l ' i n te rp ré ta t ion qui va en ê t re suggérée, e t qui sera centrée su r la mise en ordre chronologique des sect ions de la stèle.
Ce t te in t e rp ré t a t ion n 'es t pas conforme à celle des a u t e u r s qui on t par lé de no t re stèle, et qui l 'ont habi tue l lement considérée comme f o r m a n t un t ou t homogène, ce qui n ' es t ce r ta inement p a s
(171) A s a v o i r : l ' in t i tu lé [ = SETIIE, Vrk., IV, 1066, 10 - 1067, 12] ; un premier e x t r a i t d 'acte [ = Urk., 1067, 5-14] ; un second e x t r a i t d 'acte ( l i gnes 16 sqq. = Vrk., IV, 1070, 1-8) ; la procédure de rédac t ion d é f i n i t i v e ( l i gnes 13 sqq. = Vrk., IV, 1069, 0-16) ; la f o r m a l i t é t ermina le , 19-20 [ = Urk., IV, 1070, 9-12] .
(172) I l y a donc eu plusieurs r é d a c t i o n s d'un même a c t e par S é n i m o s é l u i - m ê m e ; n o u s e n rechercherons l e s r a i s o n s e t l e s e f fe ts .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 163
le cas. Gas ton MASPERO ( '"), à la fin du siècle dernier , y décelai t la l iquida t ion de la succession de H o u d j a r ; Eugène REVIL-LOUT ("'') y voyai t le réci t d 'un procès occasionné p a r cet te succession ; P i e r r e LACAU ainsi que d ' au t r e s commenta teurs , l 'a p r i se pour un acte de donat ion. Le Pro fesseur J . CERNY l 'a citée comme un « t e s t amen t », et il en es t de même pour W. HELCK mais ni l 'un ni l ' au t r e n 'en ont donné la moindre explicat ion.
Nous commencerons l 'é tude ins t i tu t ionnel le de la pièce p a r le c intre , et nous descendrons peu à peu ju squ ' au bas de la stèle. Voici l 'essentiel de l ' in t i tu lé ('™) :
L ' an X X I de Thoutmosis I I I , .. . un ac te d'« imyt-per » a é té dressé p a r Sénimosé, a lors précepteur du F i l s royal Ouadjmès , en f aveur de sa femme et de ses qua t r e enfan ts .
L 'o rdonnance des éléments avec le nom de la f emme coordonné à celui des enfan t s , ass imile p r a t i quemen t cet te femme à ces derniers , ce qui signifie qu 'une p a r t successorale égale à celle des e n f a n t s lui es t réservée.
Le c in t re de la stèle nous apprend , en d ' au t r e s termes, que Sénimosé a des t iné à sa femme un legs don t le m o n t a n t équivaud r a i t à la p a r t de chacun des e n f a n t s ; elle é ta i t donc ins t i tuée léga ta i re pour un cinquième de la succession de son mar i .
La deuxième pa r t i e (qui occupe le h a u t de la stèle, sous le c intre) p résen te les choses sous un a u t r e aspect j u r id ique (" ' ) .
Con t ra i r emen t à ce qui a été p ré tendu , ce t te deuxième pa r t i e n 'expl ic i te pas la p remiè re ; elle ne développe pas l ' in t i tu lé qui
( 1 7 3 ) G . MASPEKO, Le Musée égyptien, I ( L e C a i r e , 1 8 9 0 - 1 9 0 0 ) , p . 5 .
(174) E. REVILLOUT, La femme dans l'antiquité égyptienne, I (1909) , 1». 1 1 0 .
(175) P. LACAU, Une stèle juridique de Karnak (Le Caire , 1949) , p. 3. (176) J. CERN*, d a n s J. Eg. Arch., X X X I (1945), p. 31, n. 3. (177) W. HELCK, Zur Verwaltung des Mittleren iind Neuen Hcichs
( L e y d e - C o l o g n e , 1 9 5 8 ) , p . 6 1 .
(178) Co lonnes 1-6 du c in tre [ = Vrk., IV, 1066, 10-1067, 2 ] . (179) L'édi t ion de SETHE (Urk., IV, 1067, 5 sciq.) adopte u n e n o u v e l l e
n u m é r o t a t i o n , parce qu'il s 'ag i t d e s l i gnes d u ple in de la stèle , par opposit ion a u x c o l o n n e s d u cintre .
1G4 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
en annonce ra i t le contenu. I l y a incompat ib i l i té en t r e les données de ces deux sections de stèle.
Sénimosé lègue cette fo is tous ses biens à sa femme Hou-d j a r , qui a p p a r a î t donc comme la seule bénéficiaire de la disposit ion. Qu'advient-i l des en fan t s dans cette s i tua t ion ? La réponse va nous en ê t re donnée progressivement . Tou t d 'abord , H o u d j a r ne p o u r r a jou i r du legs que « dans son t emps de vie », c'est-à-dire à t i t r e v iager ; c'est là une première res t r ic t ion imposée à la bénéficiaire qui n 'es t pas vér i tab lement légata i re , puisqu ' i l s 'avère qu'elle ne peu t pas disposer de la l ibéra l i té ; t o u t au plus, d ' ap rè s ce que l ' é t a t du texte permet de deviner en cet endroi t , pourrai t -e l le s'en servir pour couvrir des f r a i s f u n é r a i r e s (mais sans que ce soi t cer ta in) .
Nous apprenons auss i tô t après une seconde e t cai-actéristique res t r ic t ion , ma i s dont l 'effet est d ' a i l l eurs en p a r f a i t e cohérence avec la première :
«Après la vieillesse de ma femme H o u d j a r [ tous mes biens] se[ront partagés en t r e mon fils Seâa ] , m a fille Ta ï ry , ma fille Sa t imen e t [ m a fille] une telle (le nom manque) ».
Le texte qui sui t , complètement en lacune, p o u r r a i t avoir cou-tenu quelque chose comme ceci :
« [mes e n f a n t s a u r o n t a ins i t ous mes biens ( ?) ap rè s le temps de vie (?) de ma f e m j m e et mon (propre) t emps d [ e vie] ».
On dégage du passage que Sénimosé, quoique t r a n s m e t t a n t t ous ses biens à H o u d j a r , n 'en organise pas moins lui-même sa succession pour le t emps qui su ivra la m o r t de cet te dern ière : c 'est sa volonté (à lui) qui imprègne l 'avenir . I l n ' a pas ins t i tué sa femme sa léga ta i re universelle, puisqu ' i l se substitue à elle pour disposer du legs. La femme a sinon, en Égypte , capac i té pour tes te r et con t rac te r ('*^). Ic i la volonté du m a r i con t reca r re cet te capaci té féminine.
(180) L i g n e s 1 e t 6. (181) I l e s t d o m m a g e que l e p a s s a g e so i t d a n s la lacune , m a i s il e s t
ré tabl i d 'après la l i gne 6 [ = Urk., IV, 1068, 5 ] , qui o f fre e x a c t e m e n t la m ê m e idée ; m a l g r é le l e g s consent i , tous l e s b iens d e S é n i m o s é d e m e u r e n t SCS b iens , a u m ê m e t i t re que les e n f a n t s s o n t ses e n f a n t s .
(182) E t c e dès l 'Anc ien Empire , vo ir J. PIKENNE, Histoire des Institii-
L E T E S T A M E N T D A N S L ' Ê G Y P T E A N C I E N N E 165
I l se se ra i t agi, cette fois, de l 'universal i té des biens de Séni-mosé, ma i s H o u d j a r en définit ive n'en a que la jouissance, car il est c lair qu'elle est ici une grevée de res t i tu t ion . Les biens, comme nous le consta tons , échappent à son d ro i t de disposi t ion, vu que ce n 'es t pas elle qui les f a i t passer aux enfan t s , qui eux sont donc les appelés, les fidéicommissaires. Dès le momen t où la volonté de Sénimosé sera exécutée, ils au ron t de ses biens la nue-p ropr i é t é p a r indiv is ; ils en deviendront personnel lement les p ropr ié ta i r e s à la mor t , non pas de leur père, mais de leur belle-mère. L 'hér i tage pa te rne l sera à ce moment également p a r t a g é en t re eux qua t re , puisque l 'acte ne p a r a î t avoir contenu aucune s t ipu la t ion spéciale à ce propos
P o u r expl iquer la divergence ex i s t an t en t re le c in t re et le premier e x t r a i t j u r id ique de la stèle, nous devons passer à l 'examen de la section n a r r a t i v e qui commence auss i tô t après ('^). E l le nous f a i t ass i s te r à un vér i table « d r a m e » de famil le , d r a m e é t a n t p r i s dans son acception quasi théâ t ra le , vu qu'i l nous est présenté comme une série de scènes où l'on voit évoluer des personnages avec leurs propres in térê ts , et qui exercent des pressions su r le personnage cent ra l divisé en t r e son a t t a chemen t à sa seconde femme, cer ta inement p lus jeune que lui, e t son affect ion pour les e n f a n t s issus de son premier mar iage .
I l semble que des membres de la famil le de H o u d j a r soient in te rvenus afin d 'obteni r que le m a r i ga ran t i s se à cette dern ière une vie matér ie l lement décente.
On s 'est « b a t t u », lit-on dans le t ex te après une longue lacune don t l 'é tendue ne peu t ê t re évaluée ; à la sui te de quoi quel-
tioiis et du Droit Privé de l'ancienne Égypte, I I , pp. 349 sqq. ; c f . S i e g f r i e d ScHOTT, Les chants d'amour de VÉgypte ancienne ( trad. fr . de P a u l e KRIE-GER, Par i s , 1956) , i)p. 26-57 : « G l o r i f i c a t i o n d e la f e m m e » ; « S i t u a t i o n d e la f e m m e » ; « J o i e d e v i v r e ».
(183) L i g n e s 2-3 ; 7. (184) M a i s qui n'en décou le p a s ; c 'est p lu tô t l ' inverse , l ' e x t r a i t d 'ac te
é t a n t la c o n c l u s i o n de l ' exposé qui sui t . N o t r e idée es t que l 'ac te re fa i t , dont l 'ext i 'a i t provient , e s t la conséquence des é v é n e m e n t s qui v o n t ê t r e narrés .
(185) K. SETIIE n'en a pas t e n u c o m p t e d a n s la n u m é r o t a t i o n d e s l i gnes , t o u t en s i g n a l a n t l ' e x i s t e n c e d e ce t te so lu t ion de c o n t i n u i t é ( avant la l i g n e 5, p. 1067 des Urktinden).
166 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
qu 'un « a f u i », et on s 'est « remis » à dénoncer quelque chose qu 'on ne peu t dé te rminer avec précision, car le complém e n t d i rec t f a i t dé f au t {'^h'^.n Jjbrwtbm smlt...).
Mais ce qui é ta i t visé devai t sû rement ê t re une s i tua t ion jugée intenable , consécutivement à l ' é ta t de dro i t qui a l la i t ê t re créé p a r l 'acte de Sénimosé. Cet ac te a donc été dressé a v a n t cet te phase de la n a r r a t i on .
C'est pour remédier à cette s i tua t ion que « on » a impérativemen t suggéré de r emet t r e tous les biens de Sénimosé « sous les pieds [de H o u d j a r ] », c'est-à-dire en sa jouissance, de tel le sor te qu ' ap rès sa mor t seulement, les biens pussen t ê t re recueil l is p a r les en fan t s , hér i t i e r s subs t i tués de leur belle-mère :
« [et après la vieillesse de la femme] de Sénimosé, ses biens (à lui) se ron t pa r t agés en t re ses e n f a n t s (à lui) ».
Or, c 'est exactement ce que nous a app r i s le p remier e x t r a i t d 'ac te ('*'). Cet ex t r a i t provient p a r conséquent du remaniement d 'un « imyt-per » an té r i eu r à lui, et j u squ ' à nouvel o rdre nous considérerons cet « imyt-per »-là (le t o u t premier) comme é t a n t incarné p a r le tex te du cintre. Le c in t re ne fo rme donc pas une pa r t i e décorat ive et se rvant d ' in t i tu lé général , mais de point de d é p a r t à la n a r r a t i o n de tou te l 'affaire .
Le r é su l t a t de la p ressan te suggestion qui ava i t été f a i t e à Sénimosé est à t rouver dans la rédact ion nouvelle de l 'acte, don t un e x t r a i t a été r ep rodu i t su r la stèle p rop remen t dite, et aux te rmes duquel, comme signalé, H o u d j a r obt ient la jouissance de tous les biens de Sénimosé.
(186) L e verbe wl^m e x p r i m e la réi)ét i t ion d e l 'ac t ion e n v i s a g é e . (187) Voir la l i gne 2 [ = l'rJ^., IV, 1067, 9 ] qui à n o t r e s e n s es t la m i s e
e n f o r m e jur id i ( iue d e la s u g g e s t i o n f a i t e en ce t endroi t -c i à S é n i m c s é . (188) L e f u t u r est m o i n s impérat i f ici que l or sque S é n i m o s é l 'aura
repris d a n s son a c t e connue d i spos i t i on h c a u s e de m o r t ( l i gues 2-3 = Vrk., IV, 1007, 10-12).
(189) R e p r o d u i t i m m é d i a t e m e n t en d e s s o u s d u c in tre de lu stèle , d e f a ç o n à f a i r e p e n d a n t pour u n e ra i son de compos i t i on à l ' au tre e x t r a i t qui c lôt l ' exposé narrat i f ( l ignes 16 sqq. = Urk., IV, 1067, 17-1070, 8) .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E ' 1 6 7
Quelles on t é té les réac t ions des personnages après la modificat ion appor tée à l '« imyt-per » de base que nous supposons ê t r e celui du c in t re ?
I l f a u t s ' a t t endre à ce qu'elles proviennent des e n f a n t s (""). I l s se se ra ien t mont rés t r ès réa l is tes et a u r a i e n t comba t tu avec
(190) L ' i n t e r p r é t a t i o n d u p a s s a g e e s t t r è s d i f f i c i l e du p o i n t d e v u e ph i lo log ique . S e u l A. GARDINER semble-t- i l , s"est r i squé à en i>roposer u n e t r a d u c t i o n ( c o m m e il l 'a f a i t pour t o u t e l a s t è l e ) . M a i s i l s ' en e s t m o n t r é i n s a t i s f a i t a u p o i n t de renoncer à la publ i er a v e c l e s e x p l i c a t i o n s qu'i l a v a i t c o m m e n c é il en d o n n e r (et qu'on p e u t c o n s u l t e r d a n s l e s Archives d u G r i f t i t h l u s t i t u t e , à O x f o r d , s o u s l a rubr ique AHG/32.27 e t 32 .28) . I l a t r a d u i t l e p a s s a g e qui n o u s e m b a r r a s s e ici s o u s l ' in f luence d e s dern i e r s m o t s du p a s s a g e précédent , où i l v o y a i t u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e m e n t d é f a v o r a b l e à H o u d j a r , en i-aison de l a p r é s e n c e de la c l a u s e : « . . . s e s b i e n s (de S é n i m o s é ) s e r o n t p a r t a g é s e n t r e s e s e n f a n t s ». A. GARDINER e s t i m e (lu'il f a u t y v o i r « a s t e p in t h e i r f a v o u r , a n d a p p a r e n t l y to t h e d i s a d v a n t a g e of t h e i r m o t h e r . T h i s l a s t po in t is r e n d e r e d probab le by a n a l t é r a t i o n iu t h e t ex t . T h e scr ibe f l r s t w r o t e ' l e t t h e m d i v i d e n limt.f, f o r h i s w i f e a n f o r h i s c h i l d r e n '. T h e m i s t a k e v/as c o n s i d e r e d i m p o r t a n t e n o u g h to b e a l t e r e d . . . t h e i i a s s a g e n o w r a n : ' l e t t h e m d i v i d e h i s prop-e r t y (M.f) f o r h i s c h i l d r e n '. H u z a r o n o w r a i s e s h e r v o i c e in p r o t e s t . . . ». GARDINER j u g e d o n c qu'en ce t e n d r o i t du t e x t e , H o u d j a r e l l e - m ê m e interv i e n t pour i )rendre la d é f e n s e de s e s in térê t s , e t i l t r a d u i t c o m m e s u i t l a p h r a s e l i t i g i e u s e (lu'il m e t d a n s la b o u c h e de l a d e m a n d e r e s s e : « I d id not a c t a t h i s c h i d b e a r e r to be t r e a t e d t h u s ».
N o u s a v o n s é p r o u v é d e s d i f f i c u l t é s à a c c e p t e r c e t t e t r a d u c t i o n a v a n t t o u t pour u n e r a i s o n i n s t i t u t i o n n e l l e , puisqu' i l r e s s o r t d e s i n d i c e s e n c o r e d i s c e r n a b l e s q u e H o u d j a r , l o i n d'être sacr i f i é e a u r a i t é té , d 'après l e s term e s de la s u g g e s t i o n , f a i t e u s u f r u i t i è r e d e « t o u s » l e s b i e n s de S é n i m o s é . S a n s d o u t e ne p o u v a i t - e l l e p a s d i s p o s e r d e c e s b i e n s v u q u e l e l e g s é t a i t g r e v é d 'un fidéicommis, m a i s i l n 'emi)êche q u e j u s q u ' à l a fin d e s e s j o u r s e l l e é t a i t a p p e l é e à v i v r e a p p a r e m m e n t d a n s u n e c o n f o r t a b l e a i s a n c e .
N o u s a v o n s f a i t p a r t de n o t r e t r o u b l e a u t r è s r e g r e t t é M a î t r e J a r o s l a v ÔERNi, e t s a r é p o n s e e s t i)our n o u s d ' a u t a n t p l u s é m o u v a n t e à l i r e qu 'e l l e c o n s t i t u e l a d e r n i è r e l e t t r e qu'i l n o u s a i t é c r i t e : « . . . j e n e s u i s p a s é t o n n é q u e la t r a d u c t i o n de GARDINER n e v o u s s a t i s f a s s e p a s car à m o n a v i s ms n e d é s i g n e p a s u n e f e m m e m a i s u n h o m m e . . . ». E t d'en p r o p o s e r à s o n tour u n e t r a d u c t i o n a i n s i c o m p r i s e : « J e n'ai p a s a g i c o m m e u n flls à lu i pour finir d a n s t o u t c e l a ». I l s ' a g i r a i t donc b i en d 'une i n t e r v e n t i o n d u fils ( a î n é '!) d e S é n i m o s é , ne s u p p o r t a n t p a s d 'ê tre d é f a v o r i s é p a r s o n X)ère — il d e v r a i t e f f e c t i v e m e n t a t t e n d r e l a m o r t de H o u d j a r pour recue i l l i r la p a r t qui do i t lu i r e v e n i r de l ' h é r i t a g e p a t e r n e l — a l o r s qu'i l a u r a i t t o u j o u r s eu à l ' égard d e ce père un c o m p o r t e m e n t v r a i m e n t filial !
168 A R I S T I D E T H É O D O E I D Ê S
fougue le nouvel « imyt-per », é t an t appa remmen t dir igés dans leur opposit ion à la belle-mère p a r le fils et sa femme ( '") .
C'est bien à eux que Sénimosé p a r a î t reprocher avec fe rmeté une a t t i t u d e pa r t i cu l i è rement agressive :
— « Prenez garde qu 'un écr i t ne soit f a i t contre vos t o r t s (ou les pré judices que vous causez, voire même vos a t t i t u d e s ' criminelles ' !) ("^) ».
Mais i ls ne f u r e n t pas désemparés pour a u t a n t , e t sans réticence, lui on t ré torqué que leur confiance en leur belle-mère é t a i t l imitée.
« I l s d i r en t d 'une [seule] bouche ("^) :
— ' [Évite que ce soit f a i t en lapis-lazuli ai*ti]flciel, ma i s f a i s que ce soit f a i t en lapis-lazuli véri table, . . . ' » ,
l a i s san t en tendre p a r là qu 'à leurs yeux, un t iens vau t mieux que deux tu l ' auras .
E t le père semble bien avoir cédé ! I l se t rouve que l ' ex t r a i t d 'ac te qui t e rmine la stèle n 'y est pas à sa place — nous en
(191) S'i l e n a é t é a insi , e t on n e p e u t en clouter vu ce p a s s a g e qui d é n o n c e leur a t t i t u d e agress ive , c'est, é v i d e m m e n t , qu' i ls é t a i e n t a u cour a n t des i n t e n t i o n s de leur père, des d i s p o s i t i o n s qu'i l a v a i t pr ises , e t d e s m o d i f l c a t i o n s qu'il a v a i t é t é a m e n é à y a p p o r t e r ; la c o n f e c t i o n d 'un a c t e d'à imyt -per » ne se f a i s a i t c e r t e s p a s en secre t d a n s l 'Égypte anc ienne .
(192) Le m o t btjt e s t c e r t a i n e m e n t a p p a r e n t é à ht^, « i n f r a c t i o n » (« Verbrechen » : Wôrt., I, 483-484) ; l e Wôricriuch n'en c o n n a î t que l ' e x e m p l e d e notre p a s s a g e e t en propose l a t r a d u c t i o n : « B e n a c h t e i l i -g u n g ». I l e s t r e m a r q u a b l e que l e m o t so i t d é t e r m i n é par le s i g n e d e l'abstrait, a u l i eu de r « o i s e a u d u m a l » ; la « p e t i t e c r o i x » dont il r e s t e af fecté , d é n o t e la cassure , l ' i n f r a c t i o n ; btjt p o u r r a i t e x p r i m e r l ' irrégul a r i t é p lutô t qu'un ac te concret de v io lence .
(103) L ' e x p r e s s i o n s igni f ie « u n a n i m e m e n t », ce qui n'offre a u c u n e diff i cu l t é ; m a i s il n'en es t pas de m ê m e pour la ques t ion de s a v o i r s i r « unani m i t é » e s t ce l l e de t o u s l e s e n f a n t s , ou s i m p l e m e n t d u couple f o r m é du flls e t d e s a f e m m e . N o u s penchons pour l 'unan imi té d e t o u s l e s e n f a n t s dont n o u s t r o u v o n s u n e t r a c e fi la l i gne 9 [ = Urk., IV, 1068, 13] , e t u n e f f e t d a n s le dern ier e x t r a i t d 'ac te reprodui t sur la s t è l e ( l igne 17 = Vrlc, IV, 1070, 3) : « 1" imyt -per ' que j 'ai f a i t en f a v e u r de mes quatre enfants », la f e m m e du fils n ' é tant à l ' év idence p a s comprise .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 169
d i rons les ra i sons — et le seul endroi t où il convienne institu-t ionnel lement de l ' insérer , c'est ici.
Le père a cédé à la pression des en fan t s (après combien de temps ?). Nous cons ta tons effectivement qu 'un nouvel « imyt-per » a été dressé (''''), et qu ' i l est réservé aux « q u a t r e e n f a n t s ».
Mais voici a lors H o u d j a r revenant en scène en se f a i s a n t cet te fois cajoleuse, et qui sa i t , cap t ieuse ; elle sussure à Séniraosé s u r le mode sen t imenta l quelque chose comme ceci : t u f a i s bon marché des temps heureux que nous avons vécu au Néhar ina (c'est-à-di re en Syrie) (" ' ) , dans un village, moi la Nubienne, avec toi le Syrien.
E t elle est parvenue à ses fins.
Excédé p a r les pressions successivement subies, e t qui ava ien t abou t i a u x rédac t ions successives de son « imyt-per », Sénimosé décide souverainement , avec l 'a ide de l 'Admin i s t r a t ion royale, d 'en revenir aux disposi t ions qu'i l ava i t pr ises « en i>remier lieu » (m sp tpy), ce qui signifie qu'i l a voulu s'en t en i r inébran-lab lement à ses volontés init iales.
Le problème de l'Appel au Roi.
A propos de ce texte et de ce passage dans ce texte , Eugène IJEVILLOUT ("*) a soulevé — après Alexandre MOKET ('") qu ' i l
(194) Celui du b a s de la s t è l e dont l ' ex tra i t donné e s t r e l a t i v e m e n t bien conservé e t de ce f a i t vo lont iers c i té pour les f o r m u l e s procédura les qu'il renferme.
(195) A u m o i n s d'après ce que peuvent la i s ser supposer l es t races conservées (voir la n. 140) .
(196) E. REVILLOUT, Précis du droit égyptien comparé aux autres droits do l'antiquité (Paris , 1903), pp. 1407; 1409; 142.5. N o u s n o u s y reportons pour la ques t ion de r « apiJel au Roi », m a i s non pour le fond ; REVILLOUT e s t i m e en e f fe t (p. 1407) que « après une bonne v i e i l l e s se » H o u d j a r é t a i t « déjà morte », e t que « s e s dro i t s é t a i e n t revenus à s e s tro is en fant s , ( luand son é p o u x réc lama. I l a l la t rouver une première f o i s l e Ro i Thout -niès I"''... ».
(197) Al. MOBET, L'appel au Roi en Égypte, au temps des Pharaons et des Ptolémées (Leyde, 1896), p. 143 : « L e principe du droi t qu'a l e roi de rév i ser l e s s en tences et d'évoquer l es appels .. . ». Voir W.V. HAYES, A Papyrus of tlie Late Middle Kingdom (Brooklyn, 1955), pp. 135-136 :
170 A R I S T I D E T H Ê O D O R I D È S
nomme — la quest ion de l 'Appel au Koi en mat i è re civile. I l nous f a u t ouvr i r une paren thèse afin d 'é tabl i r si v ra iment i l en est a insi .
On sa i t pa r le Papyrus Sait 124 qu 'un chef d 'ouvr iers de la nécropole thébaine (sous la XX^ dynast ie) en a appelé au Roi d 'une mesure pénale pr ise pa r le Vizir contre lui. Y avait-il eu d a n s le chef du Vizir abus de pouvoir ou e r reur de procédure ? Nous l ' ignorons ; ma i s ce qui est cer ta in , d ' ap rès cet te source, c 'est que le Vizir a été démis de sa h a u t e fonc t ion (^°°).
On sa i t qu ' i l n 'y ava i t pas en Égypte de ju r id ic t ion supér ieure devan t laquelle on p û t en appeler d 'une sentence rendue p a r une ins tance in fé r i eu re ; mais il a p p a r t e n a i t à u n e même ju r id ic t ion de revoir une cause, su r nouveau f a i t ou nouveau témoignage. I l en a été a ins i dans le « Procès de Mès » (^'), et vraisemblablem e n t auss i dans le jugement que nous f a i t connaî t re le Papyrus Mook (202).
La stèle de Sénimosé o f f r i r a i t un in t é rê t supp lémenta i re si, comme l 'a cru R B V I L L O U T , elle fou rn i s sa i t un exemple cer ta in
« T h e s t r i k i n g f e a t u r e of both decrees i s t h a t t h e p é t i t i o n s c i t ed w e r e e v i d e n t l y no t channe led , in n o r m a l f a s h i o n , t h r o u g h t h e o f f i c e of t h e v iz ier , b u t w e r e m a d e d irec t ly to the Klng, obv ious ly w i t h o u t t h e l inowl-e d g e of the viz ier , s iuce in both c a s e s h e h a d to be a p p r a i s e d in dé ta i l of the ir c o n t e n t s » ; cf . à ce s u j e t Ar. THéODORIDèS, DU rapport entre les parties du Pap. Brooklyn 35.1U6, d a n s RIDA, 1960, pp. 71 ; 111 ; 119-120 ; 1 2 6 ; 1 3 0 - 1 3 5 ; 1 4 4 .
(198) Pap. Sait 12.', (= Pap. British Muséum 10055) , R°, I I , 17-18; cf . V", I, 6 -7 ; J. GKRN-t, d a n s J. Eg. Arcli., X V (1929), pp. 243 sqq. ; I .M. Lou-RiÉ, Esquisses (le droit égyptien ancien (en russe , Lén ingrad , 1960) , pp. 3 0 7 sqq.
(199) J. CERNt, d a n s J. Eg. Arch., X V (1929), pp. 255-256. (200) W . HELOK, Ztir GeschioMe der 19. und 20. Dynastie, d a n s Z.
Deutschen Morg.-Oes., CV (1955), pp. 39 sqq. (201) V o i r A. GAKDINER, The Inscription of Mes : A Contribution to the
Study of Egyptian Judlclal Procédure (1905), pp. 32 sqq. (202) Pap. Mook (ou Pap. Munich 809) : W . SPIEGELBERG, Ein Geriohts-
protokoU aus der Zeit Thutmosis' IV, d a n s Z. ag. Spr., L X I I I (1928), pp. 105-115 ; I .M. LocRiÉ, Esquisses de droit égyptien, ancien, pp. 155-156 ; W. HELCK, Materialien zur Wirt.schaftsgesehichte des Neuen Reiches, I I ( 1 9 0 1 ) , p p . ( 2 6 2 ) - ( 2 6 3 ) ; A r . T H é O D O R I D è S , d a n s RIDA, 1 9 6 7 , p p . 1 2 6 - 1 2 7 .
Cf. a u s s i notre c o m m e n t a i r e in s t i tu t ionne l d u conte de « V é r i t é - M e n s o n g e », d a n s /.'. d'égyptol., X X I (1969), pp. 103-104.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 171
d ' appe l a u Roi en ma t i è r e civile. Nous ne pensons pas cependant qu ' i l en soi t a insi , malgré l ' impression en sens con t ra i r e que peu t p rodu i r e le passage don t nous al lons ana lyser la t eneur (̂ "") :
— « [ ] garde au Pa l a i s depuis Âakheperkarê ( = Thoutmos is I r ) — puisse-t-il vivre é ternel lement — je suis au service de mon maîti 'e ( = le Koi régnant ) ; or, [ j ' adresse ( ?) à mon Maî t re une requête {?) eu ces t e rmes] :
' [Puisse]-t- i l ê t re o r [donné ] de me f a i r e appliquer ce qu 'ava i t ordonné mon m a î t r e en p remier lieu ' ».
Comme nous le disions, on re t i re de la lecture de cet e x t r a i t la ne t te impression que, comme fonc t ionna i re a t t aché au Pa l a i s du Roi, un recours a u r a i t été ouver t à Sénimosé d i rec tement a u Souverain . Mais en l i san t a t t en t ivement le texte, nous sommes condui t à f a i r e quelques observat ions préjudiciel les. P o u r le cas où il y a u r a i t eu un réel « Appel au Roi », on ne p o u r r a i t que s 'é tonner d ' app rendre que ce n ' a u r a i t été que pour obteni r du Souverain qu' i l « ordonne » ce qu ' i l ava i t dé jà « ordonné » antér ieuremen t (">*).
Que deviendra i t la l ibre volonté d 'un par t i cu l ie r s'il ne f a i t , au moment où il dresse un tes tament , qu 'exécuter un « ordre » royal ?
I l existe une an t inomie radicale ent re ce que nous avons app r i s à conna î t r e de la f acu l t é de disposit ion des par t icu l ie rs , y compris des femmes (^°'), qui ont sous cet angle une capaci té
(203) Sénimosé, 13-15 [ = Vrk., IV, 1069, 9-16]. (204) L i t t é r a l e m e n t « q u ' i l so i t ordonné de m e f a i r e f a i r e ce q u e . . . ».
Théor iquement , l e R o i e s t sa i s i par la requête , m a i s c 'est l e fonc t ionn a i r e compétent , a u P a l a i s royal , qui s ta tue .
(20ô) Voir J. PiRE.NNE, Histoire des Institutions I I (1934), pp. 345 sqq. ; E. SEIDL, Einfiilining in die dgyptischc Rechtsyeschichte, p. 4 3 ; P . W . PESTMAN, Marriage and Matrimonial Property pp. 182-184; S h a f i k AM.AM, Zîir Stellvng der Frau im altcn Acgypten in der Zeit des Neuen Reiches, d a n s Bibl. Orientalis, X X V I (1969), pp. 155 sqq., e t d a n s Das Altcrtiim, X V I (1970), H e f t 2, pp. 67 sqq.
)
172 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
égale à des hommes, et la manière de procéder p ropre à Séni-mosé, qui ne sera i t qu 'un jouet en t re les m a i n s du Roi.
E t il y a p lus grave, et d 'a i l leurs incompat ible avec cet te capacité ju r id ique qui nous a p p a r a î t r a i t t r è s r édu i t e : si au po in t de dépar t , il y a eu un « ordre » royal, il f a u d r a i t a lors admet t re , en conformi té des renseignements f o u r n i s p a r la stèle, que c'est Sénimosé lui-même qui a u r a i t t roublé cet ordre , puisque c'est lui personnel lement qui a modifié les d isposi t ions en quest ion : un ga rde du Pa l a i s a u r a i t a ins i a l té ré l 'expression d 'un ordre de son Maî t re royal !
On en dédui t a isément qu'on ne doi t p a s p r end re le passage à la l e t t r e !
Nous sommes aidé dans no t re recherche d 'une in t e rp ré t a t ion valable p a r ce que nous enseigne le Papyrus Turin 2021, que nous ana lyserons p lus loin.
On y apprend qu 'un par t icu l ie r , qui « p rend une disposi t ion », f a i t l 'act ion de iri &hr (^'^), l i t t é ra lement « f a i r e un p lan , un proj e t » (en sous-entendant : re la t ivement à ses biens).
Or là, le Vizir préside le Conseil qui ac te les volontés du par t i culier ; le Vizir est censé f a i r e lui-même les ,s'/(r { '̂̂ ) de son ressort i s s an t ; comme représen tan t de l 'É ta t , il les p rend sur lui ; il les légalise en les f a i s a n t siennes ; il les au thent i f ie et il leur procure la force d 'exécution nécessaire.
Analogiquement , on ne peut hési ter à se figurer que le Eoi a voulu les volontés de Sénimosé, ce qui signifie qu' i l a sanct ionné ses disposi t ions pa r l 'organe de son Officier d ' adminis t ra t ion ; comme Sénimosé se t rouva i t dans le P a l a i s même, ce ne f u t pas le Vizir, mais un Conseil à fonct ion no ta r i a l e s iégeant dans le P a l a i s e t a y a n t à sa tê te un Imy-rs rwyt, un « Di rec teur de rwyt ». I l es t impossible de t r a d u i r e ce t e rme en raison de son
(206) Pap. Turin 2021, I I , 9-10 : « J e s u i s v e n u pour f a i r e c o n n a î t r e . . . cette disposition que je vais prendre (P3V shr nty Iw.'i (r) îr{<)./) en f a v e u r de . . . (ma) f e m m e » .
(207) Pap. Turin 2021, IV, 2-3 : « Le V iz i r a ordonné : ' Que cette disposition que j'ai prise so i t c o n s i g n é e sur u n r o u l e a u de p a p y r u s ( = reg i s t re ) . . . ' ( iwi mv p^y shr i . îr . i ) . . . ».
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 173
imprécis ion, ma i s il n ' imj)orte pour l ' i n s t an t (^"^j, car il n 'en demeure pas moins évident que Sénimosé, é t an t en fonct ion a u Pa la i s , a dû relever d 'un organisme « royal » s t r ic to sensu, e t que c 'est un « Di rec teur de ricyt » qui a officié. Après avoir reçu la demande de Sénimosé, il a s t a tué lui-même au sein du Conseil qu ' i l p rés ida i t . Nous sommes convaincu que ce f u t sans l ' intervention personnelle du Eoi. E n suite de quoi, et a lo rs seulement , il a adressé a u Vizir non pas le dossier, pensons-nous, ma i s uniquement u n procès-verbal de la décision prise. Ce n 'es t qu'en vue de son exécut ion que cet te décision a été notifiée au Viz i r ( ^ ) :
« Le P rés iden t du Con[sei l no ta r i a l (du Pala is ) a a lors o rdonné (?) qu' i l soit f a i t selon le désir (?) du g a r ] d e de P h a r a o n V.S.F. E t ce f u t présenté au Vizir Ouser en vue de l 'exécution de t ou t ce qui ava i t été décidé ».
Non seulement il n 'y a pas eu d ' in tervent ion de la personne du lioi, ma i s il n 'y a pas eu non plus d '« Appel au Koi ». T o u t d 'abord , il n 'en f a l l a i t pas, parce qu'i l n ' a pas existé de décision jud ic ia i re pr ise cont re Sénimosé e t qu ' i l a u r a i t voulu voir rappo r t e r ; il ne s 'est agi que d 'une disposi t ion pr ise p a r lui e t qu ' i l a modifiée lui-même, ju squ ' au moment où il a f e rmement désiré en r ep rend re le p remier libellé. I l a dû pour cela vraisemblablement i n t r o d u i r e une requête, exactement comme il a u r a i t d û le f a i r e ai l leurs , s ' i l ava i t relevé d 'un a u t r e conseil admin i s t r a t i f . I l a u r a i t d û s ' adresser au Vizir (^"'), à te l endroi t , ou à un l),3ty-''
(Gouverneur de province) (^") à te l a u t r e endroi t , ou enfin à u n
(208) N o u s n 'entrons ici d a n s a u c u n déta i l r e l a t i v e m e n t à la q u e s t i o n d e s a v o i r s' i l y a u n rapport e n t r e '^ir^yt C^rryt) e t ricyt {Wôrt., I I , 407) , e t que l l e en e s t l eur ou l e u r s s ign i f i ca t ion(s ) ; n o u s n o u s c o n t e n t o n s d e r e n v o y e r i\ no tre not i ce de R. d'éffyptol., X I X (1967), p. 117, n. 3.
(209) L i g n e s 14-15 [ = Urk., IV, 1069, 14-16] ; l e p a s s a g e de Urk., IV, 1070, 9-12 ( = l i g n e s 19-20) r e l a t e l e s f o r m a l i t é s t e r m i n a l e s a u d é p a r t e m e n t v iz iral , c e l l e s d u « s c e l l e m e n t » et de l ' enreg i s trement .
(210) Cf . Mès, N 12-13 ( t raduct ion d'A. GARDINEK, The Inscription of Mes, p. 8) : « T h e n I la id a p la in t b e f o r e the Viz i er in He l iopo l i s , a n d h e c a u s e d m e t o p l e a d t o g e t h e r w i t h N u b n o f r e t b e f o r e t h e Viz l er in the G r e a t Qenbet ».
(211) N o u s i )résumons que la procédure r e l a t i v e à la requête Intro-d u c t i v e d ' in s tance es t la m ê m e a u s i ège d'un G o u v e r n e u r qu'à ce lu i d u
174 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
scribe du Conseil des ouvr iers (^'^), s ' i l ava i t a p p a r t e n u à l a comm u n a u t é de la nécropole thébaine.
Ni pour le fond, n i pour la foi-me, il n 'y a eu d 'appe l ou de recours au Eoi (^"). Sans doute, la requête de Sénimosé a-t-elle sais i le Roi, mais ce f u t théor iquement ; d a n s la réal i té , il s 'est adressé au Conseil du Pa l a i s habi l i té à régler les a f fa i res de cet te na tu r e , et qui dépendai t du Roi.
Sénimosé déclare an surp lus , que tou te « contes ta t ion » que les disposi t ions de dernière volonté pr ises p a r lui pou r r a i en t f a i r e surgi r , sera dorénavan t irrecevable dans « t o u t bureau du Roi » (^'''). I l va de soi qu'on désigne p a r là le greffe de l 'administ r a t i o n jud ic ia i re du Pa la i s , et nu l lement le Cabinet personnel du Roi.
T o u j o u r s est-il que le t ex te appuie su r la d is t inc t ion à é tab l i r en t re l 'Admin i s t r a t ion du Roi et celle du Vizi r (^''), et c 'est d a n s le Pa l a i s royal à p rop remen t pa r l e r qu'i l f a u t chercher la sphère d 'ac t iv i té d 'un « Di rec teur de rwyt ».
Lorsque Néferper t , de son côté, a obtenu le privilège que re la te sa s t a t u e (^"), c 'est un « Di rec teur de rwyt » qui a eu, semble-t-il
Vizir . L e Pap. Berlin IO46O, 18 ( inédit , m a i s d o n t n o u s d e v o n s la transcr ip t ion à l 'ob l igeante a m a b i l i t é d u P r o f e s s e u r J. ôERN*) m e n t i o n n e u n e knht pré s idée par un listy-'^ (« g o u v e r n e u r ») .
(212) Cf. VOstracon Chicago 12.073, 4-5 [ = J . ÔEBNt-A. GAKDINER, Hie-ratic Ostraca (Oxford, 1957) , pl. L X X V I I ; Ar. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1968, pp. 50 sqq.] : « . . . A i n s i m'avai t - i l par l é (en m e p r o m e t t a n t le règlem e n t d e m a j a r r e d e grais.se f r a î c h e ) . A t r o i s r epr i s e s (dé jà ) , j e l 'ai ass i gné (lio.i \rt 3 sp n imit.f) d a n s l e t r ibunal (m knht), d e v a n t Imen-nakl i t , l e scr ibe d e la tombe r o y a l e (m-bih së n t} hr I.) ; m a i s il n e m'a r ien r e m i s jusqu'à ce jour (hr hwpio.f dit n.i ht nit r-.^^'^ hrw). C'est pourquoi , j e l 'ai a s s i g n é u n e n o u v e l l e f o i s d e v a n t lu i ( = ce m ê m e scribe) (hr ptr ^OTi.(i) éw m-bjjf.f . . . ». Vo ir a u s s i sur la procédure r e l a t i v e a u x r e q u ê t e s : Ar. THéODORIDèS, DU rapport entre les parties du Pap. Brooklyn 35.1.',/,G, d a n s RIDA, 1960, pp. 105 sqq.
(213) L a requête a dû é v i d e m m e n t ê tre l ibe l l ée d 'une m a n i è r e spécia le , p u i s q u e le t e s t a t e u r s o u h a i t a i t pouvo ir reprendre u n e d i spos i t i on antérieure, la t o u t e « p r e m i è r e » de ses d i s p o s i t i o n s !
(214) L i g n e 18 [ = Urk., IV, 1070, 4 ] . (215) Voir l e s l i g n e s 18 e t 19 [ = Vrk., IV, 1070, 4 e t 9 ] . (216) S t a t u e Caire 42121, 13-16 [ = Vrk., IV, 1021, 1-3] .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 175
bien, l ' in i t ia t ive de soumet t re cette suggestion au Conseil même du Roi : « É t a i t en t ré à ce su j e t C^k hrJ) le ' D i rec teur de rwyt ' Nebsen i ; ... (Voici) ce qui a été décidé dans la Majes té du Conseil (Royal) ... » {dddt m hm n étp-s3 V.S.F.) (^").
On se souviendra , d ' a u t r e p a r t , de la déclara t ion f a i t e p a r le ba rb ie r S ibas t i t (^"), qui é t a i t lui aussi a t t aché au Pa la i s , lorsqu' i l a l ibéré son esclave en le m a r i a n t à sa nièce :
— « L'esclave ' enrôlé ' (hm-hsbw) {™) qui m ' a p p a r t i e n t {n.i-imy), < 7 > et qui a mon Imenyouy (/ . rn.f), je l 'a i acquis (Iw.w.i) < 8 > p a r mes moyens [hr hps.i), a lors que j e < 9 > me t rouva i s au service du Souverain [Iw.l hr hné p3 hk3).
« Écou[ tez < 1 0 > ce que je vais f a i r e (?) pour lui (?) : < 1 1 > je (?) vais le placer (?) comme < 1 2 > barb ie r (?) d a n s le Temple] < 1 3 > de Bas te t , la Maîtresse de Bu-baste , à la place (m st) de mon père, le barb ier Nebséhe-hou.
« I l ne sera p lus f r a p p é (nn hw.tw.f), ni [ t enu] éloi-[gné] (nn Sn['^.tîL\f]) < 1 4 > d ' aucune por te royale (hr sb3 nb n nsw), lorsque je lui a u r a i donné [rdl.n.i n.f) fH)ur f emme (r hmt) la fille de ma sœur Nebet ta {s3t sntX N.), Takamene t , en f aveur de qui [ je vais < 1 5 > fa i re le p a r ] -tage (de mes biens) ([Itv.l r ps]S n.s) avec [ma] femme < 1 6 > e t également (ma) sœur (/iii"^ }f,mt.[l] ént.[l] m mltt). ... ».
(217) V o i r Ar. THéODORIDèS, d a n s li. d'égyptol., X I X (1967) , p. 117. (218) S t a t u e t t e Louvre (E. 11.673) [ = J. DE LINAGE, d a n s B. Inst. Fr.
Arch. Or., X X X V I I I (1939), pp. 217 sqq. = W. HELCK, Vrk., IV, 1369] ; c f . I .M. LouRiÉ, Esquisses de droit égyptien ancien (I^eningrad, 1960) , p. 1 6 5 ; P . W . PESTMAN, Marriage and Matrimonial Property .... pp. 7, n. 6 ; 8, n. 1 ; W . HEXCK, ûbersetzung zu den Heften 17-22 (des Urkunden) (Berl in, 1961) , pp. 63-64; du même , Materialien zur Wirtschaftsgeschirhte des Ncuen Rciches, I I I (1963), pp. 332-333; Ar. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 196.5, pp. 123-126. Cf. S. ALLAM, Zur Stellung der Frau im alten Aegypten, d a u s Bihl. Orientalis, X X V I (1969), p. 155 b.
(219) Cf . S. ScHOTT, Kanais : Der Tempel Sethoa I. im Wadi Mia (Got-t ingen , 1961) , p. 1 5 6 ; W . K . SIMPSON, Papyrus Reisner I (Boston , 1963) , pp. 34-35; D i e t e r MUELLER, Xeue Urkunden zur Verwaltung im Mittleren Reich, d a n s Orientalia, X X X V I (1967), pp. 356-357.
176 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
Cet te déclara t ion , S ibas t i t l 'a f a i t e devant des hrdw n ksp (™) don t l 'essentiel à re teni r , ici, est qu ' i l fo rmaien t , au Palais, un Conseil à fonct ion réelle (^'), et qu' i ls é ta ien t prés idés p a r un « Di rec teur de rivyt » (^^^).
Après le passage de la Stèle de Sénimosé don t l ' appor t institu t ionne l vient d 'ê t re examiné, se l i t sur la même stèle l ' ex t ra i t d ' ac te qui clôt la na r r a t i on , en nous m o n t r a n t l '« imyt-per » rédigé en f aveur des « qua t r e en fan t s ».
D ' a p r è s no t re thèse, cet ex t r a i t n ' es t pas à sa place en cet endroi t . Tel qu' i l s 'offre à nous, au bas de la stèle, comme pour m e t t r e le po in t final à l 'exjwsé, on eû t pu croire qu' i l nous reprodu i sa i t les « u l t imes dernières volontés » de Sénimosé. Mais ses u l t imes volontés ne sont que la repr ise de ses premières disposit ions. Aussi , ju r id iquement pa r l an t , cet ex t r a i t du bas de la stèle ne peut-il contenir les tou tes premières disposi t ions en quest ion, puisqu ' i l concerne la t r ansmiss ion des biens aux « q u a t r e e n f a n t s », sans a u t r e indicat ion.
P o u r que l 'hér i tage soit t r an smi s également aux en fan t s , il n 'y a p a s lieu de dresser un « imyt-per », car il existe une déla t ion légale du pa t r imoine dans ce sens (^'). Un « imyt-per » a p p a r a î t de la sor te comme une correction appor tée p a r la volonté d 'un pa r t i cu l i e r à la t ransmiss ion légalement prévue pour les biens. Lorsque les p a r e n t s moura ien t ai intestat, ce qui devai t se passer
(220) Wort., V, 105, 11 : « B e s o n d e r s D. 18 a l s N e b e n t l t e l v o n O f f l z l e r e n u n d B e a m t e n ». P o u r la l ec ture : A. GARDINEK, d a n s J. Eg. Arch., X X V I I (1941) , p. 57, n. 1 ; cf . A .W. SHORTER, d a n s J. Eg. Arch., X V I (1930), p. 6 0 ; J. DE LINAGE, d a n s B. Inst. Fr. Arch. Or., X X X V I I I (1939) , pp. 221-224 ; Chr. DESROCHES-NOBLECOUBT, Les enfants du Kep, d a n s Actes d u X X I " Congrès Orienta l (1948), pp. 68-70; W. HELCK, Palastverwaltungen, d a n s Zur Vcrwaltung des Mittleren und Neuen Beiches (1958) , pp. 254 sqq.
( 2 2 1 ) J . D E LINAGE, op. cit., p . 2 2 3 .
(222) Ihid., p. 232. (223) Ar. TiiÉouoRiDÈs, A propos de la loi dans VÉgypte pharaonique,
d a n s ItIDA, 1967, p. 147.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y I ' T K A N C I E N N E 177
dans la généra l i té des cas, leur hér i tage a t t e igna i t les e n f a n t s p a r p a r t s égales ; les « imyt-per » fo rmaien t donc l 'exception P*).
On rédigeai t un « imyt per », ou un acte équivalent ( ^ ) , lorsqu'on modif iai t les effets de la délat ion légale du p a t r i m o i n e ; les pa r t i cu l i e r s en ava ien t la facu l té en ver tu de la loi qui a u t o r i s a i t chacun à faii 'e ce qu' i l veut (ou désire) de ses biens. I l le f a l l a i t :
— pour laisser un legs à l 'épouse, car on d iminua i t d ' a u t a n t la masse héréd i ta i re {^) ;
— pour déshér i te r un en fan t , car on modif iai t l 'égal i té de t ous devant l 'hér i tage (^ '̂) ;
— pour avan tage r un enfan t , même une fille, car dans ce cas tous les e n f a n t s ne succédaient pas également ( ^ ) ;
— pour t r a n s f é r e r un ou des biens avan t la m o r t : on disposa i t effect ivement avant la t ransmiss ion légale (^'). Le déplace-
(224) L e s e x e m p l a i r e s conservés l e sont en pet i t nombre, e t c 'est là, pensons-nous , un reflet de la réalité.
(225) C'est une a f fa i re de terminologie , comme pour l e « t e s t a m e n t » de N a u n a k h t e , qui n'est p a s apjselé « imyt-per », m a i s « pièce e n r e g i s t r é e », à quoi doi t correspondre '^wty hrwyt (J. CERN*, d a n s J. Eg. Arch., X X X I (1945), pp. 32-33; Ar. ïHéOUORIDèS, d a n s RIDA, 19C6, p. 34, n. 17) .
(220) C'est l 'objet de Papyrus Turin 2021, qui va ê tre ana lysé . (227) Il en es t a ins i d a n s le Testament de Naunakhte cité. (228) Voir l ' exemple de la S t a t u e sbéléphore Caire 42.208 (G. LEGRAIN,
Cat. Oén.) que J a c q u e s PIRENNE a e x c e l l e m m e n t résumée en ces t e r m e s (Histoire de la Civilisation de VÉgypte Ancienne, I I I (1963), p. 14) : « .. . N a k h t e f m o u t — g r a n d personnage qui, par sa mère, é t a i t l 'arrière-petit-f i ls de Sheshonq I"' — invoque la loi j a d i s promulguée par le roi : ' Que chacun d i spose de s e s b iens ', pour remet tre à l 'une de s e s filles la p lus g r a n d e part de s e s biens, sans qu'aucun autre de s e s enfants , fils ou fille, p u i s s e prétendre obtenir une part é g a l e d a n s la success ion paternel le . I l s emble résu l ter d e c e t e x t e que, normalement , l 'hér i tage eût dû se partager é g a l e m e n t en tre l es e n f a n t s . . . . Quant a u x biens qu'il ne l è g u e p a s à cet te flUe, i l s s e par tageront entre tous les enfants , la fille l é g a t a i r e compr i se ».
(229) Voir, par exemple , la s tè le Leyde, V, 88 (XII" D y n a s t i e ) [ = BOE-SER, II , 10 = A. GARDINER, Grammar^, p. 309] : « J 'ai remis m a c h a r g e à m o n fils {swd.n.H) îpt(i) n 83.1), a lors que j ' é ta i s encore en v i e ( iw.(ï) "n-h.kiwl)) ; j 'ai dressé pour lui (Ir.n.'i n.f) un « i m y t - p e r » , en dehors de c e qu 'ava i t cons t i tué mon pt're (m-h^w \rt.n it.i) ». Le patr imoine n ' a y a n t pas été t r a n s m i s a n t i c i p a t i v e m e n t n'a p a s f a i t l 'objet d'un « imyt-per ».
12
178 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
ment de la p ropr ié té s 'opérai t « i n s t a n t a n é m e n t », comme il est d i t d a n s le Papyrus Eahoun VII, 1, la l ibéral i té devenant une donat ion en t r e vifs ;
— lorsque le d isposant f a i sa i t une donat ion ou un legs avec fidéicommis, car sa p ropre volonté soumet t a i t le bénéficiaire à l 'obl igat ion de t r a n s m e t t r e le bien sans en disposer à son t o u r ( ^ ) ; l 'une des phases de la confection de l'« imyt-per » de Sénimosé nous a précisément f a i t connaî t re une telle appl ica t ion de la subs t i tu t ion ;
— pour é tab l i r un pa r t age d 'ascendants , ca r d a n s ce cas on n ' a p a s a f fa i re à un acte de dévolution, ma i s à un p a r t a g e fixé du v ivan t de son a u t e u r et pa r lui-même I l ap p a r t i en t , sinon, a u x agen ts de l ' admin i s t ra t ion , comme nous le m o n t r e n t les pièces annexées au t e s t amen t de Naunakh te , d 'ef fectuer le partage, après la mort du d isposant (^^) ;
— pour créer une fonda t ion ("^), parce qu'on rend les biens, affectés à une fin déterminée, inal iénables et indivisibles, c'est-à-d i re qu'on leur confère un é t a t j u r id ique non conforme à celui que prévoi t la délat ion légale (^^).
(230) Cf . n o tre Donation conditionnelle du Vizir Ay, d a n s RIDA, 1958, pp. 3 3 sqq.
(231) L 'ensemble d u Papyrus Kahoun VII, 1, n o u s a p p a r a î t c o m m e u n e d o n a t i o n - p a r t a g e ; on t r o u v e r a u n e x e m p l e d'« imyt -per » a e t a n t vin part a g e d 'ascendant , d a n s l 'Ostracon Deir el Médineh 108 [ = J. CERN*, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires 1935, pl. L X ] .
(232) J. CERN*, Tlie Will of Naunakhte and the related Documents, d a n s J. Eg. Arch., X X X I (1945), pp. 37-39; pli. X - X I .
(233) Voir Al. MOKET, Donations et fondations en droit égyptien (Par is , 1907) ; J. PiBE.\NE, Histoire des Institutions et du Droit privé de l'ancienne Égypte, I I (1934), pp. 324 sqq.; La fondation en droit égyptien sous l'Ancien Empire, d a n s RIDA, 1955, p. 19 sqq. ; T y c h o MRSICH, Vnter-suchungen zur Hausurkunde des Alten Rciches : Ein Bcitrag zum alt-àgyptischen Stiftungsrccht (Berl in , 1968), pp. 131 sqq.
(234) I l f a u d r a i t a j o u t e r les «. imyt -per » d r e s s é s à l 'occas ion d'une c e s s i o n à t i t r e onéreux . N o u s a v o n s abordé l a ques t ion d a n s L'acte de sounet (vente) dans la Stèle Juridique de Karnak (RIDA, 1959) , pp. 107 sqq., m a i s d e v r o n s encore la reprendre s y s t é m a t i q u e m e n t (cf. a u s s i no t re c o m m e n t a i r e d u P a p y r u s de B r o o k l y n é d i t é par W. HAYES, d a n s RIDA, 1060, pp. 93-94) . G a s t o n MASPERO a d'emblée f a i t u n e remarcjuable observat ion à ce s u j e t qui devra ê t r e s c r u t é e (BiM. Égyptol., V I I I , pp. 435-436) :
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 179
P o u r en revenir au cas qui nous occupe, nous d i rons donc qu ' i l ne f a l l a i t pas d'« imyt-per » afin que les « qua t r e e n f a n t s » fussent déclarés ap te s à recueil l i r également l 'hér i tage pa te rne l .
Mais c 'est un f a i t qu ' i l y a eu un « imyt-per » de cet te espèce, puisqu 'on en l i t un ex t r a i t sur la stèle. On en dédu i t qu'on ne peu t pas considérer cet « imyt-per » comme é t a n t l '« imyt-per » originel : il doi t inévi tablement , pour ê t re rédigé comme il l 'est , provenir de la modificat ion d 'un « imyt-per » dé jà ex i s t an t qui, lui, modif ia i t la t ransmiss ion légale des biens.
Nous inférons de ces observat ions que l ' ex t r a i t d 'ac te repi 'odui t au bas de la stèle devai t ju r id iquement et h is tor iquement p r end re place ap rès l 'exigeante intervent ion des enfan ts , lorsqu' i ls e u r e n t f a i t comprendre à leur père qu 'à leurs yeux « un t iens vau t mieux que deux t u l ' au ras ».
Le père, comme nous le disions, a dû à ce moment aussi , modifier ses disposi t ions, et il les a rendues s implement conformes a u mode de t ransmiss ion légalement établi en la mat ière . Mais il ne s 'est pas ma in t enu à ce s tade ; il n ' a pu — nous le savons auss i — rés is te r à l ' a s sau t sen t imenta l de sa femme, e t il a r epr i s ses disposi t ions d a n s leur première forme.
La phase finale est semblable au point de dépar t . Nous sommes p a r t i du c in t re et nous y i-evenons, car le libellé du c in t re représente à nos yeux les disposi t ions i r révocablement prises, auxquelles l ' au t eu r de l 'acte est revenu ap rès les t r ibu la t ions qu'évoque la stèle. N o t r e opinion est confirmée d 'a i l l eurs p a r l ' indication de la da t e : « [ce f u t scellé] p a r le dépa r t emen t viziral [en] ce j ou r . . . » ( [m] hrtv pn) (^^). Cet te formule effect ivement es t
« Le c a r a c t è r e Juridique de c e t t e sor te d'acte e s t t o u j o u r s un \te\\ d o u t e u x : j 'y reconnais , c o m m e M. GRIFFITH, d e s t e s t a m e n t s , m a i s a u s s i d e s donat i o n s e n t r e v i f s , e t d a n s d e u x c a s qui n o u s ont é t é c o n s e r v é s s u r l e s papyr u s d e K a h o u n , la v e n t e ou la c e s s i o n d 'une c h a r g e par le t i t u l a i r e a c t u e l de c e t t e charge . Si l a c h a r g e é t a i t héréd i ta ire , ce qui e s t v r a i s e m b l a b l e quand il s 'ag i t de c h a r g e s sacerdota le s , l 'ac te de ce s s ion ou de v e n t e p o u v a i t ê t re cons idéré c o m m e rentrant d a n s la m ê m e ca tégor i e q u e l e s t e s t a m e n t s p r o p r e m e n t d i t s : on s ' exp l iquera i t a ins i c o m m e n t l e n o m d" imyt -per ' lu i é t a i t donné ».
(235) L i g n e 19 [ = Vrk., IV, 1070, 9 ] .
180 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
uti l isée pour renvoyer à la da te an té r i eu remen t indiquée qui es t ici celle du c in t re ( ^ ) .
L 'énoncé de l 'acte que nous f a i t conna î t re le c in t re a été comme l 'étincelle, le f e r m e n t des t r ibu la t ions qu 'a connues la rédac t ion du t e s t amen t de Sénimosé (nous avons vu en quoi et pourquoi), et il représente l 'aspect final de cette rédact ion. C'est la da t e de la dern ière opéra t ion que nous donne la stèle.
Mais no t re invest igat ion n 'es t pas achevée pour a u t a n t ; nous a l lons toutefois , a v a n t de poursuivre , f a i r e le po in t de ce qui est acquis j u squ ' à présent .
Qu 'un « imyt-per » puisse cons t i tuer un acte ju r id ique ne p e u t ê t r e mis en doute, ca r nous y rencont rons ind iscu tab lement la man i fes t a t ion d 'une volonté (^') qui crée des effets de di'oit.
Que cet acte soit au then t ique a p p a r a î t r a encore p lus ne t t emen t un peu p lus loin (^*).
P o u r l ' i n s t an t nous appuyons su r un carac tè re f r a p p a n t de cet ac te : sa K É V O C A B I L I T É . L'« imyt-per » de Sénimosé a été en effet cassé t ro is fois p a r lui-même, et a donné na issance à t ro i s rédac t ions différentes , la qua t r ième n ' a y a n t été que la repr ise de la première.
S a n s doute l 'expression mortis causa n 'y figure-t elle pas, ma i s « ap rè s la vieillesse » (^') en t i en t évidemment lieu ! Ce t te der-
(236) Cintre , 1 [ = Urk., IV, 1066, 10-11] . (237) Cf . G. MASPERO, Bihl. Égyptol., V I I I , p. 437-438 : « . . . l a m a n i è r e
dont M. d i s p o s e de son emplo i p r o u v e qu'il u s a i t d'un dro i t a u q u e l nu l n e p o u v a i t t r o u v e r r ien à r e d i r e ; non s e u l e m e n t il opère ce t r a n s f e r t s a n s c o n s u l t e r personne , m a i s i l o r d o n n e que l ' i n v e s t i t u r e s ' a c c o m p l i s s e à la m i n u t e . . . ».
(238) Le Papyrus Turin 2021 n o u s m o n t r e la procédure d 'authent l f l ca-t ion s o u s la prés idence du Viz ir : c o m m e il n'y a p a s d e « c o n t e s t a t i o n » à soulever , l e Viz ir qui représente l 'État f a i t s i enne la d i s p o s i t i o n pr i s e par le t e s t a t e u r : « Qu'il so i t f a i t se lon l a d é c l a r a t i o n d u ' i ière d i v i n ' I m e n k l i â o u .. . ; que cette disposition que j'ai prise (nous d i r i o n s ici ' sanct i o n n é e ') so i t cons ignée sur un rou leau d 'arch ivé . . . » (IV, 1-3).
(230) L i g n e 2 [ = Urk., IV, 1067, 9 ] . N o u s a v o n s n o t é d é j à q u e d a n s le Papyrus des Adoptions, c 'est l e ternie « m o r t » qui e s t u t i l i s é : « (Quant à
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 181
nière expression est ut i l isée pa r Sénimosé à propos d ' H o u d j a r . Lorsqu ' i l pa r le de « son temps de vie » à lui (^^), à quelle fin le ferai t - i l , si ce n 'es t pour l 'opposer au temps qui suivra sa mor t .
Malgré les disposi t ions pr ises p a r lui en f aveur de telle ou telle personne, il é t a i t — vu la révocabili té de l 'acte — demeuré le p ropr i é t a i r e de ses biens ( '̂") en a y a n t l 'ent ière f acu l t é de modifier ses d i spos i t ions ; il a t o u j o u r s agi i)ersonnellement, j u squ ' à l 'u l t ime expression de sa volonté.
Ce qui importe , c 'est que le t r a n s f e r t de propr ié té n ' ava i t toujou r s pas été opéré, qu ' i l ne le se ra i t — selon tou te vraisemblance — qu 'à la m o r t du t e s ta teur . Sénimosé disposai t donc de ses biens pour un t emps où il n ' a l l a i t p lus être.
Nous venons de pa r l e r de la révocation de l 'acte d '« imyt-per » et de ses conséquences posit ives pour l ' ins t i tu t ion t e s t amen ta i r e d a n s l 'Égypte ancienne.
Mais il ne f a u d r a i t pas que nous tombions de Cliarybde en Scylla, vu que les fo rmal i t és adoptées pour dresser cet ac te pourr a i en t f a i r e qu'on lui dén iâ t le ca rac tè re d 'un i l a t é ra l i t é qui est t o u t a u t a n t requis pour valablement le définir. I l a p p a r a î t d ' ap rès les rense ignements que nous pouvons g laner d a n s ce t ex te comme dans d 'au t res , que les enfants , la femme, la fami l le é t a i en t p résen t s lors des rédac t ions {̂ *̂ ), e t qu ' i ls on t connu les décisions prises. I l est p a t e n t que l 'acte n ' é t a i t p a s secret. Or REVILLOUT fa i s a i t du « secret » (^*') une des condi t ions de l 'existence même d 'un t e s t a m e n t ! ...
celui ) de m e s f r è r e s et s œ u r s (qui lu i f era i t ) opposit ion, à tna mort ou u l tér ieurement , e t qui d ira i t : ' Remet tez - (mol ) la par t (qui m e rev ient ) de mon père . . . ', (qu'on le déboute) » (A. GARDINEB, d a n s J. Eg. Arch., X X V I (1940), p. 2 4 ; W. HELCK, Matcrialien zur Wirtschaftsgeschichte, I I I , p. 3 3 1 ; Ar. TnÉODORiDÈs, d a n s RIDA, X I I (196!5), p. 83) . Voir la n. 121.
(240) L igne 4 [ = Urk., IV, 1067, 14] . (261) Ses biens, m ê m e l égués à sa f e m m e res tera ient jur id iquement ses
biens : « . . . e t ses b i ens seront par tagés entre ses e n f a n t s » (k^.tw psS.tw ht.f n lirclw.f).
(242) Voir a u s s i d a n s le m ê m e sens Ar. THéODOBIDèS, Le Testament de Naunakhte, d a n s RTDA, 1966, pp. 57 sqq. ; 68-69.
(243) E. REVILLOUT, Précis de droit égyptien, p. 760.
182 A R I S T I D E T H É O D O E I D È S
11 p o u r r a i t même sembler d ' après les données de la stèle qu ' i l y a i t eu pa r t i c ipa t ion de ces personnes à la confection de l ' ac te : n 'y aura i t - i l p a s eu dès lors comme un consentement ac tue l des bénéficiaires ou des t ina ta i res , et n 'aur ions-nous pas a f fa i re dans la réa l i té à un con t r a t successoral , à une donat ion mortis causa (^^) ?
E u vue de répondre à cette quest ion capi ta le pour l 'h is toi re du t e s t ament , nous a l lons nous reporter à un t r è s i m p o r t a n t document qui est conservé à Tur in . Ses éd i teurs (^"'j l ' on t interp ré té comme un con t r a t de mariage. On ne peu t sû rement pas contes ter qu' i l y soit f a i t al lusion à un con t r a t de mar iage , cont r a t qui semble avoir répondu à une prescr ip t ion légale en la mat ière , à l 'époque de sa rédact ion (XI" s. av. J . - C ) , ma i s d a n s son ensemble, ce document nous p a r a î t cons t i tuer le procès-verbal (malheureusement incomplet) de la procédure a y a n t servi à au then t i f i e r des disposi t ions t es tamenta i res .
Nous a l lons en t r ace r brièvement le contenu, e t en donner des éclaircissements , avan t d 'en é tabl i r la t r aduc t ion .
(244) On l e s vo i t ag i r d 'une m a n i è r e t e l l e m e n t v i v a n t e e t p r e s s a n t e qu'on a d m e t t r a i t f a c i l e m e n t qu' i ls e u s s e n t part ie i i ié à la c o n f e c t i o n d e l ' a c t e .
(245) Pap. Turin 20Z1. Vo ir J. CERN^-T.E. PEET, .4. Marriage Seulement of the twentieth Dynasty, d a n s J. Eg. Areh., X I I I (1927), pp. 30 sqq. ; J. CERNI', La constitution d'un avoir conjugal en Êgypte, d a n s B. Inst. Fr. Arcli. Or. X X X V I I (1937-1938), pp. 41-48; E. SEIDL, Einfuhrung in die àg. RechtsgeKchichte (2° éd., 1951) , N" 6 6 ; P . W . PESTMAN, Marriage and matrimonial l'roperty, sur tout pp. 138-139; Ar. TIIéODOKIDèS, d a n s RIDA, 1964, pp. 47 sqq. ; d a n s J. Eg. Arcli., L I V (1968) , pp. 149 sqq. (Le testament d'Imt'nlihâoii). S h a f i k ALLAM (.Zur Stcllung der Frau im alten Aogyptcn in der Zcit des Xcucn Rciches, d a n s liibl. Orientalis, X X V I (1969), p. 157) é c r i t (en s e r é f é r a n t s i )éc ia lement a u Pap. Ttirtn 2021, e t en c i t a n t R. TANNER, Untcrsuchungcn. sur ehe- und erhrecMlichen Stellung der Frau im pharaonisclien Aegypten, d a n s Klio X L I X (1967) , pp. 17 sqq.) : « . . . v i e l e n Fi i l len, in d e n e n der E h e m a n n se iner F r a u ( m a n c h m a l s a m t K i n d e r n ) s e in V e r m o g e n mortis causa vermac l i t und dadurcl i ihre E x i s t e n z nacli s e inem H i n s c h e i d e n w i r t s c h a f t l i c h s i chers te l l t ».
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 183
CHAPITRE V : Le Papyrus Turin 2021 (^'^).
Procès-verbal de la procédure propre à la confection d'un testament.
A ) EENSEIGNEMENTS UTILES 1 L'INTELLIGENCE DU DOCUMENT.
1 / Objet de l'acte :
Un p rê t r e s 'est remar ié en f o r m a n t une communau té légale ; il n ' a p a s d ' e n f a n t s du second lit .
Après avoir p ra t iquement abandonné à sa jeune femme l a jouissance de la to ta l i t é des acquêts qu' i l a réalisés, e t à ses e n f a n t s d u premier mar i age son a p p o r t à la communauté , il se décide à f a i r e au thent i f ie r comme legs la l ibéral i té qu' i l consent à sa femme.
I I / Le disposant :
nom : Imenkhâou (^'").
fonct ion : p rê t r e - « père divin » {^^), d a n s le Temple de Kamsès I I I à Médinet Habou
é t a t civil : mar ié deux fois. 1"= femme : Ta t cha ra ï a ( ^ ) ,
décédée (^').
(246) N o u s a v o n s donné les ind ica t ions b ib l iographiques re la t ives a u Pap. Turin 2021, d a n s J. Eg. Arch., L I V (1968), pp. 149 sq. ; a l o r s que n o u s n o u s é t ions r é f é r é à I.M. LOURIé à propos d e la Stèle Juridique d'Amarah (dans RIDA, 1964, p. 45) , n o u s a v o n s o m i s de l e f a i r e pour ce papyrus , c 'est pourquoi nous s igna lons ici s e s Esquisses de droit égyptien ancien (en r u s s e ; Leningrad, 1960), spéc ia l ement a u x pp. 15 e t 217-219 ( l 'ouvrage n o u s a é t é access ib le grftce à l 'obl igeance de M a d a m e Mar ie ONATZKY, P r o f e s s e u r de r u s s e à l 'Univers i t é de B r u x e l l e s ) . LOURIé e s t i m e qu'il s 'ag i t d'un p a r t a g e d 'ascendant en f a v e u r des e n f a n t s de d e u x mar iages .
{247) Pap. Turin 2021, 111, 6; 111,7; IV, 1. (248) Id., 111, 6. (249) D u moins , se lon toute probabi l i té (J. CERN^-T.E. PEET, d a n s J. Eg.
Arch., X I I I (1927), p. 37) . (250) Pap. Turin 2021, I I I , 2. (251) La m o r t n'est p a s m e n t i o n n é e d a n s la par t i e conservée du papy-
184 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
2'''' f emme : Anoksounedjem (^'^), vra isemblablement jeune.
e n f a n t s : 1) p lus ieurs en fan t s du premier l i t ; leur nombre n 'en est p a s connu, et seuls les « deux a înés » sont nommés (^^) ;
2) pas d ' en fan t s du second mar i age ; du moins, il n 'en est j a m a i s quest ion, et certa ines a t t i t udes et disposi t ions ne se comprendra i en t nu l lement s ' i l y en avai t eu.
biens : il a fo rmé une communau té avec chacune de ses femmes, en y p a r t i c i p a n t pour les deux t iers , comme ce devai t ê t re légalement prescr i t ( ^ ) ; il cite en ou t re un bien p ropre représenté p a r une maison {^').
I I I / Les avoirs conjugaux :
La l ' * communauté (formée avec TatcharaïaJ.
le 1 / 3 : appo r t de l 'épouse; la n a t u r e n 'en est pas connue, car ce t i e r s a dû passer directemen t aux enfan t s , à sa m o r t ; p a r t a n t il n 'en es t p a s quest ion ici.
les 2 / 3 : appo r t du mar i , a y a n t consisté en neuf esclaves ( ^ ) .
r u s ; c e d e v a i t ê t r e d i t a u p o i n t d e d é p a r t . On i n f è r e c e t t e m o r t n o n p a s p r é c i s é m e n t d u f a i t q u e l e m a r i a r é c u p é r é s a p a r t i c i p a t i o n à la c o m m u n a u t é f a i t e a v e c s a p r e m i è r e f e m m e (ce qui s 'opère a u m o m e n t d e la diss o l u t i o n d e l a c o m m u n a u t é ) , c a r i l e n a u r a i t é t é d e m ê m e si, p a r e x e m p l e , i l y a v a i t e u d i v o r c e e n t r e e u x ; m a i s i l a l a j o u i s s a n c e d u t i e r s d e s a c q u ê t s d e l a p r e m i è r e c o m m u n a u t é ( I I , 1 -2 ; I I I , 3 ) , a u t r e m e n t d i t d e l a p a r t d e c e t t e f e m m e , ce qui s e r a i t i n c o m p r é h e n s i b l e e n c a s d e d i v o r c e .
(252) Pap. Turin 2021, I I , 2 ; I I , 1 0 ; I I , 1 2 ; I I I , 4 ; I I I , 9 ; I I I , 12. (253) Id., I I I , 5-6. (254) V o i r J . ÔEBN't, La constitution d'un avoir conjugal en Égypte,
d a n s B. Inst. Fr. d'Aroh. Or., X X X V I I (1937) , pp. 41-48. (255) Pap. Turin 2021, I I I , 3 ; c f . I I I , 8. (256) Id., I I I , 2 ; I I I , 7.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 186
les acquêts : ne sont pas définis, mais ils ex i s t en t ; les e n f a n t s en connaissent le m o n t a n t {^') ; ces acquêts leur reviendront dans leur intégral i té . Le père a commencé p a r différencier dans ces acquêts le t i e r s des deux t ie rs (^'), sû rement pour indiquer qu' i l ne peu t pas disposer du 1 / 3 dont l 'épouse est ju r id iquement la propr ié ta i re , et ensui te ses a y a n t s cause, ses enfan ts , mais don t le conjo in t surv ivant (en l 'occurrence lui-même) a la jouissance.
La 2^' communauté (formée avec Anoksounedjem).
le 1 / 3 : pas connu. I l n 'en est pas question ici, vu que ses a y a n t s cause, à dé fau t de descendants ,
' se ront des col la téraux à elle.
les 2 / 3 : t r è s vraisemblablement , d ' ap rè s le contexte, les neuf esclaves de la 1'" communau té , qui sont échus au père « ap rès le pa r t age d'avec sa première femme» (^''). De tou te façon, la seconde communau té a existé, puisque les acquêts en sont ment ionnés ( ^ ) .
les acquêts : 4 esclaves (^'), dont le 1 / 3 = 2 esclaves femmes
(avec leurs enfan ts ) (^") ;
les 2 / 3 = 2 esclaves mascul ins (^").
(257) Id., I I I , 3. (258) Id., I I , 1-2. (259) Id., I I I , 2 ; I I I , 7-8. (260) Id., I I , 6 ; I I , 12 ; I I I , 4 .
(261) Id., I I , 3 ; I I I , 12. (262) Id., I I , 4-5. (263) Id., I I , 5-6.
186 A R I S T I D E T H É O D O K I D È S
Le m a r i a l ' admin i s t r a t ion de la commun a u t é e t il opère lui-même le p a r t a g e des acquêts propor t ionnel lement à l ' appor t de chacun des conjoints , soit 1 / 3 + 2 / 3 (^'^).
I V / Particularité :
I l semblerai t avoir été prévu qu ' i l n 'y a u r a i t pas d ' en f an t s de la seconde union, puisque la pa r t i c ipa t ion du m a r i à l 'avoir conjugal du premier ménage se r t auss i à la cons t i tu t ion de la seconde c o m m u n a u t é ; or, ces 2 / 3 reviennen t ici aux e n f a n t s du premier l i t (^^'). On est p a r conséquen t en d ro i t de se demander ce qui se ra i t advenu s ' i l y ava i t eu des en fan t s du second lit.
C'est pourquoi nous soupçonnons, d ' après les bribes conservées de la première page du papyrus , qu ' i l a dû y avoir un débat à ce su j e t devan t le Conseil local (ou Conseil du Temple) à l 'époque du second m a r i a g e ; le m a r i a peut-ê t re dû p r end re un engagement sanc t ionné d 'un serm e n t (^"), et ce, après avoir consul té l 'oracle du Temple (lors d 'une sort ie processionnelle de la s t a t u e du dieu), à quoi le tex te f e r a i t une al lusion en ces t e rmes : « et le dieu s 'est écar té . . . » (^").
On ne sa i s i ra i t pas, au t r emen t , pourquoi le père doi t jus t i f ier aux en fan t s qui sont nés de son p remier mar iage (̂ *̂) l 'usage qu'i l f a i t de la seconde communau té (^'), et des acquêts qui sont tombés dans cet te communauté(^™).
( 2 6 4 ) lû., I I , r .-G; c f . II , 1 2 - I I I , 1 ; I I I , 1 2 .
( 2 6 Ô ) Id., I I I , 2 ; I I I , 7 . ,
(2GG) Id., II , 1 .
(267) /(/ . , II , 1. Cf. J. 6ER.\*-T.E. PEET, d a n s J. Eg. Arch., X I I I , p. 36. (268) A m o i n s que, bien entendu, i l n'y a i t e u u n e loi d i s p o s a n t que
lors d 'un r e m a r i a g e d e m e u r é s a n s e n f a n t s , l e s 2 / 3 d e s a c q u ê t s de la seconde c o m m u n a u t é d e v a i e n t reven ir a u x e n f a n t s n é s d e la première u n i o n d u père (Ar. THéODORIDèS, J. Eg. Arch., L I V (1968), p. 150, n. 6 ) .
(269) Pap. Turin 2021, I I I , 2. (270) /(/., I I I , 4-5 : « E t j e l eur a u r a i s t r a n s m i s que lque c h o s e de ce que
j 'a i acqu i s c o n j o i n t e m e n t a v e c la ' c i t a d i n e ' A n o k s o u u e d j e m , m a i s Pharaon prescr i t de r e m e t t r e à chaque f e m m e son ' s e f e r ' . . . ». Vo ir sur le s e n s poss ib le de « s e f e r », la n. 313.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 187
Lie père expose dans sa déc lara t ion de disposi t ion qu ' i l t r a n s m e t « ces neuf servi teurs . . . » (" ') . P o u r pouvoir s ' expr imer a ins i (alors que c'est la première fois qu ' i l en par le) , il a dé jà dû en ê t re question, et d ' après no t re hypothèse, ce sera i t dans la pa r t i e m a n q u a n t e du papyrus .
Enf in , ces neuf esclaves, c'est-à-dire l ' appor t du père à l a seconde communauté , ont été, ap rès la réa l i sa t ion des acquêts de communauté , mis en la possession des e n f a n t s (™), sans a u t r e précision d a n s ce que nous possédons du papyrus . Mais comme le Vizir s ' enquier t diligemm e n t de la réa l i té du fa i t (™) , on ne peu t s 'empêcher d'y voir l 'effet d 'un a r r a n g e m e n t a r r ê t é au moment du second m a r i a g e du père.
I l convient d ' a j ou t e r cependant , qu ' ap rès l 'acquis i t ion des qua t r e esclaves qui sont tombés dans la seconde comm u n a u t é , Imenkhâou en a an t ic ipa t ivement cédé la jouissance à Anolvsounedjem, et ce t te fo is il ne semble p a s qu' i l a i t prévu la chose; la mesure se ra i t une marque de reconnaissance à l 'égard de sa seconde femme qui ava i t su se m o n t r e r pa r t i cu l iè rement « bonne » ("••) !
B ) TRADUCTION DU DOCUMENT (^ ' ' ) .
1 / Première phase de la procédure : EXPOSÉ NARRATIF DU DISPOSANT.
a) F o rm a l i t é s qui on t suivi le décès de sa première femme.
« < I >
< I I , 1 > et le dieu (™) s 'est écar té (?) (hc p3 ntr rtvl) ; [et j ' a i
<271) /(/., m , 2. . : . (272) Id., I I I , 3. (273) Id., I I I , 7 : « Est -ce vrai ce qu'il a déc laré concernant ces neuf
s erv i t eurs , à savo ir qu'il vous les a (déjà) r emis eu tant que se s d e u x t i ers p r o v e n a n t du partage d'avec votre mère ? .. . ».
(274) Id., I I , 3 ; I I , 4-5 ; I I , 7-8. (275) Vo ir l es n. 245-246. (276) Vra i semblab lement , comme nous l 'avons supposé, a p r è s a v o i r é té
c o n s u l t é par l ' intéressé lors d'une sort ie process ionnel le .
188 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
prê t é un se r ]n ien t {[Iw.l "rjk) là-dessus (hrJt) d a n s le Conseil i^) (m t3 knbt) de Médinet H a b o u {t3 J},wt) ; j ' a i s épa ré (?) a lors les deux t iers du t i e r s (iw.l irt 2/3 r 1/3), d a n s t o u t (^") ce que j ' ava is acquis (̂ *'') < I I , 2 > en sa compagnie ( =
(277) La knht ou « Consei l » d u T e m p l e d e R a m s è s I I I , à M é d i n e t H a bou, p r é s i d é pour la c irconstance , m a i s non n é c e s s a i r e m e n t , par l e V i z i r en i )ersonne. Le R o i a v a i t un p a l a i s a t t e n a n t a u T e m p l e et l e Viz ir y a v a i t a u s s i s e s a p p a r t e m e n t s : t3 '^t t}ty nty m liwt : « la m a i s o n d u V iz i r qui e s t d a n s ( l 'aire de) l e T e m p l e (de R a m s è s I I I ) », te l que n o u s l 'apprend le Pap. Brit. Muséum 10.383, 1, 6 [ = T .E . PEET, The great Tomh-Holihcrics, p. 125 e t pl. X X I I ; J. CERN*, d a n s J. Eg. Arch., X X V I (1940), p. 129] . L 'appe l la t ion complè te aTfnbt d u T e m p l e de R a m s è s » s e l i t en IV, 2 e t IV, 3. P o u r (3 liwt e x p r e s s i o n abrégée , vo ir CERN*, op. cit., pp. 1 2 7 - 1 3 0 : «The Temple» (<3 hwt), as an Abbreviated Natnc for the Temple of Médinet Hal)u.
(278) On i>eut t r a d u i r e tri . . . r, par « séjmrer », « d i s t a n c e r » , « d i f f é r e n c i e r » , . . . (cf. wpi ... r) ; d e t o u t e f a ç o n l e s e n s d e c e t t e e x p r e s s i o n e s t b i en d i s t i n c t de psS irm « s éparer d 'avec (quelqu'un) », qui Impl ique q u e l a d i v i s i o n a é t é f a i t e e t q u e c h a q u e part e s t é c h u e à un des conjo in t s ou s e s a y a n t s cause . Ici , a u contraire , on i^eut i n f é r e r d u t e x t e tel qu'il s e prés e n t e fi n o u s (et conf irmé par I I I , 4 ; « i l s n ' ignorent r ien de tout ce q u e j 'a i a c h e t é en c o m p a g n i e de leur m è r e ( = m a p r e m i è r e f e m m e ) ») , que l e c o n j o i n t s u r v i v a n t (en l 'occurrence le m a r i ) , a la j o u i s s a n c e de la p a r t d e s a c q u ê t s r e v e n a n t h sa f e m m e , ou ses e n f a n t s , e t q u e ce c o n j o i n t s u r v i v a n t n e p e u t donc p a s y toucher , i w i s q u e n e lu i a p p a r t e n a n t pas . D e fa i t , i l n 'en a p a s disposé , a u s s i la to ta l i t é ( 1 / 3 -|- 2 / 3 ) rev iendra- t - e l l e a u x e n f a n t s qui en c o n n a i s s e n t l e m o n t a n t : « i l s n ' [ i g n o r e n t ] r i en . . . ». E n d 'autre s termes , l e conjo in t s u r v i v a n t a p r a t i q u e m e n t à s a d i spos i t i on l a t o t a l i t é des a c q u ê t s de c o m m u n a u t é , m a i s il d e m e u r e e n t e n d u qu'il do i t t r a n s m e t t r e i n t é g r a l e m e n t l a p a r t i e qui représente la « p a r t » d u conjo in t d é c é d é (cf. THéODORIDèS, d a n s II IDA, 1964, p. 68, et 1969, p. 156) .
(279) C'est-à-dire la t o ta l i t é des acquêts r é a l i s é s (iri) p e n d a n t l 'assoc i a t i o n c o n j u g a l e qui sont t o m b é s d a n s la m a s s e c o m m u n e , e t qui n'ont é t é « s é p a r é s » que t h é o r i q u e m e n t d a n s l e s m a i n s d u c o n j o i n t s u r v i v a n t . V o i r l e p a s s a g e p a r a l l è l e de I I I , 3 : « . . . tout ce que j 'a i a c q u i s à t i t r e o n é r e u x (t)iî) en c o m p a g n i e d e l eur m è r e », e t a u s s i I I , 12, où il s 'ag i t d e la s e c o n d e c o m m u n a u t é : « . . . tout ce que j 'ai r é a l i s é en s a c o m p a g n i e . . . à s a v o i r (mes) d e u x t i er s en p lus de son t i e r s (ito P3 2/3 lir P3V.ét 1/3) ».
(280) N o u s n e p e n s o n s pas , c o n t r a i r e m e n t a u x é d i t e u r s (ôERN*-PEET, d a n s J. Eg. Arch., X I I I , p. 34, n. 16) qu'il y a i t u n e d i f f érence d e s e n s e n t r e iri irm « fa i re , r é a l i s e r a v e c (ou ' en c o m p a g n i e d e ', ' c o n j o i n t e m e n t a v e c ') », c 'est-à-dire p e n d a n t l ' a s soc ia t ion conjuga le , e t î«î irm, « acquér ir
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 1 8 9
d a n s la c o m m u n a u t é fo rmée avec m a première femme) (m p3 \ry.i ni Irm.ét) ;
b) Son r e m a r i a g e ;
les acquêts de la seconde communauté.
et [ je suis e n t r é (^') d a ] n s la maison (i[w.i '^k r] p3 pr) de la ' cit a d i n e ' (^^) ('^nlL(t)-ti-nhvt) Anolcsounedjem, ce t te f emme qui se t i e n t ( a u j o u r d ' h u i , avec moi) devan t le Viz i r {t3y st-hmt nty '^h'^.ti m b3h t3ty, < I I , 3 > e t j ' a i acheté q u a t r e se rv i t eu r s ( '̂̂ ) [ con jo in t emen t a ]vec elle {Iw.l (hr) \n{t).) bifcl [lr]m,.st) ;
11 t i t re o n é r e u x (pendant la m ê m e assoc ia t ion) ». C'est ce que m o n t r e n t l e s p a s s a g e s e x a c t e m e n t para l l è l e s de II , 2 et I I I , 3 r e l a t i f s a u x m ê m e s acquê t s (ceux de la première c o m m u n a u t é ) , e t où l'on l i t r e spec t ivement ici irm e t înl irm. On rencontre îri irm en II , 2 ; II , 3 ; II , 6 ; II , 1 2 ; e t in\ irm en I I I , 3 et I I I , 4. La f o r m e verbale qui e s t d a n s la l a c u n e en I I I , 12 et I I I , 1, 13 pourra i t donc ê t r e res t i tuée de l 'une ou de l 'autre de ces m a n i è r e s e x i g é e par le contexte .
(281) I l e s t entré d a n s la m a i s o n pour la demander en m a r i a g e ; d e p u i s lors, e l le v i t d a n s sa m a i s o n à lui . E l l e l'a accompagné ce jour d e v a n t l e Conse i l prés idé par le Vizir , m a i s il e s t h re lever qu'elle n'y j o u e a u c u n rôle. Sur l ' express ion '^k r pr « entrer d a n s la m a i s o n », voir P . W . PEST-MAN, Marriaye and Matrimonial Propcrty in Anoient Egypt (Leyde, 1961) , p. 10, n. 2.
(282) T r a d u c t i o n tout à f a i t l i t térale , m a i s sans que n o u s p u i s s i o n s dé terminer la va l eur de l ' express ion sous l 'angle soc ia l ou jur idique . Cf. Wôrt., I, 201, 1 : « Stadter in , Bi irger in an S te l l e e i n e s ï i t e l s vor F r a u e n n a m e n ». N o u s n o u s s o m m e s demandé si, à propos d'une f e m m e , l ' express ion n 'équivaudra i t p a s pra t iquement à « ménagère s a n s profes s ion ». Cf. J. PIRE.NNE, d a n s Archives du Droit Oriental, I (1937), longue no te des p a g e s 54-56, dont voici la conc lus ion : « . . . d a n s l e s a c t e s jur idi ques e l l e équivaut , semble-t-i l , à notre expres s ion ' le s i eur ', ou ' l a f e m m e '. J e ne crois donc p a s qu'on pu i s se lui donner l e s e n s de ' c i toyen ' e t encore m o i n s ce lui de ' c i tad in ' ».
(283) Il e s t encore ques t ion de ces servi teurs-a e s c l a v e s » en II , 12 ; I I I , 1 et I I I , 12 ; on apprend d a n s l es d é t a i l s en II , 4-5, que c e s « q u a t r e » e s c l a v e s sont composés de deux f e m m e s et de d e u x hommes , et impl ic i tem e n t que l e s honuues va l en t d e u x f o i s p lus que l e s f e m m e s puisqu' i l s repré.sentent l e s 2 / 3 des ac(iuêts du disposant , a lors que les d e u x f e m m e s correspondent a u 1 / 3 de son é iwuse .
(284) I l e s t à no ter qu'il d i t « j'ai a che té » et qu'il d ira p lus lo in « j'ai remis pour son t i ers », ce qui s igni f ie c la i rement qu'il a d m i n i s t r e l 'avoir conjuga l et qu'il lu i appart i ent d'opérer personne l l ement le p a r t a g e des acquêts . Cf. THéODOBIDèS, d a n s RIDA, 1964, p. 69, n. 74 ; 1969, pp. 154-156.
190 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
c) Sa décision appuyée p a r u n e jus t i f i ca t ion , de m e t t r e tous les acquê t s de la c o m m u n a u t é en la jou i s sance de sa seconde femme.
« (or), elle m ' a f a i t du bien (^*') {Iw.st nfr ni), elle s 'est a d a p t é e à mon ca rac t è re (^^) {lw..st Snis l)\{3)t.i), e t elle a f a i t p o u r moi (iw.ét ir{t) n.i) ce q u ' a u r a i t f a i t {Viryt) < I I , 4 > un fils (ou) u n e [ f i l ] le (^") ; je lu i a i a lo r s remis {^) {iw.l dit n.st),
(285) Voir s e m b l a b l e m e n t l e Papyrus des Adoptions, V° 9-11 {RIDA, 1965, p. 91) : « Q u a n t à la t o ta l i t é des a f f a i r e s q u e j 'a i c i tées , e l l e s sont conf iées à Péd iou , ce m i e n fils ( a d o p t i f ) , qui m'a f a i t du b ien l or sque j e f u s v e u v e à la m o r t de mon mar i », e t VOstracon Gardincr 90 {RIDA, 1968, 95-96), où u n scu lp teur d e la nécropo le d o n n e à son fils l e s « journ é e s » d e s e p t e s c l a v e s (ce qui s ign i f i e qu'i l a u r a la j o u i s s a n c e d u t r a v a i l d e s d i t s e s c l a v e s ) en p r é c i s a n t : « ( i l s sont ) pour m o n fils qui est ion pour moi (nty nfr n.i) ». Cf. auss i THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1966, pp. 64-66.
(286) F a ç o n s u a v e d e d ire qu'el le a é t é doc i l e en se s o u m e t t a n t à s e s vo lontés , c a r à ce qu'i l semble , c 'est b ien ce la qu'i l f a u t e n t e n d r e p a r s u i v r e le c a r a c t è r e s 'adapter a u c a r a c t è r e d e c o m m e il re s sor t d e Vrk., IV, 903, 12 où « su ivre l e c a r a c t è r e d u M a î t r e d e s D e u x T e r r e s » r e v i e n t à d ire p r a t i q u e m e n t ( comme l e p r o u v e l e p a r a l l é l i s m e d e s p h r a s e s ) : « e n t r e r d a n s l e s lo i s du R o i », c 'est-à-dire app l iquer l e s lo i s e t p a r t a n t s e s o u m e t t r e a u x v o l o n t é s du chef . N o t o n s q u e l 'on r e n c o n t r e a u s s i '^k m bit « entrer d a n s l e c a r a c t è r e . . . » (Wôrt., I, Belegstcllcn, p. 56^, 18) .
(287) L 'épouse e s t a i n s i a s s i m i l é e à u n e e n f a n t , ce qui n e n o u s é t o n n e p a s a p r è s a v o i r l u d a n s la Stèle de Sénimosé que ce lui -c i d e s t i n e à sa f e m m e u n l e g s d u m o n t a n t d 'une p a r t s u c c e s s o r a l e ( é g a l a n t d o n c la part d e c h a q u e e n f a n t ) . C'est pour u n e ra i son s e m b l a b l e que n o u s a v o n s about i à la conc lus ion , d a n s l ' a n a l y s e d u Papyrus des Adoptions, qu'il f a l l a i t p r e n d r e la d i spos i t i on de la l igne 4 a u figuré : « il s ' e s t f a i t u n e fille d e m o i (\to.f irt.Ci) n.f n (= m) sr'\(t)) en m e l é g u a n t t o u t ce qui é t a i t s i e n (\w.f sâ w.i n ( = m) P3 stct nh) », ce qui s ign i f i e : i l m'a t r a i t é e comme s a fille (unique) en f a i s a n t de moi sa l é g a t a i r e u n i v e r s e l l e {RIDA, 1965, p. 103) .
(288) Ce t t e r e m i s e s 'es t f a i t e d e la m a i n à l a m a i n : i l a cédé à sii f e m m e la j o u i s s a n c e d u t r a v a i l des e sc laves . E l l e a é té la bénéf ic ia ire d e tous l e s acquêts , dès c e moment - là . Cet te déc i s ion pr i se par lui , d e f a c t o , i l e s t v e n u pour l 'authent i f i er s o u s f o r m e de d i s pos i t i on testamentaire, puisqu' i l l è g u e tous l e s a c q u ê t s de la c o m m u n a u t é c o n j u g a l e à s a f e m m e , y c o m p r i s ce qu'il pourra i t encore réa l i s er (ou ache ter ) « c o n j o i n t e m e n t a v e c e l l e » ( I I I , 12-13) . Ce que le d i s p o s a n t f a i t pour sa f e m m e , à s a v o i r d e lui a b a n d o n n e r la posses s ion de tous l e s acquêts , qui d e v i e n d r a propr i é t é a u m o m e n t où la d i spos i t i on t e s t a m e n t a i r e a u r a f o r c e exécuto i re , il le f a i t a u s s i pour ses fils avec son apport à la c o m m u n a u t é : i l s 'ag i t
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 191
1. — son t ie rs des acquêts qui doit légalement lui revenir lors de la dissolut ion du mar i age :
l 'esclave (féminine) {hin{t)) Noumoute r i et l 'esclave (féminine) {}f,mt) Boup(\v)j-moutkhaân, avec < I I , 5 > leurs en fan t s (^*') {hn'^ my.w msw), pour s [on ] t i e rs {r [p3y.]é 1/3) ;
2. — les deux t ie rs qui rev iendront à lui-même, ma i s qu'i l va léguer à cet te même épouse :
e t j e l 'a i augmenté au moyen de l 'esclave Sape te rd jéhou ty (ÎM'.Î dwn.ét m km 8.) et de l'esclave(?im) < 1 I , (>> Gemimen-paâsh[ene f , ces] deux [ se rv i ] teurs (masculins) qui sont en ma possession {^^) {[p3y b3]ki 2 nty m-dl.l), et qui r eprésen ten t (ma) p a r t (m dnlt) (^") dans t ou t ce que j ' a i f a i t [comme acquis i t ion ( ' ) ] ( '̂̂ ) con jo in tement avec elle (m psy.l [...] Iry.l nb irni.ét), < I I , 7 >
d e s 9 e s c l a v e s dont il l eur a cédé l a posses s ion , e t a u s s i ce l l e d 'une m a i s o n qui d o i t ê t r e u n propre à lui . Cf . I I I , 8 : « I l s on t répondu d 'une s e u l e v o i x : ' n o t r e père a d i t la vér i té ; i l s (ces b i ens : l e s 9 e s c l a v e s e t la m a i s o n ) s o n t v r a i m e n t en no tre p o s s e s s i o n ' ».
(289) Ces « e n f a n t s » d e s e s c l a v e s sont a u s s i m e n t i o n n é s eu I I I , 1, e t c h a q u e f o l s ce n 'es t p a s l e t e r m e hrdw ( enfants , à proprement par ler ) m a i s msw ( = c e u x qui sont nés) qui e s t ut i l i sé .
(290) « P o s s e s s i o n », d ' a u t a n t p lus qu'il n e s 'ag i t encore que d 'une p a r t i n d i v i s e d e s a c q u ê t s de c o m m u n a u t é .
(291) U n des s e n s p r é v u s par l e Wôrtcrbnch pour ânit e s t « part qui r e v i e n t à », m a i s a t t e s t é u n i q u e m e n t par des d o c u m e n t s h i é r o g l y p h i q u e s d e la t o u t e b a s s e é p o q u e ; en réa l i t é ce s e n s conv ien t p a r f a i t e m e n t ici , e t en II , 9 : « j e s u i s v e n u .. . pour f a i r e conna î t re sa part à c h a c u n d e m e s e n f a n t s » ; et e n c o r e d a n s le Papyrus des Adoptions, l i gne 7, a v e c u n e l é g è r e n u a n c e s u p p l é m e n t a i r e (que l'on pourra i t d 'a i l l eurs app l iquer a u l'ap. Turin 2021) : « par t qui r e v i e n t théor iquement (ou l é g a l e m e n t ) à », s a u f d i spos i t i o n contra ire . J u s t e m e n t , d a n s le Papyrus des Adoptions, l a d i spos i t i on d u m a r i i n s t i t u a n t sa f e m m e sa l é g a t a i r e u n i v e r s e l l e e n t r a v e c o m p l è t e m e n t l a t r a n s m i s s i o n de s e s b i e n s à s e s c o l l a t é r a u x (qui a u r a i e n t d û ê tre s e s h é r i t i e r s l ég i t imes , vu qu'il n 'ava i t pas d ' e n f a n t ) . I l s ' e x p r i m e à ce propos e n ce s t e r m e s : « (Quant à ce lui ) de m e s f r è r e s e t sœurs , (qui lui f e r a i t ) opposi t ion, à m a m o r t ou u l t ér i eurement , en d i s a n t : ' R e m e t t e z -moi la p a r t (qui m e rev ient ) de mon f r è r e (rfni(i) « p^y.i àn), ... (qu'on le déboute ) ' » (RIDA, 1965, p. 83) .
(292) A l o r s que v r a i m e n t l e s e n s du p a s s a g e e s t acquis , i l a p p a r a î t on ne p e u t p l u s d i f f i c i l e d e combler la lacune . P u i s q u e la p h r a s e c o n c e r n e les acquêts , e t qu'il n e peut y ê tre ques t ion que d e s « a c q u ê t s », n o u s
192 A R I S T I D E T H Ê O D O R I D È S
(et cela) [ a p r è s ] qu'el le e u t ag i comme une flUe (^') [ pou r mo i ] ([ÎMJ] ir.ét m Sri(t) [n.i]), [ à ] l ' i n s t a r t r è s e x a c t e m e n t des e n f a n t s de m a p remiè re f emme {[ml] kd 113 lirdw n tiyX hmt h3w[ty{t)} ^ki sp snw), qui é t a i en t Çy.wnw) d a n s < I I , 8 > m a maison , s ans avo i r [négligé (? ) ] a u c u n dés i r [que] j ' a i e ( j amais ) f o r m é (ito iwpuiy.[ét ... (?)] w'^ mri Iry.l) ».
I I / Deuxième phase de la procédure :
LA DÉCLARATION DE DISPOSITION,
ou p rocédure d ' au then t i f i ca t ion de l a décision qui ava i t d é j à é té p r a t i q u e m e n t prise.
— « Auss i , suis-je venu {hr ptr tw.i lw.k(wi)),
a) devan t le Viz i r {m-isb tsty), < I I , 9 >
b) e t [ les] membres (« m a g i s t r a t s ») d u Consei l (de Médi-n e t Habou ) {^*) {[ns] srw n ts knbt),
a u r i o n s p e n s é a u t e r m e éhpno qu i o f f re c e s e n s . M a i s o u t r e qu' i l n ' e s t j a m a i s u t i l i s é d a n s l e p a p y r u s , i l s ' i n t é g r e r a i t m a l a u t e x t e p o u r c e qui e s t d e la c o n s t r u c t i o n . N o u s o b t i e n d r i o n s q u e l q u e c h o s e c o m m e c e c i : « . . . c e s e s c l a v e s q u e j ' a v a i s en m a p o s s e s s i o n , c o m m e p a r t m e r e v e n a n t , c ' e s t -à -d ire e n t a n t q u ' a c q u ê t s à m o i d a n s t o u t c e q u e j ' a i r é a l i s é a v e c e l l e ». Cf . s u r l e s éhprw : J. CERN^-T.E. PEET, d a n s J. Eg. Arch., X I I I (1927) , p. 3 3 ; J . ÔEKNt, d a n s Bull. Inst. Franç. d'Arch. Or., X X X V I I ( 1 9 3 7 ) , p . 4 7 ; A . GARDIIVER, d a n s J . Eg. Arch., X L I I ( 1 9 5 6 ) , p . 1 7 ; R . CAMI-
N o s , Late-Eyyptlan Miscellanics ( L o n d r e s , 1 9 5 4 ) , p p . 1 4 0 ; 4 0 3 ; A r . T H é O -
DORiDÈs, d a n s RIDA, 1964, p. 47. (293) L e d i s p o s a n t r e v i e n t s u r l ' a t t i t u d e d e s a s e c o n d e f e m m e c o m p a
r a b l e à c e l l e d e s e n f a n t s : on n e d i s c e r n e p a s s' i l f a u t n 'y v o i r q u ' u n e s i m p l e r é p é t i t i o n o u t r o u v e r d a n s c e t t e r é p é t i t i o n u n e j u s t i f i c a t i o n d e p l u s à l a l i b é r a l i t é d u m a r i : n o n s e u l e m e n t i l l u i c è d e l a p o s s e s s i o n d e s e s c l a v e s r e p r é s e n t a n t s a p a r t d e s a c q u ê t s à e l le , m a i s II l ' a c c r o î t {dwn : « é t e n d r e » ) d e s « d e u x t i e r s » r e v e n a n t fi l u i - m ê m e . A j o u t o n s q u e c e t t e a p p a r e n t e j u s t i f i c a t i o n , qu i e s t d é j à d o u b l e d a n s s o n e x p r e s s i o n , p r e n d r a b i e n t ô t a p p u i s u r d e u x lois d e P h a r a o n , c e l l e qu i p e r m e t à q u i c o n q u e d e f a i r e d e s e s b i e n s c e qu'i l d é s i r e ( II , 11 ) , e t c e l l e ( I I I , 4-5) qu i d i s p o s e qu ' i l y a l i e u d e r e m e t t r e à c h a q u e f e m m e s o n « s e f e r » ( = ?).
(294) N o u s a p p r e n o n s e n IV, 2 q u e la Içiiht e n q u e s t i o n e s t b i e n c e l l e d u T e m p l e f u n é r a i r e d e R a m s è s I I I , à M e d i n e t H a b o u . C e t t e knht e s t d i s t i n g u é e d e la « g r a n d e knbt d e l a V i l l e » , qu i e s t c e l l e d u V i z i r à T h è b e s . C o n m i e déji i s ignîUé, ce d o i t ê t r e o c c a s i o n n e l l e m e n t q u e l e V i z i r p r é s i d e la Içnht d u T e m p l e . S u r l e s érto : Ar. TIIéODOKIDèS, RIDA, 1969, pp. 1 0 8 sqq.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 193
en ce j o u r {m p3 hrw), afin de f a i r e conna î t re , à chacun de mes e n f a n t s ( '̂̂ ) {rrdlt rh w'^ ni) ... m nsy.i hrdw) :
1/ sa p a r t O {dnit.f), <11,10>
2 / e t ce t te d ispos i t ion (psy éhr) que j e va i s p r e n d r e (^") [nty Iw.l ir(t).f) en f a v e u r (w) de la * c i t ad ine ' Anok-souned jem, ce t te f emme {t[3]y àt-limt) qui es t ( = qu i vit) d a n s [ m ] a [ma i so ]n en ce < I I , 11 > j o u r {nty m P3[y.l pr] m pi hrw),
ca r P h a r a o n a d i t ( '̂*) {lir dd Pr-'^i V.S.F.) QUE CHACUN FASSE CE QU'IL D é S I R E DE SES BIENS (^'') ( i m l Iry
s nh sM.f m ht.f).
(295) L e s e n f a n t s ont donc é té convoqués à cet te fin d e v a n t l a IftiM que prés ide le Vizir en personne. Seu l s l e s a înés t o u t e f o i s son t p r é s e n t s ; il e s t imposs ib le de d ire s ' i l s « représentent » tous l es enfants , ou, p lus vra i semblablement , s ' i ls son t s eu l s à avoir a t t e i n t la m a j o r i t é l é g a l e (?) , concernant laque l le n o u s ne s a v o n s rien de précis.
(29C) Chacun aura la m ê m e part. A u t r e m e n t d i t : i l s v iendront , d 'après la dévo lu t ion l éga le du patr imoine , à é g a l i t é à l 'héritage, é t a n t e n t e n d u que la m a s s e g loba le de ce t h é r i t a g e devra ê tre d i m i n u é e du l e g s des t iné à la s econde é p o u s e du disposant . N o t o n s que c'est dnit, « par t qui rev ient théor iquement à » qui e s t employé e t n o n pë ou psà, « par tage », « p a r t », car ce t e r m e e x p r i m e le ré su l ta t de l 'opérat ion e f fec t ive d u p a r t a g e (voir : I I I , 8 ) . Cf. l e s notes 278 et 291.
(297) L'emploi du f u t u r es t t rè s impor tant à relever. I l conf irme qu'il y a v a i t déjà eu une cess ion d a n s l es f a i t s qui va ê t re ici au thent i f i ée e t l é g a l i s é e : l e d i sposant l ègue ici s e s droits s u r l e s choses dont 11 a v a i t dé jà cédé la posses s ion à sa f e m m e . Il n 'es t p a s poss ib le de savoir , mal heureusement , s i la c-ession en quest ion a v a i t e x i g é que lque f o r m a l i t é ; r ien ne n o u s l ' indique. I l y a tout de m ê m e un déta i l à s igna ler : si la posses s ion résu l te d 'une s imple cess ion de fa i t , s a n s f o n d e m e n t jur id ique , pourquoi le Viz ir s 'enquiert- i l de la réa l i t é de ce f a i t : « Est -ce vra i c e qu'il ( = vo tre père) a déc laré concernant ces 9 servi teurs , à s a v o i r qu'i l v o u s l e s a (déjà) r emis .. . ? ». I l convena i t peut-être d e protéger cet te posses s ion dont l e s t a t u t deva i t ê tre défini, en a t t e n d a n t qu'el le d e v î n t propriété, lorsque l e s c l a u s e s t e s t a m e n t a i r e s s era i en t exécutées . N o u s n o u s sommes , déjà , antér ieurement , posé la quest ion d a n s ces t ermes {J. Eg. Arch., L I V (1968), p. 1.54).
(298) Cf. Ar. THéODORIDèS, A propos de la loi dans VÉgypte pharaonique, (RIDA, 1967), p. 139.
(299) L a m ê m e loi réappara î t p lus lo in d a n s la bouche des e n f a n t s qui en rapi)e l lent la s u b s t a n c e s a n s préc iser que c'est un « dit » ( = un ordre) de P h a r a o n : « S e s b iens lu i appart iennent , qu'il l e s donne à qui 11 v e u t » ( I I I , 10-11).
13
194 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
A / Biens dont le père dispose. Il s'agit de sa part des acquêts de la communauté faite avec sa seconde femme, de sorte qu'il lui abandonne la totalité desdits acquêts :
— « J e lègue (3°*') [twA dit) < I I , 1 2 > ce j o u r {m p3 hlrw]), à la ' c i tadine ' Anoksounedjem, la femme qui es t ( = qui vit) dans ma maison (ts st-hmt nty m p}yX pr), t ou t (^^) ce que j ' a i acquis con jo in tement avec elle (p[3] Iry.X nb Irm ...), e t qui consiste en < I I I , 1 > deux servit e u r s hommes {m p3 bskl 2 '^hswtytv) et deux serv i teurs femmes {b3k(t) 2 Jimwt), (soit) au t o t a l : q u a t r e (serviteurs ) , avec leurs e n f a n t s {dmd ^ Im'^ mâw.w), ce qui (dans nos acquêts de communauté) représente (mes) deux t i e r s a j o u t é s à son t ie rs (iM' p3 2/S hi,r p3y.ét 1/3) ;
B / Biens que le père transmet à ses enfants : — et je < I I I , 2 > t r a n s m e t s à mes e n f a n t s (̂ ''̂ ) {mtw.l
dit ... n n3y.\ hrdw) :
(300) A p r è s a v o i r annoncé qu'il a l l a i t f a i r e c o n n a î t r e l a p a r t d e c h a q u e e n f a n t e t la d i spos i t i on qu'il a l l a i t prendre en f a v e u r d e sa s e c o n d e f e m m e , il f a i t la déc lara t ion d e d i spos i t i on e n a d o p t a n t l 'ordre i n v e r s e : « J e l è g u e à m a f e m m e . . . ; j e t r a n s m e t s à m e s e n f a n t s » (II , 11 e t I I I , 1-2) . Cet ordre-ci e s t logique, p u i s q u e pour é tab l i r l a m a s s e r e s t a n t à part a g e r e n t r e l e s en fant s , il f a u d r a c o m m e n c e r p a r c o n n a î t r e l e m o n t a n t d u l e g s ; a u surj^lus, ce l e g s sera u n e a p p l i c a t i o n d e la loi qui v i e n t d'être c i tée .
(301) « J e lègue ... j e transmets^ : u n m ê m e m o t rend en é g y p t i e n c e s not ions , à s a v o i r rd\, « donner » (avec n o m b r e d e n u a n c e s qui lu i sont a t t a c h é e s ) . I l en ré su l t e qu'en d i s a n t en é g y p t i e n : « j e rdi ' t o u s ' l e s a c q u ê t s h mon é p o u s e », on ne c o m m e t p a s d'erreur, p u i s q u e ce rd'\ i n c l u t d e n o m b r e u x sens, ce qui n'est p a s vra i en f r a n ç a i s , vu que d a n s la réa l i t é j u r i d i q u e « l é g u e r » n e s 'appl ique qu'aux d e u x t i e r s d e s a c q u ê t s d u mari , l ' autre t i e r s d e v a n t r e v e n i r de dro i t à l ' épouse ou s e s a y a n t s cause . Auss i , l e l e g s ne porte-t- i l donc que sur l e s « d e u x t i er s ».
(302) I l s 'ag i t de la t o ta l i t é d e s b i ens c o n s t i t u a n t la s e c o n d e commun a u t é m e n t i o n n é e en II , 6, m a i s dont il n 'es t p a s rappe lé ic i qu' i l s sont déjii en la p o s s e s s i o n de l ' épouse (II , 4-5) . Ce t t e s i t u a t i o n d e f a i t n'a a p p a r e m m e n t a u c u n e répercuss ion sur la d i spos i t i on i)rise ici, qui a s s u r e r a a u m o m e n t de son e x é c u t i o n la t r a n s l a t i o n dé f in i t ive d e s b iens .
(303) D a n s l e t ex te , l e dat i f d 'a t tr ibut ion (n njy.l hrdw) se t r o u v e n o r m a l e m e n t p l a c é en fin d e propos i t ion .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 196
1) ces 9 servi teurs {psy 9 bskl) qui me sont échus ( ^ ) en t a n t que mes deux t ie rs d 'avec la ' citadine ' T a t c h a r a ï a ( = m a première femme, l eu r mère) (Ihsy r.l m psy.l 2/3 \rm ...) ; < I I I , 3 >
2) a ins i que ( ^ ) la maison de (mon) père de mère {hn'^ p3 pr \t mwt),
(le tou t ) ( ^ ) dé jà (^') en leur possession {w-di.w m
3) I l s n ' [ i g n o ] r e n t {hn st [hr lim[t] (.«")]) r ien de t ou t ce que j ' a i acheté con jo in tement avec
(304) « Qui m e sont é c h u s (en par tage ) », su i t e donc a u par tage e f fec tué a u m o m e n t de la d i s so lut ion du premier mariage . Voir l 'emploi du t e r m e « p a r t a g e » (p.?) d a n s l e p a s s a g e e x a c t e m e n t para l l è l e de I I I , 7-8.
(305) Pourquoi f a i r e l ' énumérat ion 1-2-3, a u l i eu de déc larer : « tous m e s biens, déduct ion f a i t e du legs » ? C'est qu'il y a d e u x ca tégor ie s d e b i ens env i sagés , a v e c u n e subdiv i s ion au se in de la première en fonc t ion de l 'or ig ine des biens, l e § 2 représentant un propre du mari . La première ca tégor i e (§ 1 et 2) es t ce l le des b iens déjà en la possess ion des e n f a n t s ; ceux-c i le r econna i s sen t exp l i c i t ement en I I I , 8. L 'autre ca tégor i e (§ 3) e s t ce l le des b i ens acqu i s pendant la première assoc ia t ion conjugale . L e père a é v i d e m m e n t à sa d ispos i t ion sa propre part de sd i t s acquê t s ; n o u s a v o n s en outre dédui t de II , 1-2, qu'il deva i t avo ir la jouissance, en t a n t que conjo in t surv ivant , du « t i ers » de sa f emme, auquel il n'a p a s l e droi t de toucher ; d'où, c o m m e présumé plus haut , la d i f f érenc ia t ion qu'i l é tabl i t , a u m o m e n t de son remariage , entre ce t i ers e t l e s d e u x t i e r s s i e n s (II , 1-2).
(300) N o u s a v o n s complété la propos i t ion en y a j o u t a n t « ( le tout) » afin (]u'il n'y a i t p a s d 'ambiguïté . P o u r le fond, nous sonmies inv i t é à l e f a i r e d 'après III , 7-8 ; et pour la f o r m e on peut se demander si la tournure es t v r a i m e n t e l l ipt ique, ou s'il y a eu un oubli i m p u t a b l e à une dist rac t ion du scribe. On pourra i t sous -entendre d'après I I I , 8 : àt m-dl.w, « i l s ( = c e s b iens) sont en leur posses s ion » (cf. J. CERN*, Late Ramessidc Lrtters, 15, 7 : st m-rfi.î), ou, ce qui s era i t peut-être p r é f é r a b l e ici : « ( te l s e t te l s b iens) qui sont en leur possess ion (ntj/ m-di.w) » ; (cf. Pap. Sait IZ.'t, I, 4, 4 : ntp m-dl.k) ; m a i s auss i s a n s nty, d a n s Vérité-Mensonge, V I I I , 6 : « D e (ces) b œ u f s complè tement en ta posses s ion ( = ici « à ta dispos i t ion ») {m (n}y î ) \hw m-dlk dr.w sp 2), procure-toi ce lu i que tu dés i res ».
(307) Sur m ry'^, avec le s ens de « déjà » ou « é g a l e m e n t », voir Ar. TiiÉODORiDics, d a n s J. Eg. Arch., LIV (1968), p. 154, n. 4.
(308) Voir RIDA, 1969, p. 155, n. 195.
196 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
leur mère {^) ( = ma première femme) (p3 'm.(l) nb Irm tsy.w mict) ; < I I I , 4 > .
C / Nouvelle justification du legs : — « E t je leur a u r a i s t r a n s m i s (Iw wn iw.l dit n.w)
quelque chose de ce que j ' a i acheté con jo in tement avec la ' c i tad ine ' Anoksounedjem ( = ma seconde femme) [m ps hi.l irm ...),
mais P h a r a o n a prescr i t ("^) (Ijr Pr-^s V.8.F. dd) de D O N N E K À C H A Q U E < i n , 5 > F E M M E S O N ' S E F B R ' ( ' ' ^ )
(Iml sjr n st «6(*) n.ét) ».
(309) I l s s a v e n t pax-faitenient ce qui va l eur r e v e n i r d e ce côté : l e t i e r s d e l e u r mère , d e m e u r é en la j o u i s s a n c e d u père, e t l e s d e u x t i e r s d e ce dernier .
(310) E n dé f in i t i ve il m a n q u e r a a u x e n f a n t s l e s d e u x t i er s d e l a s e c o n d e c o m m u n a u t é . On n e par l e p a s du t i ers de la s econde f e m m e , c a r il p a s s e r a d'oft'ice II s e s a y a n t s droit , qui seront s e s c o l l a t é r a u x à d é f a u t d ' en fant s . C'es t u n f a i t qu'i l n'y a p a s d ' e n f a n t s d e la s e c o n d e u n i o n d ' I m e n k h â o u , s i n o n i l n 'aura i t p a s d e c o m p t e à rendre a u x e n f a n t s d e la p r e m i è r e u n i o n à propos de ces acquêts .
(311) « Que lque c h o s e » = c o n f o r m é m e n t à la t r a d u c t i o n d e s éd i teurs . O n p o u r r a i t peut -ê tre comprendre a u s s i : « (ma part ) d a n s ce que j 'a i a c h e t é », puisqu' i l n e jjourrait s 'ag ir que d e s e s 2 / 3 à lu i !
(312) Ce t t e lo i e s t c i t é e pour jus t i f i er q u e l e s a c q u ê t s d e l a s e c o n d e c o m m u n a u t é n e sont p a s l a i s s é s a u x e n f a n t s . C o m m e le p è r e l è g u e à s a s e c o n d e f e m m e l e s 2 / 3 d e s a c q u ê t s d e la c o m m u n a u t é f a i t e a v e c el le, i l e n r é s u l t e q u e c e s a c q u ê t s sera ient , s inon, r e v e n u s a u x e n f a n t s d u p r e m i e r l it . E n v e r t u d 'une loi dont n o u s a v o n s supposé l ' e x i s t e n c e (voir la n. 268) , e n c a s de r e m a r i a g e s a n s e n f a n t s , l e s a c q u ê t s r é a l i s é s p e n d a n t la seconde a s s o c i a t i o n c o n j u g a l e r e v e n a i e n t a u x e n f a n t s d u premier m a r i a g e . L a loi d u « s e f e r » d e v a i t a v o i r pour e f fe t d e n e u t r a l i s e r c e t t e a u t r e loi.
(313) Le t e n n e « s e f e r » e s t u n h a p a x ! On t r o u v e r a la b ib l iograph ie l e c o n c e r n a n t d a n s PESTMAN, Marriuge and Matrimonial Property (Leyde , 1961) , pp. Iô3, n. 8 ; cf . p. 107, n. 6, e t l e dern ier c o m m e n t a i r e à son s u j e t d a n s Ar. THéODORIDèS, Le Testament d'Imenlhâou, d a n s J. Eg. Arch., L I V (1968) , pp. 151-152. L e « s e f e r » n 'est s û r e m e n t p a s u n e dot, contra irem e n t à ce qui a g é n é r a l e m e n t é té a f f i r m é ou supi iosé ; t o u t e f o i s la s e u l e c h o s e p o s i t i v e qu'on p u i s s e dire, e s t qu'on d é s i g n e par là u n p r i v i l è g e f é m i n i n . N o u s ignorons pour l e reste , e n quoi e x a c t e m e n t il c o n s i s t a i t ou d e v a i t cons i s ter , e t c o m m e n t il f a l l a i t l e réal i ser , car l e m o y e n adopté d a n s no tre p a p y r u s n'a été qu'occas ionnel , v u que l e s e n f a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e u r père p o u v a i t donner ses b i ens à qui il voulait. I l n ' e x i s t a i t donc
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 197
I I I / Troisième phase de la procédure :
DIALOGUE en t r e l ' au to r i t é et les e n f a n t s défavorablem e n t touchés p a r la disx)osition, la légata i re n ' interven a n t pas.
Ce qu'a d i t le Vizir {ddt.n tsty) au prêtre-« ouâb » et chef des por t i e r s (dans le Temple) {hry kiwtyw) Âhaout inefer , a ins i qu 'au prêtre-« ouâb » Nebnefer , les e n f a n t s < I I I , 6 > du « père divin » Imenkhâou , qui é ta ien t debout devant lui [nty V{w) m hsh.f), (et qui é ta ient) les f r è r e s a înés (^''') de ses e n f a n t s («3 snw ^iw nîy.f hrdw),
a) concernant les Mens dont leur père n'a pas disposé, mais dont il a déclaré avoir remis la possession à ses enfants (son apport à la communauté et un sien bien propre (une maison)) :
— « Qu'avez-vous à d i re de l 'exposé qu 'a f a i t (l/i hr.tn tî
\vAs d e r é s e r v e f é m i n i n e sur l e s b i ens d e la c o m m u n a u t é c o n j u g a l e : « s i l e s d l t s a c q u ê t s d e v a i e n t d e v e n i r l éga lement , e t en leur to ta l i té , l a propr ié té de l 'épouse, l e m a r i n 'aura i t pas dû d r e s s e r d 'acte à c e t t e fin, c o m m e le présent p a p y r u s n o u s a t t e s t e qu'il le f a i t , e n p r e n a n t so in d e c o m m e n c e r par i n v o q u e r u n e loi d 'ordre généra l (' que c l iacun f a s s e ce qu'il d é s i r e de s e s b i ens ') ; de surcroît , i l t i e n t à just i f ier , c o m m e il n o u s a p p a r a î t q u e c 'é ta i t n é c e s s a i r e pour t o u t a c t e de l ibéral i té , l ' u s a g e qu'i l f a i t d e c e t t e lo i e n qua l i f i an t l a c o n d u i t e d e sa f e m m e : ' e l l e a é t é bonne pour moi '. ' s e f e r ' e s t donc que lque c h o s e à quoi la f e m m e a théoriq u e m e n t droit , m a i s p a s automat i ( iuement , . . . » (J. Eg. Arrh., TAY, pp. 151-l . j2 ) . R e m a r q u o n s a u s u r p l u s que s'il e s t prescr i t de remet t re u n « s e f e r » a u x f e m m e s , c 'est bien des f e m m e s en g é n é r a l (st nit), e t non d e s é p o u s e s qu'il e s t ques t ion , e t il n 'es t p a s d i t qu' i l a p p a r t i e n t s p é c i a l e m e n t a u x é p o u x d'y ve i l ler . C o m m e le m o t est, en égypt ien , d é t e r m i n é par l e s i g n e g é n é r i q u e de la p lante , n o u s n o u s s o m m e s d e n m n d é s'i l n e f a l l a i t p a s y vo ir u n e r e c o m m a n d a t i o n d 'assurer la s u b s i s t a n c e d e s f enmies . T o u t e s n ' a v a i e n t a s s u r é m e n t p a s beso in d'être a idées , c 'est ce qui e x p l i q u e r a i t q u ' I m e n k h a o u n 'a i t pr i s a u c u n e d i spos i t i on de c e t t e n a t u r e en f a v e u r d e sa p r e m i è r e f e m m e .
(314) L e s d e u x a î n é s « représentent » ( ?) donc d e v a n t le Conse i l prés idé par le V iz i r t o u s l e s e n f a n t s du d i sposant . N o u s ignorons combien il y a v a i t d ' enfant s , e t il n ' importe pu i sque c'est u n ac te d e d é v o l u t i o n qui e s t ici dre s sé ; l 'hér i tage sera é g a l e m e n t p a r t a g é en tre les e n f a n t s , quel que soi t l eur nombre .
198 A R I S T I D E T H É O D O K I D È S
mdt l.dd) le ' père divin ' < I I I , 7 > Imenkhâou , votre père {psy.tn It) ?
— « Est-ce vra i ce qu' i l a déclaré concernan t ces neuf serv i teurs {n (= In) ms'^t m j^iy 9 h}k\w), (à savoir) qu ' i l vous les a (déjà) remis ( '̂̂ ) en t a n t que ses deux t i e r s p rovenan t du pa r t age d'avec < 1 I I , 8 > votre m è [ r e ] {i.dd.f : dl.l ét n.tn m psy.l 2/3 i.pS.[l] irm tây.tn mlwt]), ains i que la maison de (son) père de mère ([/ijw"^ p3 pr \t mtvt) ? ».
I l s on t répondu d 'une seule voix (dd.w m rs W^) :
— « Not re père a d i t la vér i té {mi^ty psy.n \t) ! I l s ( = ces biens) sont v ra iment en no t r e possession {ét m-d\.n n miH) ».
Ce qu 'a d i t < I I I , 9 > le Vizir [ddt.n t3ty),
b) concernant les Mens dont le père a disposé [à savoir sa part des acquêts de la seconde communauté), en faveur de sa seconde femme :
(315) Le Viz ir s 'a t tac l ie d 'emblée à l a q u e s t i o n d e s b i e n s dont la poss e s s i o n a d é j à é t é c é d é e par le père a u x e n f a n t s , c o m m e si e l l e é t a i t u n e c o n d i t i o n de la v a l i d i t é du l e g s m e n t i o n n é en premier l i eu d a n s la déc lar a t i o n de d i s p os i t i on ( « j e l è g u e . . . » : II , 1 1 ; I I I , 1 ) . A m o i n s que ce n e f û t u n e d e s cond i t ions de son remar iage . C'est qu'en effet , c o m m e n o u s l ' avons f a i t observer d a n s l ' in troduct ion à l ' a n a l y s e du présent document , e t c o m m e n o u s s erons a m e n é à l e f a i r e encore à propos de I I I , 12-13, i l ne s 'ag i t p a s ici d'acquêts , m a i s d e l 'apport du p è r e à la commun a u t é conjuga le . I l n'y a u r a i t en ce la r ien d 'anormal s'il n ' é ta i t préc i sé c h a q u e f o i s ( I I I , 2 ; I I I , 7) que l e s neuf e s c l a v e s a v a i e n t serv i à f o r m e r l a c o m m u n a u t é a v e c la première f e m m e , e t i m p l i c i t e m e n t a u s s i la s e c o n d e c o m m u n a u t é . Que serai t - i l donc a d v e n u s'il y a v a i t eu d e s e n f a n t s du second l i t ? 11 a v a i t s a n s doute é t é c o n v e n u au po int de dépar t q u e coûte que coûte ces « d e u x t i er s » du père r e v i e n d r a i e n t a u x e n f a n t s qu'il a v a i t e u s d e la p r e m i è r e f e m m e . C'est pourquo i l e Viz ir c o m m e n c e r a i t par s 'en enquér i r t r è s n e t t e m e n t ; on en d é g a g e d 'autre part que la posses s ion , c o m m e dé jà s ignalé , d e v a i t avo ir un s t a t u t jur id ique .
(316) « D é j à r e m i s » : c 'est u n i q u e m e n t l e c o n t e x t e qui n o u s i n v i t e à t r a d u i r e le verbe (r)di d e c e t t e manière . A p r è s u n verbe déc lara t i f , en néo-égypt ien , ce {r)dl pourra i t ê t re a u s s i b ien u n prosi>ectlf qu'un per-f e c t i f .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 199
— « [Qu'avez-vous à d i re de] cet te disposi t ion qu 'a pr i se votre père en faveur de la ' c i tad ine ' Anoksouned jem ([i^ hr.tn] psy shr l.ir psy.tn \t n ...), ce t te (seconde) femme à lui (t3y hbs{t) swt) ? ».
< I I I , 1 0 > I l s ont répondu :
— « [Nous avons en tendu ce qu ' a ] f a i t no t re père ( [édm.n ( f ) ps] iry piy.n U).
« Q u a n t à ce qu'i l a f a i t (ir ps Iry.f), qui p o u r r a i t le lu i contes ter ( irr nym [r]h mdt im.f) ?
« Ses biens lui appa r t i ennen t {hot ht.f) ; < I I I , 1 1 > qu' i l les donne [à qu i ] il [veut] (uni di.f sw [n rwr]./) ».
Ce qu 'a d i t le Vizir {ddt.n tsty) :
—• « Si ce n ' é t a i t pas du t ou t son épouse ( '̂*) (\r Iw in hmt éwt in), ma i s une (concubine) syr ienne ou nubienne (" ' ) , qu ' i l eû t aimée (IM' hsrw nhéy(t), Iw mr.f éw), e t à qui il donnera i t < I I I , 1 2 > ses biens (̂ '̂') ([i]w.f dit n.s
(317) A p r è s la q u e s t i o n de f a i t (« Votre père v o u s a-t-i l r e m i s c e s b i ens » ?), l e V i z i r p a s s e à la ques t ion d e dro i t : « Qu'avez -vous à d ire d e c e t t e d i spos i t i on qu'i l a pr i se en f a v e u r de sa seconde f e m m e ? ». L e po int i m p o r t a n t e s t l e s u i v a n t : b ien que l e s e n f a n t s a i e n t é t é présents , la d i spos i t i on a é t é pr i se sans eux, m a i s i l s ont le dro i t d'en appréc ier la légalité, et c 'es t en ce la que rés ide leur rôle d a n s la p r o c ^ u r e . I l s ne p a r t i c i p e n t donc pas, en t o u t e r igueur, à l 'acte de d i spos i t ion c o m m e tel ; « c o n t e s t e r » d e la p a r t des e n f a n t s s ign i f i era i t par conséquent sou lever une i r r é g u l a r i t é l éga le .
(318) L e ^'izir reprend la paro le en renchér i s sant , ce qui l a i s s e e n t e n d r e q u e l e s e n f a n t s s 'en p r e n a i e n t à l eur be l le -mère et que le m a g i s t r a t l ' a v a i t perçu. O f f i c i e l l e m e n t il l ' ignore, e t s o u s l 'angle du droit , il g é n é r a l i s e la q u e s t i o n en a d m e t t a n t que m ê m e u n e concubine e û t pu d e v e n i r la l égat a i r e d u père.
(319) S y r i e n n e ou n u b i e n n e : or ig ina ire du nord ou du sud, c 'est -à-dire de n ' importe quel po int de l ' empire égypt i en .
(320) C o m m e n o u s l ' avons d i scu té d a n s RIDA, 10C9, p. 157, ht (« b i e n s » e n g é n é r a l ) peut s e rapporter à u n e part d 'acquêts d a n s la c o m m u n a u t é , puisqu' i l e s t ici s y n o n y m e de « ce qu'il a a c q u i s en s a c o m p a g n i e » ( I I I , 12) , e t p a r t a n t de « m e s d e u x t i e r s » ( I I I , 13) (Cf. RIDA, 1965, p. 1 0 1 ; 1966, p. 40 ; 1967, p. 124) . D a n s l e « T e s t a m e n t de N a u n a k h t e », ht e s t a u s s i u t i l i s é pour d é s i g n e r l e s « b iens (propres) » (RIDA, 1966, p. 41, n. 42) .
200 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
ht.f), [qui] p o u r r a i t annu le r ('^') {[nym l ] . I r . / ( ' ^ ) wé}), ce qu ' i l f e r a i t {p3 Iry.f) ?
« Qu ' [ i l lègue ('̂ ^) (donc) à l a ] c i tad ine Anoksounedjem [les] 4 servi teurs ('^'') ([ îmi dl.f n.é ps] 4 hskw), qu ' [ i l a acquis] ('̂ ^) ( l [ l r . / ] ) conjo in tement avec elle {irm A.), < I I I , 1 3 > e t ce qu ' [ i l acquer ra (encore)] (̂ ^̂ ) conjointe-
(321) « A n n u l e r » pour a v o i r c o n t r e v e n u à d e s d i s p o s i t i o n s l éga le s . N o u s t o u c h o n s a i n s i l e second aspec t d e s oppos i t i ons p o s s i b l e s à la d é c i s i o n p a t e r n e l l e : a) l e s e n f a n t s en c o n t e s t e r a i e n t l e f o n d e m e n t l éga l ; b) i l a p p a r t i e n d r a i t a u x a u t o r i t é s d'annuler l ' ac te e n t a c h é d ' i rrégular i té .
(322) J. CERN* a jus t i f i é d a n s B. Inst. Fr. Arch. Or., X X X V I I (1937), p. 45, la r e s t i tu t ion qui a toute la v r a i s e m b l a n c e pour el le, m a i s la quest ion posée par CERN* lu i -même e s t d e m e u r é e s a n s réponse pour ce qui c o n c e r n e la c o n s t r u c t i o n g r a m m a t i c a l e : pourquoi nym lArf, a l o r s qu'en I I I , 10 on l i t \rr nym ? (J. Eg. Arch., X I I I (1927), pp. 35-36) .
(323) C o m m e p lus haut , rd\ (ce verbe e s t b i en d a n s l a l acune , m a i s il n'y a v r a i m e n t p a s m o y e n d e re s t i tuer a u t r e m e n t l e t e x t e ) i n c l u t l e s d e u x s e n s d e : r e m e t t r e à l ' épouse ce qui lui rev ient l é g a l e m e n t en f a i t d 'acquêts e t lu i l é g u e r le s u r p l u s ( les d e u x t i er s du m a r i ) .
(324) I l a é té préc i s é d a n s le t e x t e m ê m e (II , 12 ; I I I , 1) q u e ce s « q u a t r e s e r v i t e u r s » c o m p r e n n e n t d e u x e s c l a v e s - f e m m e s qui i n c a r n e n t l e t i e r s d e s a c q u ê t s d e l ' épouse e t d e u x e s c l a v e s - h o m m e s v a l a n t l e double .
(325) D a n s ce qu'il a acqu i s e t ce qu'il a c q u e r r a (encore) . L e verbe e s t c h a q u e f o i s d a n s la lacune , m a i s l e c o n t e x t e n o u s g a r a n t i t q u e n o u s pouv o n s accepter s a n s la m o i n d r e h é s i t a t i o n l e s r e s t i t u t i o n s p r o p o s é e s (v. l a n. 305 ; cf . pour \ry.f la n. 326) , à c e t t e r e m a r q u e près que, c o m m e le p r o u v e n o t r e d o c u m e n t (v. la n. 280) , \n\, « acquér ir à t i t re o n é r e u x (dans la comm u n a u t é ) », pourra i t ê t r e u t i l i s é a u s s i b ien que irl, « fa ire , réaliser (dans l a c o m m u n a u t é ) ».
(326) N o u s abordons ici l e po int cruc ia l de l ' a r g u m e n t a t i o n . Ce pass a g e e s t déc i s i f pour renforcer l 'hypothèse que n o u s d é f e n d o n s d 'avoir a f f a i r e à des disi>osit ions t e s t a m e n t a i r e s . I l re s sor t de t o u t ceci , m ê m e si c e n 'est p a s d i t exp l i c i t ement , que l e s d i s p o s i t i o n s produiront l e u r s e f f e t s à la m o r t du père. Vo ir des f o r m u l e s p lus c la i re s d a n s le t e s t a m e n t d e Sénimosé « a p r è s l a v i e i l l e s se ( = à la mort ) d e m a f e m m e » (Urk., IV, 1067, 9) , ou d a n s la p r e m i è r e sec t ion du Papyrus des Adoptions : « . . . à m a mort , (ou) u l t é r i e u r e m e n t » (RIDA, 1965, p. 83) . M a i s pour en reven ir à n o t r e pas sage , l e po int é p i n e u x es t l e s u i v a n t : il n'y a p a s d 'obs tac le à ce q u e l e s acquê t s d é j à réa l i s é s e t dont la p o s s e s s i o n a é t é cédée à l ' épouse p u i s s e n t encore croître . Or, s'il y a e u des acquêts , ce f u t a u m o y e n d e l 'avo ir c o n j u g a l dont l e père a v a i t (et c o n t i n u e à a v o i r t h é o r i q u e m e n t ) l ' admin i s t ra t ion . T o u t e f o i s , pour ce qui le concerne, cet a v o i r c o n j u g a l e s t c o n s t i t u é d e s « neuf e s c l a v e s » qui a v a i e n t dé jà s e r v i à f o r m e r l a p r e m i è r e
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 2 0 1
m e n t avec elle (hn" ps [Iry.f] Irm.st), e t d o n t il a déc la ré (Idd.f) :
— « J e lui lègue {tw.l dit n.st) mes deux t i e r s (de nos acquê t s de communau té ) [en supplém e n t de] s [ o n ] t i e r s {psy.l 2/3 [hr p3]y.êt 1/3), e t a u c u n fils e t aucune fille < I V , 1 > ne con tes te ra (̂ *̂) ce t te d ispos i t ion que j ' a i p r i se en sa f a v e u r (hv hn irl srl ... mdt m psy éhr l.lr.l n.st), ce j o u r {m pi hrw) ».
I V / Quatrième phase de la procédure.
LES FORMALITÉS FINALES.
a) l a sanc t ion vizirale.
Ce qu ' a d i t le Viz i r {dd{t.n) t3ty) :
— « Qu' i l soi t f a i t selon la ('^') déc la ra t ion du ' pè re
c o m m u n a u t é ( I I I , 2 ; I I I , 7) , e t c e s neuf e sc laves , l e i)ère e n a a b a n d o n n é l a p o s s e s s i o n à s e s e n f a n t s , ce qui r e v i e n t à d i re qu' i l s e n ont la jouis s a n c e en bénéf ic iant du produ i t d u t r a v a i l de ce s e sc laves . M a i s c o m m e n t d è s l o r s l e s a c q u ê t s de la seconde c o m m u n a u t é pourra ient - i l s e n c o r e croît r e ? C o m m e 11 n'est j a m a i s q u e s t i o n du t i er s a p i w r t é par la f e m m e à c e t t e c o m m u n a u t é , il r e s t e que c 'est d e ce t i e r s que le père a t o u j o u r s la ges t ion .
(327) L e Viz ir reprend l a déc lara t ion d u d i s p o s a n t m a i s p a s t ex tue l l e ment . On peut d ire qu'i l l ' in terprète en y a p p o r t a n t p l u s de r igueur d a n s l ' expres s ion j u r i d i q u e : a) l e s t e rmes dont s 'est serv i le père « j e l è g u e tous l e s a c q u ê t s d e n o t r e c o m m u n a u t é à ce t te f e n n n e » d e v i e n n e n t : « j e lu i l ègue (ou j e lu i « d o n n e » : rd\) mes deux tiers a j o u t é s à son t i e r s ». On s a i t e f f e c t i v e m e n t que la d i spos i t i on n e porte que sur l e s « d e u x t i er s » d u mari , l e t i ers de la f e m m e d e v a n t l é g a l e m e n t lu i é cho ir lors d e la disso lu t ion d u m a r i a g e ; b) c o m m e la d i spos i t i on e s t a u t h e n t i q u e n i e n t prise , e l l e e s t l é g a l e m e n t ina t taquab le , e t i l va d e soi que l e s e n f a n t s n e pourront la « c o n t e s t e r » . Le i)ère l u i - m ê m e ne l ' ava i t p a s d i t (II , 11 - I I I , 1) , m a i s l e s e n f a n t s , i n t e r r o g é s par l e Vizir, l ' ava i en t b ien c o m p r i s a i n s i ( I I I , 10) .
(328) I l e s t p a t e n t q u e bn ... mdt m, qui se t r a d u i t l i t t é r a l e m e n t « il n e c o n t e s t e r a p a s » e s t à comprendre d a n s ce c o n t e x t e j u r i d i q u e « n 'aura p a s l e droit de c o n t e s t e r ». Cf. R. d'égyptol., X X I (1969), p. 86, n. 6.
(329) I l e s t s ign i f i ca t i f que, d e t o u t e la procédure suiv ie , ce qui c o m p t e c 'est a la d é c l a r a t i o n du i )ère-divin I m e n k h â o u ». C'est sa vo lonté é n o n c é e par s a p a r o l e qui f o n d e la d i spos i t ion prise . T o u t le re s te n'a c o n s t i t u é qu'un c o m p l é m e n t procédura l en vue d ' ins i s ter s u r la l é g a l i t é d e la dispo-
202 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
d i v i n ' Imenkhâou {Irw wXtt m p3 dd It-ntr ...), ce ' p è r e divin ' qui es t debout devant moi [psy it-ntr nty '^}f(w) m-6i/i,.i) ».
b) les fo rmal i t és de l ' enregis t rement .
< I V , 2 > E t le Vizir a donné l ' o rdre que voici au prêtre-« ouâb » P tahemheb {d\ tsty m hr n P.), le scribe archivis te {ss n dm'^) du Conseil du Temple de Eamsès I I I (n t3 knbt t3 hwt Ou-sermaâtrê-Mérylmen, r dd) :
— « Que cette disposi t ion que j ' a i sanct ionnée ('^) soit consignée (Im'i mn p3y shr l l r . i ) < I V , 3 > sur un rouleau de p a p y r u s ('^') ( = un registre) {fir "rit) n dm''), d a n s le Temple (m t3 hwt) de Eamsès I I I ( = de Médinet Habou)» .
c) la copie pour le Dépa r t emen t viziral (ou l 'Admin i s t r a t ion centrale) .
On en fit une copie ("^) [Iw.tw [hr) lr{t) m mitt) pour (n) le « G r a n d Conseil » (^") de Thèbes [knbt '^st niwt).
s i t i o n . C ' e s t b i e n a i n s i d ' a i l l e u r s q u e l u i - m ê m e a c o m p r i s l ' e s s e n c e d e c e t t e p r o c é d u r e : «je s u i s v e n u p o u r f a i r e c o n n a î t r e . . . c e t t e d i s p o s i t i o n q u e je v a i s p r e n d r e » ( I I , 8 -11) .
(330) L e V i z i r s e s e r t e x a c t e m e n t d e s m ê m e s t e r m e s q u e l e p è r e : !>-î shr « p r e n d r e u n e d i s p o s i t i o n ». L e V i z i r p r e n d s u r lu i , a u n o m d e l ' É t a t qu' i l r e p r é s e n t e a d m i n i s t r a t i v e m e n t , e n é t a n t l e p r e m i e r f o n c t i o n n a i r e d u R o i , l a d é c i s i o n d 'un p a r t i c u l i e r , i l l a f a i t s i e n n e ; i l lu i c o n f è r e l ' a u t h e n t i c i t é , i l l a l é g a l i s e .
(331) V o i r s u r l e r o u l e a u d e p a p y r u s <^r(i) n dm'', A. GARDINER, d a n s J . Eg. Arch., X X I I ( 1 9 3 6 ) , p p . 1 8 2 - 1 8 8 ; R . CAMINOS, Late-Egyptian Misccl-
lanies ( 1 9 5 4 ) , p . 2 3 6 .
(332) C f . l e Pap. Mook ( ou Pap. Munich 809), I I , 10-11 : « L e (procès -v e r b a l ) a é t é d r e s s é p a r e t l e s u p é r i e u r d e s a u x i l i a i r e s (de l ' a d m i n i s t r a t i o n j u d i c i a i r e ) T o u e n r a , l e fils d e H o r m è s , a é t é c h a r g é d ' en f a i r e u n e c o p i e (<̂ 7t<̂ .n d'iw m Jir n hry smsw T. r \rt m mitt) » ( W . SPIEGELBERG, Ein Gerichtsprotokoll aus (1er Zeit Thutmoais' IV, d a n s Z. Âg. Spr., L X I I I ( 1 9 2 8 ) , pp. 105 sqq. ; I .M. LODRIé, Esquisses de droit égyptien ancien ( e n r u s s e , L e n i n g r a d , 1960) , pp. 1 5 5 - 1 5 6 ; W . HELCK, Materialien sur Wirt-schaftsgcschichte dos Nciien Reiches, I I ( 1 9 6 1 ) , p p . ( 2 6 2 - 2 6 3 ) ; A r . T H é O D O -
R i D È s , d a n s RIDA ( 1 9 6 7 ) , p p . 1 2 6 - 1 2 7 ) .
(333) I^e C o n s e i l l o c a l qui e s t i c i l e C o n s e i l d e M e d i n e t H a b o u e s t touj o u r s d a n s n o t r e d o c u m e n t a p p e l é knbt ( I I , 1 ; I I , 9 ; I V , 2 ; I V , 3 ) , b i e n q u e l e V i z i r e n p e r s o n n e l ' a i t p r é s i d é . E n r e v a n c h e , d a n s l a v i l l e d e T h è b e s
L E T E S T A M E N T D A N S L ' Ê G Y P T H A N C I E N N E 203
d) les témoins : Devan t des témoins t rès nombreux (m-hsiib mtrw Ipnw '^é3w),
d o n t voici l a l is te nominat ive (imy-rn.f iry) ('^) : 1. < I V , 4 > Djéhoutyemheb, chef des gardes [hry S3w)
et scribe de la pr i son de l ' a rmée (ss hn[rt] D. n p3 mës) ;
2. Hor i , le fils de Djéhoutynakl i t , chef des ga rdes de l ' a rmée [hry S3iv J). n p3 ms3) ;
3. Neskhons, l i eu tenan t de l ' a rmée {idnw n p3 11153) ; 4:. Mensénou, chef d 'é table (Ijiry ih[w]) de K h é n [ y ] ; 5. Bakienset , conducteur de char (ktn) du [Tem]p le {n
[t3 hw^t) ; 6. Djéhoutymosé, scribe de la nécropole {sS D. n ps hr) ; 7. loufenkhonsou , scribe de la nécropole {p3 hr) ; 8. Bakienmout , chef d 'équipe ('^3 n \st) de la [néc ropo j l e ;
9. les prêt res- lecteurs (ou r i tua l i s tes) du Temple (n3 hryw-}),!) n ts Ij-wt) ;
10. Nésimenipet , gouverneur {h3ty-'^) ; 11. Nésimenipet , scribe de qua r t i e r {(l3tt) ; 12. les chefs de police de la nécropole (n3 Jiryw mi3y'w n
p3 hr); 13. Imenkhâou , contrôleur de Thèbes-Ouest {w'^rtw I. n
\mntt nlict) ; 14. P a k h a r o u , contrôleur de Thèbes-Ouest ;
(rnwt -» « N ô » ) , où se trouvai t le département proprement viziral , il y a le « G r a n d C(mseil » (knbt ^3*). N o u s es t av i s que ce n'est p a s dû a u f a i t que le Viz ir y a v a i t ses bureaux ; c'est plutôt la nature des causes qui dé t ermina i t la jur id ic t ion appelée à en connaître. U n e knbt loca le é ta i t compétente pour acter et authent i f ier des d ispos i t ions t e s t a m e n t a i r e s : e l l e demeure knbt, m ê m e si les c irconstances ont voulu que le Vizir en personne l 'ait présidée. Il f a u t ajouter toute fo i s qu'on n'est pas certa in de rencontrer l 'express ion knbt '^^t avant la X I X " dynas t i e (A. GARDINEB, The Inscription 0 / Mes, p. 33, n. 2) .
(334) J. CERN*-T.E. PEET, A Marriage Settlement of the Twentieth Dynasty (J. Eg. Arch., X I I I ) , p. 33 ; I.M. LOUKIé, Esquisses de droit égyptien, ancien, p. 219.
204 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
15. Panekh t ipe t , contrôleur ; 16. Imenhotep , contrôleur ; 17. I inen ipe tnakht , con t rô leur ; 18. Ankhtoumédi ïmen, contrôleur .
C ) C O M M E N T A I R E
La présen ta t ion ana ly t ique qui vient d 'ê t re donnée du Papyrus Turin 2021, nous prouve que l 'o rdre des sect ions n 'es t p a s cet te fo is ar t i f ic ie l lement établi pour sa t i s fa i re à des i m p é r a t i f s de composit ion, su r une stèle commémorative.
C'est le procès-verbal même de la séance que nous avons la chance d 'avoir sous les j 'eux. La s t r uc tu r e du p a p y r u s nous off re , tel qu ' i l a été, l ' o rdre de succession des phases de la procédure.
Cet te procétlure a concerné la confection d 'un acte de disposit ion ; nous ne par lons pas d 'un acte d '« imyt-per », vu que ce t e rme n ' a p p a r a î t pas dans ce document , ma i s il n ' e s t peut -ê t re p a s impossible qu'i l a i t eu sa place dans l ' in t i tu lé qui es t main te n a n t pe rdu ('^').
L 'ac te dressé é ta i t un acte de notor ié té et de d ro i t public, puisqu ' i l l 'a été devan t les au to r i t é s présidées p a r le Viz i r lui-même, en présence de p lus ieurs personnes parmi lesquelles f igurent la f emme du t e s t a t eu r et les deux aînés de ses enfan t s .
L ' au then t i c i t é a été conférée à l ' ac te p a r le Vizir qui a sanct ionné la disposi t ion en la couvrant de l ' au to r i t é de l ' É t a t e t qui en a f a i t r eprodu i re le procès-verbal en deux exempla i res don t l 'un é ta i t dest iné à la knht (ou « Conseil ») de Médinet Ha-bou (^") et l ' au t r e à la Grande knbt de Thèbes, c'est-à-dire le d é p a r t e m e n t viziral de la Capi ta le .
( 3 3 5 ) N o u s n e s e r i o n s p a s s u r p r i s , p o u r n o t r e p a r t , q u e l e t e r n i e éhr
( p l a n , p r o j e t , d i s p o s i t i o n ) a i t p e u t - ê t r e a u s s i é t é u t i l i s é à c e t t e é p o q u e ,
o ù d a n s l e l a n g a g e c o u r a n t , y c o m p r i s c e l u i d e s s c r i b e s d e l a n é c r o p o l e
t h é b a i n e , o n s e s e r v a i t p e u d u t e r n i e t e c h n i q u e « i m y t - p e r » ( c f . A r . T H é O -
DORiDÈs , d a n s RIDA, 1 9 6 6 , p . 3 4 , n . 1 7 ; r « i m y t - p e r » ( p a r t a g e d ' a s c e n
d a n t ) d e VOstracon Deir el-Médineh 108, d a t e d u d é b u t d e l a X I X ° d y
n a s t i e ) .
( 3 3 6 ) V o i r l e s n . 1 0 8 ; 2 0 6 - 2 0 7 ; 2 3 8 ; 3 3 0 .
( 3 3 7 ) C ' e s t c e t e x e m p l a i r e q u e , c o m m e d é j à s i g n a l é d ' a p r è s l a c o n v i c
t i o n d e s é d i t e u r s , n o u s a u r i o n s c o n s e r v é . C f . J . Ëg. Aroh., X I I I , p p . 37-38.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 205
P o u r que l ' ac te p r î t corps, il a fa l lu que l ' intéressé f î t une déc la ra t ion devant l ' au to r i t é compétentes^*), e t en présence, comme nous le savons, des membres de la famil le .
Cet te déc lara t ion est doublée d 'une in te r roga t ion dirigée p a r le fonc t ionna i re qui préside la knbt (c'est ici, mais occasionnellement , le Viz i r (" ')) . Cet te in te r roga t ion ne s 'adresse pas au testateur , qui a f a i t ce qu'on appe l le ra i t volontiers un exposé des mot i f s de ses in tent ions , suivi du disposi t i f , qui es t bien en tendu sa déc la ra t ion de disposi t ion.
Le Vizi r ne s 'adresse pas non p lus à la légata i re , qui est la bénéficiaire de l 'opérat ion, ma i s a u x e n f a n t s défavorisés p a r l 'existence même du legs.
I l f a u t no te r avec r igueur que ce n 'es t pas leur avis et encore moins leur accord qui es t demandé. I l s ne fo rmen t p a s une pa r t i e ag issan te et in te rvenante ; i ls ne demanden t r ien, i ls réponden t s implement à une question de f a i t et à une quest ion de dro i t .
La quest ion de f a i t (^°) p a r a î t en premier lieu, a u po in t que nous soupçonnons que son obje t a dû répondre à une en ten te é tabl ie en t r e les membres de la famil le , voire à un engagement p r i s p a r le père au moment de son second mariage. I l se t rouve effect ivement, comme nous l 'avons indiqué, que ce sont les neuf esclaves qui on t représenté l ' appor t du père à la première com-
(338) C'est d e p u i s l 'Anc ien E m p i r e qu'une d é c l a r a t i o n e s t e x i g é e pour l a c o n f e c t i o n d'un a c t e ; cf . l 'acte d e f o n d a t i o n de N e k a n k h [ = Vrk., I, 162, G] : « D i s p o s i t i o n (wdt-mdt) [qu'il pr i se (\rt.n) le « Connu du R o i » N e k ] a n k h , c o n c e r n a n t son d o m a i n e (m pr.f), d e sa bouche v i v a n t e (m r^.f '^nh(w) ) ». Wdt-mdt = ordre parlé , énoncé , déc laré ; e t « d e sa b o u c h e v i v a n t e » = oi-alement, a l o r s qu'il é t a i t en vie. Cf . a v e c t o u t e la bibliog r a p h i e : T y c h o MBSICH, Vntersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches : Ein Beitrag zum altagyptischen 8tiftungsrecht (Ber l in , 1968) , p. 71 ; vo ir la t r a d u c t i o n i) lus bas, a v e c l e s n. 86 sqq.
(339) N o u s e n t r o u v o n s la p r e u v e d a n s le f a i t qu'i l n 'of f ic ie p a s chez lui , d a n s l a « G r a n d e Ifnbt ».
(340) « Es t - ce vra i ce qu'a déclai'é (votre père) c o n c e r n a n t ce s n e u f s erv i t eurs , à sjivoir qu'il v o u s l e s a (déjà) r e m i s en t a n t que s e s d e u x t i e r s p r o v e n a n t du p a r t a g e d 'avec vo tre mère, a i n s i que l a m a i s o n d e s o n père de m è r e » ? ( I I I , 7-8) .
206 A R I S T I D E T H É O D O K I D È S
m u n a u t é conjugale, et qui lui sont revenus ap rès la dissolut ion de cet te communauté , qui lui ont servi à f o r m e r la seconde commun a u t é (^').
Cet te communauté , le père l 'a adminis t rée , l 'a f a i t f ruc t i f i e r au po in t d ' acquér i r bientôt deux esclaves femmes e t deux esclaves hommes (ceux-ci va lan t le double des au t res ) .
E t auss i tô t après , le père a cédé la possession des neuf esclaves à ses e n f a n t s e^^), qui, rappelons-le, sont ceux du premier l i t . Q u a n t aux acquêts , il en a abandonné la jouissance à sa seconde femme (^^) : il s 'agi t , comme il le spécifie, de la to ta l i t é des acquêts , à savoir du « t i e r s » , p ropor t ionne l à l ' appor t de sa femme à la communauté e t qui doi t échoir à celle-ci au moment de la dissolut ion, et des « deux t ie rs » à lui, qui devra ient normalement revenir à ses en fan t s du premier l i t , à d é f a u t d ' e n f a n t s du second l i t .
Le Vizir donc, comme nous l 'annonçions, commence p a r s'enquér i r de la réa l i té du f a i t : les neuf esclaves sont-ils v ra iment en possession des e n f a n t s ?
A quoi ceux-ci r éponden t {^^) :
— « Not re père es t vérace (niB'^ty psy.n \t). I l s ( = ces biens) sont v ra iment en no t re possession ».
Cet te réponse appelle deux précisions supplémenta i res relat ive, à la n a t u r e de « ces Mens », et à la personnal i té des possesseurs.
I l s 'agi t des « neuf esclaves » e t d 'une « maison » {^^) de son père de mère, qui est ment ionnée de semblable m a n i è r e ; ce qui signifie que la condition qui devait régir ce p ropre é t a i t identique à celle qui ava i t été prévue pour les « neuf esclaves » : cet te « maison » a u r a i t dû revenir auss i a u x e n f a n t s du p remier l i t a u moment de la dissolut ion du premier mar i age de leur père.
(341) D é j à s i g n a l é p l u s h a u t (voir l e s n. 259-260) . (342) Papyrus Turin 2021, I I I , 2-3. (343) Id., I I , 4-6. (344) Id., I I I , 8. (345) Jd., I I I , 3 ; I I I , 8.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 2 0 7
Q u a n t a u x possesseurs, ce sont les deux aînés des e n f a n t s présents devant le « Conseil », les au t r e s e n f a n t s é t an t vraisemblablement encore mineurs ( ^ ) .
Ces deux aînés a u r o n t donc la jouissance du t r ava i l des esclaves; i ls admin i s t r e ron t cette possession, qui est leur avoir en puissance, e t qui le deviendra ju r id iquement à la m o r t du père. I l semblera i t — mais le document ne nous fou rn i t aucune indicat ion à ce propos — que les aînés possèdent ces biens p o u r l'ensemble des e n f a n t s qu' i ls représen ten t devant le Conseil prés idé p a r le Vizir .
Ces neuf esclaves et la maison, qui sont donc « dé jà en leur possession », le père déclare m a i n t e n a n t qu'i l les rdl aux enfan t s . Or ce rdl es t exactement para l lè le au rdl de la l ibéra l i té qu ' i l prévoi t pour sa femme (^^). Comme rdl doi t se t r a d u i r e là p a r « léguer », la t r aduc t ion qui s ' impose ici est donc bien celle de « t r a n s m e t t r e ». Ces biens é t a n t dé jà en leur possession, on en dédu i t que c'est le droit de propriété (^^) su r ces mêmes biens que le père leur p romet pour le moment où sa disposi t ion sera exécutée, c'est-à-dire à sa mor t .
La seconde quest ion posée p a r le Vizir vise précisément ce legs ; auss i n'est-ce p lus cette fois une question de fa i t . Pu i squ ' i l
(346) C o m m e n o u s l ' avon s conjec turé (voir la n. 295) . (347) Papyrus Turin 2021, II , 11 - I I I , 2. (348) L e m ê m e verbe, rdi, s a n s spéc i f i cat ion (à m o i n s que, pour l e s
Égypt i ens , d e s v a r i a n t e s de v o c a l i s m e a i ent d i s t i n g u é l e s emplo i s du t e r m e ) , ser t pour l a t r a d i t i o n d'une chose e t pour le t r a n s f e r t du droi t sur c e t t e c h o s e (cf. Ar. THéODORIDèS, d a n s J. Eg. Arcli., L I V (1968), p. 150, n. 2 ) . Vo ir p a r e x e m p l e l'Ostracon Deir el-Médineli 235 : « . . . l e s m e m b r e s d e l a Arafii lu i on t « d o n n é » (rdi) l e s b i ens immobi l i e r s (qu'el le r e v e n d i q u a i t ) ». I l e s t e n t e n d u qu' i ls n'ont p a s p u l e s lu i m e t t r e en main , m a i s qu' i l s lu i ont proc lamé son droit sur ces b i ens (Ar. THéODOBIDèS, d a n s RIDA, 1969, p. 173) . U n a u t r e emplo i j u r i d i q u e in ahstracto d u m ê m e rd'\ e s t à t r o u v e r d a n s l ' in troduct ion a u x Contrats d ' H â p i d j e f a (Siut, I, 270 = SETHE, Lcse-stilcke, 92, 14-16) : « J e t 'ai f a i t c o n n a î t r e ce s b i ens que j 'a i r e m i s à c e s prê tres e n contre -va l eur de ce qu'ils se sont engagés à me donner (pour l ' entre t i en de m o n c u l t e f u n é r a i r e à perpétu i té ) (m Isw nn n ht rd\(w). n.én n.l) ». L i t t é r a l e m e n t , ce s e r a i t : en contre -va leur de « ce qu' i l s on t d o n n é », m a i s i l s n 'ont encore r ien donné, pu i sque l eur e n g a g e m e n t n e s e r é a l i s e r a é v i d e m m e n t qu'après la m o r t d ' H â p i d j e f a ! Cf. R. d'égyptol., X X I ( 1 9 6 9 ) , p . 1 0 2 , n . 5 .
208 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
s 'ag i t d 'une disposi t ion mortis causa, et que la clause ne se réal isera qu 'au moment de l 'exécution d u t e s t ament , nous nous t rouvons su r le p lan du droi t .
I l n 'y a pas eu à cet égard d 'accord ou de consentements exprimés p a r les en fan t s , t ou t au p lus une reconnaissance de la légal i té de la disposi t ion (^') :
— [« Nous avons en t endu] { = p r i s ac te de ?) ce qu 'a f a i t no t re père.
Qui p o u r r a i t le lui contes ter ? — « Ses biens sont siens {éwt ht.f), qu ' i l les donne [à
qui] il [veut] ».
I l r essor t d u texte que leur seule f acu l t é en cet te c i rconstance se ra i t de « contes ter » l 'acte. E t « contes ter » cons is tera i t à en suspecter la légal i té (^^), et aussi à le s ignaler a u x au to r i t é s à ce moment-là, semble-t-il bien. Sinon leur requête se ra i t déclarée i rrecevable (^'').
(349) Papyrus Turin 2021, I I I , 10-11. (350) P u i s q u e , a p r è s a v o i r p a r l é d e « c o n t e s t e r », i l s r e p r o d u i s e n t l a
s u b s t a n c e d e l a lo i , d o n t n o u s c o n n a i s s o n s l ' é n o n c é p l u s p r é c i s grf tce a u p è r e ( I I , 11) : « Q u e c h a c u n f a s s e ce qu' i l d é s i r e d e s e s b i e n s ». O n t r o u v e u n e m e n t i o n d e l a m ê m e lo i r e l a t i v e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e s b i e n s pers o n n e l s d a n s l e t e x t e d e l a S t a t u e s t é l é p h o r e Caire Jf2.208, l i g n e s 14-15 : « . . . e n c o n f o r m i t é de ce q u e l e g r a n d D i e u ( = l e R o i ) a d i t ' Q U E C H A C U N D I S P O S E D E S E S B I E N S ' ( imi 'try s nb éhrw n Uwt.f). Or, m e s b i e n s m ' a p p a r t i e n n e n t e n t a n t q u e b i e n s p r o v e n a n t d e m o n p è r e e t d e m a m è r e , e t e n t a n t q u e b i e n s a c q u i s p a r m e s bras , l e r e s t e m ' a y a n t é t é a c c o r d é p a r l a f a v e u r d e s R o i s , e n r a i s o n d e m e s s e r v i c e s . O n n e p e u t y t r o u v e r r i e n d ' i n j u s t e , a u s s i , p u i s - j e e n f a i r e c e q u e j e d é s i r e ». V. l a n. 121.
(351) I l y a v a i t u n e c l a u s e d e s t y l e à c e t e f f e t , q u e n o u s o n t c o n s e r v é l a Stèle Juridique de Kamak, 9-10 ( = éd . P . LACAU, p. 1 7 ) , e t l a Stèle de Sénimosé, 17-18 [ = Urk., IV , 1070, 4 ] : « . . . q u ' o n n e l e s é c o u t e p a s ( = q u ' o n n e l e u r p r ê t e p a s a t t e n t i o n ) ». Cf . RIDA, 1965, p. 83, n . 21. C e t t e c l a u s e n e s e r e n c o n t r e ic i q u ' i m p l i c i t e m e n t d a n s l a b o u c h e d u V i z i r , q u i d i t e n p a r l a n t d u p è r e : « i l a d é c l a r é : ' j e l u i l è g u e m e s d e u x t i e r s e t aucun fils et aucune fille ne contestera c e t t e d i s p o s i t i o n q u e j ' a i p r i s e ' » ( I I I , 1 3 - I V , 1 ) . L e s c r i b e a-t-11 n é g l i g é d e r e p r o d u i r e c e t t e c l a u s e l o r s q u e l e p è r e a u r a i t d û l ' é n o n c e r , o u b i e n a l l a i t - i l d e so i q u ' e l l e e x i s t a i t , m ê m e n o n p r o n o n c é e , l o r s q u ' o n p r e n a i t u n e d i s p o s i t i o n ?
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 209
Le Vizir synthét ise la déclara t ion du père en ces t e rmes ( '̂̂ ) :
— « Qu' i l [lègue (donc) à la ] * c i tadine ' Anoksoune-d j e m [les] q u a t r e servi teurs qu ' [ i l a acquis] con jo in tement avec elle, et ce qu ' [ i l acquer ra encore] conjo in tement avec elle et don t il a déclaré :
— ' J e lui lègue mes deux t ie rs (de mes acquêts de communauté) [en supplément de] s [ o n ] t iers , et aucun fils et aucune fille ne contes tera ( = ne p o u r r a le f a i r e —> n'aura le droit de contester) ce t te disposi t ion que j ' a i pr ise ce j ou r ' ».
Si le père f a i t sa déclara t ion dans ces condi t ions avec les effets d 'o rdre ju r id ique que nous venons de m e t t r e en relief, et si de son côté le Vizir s ' enquier t du fait de la remise des biens en la jouissance des enfan ts , et qu' i l commence p a r là a v a n t de les in te r roger su r la légali té du legs — alors que le père ava i t adop té l 'ordre inverse dans sa déc lara t ion — ne serait-ce p a s l ' indice de ce que l ' a t t i t ude du père (qui a peut-être dû ê t re annoncée dans la pa r t i e m a n q u a n t e du papyrus ) correspondai t , comme nous l 'avons présumé p lus hau t , à un modus vivendi convenu en t re ses e n f a n t s et lui à l 'époque de son remar iage , et ce, avec l 'accord des au tor i tés . I l semble, en effet, que théor iquement les neuf esclaves e t la maison a u r a i e n t dû passer d i rec tement a u x enfan ts , à la m o r t de leur mère.
E t si le Viz i r appuie su r cette mise en possession des biens cités, c 'est qu ' i l y ava i t peut-être lieu d ' assure r officiel lement la protect ion de la possession {^^), en a t t e n d a n t qu'elle devînt propr ié té au moment du t r a n s f e r t du d r o i t ; celui-ci se f e r a donc
(352) Papyrus Turin 20Z1, I I I , 12-13. (353) Ce passage , c o m m e dé jà d i t (voir la n o t e 326) e s t cap i ta l pour que
la « d é c l a r a t i o n » du père so i t c l a i r e m e n t u n e d i spos i t i on à c a u s e d e mort , puis(iu'i l e s t censé , d 'après ceci, cont inuer à réa l i s er d e s a c q u ê t s jusqu'à un ternie qui ne peut ê t re que la mort . I n u t i l e d 'a jouter combien il e s t regre t tab le qu'il y a i t des lacunes . Le b ien- fondé d e s r e s t i t u t i o n s e s t a s s u r é : l e P r o f e s s e u r J. CERN* é t a i t ca tégor ique à ce sujet , l 'an dernier , quand n o u s a v o n s encore eu l ' a v a n t a g e d ' e x a m i n e r ce p a s s a g e a v e c lui, à Oxford , sur p h o t o g r a p h i e e t d a n s ses cahiers .
(354) N o u s ne s o m m e s p a s r e n s e i g n é s sur ce t te mat ière . 14
210 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
p o s t é r i e u r e m e n t à la l ivra ison des choses t e s t a m e n t a i r e i n e n t t r a n s m i s e s .
On ne c o m p r e n d r a i t p a s s inon pou rquo i ces biens-là son t ment i o n n é s à p a r t , p a r le pè re (^''), e t pou rquo i même, i ls s o n t ment ionnés . I l e û t suf f i au pè re de s igna le r que l ' hé r i t age des e n f a n t s s e r a i t c o n s t i t u é de la t o t a l i t é de ses biens, d é d u c t i o n f a i t e d u legs réservé à l a belle-mère des e n f a n t s .
I l r ésu l te , pK)ur le res te , de ce t te é t u d e d u documen t , que la p résence des e n f a n t s lors de la r édac t ion de l ' ac te n ' a p a s impliqué d ' e n g a g e m e n t de l eu r p a r t . I l n ' a p a s ex i s t é de cond i t ions e x p r e s s é m e n t acceptées p a r eux, qu i e u s s e n t f a i t d ' eux des donat a i r e s .
Le Consei l p ré s idé p a r le Viz i r n ' a p a s ac t é de convent ion . Auss i la p r o c é d u r e suivie p o u r la confec t ion de cet a c t e n ' en élimine-t-elle p a s le c a r a c t è r e u n i l a t é r a l . C 'es t s ans dou t e a u p r i x d ' u n e fiction, m a i s f ict ion il y a v a i t donc, e t une tel le no t ion , comme bien d ' a u t r e s , e s t en f a v e u r du s t a t u t a b s t r a i t du d r o i t égypt ien .
J u r i d i q u e m e n t p a r l a n t — et ma lg ré , répétons-le , l ' a s s i s t ance des m e m b r e s de la f ami l l e — la d i spos i t ion mortis causa a é t é p r i s e p a r la seule volonté pa te rne l le .
* * *
E n r e p r e n a n t l ' examen de la s tèle de Sénimosé , n o u s d i r o n s qu ' i l deva i t ê t r e connu de quiconque que les m e m b r e s de l a f a m i l l e de Sénimosé lui ava i en t f a i t des sugges t ions , qu ' i l s a v a i e n t exercé s u r lu i des press ions , qu ' i l s a v a i e n t même usé de violence à son éga rd (puisque le pè re m e n a c e de les dénonce r p a r écr i t , c 'est-à-dire d ' ad re s se r u n e p l a i n t e en règle a u x a u t o r i t é s ) ; m a i s t o u t e s ces a t t i t u d e s n ' o n t p o u r t a n t p a s causé l a n u l l i t é de l ' ac te . E t si d a n s les f a i t s n o u s devr ions p a r l e r d ' u n a c t e bilat é r a l , voire m u l t i l a t é r a l , l éga lement , la confec t ion de ce t ac te a é té l 'œuvre d ' u n e seule volonté.
(355) Papyrus Turin 2021, I I I , 2-3.
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 211
La volonté, officiellement autonome, du d isposant e n t r a i t seule en ligne de compte, à condit ion sans doute qu'elle ne cont revîn t pas à cer ta ines prescr ip t ions légales ; a ins i pa r exemple, bien que ce ne soit j a m a i s d i t explici tement, mais comme des recoupem e n t s nous au to r i s en t à l ' a f f i rmer , les en fan t s é ta ien t hé r i t i e r s rése rva ta i res
I l r essor t des t e rmes mêmes de l 'acte que Sénimosé est considéré comme l 'unique a u t e u r de l 'acte, comme la p ropre source de ses volontés.
Tou t por t e à croire, p a r ai l leurs , que méconten ts e t contestat a i res comme ils l 'ont été, les e n f a n t s n ' a u r a i e n t pas manqué d ' expr imer leur désaccord devant les au to r i t é s mêmes, s ' i ls ava ien t eu le d ro i t de le fa i re .
D a n s la réal i té , c'est chaque fois après coup que les membres de la famil le récr iminent , quand les actes on t été rédigés. I l s le f o n t de façon à obteni r une modification, une re fon te dans le sens de leurs in térê ts . Mais seule la volonté de Sénimosé p rodu i t les modi f ica t ions ; lui seul en a eu l ' in i t ia t ive aux yeux de l 'autor i t é (^s') :
« . . .S ' i l vient
a / quelque fils ou quelque fille b / quelques f r è res ou quelques sœurs (^"), c / n ' impor te quel homme de ma pa ren té ('^)
(356) N o u s i g n o r o n s à c o m b i e n s e m o n t a i t c e t t e i-éserve. Cf . Ar. ï H é O -DORn)fes, A propos de la loi dans VÉgypte ancienne, d a n s RIDA, 1967, pp. 142-143 ; 1969, p. 115.
(357) Sénimosé, 16-18 [ = Vrk., IV, 1070, 1-5] . (358) D a n s le Papyrus Turin 20Z1 ( I I I , 1 3 - I V , 1 ) , s e u l s l e s e n f a n t s
s o n t s i g n a l é s c o m m e s o u r c e p o s s i b l e d e l a c o n t e s t a t i o n : « a u c u n f i l s e t a u c u n e f i l le n e c o n t e s t e r a c e t t e d i s p o s i t i o n q u e j 'a i p r i s e en f a v e u r ( d e l e u r b e l l e - m è r e ) c e j o u r ».
(359) D a n s le Papyrus des Adoptions ( p r e m i è r e p a r t i e ) , c o m m e le m é n a g e e s t s a n s e n f a n t s , la c o n t e s t a t i o n p r o v i e n d r a i t d e s c o l l a t é r a u x , bér i -t i e r s l é g i t i m e s d a n s ce c a s (lilUA, 19C5, p. 8 3 ) .
(3G0) L a f o r m u l e a u comple t , qui e n v i s a g e t o u s l e s l i é r i t i e r s réservat a i r e s p o s s i b l e s , s e l i t ic i e t d a n s la Stèle Juridique de Karnak (éd. P . LACAU, pp. 17-18 ; Ar. TKéODORIDèS, Le rôle du Vizir dans la Stèle
212 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
pour C O N T E S T E E (la valeur) de cet ac te d " imyt-per ' que j'ai dressé en f aveur de mes qua t r e enfan t s , qu'on ne leur prê te a t t en t ion d a n s aucun bureau (du greffe) royal, où ils s ' adressera ient ».
V I / Conclusions.
1. — Concernant le testament.
Not re bu t a é té d 'é tudier a v a n t t o u t et à fond le document appelé l '« imyt-pr de Sénimosé » connu p a r la stèle n° 3401G du Caire. Le contenu en est de pr ime abord complexe. Cependan t la stèle qui nous le r appor t e est consacrée, con t ra i r emen t à ce qui a pa r fo i s été af f i rmé, à une seule affa i re , bien qu'elle a i t connu d i f fé rentes phases jur id iques , et p a r t a n t divers aspects d ' o rd re fami l ia l .
Nous avons élargi les dimensions de la recherche en in sé ran t n o t r e ana lyse dans le problème généra l du t e s t amen t en Égypte , et en r ecou ran t à deux a u t r e s documents qui nous on t confirmé les carac tè res essentiels d 'un acte t e s t amen ta i r e : sa révocabil i té et son uni la té ra l i t é , malgré les t r a i t s p rop res à la confection d 'un pare i l ac te en Égypte.
Au t e rme du t ravai l , il p a r a î t incontes table que nous puiss ions pa r l e r d 'un acte à fonct ion de t e s t amen t puisqu ' i l est c lair que le personnage Sénimosé a volonta i rement disposé de ses biens pour le t emps où il ne sera i t plus.
I l résul te de ce que nous pouvons ex t ra i r e des documents de la p r a t i que étudiés, qu 'un t e s t amen t égyptien est une déclarat ion solennelle de dernières volontés, qui ne comporte pas d ' institu t ion d 'hér i t ie r .
Juridique de Earnak, d a n s HIDA, 1962, pp. 62 sqq.) . N o u s y a v i o n s rendu sn (« f r è r e ») par « co l la téra l » (pp. 64, n. 58 ; 68-69) ; K l a u s BAER a bien v o u l u n o u s d i re ( c o m m u n i c a t i o n orale) qu 'une p ièce a r c h é o l o g i q u e découv e r t e par lui à H i é r a k o n p o l i s a t t e s t e r a i t que Kebs i e t S e b e k n a k h t é t a i e n t r é e l l e m e n t d e s « f r è r e s ». Cela n e c h a n g e é v i d e m m e n t r ien à l ' a n a l y s e i n s t i t u t i o n n e l l e d u document , u n f r è r e é t a n t u n co l la téra l .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 213
La « déc lara t ion » se f a i t publ iquement , et l 'acte a ins i créé es t de d ro i t public (comme à Kome au débu t de son his toire) . E l le es t « solennelle » vu qu'elle doi t sa t i s fa i re à des fo rmes légales que nous avons appelées la procédure p ropre j\ la confect ion de l 'acte.
D u po in t de vue du droi t , la volonté créat r ice de l ' ac te émane exclusivement du d isposant , malgré la présence de la fami l le devant les au to r i t é s au moment de cette confection. La décision ( l 'autre p a r t é ta i t comprise comme devant produii-e ses effe ts ap rè s la m o r t du d isposant ; e t en t re temps, ce d i sposan t ava i t la f acu l t é de révoquer l 'acte, e t dans le cas de Sénimosé, il a été usé à p lus ieurs repr ises de ce droi t .
I l n ' es t question dans les documents que de successeurs a u x b iens ; ceux que nous venons d ' é tud ie r cont iennent chacun un legs pa r t i cu l i e r dest iné à la deuxième épouse du disposant .
Ije legs sera sous t ra i t de l 'héri tage, qui pour le res te sera part agé également en t re les enfan t s , sans que ce ne soi t s t ipulé. I l n 'y a donc pas en Égypte d ' incompat ib i l i té en t re la succession t e s t amen ta i r e et la succession ab intestat : un Égypt ien peu t t es te r su r une pa r t i e de ses biens, la succession é t an t réglée p a r la loi pour le su rp lus (^').
Disons enfin que la procédure remplie p a r les ac tes analysés e t qui abou t i t à leur authent i f ica t ion est de n a t u r e civile e t nullement religieuse : elle ne r en fe rme rien, absolument r ien, de r i t u e l ; les disposi t ions ne sont soumises à aucune considéra t ion d'essence métaphysique.
Nous n 'avons pas af fa i re à un formal i sme étroi t , pour la ra i son qu ' i l n 'y ava i t pas de fo rmula i r e imposé; les in téressés f o n t des déc la ra t ions en respec tan t le sens général de ce à quoi i ls veulent about i r , ma i s don t le contenu leur es t propre.
Nous pouvons pa r l e r sans hés i ta t ion de « d ro i t » e t non de p r a t i que ressor t i s san t à la magie ou quelque a u t r e man i fe s t a t ion de pr imi t iv i té , et ce d ro i t connaî t cette not ion qualifiée de supér ieure , à savoir la disposi t ion à cause de mor t .
(361) Ar. TiiÉoDOKiDÈs, A propos de la loi dans l'Égyptc pharaonique, d a n s RIDA, 1967, p. 147.
214 A R I S T I D E T H É O D O R I D È S
2. — Concernant l'acte dW imyt-per ».
Q u a n t à r « imyt-per », il f a u t éviter dans la recherche de sa fonct ion jur id ique , de se laisser obnubiler p a r l 'étymologie. Que l 'é tabl issement d'« inventa i res » f û t pa r fo i s requis, nous pouvons en ê t re convaincus, ma i s « imyt-per », dans son s u b s t r a t sémantique, ava i t dépassé ce stade, puisqu ' i l correspond souvent à un acte de dévolution, à l 'occasion duquel, p a r conséquent, on donne des indica t ions su r la disposit ion des biens ma i s sans en t r e r dans des dé ta i l s concrets.
P o u r découvr i r l 'essence d '« imyt-i>er », il f a u t en no te r les cas d 'u t i l i sa t ion . Quand dresse-t-on un « imyt-per », et quelles en sont les ra i sons ?
Nous en avons f a i t le relevé plus h a u t (^^'). 11 suf f i ra iwur conclure d'en déceler le dénomina teur commun : un « imyt-per » es t rédigé lorsque le d i sposant ne respecte pas la t r ansmiss ion légalement fixée pour ses biens. Loin d 'ê t re étouffée p a r le groupe fami l ia l , et ja lousement in te rd i te pa r les pouvoirs publics, nous voyons la volonté individuelle s 'expr imer p a r le moyen de l'« imyt-per ».
Rappelons brièvement le cas de la fonda t ion , pour passer ensui te à celui de la vente. Lorsqu 'un p ropr i é t a i r e crée une fonda t ion , il prélève su r la masse héréd i ta i re ce r ta ins biens qu' i l affecte à une fin précise, en les r e n d a n t indivisibles et inaliénables, e t cela, comme généralement prescr i t , « à pe rpé tu i t é » : sa p ropre volonté imprime aux biens en quest ion une or ien ta t ion définie et leur confèi'e un s t a t u t qui n 'es t pas conforme à celui que connaissent les au t r e s biens.
C'est dans cet te perspective qu' i l f a u t s i tue r la vente p a r « imyt p?r ». Une vente o rd ina i re se f a i t de la main à la main , ou p a r acte d i t de « sounet ». L'« imyt-per » est r endu indispensable — les cas connus sont t ou jou r s les mêmes — lorsqu' i l s ' ag i t d 'une fonct ion pa t r imonia l i sée ; c 'est que cet te fonct ion a été remise à son t i t u l a i r e pourvue de la clause S3 n S3 (« de fils à fils ») qui la rend héréd i ta i re p a r voie de p r imogéni tu re mascu-
(3G2) Voir l e s n. 22,")-234, a v e c le t e x t e eorresponclaiit .
L E T E S T A M E N T D A N S L ' É G Y P T E A N C I E N N E 2 1 5
l ine ; cet te fonct ion est donc grevée d 'une subs t i tu t ion perpétuel le en f aveur des aînés à venir.
I l es t p a t e n t tou te fo is que la clause S3 n s3, « de fils à fils », vise fondamen ta l emen t l ' indivision du fonds ou de la fonct ion (et de ses accessoires) p lu tô t que l ' inal iénabi l i té , sinon il n 'y a u r a i t pas eu de vente ou d ' a u t r e moyen de d ispos i t ion ; or la Stèle Juridique de Karnak (^') nous prouve que ces moyens exis ta ient , e t il en est de même dans l 'exemple du Papyrus Kahoun I I , 1 (^^).
Lors d 'une a l iénat ion (en l 'occurrence, à t i t r e onéreux) , la l ignée de t ransmiss ion originelle n ' é t a i t p lus respectée; ma i s le p r inc ipe formel de la p r imogéni tu re devai t l 'être, e t c 'est pourquoi un nouvel « imyt-per » é ta i t dressé, avec l ' inser t ion de la même clause (s3 n ss), p rescr ivan t donc que la succession dans la fami l le de l ' acquéreur a l l a i t ê t re déterminée p a r la mascu l in i t é et l 'aînesse.
I l ne f a u t pas dresser d '« imyt-per » bien en tendu s'il n 'y a pas d 'a l iénat ion , puisque la ligne de t ransmiss ion a été fixée de sor te qu'elle s 'opère « de fils à fils » ('^^).
L 'u t i l i sa t ion de l '« imyt-per » s 'est généralisée à cette fin, a u po in t que nous voyons les Kois s'en servir, ap rès l 'Ancien Empi re , lorsque, p a r exemple, Ahmosis I""" remet (ou même « vend » (?), d ' ap rès cer ta ines indica t ions du texte) , une fonct ion rel igieuse à Ahmès-Nefer ta r i [^^), p a r un « imyt-per » qui con-
( 3 6 3 ) P . LACAU, Une stèle juridique de Karnak, p . 1 5 ; A r . T I I é O D O R I D è S ,
Le rôle du Vizir dans la Stèle Juridique de Karnak, d a n s RIDA, 1962, pp. 5 2 sqq.
( 3 6 4 ) Papyrus Kahoun I I , 1 [ = G R I F F I T H , p p . 3 6 - 3 8 ; p l . X I I I ; K . S E -
THE, Lesestiickc, 91, 11 sqq.] ; c f . Ar. TIIéODORIDèS, d a n s RIDA, 1959, pp. 1 1 8 sqq.
(365) Cf. Ar. THéODORIDèS, d a n s RIDA, 1962, p. 66 : « E n a l i é n a n t ce bien, i l appor te u n e modi f i ca t ion à l a vo lonté e x p r i m é e p a r son a n c ê t r e ; c 'est pourquoi il lu i f a u t invoquer ce d o c u m e n t (V'myt-pr du Viz ir Ay) qui a v a i t a c t é c e t t e volonté . Si lu i -même n e modi f ia i t pas la déc i s ion pr i se par son ancêtre , l e pr inc lpa t d 'El -Kab c o n t i n u e r a i t d e s e t r a n s m e t t r e par vo i e d e i ) r imogéni ture mascu l ine , en ver tu de la l i gne s u c c e s s o r a l e t r a c é e par A y ».
( 3 6 6 ) E . DRIOTON, d a n s B. Soc. Fr. Eg., 1 2 ( 1 9 5 3 ) , p p . 1 1 s q q . ; I . H A R A K I ,
Nature de la stèle de donation de fonction du Roi Ahmôsis à la Reine Ahmès-Néfertari, d a n s Ann. Serv. Ant., L V I (1959), pp. 139 sqq.
216 A R I S T I D E T H É O D O E I D È S
t i en t la clause en question, ou lorsque Séthi I"' érige des biens en fonda t ion à K a n a ï s (^").
Les pa r t i cu l i e r s ava ien t le droi t , d a n s l 'Égypte ancienne, de déroger à la t ransmiss ion légale du pa t r imoine , et l ' i n s t rumen t de ce d ro i t é t a i t l '« imyt-per » (à moins que, comme vu, on ne se servî t du te rme ss, « écr i t »). Cette dérogat ion pouvai t s 'exercer de diverses manières , comme nous l 'avons indiqué. I l semble que, sans a u t r e s s t ipula t ions , ce sont les disposi t ions à cause de mor t que l 'on ava i t spécialement en vue, et l '« imyt-per » peu t a lors ê t r e r endu p a r « t e s t amen t », mais il n 'es t qu 'un cas pa r t i cu l i e r d a n s l 'éventai l des dérogat ions.
(367) S. ScHOTT, Kanais, Der Tempel Sethos I. im Wâdi Mia (Nachr lch-t e n der A k a d e m i e . . . in Gott ingen, 1961) , pp. 157-158 ; 172.