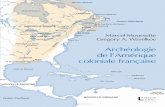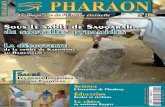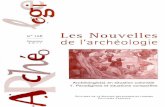Joie et tristesse en Égypte ancienne - Archéologie de l'émotion
Transcript of Joie et tristesse en Égypte ancienne - Archéologie de l'émotion
ACADEMIE
DES
INSCRIPTIONS & BELLES-LETTRES
COMPTES RENDUSDES
SÉANCES DE L'ANNÉE
2012NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Publication trimestrielle
Fascicule IV
PARIS
DIFFUSION DE BOCCARD
11, Rue de Médicis2012
TABLE DES MATIERES
NOVEMBRE
S é a n c e s 1 4 5 3 , 1 5 2 7 , 1 6 4 7 , 1 7 0 1Allocution d'accueil du XIVe colloque international hippocratique : « Hippo-
crate et les hippocratismes : médecine, religion, société », par M. MichelZ i n k , S e c r é t a i r e p e r p é t u e l d e l ' A c a d é m i e 1 4 5 5
Le glossaire d'Érotien et le Pronostic d'Hippocrate. Découvertes et problèmes :du grain au divin, par M. Jacques Jouanna, membre de l'Académie 1461
Hippocrate aristotélicien, par M. Philip Van der Eijk, correspondant étrangerd e l ' A c a d é m i e 1 5 0 1
Figures antiques de pêcheurs : du grotesque au sublime ?, par M. AlainPasqu ie r, co r respondan t f r ança i s de l 'Académie 1529
Joie et tristesse en Egypte ancienne. Archéologie de l'émotion, par Mme NathalieB e a u x 1 5 6 5
Sur la fondation de la ville de Memphis au début de l'histoire pharaonique.De nouvelles données au Ouadi Ameyra (Sud-Sinaï), par M. Pierre Tallet 1649
Les inscriptions antiques de Phocide et de Doride, par M. Denis Rousset.... 1659Discours sur la vie et les travaux de l'Académie au cours de l'année 2012,
par M. Jean-Pierre Mahé, Président de l 'Académie 1703Lecture du Palmarès 2012 et proclamation de la liste des nouveaux
archivistes paléographes, M. Jean-Marie Dentzer, Vice-Président del ' A c a d é m i e 1 7 1 5
Allocation d'accueil à la cérémonie solennelle de rentrée sous la Coupole,par M. Michel Zink, Secrétaire perpétuel de l'Académie 1723
L'image et le mot. André Chastel, historien de l'art, par M. Roland Recht,m e m b r e d e l ' A c a d é m i e 1 7 2 7
Orient, Afrique et classicisme : l'Egypte pharaonique face à l'histoire del'art, par M. Nicolas Grimal, membre de l'Académie 1741
AppendicesRapport sur la vie et les activités de l'École française d'Athènes (2011-2012),
par M. Jacques Jouanna, membre de l 'Académie 1601Rapport sur la vie et les activités de l'École française de Rome (2011-2012),
p a r M . P i e r r e G r o s , m e m b r e d e l ' A c a d é m i e 1 6 2 0L i v r e s o f f e r t s 1 5 2 2 , 1 5 9 0 , 1 6 9 0
DECEMBRE
S é a n c e s 1 7 6 1 , 1 8 0 3 , 1 8 4 5Allocution d'accueil du colloque international : « Heinrich Denifle (1844-
1905). Un savant dominicain entre Graz, Rome et Paris », par M. MichelZ i n k , S e c r é t a i r e p e r p é t u e l d e l ' A c a d é m i e 1 7 6 3
Heinrich Denifle et l'histoire des universités italiennes, par Mme Caria Frova 1765Heinrich Denifle, historien de la guerre de Cent Ans, par M. Jean-Marie
M o e g l i n 1 7 7 9Georges Cuvier, explorateur des mondes disparus, par M. Philippe Taquet,
V i c e - P r é s i d e n t d e l ' A c a d é m i e d e s S c i e n c e s 1 8 0 5L'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Bilan des travaux 2011-
2 0 1 2 , p a r M m e B e a t r i x M i d a n t - R e y n e s 1 8 1 1
(suite page 3 de couverture)
COMMUNICATION
IOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE.ARCHÉOLOGIE DE L'ÉMOTION,
PAR M™ NATHALIE BEAUX
On sait que les Inuits disposent d'une large palette lexicale pourévoquer la neige (vingt-cinq termes), car il convient dans leur environnement de pouvoir distinguer la neige molle, en profondeur, de laneige compacte, humide, ou encore la neige dure, marquée par desempreintes de pas, de celle compressée, s'adoucissant au printemps1...Mais sait-on que les anciens Égyptiens avaient plus de quarantetermes se référant à la joie ? Bien moins pour la tristesse. Ainsi, dansun corpus comme les Textes des Pyramides, on dénombre une quinzaine de lexemes évoquant la joie, et moins de dix pour la tristesse.
Une telle abondance lexicale pour la joie n'est cependant pasuniverselle2.
Il ressort de cela que la « culture de la joie » ne va pas de soi, etque si les anciens Égyptiens lui avaient accordé une telle importance,il convient de cerner plus précisément ce que cette émotion signifiaitpour eux. Si plusieurs mots veulent dire «joie » ou « tristesse »,quelle est la nuance que chaque terme véhicule, et par là même,quelle dimension de l'émotion met-il en valeur, quelle approchereflète-t-il ?
La méthode suivie pour explorer une telle variété lexicale a été dese saisir de chaque terme et d'en préciser le contenu de deux façons :
- en étudiant les signes figuratifs accompagnant chaque mot(déterminatifs ou classificateurs). Ces signes permettent de préciser,nuancer, définir, à l'aide de l'image convenablement décodée, lechamp sémantique en question ;
1. L.-J. Dorais, La parole inuit. Langue, culture et société dans l'Arctique nord-américain,Paris, Peeters, 1996, p. 145.
2. Lorsque j'ai présenté une recherche sur / 'écriture des émotions en Egypte ancienne (il s'agissait de la joie, de la tristesse, de la peur et de la colère) à un séminaire Fédération du CNRS« Typologie et Universaux Linguistiques » coordonné par Nicole Tersis et Pascal Boyeldieu etconsacré à « l'expression des émotions : syntaxe et sémantique », les linguistes présents furentextrêmement surpris de découvrir la part de la joie dans le lexique égyptien. Cet exposé sera publiédans les Actes du séminaire.
1566 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
- en explorant les homophones, dans cet esprit du « jeu de mot »dont les Égyptiens étaient friands et en scrutant les contextes danslesquels ces termes étaient employés.
J'ai choisi de fonder ma recherche sur un corpus précis et ancien,celui des textes religieux gravés dans les pyramides3, tombeaux depharaons de l'Ancien Empire, en élargissant ensuite mon enquête,de façon diachronique, au lexique égyptien classique (jusqu'auNouvel Empire)4.
Mots, signes, contextes, représentations nous invitent donc à unepromenade en ancienne Egypte et à une réflexion sur l'émotion, lafaçon dont les anciens Égyptiens la concevaient, la décrivaient et lagéraient.
Tristesse
Dans le corpus religieux le plus ancien, celui des textes que lepharaon faisait graver dans la pyramide où reposerait son corps, unedizaine de termes se rapportent à la tristesse et ses manifestations.Chacun est accompagné d'un signe indiquant le registre dans lequelil se situe. Mais l'unique terme correspondant au ressenti de la tris-tessejVjTMW, lui, est écrit exclusivement phonétiquement. Le contextedans lequel il apparaît est pourtant clair : il s'agit de l'accueil du roiressuscité, et il est dit que « la tristesse (jqmw) disparaît et le rire(sbt) apparaît » (Pyr. 1989a)5.
Si l'on rapproche ce terme, jqmw (var. qmw6) de nqm1, « êtreinconscient, dans un état de torpeur à la suite d'une maladie », on
3. Les références (Pyr.) aux Textes des Pyramides seront faites d'après l'édition de K. Sethe,Die Altàgyptischen Pyramidentexte, Leipzig, 1908-1922.
4. On prendra comme références le dictionnaire de moyen égyptien de R. O. Faulkner(A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1964 [2nde éd.], University Press, ci-aprèsabrégé en FCD), celui de A. Erman et H. Grapow (Wôrterbuch der aegyptischen Sprache I-V,Berlin, 1955 [rééd.], Akademie-Verlag, abrégé en Wb.) et enfin les recueils lexicographiques deD. Meeks (Année Lexicographique 1-3, Paris, 1980-1982, abrégés en AnLex). Pour un lexique destermes concernant les émotions sur l'ensemble de l'histoire pharaonique égyptienne, voirM. I. Toro Rueda, Das Herz in der àgyptischen Literatur des zweiten Jahrtausends v. Chr. —Untersuchungen zu Idiomatik und Metaphorik von Ausdriicken mit jb und hpj. Dissertation,Georg-August-Universitàt Gottingen, 2003, p. 90-116.
5. Tm jqmw hpr sbt.6. AnLex II, p. 390, 78.4292. Mais R. Van der Molen juge, dans les Textes des Sarcophages, que
le mot est un « oiseau » parce qu'il est accompagné d'un signe d'oiseau (A Hieroglyphic Dictionaryof Egyptian Coffin Texts, Problème des Àgytologie 50, Leiden, 2000, p. 653). Il semble pourtantopposé à la « joie » (CT VI 157i).
7. AnLex II, p. 209, 78.2254-5.
IOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1567
comprend que la tristesse est ici synonyme d'abattement, par opposition au pétillement du rire.
La mort est par excellence le champ sur lequel croît la tristesse.Les termes pour la tristesse et ses manifestations sont tous rattachésau registre du deuil et de la lamentation que les Égyptiens désignaientglobalement par le terme de jjkbs, « tristesse, deuil, lamentation ».Une dizaine de citations dans ce corpus permet de définir l'expression de ces lamentations. Le signe accompagnant ce mot représenteune mèche de cheveux, avec plusieurs boucles (signe D39) (fig. la).Mais quelques variantes peuvent faire penser que le scribe jouait del'homomorphie d'autres signes pour introduire de nouvelles résonances : ainsi, sur le signe de la mèche de cheveux peut se superposer, tout en gardant la même forme générale, celui de la bouchedont s'épanche un liquide, signifié par le trait (Pyr. 829c N) ou lestrois (ou quatre) traits ondulés de l'eau (Pyr. 1009a N, 1978a N)(fig. lb). Le contexte général du mot, jjkb, fait que le lecteur attendle signe de la mèche de cheveux et le reconnaît. Mais la relectureavec la bouche et l'eau évoque et enrichit la référence en ajoutantaux cheveux, cris (sortant de la bouche) et larmes (le liquide quis'épanche).
Pourquoi les cheveux servent-ils de réfèrent ?
Il suffit de revenir à un texte décrivant le deuil d'Osiris (Pyr.1004-5) :
« Ô mon père, les vantaux du ciel sont ouverts pour toi... Les dieux de Pe(...) ils viennent vers Osiris à la voix des cris d'Isis et de Nephthys. Lesâmes de Pe dansent pour toi, elles heurtent leurs chairs pour toi, ellesfrappent leurs bras pour toi, elles décoiffent leur chevelure pour toi... »
Les scènes de deuil avec lamentations, rares à l'Ancien Empire10,illustrent parfaitement ce texte. Chez Mererouka11, tout commencepar les femmes qui se lamentent, lèvent les bras, et s'arrachent lescheveux. L'une d'elle est contenue par deux autres qui l'entourent
8. AnLex 1, p. 14,77.0140-2.9. Référence à la liste de signes de A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1957. Les
signes proviennent de la tombe de Ti, noble de la Ve dynastie, à Saqqara (paléographie de l'auteur)et des textes des pyramides.
10. Y. Harpur, Decoration in Egyptian Tombs of the Old Kingdom - Studies in Orientation andScene Content, London, 1987, p. 113.
11. P. Duell et al.. The Mastaba of Mereruka II, The University of Chicago Oriental InstitutePublications XXXIX, 1938, pi. 130-1.
1568 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
& J
FlG. 1. - a. Signe D3 de la mèche de cheveux (Tombeau de Ti - dessin de l'auteur),b. Écriture de jjkb, « tristesse, deuil, lamentation » dans les Textes des
Pyramides avec jeu graphique du déterminatif (Pyr. 829c, 1009a,1978a).
de leurs bras, et essayent, d'un geste de la main sur la tête, de laconsoler, comme on ferait pour un enfant (fig. 2a). À la fin ducortège funéraire, devant la tombe, des femmes claquent des mainspendant que des hommes dansent, les bras refermés sur leur tête. Lachevelure que l'on s'arrache est par excellence le symbole dudésarroi, de la douleur, de la tristesse, chez les hommes et lesfemmes, comme en atteste une scène de deuil au tombeau d'Idou(fig. 2b)12. Ce désordre est le signe de la rupture qu'introduisentdeuil et tristesse dans la vie de l'homme. Il marque l'inversion devaleurs positives, jugées bonnes par l'Égyptien : à l'homme assissur un siège, serein, parfaitement coiffé s'opposent l'agitation et lachevelure défaite des pleureurs et pleureuses.
Larmes et plaintes, autres aspects de la tristesse
Rmj, rmw, rmjtn, « pleurer, pleurs, larmes », tous déterminés dansles Textes des Pyramides par le même signe avec une grande variétépaléographique : un œil dont deux ou quatre larmes s'écoulent (fig. 3).Du registre de la tristesse, c'est le mot le plus cité dans ce corpus. Ilest intéressant à cet égard de remarquer que dans les représentations
12. W. K. Simpson, The Mastabas of Qar and Idu, Giza Mastabas 2, Boston, 1976, fig. 35,pi. XIX.
13. AnLex I, p. 215, 77.2368-70.
IOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1569
Fig. 2. - a. Scène de deuil à l'Ancien Empire, dans le tombeau de Mererouka(P. Duell et al., The Mastaba of Mereruka II, The University of ChicagoOriental Institute Publications XXXIX, 1938, détail de la pi. 131).
b. ScènededeuilàrAncienEmpire,dansletombeaudTdou(W. K. Simpson,The Mastabas ofQar and Idu, Giza Mastabas 2, Boston, 1976, détail dela fig. 35).
fi nFig. 3. - Variantes paléographiques du signe de l'œil pleurant, déterminatifs de rmj,
rmw, rmjt, « pleurer, pleurs, larmes » (Pyramide d'Ounas, AN3, FS31, AW34 -clichés G. Pollin).
de deuil de cette époque, le visage reste globalement impassible, et leslarmes semblent invisibles, pour autant qu'on puisse en juger sur lesbas-reliefs dont les détails peints sont perdus. Peut-être y figuraient-elles, comme sur les représentations de la tombe de Ramose, auNouvel Empire. Quoi qu'il en soit, l'écriture et les textes reviennentconstamment sur les larmes. L'importance de ces dernières permet
1570 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
peut-être d'avancer une interprétation du terme nhrhr14, mot rare serapportant au visage et que l'on traduit par « être triste »15. Nhr16signifiant « fleuve », on pourrait voir dans la réduplication hr ennhrhr l'évocation d'un visage ravagé de larmes, d'autant que l'échoavec le mot pour « visage », hr, est puissant et suggère par onomatopée, un flot de sanglots, de pleurs. « Nhrhr hr-k », comme dit letexte, voudrait alors dire : « ton visage est inondé de larmes ».
LA PLAINTE, LA LAMENTATION, LE CRI
Dernière expression de la tristesse : la plainte, la lamentation, lecri. Pour ce registre, l'Égyptien dispose d'une large palette determes :
- //y7, un cri bref, issu de l'interjection hy et dont est tiré l'un desnoms des pleureuses18, désigne la souffrance, la douleur ;
- Jww19, cri de détresse, onomatopée, sorte de sanglot ;- Sbh20, cri de souffrance, appel guttural, à rapprocher peut-être
du cri d'un oiseau dont c'est aussi le nom21.
À cela s'ajoutent lamentations en se frappant la poitrine, jk22et invocations, dsw2i. À noter que jk signifie aussi « s'agripper,saisir »24 et correspond parfaitement à cette impossibilité de sedétacher du sujet de la tristesse, comme l'illustre bien la légende despleureurs et des pleureuses d'Idou : « Ô mon maître, prends-moi
Ces cinq termes utilisés dans les Textes des Pyramides sont tousaccompagnés de signes déterminatifs humains correspondant à lagestuelle que l'on retrouve dans les scènes de deuil (fig. 4) :
- bras levés, mains au ciel (jw, hjj) ;- bras levés, mains tournées vers l'extérieur (hjj) ;
14. Wb. II, p. 313, 1 ; AnLex I, p. 198,77.2182.15. Pyr. 644d (Téti et Pépi II). Ce mot n'est attesté que dans les Textes des Pyramides.16. AnLexl,p. 198,77.2181.17. FCD, p. 160.18. hyt (AnLex I, p. 234,77.2551 ).19. AnLex ni, p. 12, 79.0122.20. AnLexl, p. 316,77.23504-5.21. Wb. IV, p. 91, 8 et I. Vandier, Manuel d'archéologie égyptienne III, Paris, 1958, pi. XXIII,
fig. 178B (bas-relief de Manefer).22. AnLex II, p. 52, 78.0520.23. AnLex II, p. 445, 78.4957.24. AnLexll, p. 52, 78.0521.25. J nb=j ! Jt n=k wj ! (W. K. Simpson, op. cit. [n. 12], fig. 35 et p. 22).
IOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1571
\ £ L - f
FlG. 4. - Tristesse figurée par les signes déterminatifs(Pyr. 550b, 872a, 1004d, 2112a, 2117).
- un bras levé, l'autre abandonné (sbh) ;- un bras levé, l'autre frappant la poitrine (jkj) ;- les deux bras embrassant le vide (hjj).
Un seul signe, celui de l'homme portant la main à la bouche, serapporte directement à l'aspect vocal de la lamentation, et seulementpour le terme sbh.
Les textes mêlent ces expressions de deuil :- « Pleurez-le, heurtez votre poitrine (à cause de) lui, criez de
détresse (vers) lui » (Pyr. 550b)26 ;- « Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, les smtt
crient pour toi, le grand pieu d'amarrage lance des invocations pourtoi... » (Pyr. 1365c, 1366a)27 ;
26. Rmy sw, jkj sw, hjj sw. Les déterminatifs éloquents nous permettent de traduire plus précisément que « crier » ou « se lamenter ». A noter cependant que ces trois verbes sont construits enégyptien de façon directe, illustrant trois façons de pleurer le défunt.
27. Rm n=kp.t sdj n=k ty sbh n=k smntt dsw n=k mnj.t wr.t. Ici la structure est une accumulation d'actions réalisées et rythmées par n=k, « pour toi ».
1572 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
- « Ils viennent vers cet Osiris, à la voix des pleurs d'Isis, descris de Nephthys, des lamentations de ces deux esprits... » (Pyr.1973b-c)28.
Pour cette époque, il existe donc un terme général désignant latristesse en terme d'abattement, jqmw, et renvoyant au ressenti del'émotion. En revanche, plusieurs termes renvoient à l'expressionde l'émotion : de façon générale jjkb (opposé au rire de la joie),évoque un comportement désordonné, cheveux arrachés, pleurs etcris. Rmjt désigne les larmes, hj, jww et sbh différents cris, jk etdsw des lamentations correspondant à une gestuelle précise. Lessignes utilisés pour accompagner ces termes représentent tous uneexpression de la tristesse chez l'homme par le corps, que ce soitla gestuelle ou la voix. La représentation du deuil laisse libre coursà ce débordement d'émotion, soulignant le désordre des comportements. Textes, mots et représentations s'attachent essentiellement àcette époque à une description des attitudes, des expressions de latristesse.
Après l'Ancien Empire, le lexique de la tristesse, enrichi, recouvreun peu moins d'une vingtaine de termes29. Parmi les lexemes exprimant la tristesse et déjà vus dans les Textes des Pyramides, on trouveencore dsw, hyj, jjkb et rmj. S'y ajoute une expression pour « êtretriste » décrivant une position de détresse, tp-mjsti0, littéralement« tête (sur) genou ». Si l'on retrouve le terme général de jqmw sousla forme qmw21 pour « tristesse » et nqmt « affliction »32, termedont nous avons vu qu'il évoquait une certaine torpeur, apathie, levocabulaire pour exprimer le ressenti de la tristesse s'est enrichid'autres mots dont nous allons préciser les nuances :
28. Jw=sn n Wsjr N. hr hrw rmm Js.t hr sbh Nb.t-hw.t hr jw.w jh.ty jptw.29. 3hw, « chagrin, tristesse, souffrance » (FCD, p. 3 ; AnLex I, p. 6, 77.0061) ; jjkb, « deuil,
lamentation » (FCD, p. 9) ; jw, « se lamenter » (FCD, p. 12) ; jnd, « être affligé » (FCD, p. 24 ;AnLex I, p. 35,77.0362) ; jqmw I qmw, « tristesse, affliction » (Wb. I, p. 136,18 ; AnLex II, p. 389,78.4292) ; mgj, « être triste » (FCD,p. 120 ;AnLexl,p. 175,77.1914) ; nhp, « plaindre quelqu'un,se lamenter » (FCD, p. 135 ; AnLex I, p. 195,77.2139) ; nhj-jb I nh)t-jb, « triste / tristesse » (FCD,p. 136) ; nhrhr, « être triste » (Wb. II, p. 313, 1) ; nqm I nqmt, « souffrir, être affligé / affliction »(FCD, p. 141) ; rmj, « pleurer » (FCD, p. 149) ; hjj, « se lamenter, gémir » (FCD, p. 160) ; hb,« pleurer quelqu'un » (FCD, p. 167 ; AnLex I, p. 242, 77.2648) ; sbh, « crier » (FCD, p. 220) ;snm, « être triste » (FCD, p. 232) ; gmw, « deuil, lamentation » (FCD, p. 289) ; tp-mjst, « êtretriste », lit. « tête (sur) genou » (Wb. V, p. 285,6-7) ; dwt, « tristesse », lit. « mal » (FCD, p. 320) ;dsw, « appeler, invoquer » (FCD, p. 324).
30. Wb. V,p. 285, 1.6.31. AnLex II, p. 390, 78.4292.32. FCD, p. 141.
IOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1573
- ̂ /jw33, mgf4, évoquent une sensation de vide, de manque, dans lamesure où jh m35 signifie « manquer de » et m gjw36 « en manque » ;
- snm?1, qui signifie aussi une « pluie torrentielle »38, exprime lasensation d'être submergé, rappelant nhrhr dont on a vu qu'il estpeut-être dérivé de nhr, « fleuve » ;
- jnd19, à rapprocher de jndw « sac »40,etjntt,« liens »41, suggèrela sensation d'être noué, ligoté ;
- gmw42 évoque la sensation d'être brisé, que l'on retrouve dansle terme rédupliqué, gmgm4i, signifiant « réduire en poudre, briser » ;
- nhjt-jb44, nhy45 étant un terme appliqué aux tempêtes terribles,traduit la sensation d'être dévasté ;
- nhp46, « plaindre quelqu'un, se lamenter », exprime la compassion.
Dévasté, brisé, submergé, noué, vidé, accablé... Une descriptionprécise des états de la tristesse accompagnée de signes non moinsexplicites.
Le plus fréquent est le signe du moineau, marqueur négatif parexcellence (fig. 5a). En effet, l'oiseau grégaire, par son comportement vorace, est un véritable fléau pour le paysan. Aussi est-ildevenu le signe de la petitesse, de la méchanceté, de la nuisance,voire de tout ce qui est négatif47. Il intervient après huit termes pourla tristesse48.
Le signe de l'animal séthien (fig. 5b), signe de désordre, se trouveaprès deux termes pour « être triste », nqm et jnd. Son mélange detraits inspirés de divers animaux dont l'oryctérope et le phacochère,animaux destructeurs et imprévisibles pour l'homme, en fait une
33. « Chagrin, tristesse, souffrance », AnLex I, p. 6, 77. 0061 ; FCD, p. 3.34. « Être triste » (ou m gyw ?) cf. AnLex I, p. 175,77.1914.35. AnLex I, p. 6, 77. 0060.36. AnLex I, p. 175, 77. 1914.37. « Être triste », AnLex III, p. 332, 78.3615.38. Wb.YV.p. 165,11.39. « Être affligé », AnLex I, p. 35, 77. 0362, et jnd, « be afflicted », FCD, p. 24.40. AnLex I, p. 35, 77.0363 ; AnLex II, p. 37, 78.03~89.41. AnLex I, p. 35, 77.0360.42. « Mourning », FCD, p. 289.43. AnLex III, p. 314, 79.3289.44. « Sadness », FCD, p. 136.45. « Terrible, dangereux », AnLex III, p. 152, 79.1583.46. AnLex l, p. 195,77.2137.47. A. David, De l'infériorité à la perturbation - L'oiseau du « mal » et la catégorisation en
Egypte ancienne, Gôttinger Orientforschungen IV. Reihe Àgypten 38, 2000 ; P. F. Houlihan, TheBirds of Ancient Egypt, Warminster, 1986, p. 136 ; P. Vermis et J. Yoyotte, Bestiaire des Pharaons,Paris, 2005, p. 397.
48. Signe classificateur tie jhw, jnd, nhp-jb, nqmt, hyj, snm, gmw, dwt-jb.
1574 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
FlG. 5. - Signes déterminatifs de la tristesse après l'Ancien Empire : a. le moineau,G37 (Tombeau de Ti) ; b. l'animal séthien, E21 (Tombeau de Meresankh- dessins de l'auteur) ; c. l'homme accablé, A7 (dessin E. Majerus) ; d. l'hommelevant les bras au ciel, A28 ; e. l'homme portant la main à la bouche, A2 (chapellede Sésostris Ier à Karnak - clichés A. Chéné).
créature néfaste, signe de bouleversement et de confusion. Dieu desdéserts, de la tempête et du désordre, Seth incarne les forces destructrices du chaos. Sa présence comme signe classificateur est doncperçue comme largement négative49.
Le signe de l'homme accablé baissant les bras se rencontre aprèsgmw et ngj renvoyant aux sensations de vide et de destruction(«g. 5c).
Enfin le signe de l'homme levant les bras au ciel, que l'on trouveaprès hjj, et celui de l'homme portant la main à la bouche, utiliséavec nqmt mais aussi après jjkb, nhp, sbh et jww, renvoient à lagestuelle et l'expression vocale de la tristesse dans le registre de lalamentation (fig. 5d-e).
49. A. I. McDonald, Animal Metaphor in the Egyptian Determinative System - Three casestudies, PhD thesis, Oxford Univ., Trinity, 2000, ch. 2 ; N. Beaux, « Signes animaux, expressionsdu divin en Egypte ancienne », dans Créatures mythiques animales. Écriture et signes figuratifs,N. Beaux et X. Li éd., You Feng, Paris, 2013, p. 166-170.
IOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1575
Au registre lexical décrivant l'expression de la tristesse à l'AncienEmpire s'ajoute maintenant un large éventail de termes pour décrirele ressenti de cette émotion, de façon subtile. La tristesse est de plusclairement classée comme négative, soit par l'emploi de signesayant cette signification (signes du moineau ou de l'animal séthien),soit par le terme de dw.t qui, de « mal » en général, prend la connotation de « tristesse » dans l'expression dw.t-jb, lit. « mal de cœur »pour « tristesse »50, s'opposant à rsw.t, « la joie ». Enfin dans lesreprésentations de deuil, par exemple dans la tombe thébaine deRamose (7T55), au Nouvel Empire, on note que l'expression dudeuil, globalement plus ordonnée, se restreint aux bras levés et auxlarmes (fig. 6a). De même que les mots de la tristesse portent maintenant la marque du « mal », de même la représentation du deuilélague les débordements dont elle autorise seulement l'expressionrestreinte et codée, s'ordonnant désormais harmonieusement, dansun effort pour nommer et dominer ce mal, ce désordre. Reste à savoirsi pour autant, dans l'Egypte de cette époque, une certaine retenueremplaçait effectivement l'expression spontanée de la tristesse. Pourtenter de cerner cela, reprenons bas-reliefs et peintures et scrutonsles visages.
À l'Ancien Empire, dans les représentations de deuil, on estfrappé par l'absence d'expressions de tristesse sur les visages. C'estle corps, et non le visage, qui, avec une certaine liberté dans sonintensité comme dans ses mouvements, révèle la tristesse par unegestuelle que l'on retrouve dans les signes. Gestuelle de la rupture,du désordre, passant de l'abattement à l'hystérie collective extériorisant la douleur par des cris que l'on devine, l'auto-meurtrissurephysique (les cheveux qu'on arrache) et les larmes. Mais les visagesdemeurent identiques, impassibles, et les bouches fermées.
Lorsqu'au Nouvel Empire, on assiste à une harmonisation et unerestriction de la gestuelle du deuil, les visages demeurent impassibles, les bouches fermées. Seules les larmes, expression convenuede l'émotion, sont figurées. Cependant, dans ce « beau » tableauaux visages presque sereins, il peut surgir une exception, commecette moue d'amertume d'une pleureuse (fig. 6b). Se peut-il qu'il yait eu une évolution vers une plus grande intériorité du sentiment,comme semble le souligner l'apparition de nombreux termes décrivant le ressenti de la « tristesse », et l'expression plus maîtrisée,
50. Wb. V,p. 548, 15.
1576 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
■3 * £ y F g < ! t a l I i U N 1
^r
FlG. 6. - Scènes de deuil au Nouvel Empire, dans la tombe de Ramose(7T55 - clichés N. Grimai).
I
plus restreinte du corps (en tout cas dans les représentations) ? Cetteintériorité laisse-t-elle plus de place à la sensibilité individuelle,intime, autorisant à manifester l'expression de son émotion sur sonvisage ?
Effectivement, après l'époque amarnienne, si l'on demeure attentifà l'harmonie de la composition, à la beauté des sujets, les bouchess'ouvrent et gémissent, une certaine spontanéité de l'expressionsurgit, comme la main sur le sarcophage, tentant de retenir le défunt ;une précision du geste, toujours limité, est permise : c'est bien de lapoussière grise qui est jetée sur la tête (fig. 7a). Plus on avance versl'époque ramesside, plus la dynamique de l'émotion, son agitation(fig. 7b) et ses effets destructeurs s'affichent avec réalisme (fig. 7c) :les gestes sont les mêmes, mais au lieu d'être comme arrêtés et figésdans l'instant, la fluidité du trait les met en mouvement. La laideur,l'abandon du corps, le sein affaissé, le maquillage qui coule sousl'effet des larmes traduisent l'horreur de la tristesse. Ici l'expressionde la laideur, du laisser-aller permet de « marquer » du sceau du mal,la tristesse et le deuil, comme la beauté et l'harmonisation des scènesde deuil avaient tenté de le maîtriser, de le canaliser. Dans les deuxcas, la tristesse est jugée mauvaise, et le mode de représentationtraduit ce jugement : dans un premier temps en étouffant et camouflant l'émotion qui gêne, dans un second temps en laissant surgir parcoups de pinceaux quelques traits de l'expression, traits qui ne sont làque pour souligner la laideur et le désordre de l'émotion condamnée.
IOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1577
FlG. 7. - Scènes de deuil après l'époque amarnienne(TT181, TT51, TT45 - dessins E. Majerus).
Restent les larmes... pont entre ces diverses approches : dans lesreprésentations de Ramose, pas de bouches hurlantes mais des larmescoulant d'un œil parfaitement maquillé, joliment cerné de noir. ChezDjehoutemheb, la larme se mêle au noir du kfiôl et laisse une longuetrainee noire sur la joue, jusqu'à la bouche gémissante, entrouverte.La larme est une émanation partant de l'intimité profonde de l'êtrevers l'extérieur, elle permet l'extériorisation de l'émotion, la révèlepubliquement et sans pudeur. Elle est peut-être précisément le lienentre l'expression contenue de la tristesse par le corps, faite à l'imagedu désir de la société d'ordonner ce désordre, et la suggestion, sur levisage, des tourments individuels et profondément intimes de la tristesse. Les Égyptiens étaient réellement conscients de l'importancedes larmes, eux qui écrivaient, à la faveur d'un jeu de mots entre rmt,« humanité », et rmj, « pleurer » que l'humanité était née des larmesmêmes de Rê : « J'ai créé les dieux de ma sueur, et les hommes deslarmes de mes yeux » (CT VII, 464g-565a)51 dit le démiurge.
Tournons-nous maintenant vers la joie telle qu'elle est désignée,exprimée, représentée en Egypte ancienne.
51. E. Otto, Fragen an die altàgyptische Literatur (eds. J. Assmann, E. Feucht, R. Grieshammer),Wiesbaden, 1977, p. 9.
1578 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
Joie52
Nous partons à nouveau du corpus des Textes des Pyramides.Environ seize termes évoquent la joie, son ressenti et ses expressionsdont il convient de préciser les nuances. L'abondance de formesrédupliquées pour plus d'un tiers de ces mots souligne sans aucundoute l'emphase liée à la joie : rsrs51, nhnh, nhrhr, nhmhm, trwrw,nthth.
L'expression la plus employée pour la joie est celle d'jw.t-jb54.Elle désigne une expansion, une dilatation du cœur, un cœur « gonfléde joie ». Elle dévoile donc l'effet de la joie, son ressenti. La joieélève le cœur, elle le « soulève », le « porte », comme l'indiquelittéralement wtsjb55, « jubiler ».
Deux autres termes nous permettent d'affiner l'essence de la joie :« se réjouir, se délecter » trwrw56, ainsi que « se réjouir, être serein,se calmer » hrw51, et, proche de cette notion de sérénité, l'expressionwdy-jb5i, « avoir le cœur joyeux », lit. « sain, prospère » marquant laplénitude. Sérénité, plénitude, délectation, ou encore plaisir engendrépar la joie, comme l'évoquent les nombreux dérivés de ndm59, « êtredoux, agréable », comme la gousse d'acacia qui en est le signe, et quidonne ndm-jb, « joyeux », lit. « avoir le cœur adouci », ou encore leterme jmf°, « doux, plaisant, charmant », engendrant jmj-jb,« joyeux », lit. « avoir le cœur charmé », qui renvoie à un ravissement olfactif, celui du doux parfum de l'œil d'Horus.
La joie peut être aussi modulée en fonction du rapport entre celuiqui l'éprouve et celui qui la provoque. Aussi nhnh6X, « se réjouir »,dérive-t-il sans doute de nlf1, « protéger », et exprime-t-il la joie du
52. Une thèse sur la joie (« Modes et domaines d'expression de la joie au quotidien en Egypteancienne ») a été soutenue en 2008 par Cédric Gobeil à l'Université de la Sorbonne (Paris IV). Il n'apas été possible de consulter cette thèse qui n'est pas publiée.
53. Pyr. 2127b, seule attestation dans les TdP.54. AnLex I, p. 2, 77.0019. Une trentaine de textes des TdP l'emploie.55. « Jubiler », Wb. 1, p. 383, 12. Pyr. 118a.56. Wb. V, p. 387,4 ; AnLex I, p. 428, 77.4953. Pyr. 453b.57. Wb. II, p. 496, 11-12 ; AnLex II, p. 232,78.2510. Pyr. 415a.58. FCD, p. 74. Pyr. 1198-9, 1444-8.59. Pyr. 293a, 707c. Ndm-jb, « joyeux, heureux, plaisant » (FCD, p. 144 ; AnLexlïl, p. 163,
79.1692), sndm ou encore ndmmt, « orgasme », comme l'indique le signe déterminatif du phalluséjaculant (Pyr. 1248c) ; on note là-aussi la répétition de la consonne finale, marque emphatique.
60. Pyr. 1802b-1803b. Wb. I, p. 79,17-23.61. Wb. II, p. 312, 11.62. AnLex II, p. 203, 78.2190.
JOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1579
cœur (nhnhjb) de la déesse protectrice de Haute-Egypte lorsqu'ellevoit le roi, son protégé, s'élever dans le ciel63. La joie ressentie dansle cœur des dieux vient aussi de la reconnaissance du roi défuntcomme l'un des leurs, dans un effet miroir, d'où le terme de nhrhr64,« se réjouir », à rapprocher de nhr, « ressembler à »65 :
« Une porte dans le ciel s'ouvre pour toi à l'horizon,et c'est à ta rencontre que le cœur des dieux se réjouit. »
Ici le signe de l'homme levant la main au ciel, et l'écriture denh(r)hr avec le signe de la pintade permet une double lecture : nh66première syllabe de nh(r)hr, signifie « invoquer », comme le cripuissant de la pintade au soleil levant67 (fig. 8). Aussi Y expressionpar le cri et la gestuelle de l'émotion est-elle ajoutée, par l'imageportée dans les signes, au texte qui décrit seulement par nh(r)hr lajoie ressentie par les dieux.
Les expressions de la joie, comportements découlant de l'excitation (intérieure) de la joie, sont également décrites par des termesprécis.
La joie s'exprime par des cris, /y68, « jubiler », proche de l'interjection que les textes opposent volontiers à la tristesse et à seslarmes. Ce mot est d'ailleurs accompagné du signe d'un hommelevant un bras, de même que nhrhr. Jrj hj signifie « faire des hj,faire de la musique », il s'agit donc bien du domaine sonore.
Autre terme appartenant au registre acoustique, mais soulignantun volume sonore puissant, nhm69, « se réjouir, pousser des cris dejoie », qui signifie aussi « jouer du tambourin » et sa forme dupliquée, nhmhm10, « tonner, gronder (de joie) », le terme s'employantpour le ciel qui tonne ou gronde, le lion qui rugit.
Enfin, toujours dans le champ sonore, mais lié à une gestuelleprécise, le terme hnw7i, « jubiler, ovationner ».
63. Pyr. 1107b.64. Wb. I,p.299, 1.65. Pyr. 779b, 1720b.66. AnLex I, p. 196.67. N. Beaux, « La pintade, le soleil et l'éternité - À propos du signe G 21 », Bulletin de
l'Institut Français d'Archéologie Orientale 104, 2004, p. 21-38.68. Pyr. 316c, 700a. Wb. II, p. 483, 1-7.69. Pyr. 1150a, 111lb. AnLex 111, p. 151,79.1575.70. Pyr. 163c, 1120b, 1150c, 1394c, 1561d.AnLexlll.p. 151,79.1577.71. Pyr. 500c, 687d, 842c, 897d, 1422c, 1430e. Wb. II, p. 493, 15-22.
15 80 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
^ 7 \ M* fil \A"fB& J» c=>
x-. "A T=T ^ P J * n 4-= > % ^
a.
ï. ^— il IXV.*îfl VI* *^7V
JU.'for .*m Xe>Pf ^C7\
Jf:-4é
x ^ ^ t n V >r? ^ 7 V
& 4 W
FlG. 8. - « Se réjouir » (/>. 799ab).
Le rire, sor72, est aussi une expression de joie, il est déterminé parle signe du nez ou du visage tendu en avant, comme l'est nthth11,« sourire », dont la racine, thw14, est un des mots pour « joie ».
Une autre expression de la joie est l'éclat qu'elle donne au visage,éclat semblable, pour les Égyptiens, à celui de la faïence, thnt15, dontsont dérivés deux verbes, thnlb, « réjouir », etthnn11, « se réjouir »,à comprendre comme « rayonner de joie », image parfois aussiévoqué par h d hrn, « avoir le visage lumineux (de joie) ».
Enfin citons le mot h'f9, « se réjouir, jubiler » et h"w.f°, « laliesse », qui est, avec jw.t-jb, le mot le plus employé pour la joie81.Ce mot porte souvent, comme déterminatif, le signe de l'homme auxbras levés, les mains dans une position variable, notant une attituded'excitation qui est généralement exprimée par le corps, par des
72. Pyr. 1149a, 1554a. FCD, p. 221.73. Pyr. 1149a. Wb. II, p. 366,17.74. Wb. V, p. 389, 6.75. AnLex II, p. 424, 78.4707. Ce nom de la faïence est aussi utilisé pour désigner « la joie ».
La racine thn signifie « être lumineux, éclatant » (AnLex II, p. 425, 78.4708).76. AnLex II, p. 425, 78.4709.77. Pyr. 561d. Wb. V, p. 395, 2.78. Pyr. 1554b. Wb. IV, p. 225, 18.79. AnLex III, p. 187,79.1901.80. Ibidem, 79.1902.81. Une vingtaine d'attestations dans les Textes des Pyramides.
JOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1581
gestes, ou des cris... H'j, « se réjouir », peut s'accompagner demanifestations de tendresse, d'amour :
« (Le dieu) se réjouit à ta rencontre, il te prend dans ses bras, il t'embrasseet te caresse... »82
H'j peut même exprimer une excitation sexuelle féminine, commeplusieurs textes en témoignent en décrivant la déesse Isis (ou Nout)s'approchant, « réjouie de l'amour du dieu », avant de se donner àlui83.
Plus de la moitié des mots relatifs à la joie ne sont pas accompagnés de signe déterminatif. Lorsqu'ils le sont, il s'agit de signes debras levés, les mains dans différentes directions, et des signes du nezou du visage, utilisés uniquement pour le verbe « rire » (fig. 9). Lesigne le plus employé est certainement celui que nous avons déjàrencontré pour la tristesse, celui de l'homme debout, les bras levésau ciel (A28), et ses variantes.
L'évocation de la joie se joue donc sur une large palette : l'Égyptien disposait de termes permettant d'exprimer largement un ressenti,allant de la profonde sérénité à la délectation, voire au plaisir, et setraduisant par une sensation intérieure de dilatation ou d'élévationdu cœur. Cette joie, communicative par essence, il la manifestaitlibrement par des cris allant jusqu'aux hurlements, lorsqu'il « tonnaitde joie », ou par des gestes, levant les bras au ciel, extatique ougesticulant. Le visage traduisait à lui seul par son éclat (lumineux),ou par le rire et le sourire ce bonheur intérieur.
Les textes mettent toujours en évidence une rencontre84, unéchange, à la source de cette joie, l'amour qui engendre baisers etcaresses85, la restauration d'une intégrité perdue (Horus retrouvantson œil intact)86 ou la simple et lumineuse contemplation du lever dusoleil87. La joie est donc ouverture et partage, naturel, humain oudivin.
82. Pyr. 656a-b.83. Pyr. 632a, 1426a, 1635b, 1787.84. />.1246b-c.85. Pyr. 656a-b.86. Pyr. 977a-d.87. Pyr. 923a-b.
1582 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
FlG. 9. - Signes déterminatifs de la joie dans les Textes des Pyramides (Pyr. 632a,656a, 659b, 700a, 799b, 1149a, 1233c).
Le vocabulaire de la joie, déjà très riche à l'Ancien Empire, s'épanouit encore par la suite. On compte désormais une quarantaine determes pour ce registre88.
88. jwt-jb, « joie », sywj, « réjouir » (FCD, p. 1 ; Wb. IV, 17,2-7 ; AnLex I, p. 303, 77.3340) ;jms-jb, « se réjouir » (Wb. I, p. 11, 7 ; AnLex 1, p. 6, 77.0054) ; jhhj, « jubilation, cris de joie »(AnLex I, p. 41, 77.0417) ; wjg, « jubiler » (Wb. I, 262, 18) ; wnf, « se réjouir » (AnLex II, p. 97,78.0986) ; bjbj, « jubiler » (Wb. I, p. 442, 9) ; njm, « se réjouir » (Wb. U, p. 203, 6 ; AnLex I,p. 183,77.1993) ; nhm, « la joie »,nhm, « se réjouir, pousser des cris de joie » (AnLex III, p. 151,79.1575-6) ; nhn, « se réjouir » (Wb. U, 297, 12) ; nhrhr, « se réjouir » (Wb. II, 299, 1) ; ndm-jb,« joie », lit. « avoir le cœur adouci », sndm, « réjouir, satisfaire » (AnLex III, p. 163, 79.1692 ;Wb. IV, p. 186,12-17 ; AnLex II, p. 336,783655) ;rnn,« se réjouir » (AnLex m, p. 171,79.1759) ;rSw, « se réjouir », rSwt, « la joie » (AnLex III, p. 174, 79.1790-1) ; rSrS, « la joie » (AnLex III,p. 174, 79.1792) ; hj, « jubilation » (AnLex UT, p. 178, 79.1820) ; hnw, « jubilation » (AnLex III,p. 179, 79.1832) ; hrw, « se réjouir, être calme » (AnLexlll, p. 179, 79.1835) ; htt, « exulter »(Wb. II, p. 504, 7-12) ; h}g, « être joyeux » (FCD, p. 163) ; lygjg, « se réjouir » (FCD, p. 163) ;h'j, « se réjouir » (AnLex III, p. 187,79.1901) ; h"wt, « liesse » (AnLex III, p. 187,79.1902) ; hbj,« être en fête » (AnLexlll, p. 189, 79.1926) ; hkn, « être joyeux » (FCD, p. 178) ; hnm, « êtrejoyeux, se réjouir » (FCD, p. 192-3) ; hnty-jb, « avoir le cœur joyeux » (FCD, p. 194) ; hntS, « êtrejoyeux » (FCD, p. 195) ; sbt, « rire » (FCD, p. 221) ; snfr-jb, « réjouir », lit. « rendre le cœurparfait » (FCD, p. 232 ; AnLexlll, p. 258, 79.2619) ; shd-hr, « rendre joyeux », lit. « éclairer levisage » (FCD, p. 239) ; shmh-jb, « joie » (FCD, p. 241 j ; tpnpn, « se réjouir » (Wb. V, p. 364, 8 ;
JOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1583
Cela va de la simple réjouissance89 à la jubilation90, voire l'exultation91 ou l'adoration (htt).
Ce degré d'émotion est parfois noté dans la structure même dumot, par simple réduplication du radical entier (rsrs < rs, hjgjg <hjg) ou partiel (h"w < h"j ; thh < thw), ou par ajout d'une finaleintensive (shmh < shm).
Les nuances s'affinent encore dans le ressenti de la joie :C'est d'abord une respiration ample, presque un ravissement
olfactif que décrit hnm, qui signifie aussi « respirer un parfumagréable »92, un bien-être semblable à une caresse, évoqué par rnn,« caresser, dorloter, élever comme une nourrice »93, une sensationd'amour, comme jms-jb, mot tout entier présent dans la tendresse dudéterminatif de la vache dont la tête est tournée vers son veau. Lecœur ressent diversement les effets de la joie : il se sent libre, délié,comme l'exprime wnf-jb, avec le déterminatif de la boucle défaite(wnf signifie « délier »94), il bat violemment, comme le décrithnt-jb, à rapprocher de /m95, « battre des mains », il chante, shmh-jb,comme le sistre shm96, en un mot, il s'embellit, atteint la perfection :snfr-jb.
L'expression de la joie est, elle aussi, évoquée par plusieurs motsproches d'onomatopées : hj, jhhj. Elle va jusqu'à l'éclat de joie,hnw, terme qui est également utilisé pour signifier « pousser dehauts cris » dans la liesse comme dans l'affliction. La joie est synonyme de « fête » comme le mot wyg97, « fête », signifiant aussi « seréjouir », nous l'indique, ou encore hbj, « être en fête » et hb,« fête »98.
Certains mots, hkn, nhn, ont évolué ; exprimant initialement l'invocation, la prière, la louange, ils évoquent désormais l'émotion dejoie que cette action suscite. Le degré d'extase dans la joie, enfin,est tout entier présent dans l'évocation des babouins adorateurs du
AnLex II, p. 421, 78.4664) ; trwrw, « se réjouir » (Wb. V, p. 387, 4) ; thw, « se réjouir » (FCD,p. 306) ; thn, « réjouir » (AnLex II, p. 425, 78.4709) ; thnn, « se réjouir"» (Wb. V, p. 395, 8) ; thh,« exulter » (FCD, p. 307).
89. jwt-jb, wnf, ndm-jb, rS, hjg, h 'j, hnm, hnty-jb, hntS, snfr-jb, shd-hr, shmh-jb, thw.90. bjbj, nhn, rnn, rSrS, hy, hnw, hjgjg, h"w, hkn.91. jhhj, wyg, nhm, thh.92. AnLex I, p. 279,"77.3094.93. FCD, p. 150.94. AnLex II, p. 97, 77.0986.95. FCD, p. 192.96. AnLexlll, p. 268, 79.2731, ou à rapprocher de shmh, « se divertir » (AnLexlll, p. 268,
79.2734).97. FCD, p. 55.98. AnLexlll, p. 189,79.1924.
1584 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
soleil levant, les mains levées vers lui. C'est le nom et l'image deces singes, htt, qui signifie, à partir de la XVIIIe dynastie, « seréjouir ».
Comme on l'avait noté pour la tristesse après l'Ancien Empire,les mots du registre de la joie apparaissent désormais le plus souventaccompagnés d'un déterminatif, d'un signe classant le lexeme et parlà même ce à quoi il réfère. Ce sont essentiellement des signeshumains qui sont employés pour classer les mots relatifs à la joie(fig. 10). Le plus fréquent est celui de l'homme portant la main à labouche (A2), et dans une moindre mesure celui de l'homme levantles bras au ciel (A28). Nous avons déjà rencontré ces deux signesdans le lexique de la tristesse, ils y soulignent la manifestationsonore et la gestuelle liées à l'excitation, ici issue de la joie. Pluspropre à la joie est le signe de l'homme dansant (A32), semblableaux positions que l'on observe chez les danseurs de Mérérouka parexemple. Enfin le signe du nez (D19) marque l'importance du visagepour le ressenti (olfactif) de la joie et peut-être, de façon plus générale, dans son expression. À ces signes utilisés pour plusieurs mots,on peut rajouter ceux que l'on vient d'évoquer et dont l'emploi estspécifique et se réduit à un seul mot, celui de la vache tournée versson veau (E5), celui de la boucle défaite (VI2) ou du tissage, et enfincelui du babouin dressé sur ses pattes arrières, paumes levées vers lesoleil (E51).
Les représentations de la joie sont, à dire vrai, assez difficiles àidentifier. Les visages semblent toujours entre impassibilité et sérénité, quelles que soient les circonstances, un très léger sourire étantparfois discerné. Seuls les contextes invitent à considérer certainesscènes comme appartenant au registre de la joie : ce sont les scènesde musique et de danse99, de jeux et celles de récompense100.
Danses et battements de mains101 rappellent les danses funèbresdevant le tombeau de Mererouka, mais la danse, cette fois-ci, se faiten l'honneur de la déesse à l'éclat incomparable, celle qui brillecomme l'or, Hathor, déesse de l'amour, de la joie, de la danse et de
99. P. Duell et al., op. cit. (n. 11), pi. 86 ; W. K. Simpson, op. cit. (n. 12), fig. 38.100. T. El-Awady, Sahure - The Pyramid Causeway - History and Decoration Program in the
Old Kingdom, Abusir XVI, Prague, 2009, pi. 7.101. P. Duell et al., op. cit. (n. 11), pi. 86 ; Tombeau d'Idou, W. K. Simpson, op. cit. (n. 12),
fig. 38.
JOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1585
Fig. 10. - Signes déterminatifs de la joie après l'Ancien Empire : a. l'hommeportant la main à la bouche, A2 ; b. l'homme levant les bras au ciel, A28(chapelle de Sésostris Ier à Karnak - clichés A. Chéné) ; c. l'homme dansant,A32 (dessin E. Majerus) ; d. le nez, D19 (chapelle d'Hathor d'Hatchepsout,Deir-el-Bahari - cliché N. Beaux) ; e. la vache allaitant son veau, E5 ; f. lebabouin dressé sur ses pattes arrière et adorant le soleil, E51 (dessins E. Majerus) ;g. la boucle défaite, V12.
1586 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
la musique (fig. lia). Les mouvements sont transcrits dans unensemble ordonné. Mais aucune expression particulière ne se lit surles visages, pas plus que dans les scènes de récompense, commecelle du marin recevant un beau collier d'or au retour de l'expéditionde Pount lancée avec succès par le roi Sahourê102. Au Nouvel Empire,dans les scènes de danse et de récompense, les personnages gardentune gestuelle identique, ordonnée, avec des visages parés de lamême expression sereine103. Tout au plus, chez Inherkiiâouy, peut-ontrouver chez le défunt et sa femme ravis par les notes mélodieusesdu harpiste et son chant, une expression réellement souriante, et lirele geste de la main levée, généralement geste d'accueil et de salut,comme un signe d'enthousiasme104 (fig. 1 lb).
« La forme qui apparaît dans un corps s'évanouit depuis le temps du dieu,et une nouvelle génération prend sa place », chante le harpiste, « Passe unejournée parfaite (...) que vraiment, vraiment, ton cœur ne se lasse pas aveccelle que tu aimes ! Passe doublement une journée parfaite ! Placeensemble, près de toi, de l'encens et des huiles de premier choix (ainsi que)des colliers de lotus et de mandragores sur ta poitrine, la femme qui occupeton coeur étant assise à tes côtés. Fais que l'on chante en ta présence !Oublie le mal que le dieu a en aversion, mais souviens-toi de la JOIE (...) !Donne quotidiennement de l'ivresse à ton cœur, jusqu'à ce que vienne lejour qui sera celui d'aborder. »105
Ce n'est que dans les scènes de processions, lors de fêtes, que l'onpourra voir l'exubérance de la joie, l'allégresse croissante, le degréd'excitation dans les bras levés, les pas de danse esquissés, les têtesrejetées en arrière des danseurs noirs (fig. 1 le). Le dynamisme de ladanse est transcrit par l'ondulation des corps et la façon dont lesjambes se croisent. Mais sur les visages, aucune expression particulière. Tout est dans la gestuelle corporelle. Le corpus de représentations de la joie est donc assez cohérent et stable de l'Ancien auNouvel Empire.
102. T. El-Awady, op. cit. (n. 100), pi. 7.103. Tombe d'Aye n° 25 à Tell el-Amarna.104. N. Cherpion, J.-P. Corteggiani, La tombe d'Inherkhâouy (TT359) à Deir ETMedina II -
Planches, MIFAO 128, Le Caire, 2010, p. 70, pi. 107.105. Eid., La tombe d'Inherkhâouy (TT359) à Deir El-Medina I-Texte, MIFAO 128, Le Caire,
2010, p. 232-233. J.-P. Corteggiani traduit « souviens-toi (des moments) de joie », pour shj n=krSw.t.
Ani
JOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1587
</(') N
FlG. IL- Scènes de réjouissance : a. danse dans le tombeau de Mérérouka (P. Duellet al., op. cit. (n. 11), détail de la pi. 86) ; b. chant du harpiste chez Inherkhâouy(TT359) (cliché N. Grimai) ; c. danse festive au temple de Louqsor (cliché N. Beaux).
1588 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
Conclusion
Nous avons rencontré une similitude dans la gestuelle de la tristesse et de la joie, à telle enseigne que les déterminatifs les plusemployés sont souvent les mêmes, indiquant que c'est bien l'émotionpure, perceptible sous forme d'excitation, vocale ou corporelle, quiest signalée, et non la joie plutôt que la tristesse. En ce sens, on peutdire que la classification du vocabulaire de la joie et de la tristesserelève d'abord de l'émotion. Après l'Ancien Empire, l'emploi dedeux déterminatifs « négatifs », le moineau et l'animal séthien, auxcôtés de mots appartenant au registre de la tristesse, tend à isoler cetteémotion en la considérant comme mauvaise, d'où le nouveau nomqu'on lui donne de dwt-jb, lit. « mal de cœur ». Les représentationsvont tenter de maîtriser ce mal, dans un premier temps, en l'enchaînant dans l'ordre, l'harmonie plastique, en limitant ses débordements,en posant sur la tristesse le masque de la beauté. Dans un deuxièmetemps, aspirant à un certain réalisme, la peinture des débordements dela tristesse sera permise mais poussée cette fois-ci jusqu'à la laideur,afin d'en stigmatiser graphiquement le mal, autre façon de le cerner.
Si la tristesse est marquée négativement dans l'écriture, on n'observe cependant aucun déterminatif « positif » pour la joie. Lesdeux émotions ne sont donc pas opposées. La joie semble constituerl'émotion de référence, révélée par une forme non marquée, alorsque la tristesse, elle, dans l'écriture comme dans l'art, est la formemarquée de l'émotion, portant le sceau du mal.
Revenons à l'expression de l'émotion sur le visage. Le plussouvent, nous l'avons vu, le visage porte dans les représentationsune expression neutre, avec peut-être un très léger sourire, quellesque soient les circonstances, tristes ou gaies, à de rares exceptionsprès. Plutôt qu'une absence de manifestation d'émotion, ne peut-ony lire le désir de fixer la sérénité, la joie intérieure, comme norme ?On sait que les Anciens Égyptiens avaient parmi leurs souhaits lesplus chers ceux de « vie, santé, prospérité et joie », littéralement« expansion du cœur » ! Cette joie pour laquelle ils avaient tant demots, qu'ils décrivaient avec tant de subtilité, qu'ils voyaient partout,dans un lever de soleil, un parfum, un goût, un visage, cette joie étaitpour eux le moyen d'atteindre la perfection comme nous le révèlel'expression snfr-jb, « se réjouir », qui signifie littéralement « faireque le cœur soit parfait ». La perfection dans et par la joie... àl'image de la déesse Hathor pour laquelle furent écrites ces paroles :
JOIE ET TRISTESSE EN EGYPTE ANCIENNE 1589
« Tu es Dame de louange, Maîtresse de la danse, grande d'amour, Maîtressedes femmes et des Belles,Tu es Dame de l'ivresse, aux fêtes nombreuses, Dame de l'oliban, Damede l'acclamation, Dame de l'exultation, à la Majesté de qui on fait de lamusique.Tu es Dame du sistre, Maîtresse des chants et de la danse-au-luth, dont laface brille chaque jour, qui ignore le chagrin.Puisses-tu présenter ton beau visage au roi de Haute et Basse-Egypte, puisses-tu le rendre florissant dans l'épanouissement-de-cœur, éternellement ! »106
** *
Le Président Jean-Pierre MahÉ intervient après cette communication. M. Bernard Pottier présente les remarques suivantes :
Je me permets de prendre la parole, parce que le linguiste se sentconcerné par une communication comme celle que nous venonsd'entendre, si parfaitement documentée, et qui enrichit la réflexionsémiotique.
La JOIE et la TRISTESSE forment une paire antonymique dontvous avez montré les principales représentations, souvent identiques, et qui nécessitent en conséquence, pour une bonne interprétation, une référence au contexte.
Il ressort de votre exposé qu'on peut ainsi considérer un ensembletripartite, avec, au centre, le terme médian : la sérénité, le calmeintérieur, l'impassibilité, représentant TORDRE, et à partir de là,deux types de DÉSORDRES, l'un d'exaltation vers la JOIE etl'autre, opposé, d'exaltation vers la TRISTESSE.
Vous avez montré que cette symétrie apparente cachait uneasymétrie, marquée de plus en plus au cours des siècles, et aboutissant à l'utilisation de marques spécifiques pour la TRISTESSE,allant de pair avec un développement du réalisme.
On est frappé par le fait que ce soient des attitudes identiquesqui évoquent des ÉMOTIONS contraires. On a donc affaire à unepolysémie lorsque sont mentionnés aussi bien les /bras levés/ queles /larmes/, pour nous en tenir à ces deux expressions.
Or cela ne nous dépayse nullement. Nous connaissons leslarmes de chagrin et les larmes de joie et en position médianeapparaissent, dans leur ambigiiité, les larmes de crocodile (du Nilnaturellement).
106. A. BarucqetFr. Daumas, Hymnes et prières de l'Egypte ancienne, Paris, 1980, p. 452-453.
1590 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
On peut donc dire qu'une IMAGE MENTALE, les bras levés parexemple, s'actualise par une représentation iconique en égyptienancien et, en français, par une séquence textuelle à valeur métaphorique et culturellement intégrée.
On trouve en effet, dans un contexte positif, chez George Sand« Dieu soit loué ! s'écria Haydn en pleurant de joie, et en levant lesbras au ciel avec enthousiasme », tandis que Beaumarchais, dansun contexte négatif, écrit : « Suzanne sort, en levant les bras auciel, de terreur ».
Quant aux homomorphies que vous dégagez entre les cheveux,les larmes et Y eau, elles se retrouvent, cinq mille ans plus tard, dansdes textes d'écrivains contemporains :
« Elle... ferma les yeux, et Y eau, goutte à goutte, tombait de sescheveux sur ses genoux comme des larmes. » (Catherine Hermary-Vieille, 1983).
On peut donc concilier les spécificités évidentes des moyensd'expression iconiques et linguistiques des civilisations et un certainnombre de comportements corporels émotionnels généraux, sinonuniversaux.
MM. Robert Martin et Nicolas Grimal interviennent également.
LIVRES OFFERTS
M. Nicolas GRIMAL a la parole pour deux hommages :« J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Académie, de la part de
l'auteur et de l'éditeur, l'ouvrage paru sous la direction de GuillaumeCharloux, Le parvis du temple d'Opet à Karnak. Exploration archéologique1. Préfacé par Michel Azim et précédé d'une introduction due àEmmanuel Laroze, cet ouvrage regroupe les contributions de GuillaumeCharloux, Raphaël Angevin, Sylvie Marchand, Hervé Monchot, AgnèsOboussier, Joshua Roberson et Hélène Virenque2.
1. BiGen 41 (IF1068), Le Caire, IFAO, 2012,1 vol., on-4°, 400 p., 35 €.2. Avec la participation de Isâm Nâjî Mustafâ, Badawî Idris Muhammad, Mây Al-Husnî
Muhammad, Ghâda Ibrahim Fu'âd, trois notes de Damien Agut, Jean-Claude Dégardin et DelphineDixneuf. Photographies de Clément Apffel, Nathalie Gambier, Jean-François Gout et LucieMoraillon.
Énigmes à Theveste et Thysdrus. Rhétorique, ethnographie et procédéscryptographiques dans le milieu des sodalités africo-romaines, parM. Azedine Beschaouch, associé étranger de l'Académie 1847
Mutations et permanence architecturale au cœur de Thasos (vme s. av. J.-C-v n e s . a p . J . - C ) , p a r M . A r t h u r M u l l e r e t a l i i 1 8 5 5
AppendicesRapport sur la vie et les activités de l'École biblique et archéologique
de Jérusalem (2011-2012), par M. Jean-Marie Dentzer, membre del ' A c a d é m i e 1 8 9 9
L i v r e s o f f e r t s 1 7 9 9 , 1 8 3 9 , 1 8 8 9T a b l e a l p h a b é t i q u e 1 9 0 9T a b l e a n a l y t i q u e 1 9 1 7T a b l e d e s l i v r e s o f f e r t s 1 9 2 5A u t e u r s d e s h o m m a g e s 1 9 3 7T a b l e d e s r a p p o r t s 1 9 3 9I n d e x d e s t h è m e s e t d e s l i e u x 1 9 4 1T a b l e d e s m a t i è r e s 1 9 4 7
CONDITIONS D'ABONNEMENT
L ' a n n é e 2 0 1 2 , e n q u a t r e f a s c i c u l e s 1 5 0 €