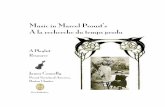Archéologie de l’Amérique coloniale française (with Marcel Moussette)
-
Upload
southalabama -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Archéologie de l’Amérique coloniale française (with Marcel Moussette)
Marcel MoussetteGregory A. Waselkov
Archéologie de l’Amérique
coloniale française
Arc
héol
ogie
de
l’Am
ériq
ue c
olon
iale
fran
çaise
Mar
cel M
ouss
ette
G
rego
ry A
. Was
elko
v
www.levesqueediteur.com
La première synthèse de la recherche archéologique sur l’Amérique coloniale française
Entre le début du xvie siècle et le milieu du xviiie, de vastes territoires de l’Amérique du Nord, plusieurs îles des Antilles et de petites régions du
littoral de l’Amérique du Sud devinrent des colonies de la France. Au cours de cette longue expérience impérialiste, des milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants transplantés de France créèrent de nouveaux foyers et de nouvelles communautés dans des contrées occupées jusqu’alors par les Autochtones
d’Amérique. Depuis environ trois quarts de siècle, et en particulier à partir des années 1960, les archéologues ont entrepris des fouilles dans toutes les régions des Amériques susceptibles de révéler des traces laissées par cette occupation française. Toutefois, les résultats de ces recherches archéologiques demeurent
trop souvent confinés dans des écrits et rapports techniques difficilement accessibles au grand public – et même aux chercheurs.
Marcel Moussette et Gregory A. Waselkov ont donc relevé le défi d’organiser de façon rationnelle l’immense quantité de données disponibles et de construire une étude autour d’un fil de discussion qui retiendra l’attention du lecteur en proposant une synthèse de la recherche archéologique accomplie sur le vaste
territoire de l’Amérique coloniale française qui couvre l’Acadie et Terre-Neuve, le Canada, le Pays d’en Haut et le Pays des Illinois, la Louisiane, les Antilles
et la Guyane. Pour guider leur cheminement, les auteurs se sont appuyés sur trois concepts principaux, chacun dominé par des facteurs liés aux contextes
naturels et culturels, soit l’adaptation, l’accommodation et l’exploitation. Leur intention est d’en arriver à une meilleure compréhension et explication
du fonctionnement ainsi que du développement des colonies françaises d’Amérique à partir des traces et vestiges matériels que les colons ont laissés
derrière eux. Avançant leurs propres points de vue et interprétations, qui s’écartent parfois substantiellement de ceux exprimés par d’autres auteurs,
Marcel Moussette et Gregory A. Waselkov offrent une vision renouvelée d’un domaine riche de promesses.
Gregory A. Waselkov est professeur d’anthropologie à la University of South Alabama où il est directeur du Center for Archaeogical Studies. Ses recherches portent sur le sud-est de l’Amérique du Nord à l’époque coloniale, en particulier sur le site du Vieux-Mobile, celui du fort Toulouse et d’autres établissements de la Louisiane de l’époque coloniale française. Il a publié de nombreux livres et articles sur des sujets allant des traditions cartographiques indigènes à la création de communautés métisses et aux cultures matérielles des systèmes commerciaux de l’époque coloniale.
Marcel Moussette est professeur associé au
Département d’histoire et chercheur associé au CÉLAT
(Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les
arts et les traditions) de l’Université Laval à Québec.
Il est spécialisé en ethnologie et en archéologie historique
nord-américaine. Ses recherches et publications
portent sur la culture matérielle des francophones
d’Amérique, les sites d’établissements ruraux
anciens de la vallée du Saint-Laurent et l’archéologie
urbaine de la période historique. Il est lauréat du prix Gérard-Morisset 2009
(les Prix du Québec) pour sa contribution à la connaissance
du patrimoine québécois.
Extrait de la publication
Archéologie de l’Amérique
coloniale française
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 3 13-11-25 13:26
Ouvrages de Marcel Moussette
Les patenteux, roman, Montréal, Éditions du Jour, 1974.
La pêche sur le Saint-Laurent, essai, Montréal, Éditions du Boréal, 1979.
Le chauffage domestique au Canada, essai, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1983.
L’hiver du Chinois, roman, Montréal, XYZ éditeur, 1992.
Le site du Palais de l’intendant à Québec, Sillery, Septentrion, 1994.
Prendre la mesure des ombres. Archéologie du Rocher de la Chapelle, île aux Oies, Québec, Éditions GID, 2009.
La photo de famille, roman, Montréal, Lévesque éditeur, 2012.
Ouvrages de Gregory A. Waselkov
Powhatan’s Mantle : Indians in the Colonial Southeast (codirecteur avec Peter H. Wood et M. Thomas Hatley), Lincoln, University of Nebraska Press, 1989 ; édition revue et augmentée, 2006.
William Bartram on the Southeastern Indians (codirecteur avec Kathryn Braund), Lincoln, University of Nebraska Press, 1995 ; réédition en format livre de poche, 2002.
The Archaeology of French Colonial North America : English-French Edition, Tucson, Guide to the Historical Archaeological Literature 5, Society for Historical Archaeology, 1997.
Old Mobile Archaeology, Mobile, Center for Archaeological Studies, University of South Alabama, 1999 ; 2005.
French Colonial Archaeology at Old Mobile : Selected Studies (directeur), Lincoln, Historical Archaeology 36 (1), 2002.
A Conquering Spirit : Fort Mims and the Redstick War of 1813-1814, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2006.
The Commerce of Louisiana during the French Régime, 1699-1763, par N. M. Miller Surrey, avec une introduction de Gregory A. Waselkov, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2006.
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 4 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
Marcel MoussetteGregory A. Waselkov
Archéologie de l’Amérique
coloniale française
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 5 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
Catalogage avant publicationde Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Moussette, MarcelArchéologie de l’Amérique coloniale française
(Réflexion)Comprend des références bibliographiques
ISBN 978-2-924186-38-11. Français – Amérique – Histoire – 17e siècle. 2. Français – Amérique – Histoire – 18e siècle.
3. Fouilles (Archéologie) – Amérique. 4. France – Colonies – Amérique – Histoire. 5. Amérique – Histoire – Jusqu’à 1810. i. Waselkov, Gregory A. ii. Titre. iii. Collection : Collection Réflexion (Montréal, Québec).
E29.F8M682 2014 970.004’41 C2013-942492-X
Lévesque éditeur remercie le Conseil des arts du Canada (CAC) et la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC)
de leur soutien financier.
© Lévesque éditeur, Marcel Moussette et Gregory A. Waselkov, 2013
Lévesque éditeur11860, rue Guertin
Montréal (Québec) H4J 1V6Téléphone : 514.523.77.72
Télécopieur : 514.523.77.33Courriel : [email protected]
Site Internet : www.levesqueediteur.com
Dépôt légal : 1er trimestre 2014Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du QuébecISBN 978-2-924186-38-1 (édition papier)
ISBN 978-2-924186-39-8 (édition numérique)
Droits d’auteur et droits de reproductionToutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à :Copibec (reproduction papier) • 514.288.16.64 • 800.717.20.22
Distribution au Canada Distribution en Europe Dimedia inc. Librairie du Québec 539, boul. Lebeau 30, rue Gay-Lussac Saint-Laurent (Québec) H4N 1S2 75005 Paris Téléphone : 514.336.39.41 Téléphone : 01.43.54.49.02 Télécopieur : 514.331.39.16 Télécopieur : 01.43.54.39.15 www.dimedia.qc.ca www.librairieduquebec.fr [email protected] [email protected]
Production : Jacques RicherConception graphique et mise en pages : Édiscript enr.
Illustration de la couverture : Nouvelle-France et régions : Acadie et Terre-Neuve ; Canada ; Pays d’en haut et Pays des Illinois ; Louisiane, Antilles et Guyane. Infographie : Andrée Héroux.
Photographie de Marcel Moussette : Rémy Boily © Gouvernement du Québec (Les Prix du Québec), 2009Photographie de Gregory Waselkov : Sarah Mattics
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 6 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
7
Remerciements ...................................................................................................................... 9
Introduction (Waselkov et Moussette) ....................................................................................... 11
Chapitre 1LES EUROPÉENS ET LES FRANÇAIS EN AMÉRIQUE (Moussette et Waselkov) ............................. 19
Les explorations ................................................................................................................. 19Les Français en Canada et en Floride .................................................................................... 26L’espace atlantique .............................................................................................................. 32
Chapitre 2L’ACADIE ET TERRE-NEUVE (Moussette) ................................................................................ 35
Béothuks et Mi’kmaqs : les premiers contacts avec les Européens ........................................... 35Les premiers établissements français ................................................................................... 43Les postes de traite ............................................................................................................. 57Les missions ...................................................................................................................... 67Les établissements de pêche ................................................................................................ 73Les établissements ruraux ................................................................................................... 84Louisbourg : forteresse et ville portuaire ............................................................................... 103Deux forts frontaliers : Beauséjour et Gaspareau .................................................................... 130La fin d’une époque ............................................................................................................ 139
Chapitre 3LE CANADA (Moussette) ......................................................................................................... 145
Les Basques, la chasse à la baleine et la traite des fourrures .................................................... 146La protohistoire et les sites de contact .................................................................................. 162L’établissement permanent de Québec .................................................................................. 176Les postes avancés .............................................................................................................. 191
Les fortifications militaires ............................................................................................. 193Les missions .................................................................................................................. 198Les postes de traite ......................................................................................................... 208
Les villes et les villages ........................................................................................................ 213La ville de Québec ............................................................................................................... 216La ville de Montréal ............................................................................................................ 257Les villages du Canada ......................................................................................................... 284Les établissements ruraux ................................................................................................... 301Le « chemin qui marche » .................................................................................................... 316
TABLE
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 7 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
Archéologie de l’Amérique coloniale française
8
Chapitre 4LE PAYS D’EN HAUT (Waselkov et Moussette) ........................................................................... 331
Survol historique de la traite des fourrures ............................................................................ 333Le fort Michillimakinac ....................................................................................................... 335À la recherche d’un modèle archéologique pour les postes de traite ......................................... 341Le Pays d’en Haut comme entre-lieux (middle ground) ............................................................ 344L’éducation populaire : le projet archéologique du fort Saint-Joseph ........................................ 355Les pipes à fumer de style mi’kmaq comme signifiants identitaires ......................................... 357La distribution méridionale des pipes à fumer de style mi’kmaq ............................................. 360
Chapitre 5LA LOUISIANE, LES ANTILLES ET LA GUYANE (Waselkov) ....................................................... 367
La Louisiane ....................................................................................................................... 367Les premiers contacts ..................................................................................................... 367La colonie de La Salle ...................................................................................................... 371La colonie d’Iberville ...................................................................................................... 376Évaluer la « richesse » ..................................................................................................... 387L’interaction entre Français et Amérindiens ..................................................................... 389La neutralité et le factionnalisme amérindiens ................................................................. 396Les postes militaires ....................................................................................................... 399Les plantations et les villages ........................................................................................... 402La Nouvelle-Orléans ....................................................................................................... 405
Les Antilles et la Guyane françaises ...................................................................................... 406Les Petites Antilles ......................................................................................................... 408La Guyane ...................................................................................................................... 411
Conclusion (Moussette) ........................................................................................................... 415
Notes ..................................................................................................................................... 419
Bibliographie ......................................................................................................................... 423
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 8 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
9
Nos remerciements vont d’abord à notre éditeur, Gaëtan Lévesque, et à son équipe, Jacques Richer, Régis Normandeau et Noémie Thibodeau, qui ont su mener ce projet avec rigueur et célérité à son
aboutissement. Nous voulons aussi exprimer toute notre gratitude à nos premiers lecteurs, Ian Brown, Céline Cloutier et John Walthall, qui ont gracieusement accepté de lire notre texte et de nous faire part de leurs précieux commentaires. Notre reconnaissance toute spéciale va à quatre collaboratrices qui ont contribué à la mise en forme de base du livre : Clara Marceau, qui a dactylographié le texte, Lise Jodoin et Sarah Mattics, qui ont numérisé et retouché les images, et Andrée Héroux qui a produit les cartes.
Nous sommes gré à tous ces collègues, archéologues, conservateurs et restaurateurs, responsables de collections, archivistes et bibliothécaires, qui nous ont fourni, souvent de façon spontanée, des illustra-tions pertinentes, nous ont signalé l’existence d’études et de documents importants ou nous ont simple-ment guidés dans le dédale des crédits iconographiques et des droits d’auteur : Réginald Auger, Allison Bain, Jeffrey Behm, André Bergeron, Marc-André Bernier, Ian Brown, Margaret Kimball Brown, James Bruseth, Céline Cloutier, Pierre Cloutier, Pamela Crane, Amanda Crompton, Charles Dagneau, Marie Danforth, Marie-Hélène Daviau, Pierre Drouin, Jean-Claude Dupont, Patrick Eid, Chris Ellis, Lynn Evans, Nicolas Giroux, Jacques Guimont, Bonnie Gums, Harry Haskells, Andrée Héroux, Ann Marie Holland, Lisa Jemison, Lise Jodoin, Dominique Lalande, Paul-Gaston L’Anglais, Daniel La Roche, Marc Lavoie, Dianne LeBrun, Brad Loewen, Robert Mazrim, Katherine McCracken, Jean-François Moreau, Marie-Claude Morin, William Moss, Michael Nassaney, Vergil Noble, Caroline Parent, Steven Pendery, Peter Pope, Louise Pothier, Cybèle Robichaud, Arthur Spiess, Dale Standen, Sue Surgeson, Julie Toupin, Jean-Luc Tremblay, James Tuck, Gina Vincelli, John Walthall et Nicola Woods.
Les sources des illustrations et les crédits d’auteur sont indiqués dans les légendes accompagnant les illustrations. Nous remercions les individus et organismes qui nous ont donné la permission de publier ces images.
REMERCIEMENTS
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 9 13-11-25 13:26
11
Entre le début du xvie siècle et le milieu du xviiie, de vastes régions continentales de l ’Amérique
du Nord, plusieurs îles des Antilles et de petites régions du littoral de l’Amérique du Sud devinrent des colonies de la France. Au cours de cette longue expérience impérialiste – une partie d’une expan-sion européenne plus vaste réclamant et coloni-sant les deux Amériques –, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants transplantés de France créèrent de nouveaux foyers et de nouvelles com-munautés dans des contrées occupées depuis long-temps par les Autochtones d’Amérique. Influencés à différents degrés par leurs rapports avec les Autochtones et poussés par divers objectifs éco-nomiques (souvent appuyés par le travail d’Amé-rindiens et d’Africains réduits en esclavage), ces processus complexes d’établissement dans des environnements disparates et mal connus don-nèrent une ampleur fantastique à l’expérience coloniale française. Des colons de toutes les par-ties de la France atlantique et du bassin de Paris se refirent une nouvelle vie comme fermiers des marais salins endigués de l’Acadie, pêcheurs de morues à l’île Royale, ursulines à Québec et à La Nouvelle-Orléans, marchands à Montréal ou traiteurs de fourrures dans la région supérieure des Grands Lacs, le Pays d’en Haut. En tant que contremaîtres de plantation en Guyane française, missionnaires jésuites en Huronie ou engagés à Saint-Domingue (Haïti), et comme corps de dou-zaines de garnisons dans ces différents endroits, ces émigrés de la France métropolitaine s’adap-tèrent aisément aux limites mouvantes de l’Em-pire. En dépit de leurs expériences de vie diverses, les émigrants vers ces premières colonies fran-çaises d’outre-mer, de façon générale, tinrent ferme à l’usage de la langue française, conservèrent
un semblant de style de vie et une vision du monde à la française, et mirent l’accent sur leur identité et leur patrimoine français pendant des générations, dans certains cas jusqu’à présent.
Ce vaste sujet de la présence française en Amérique a été traité de long en large par les his-toriens. Depuis le milieu du xixe siècle, les cher-cheurs se sont appuyés à peu près exclusivement sur la documentation écrite – lettres et journaux d’individus, rapports officiels, recensements, in-ventaires, documents légaux, esquisses et cartes – pour explorer et interpréter le déroulement de la colonisation de l’Amérique française. Ainsi, comme en témoigne une production historique immense, les spécialistes de l’histoire politique et sociale, toujours en se basant sur les documents d’archives, ont souvent démontré une imposante habileté sur le plan méthodologique et une pers-picacité sur le plan de l’érudition, tout en relevant avec une précision de plus en plus grande les mul-tiples facettes des contours de la Nouvelle-France 1.
On peut cependant approcher ce sujet d’un autre point de vue, tout aussi valide, à savoir celui où la documentation d’archives est complétée par les preuves matérielles héritées des Français : les vestiges de maisons, de forts et d’églises ; les restes de navires et de cargaisons conservés au fond de la mer et des rivières ; les débris frag-mentaires et corrodés des objets les plus com-muns de la vie quotidienne ainsi que les souvenirs conservés précieusement ; les choses perdues, jetées, abandonnées, ou cachées et oubliées. Cette approche constitue la voie d’enquête particulière empruntée par l’archéologue. En fait, depuis envi-ron trois quarts de siècle (et avec une intensité et un professionnalisme grandissants depuis les années 1960), les archéologues ont entrepris des
INTRODUCTION
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 11 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
Archéologie de l’Amérique coloniale française
12
fouilles dans toutes les régions des Amériques susceptibles de révéler des traces laissées par cette occupation française.
Puisque le potentiel intellectuel de cet effort soutenu demeure pour une large part en gestation, nous avons pressenti le besoin d’une synthèse de la recherche archéologique accomplie sur ce vaste territoire qui couvre l’Acadie, la vallée et le golfe du Saint-Laurent, le Pays d’en Haut et l’Illinois, la Louisiane et le golfe du Mexique, ainsi que les Antilles et la Guyane françaises. Chaque année passée voit s’agrandir un corpus déjà colossal de données accumulées par les archéologues sur à peu près chaque aspect de la vie des colons d’expression française et leurs relations avec les Autochtones. Toutefois, cette importante ressource historique en continuelle expansion demeure mal connue et sous-exploitée.
Il y a plus d’une décennie, l’un de nous a éta-bli une bibliographie sur l’archéologie coloniale française en Amérique du Nord (un volume dans la série des Guides to Historical Archaeological Literature publiés par la Society for Historical Archaeology 2).
En 1997, plus de 1 900 titres avaient été publiés sur le sujet. En dépit de leur nombre impression-nant, la plupart des études produites jusqu’à ce jour semblent de nature strictement empirique,
[…] s’appliquent spécifiquement aux sites eux-mêmes, et sont descriptives et essentiellement athéoriques – ou plutôt, les théories y sont peu explicites. D’ailleurs, bon nombre de ces études ont été menées afin de permettre la restauration architecturale ou l’interprétation historique des sites ; seul un nombre réduit d’études découlent de projets de recherche n’ayant pas comme but le développement de centres d’interprétation. Cela a profondément influencé l’archéologie coloniale française, les études faites à ce jour, ainsi que l’idée que les archéologues, les historiens et le grand public se font de ce sous-domaine. (Waselkov, 1997 : 68)
Bien que quelques signes prometteurs de change-ment soient apparus entre-temps, notre évalua-tion demeure généralement la même aujourd’hui, et nous avons la ferme intention que cet ouvrage serve d’argument fort contre ce particularisme
incrusté, voire chronique, qui a tellement infecté la recherche dans ce domaine. Après des décennies de pratique professionnelle, nous sommes deve-nus familiers avec une portion considérable de la littérature sur l’archéologie coloniale française au Canada et aux États-Unis. Ce faisant, nous pen-sons avoir acquis l’expérience et les connaissances nécessaires pour affronter cet immense corpus de données archéologiques et les interpréter en regard du discours historique et anthropologique actuel. Notre vœu sincère est que, dorénavant, l’ar-chéologie soit pleinement en mesure de contribuer aux études sur la présence française en Amérique, et peut-être même de mener à une vision renouve-lée du passé français dans cette contrée.
Commençons par le rappel de la vénérable asser-tion de Walter Taylor (1948) selon laquelle « l’ar-chéologie n’est ni histoire ni anthropologie ». Il y a un demi-siècle, Taylor a opposé les disci-plines autonomes que sont l’archéologie (avec son ensemble de techniques spécialisées pour cueillir et analyser les traces de culture matérielle), l’eth-nographie (qu’il caractérisait comme étant la col-lecte de traditions orales) et l’historiographie (qu’il entendait comme la description de contextes culturels à partir d’une recherche documentaire). Il considérait ces trois approches comme trois moyens complémentaires de recueillir des don-nées dont l’interprétation se faisait à l’intérieur du cadre plus général de l’ethnologie (Taylor, 1948 : 23-42). Depuis l’époque de Taylor, les domaines de l’archéologie, de l’anthropologie et de l’his-toire ont tous fait l’objet d’importants change-ments. Même si leurs principales techniques de cueillette des données demeurent vraiment dis-tinctes, leurs objectifs d’interprétation ont de plus en plus convergé, phénomène encouragé par une érosion continue des frontières théoriques, par beaucoup d’emprunts interdisciplinaires de méthodes et de principes d’interprétation, et par les récentes réévaluations autocritiques sous la bannière postmoderne à la grandeur du monde universitaire. Plus particulièrement, l’apparition, après la Seconde Guerre mondiale, de l’ethno-histoire, de l’anthropologie, de la géographie et
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 12 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
Introduction
13
de l’archéologie historiques en tant que sous-domaines interdisciplinaires importants a signalé une volonté plus grande d’emprunter et d’utiliser des méthodes éclectiques. Le paysage disciplinaire a évolué considérablement depuis les années 1940, et la démarche avant-gardiste de Taylor qui consis-tait à appliquer les méthodes archéologiques à la fois aux questions de nature anthropologique et historique semble maintenant chose courante.
Malgré l’abondante liste de publications qui démontre leur grand intérêt pour les sites colo-niaux français, les archéologues ont été jusqu’à présent des partenaires fort silencieux par rap-port aux historiens dans cette tentative commune de comprendre l’expérience coloniale française en Amérique. À ce jour, l’archéologie a principa-lement été utilisée pour illustrer le texte, et les archéologues semblent s’être contentés d’ajouter passivement des objets et des plans au sol pour qu’ils soient consommés par d’autres. Cette façon de faire a cependant eu quelques résultats posi-tifs. Elles ne sont pas rares les histoires récentes de la Nouvelle-France et des autres colonies fran-çaises qui sont décorées d’images d’artéfacts et de fouilles ; l’impression d’exotisme et de relation avec des colons depuis longtemps disparus ainsi créée aide à rendre le texte encore plus vivant. L’archéologie a fourni les données de base pour les reconstructions de la forteresse de Louisbourg, du fort Michillimakinac, de la mission Sainte-Marie-aux-Hurons, et d’autres sites éducatifs impressionnants où les visiteurs ont accès à des représentations de paysages culturels coloniaux français. Aussi, les expositions muséales de même que les médias visuels exhibent de façon efficace les trouvailles au public, nous pourvoyant tous – en tant qu’habitants d’un monde de plus en plus virtuel – de liens véritables, tangibles et encore plus précieux avec notre passé. Pourtant, ces arté-facts – et les reconstitutions auxquelles ils ont servi – demeurent généralement muets. Pourquoi devrait-il en être ainsi, alors qu’ils possèdent le potentiel d’inspirer l’investigation critique et approfondie d’une histoire coloniale française écrite presque entièrement à partir d’un point de vue documentaire ?
Malgré tout l’intérêt qu’ils présentent en soi – qui tient à leur origine exotique, marquant les
débuts de notre âge moderne, et à l’improbabilité de leur survie séculaire sous terre –, ces morceaux de poterie, d’os, de verre et de métal ont rarement trouvé une voix éloquente chez les historiens. De fait, peu d’historiens sont formés à l’interpré-tation de sites et d’artéfacts au même niveau de compétence qu’ils appliquent habituellement à la documentation écrite. Peut-être qu’une collabo-ration serrée, routinière entre les archéologues-historiens et les historiens fera la preuve qu’elle est la meilleure façon de tirer des leçons du passé à partir de l’ensemble complet des données qui nous sont disponibles. Entre-temps, nous pensons que les archéologues-historiens engagés dans des recherches sur la France coloniale peuvent et doivent contribuer à cette rencontre en propo-sant plus que du matériel brut pour les historiens et un nombre infini d’autres rapports descriptifs lus seulement par les archéologues. L’archéologie en général possède ses propres forces, et ces der-nières ne sont pas toujours arrimées aux champs d’intérêts actuels des historiens prisonniers de leurs sources documentaires. Les spécialistes de la colonisation française en archéologie histo-rique doivent jouer un rôle dominant dans l’inter-prétation de leurs résultats en utilisant les avenues théoriques (non pas les sujets à la mode, en perpé-tuel changement) mises au point par les historiens et les anthropologues, ces idées et approches qui donnent un sens aux compétences techniques de l’archéologie.
Cela n’est certainement pas une idée nou-velle. Par exemple, les archéologues-historiens œuvrant sur des sites anciens de la Virginie et de la Floride ont énormément contribué à notre com-préhension des entreprises coloniales anglaises et espagnoles et ont souligné leurs différences. Ces réussites se concrétisent quand les archéo-logues allient des questions de grande importance tant sur le plan historique qu’archéologique à cet ensemble unique de données dont nous dis-posons. En 1991, Kathleen Deagan a publié un court article sur les cinq façons dont les archéo-logues peuvent faire des contributions originales à notre compréhension de l’Amérique depuis l’arrivée des Européens. Sa liste des sujets parti-culièrement pertinents à l’analyse archéologique inclut les contacts culturels et la colonisation ; la
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 13 13-11-25 13:26
Archéologie de l’Amérique coloniale française
14
reconstitution des environnements physiques et matériels à partir des études de paléobotanique et de zooarchéologie ; la paléoanthropologie de la santé, de la nutrition et du régime alimentaire ; les gens socialement marginalisés pour s’être livrés à des activités comme la prostitution, la consom-mation d’opium ou la contrebande ; et finalement les gens dont on parle peu ou qui se sont rarement exprimés par écrit, tels les Africains réduits en esclavage. Dans cette dernière sphère, les archéo-logues-historiens ont trouvé un terrain commun avec des anthropologues-historiens comme Eric Wolf (1982), auteur de l’influent Europe and the People Without History, lequel, soit dit en passant, contient malheureusement peu de références à la littérature archéologique (Schuyler, 1988).
Même si nous trouvons très à propos les recommandations de Deagan et que nous encou-rageons leur exploration, nous nous concentrons sur le phénomène de la colonisation dans le pré-sent volume, un sujet dont les archéologues ont à peine entamé l’examen systématique. Quant aux historiens, ils ont labouré ce champ depuis des années et leurs expériences suggèrent qu’il existe peut-être des façons – certaines plus productives que d’autres – par lesquelles les archéologues peuvent contribuer à l’étude de la colonisation de l’Amérique française. Allan Greer, historien de la Nouvelle-France, a observé comment ses collègues anglophones ont tendance à « tirer des événements politiques et de la personnalité des acteurs [des élites coloniale et européenne] des conclusions quant aux réalités sociales », tan-dis qu’« une nouvelle génération de chercheurs canadiens- français préfère s’arrêter directement et exclusivement à la société elle-même. Plutôt que de chercher la cause de la chute de la Nouvelle-France, ces chercheurs se demandent comment on y vivait. En général, ils croient que les circons-tances matérielles ont joué un rôle plus fondamen-tal que l’impérialisme de Colbert ou les pratiques corrompues de Frontenac » (Greer, 1998 : 17-18). Les archéo logues sont certainement d’accord avec cette seconde approche – une analyse de la société coloniale qui va du bas vers le haut, opposée à celle qui va du haut vers le bas –, et ils la trouvent tout à fait appropriée à l’abondant corpus de données auquel ils ont à faire face.
C’est dans l’étude de Louise Dechêne (1974) sur les habitants et les marchands de Montréal que l’on trouve, défini pour la première fois, ce style de recherche utilisé par les historiens canadiens- français. Dechêne cherchait à saisir la complexe « interaction des diverses influences sur les colons – l’environnement, l’économie, le bagage cultu-rel des immigrants, les institutions de l’Ancien Régime, et la nouvelle société qui émergeait rapi-dement de ce réseau ». L’approche de Dechêne de l’histoire coloniale tient de l’école des Annales, influencée par l’anthropologie et développée par des historiens français mécontents des explica-tions du comportement humain fondées à la fois sur l’économie et le marxisme. Daniel Roche (1997), également de la tradition des Annales, plaide pour un lien encore plus fort entre la culture maté-rielle et l’organisation sociale dans son ouvrage Histoire des choses banales. Avec ces modèles histo-riques français tellement en accord avec les don-nées archéologiques à portée de main, nous nous demandons pourquoi les archéologues s’intéres-sant à l’Amérique coloniale française se sont si rarement inspirés de cette tradition intellectuelle. Dans les pages qui suivent, nous allons mettre de l’avant certaines interprétations inspirées de ce courant de l’histoire matérialiste française.
Nous avons limité la dimension temporelle de cette étude à la période coloniale française, c’est-à-dire au Régime français. Tant qu’elles furent reliées économiquement et politiquement à la France, les colonies françaises d’Amérique avaient beaucoup en commun. Par la suite, à divers moments et dans des circonstances différentes, chacune d’elles allait voir ses liens avec la mère patrie brisés ou transfor-més et chacune allait poursuivre sa propre destinée. En restreignant notre enquête au Régime français, nous espérons faire ressortir ces phénomènes à la base de l’occupation française en Amérique.
À leur arrivée en Amérique, les Français ont rencontré deux réalités déstabilisantes : premiè-rement, des environnements physiques inhabi-tuels caractérisés par des climats extrêmes, allant de l’Arctique glacial à la chaleur et à l’humidité oppressantes des tropiques, et deuxièmement,
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 14 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
Introduction
15
des populations mal connues possédant des millé-naires d’expérience dans leurs propres paysages. Les nouveaux venus français – marchands, fer-miers, engagés, soldats – devaient rapidement évaluer ces nouvelles réalités, prendre des déci-sions et adopter des stratégies dont allaient dépendre leurs nouveaux modes de vie et leur propre survie. D’un côté, ils devaient s’adapter physiquement à de longs hivers ou de longs étés, à de nouvelles flores et faunes, et à diverses topo-graphies en modifiant leurs maisons, leurs vête-ments et leurs aliments. De plus, simplement pour occuper le territoire, pour exploiter les ressources locales ou faire du troc, ils devaient aussi en arri-ver à des accommodements avec les populations autochtones déjà en place. De ce point de départ, nous tirons trois concepts qui s’entrelacent tout au long de nos discussions : l’accommodation, l’adap-tation et l’exploitation.
L’idée d’accommodation est fondée sur une conciliation de toutes les parties, une volonté par-tagée d’être d’accord. L’historien Richard White (1991) a utilisé l’accommodation comme concept opératoire dans son élégante étude des popu-lations amérindienne, métisse et française du middle ground, cet entre-lieux culturel qui s’est développé au sud des Grands Lacs au xviiie siècle.
Dans le middle ground, des personnes d’origines diverses ajustent leurs différences à travers ce qui équivaut à un processus de malentendus sou-vent opportuns et créatifs. Les Uns essaient de se gagner l’Autre qui leur est différent en faisant appel à ce qu’ils pensent être les valeurs et les pra-tiques de l’Autre. Souvent, ils interprètent mal et déforment à la fois les valeurs et les pratiques de ceux avec qui ils interagissent, mais de ces malen-tendus surgissent de nouvelles significations, et à travers elles, de nouvelles pratiques – les signifi-cations et pratiques partagées du middle ground 3. (White, 1991 : x)
Nous pensons que des situations similaires exis-tèrent dans les premiers temps de la colonisation française en Amérique et que l’accommodation entre divers groupes joua un rôle crucial dans les développements culturels et interculturels ultérieurs.
Quand au concept d’adaptation, nous préférons la définition proposée par le spécialiste de l’écolo-gie culturelle John W. Bennett :
La manipulation rationnelle ou réfléchie des envi-ronnements social et naturel constitue l’approche humaine de la nature : les caractéristiques de ce style d’adaptation doivent, il me semble, devenir le cœur de n’importe quelle approche d’une éco-logie humaine qui s’intéresse à ce que les gens veulent et aux moyens qu’ils prennent pour se l’approprier, et aux effets que cela a sur eux et sur la nature. L’adaptation est considérée comme un comportement multidimensionnel : ce qui pour-rait conduire à l’adaptation pour un individu n’aura pas nécessairement le même effet pour un autre ou pour le groupe ; ce qui pourrait conduire à l’adap-tation des humains aura peut-être un tout autre résultat sur la nature. (Bennett, 1976 : 3)
Ce point de vue dynamique sur l’adaptation est partagé par l’anthropologie écologique et l’écolo-gie humaine, des sous-disciplines de l’écologie culturelle. Ainsi conçu, le processus d’adaptation – on pourrait aussi parler d’adaptabilité – peut très bien s’appliquer à la population qui s’établit sur les terres des Amériques à partir du xvie siècle (Hardesty, 1977 : 21-35 ; Moran, 1982 : 7-8 ; Hawley, 1986 : 1-9).
Le concept d’adaptation s’applique directement à l’archéologie environnementale. En outre, le concept de « niche écologique » – les conditions dans lesquelles l’espèce humaine vit, se reproduit et survit – est central à n’importe quelle réflexion concernant l’exploitation. Selon John Evans et Terry O’Connor :
[…] puisque ni les gens ni l’environnement ne peuvent [dorénavant] exister indépendamment l’un de l’autre, l’archéologie doit nécessairement considérer une certaine intégration des deux. Le concept de niche renferme cette intégration, incorporant l’organisme, ses perceptions et ses réponses à un éventail de variables qui peut inclure des facteurs abiotiques, telles la température et l’humidité, et des facteurs biotiques, telles la pré-dation et la compétition. L’unité d’étude à la base de l’archéologie peut donc être définie comme étant
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 15 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
16
Archéologie de l’Amérique coloniale française
la niche humaine, dans toute sa splendide diver-sité et polyvalence. (Evans et O’Connor, 1999 : 215)
Tel qu’il est exprimé ici, le concept de niche écolo-gique ne prend pas assez en compte la dimension culturelle, mais il lui est compatible et ouvre la porte à des approches dont la portée est beaucoup plus grande, à ce que Ian Hodder (1986) a appelé « l’archéologie contextuelle ».
Une question importante peut ainsi être for-mulée : comment ces phénomènes d’adaptation, d’exploitation et d’accommodation témoignent-ils, par exemple, d’une appropriation du territoire du golfe et de la vallée du Saint-Laurent qui serait par-ticulière à la Nouvelle-France ? Plus spécialement, quels sont les rôles joués respectivement dans cette appropriation par les facteurs liés à l’environne-ment naturel et ceux relevant du domaine culturel ? Et, comment cette façon proprement française et coloniale de s’approprier ce territoire a-t-elle évo-lué dans le temps ? Du point de vue de l’anthropolo-gie écologique, l’adaptation des colons français ne peut être comprise uniquement en tenant compte de leur réponse à l’environnement. Notre intention ici n’est pas d’écrire une histoire écologique des Français en Amérique, mais d’en arriver à une meil-leure compréhension et explication du fonctionne-ment et du développement des colonies françaises d’Amérique, à partir des traces et vestiges matériels que les colons ont laissés derrière eux.
Notre approche encourage aussi l’exploration du paysage social et de la riche interaction des diverses nations qui ont caractérisé les colonies françaises d’Amérique. En prenant comme sujet principal les colonies telles qu’elles existaient, et non telles que les envisageaient le roi et ses ministres, les archéologues peuvent interroger les preuves matérielles pour en faire ressortir les créations graduelles d’entités sociales dans les contextes coloniaux. Le développement de la nation métis dans les Prairies et celui des créoles africains dans les Antilles sont des exemples notables de ce processus. Rappelons également que ni les sociétés de Québec, de Louisbourg ou de La Nouvelle-Orléans n’ont reproduit la société de Paris (ou de n’importe quel autre centre urbain de France). Les différences sociales et culturelles plus subtiles qui surgirent entre les colons nés
dans la colonie et ceux nés en France présentent des parallèles contrastés qui ont attiré l’atten-tion des archéologues seulement récemment. De telles différences sont apparues et ont été main-tenues par les agissements conscients des colons. Ainsi, les archéologues devraient tenir compte de ces « passeurs », ces individus actifs qui, par leurs choix et leurs actions, transformèrent les sociétés coloniales (Voir Dobres et Robb, 2000 ; Pauketat, 2001 ; Gardner, 2004 ; et Given, 2004). Le concept de passeur peut aussi enrichir nos études sur les Autochtones colonisés et ceux réduits en esclavage qui s’accommodèrent, s’adaptèrent et exploitèrent les ressources pour leur propre bénéfice – dans les limites du possible – à l’intérieur d’un paysage social dominé par les colons.
Cette étude se veut une synthèse. Nous n’avons entrepris aucune nouvelle fouille pour ce livre, mais avons plutôt puisé dans les données déjà accumulées, mettant l’accent de préférence sur l’information de base accessible aux lecteurs en tant qu’analyses publiées, et nous tournant seu-lement de façon occasionnelle vers les collections d’artéfacts elles-mêmes, conservées dans plus de 10 000 caisses à documents réparties dans les nombreuses réserves à travers le continent. Nous avons donc privilégié les sources publiées, acces-sibles pour la plupart dans les bibliothèques uni-versitaires et les centres de recherche importants au Canada et aux États-Unis. Notre point de départ est la bibliographie établie par Waselkov en 1997, mais, bien sûr, l’archéologie coloniale française demeurant un champ d’études actif, plusieurs pro-jets plus récents (certains encore en cours) sont aussi l’objet de discussions. Dans chaque cas, nous avons mis de l’avant nos propres points de vue et interprétations, dont certains peuvent s’écarter substantiellement de ceux exprimés par d’autres auteurs. Le résultat, nous l’espérons, est une vision renouvelée, constructive mais provocante, d’un domaine intellectuel rempli de promesses.
Cela dit, nous avons été mis au défi d’organi-ser de façon rationnelle cette immense quan-tité de données disponibles et de construire une étude autour d’un fil de discussion qui retiendra
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 16 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
Introduction
17
l’attention du lecteur. Dès le début, pour plusieurs raisons à la fois théoriques et pratiques, nous avons mis de côté l’idée d’un traitement stricte-ment chronologique du sujet. La raison en est fort simple : une analyse par région permet un récit plus cohérent de la colonisation française dans des territoires présentant des conditions naturelles et culturelles très différentes. Notre seul écart à cette logique est de réunir, dans un unique chapitre introductif, le témoignage archéologique des pre-mières et hésitantes incursions des Français dans toutes les parties des Amériques, surtout parce que ce genre de témoignage fugitif demeure tout à fait rare et souvent inexploité ou inexploitable sur le plan archéologique.
Après avoir opté pour un découpage régional, il nous a fallu établir l’ordre dans lequel les régions seraient traitées (figure 1). Nous avons réglé la question en fondant notre séquence sur l’inten-sité des relations et des ressemblances culturelles entretenues par les diverses régions. Nous iden-tifiâmes d’abord deux pôles de l’Amérique colo-niale française : le Canada au nord et la Louisiane au sud. Situés géographiquement et administrati-vement entre ces deux pôles, se trouvaient le Pays d’en Haut et le Pays des Illinois. Bien sûr, l’Acadie
et les établissements des côtes du Labrador et de Terre-Neuve avaient des liens serrés avec le Canada et, puisque la présence française s’y faisait déjà sentir dès le xvie siècle, c’est par cette région que nous commençons notre discussion en pro-fondeur. Les Antilles et la Guyane, qui pourraient facilement constituer un troisième pôle étant donné la taille de leur population et leur impor-tance économique, montrent néanmoins plus d’affinités avec la Louisiane qu’avec le Canada. Fait important pour notre propos, les archéologues ont à peine commencé leurs recherches sur les sites coloniaux français d’Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Cela explique qu’il n’y ait qu’une mention relativement brève de ces nouvelles recherches dans notre dernier cha-pitre régional. Ainsi, nous en sommes venus au plan suivant : d’abord les origines, puis l’Acadie et Terre-Neuve, le Canada, le Pays d’en Haut et le Pays des Illinois, et finalement la Louisiane, les Antilles et la Guyane. Notre ouvrage se termine sur une comparaison interrégionale de l’expérience coloniale française, dans laquelle nous essayons de mettre en lumière les tendances croisées qui se manifestent dans les archéologies de ces diverses régions.
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 17 13-11-25 13:26
Extrait de la publication
18
Figure 1. Nouvelle-France et régions : Acadie et Terre-Neuve ; Canada ; Pays d’en haut et Pays des Illinois ; Louisiane, Antilles et Guyane. Cette carte a été largement établie à partir de celle de Mathieu (2001 : 63) à laquelle on a ajouté la Guyane
et les Antilles françaises. Infographie : Andrée Héroux.
Archéologie de l’Amérique coloniale française
Archéologie de l’Amérique coloniale française.indd 18 13-11-25 13:26
Marcel MoussetteGregory A. Waselkov
Archéologie de l’Amérique
coloniale française
Arc
héol
ogie
de
l’Am
ériq
ue c
olon
iale
fran
çaise
Mar
cel M
ouss
ette
G
rego
ry A
. Was
elko
v
www.levesqueediteur.com
La première synthèse de la recherche archéologique sur l’Amérique coloniale française
Entre le début du xvie siècle et le milieu du xviiie, de vastes territoires de l’Amérique du Nord, plusieurs îles des Antilles et de petites régions du
littoral de l’Amérique du Sud devinrent des colonies de la France. Au cours de cette longue expérience impérialiste, des milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants transplantés de France créèrent de nouveaux foyers et de nouvelles communautés dans des contrées occupées jusqu’alors par les Autochtones
d’Amérique. Depuis environ trois quarts de siècle, et en particulier à partir des années 1960, les archéologues ont entrepris des fouilles dans toutes les régions des Amériques susceptibles de révéler des traces laissées par cette occupation française. Toutefois, les résultats de ces recherches archéologiques demeurent
trop souvent confinés dans des écrits et rapports techniques difficilement accessibles au grand public – et même aux chercheurs.
Marcel Moussette et Gregory A. Waselkov ont donc relevé le défi d’organiser de façon rationnelle l’immense quantité de données disponibles et de construire une étude autour d’un fil de discussion qui retiendra l’attention du lecteur en proposant une synthèse de la recherche archéologique accomplie sur le vaste
territoire de l’Amérique coloniale française qui couvre l’Acadie et Terre-Neuve, le Canada, le Pays d’en Haut et le Pays des Illinois, la Louisiane, les Antilles
et la Guyane. Pour guider leur cheminement, les auteurs se sont appuyés sur trois concepts principaux, chacun dominé par des facteurs liés aux contextes
naturels et culturels, soit l’adaptation, l’accommodation et l’exploitation. Leur intention est d’en arriver à une meilleure compréhension et explication
du fonctionnement ainsi que du développement des colonies françaises d’Amérique à partir des traces et vestiges matériels que les colons ont laissés
derrière eux. Avançant leurs propres points de vue et interprétations, qui s’écartent parfois substantiellement de ceux exprimés par d’autres auteurs,
Marcel Moussette et Gregory A. Waselkov offrent une vision renouvelée d’un domaine riche de promesses.
Gregory A. Waselkov est professeur d’anthropologie à la University of South Alabama où il est directeur du Center for Archaeogical Studies. Ses recherches portent sur le sud-est de l’Amérique du Nord à l’époque coloniale, en particulier sur le site du Vieux-Mobile, celui du fort Toulouse et d’autres établissements de la Louisiane de l’époque coloniale française. Il a publié de nombreux livres et articles sur des sujets allant des traditions cartographiques indigènes à la création de communautés métisses et aux cultures matérielles des systèmes commerciaux de l’époque coloniale.
Marcel Moussette est professeur associé au
Département d’histoire et chercheur associé au CÉLAT
(Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les
arts et les traditions) de l’Université Laval à Québec.
Il est spécialisé en ethnologie et en archéologie historique
nord-américaine. Ses recherches et publications
portent sur la culture matérielle des francophones
d’Amérique, les sites d’établissements ruraux
anciens de la vallée du Saint-Laurent et l’archéologie
urbaine de la période historique. Il est lauréat du prix Gérard-Morisset 2009
(les Prix du Québec) pour sa contribution à la connaissance
du patrimoine québécois.
Gregory A. Waselkov est professeur d’anthropologie à la University of South Alabama où il est directeur du Center for Archaeogical Studies. Ses recherches portent sur le sud-est de l’Amérique du Nord à l’époque coloniale, en particulier sur le site du Vieux-Mobile, celui du fort Toulouse et d’autres établissements de la Louisiane de l’époque coloniale française. Il a publié de nombreux livres et articles sur des sujets allant des traditions cartographiques indigènes à la création de communautés métisses et aux cultures matérielles des systèmes commerciaux de l’époque coloniale.
Marcel Moussette est professeur associé au
Département d’histoire et chercheur associé au CÉLAT
(Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les
arts et les traditions) de l’Université Laval à Québec.
Il est spécialisé en ethnologie et en archéologie historique
nord-américaine. Ses recherches et publications
portent sur la culture matérielle des francophones
d’Amérique, les sites d’établissements ruraux
anciens de la vallée du Saint-Laurent et l’archéologie
urbaine de la période historique. Il est lauréat du prix Gérard-Morisset 2009
(les Prix du Québec) pour sa contribution à la connaissance
du patrimoine québécois.
Extrait de la publication























![L’AMÉRIQUE LATINE VEUT COMPTER DANS LA STRATÉGIE MONDIALE [Latin America wants to count in the global strategy]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f3ac163ac2c35640ab616/lamerique-latine-veut-compter-dans-la-strategie-mondiale-latin-america-wants.jpg)