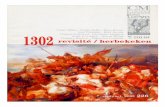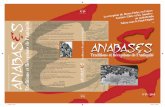Archéologie du son : les dispositifs de pots acoustiques dans les édifices anciens : AVANT PROPOS
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Archéologie du son : les dispositifs de pots acoustiques dans les édifices anciens : AVANT PROPOS
ARCHÉOLOGIE DU SONLes dispositifs de pots acoustiques
dans les édifices anciens
Société Française d’ArchéologieSFA2012
AR
CH
ÉO
LOG
IED
USO
N
ISBN : 978-2-901837-41-1
Faux code barre
Les églises médiévales et modernes conservent parfois dans leurs murs ou dans leursvoûtes des poteries noyées dans la maçonnerie dont seul affleure le col, ouvert sur l’espaceintérieur du bâtiment. L’usage de ces poteries architecturales, souvent méconnu, a étéparfois mal interprété. Il s’agit en fait de dispositifs de correction acoustique destinés àaméliorer la perception de la voix parlée et chantée, non seulement dans les lieux de cultemais dans certains bâtiments civils. Pour les érudits qui en découvrirent l’existence auXIXe siècle, la raison d’être de ces pots a constitué une énigme.
Depuis lors, nombre d’entre eux ont disparu à l’occasion de travaux de ravalement oude restauration, faute d’être perçus comme des vestiges dignes d’intérêt. Cet ouvragepropose un bilan de nos connaissances actuelles et un certain nombre de pistes derecherche. Il est le fruit d’un travail interdisciplinaire mené depuis plusieurs années entrehistoriens, archéologues, linguistes et acousticiens Les indications fournies par les textesanciens et les observations résultant de l’étude matérielle des poteries ont ainsi pu êtreconfrontées à des mesures de fréquence, afin de mieux comprendre le phénomènephysique et, par là même, de mieux apprécier l’effet acoustique des poteries insérées dansles maçonneries de certains édifices. Au-delà de la redécouverte d’une pratique disparuede la mémoire collective depuis deux siècles, c’est la conservation de ces dispositifs quiest en jeu.
Textes de A. Boato, G. Boto, P. Carvalho, C. Delomier, V. Desarnaulds, E. Dupuy,C. Ferron, J.-M. Fontaine, S. Grégoire, M. Jurkovic, A. Kottmann, J. Laumonier,S. Moreau, E. Palazzo, B. Palazzo-Bertholon, L. Philippon, J.-D. Polack, D. Prigent,R. Rebeix, Chr. Sapin, T. Turkovic, J.-Chr. Valière.
30 €
Sous la direction deBénédicte Palazzo-Bertholon
et Jean-Christophe Valière
Société Française d’Acoustique
2012
Supplément au Bulletin monumental
n° 5
ARCHÉOLOGIE DU SON
Les dispositifs de pots acoustiquesdans les édifices anciens
Sous la direction de Bénédicte Palazzo-Bertholon et de Jean-Christophe Valière
© Société Française d’ArchéologieSiège social : Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris.
Bureaux : 5, rue Quinault, 75015 Paris, tél. : 01 42 73 08 07, mail : [email protected]
ISSN : 2102-4499ISBN : 978-2-901837-41-1CPPAP : 0112 G 86537
Diffusion : Éditions A. & J. Picard, 82, rue Bonaparte, 75006 ParisTél. librairie 01 43 26 96 73 - Fax 01 43 26 42 64
Comité scientifique
Jean-Pierre BABELON, Françoise BERCÉ, Gabrielle DEMIANS D’ARCHIMBAUD,Peter KURMANN, Willibald SAUERLÄNDER, Neil STRATFORD
Comité des publications
Marie-Paule ARNAULD, Françoise BOUDON, Isabelle CHAVE, Alexandre COJANNOT, Thomas COOMANS, Thierry CRÉPIN-LEBLOND,Vincent DROGUET, Nicolas FAUCHERRE, Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP, Étienne HAMON, François HEBER-SUFFRIN,
Dominique HERVIER, Bertrand JESTAZ, Claudine LAUTIER, Emmanuel LURIN, Jean MESQUI,Jacques MOULIN, Philippe PLAGNIEUX, Éliane VERGNOLLE
Directeur des publications Marie-Paule ARNAULDRédacteur en chef Éliane VERGNOLLE
Secrétaire de rédaction Nathalie LEBLONDInfographie et P.A.O. David LEBOULANGER
Toute reproduction de cet ouvrage, autre que celles prévues à l’article L. 122-5 duCode de la propriété intellectuelle, est interdite, sans autorisation expresse de la Sociétéfrançaise d’archéologie et du/des auteur(s) des articles et images d’illustration concernés.Toute reproduction illégale porte atteinte aux droits du/des auteurs(s) des articles, àceux des auteurs ou des institutions de conservation des images d’illustration, nontombées dans le domaine public, pour lesquelles des droits spécifiques de reproductionont été négociés, enfin à ceux de l’éditeur-diffuseur des publications de la Sociétéfrançaise d’archéologie.
La proposition de publier unnuméro spécial du Bulletinmonumental consacré aux potsacoustiques 1 peut être entrevue
de prime abord comme une gageure sin-gulière compte tenu de l’apparente confi-dentialité du sujet, en dépit du nombreconséquent de témoignages archéologiquesconcernant ces objets. Et pourtant, l’archi-tecture des époques médiévale et moderneconserve encore, dans de nombreux édifices,les traces matérielles de cette technique dis-parue de notre mémoire collective.
avant d’entrer dans le vif du sujet,voyons d’abord de quoi il retourne.Certains édifices – des églises dans laplupart des cas – conservent dans lesparties hautes des murs ou bien dans lesvoûtes des trous apparents de quelquescentimètres de diamètre, placés selon desschémas géométriques répétitifs. il faut sehisser à proximité de ces orifices pour aper-cevoir le col de pots en terre qui affleure aunu de la paroi, leur panse étant noyée dansla maçonnerie. la présence de poteriesarchitecturales dans les parties hautes desédifices pose la question première de leurusage et de leurs fonctions.
C’est au milieu du xixe siècle que desérudits, architectes et archéologues signa-lèrent, avec étonnement et curiosité, laprésence de ces pots insérés dans les murset les voûtes des églises. Ce faisant, ilsouvrirent un large champ d’étude qui inté-ressa successivement les archéologues et lesacousticiens jusqu’à la publication duprésent volume.
les réponses partielles obtenues à cejour sur le rôle et le fonctionnement despots acoustiques dans les églises anciennesnous ont conduits à aborder la question demanière transversale, en faisant dialoguerdifférentes approches historiques, archéolo-giques et physiques (scientifiques), afin decroiser le regard de scientifiques d’horizonsdivers, peu enclins habituellement à travail-ler ensemble sur une même problématique.le dossier présenté dans ce supplément auBulletin monumental dresse un état de laquestion sur les pots acoustiques ; celui-ciest le fruit d’un travail collectif, mené dansle cadre d’un programme de recherchesoutenu par l’université de Poitiers entre2005 et 2008 2. l’orientation clairementinterdisciplinaire du projet a permis la réali-sation d’un travail faisant intervenir desarchéologues, des acousticiens, des histo-riens, des physiciens spécialistes des maté-riaux 3. À ce groupe de chercheurs, se sontajoutés des étudiants de Master et de Deaqui travaillèrent avec enthousiasme lors desphases successives de ce projet 4. en margedu « noyau dur » constitué par ce groupe,de nombreux chercheurs et collègues(université, CnrS, ministère de la Culture,indépendants) ont participé à nos efforts, entransmettant des signalements d’églises, desréférences bibliographiques et des avis éclai-rés. les informations collectées et la richessedes échanges nourris durant ces quatreannées ont constitué une matière assez densepour envisager cette publication. nousavons choisi de présenter nos travaux enquatre parties successives.
la première partie, consacrée à la présen-tation des sources écrites, vise à rassembler
les connaissances sur les pots acousti-ques. C’est dans le contexte archéologiquefrançais que se développe, à partir de 1840,la redécouverte des pots acoustiques.Depuis le milieu du xixe siècle, la liste desdispositifs connus a été considérablementaugmentée, avec une fortune variable selonles régions et les périodes. Ce passage enrevue de la bibliographie, qui proposeun panorama éclairant à plus d’un titre,permet de comprendre la genèse du sujetdans le cadre d’une érudition variée. lestextes médiévaux, pour leur part, pré-sentent quelques rares témoignages de lamise en place de ces dispositifs entre lexVe et le xViiie siècle. leur nature est hété-rogène et leur contenu parfois inattendu,mais ils fournissent des informations indis-pensables à la compréhension du phéno-mène. les textes d’époque moderne, enfin,apportent un éclairage particulier et perti-nent, qui, à défaut de témoigner directe-ment des dispositifs de poteries, est sur-tout centré sur la science acoustique del’époque.
la deuxième partie est un regard àpartir d’approches différentes : la filiationentre les echea antiques et les pots acous-tiques médiévaux, la dimension sonore dela liturgie, la lecture symbolique des pots,l’approche sémantique de la terminologieacoustique. Ce volet se termine avec uneprésentation des principes de l’acoustiquedes salles, permettant de poser les basesindispensables à la compréhension descontributions ultérieures.
la troisième partie propose un éclairagearchéologique avec, en manière d’introduction,
5
AVANT-PROPOS
Bénédicte Palazzo-Bertholon ܀ et Jean-Christophe Valière ܀܀
« Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre,ni de réussir pour persévérer »
Charles le téméraire
Bénédicte Palazzo-Bertholon et Jean-Christophe Valière
6
quelques exemples : Saint-Martin d’angers,l’abbatiale de Montivilliers, les églisesdu Villars, de Pommiers-en-Forez et deBaume-les-Messieurs. Ces cinq sites illus-trent la variété des cas où l’on rencontre desvestiges concrets de ces dispositifs acous-tiques et l’approche matérielle qui peut enêtre faite. on présentera ensuite la questionde l’inventaire des églises qui sont (ou ontété) dotées de pots acoustiques, en Franceet dans les autres pays qui en conservent lesvestiges. Cette partie sera clôturée, enfin,par un panorama des recherches menéessur le sujet dans quelques pays d’europe,tels que l’italie, la Suisse, l’allemagne, laCroatie et l’espagne. Ce choix a été condi-tionné par les travaux récents réalisés sur lesujet et par les liens internationaux, entre-tenus ces dernières années avec les scienti-fiques intéressés par les dispositifs acous-tiques. il existe de nombreux exemples dedispositifs acoustiques dans la plupart despays d’europe, comme en témoigne l’in-ventaire général figurant en préambule.aussi, le panorama brossé pour ces cinqpays n’a-t-il nullement la prétention d’êtreexhaustif, mais il fournit toutefois un
éclairage pertinent sur les caractéristiquesde ces dispositifs dans chacune des régionsvisitées.
la quatrième partie est consacrée,quant à elle, au volet proprement acous-tique de la problématique. elle rassembleet propose une lecture renouvelée des résul-tats obtenus à partir des mesures physiquesmenées dans le cadre de l’aCi entre 2004et 2009. la méthodologie et les résultatsdes mesures acoustiques y sont exposés,puis comparés à ceux d’études anciennesou récentes, avant de conclure sur l’inter-prétation des résultats obtenus à partird’exemples concrets. la conclusion géné-rale du volume, de nature à la fois synthé-tique et prospective, est suivie d’un glossairetechnique, indispensable à l’appréhen-sion et à la compréhension d’un sujetpluridisciplinaire, qui emprunte à chaquedomaine des termes spécifiques qui ne noussont pas tous familiers. Cet effort decompréhension du regard de « l’autre »,de son approche, de son vocabulaire,comme de son raisonnement, trop souventétranger à nos modes de fonctionnement
cloisonnés et à nos repères scientifiqueshabituels, a été permanent dans notredémarche, jusqu’à son étape finale : sa trans-mission à un public élargi.
nous aurions voulu proposer unepublication plus complète encore, enouvrant, par exemple, une tribune auxmusicologues, les invitant à décrire lesdifférentes modalités d’exécution duchant dans les églises médiévales et d’étu-dier la correspondance éventuelle deschants avec les pots acoustiques. Cela n’apas été possible dans le cadre de cettepublication, mais il serait souhaitable qu’ilspuissent apporter prochainement leurconnaissance et leur contribution à ce vastechantier de recherche. De même, on atten-dra dans l’avenir que des archéologues etdes historiens de l’architecture se penchentsur l’analyse conjointe des aménagementsliturgiques de l’église et sur la position desofficiants dans l’espace de l’église, enrapport avec la localisation des pots et ladiversité de leurs schémas de répartitionspatiale. aussi, espérons-nous que la publi-cation de ce volume stimulera et renouvel-lera l’intérêt des scientifiques pour lesdispositifs de pots acoustiques, afin decompléter nos connaissances sur leur usage
Fig. 1 - Maguelone, cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, vue générale des première et deuxièmetravées de la nef, situées au-dessus de la tribune construite à l’extrême fin du xiie siècle. les céra-miques placées dans les voûtes sont réparties sur deux lignes de manière symétrique, à raison de seizepoteries dans la première travée, de quatorze dans la deuxième et de douze dans la troisième. la miseen place des pots est contemporaine de la construction de la voûte.
Fig. 2 - Maguelone, cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, détail d’une poterie insérée dans lavoûte de la nef avec le col et le bec verseur de lacruche affleurant. on distingue également surles claveaux de la voûte des marques de tâche-rons, sans rapport direct avec les vases puisqu’onles retrouve en de multiples endroits dans lebâtiment.
Cl. a. Garnotel.
Cl. a. Garnotel.
܀ archéologue, chercheur associé, université dePoitiers, CeSCM / CnrS (UMr 7302).
܀܀ Professeur, université de Poitiers, institut Pprime /CnrS (UPr 3346).
1. les termes utilisés pour désigner ces dispositifs sontvariés, parmi lesquels figurent : « vase acoustique »,« vase de résonance », « résonateur », « poterie acous-tique » ou « echea ». nous avons choisi le terme de « potacoustique » dans cette publication pour désigner lerécipient inséré dans les maçonneries au Moyen Âge,
afin de le distinguer de la terminologie employée plusspécialement pour l’antiquité (vase et echea).
2. action incitative (aCi) de l’université dePoitiers visant à encourager des études pluridiscipli-naires.
3. Philippe Bernardi (laMoP, Paris), olivier Cullin(CeSCM, Poitiers), Jean-Marc Fontaine (institutD’alembert, Paris), Janick laumonier (institutPprime, Poitiers), Bénédicte Palazzo-Bertholon(CeSCM, Poitiers), anne Pantet (institut Pprime,
Poitiers), laurent Philippon (institut Pprime, Poitiers),Jean-Dominique Polack (institut D’alembert, Paris),Daniel Prigent (Service d’archéologie du Conseilgénéral du Maine-et-loire), Jean-Christophe Valière(institut Pprime, Poitiers).
4. nous remercions pour leur collaboration : raphaëlBerthonneau, Pauline Carvalho, Sylvain Grégoire,Solenn Moreau, François Pouyau, romain rebeix etolivier terny.
AVANT-PROPOS
7
NOTES
et leur signification dans une dimensionsensible et vivante, qui nous fait encoredéfaut.
nous tenons enfin à témoigner notregratitude aux nombreuses personnes quiont œuvré à la réussite de ce projet de publi-cation. tout d’abord, nous remercions lecomité des publications du Bulletin monu-mental, qui a accepté le pari osé d’un supplé-ment consacré tout entier à un sujet singu-lier, interdisciplinaire et difficile. ensuite, ce
volume n’aurait pas vu le jour sans la contri-bution enthousiaste et dévouée de ses diffé-rents auteurs. nous tenons à remercier égale-ment les nombreux collaborateurs, collègues,amis, passionnés et supporters, qui ont parti-cipé d’une manière ou d’une autre à ceprogramme de recherche. Sans pouvoir tousles nommer, que chacun d’entre eux trouveici nos remerciements chaleureux pour leursoutien, leur concours, leur avis d’expert ouleur aide logistique. enfin, nous remercionsvivement nos autorités de tutelle – l’université
de Poitiers, l’institut Pprime et le Centred’études supérieures de civilisation médiévale– qui ont cru à notre projet de rechercheinterdisciplinaire et qui l’ont soutenu finan-cièrement. Cette publication a égalementbénéficié du soutien financier de l’État, parl’intermédiaire du conservateur régional d’ar-chéologie de Poitou-Charentes, de l’univer-sité de Poitiers et de la Société françaised’acoustique. nous espérons que le résultatprésenté sera à la hauteur de la confiancequ’ils nous ont accordée.
AVANT-PROPOS................................................................................................................................................................................
Première Partie
SourceS et hiStoriograPhie
iNTRODUCTION, par Bénédicte Palazzo-Bertholon..........................................................................................................................
CHAPITRE I - L’historiographie des XIXe et XXe siècles, par Bénédicte Palazzo-Bertholon...............................................................
CHAPITRE II - Les sources médiévales et modernes, par Bénédicte Palazzo-Bertholon.................................................................
CHAPITRE III - L’acoustique architecturale. Théorie et pratique, par Pauline carvalho et Jean-christophe Valière.....................
Deuxième Partie
aPProcheS croiSéeS
INTRODUCTION, par Bénédicte Palazzo-Bertholon..........................................................................................................................
CHAPITRE I - La filiation entre les echea antiques et les pots acoustiques médiévaux, par Pauline carvalho,Bénédicte Palazzo-Bertholon et Jean-christophe Valière..................................................................................
CHAPITRE II - La dimension sonore de la liturgie dans l'Antiquité chrétienne et auMoyen Âge, par éric Palazzo....................
CHAPITRE III - Pour une lecture symbolique des pots acoustiques, par Bénédicte Palazzo-Bertholon.........................................
CHAPITRE IV - Résonner, réfléchir/réflexion, retentir/retentissement, écho. Approche diachronique, par estèle Dupuy etcorinne Ferron......................................................................................................................................................
CHAPITRE V - Introduction aux principes de l’acoustique des salles, par Jean-Dominique Polack.........................................
5
11
13
27
33
41
43
51
59
67
75
TABLE DES MATIÈRES
troiSième Partie
étuDeS archéologiqueS
INTRODUCTION, par Bénédicte Palazzo-Bertholon..........................................................................................................................
CHAPITRE I - Pour un recensement des pots acoustiques. État de la question, par Bénédicte Palazzo-Bertholon,Jean-christophe Valière, anna Boato, Victor Desarnaulds, miljenko Jurkovic, aline Kottmann et tin turkovic
CHAPITRE II - Quelques études de cas en France1. l’église Saint-martin d’angers, par Daniel Prigent.............................................................................................2. l’ancienne abbatiale de montivilliers (Seine-maritime), par Pauline carvalho....................................................3. l’église de la madeleine du Villars (Saône-et-loire), par christian Sapin............................................................4. l’église priorale de Pommiers-en-Forez (loire), par chantal Delomier................................................................5. l’ancienne église abbatiale de Baume-les-messieurs (Jura), par Sébastien Bully et marie-laure Bassi.................
CHAPITRE III - Le paysage européen1. l’italie : le cas de gênes, par anna Boato............................................................................................................2. la Suisse : essai d’inventaire, par Victor Desarnaulds..........................................................................................3. l’allemagne : état de la recherche, par aline Kottmann......................................................................................4. la croatie médiévale : état des lieux, par miljenko Jurković et tin turković.......................................................5. l’espagne : premières approches, par gerardo Boto............................................................................................
quatrième Partie
archéométrie et acouStique
INTRODUCTION, par Jean-christophe Valière..................................................................................................................................
CHAPITRE I - Proposition d’une méthode de mesure archéométrique1. approche théorique, par Janick laumonier, Solenn moreau et Jean-christophe Valière.......................................2. mise en place expérimentale, par Solenn moreau, laurent Philippon, romain rebeix et Jean-christophe Valière...
CHAPITRE II - Mesure des fréquences acoustiques des pots1. la constitution d’un corpus archéologique, par Sylvain grégoire, Bénédicte Palazzo-Bertholon, romain rebeix
et Jean-christophe Valière...............................................................2. analyse des résultats, par Jean-christophe Valière..............................................................................................3. quelques études de cas
a. reproduction en laboratoire et étude in situ du dispositif des églises de Syens et de Villette (Suisse), parVictor Desarnaulds.......................................................................................................................................B. l’exemple de Ploaré-Douarnenez (France), par Jean-marc Fontaine et Jean-christophe Valière....................
CHAPITRE III - Synthèse et interprétation, par Jean-christophe Valière.....................................................................................
PERSPECTIVES D’ÉTUDE, par Bénédicte Palazzo-Bertholon et Jean-christophe Valière.....................................................................
gloSSaire.......................................................................................................................................................................................BiBliograPhie...............................................................................................................................................................................inDex..............................................................................................................................................................................................réSuméS, engliSh Summary, DeutSche zuSammenFaSSung.........................................................................................................taBle DeS auteurS........................................................................................................................................................................taBle DeS matièreS........................................................................................................................................................................
81
85
99102106108111
115121127133141
149
151155
157163
171175
183
187
189193201205207209