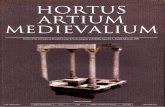ANNE SAROSY L'application de la photographie en archéologie : L'exemple de la Grande Fouille de...
-
Upload
sorbonne-fr -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ANNE SAROSY L'application de la photographie en archéologie : L'exemple de la Grande Fouille de...
UNIVERSITÉ PARIS IV – SORBONNE
UFR 03 – Histoire de l’art et Archéologie
Mémoire de MASTER 1
Présenté par Anne SAROSY
Année Universitaire 2013 – 2014
L’APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE EN ARCHÉOLOGIE : L’EXEMPLE DE
LA GRANDE FOUILLE DE DELPHES (1892 – 1903)
Texte
Sous la direction de M. Thierry Laugée et de Mme Hélène Brun
1
Remerciements
Je tiens à remercier en premier lieu mes professeurs, Mme
Hélène Brun et M. Thierry Laugée. Je profite de ces quelques
phrases pour leur faire part de toute ma reconnaissance pour
leur aide, leur attention, leur écoute, leur suivi et leur
patience. Je tiens aussi à faire part de toute ma gratitude à
M. Alexandre Mazarakis qui a pu me conseiller au long de ce
travail.
Je souhaite remercier M. Alexandre Farnoux pour son
accueil à l’École française d’Athènes. Je voudrais exprimer ma
gratitude à M. Philippe Collet qui m’a fait largement profiter
de sa connaissance et de sa grande expérience en tant que
photographe de l’École française d’Athènes. Mes plus sincères
remerciements vont aussi à Mme Calliopi Christophi, responsable
de la photothèque de l’École, qui m’a guidée au sein des
différentes collections et qui m’a permis d’étudier le fonds de
la Grande Fouille de Delphes dans les meilleures conditions. Je
tiens à exprimer ma reconnaissance à Mme Anne Rohfritsch,
2
responsable des archives, qui m’a gracieusement permis
d’accéder aux archives administratives de l’École.
Pour m’avoir proposé son aide, extrêmement précieuse, je
voudrais exprimer toute ma reconnaissance et toute mon
affection à M. Erwin Aureillan, qui a dû s’armer de patience
pour relire mon travail.
Enfin, j’exprime toute ma gratitude à mes parents pour
m’avoir toujours soutenue dans mes choix d’études. Je remercie
particulièrement ma mère, Mme Christine Fournier pour m’avoir
accompagnée et soutenue durant la rédaction de ce travail. I
wish to thank my father, Mr Paul Sarosy, for supporting me
during my studies. I hope that one day you will be able to read
this work in french.
Table des matières
Remerciements................................................1Abréviations.................................................3Introduction.................................................4I. La photographie : un nouvel instrument de travail pour les archéologues.................................................9A. Mise en place de la photographie scientifique.................91. Une généralisation de la pratique...........................92. Conditions d’une photographie scientifique.................143. Une réponse aux exigences des nouvelles méthodologies de fouilles......................................................20
3
B) Les multiples applications de la photographie à Delphes......221. La photographie comme témoin : une vocation documentaire. . .222. Les finalités pédagogiques : les envois à l’Académie.......24
C) Les paradoxes de l’objectivité photographique................271. La machine et le photographe : façade d’une objectivité photographique................................................27
II. Photographier La Grande Fouille de Delphes..............34A) L’organisation des fouilles et le témoignage de leurs réalisations....................................................341. Le matériel photographique : de nouvelles exigences........342. Les épreuves photographiques : un témoignage de la fouille en elle-même.....................................................393. Les références aux prises de vue dans le Journal de la Grande Fouille.......................................................44
B) Photographier le vivant......................................511. Le témoignage d’un métier..................................522. Les trois moments de la prise de vue (le Journal de la Grande Fouille) : témoignage du métier de photographe ?..............563. Le choix de témoigner de son expérience : le caractère ethnologique..................................................63
C) Des prises de vue à la mise en place réfléchie...............681. Intervention du photographe dans la mise en scène..........682. Rendre compte de l’information : des méthodes empiriques. . .713. Intervention manuelle sur le cliché en vue de la publication74
III. L’édition, un développement pour la photographie.......78A) L’exploitation de la photographie dans les publications scientifiques : l’illustration dans le BCH, CRAI et Les fouilles de Delphes..........................................................781. Utilité et fonctions.......................................782. L’image et le texte : la question des légendes et commentaires..............................................................833. Variété des utilisations de l’image : publication et envois pour le CRAI..................................................88
B) L’industrie photographique au service de l’EfA...............901. Les nouveaux procédés photomécaniques utilisés par l’EfA. . .902. Les studios de photographie et d’impression de l’EfA.......933. Une autre présentation des clichés : leur projection pendant les séances de l’Institut de correspondance hellénique........95
Conclusion.................................................100Bibliographie..............................................103
4
Abréviations
BCH : Bulletin de correspondance hellénique
CRAI : Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres
EfA : École française d’Athènes
EPHE : École Pratique des Hautes Etudes
ICH : Institut de correspondance hellénique
MDAI : Mitteilungen des Deutschen Archäogischen Instituts
5
Introduction
En 1839, Arago1 présente l’invention de Daguerre à
l’Académie des sciences : « [..] chacun [songe] à l’immense
parti qu’on aurait pu tirer, pendant l’expédition d’Égypte,
d’un moyen de reproduction aussi exact et si prompt […]
». Ainsi, Arago salue l’apparition du médium photographique et
introduit d’emblée les possibilités d’application de celui-ci
au domaine archéologique. Par la présentation de l’éminent
membre de l’Académie, la photographie se trouve, dès ses
balbutiements, rattachée à l’entreprise scientifique et se
présente comme l’un des catalyseurs de l’archéologie moderne en
Grèce au XIXe siècle. Le fonds photographique qui fait l’objet
de la présente étude s’impose comme la mémoire vive, par ses
mille six cents quatorze plaques de verres, du plus important
chantier jamais entrepris à l’époque : la Grande Fouille de
Delphes ayant lieu de 1892 à 1903, sous la responsabilité de
Théophile Homolle (1848 – 1925), Directeur de l’École Française
d’Athènes (EfA) de 1890 à 1903. Celui-ci s’entoure de nombreux
1 ARAGO, François, « Le Daguerréotype » dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, séance du lundi 19 août 1839, p. 257.
6
de membres de l’École comme Paul Perdrizet, Paul Fournier et
Émile Bourguet. Le fonds apparaît désormais comme un élément
constitutif du patrimoine delphique et un exemple de sa
réappropriation par l’EfA. L’étude de ce fonds attire en
premier lieu notre attention par son ambivalence et la
multitude de questionnements qu’il soulève. En effet, les
conditions de prises de vue frappent par leur homogénéité
puisque la grande majorité des clichés ont exclusivement été
réalisés sur le site de Delphes -village de Castri compris-
contrairement aux précédentes expériences photo-archéologiques
de Prangey ou Perrot2 destinées à la documentation de leurs
voyages scientifiques. Les images réalisées à Delphes sont
l’œuvre d’un nombre restreint d’opérateurs et la pluralité des
sujets étudiés trouve son fil conducteur dans l’omniprésence
des principaux acteurs delphiques. L’homogénéité du fonds et
son étendue chronologique facilitent une étude raisonnée de
l’intégration de la photographie à la discipline archéologique.
Paradoxalement ces caractéristiques n’ont d’égal que la variété
des sujets représentés puisque l’ambition documentaire de la
fouille est sans précédent : plus de deux-mille clichés sont
produits et demeurent présents sous la forme de plaques de
verre depuis plus d’un siècle dans la photothèque de l’EfA. Le
chantier de Delphes fut l’une des premières grandes entreprises
de l’École, fondée en 1846, qui se donne comme objectif une
exploration systématique du site. On comprend aisément que la
photographie y ait joué un rôle prépondérant. Delphes s’impose
2 PERROT, Georges, Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, d’une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, exécutée en 1861 et publiée sous les auspices du ministère de l’Instruction publique, Firmin – Didot frères, Paris, 1862 [392 p.].
7
comme un reflet de l’évolution des techniques archéologiques et
semble symptomatique des bouleversements que connaît la
discipline à la fin du XIXe. En effet, Delphes a connu les
récits de voyageurs du début du XIXe siècle, les aquarelles et
la suprématie du dessin avant de connaître les avancées
techniques liées à la Grande Fouille. Si le dessin demeure un
outil privilégié de l’archéologue, la chambre photographique ne
cesse d’accroître son rôle et sa présence sur le chantier, puis
au sein des publications scientifiques quand vient l’heure de
rapporter les connaissances extraites de la campagne delphique.
Afin de mener cette étude sur le fonds photographique
delphique, nous avons examiné à la photothèque de l’École les
clichés développés, les plaques de verre étant conservés avec
la plus grande vigilance dans des salles froides. Nous vous
prions de vous rapporter au catalogue présent en annexe pour
compléter cette étude.
Afin d’orienter l’étude qui nous incombe, il convient de
répertorier les précédents travaux accordés au fonds
photographique de la Grande Fouille de Delphes. On peut en
premier lieu signaler deux thèses doctorales, celle de P.
Folliot, G. Réveillac et A. Chéné3 publiée en 1986 et celle
d’A. Lacoste4 soutenue en 2008. Si les deux ouvrages ne se
donnent pas la Grande Fouille de Delphes pour sujet exclusif,
ils s’attachent tous deux au dialogue entre photographie et3 FOLLIOT, Philippe, RÉVEILLAC, Gérard et CHÉNÉ, Antoine, De la photographie enarchéologie, Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille, 1986 [300 f.].4 LACOSTE, Anne, La photographie et les sciences de l'Antiquité en Orient dans la seconde moitiédu XIXe siècle d'après l'étude des fonds photographiques de la Bibliothèque de l'Institut de France,thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université de Paris IVSorbonne, 2008 [1 034p.].
8
archéologie et à leurs enrichissements mutuels. La présente
étude prend connaissance de ces travaux pour supposer que,
davantage qu’un enrichissement, il existe un véritable trajet
commun entre l’essor de la photographie scientifique et de
l’archéologie institutionnelle. Il nous faut désormais traiter
des ouvrages ayant trait à la Grande Fouille afin de compléter
et replacer les hypothèses d’influences de la photographie sur
l’archéologie dans le cas précis de Delphes. En 1988, Olivier
Picard, directeur de l’Ecole de 1981 à 1992, confie à G.
Réveillac le soin d’une mission exploratoire du fonds
photographique de l’Ecole. Cette recherche est présente dans
les archives sous le titre Rapport de mission exploratoire de G. Réveillac5.
La recherche prend la forme d’un état des lieux général en vue
d’une restauration future du fonds. Il s’agit d’une étude
d’échantillonnage réalisée sur huit-cent négatifs de plaques de
verres exhumés au hasard. Ce premier rapport s’enrichit l’année
suivante d’un second, intitulé Le fonds photographique ancien de l’Ecole
Française d’Athènes – la « Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903)6, rédigé par
G. Réveillac et s’attachant au cas précis de Delphes
probablement dans le cadre de la commémoration du centenaire du
chantier ayant lieu trois ans plus tard. La poursuite du
travail d’inventaire et la préoccupation de durabilité du fonds
trouve sa réalisation dans le rapport de Bertrand Lavrédine :
Mission sur la conservation des photographies de l’Ecole Française d’Athènes7.
5 RÉVEILLAC, Gérard, Rapport de mission exploratoire, Dossier Administratif 4.4,carton n5 : collection de photographies (1989 – 1992), 1988 [4 p.].6 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’École française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), Dossier Administratif 4.4, carton n5 :collection de photographies (1989 – 1992), 1989 [45 p.].7 LAVÉDRINE, Bertrand, Mission sur la conservation des photographies de l’École françaised’Athènes réalisée entre le 25 juin et le 2 juillet 1992, Dossier Administratif 4.4, carton
9
Ingénieur au Centre de Recherche de la Conservation des
Documents Graphiques, il produit un rapport bien plus précis
sur la natures des différentes altérations présent dans le
fonds général et en favorise l’exploitation documentaire. Si
l’intitulé du rapport paraît introduire à une étude d’ordre
général, celui-ci est publié au moment du centenaire de la
Grande Fouilles de Delphes ; il y accorde ainsi une importance
particulière qui s’inscrit dans la volonté de réappropriation
du fonds photographique. L’année 1992 correspond à une plongée
de la communauté archéologique dans l’univers de la Grande
Fouille. L’ouvrage le plus représentatif de cette tendance est
certainement La redécouverte de Delphes8, ouvrage à l’intitulé sans
équivoque. Celui-ci s’appuie sur le rapport de G. Réveillac de
1989 dont il constitue l’aboutissement auprès de la communauté
scientifique par la publication des conclusions qui y étaient
apportées. L’article « Photographies de la Grande Fouille9 »
élève de manière inédite les clichés réalisés de 1892 à 1903 au
rang de strict objet d’étude. En 1996, Philippe Collet publie
l’article « Photographie et archéologie : des chemins
inverses10 » qui s’attache à retracer les étapes de
l’institutionnalisation de la photographie au sein de l’EfA.
Les clichés relatifs à la Grande Fouille y prennent une part
prépondérante et font de Delphes le moment décisif de
l’application de la photographie au domaine archéologique. n5 : collection de photographies (1989 – 1992), 1992 [4 p.].8 PICARD, Olivier [dir.], La redécouverte de Delphes, École française d’Athènes,Athènes, Eforeia arhaiotētōn Delfōn, Paris, de Boccard, 1992 [291 p.].9 RÉVEILLAC, Gérard, « Photographies de la Grande Fouille » dans LaRedécouverte de Delphes, pp. 180-193. 10 COLLET, Philippe, « La photographie et l’archéologie : des cheminsinverses » dans le Bulletin de correspondance hellénique, volume 120, numéro 1,Athènes, École française d’Athènes, 1996, pp. 325-344.
10
En 1846 est fondée l’Ecole Française d’Athènes, placée en
1874 sous l’autorité de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. L’apparition du médium photographique précède la
création de l’Ecole d’à peine sept années. Pour autant, la
collaboration avec l’outil photographique prend son essor plus
tardivement puisque les albums photographiques pionniers de G.
Perrot11 et E. Renan12 sont respectivement publiés en 1862 et
1874. Il faut attendre le passage du statut de la photographie
comme communication artistique à celui de langage scientifique.
En effet, dès 1839, les grands monuments de l’Antiquité grecque
deviennent les sujets des premières vues photographiques comme
l’illustrent les travaux de Pierre Gustave Gaspard Joly de
Lotbinière. Ces vues, avec celles réalisées par Guillaume de
Prangey, bien que plus pittoresques que scientifiques, vont
permettre d’envisager l’étendue des applications de la
photographie quant à la documentation, l’enregistrement,
l’archivage ou l’analyse des vestiges archéologiques. Aussi
l’ambivalence de la photographie entre vocation esthétique et
application scientifique doit-elle être questionnée.
L’archéologie du XIXe semblait avoir déjà résolu le paradoxe de
travaux réalisés par une technique artistique dans un but
scientifique par l’usage du dessin, alors médium exclusif de la
promotion des découvertes. Ce précédent offre une porte
d’entrée à la photographie au sein du milieu archéologique,
11 PERROT, Georges, Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, d’une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, exécutée en 1861 et publiée sous les auspices du ministère de l’Instruction publique, Firmin – Didot frères, Paris, 1862 [392 p.].12 RENAN, Ernest, Mission de Phénicie, Paris, Impr. impériale, 1864-1874 [884
p.].
11
d’ores et déjà rompu à la transdisciplinarité, à la
collaboration des techniques. Dès les prémices de l’utilisation
de la chambre photographique en milieu archéologique, l’intérêt
des spécialistes et des novices pour l’exotisme des clichés
réalisés joue le rôle de caisse de résonnance des travaux
archéologiques dans les capitales européennes. En effet la
multiplication de gravures d’après photographies dans des
revues telles L’Illustration ou A travers le monde atteste l’engouement
des scientifiques et du public pour le support photographique.
Peut-on pour autant limiter l’application de la photographie à
la promotion des missions archéologiques ? Le cas de Delphes
suggère une implication bien plus large de la photographie lors
de la Grande Fouille qui s’étend sur plus de dix ans, de 1892 à
1903. Si l’intérêt pour l’image géographique et sensationnelle
constitue un terrain fertile à la présence de l’outil
photographique sur le chantier de fouille, les missions
réalisées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle ne
cessent de révéler les nombreuses facettes de l’application de
la photographie à l’archéologie. Aussi la « scientifisation »
de la photographie et de l’archéologie semblent appartenir à un
même mouvement qui s’étend sur une même période. Dès lors, une
fois leur concomitance établie, quelle a été l’influence de la
photographie dans le trajet commun qu’elle parcourt avec
l’archéologie vers leur définition moderne, scientifique ?
Comment la photographie a-t-elle imposé son caractère
scientifique lorsque les expériences récentes et sa vocation
artistique première semblent signaler la fragilité de
12
l’objectivité photographique et des connaissances qui en
découlent ?
Aussi, dans quelle mesure la photographie s’impose-t-elle,
par ses différentes applications et résonances au sein de la
communauté savante, comme l’instrument privilégié d’une
archéologie qui affirme son caractère institutionnel et
scientifique ? Le cas de Delphes est choisi comme lieu de ce
questionnement en ce qu’il inaugure la collaboration intensive
du médium photographique avec une recherche archéologique
enrichie de nouvelles méthodologies.
Afin de déterminer les conditions d’intégration de la
photographie aux travaux archéologiques, les bouleversements
qu’elle opère et les possibilités qu’elle offre, il nous faut
en premier lieu étudier le contexte d’une généralisation de la
pratique au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les
conditions sont-elles alors réunies pour que la chambre
photographique soit considérée comme un nouvel instrument pour
les archéologues ? Ce semble être le cas à Delphes lors de la
Grande Fouille qui apparaît comme le catalyseur des définitions
de la photographie scientifique à cette période. Le site
delphique s’impose également comme le lieu de l’expérimentation
des différentes applications de la photographie à
l’archéologie. Aussi l’exemple de Delphes sera au cœur du
deuxième temps de notre étude puisqu’il s’agira de considérer
le témoignage photographique du chantier de la Grande Fouille
afin d’envisager une analyse détaillée des photographies tant
13
par la prise de vue que par les traitements et publications
dont elle font l’objet. Enfin, on s’attachera à déterminer les
modalités de l’exploitation des clichés au sein des
publications scientifiques telles que le BCH, le CRAI et Les
fouilles de Delphes.
I. La photographie : un nouvel instrument de travail pour les archéologues
A. Mise en place de la photographie scientifique
Afin de déterminer les facteurs ainsi que les tenants et
les aboutissants de la mise en application de la photographie à
la discipline archéologique, considérons en premier lieu le
contexte d’une généralisation de la pratique à la fin du XIXe
siècle. Existe-t-il une volonté de créer une norme dans la
création du genre de la photographie dite scientifique ? Enfin
nous verrons dans quelle mesure l’outil photographique répond
il aux exigences des nouvelles méthodologies de fouilles
introduites à cette époque à la pratique archéologique ?
14
1. Une généralisation de la pratique
Aussi, déterminons dans quel environnement l’ambition
d’une photographie scientifique prend racine. Cette question
suggère l’étude des manuels photographiques appliqués aux
sciences à travers l’étude de l’ouvrage d’Eugène Trutat publié
en 1879, La photographie appliquée à l’archéologie13. E. Trutat (1840 –
1910), directeur du Musée d’Histoire Naturelle de Toulouse,
utilise la photographie dans ses voyages d’études dans les
Pyrénées, et l'applique à la géologie et à l’archéologie. Il
écrit de nombreux manuels techniques et ouvrages sur les
applications scientifiques de la photographie, particulièrement
à l’histoire naturelle14. L’ouvrage rapporte un état de la
connaissance des années 1875 – 1880 sur la technique
photographique tout en retranscrivant l’expérience de ses
prédécesseurs. Il renseigne en outre les lecteurs de l’époque
sur les dernières nouveautés photographiques. E. Trutat donne
des conseils et son point de vue quant à l’application de la
photographie en archéologie. On peut souligner l’intérêt que
porte E. Trutat à l’application de la photographie à
l’épigraphie. Pour l’auteur, l’épigraphie et la photographie
représentent le symbole même de l’apport considérable que
peuvent avoir les prises de vue pour les recherches
archéologiques. L’intérêt de la photographie pour les
recherches épigraphiques et la somme d’inscriptions présentes à
Delphes en font le lieu privilégié de la mesure de l’influence13 TRUTAT, Eugène, La photographie appliquée à l’archéologie : reproduction des monuments,œuvres d’art, mobilier, inscriptions, manuscrits, Paris, Gauthier – Villars, 1879 [139p.].14 TRUTAT, Eugène, La photographie appliquée à l’histoire naturelle, Paris, Gauthier –Villard, 1884 [225 p.].
15
de la photographie sur l’archéologie. On peut citer le CAT 147,
représentant une inscription du Stade, pour illustrer cette
approche. Ainsi, Trutat se place en précurseur de l’utilisation
du cliché photographique en tant que support, puisqu’avant les
années 1880 les études publiées ne sont que très rarement
illustrées15. On peut d’ailleurs noter que les études
épigraphiques ne sont pas complétées par des dessins dans les
corpus épigraphiques. Trutat est -de manière pionnière-
conscient de l’apport des clichés pour les corpus. Il salue le
fait « que l’archéologue puisse emporter avec lui à loisir une
représentation du sujet douteux16 ». On peut constater la
modernité de son propos lorsqu’il prétend que face à une
photographie chaque épigraphiste pourra donner sa propre
interprétation et ne dépendra pas de l’opinion d’un seul. E.
Trutat considère la photographie comme un support documentaire,
un instrument de travail aisément transportable qui facilite le
travail du chercheur. L’ambition de cet ouvrage est d’enseigner
aux archéologues la pratique de la photographie afin de créer
des images qu’ils pourront publier par la suite. La démarche
d’E. Trutat peut être mise en parallèle avec celle de P.
Foliot, G. Réveillac et A. Chêne17 qui cherchent à rapprocher
la pratique des photographes de celle des archéologues afin que
ces deux corps de métiers apprennent à mettre en commun leur
savoir pour créer une image normalisée, scientifique.
15 En effet, le Bulletin de correspondance hellénique n’est illustré qu’àpartir de 1878. Voir III, A, 1 : « Utilité et fonctions de l’exploitationde la photographie dans les publications scientifiques ».16 TRUTAT, Eugène, La photographie appliquée à l’archéologie : reproduction des monuments,œuvres d’art, mobilier, inscriptions, manuscrits, p. 2. 17 FOLLIOT, Philippe, RÉVEILLAC, et Gérard CHÉNÉ, Antoine, De la photographie enarchéologie, Aix, Université d’Aix – Marseille, 1986 [300 f.].
16
Le savant devient photographe et participe ainsi à la mise
en place de la photographie appliquée à la science bien mieux
que lorsqu’il devait diriger un photographe. On assiste
conjointement à l’apparition d’une nouvelle génération de
savants formés à l’École Française d’Athènes qui se
familiarisent avec la photographie et les nouvelles formes de
documentations par l’intermédiaire de manuels, traités et
publications scientifiques consultables à la bibliothèque18.
Nous avons examiné les inventaires des bibliothèques de l’École
française d’Athènes. Ceux-ci s’avèrent cependant trop
lacunaires pour nous aider dans la recherche des ouvrages
traitant de photographie alors accessibles aux membres de
l’École. Néanmoins, nous savons que l’institution recevait la
presse étrangère, particulièrement les journaux français, et
que de part son attachement à l’Académie, l’École se devait
d’être informée des progrès scientifiques, notamment
photographiques. Pour les scientifiques ou photographes du
XIXème siècle on peut observer que l’intérêt premier qui
résulte de la pratique photographique est « l’exactitude
mathématique19 » qu’elle procure. Cette précision est en fait
d’une grande utilité pour les études de l’Antiquité en tant que
science moderne. Paul Martellière20 (1830 – 1921), dans son
18 LACOSTE, Anne, La photographie et les sciences de l'Antiquité en Orient dans la seconde moitiédu XIXe siècle d'après l'étude des fonds photographiques de la Bibliothèque de l'Institut de France,thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université de Paris IVSorbonne, 2008, pp. 202-209. 19 MARTELLIÈRE, Paul, « De la Photographie comme complément des étudesphotographiques » dans Bulletin de la Société archéologique et littéraire du Vendômois, TomeXVIII, 3ème trimestre 1879, Vendôme, Lemercier & Fils, p. 216. 20 Un des membres de la Société archéologique du Vendômois (société fondée en 1862qui publie depuis sa création un bulletin annuel sur l’archéologie).
17
intervention, « De la Photographie comme complément des études
archéologiques21 » fait une description particulièrement
simplificatrice de la pratique, ce qui nous laisse penser qu’il
souhaite promouvoir l’initiative :
« Si le public savait que la photographie est la
chose la plus simple du monde, et que le premier venu
peut avec un peu de soin obtenir des résultats
satisfaisants, il manquerait volontiers de respect au
photographe, qui ne l’entend pas ainsi.22 »
Nous pouvons ainsi observer que la pratique photographique se
généralise peu à peu en France, et qu’elle devient un outil que
les promoteurs de ce mouvement décrivent comme étant
accessible. Trutat constate le développement de la pratique
dans le milieu archéologique mais contrairement à Martellière,
il en évoque aussi les résultats limités, dus au manque de
préparation et d’expérience : « Un cliché est encore chose
assez facile à obtenir, mais il faut de toute nécessité faire
un véritable apprentissage pour arriver à des résultats
convenables.23 » Le manuel renseigne de manière détaillée sur
la pratique de la photographie à l’époque. Il comprend en
premier lieu la description du matériel adapté aux conditions
d’utilisation en voyage ou en studio. Il décrit ensuite la
chambre et le pied, soulignant l’importance d’une rigidité
suffisante de ce dernier afin d’éviter les vibrations21 MARTELLIÈRE, Paul, « De la Photographie comme complément des étudesphotographiques » dans Bulletin de la Société archéologique et littéraire du Vendômois, p.215-223.22 MARTELLIÈRE, Paul, « De la Photographie comme complément des étudesphotographiques » dans Bulletin de la Société archéologique et littéraire du Vendômois,p.222. 23 TRUTAT, Eugène, La photographie appliquée à l’archéologie : reproduction des monuments,œuvres d’art, mobilier, inscriptions, manuscrits, p. 27.
18
occasionnant des épreuves floues. Certaines catégories de verre
étant susceptibles de se ternir, il recommande de les conserver
dans une atmosphère sèche et de les préserver de brusques
changements de température, ainsi que d’éviter de les ballotter
lors des déplacements. Quant aux négatifs, E. Trutat favorise
la demi–plaque (13 x 18 cm) pour les voyages, format moyen
s’adaptant à quasiment tous les sujets et entraînant moins de
complications que le transport de formats plus imposants. On
remarque que les deux formats les plus utilisés pour la Grande
Fouille de Delphes sont le 13 x 18 et le 18 x 24 cm.
Suite à ces considérations d’ordre général, l’ouvrage est
divisé en cinq catégories, chacune étant illustrée par une
lithophotographie : monuments, objets, sculpture, inscriptions
et manuscrits. Trutat prend en compte les différentes
compositions et les matériaux pour chaque élément, et tout
particulièrement pour l’épigraphie. Il décrit les effets à
obtenir dans le but de mieux représenter l’objet photographié,
se référant souvent à des manuels techniques de photographes.
Il cite notamment Blanquart-Evrard24 (1802 – 1872) afin de
définir l’éclairage nécessaire pour la photographie de
monuments, une des principales difficultés. Les vues d’ensemble
demandent une lumière vive afin d’avoir des ombres portées
donnant du relief aux parties saillantes et d’obtenir des
effets de perspective bien adoucis. Les éclairages doivent être
obliques pour mettre en relief les masses sans tomber dans
l’exagération de l’allongement des ombres portées, comme on
24 BANQUART-EVRARD, Louis-Désiré, Traité de photographe sur papier, Paris,Chevalier, 1651 [199 p.].
19
peut le voir sur le CAT 061. Les sculptures au contraire
nécessitent une lumière large et douce pour obtenir le modelé
de l’épreuve : le CAT 140 en est l’exemple même. Trutat précise
aussi la taille des épreuves la plus adaptée, la manœuvre des
appareils, lesquels doivent être généralement positionnés à
moitié de la hauteur totale du sujet, ainsi que la mise au
point et le temps de pose. Enfin, la description des principaux
procédés disponibles attestent encore de la diversité des
utilisations à cette période : négatif papier, collodion
humide, collodion sec, procédé au gélatino-bromure d’argent. Le
collodion sec semble être le plus employé et est recommandé
pour le voyageur mais Trutat annonce aussi les plaques
émulsionnées au gélatino-bromure préparées et fournies par le
commerce, et recommande tout particulièrement celles de Jacques
Garcin (18..-19.. ?) à Lyon25, plaques sèches au gélatino-
bromure d’argent excellentes et d’un prix inférieur à toutes
les autres préparations. Le procédé au gélatino-bromure
d’argent profite tout particulièrement au développement de la
photographie dans les missions. Les plaques sèches préparées à
l’avance rendent ainsi la tente inutile et éliminent toutes les
manipulations chimiques des procédés précédents, simplifiant
dans une grande mesure le bagage du voyageur, et surtout
réduisent considérablement le coût de la production. Ainsi,
grâce à la brièveté des opérations nécessaires et du temps
d’exposition, la pratique devient plus spontanée et élargit les
possibilités ainsi que les sujets. Ce nouveau procédé assure
25 Photographe ayant participé à l’Exposition Universelle de 1894. VoirArchives municipales de Lyon, 925 Wp 299, carton n°81/2, dossier 4, piècen° 25-26.
20
l’indépendance du scientifique qui est à même de maîtriser la
production et de trouver dans cette méthode un auxiliaire
précieux pour ses recherches. Cependant, la photographie
constitue toujours un excédent de bagages important et fragile,
et le procédé nécessite certaines précautions. Le voyage est à
l’époque sécurisé et banalisé mais l’utilisation de la
photographie en complique les conditions du fait de la lourdeur
de son dispositif. Les difficultés sont nombreuses : lenteur
des déplacements et importance des distances, du climat,
conditions de travail limitées par la chaleur et le vent,
difficulté de préservation du matériel photographique. En
effet, la chaleur et la poussière s’avèrent être de véritables
fléaux. Les solutions chimiques utilisées s’évaporent sous la
chaleur, et la poussière complique les opérations. La chaleur
et l’humidité déforment les chambres et lorsque le matériel est
endommagé, il est difficile à remplacer. La photographie est à
l’époque un véritable défi, nécessaire pour la progression de
l’archéologie scientifique.
Si le savant n’en est pas l’auteur, il en dirige les
opérations, assurant ainsi l’intérêt scientifique de cette
production. L’invention du procédé au gélatino-bromure
d’argent26 par le physicien anglais, le Docteur Richard Leach
Maddox27 (1816 – 1902) date de 1871. Il permet la préparation
des négatifs en avance. Les premières émulsions sensibilisées
en usine et vendues prêtes à l’emploi sont distribuées dans le
26 MADDOX, Richard Leach, « An experiment with Gelatino Bromide » dans TheBritish Journal of Photography, volume 18, Londres, 8 Septembre 1871, pp. 422-423. 27 [Anonyme], « Obituary of the year : Richard Leach Maddox, M.D. » dans TheBritish Journal of Photography, 1903, p. 478.
21
commerce vers 1878. Le procédé, par sa simplicité et son faible
coût, supplée le collodion à partir des années 1880. Si la
réforme théorique des sciences de l'antiquité en tant que
sciences modernes intègre déjà l'outil photographique dès la
décennie 1860, le succès de ces premières applications reste
toutefois limité. C'est que la production des épreuves est
encore trop onéreuse et imparfaite et en restreint la
diffusion. En revanche, à partir de 1880, la pratique
photographique se généralise au sein des milieux archéologiques
sous l'impulsion d'une nouvelle génération de savants aux
compétences multidisciplinaires sortis des rangs de l'Ecole
Française d'Athènes ou de Rome, ou encore de l'EPHE. Hommes de
terrain, ils incarnent l'ère moderne de la discipline et
s'appuient sur les récents travaux d'E. Trutat et de P.
Martellière publiés en 1879. La photographie devient l'outil
privilégié de leur méthodologie tandis que l'amélioration des
procédés de développement encourage la publication des clichés.
Dès lors les conditions et les normes d'une
photographie scientifique doivent être mises en places.
2. Conditions d’une photographie scientifique
La photographie a pour premier effet de préciser la
typologie des différents types de matériel archéologique avant
de définir les codes d'une prise de vue scientifique et
d'imposer une approche documentaire et rigoureuse aux
22
opérateurs qui en sont responsables. Gérard Réveillac dans son
rapport28 a compté le nombre de clichés par thèmes29 :
- Sculpture (637 clichés)
- Architecture – site – fouilles (301 clichés)
- Epigraphie (201 clichés)
- Objets divers (187 clichés)
- Architectonique (116 clichés)
- Objets en céramique (98 clichés)
- Peinture – décor (52 clichés)
- Ethnographie (22 clichés + 81 clichés des fouilles qui
peuvent être considérés comme ethnographiques)
Cette classification du fonds delphique permet de noter les
intérêts majeurs de l’utilisation de la photographie pour le
chantier de la Grande Fouille. Cette classification a permis à
Gérard Réveillac d’étudier les techniques employées en vue de
son étude sur la conservation du fonds30. Il est important de
noter que ces thèmes correspondent aussi au classement des
clichés dans les catalogues et inventaires anciens, présents à
la photothèque de l’École française d’Athènes. Ces catalogues
ne sont qu’une tentative d’inventaire de la première partie du
XXème siècle et ne répertorient pas tous les clichés. Mais on
peut observer que le registre « A », conservé à l’École
française d’Athènes, recense la plupart des photographies de la
partie « architecture – site – fouilles ».
28 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), Dossier Administratif 4.4, EcoleFrançaise d’Athènes, Athènes, 1989, [45 p.].29 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 15.30 RÉVEILLAC, Gérard, Rapport de mission exploratoire, École française d’Athènes,Dossier Administratif 4.4, 1988 [4 p.].
23
Les photographies de sculptures représentent la large
majorité des prises de vue de la Grande Fouille selon G.
Réveillac. Les photographies prises dans un contexte
archéologique et qui sont les plus connues du grand public sont
celles des découvertes. En effet, de nombreux musées, notamment
celui de Delphes, utilisent dans leurs scénographies des
clichés d’archives représentant la mise au jour des objets
présentés. Les clichés CAT 131 et CAT 138, représentant
respectivement la découverte de l’Antinoüs et celle de Cléobis,
témoignent de cet intérêt pour l’objet au moment de relève. Une
autre série importante présente des objets photographiés à même
le site ; il est possible de distinguer, avec plus de
difficulté, des fragments de bas-reliefs ou rondes-bosses,
après nettoyage. On peut citer les CAT 032 et CAT 035, prises
de vue du chantier des Athéniens effectuées à la fin de la
campagne. Ces dernières donnent un aperçu de l’apparence du
site en pleine fouille. Une troisième partie de ces clichés est
celle qui a recours à l’utilisation d’un studio photographique
improvisé sur le site, que nous pouvons illustrer par deux
prises de vue, les CAT 133 et CAT 139. On peut y voir un tissu
sombre utilisé afin d’isoler l’objet (pour éviter, ou au
contraire faciliter le détourage prépublication). L’opération
de la prise de vue est ici très réfléchie. Les objets sont
orientés à la lumière du jour. À partir de 1903, ce genre de
prise de vue est effectué dans le nouveau musée de Delphes. Les
sculptures en relief, telles les métopes ou les décors de
frises, se voient dotées d’un traitement chimique à fort indice
24
de révélateurs, ce qui les transforme en clichés très
contrastés ; par exemple, la photographie du décor ionique du
Trésor de Marseille (CAT 126), que l’on peut citer même si la
prise de vue a été effectuée en intérieur. Nous constatons une
volonté de montrer les détails et de donner une lisibilité des
motifs.
Les photographies considérées par Réveillac comme
« photographies de fouilles » nous renseignent sur la vie de
chantier (comme par exemple la nécessité de faire appel aux
forces militaires, CAT 037), sur les infrastructures présentes
(comme l’utilisation des voies Decauville visibles sur le
cliché CAT 020) et sur les méthodes de fouilles. La lecture du
Journal de la Grande Fouille (1892-1902)31 permet d’approfondir
la connaissance sur les conditions de travail pendant la Grande
Fouille. Nous voyons des hommes sur une grande partie des
clichés de cet ensemble. C’est pourquoi on peut considérer
certaines de ces photographies comme des témoignages
ethnologiques. Les ouvriers posent sur la plupart des
photographies, soit pour donner une échelle humaine au sujet
archéologique concerné, soit pour respecter la contrainte du
temps de pose, même s’il avoisine une seconde à la fin du
XIXème siècle. Il y a peu de photographies de structures car à
part le mur polygonal, les structures découvertes ne sont pas
assez hautes pour mettre en œuvre les bascules et décentrements
que proposent les chambres photographiques. C’est souvent
pendant le dégagement ou pour l’intérêt de la localisation
31 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), École française d’Athènes, [576p.].
25
géographique que ces structures sont photographiées comme
l’Hémicycle d’Argos (CAT 029). Nous pouvons ajouter, à
caractère informatif, que l’anastylose du Trésor des Athéniens
(de 1903 à 1906) a été très photographiée, notamment grâce aux
chambres photographiques à bascule comme nous pouvons le voir
sur les CAT 231 et 233. Cela prouve que les photographes
avaient la possibilité d’utiliser à ce dessein leurs chambres
photographiques mais que l’absence de sujets de grande ampleur
ne leur permettait pas d’utiliser les bascules et
décentrements. Le terme « photographie de fouilles » peut
surprendre les archéologues d’aujourd’hui car elles ne
présentent pas les mêmes prérogatives. En effet, à la fin du
XIXème siècle, l’archéologie ne se préoccupe pas encore de la
stratigraphie et les prises de vue semblent s’intéresser aux
problèmes de topographie. Ainsi, nous pouvons observer que la
plupart des vue de l’esplanade du temple s’attachent à montrer
la relation étroite qui existait entre l’ancien village de
Castri et les fouilles en cours, comme les CAT 036 et CAT 061
l’attestent également. Les photographies de fouilles sont
prises de loin, dans un souci de montrer l’organisation de la
fouille en elle même.
Le rapport de G. Réveillac32 dénombre 201 clichés
représentant 332 inscriptions (certains clichés regroupent
plusieurs fragments épigraphiques). On observe une bonne
technique pour la prise de vue des fragments épigraphiques ; la
lumière frisante est une obligation pour une bonne lecture de
32 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903).
26
ces fragments, comme le montre le CAT 147, représentant une
inscription du Stade. Henri Weil33 ( 1818 – 1909) évoque le
bilan des fouilles :
« Les fouilles de Delphes, poursuivies avec tant de
succès par notre Ecole d’Athènes ont mis au jour,
outre le Pean d’Aristonoos, d’autres textes poétiques
que M. Homolle a bien voulu nous communiquer. Après
avoir travaillé sur des copies […] nous avons reçu
des photographies qui reproduisent assez fidèlement
l’état des pierres34. »
On peut dire ainsi que la photographie bénéficie d’une large
place dans l’étude du matériel archéologique, notamment
épigraphique. Or, Delphes est un site d’une richesse
épigraphique absolue et on peut rappeler l’intérêt de Trutat
pour le traitement photographique du matériel épigraphique35.
La catégorie des « photographies d’objets » regroupe tous
les objets ne rentrant pas dans un autre classement. Nous
constatons que les conventions photographiques, ayant pour but
de donner une idée de l’objet dans son entièreté, étaient déjà
présentes à la fin du XIXème siècle. En effet, certains objets
vont être photographiés d’en haut, comme par exemple la série
de lampes à huile (CAT 142). Pour la photographie de pièces
architectoniques, la technique de prise de vue s’apparente à
33 Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Voir PERROT,Georges, « Notice sur la vie et les travaux de Henri Weil » dans Comptesrendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles, 1910, volume 54, n8, pp. 708-762. 34 WEIL, Henri, Études de littérature et de rythmique grecques : textes littéraires sur papyrus etsur pierre, Paris, Hachette, 1902, p. 33. 35 Voir I, A, 1 : « Une généralisation de la pratique ».
27
celle utilisée pour le matériel épigraphique et pour les
reliefs comme en témoigne la recherche d’une lumière frisante,
capable de montrer sur la photographie publiée, ou même
seulement développée, la complexité du décor et des détails.
Sur la photographie CAT 126, c’est la grande maîtrise de la
lumière qui permet de révéler toute la précision du travail du
décor ionique par exemple. Pour ce qui est de la photographie
d’objets en céramique, on remarque un effort de réunion de
plusieurs objets par planche, comme pour le cliché CAT 141, à
moins qu’un détail ne puisse justifier une prise de vue
rapprochée, par exemple le décor d’un morceau de lécythe (CAT
144). On ne peut s’empêcher de se demander pour quelle raison
les archéologues ont-ils décidé de réunir plusieurs types
d’objets en céramique, tous différents, sur la même planche.
Le cliché CAT 141 nous invite à penser que c’est un choix
typologique, tout comme les clichés CAT 175 et CAT 176, même si
ces derniers ont été visiblement photographiés ensemble pour
l’étude numismatique de Svoronos36. Il ne semble pas y avoir eu
de prises de vue de matériel trouvé à un même endroit, la
fouille par étude stratigraphique n’apparaissant qu’au XXème
siècle. Les clichés de peintures et décors représentent
essentiellement les peintures byzantines des églises qui
allaient être détruites à Castri et sur le site de Marmaria au
moment des fouilles (ancien monastère du gymnase, église de la
Panaghia et l’église Saint Nicolas). Les photographies comme
les CAT 127 et CAT 128 ont été faites à la lumière naturelle,
sans flash, et ont donc nécessité un temps de pose assez
36 SVORONOS, Ioannis, « Nomismatiki ton Delphon » dans Bulletin de CorrespondanceHellénique 1896, vol. 20, pp. 5-54.
28
conséquent. On peut penser que les archéologues, conscients de
la destruction imminente de ces églises, ont considéré qu’il
était de leur devoir de conserver une trace de ces ouvrages. Le
cliché CAT 086 représentant la mosaïque des thermes de l’Est
est fort utile pour les archéologues car même si la mosaïque
n’a pas été détruite, elle a fortement souffert au cours du
XXème siècle et c’est la seule photographie la représentant
avant sa détérioration. Enfin, les photographies à caractère
ethnographique sont les moins nombreuses du fonds
photographique (il n’y en a que 22, mais on peut ajouter à ce
nombre une centaine de clichés de fouilles dont certains
éléments s’apparentent à une dimension ethnographique). Ce sont
les photographies dont on se souvient le mieux, celles qui sont
le plus publiées actuellement car elles constituent non
seulement un témoignage sur la Grèce du siècle dernier, mais
également sur les premières grandes fouilles archéologiques.
En dépit de la grande diversité des sujets représentés,
l’aspect principal se dégageant du fonds photographique de la
Grande Fouille de Delphes est l’approche documentaire des
photographes. Ces derniers sont au service de l’archéologie et
se doivent d’être très rigoureux vis à vis de la clarté et de
la précision de la représentation. Afin d’assurer le résultat
des explorations, le Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques aux Correspondants du Ministère de l’Instruction
Publique publie en 1890 Recherche des antiquités dans le Nord de l’Afrique.
Conseils aux archéologues et aux voyageurs37, ce qui permet la
37 [Anonyme], Recherche des antiquités dans le Nord de l’Afrique. Conseils aux archéologues et auxvoyageurs. Instructions adressées par le Comité des travaux historiques et scientifiques aux
29
constitution d’une photographie spécifique aux études
scientifiques. Un chapitre de l’introduction, rédigé par Henri
Saladin (1851 – 1923), architecte et photographe, est consacré
à la pratique scientifique38. Ses instructions sont bien plus
concises que celles d’E. Trutat, puisqu’il est écrit dans un
contexte d’archéologie nord-africaine, mais présente les
exigences spécifiques d’une photographie scientifique. Comme
les manuels étudiés précédemment, il souligne l’importance de
la lumière qu’il est primordial d’adapter au sujet. Saladin
insiste sur la nécessité de l’inclusion d’une échelle de
grandeur, en disposant un mètre près de l’objet photographié
tel que bas–relief, monument ou inscription. Les statuettes et
petits objets doivent être représentés sur différents angles
(face, profil et face postérieure) afin d’en assurer
l’originalité du style. La même démarche est à suivre en ce qui
concerne les monuments dont les reproductions doivent
comprendre des vues directes, des vues d’angles intérieurs et
extérieurs, ainsi que des détails. Enfin, les photographies
doivent être complétées par les mesures exactes (verticales,
horizontales et de profondeur) repérées sur des points bien
définis, quelques cotes de hauteur (colonne, entablement) et le
relevé du plan de l’édifice. Si les instructions des différents
comités sont souvent respectées, la consigne concernant
l’insertion d’une échelle de grandeur ne l’est pas toujours, ou
du moins très rarement. La photographie CAT 109 représentant
correspondants du ministère de l’Instruction Publique, Paris, E. Leroux, 1890 [252 p.]. 38 SALADIN, Henri, « Photographie » dans Recherche des antiquités dans le Nord del’Afrique. Conseils aux archéologues et aux voyageurs. Instructions adressées par le Comité destravaux historiques et scientifiques aux correspondants du ministère de l’Instruction Publique,Paris, E. Leroux, 1890, pp. 10-15.
30
l’angle sud-est du Temple intègre un élément d’échelle de
grandeur. Les dimensions peuvent être relevées et intégrées
dans les descriptions et légendes de certaines planches, comme
les photographies CAT 193, CAT 197 et CAT 198, publiées dans la
série des Fouilles de Delphes. En revanche, on peut noter l’effort
de placer une présence humaine, ce qui permet d’apprécier la
taille des monuments reproduits. Ces échelles humaines sont
visibles sur les clichés CAT 036 ou CAT 092 : les hommes
permettent de mettre en valeur respectivement le Portique des
Athéniens et la tribune centrale du Stade.
L’amélioration des procédés photographiques permet de
produire des clichés très nets : l’image se perfectionne grâce
à la mise au point d’objectifs adaptés aux différentes prises
de vue. L’invention du flash permet désormais l’application de
la photographie dans des lieux obscurs, inaccessibles
jusqu’alors : ainsi, l’intérieur d’un tombeau romain souterrain
peut être photographié dans les meilleures conditions (CAT
117). On remarque qu’il s’agit des débuts de l’application du
flash et que sa maîtrise n’est pas excellente, les ombres
n’étant pas modérées comme le montre le CAT 117, représentant
grâce à la technique l’éclairage artificiel. Si on ne sait quel
type de flash les membres de la mission delphique utilisent, il
se peut que ce soit à la technique du flash à ampoules
magnésium. En observant le cliché, on s’aperçoit que le premier
plan est trop éclairé alors que le fond reste trop sombre : la
technique n’est pas tout à fait contrôlée par l’opérateur. En
revanche, les photographies CAT 127 et CAT 128 sont réalisées
31
de manière plus réussie. Ces clichés d’intérieur représentent
les peintures byzantines de l’église de la Panaghia : il est en
effet essentiel que les peintures soient parfaitement
appréciables. On peut penser que le temps de pose a été plus
long pour la réalisation de ces clichés, afin de capturer
précisément les éléments. L’obturateur est laissé ouvert plus
longtemps, ce qui rend la photographie plus lumineuse, et ici,
plus nette.
Grâce à la typologie mise en place par G. Réveillac des
photographies réalisées durant la Grande fouille on observe la
grande diversité des éléments sujets aux prises de vue ainsi
que la volonté de traiter ceux-ci de manière scientifique,
c'est-à-dire normée, codifiée. Les Instructions du Rapport du Comité des
travaux historiques et scientifiques entérinent les spécificités d'un
cliché scientifique et les techniques devant être appliquées à
la prise de vue des différents types de matériel archéologique.
Parallèlement, les avancées proprement techniques du médium
renforcent la présence et l'intérêt de l'opérateur dans le
cadre des travaux sur le chantier et au-delà. Il s'agit dès
lors d'analyser les enrichissements mutuels voire le trajet
commun de l'archéologie qui s'institutionnalise et de la
photographie qui gagne ses galons d'outil scientifique.
3. Une réponse aux exigences des nouvelles méthodologies de fouilles
La photographie est désormais présente sur les grands
chantiers de fouilles, dont Delphes est le parfait exemple ; il
32
s’agit à présent de comprendre le complexe étudié dans son
entité et d’assurer le relevé de toutes les données suivant des
principes d’observation rigoureux. Le XIXème siècle marque
l’institutionnalisation de l’archéologie. Ce changement
s’accompagne de nouvelles méthodologies de fouilles, plus
organisées. En effet, l’archéologie est une destruction
méthodique et organisée. Il est par conséquent nécessaire
d’enregistrer le plus précisément les différents états de la
fouille. C’est une nouvelle pensée qui prend place, et se
construit autour de cette question de l’enregistrement. Delphes
s’inscrit pleinement dans cette évolution car c’est le
développement de missions permanentes qui permet à
l’archéologie de prendre son essor. La photographie devient
l’un des auxiliaires les plus utiles aux sciences de
l’observation, dont fait partie l’archéologie. Les hommes de
sciences promulguent le medium et valorisent son caractère
irrécusable, son exactitude mathématique qui répond aux
nouvelles exigences des études de l’Antiquité. La photographie
assure le succès de la fouille par l’importance et la précision
de la documentation recueillie. Les clichés sont souvent
comparés aux copies manuelles utilisées auparavant, cela
atteste de la primauté des travaux photographiques. Rodolphe
Radau39 (1835 – 1911) s’y réfère d’ailleurs en 1878 dans son
ouvrage sur la photographie et ses applications scientifiques,
La photographie et ses applications scientifiques40 :
39 Un scientifique travaillant notamment dans le domaine des mathématiqueset de l’astronomie. 40 RADEAU, Rodolphe, La photographie et ses applications scientifiques, Paris, Gauthier-Villars, 1878 [115 p.].
33
« Insister sur les avantages que l’archéologue retire
de la production photographique des monuments est
superflu. Qu’on songe seulement au temps qu’il
faudrait à un dessinateur, même habile, pour
reproduire tant bien que mal les hiéroglyphes qui
couvrent tel monument de Memphis ou Karnak ! Les
planches qui accompagnent des ouvrages comme la
célèbre Exploration de l’Asie Mineure41 de M. Georges Perrot,
la Mission de Phénicie42 de M. Renan, ou Milet, par MM.
Rayet et Thomas, sont là pour démontrer l’importance
de cette application.43 »
La stratigraphie se généralise dans les études
archéologiques à partir des années 1870. En effet, cette
nouvelle méthodologie de l’archéologie était utilisée pour les
sciences de la nature, notamment appliquée à la préhistoire. La
collaboration des architectes, déjà décisive pour réaliser les
relevés précis et exacts des constructions ainsi que leurs
restaurations ou anastyloses, est primordiale dans cette
nouvelle pratique puisqu’ils mettent au point la méthode
stratigraphique d’exploration des sites. On peut citer une des
premières utilisations de cette pratique, entreprise par
l’archéologue allemand Ernst Curtius44 (1814 – 1896), assisté
41 PERROT, Georges, Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, d’une partie de laMysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, exécutée en 1861 et publiée sous les auspices duministère de l’Instrucion publique, Firmin-Didot frères, Paris, 1862 [392 p.].42 RENAN, Ernest, Mission de Phénicie, Paris, Impr. impériale, 1864-1874 [884p.].43 RADEAU, Rodolphe, La photographie et ses applications scientifiques, Paris, Gauthier-Villars, 1878, p. 41. 44 Archéologue et historien classique entreprenant des campagnes de fouillesà Olympie à partir de 1875.
34
de l’architecte Friedrich Adler45 (1827 – 1908), en 1875 pour
les fouilles d’Olympie. La stratigraphie du site est
soigneusement réalisée et étudiée. Tous les monuments
découverts sont préservés et conservés dans un petit musée
construit à cet effet au moment des fouilles. L’archéologie se
rapproche de l’aspect matériel de l’histoire humaine et
s’émancipe des textes. Son étude se caractérise par trois
champs complémentaires d’investigation : l’observation du sol,
la typologie et la fonction des objets. La méthode de la
stratigraphie, empruntée aux sciences de la nature, s’impose à
partir des années 1880 en devenant un des principes de datation
archéologique. De plus, tous les produits de l’activité humaine
sont pris en compte dans ce renouveau de l’archéologie. L’étude
comparative devient une des méthodes des archéologues pour
étudier un objet et il est à noter que la photographie facilite
grandement ces opérations. Des sortes de classements selon la
typologie des objets apparaissent. Ces derniers vont être
décrits et classés en ensembles significatifs dans l’espace et
le temps ainsi que selon leurs fonctions, incluant leur
identification, leur mode de fabrication et leur unité.
L’archéologie fait face à un renouveau, qui la hisse au rang de
science de la nature. L’intégration de la photographie joue un
rôle décisif dans l’essor de l’archéologie moderne. Comme outil
d’enregistrement, elle assure la mise en place d’une
méthodologie scientifique sur le terrain, tant dans le domaine
des fouilles que de la conservation et de la restauration. Le
45 Architecte ayant travaillé avec E. Curtius en Asie Mineure puis à Olympieoù il prend la direction du chantier. Il est un des architectes a avoirréalisé le Musée Archéologique d’Olympie en 1885.
35
médium permet de reproduire rapidement tous les objets exhumés,
de figurer le plan précis des monuments et sites, et d’en
enregistrer le relevé et la description des différentes étapes
des travaux. Ces premières collaborations de la photographie
dans les missions scientifiques consacrent le medium comme l’un
des auxiliaires les plus précieux des sciences d’observation.
Son caractère irrécusable et son exactitude mathématique
répondent aux nouvelles exigences des études de l’antiquité qui
s’élaborent comme sciences modernes dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Ces trois phases sont intimement liées : c’est la
confrontation avec l’objet qui détermine les éléments
techniques à utiliser, et de là dépend la plus ou moins large
utilisation que l’on fera de l’image.
On a analysé les trajets communs de la photographie
scientifique et de l'archéologie institutionnelle à la lumière
des nouvelles méthodologies de fouilles telles que la mise en
place de missions permanentes et l'introduction de la
stratigraphie. On note ainsi le rôle majeur de la chambre
photographique qui s'impose comme médium figurant parmi les
plus précieux auxiliaires nécessaires aux sciences de
l'observation auxquelles l'archéologie s'intègre à la fin du
XIXe.
B) Les multiples applications de la photographie à Delphes
La Grande Fouille de Delphes se révèle en tant que
laboratoire de l'utilisation de la photographie scientifique à
36
grande échelle dont elle est l'un des premiers et des plus
marquants exemples. L'outil photographique s'impose alors comme
élément à vocation documentaire, tant dans le suivi des
différentes étapes du chantier que dans une finalité
pédagogique et institutionnelle puisqu'elle permet la promotion
des travaux archéologiques et des conclusions qui s'y
rapportent auprès de l'Académie.
1. La photographie comme témoin : une vocation documentaire
La photographie est dès son invention associée aux
découvertes archéologiques, de part sa vocation
documentaire comme tel que François Arago46 (1786 – 1853)
l’expose lors de son discours de 1839 qui officialise
l’apparition du médium auprès de la communauté scientifique.
Ainsi, la photographie est utile à l’archéologie car elle
permet de témoigner des différents états. Ces témoignages sont
utiles à l’archéologue non seulement pour effectuer ses
recherches, mais également pour appuyer ses arguments lors de
séminaires ou de séances à l’Académie de France notamment. La
photographie est, dans ce cas-là, considérée comme un témoin
irréfutable. Ainsi, pour la séance du 5 juin 1896, Théophile
Homolle envoie une lettre et des photographies pour exposer aux
académiciens les découvertes de Delphes, notamment une statue
de bronze.
« Je demande la permission de refaire ici, sur les
photographies que j’ai l’honneur de soumettre à
l’Académie, l’examen que j’ai fait à Delphes sur46 Astronome, physicien et homme politique français.
37
l’original ; d’exposer et de justifier les
conclusions qui m’ont paru et me semblent encore
résulter de cette étude, en ajoutant à ma lettre les
détails et les preuves qui y manquaient.47 »
La photographie est ici utilisée par Homolle comme un élément
prouvant l’exactitude de ses conclusions. Sa simple existence
suffit pour éliminer un doute quelconque. Elle devient ici une
preuve indiscutable, attestant l’état d’une découverte située
dans un autre pays et pouvant le transmettre dans un autre
contexte d’études. Si elle peut constituer une preuve
indiscutable, elle peut également constituer la mémoire, voire
l’unique mémoire d’une découverte ayant disparu depuis. Cette
fonction concerne un très grand nombre d’images utilisées par
les chercheurs. On peut alors observer des états différents
d’un même site ou monument. Cette capacité se révèle en
adéquation avec la définition même de la fouille
archéologique : une destruction systématique organisée. Elle ne
reste dans la mémoire des chercheurs que grâce à l’abondante
documentation photographique qui fait revivre les différentes
phases et apporte de nombreux témoignages de l’existence des
structures comme des objets dans leur contexte. La photographie
devient substitut d’une réalité disparue. Ainsi, le cliché CAT
86 représente la Mosaïque des Thermes de l’Est. Il fait partie
des photographies qui témoignent d’un état qui s’est détérioré
ou qui a été détruit par la suite. Cette photographie a été
prise en perspective. On peut se douter qu’elle a nécessité un
47 Homolle Théophile, « Statue de bronze découverte à Delphes, séance du 5juin 1896 » dans Comptes rendus de l’Académie des Belles lettres et inscriptions, volume 40,numéro 4, 1896 p. 363.
38
temps de pose assez long, de manière à rendre compte des
détails. La mosaïque a été fortement endommagée par le temps et
cette photographie est la seule preuve de son état antérieur.
Ainsi, la photographie peut non seulement témoigner de l’état
ou de la présence d’un vestige pour la recherche des
archéologues qui ont pris ce cliché, mais aussi pour les futurs
archéologues qui s’intéresseront à ce site. Les clichés CAT 127
et CAT 128 représentent quant à eux les peintures byzantines
des églises qui ont été détruites à Castri et sur le site de
Marmaria au moment des fouilles. Il s’agit de l’ancien
monastère du Gymnase, de l’Église de la Panaghia et de l’Église
de Saint Nicolas. Nos deux exemples représentent l’intérieur de
l’Église de la Panaghia. Ces photographies sont faites en
lumière du jour : elles ont sans doute nécessité un temps de
pose assez long, et sont prises par les archéologues
conscients de la destruction prochaine de ces lieux de cultes.
Mais ce genre d’étude exhaustive est courant pendant des
fouilles archéologiques. Les archéologues s’intéressent et se
documentent sur les sites et vestiges aux alentours de la
fouille. Théophile Homolle témoigne de cet intérêt dans un
article « Le Gymnase de Delphes » dans lequel il décrit
l’Église de la Panaghia48 :
« L’Eglise de la Panaghia était entièrement couverte
de peintures et conservait presque intacte sa
décoration ; nous avons photographié tous les sujets
ou personnages isolés et fait enlever les morceaux
les plus intéressants pour le musée byzantin
48 HOMOLLE, Théophile, « Le gymnase de Delphes » dans Bulletin de correspondancehellénique, volume 23, 1899, p. 561.
39
d’Athènes. M. Colin a pris copie de toutes les
inscriptions qui accompagnaient les peintures, ainsi
que les graffites qui s’y sont ajoutés au cours du
siècle. Deux inscriptions peintes à fresque dans des
écussons entourés de feuillage, l’une au dessus de la
porte principale, l’autre au dessus de la porte
secondaire de droite, font connaître la date de la
construction de l’église actuelle et le nom de son
décorateur. »
Ainsi, la chambre photographique se révèle être un précieux
outil sur le site delphique. Il remplit une fonction à vocation
documentaire puisqu'il fait état des différentes étapes du
chantier et permet en outre d'assurer, avec le Journal de la
Grande Fouille, la mémoire de certaines découvertes telle la
Mosaïque des Thermes de l'Est. Enfin la photographie, ainsi que
les nouveaux procédés de développement, permettent
l'exportation des clichés dans un autre contexte d'étude hors
du pays dans lequel se déroulent les fouilles. Par ces
multiples applications, la photographie acquiert à Delphes une
qualité de témoin irréfutable dans les conclusions apportées
par les membres de l’École française d’Athènes.
2. Les finalités pédagogiques : les envois à l’Académie
La photographie s'impose de plus comme un gage
d'authenticité des découvertes et de véracité des études qui
s'y rapportent quand vient l'heure de leur présentation auprès
40
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. En 187449,
l’Académie voit sa fonction se modifier vers celle de conseil
et de tutelle pour les services archéologiques français. Mais
l’institution reste à l’initiative de la recherche, et
notamment de sa promotion, en participant au contrôle
scientifique des grands instituts français de recherche à
l’étranger comme l’École française d’Athènes, mais aussi de
Rome et du Caire. Les nombreuses communications et rapports qui
sont adressés à l’Académie attestent de son rôle consultatif.
Cette dernière publie les comptes rendus des séances, nommées
Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, sous
l’autorité du Secrétaire perpétuel. On y trouve la publication
des discours, envoyés sous forme de rapports, de Théophile
Homolle, traitant des avancements et des recherches sur le site
de Delphes.
Par exemple, l’article « Dernières découvertes à Delphes » :
« M. Homolle expose les découvertes faites à Delphes
pendant le mois de juillet dernier et présente les
photographies de nouvelles métopes du trésor des
Athéniens. Le déblaiement du temple d’Apollon est
commencé et sera poursuivi dès la reprise des
travaux, en octobre prochain. Il rend compte des
difficultés qui ont amené la suspension des travaux ;
elles auraient été causées par le mauvais vouloir et
les abus de pouvoir de l’inspecteur grec ; elles ont
49 Date de la création de la Commission des missions par le Ministère del’Instruction Publique : nouvel organe décisionnaire sur l’attribution desmissions, rôle qu’assurait l’Académie depuis 1850.
41
été rapidement levées, grâce à un esprit réciproque
de conciliation, par le rappel de l’inspecteur.50 »
L’envoi des photographies est utile pour la présentation de son
discours scientifique à l’Académie. Les images constituent ses
meilleures alliées dans sa quête d’obtention de crédits :
Homolle accompagne presque chaque rapport de photographies. Les
archéologues ne peuvent se permettre de venir à Paris pour
présenter les progrès de leurs recherches et se doivent donc
d’envoyer fréquemment des rapports. Afin d’en faciliter
l’explication, les archéologues de Delphes demandent à un
membre de l’Académie de lire leur communication et de présenter
les documents annexes telles que les photographies. Par
exemple, en 1894, Homolle charge Henri Weil de montrer l’état
des recherches delphiques sur le sujet des textes poétiques51 :
« Des photographies et des estampages, envoyés par M.
Homolle, ont été mis sous les yeux de l’Académie. M.
Henri Weil, qui en avait reçu communication
auparavant, s’est occupé de la constitution et de
l’explication de ces précieux textes. »
La photographie devient un outil de communication des
informations lors de ces séances de consultation à l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. Ici, la méthode
photographique est considérée comme un outil utile à l’étude à
distance. La photographie permet de faciliter la compréhension
et le travail des groupes de recherche situés à Paris.50 HOMOLLE, Théophile, « Dernières découvertes à Delphes » dans Comptesrendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1893, volume 37, numéro5, pp. 290-291.51 WEIL, Henri, « Textes poétiques découverts à Delphes par l’Écolefrançaise d’Athènes » dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions etBelles-Lettres, 1894, volume 38, pp. 15-16.
42
L’archéologie est considérée comme porteuse d’une mission
éducative et est tenue de dévoiler au monde les résultats de
ses découvertes, et ce n’est que par son association avec la
photographie qu’elle parvient à des résultats probants. Lors
des séances, les membres de l’Académie utilisent les
photographies envoyées pour illustrer les discours
scientifiques sur Delphes. La seule caractéristique commune à
toutes les images du fonds photographique étudié est qu’elles
sont toutes au service d’une même discipline scientifique.
Cependant les images peuvent échapper à la spécificité d’un
discours pour entrer dans un autre : en effet un archéologue,
un ethnologue et un photographe peuvent utiliser la même
photographie, par exemple celle représentant le déblaiement de
l’escalier du théâtre (CAT 070) pour éclairer le sens de leur
propre discours. L’image reste identique mais les commentaires
qui en seront issus sont différents. L’archéologue se
concentrera sur la structure de l’escalier du théâtre, en
effaçant de son analyse la présence de l’ouvrier. On remarque
que le titre donné à l’École française d’Athènes omet de citer
cette présence : « Déblaiement de l’escalier du théâtre ».
L’ethnologue, quant à lui, se focalisera essentiellement sur la
figure de l’ouvrier grec et le photographe axera sa recherche
sur la mise au point du photographe sur l’ouvrier et donc sur
le manque de netteté des escaliers et des deux blocs du premier
plan, et sur la grande maîtrise de l’utilisation de la lumière.
Ces images peuvent également servir, dans le cadre d’une seule
discipline, ici l’archéologie, plusieurs discours spécialisés.
Ainsi, le cliché représentant deux blocs du Trésor de Marseille
43
(CAT 126) peut provoquer plusieurs discours. La première
perspective est de considérer les blocs comme faisant partie
d’une construction et de les commenter en tant que tels. Le
titre donné par l’École française d’Athènes, « Décor ionique du
Trésor de Marseille », insiste sur cet attachement. Le second
discours possible peut être celui du spécialiste en
architecture qui s’intéresse à ces blocs et les sort du
contexte de la fouille dans le but de les étudier
indépendamment. Le troisième discours peut être celui de
l’épigraphiste (mais pas dans le cas particulier de ces blocs)
à supposer que, sur une des faces de ces blocs, apparaissent
des inscriptions. La même image de base peut donc rendre des
services divers et complémentaires : les différentes
spécialisations de l’archéologie sont alors mises en œuvre. Les
séances de l’Académie sont tenues par les membres spécialisés
en toutes matières et la photographie est l’outil le plus utile
à ces sessions de travail en groupe.
Si la reproduction photographique permet d’instaurer un
dialogue régulier et facilité entre scientifiques et
institutions, la réception favorable et le crédit dont
jouissent les clichés de l’époque renforcent encore le lien
entre les hommes de terrain et leurs pairs de l'Académie.
C) Les paradoxes de l’objectivité photographique
Il faut ainsi analyser les éléments qui permettent à
la photographie de la fin du XIXe d'être au dessus de tout
44
soupçon de subjectivité. La machine et le photographe forment
alors la façade d'une objectivité photographique supposée
incontestable.
1. La machine et le photographe : façade d’une objectivité photographique
La Grande Fouille de Delphes est conduite à une période où
l’objectivité n’est pas encore remise en cause. En effet, la
technique photographique est consacrée par l’Institut de
France, une des plus puissantes institutions scientifiques du
XIXe siècle. Cette pratique est présentée comme une création
scientifique et trouve dans cette sphère savante l’un de ses
principaux champs d’application. On peut citer Victor Regnault
(1810 – 1878), Président de l’Académie des Sciences et de la
Société française de Photographie, qui se passionne pour la
photographie tout en étant un grand homme de science.
L’Académie des Sciences – qui a participé à la création de la
photographie – a un rôle déterminant dans le développement et
le succès de cette dernière. Les nombreux articles publiés dans
les différents Comptes rendus de l’Académie témoignent de
l’enthousiasme des scientifiques. La photographie a pour
spécificité le caractère mécanique de son processus
d’enregistrement. Le XIXe siècle étant le siècle de l’émulation
scientifique, il est impossible pour les savants ou amateurs de
photographie de remettre en cause l’objectivité d’une machine
créée dans un contexte scientifique. En effet, pour les
savants, les vue doivent pouvoir se substituer à l’observation
directe. On observe pourtant une volonté de l’Académie de
45
préciser l’homogénéité des prises de vue. L’Académie se rend
compte que les photographes sont loin d’avoir une formation
historique d’une parfaite rigueur. En effet, leurs différents
statuts, compétences et motivations sont très divers. Elle va
donc chercher à pallier la subjectivité dont le photographe ne
peut se défaire en rédigeant des instructions précises qui
viennent guider le choix des opérateurs sur le terrain. La
vocation documentaire de la photographie est mise à l’honneur.
La confiance en la photographie au XIXe siècle est
unanime. La photographie est vue comme un témoin irréfutable :
les sciences peuvent s’appuyer de plus en plus sur l’image
photographique pour appuyer leur discours. Cette confiance est
infinie : la photographie apporte une caution scientifique dans
la publication. Nous pouvons citer le fait que la Justice
considère la photographie comme preuve : les premières
photographies ayant valeur de pièce à conviction ont été faites
pendant la Commune de Paris en 1870. Le rôle premier de la
photographie est celui de témoin irréfutable de la réalité
physique des objets. On peut expliquer le fait que la
photographie soit considérée comme un témoin irréfutable par le
caractère singulier du négatif. Il est impossible de le créer
de façon artificielle et donc il témoigne d’une réalité
physique. L’intervention de l’homme ne peut agir que sur une
image positive (une copie obtenue après le tirage d’une
pellicule négative), ce qui veut dire que l’intervention ne
peut être effectuée que sur un vrai cliché, d’une façon
ponctuelle. La conformité possède des limites : l’objectivité
46
est strictement incommunicable car elle est individuelle. Une
objectivité collective est impossible. La précision est ce qui
séduit particulièrement les archéologues mais l’objectivité ne
sera remise en cause qu'à partir du XXe siècle. Un paradoxe
intéressant est présent dans la volonté d’utiliser la
photographie en archéologie. À l’époque de la Grande Fouille où
la confiance vis-à-vis de la photographie est la plus unanime,
l’archéologie ne l’utilise presque jamais à des fins
descriptives sur le terrain, mais surtout à des fins
documentaires. En revanche, plus tard, lorsque l'on aura
réalisé qu’une photographie donne une image différente du réel,
l’archéologue souhaitera l’utiliser comme une mémoire, afin de
décrire parfaitement la réalité.
On peut ainsi considérer la période de la Grande Fouille
de Delphes comme un âge d'or de l'objectivité photographique
qui n'est pas encore sujet à caution comme ce sera le cas au
cours du XXe siècle. Dans un contexte de positivisme
scientifique, comment remettre en cause l'objectivité d'une
machine ? Les prises de vue bénéficient d'un crédit sans bornes
et s'imposent comme un substitut à l'observation directe.
L'Académie cherche néanmoins à écarter toute subjectivité de
l'opérateur en rédigeant de nombreux précis de photographie
destinés à une application sur le terrain. De manière
paradoxale c'est en s’intéressant à la figure de l'opérateur et
en nuançant l'objectivité photographique que les clichés vont
acquérir une dimension supplémentaire : une utilisation
consciente et non plus uniquement documentaire. 2.
47
L’archéologue – photographe à Delphes
On pose alors la question de savoir qui est l'opérateur à
Delphes et comment évolue son statut ? En effet celui-ci va
passer de celui d'anonyme à celui d'un intervenant salué par la
communauté scientifique. Les archéologues plébiscitent le
travail des photographes mais ne citent jamais leurs noms : on
peut dire que le statut de photographe est de plus en plus
reconnu. La liberté consciente de ce dernier est l’une des
questions les plus importantes de la méthode photographique. Le
cadrage est un des exemples de la série de choix raisonnés
auxquels le photographe est confronté, ce qui prouve qu’il ne
se contente pas d’enregistrer une image mais y réfléchit.
Ainsi, une photographie est définie par un certain nombre de
choix conscients ou inconscients. Mais pour la photographie
archéologique, ces choix devront être conscients si
l’archéologue désire faire un cliché destiné à appuyer une
démonstration. Les choix des différents paramètres, celui du
point de vue, de l’objectif, de l’éclairage, et du choix de
techniques particulières, sont mis au service du but recherché
par le scientifique qui cherche à démontrer une thèse, aidé
d’un document. La non neutralité du procédé photographique a
pour but de servir les objectifs du scientifique quand celui-ci
veut faire état de ses convictions. P. Folliot, G. Réveillac et
A. Chéné les appellent photographies « démonstrations »52.
52 FOLLIOT, Philippe, RÉVEILLAC, et Gérard CHÉNÉ, Antoine, De la photographie enarchéologie, Aix, Université d’Aix – Marseille, 1986, p. 259.
48
Comme nous l’avons déjà étudié, la photographie sur le
site de Delphes a une vocation documentaire. Les vues doivent
idéalement, par leur caractère mécanique et donc irréprochable
comme on le pense au XIXe siècle53, pouvoir se substituer à
l’observation directe pour les savants. Les opérateurs des
missions photographiques diverses, n’ayant pas de formation
historique approfondie, utilisent des instructions précises.
Ces dernières, rédigées par l’Académie, transforment les prises
de vue éparses en une stratégie scientifique en dotant la
photographie d’une double visée : fournir une documentation
scientifiquement correcte et assurer une qualité apte à la
publication. Ce n’est pas le cas de la Grande Fouille de
Delphes car les opérateurs semblent être les membres de l’École
française d’Athènes, mais le travail des opérateurs spécialisés
enrichie d’une rigueur scientifique la photographie de mission.
A ce titre, on peut citer le travail de Jules Delbet, le
photographe de la mission d’exploration archéologique de
Georges Perrot de 186154. J. Delbet est un médecin qui se
charge entièrement de l’exploitation photographique de la
mission. Devant la limite des crédits accordés par le ministère
de l’Instruction Publique pour cette mission, la photographie
n’est pas une priorité. Si Delbet n’est qu’un photographe
amateur, il met tout en œuvre pour fournir une importante
documentation permettant l’étude exhaustive des monuments
étudiés sur place. Les archéologues ont donc un rôle important
53 Voir I, C, 1 : « La machine et le photographe : façade d’uneobjectivité »54 PERROT, Georges, Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, d’une partie de laMysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, exécutée en 1861 et publiée sous les auspices duministère de l’Instruction publique, Firmin-Didot frères, Paris, 1862 [392 p.].
49
dans les prises de vue ; si ces dernières sont réfléchies en
fonction de leur recherches, elles deviennent des arguments
d’autorités. Comme le note G. Réveillac55 : « Ce sont sans
doute les archéologues qui sont les auteurs de la plupart de
ces clichés, car on trouve dans la manière de photographier les
objets la volonté d’en donner une image facilitant la
description, sans ombres importantes et gênantes ».
Il ne subsiste que très peu de témoignages écrits sur les
débuts de la photographie à l’École française d’Athènes. Les
renseignements dans les journaux de fouilles sont très vagues,
les noms des photographes ne sont jamais précisés. Par exemple,
P. Perdrizet écrit le 17 mai 1894 dans Le Journal de la Grande
Fouille, « deux photographies ont été prises depuis le perron
de l’éphore56 ». Ainsi, les auteurs des prises de vue ne sont
pas connus, on ne sait même pas si les grandes fouilles comme
celle de Delphes utilisaient les services d’un photographe. Il
paraît peu probable que ce soit le cas pour la Grande Fouille
de Delphes. En effet les archives nous fournissent les noms des
membres et des salariés de l’École française d’Athènes et il ne
semble pas y avoir eu de photographe spécifique. En dépit des
renseignements lacunaires, il se pourrait que Henri Convert, le
conducteur des travaux, soit l’auteur d’un nombre important de
prises de vue pendant la Grande Fouille :
« L’Ecole ne saurait taire ce qu’elle doit, sous ce
rapport, au conducteur technique des travaux. Henri
55 COLLET, Philippe, « La photographie et l’archéologie : des cheminsinverses » dans le Bulletin de Correspondance Hellénique, p. 327. 56 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 143.
50
Convert fut pour elle un collaborateur précieux. Ses
fonctions étaient multiples. Achat de matériel,
installation des voies, construction des
baraquements, organisation des ateliers et des
cantines, direction des chantiers (embauchage,
surveillance, paie), outillage, traction,
comptabilité, il cumulait les spécialités les plus
complexes du métier de l’ingénieur. En outre,
dessinateur et photographe, il prenait des croquis,
levait des plans, exécutait des clichés. Jamais, si
lourde que fût la charge, ses qualités de labeur,
d’invention, de courage ne fléchirent. Sans lui, sans
la connaissance éprouvée qu’il avait de la langue et
du caractère grecs, sans l’ascendant qu’il exerçait
sur les ouvriers, sans la vigueur habile et prudente
avec laquelle il paya de sa personne, les
discussions, les conflits, les grèves eussent fait
durer des années ce qui prit déjà tant de mois.
L’homme de dévouement, d’énergie et de coup d’œil que
fut Henri Convert a sa place marquée dans le bulletin
de conquête.57»
A part le paragraphe précédant traitant de la personnalité de
Convert dans L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes58 de Georges
Radet, il n'existe que très peu de références faites à ce
dernier dans les sources de la Grande Fouille. Anne Jacquemin59
57 RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, Fontemoing,1901, p. 312.58 RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, Fontemoing,1901 [492 p.].59 JACQUEMIN, Anne, « En feuilletant le Journal de la Grande Fouille » dansLa Redécouverte de Delphes, p. 151.
51
nous renseigne sur la fonction de Convert – que nous
connaissons déjà grâce à l’ouvrage de Georges Radet : en effet,
sur la stèle commémorative de l’achèvement des fouilles on peut
y voir inscrit « Fouilles de Delphes / octobre 1892 – mai
1903 » : « Henri Convert conducteur technique ». Convert est
un des piliers de la Grande Fouille mais sa carrière ne
s’arrête pas là : Théophile Homolle l’envoie à Délos où les
références à son activité de photographe sont plus promulgués,
notamment dans les Comptes rendus de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. Par exemple, L. Couve en 1894
parle déjà du travail de Convert à Délos mais en précisant
qu’il est attaché à la Grande Fouille de Delphes :
« M. Conve fait passer ensuite sous les yeux de
l’Académie un grand nombre de photographies, avec des
plans et des dessins faits par M.Convert, ingénieur
des fouilles de Delphes60 ».
Convert étant connu pour ses talents de photographe, il est
appelé à Délos. Comme Perdrizet, il ne prend pas que des prises
de vue à Delphes mais dans toute la Grèce, selon les besoins de
l’École française d’Athènes à laquelle il est rattaché. En 1896
dans les mêmes Comptes rendus existe une allusion à Convert
mais il s’agit surtout d’une reconnaissance de son talent de
photographe :
« M. Convers [sic], ingénieur attaché aux fouilles de
Delphes et excellent photographe. Les pièces les plus
60 COUVE, Louis, « Fouilles sur l’Île de Délos » dans Comptes rendus des séancesde l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 38, numéro 6, Paris, Académie desInscriptions et Belles-Lettres, 1894, p. 419.
52
intéressantes et les mieux conservées sont ainsi
reproduites dans des fac-similés très fidèles61 ».
Cette citation est extraite d’un rapport sur les livres offerts
à l’Académie ; malheureusement pour nous, elle ne fait pas
référence à un ouvrage sur Delphes dont on aurait pu savoir de
quelles prises de vue Convert était l’auteur, mais d’un ouvrage
sur l’Acropole, Catalogue des bronzes trouvés sur l’Acropole d’Athènes par
M.A. de Ridder62. La dernière référence aux photographies de
Henri Convert concerne aussi Délos : en 1905, dans une note
d’A. Jardé63 sur les fouilles de Délos, il remercie le
photographe : « […] c’est à M. Convert que je dois les
photographies et les plans qui accompagnent cet article ». On
suppose encore qu’à sa première activité de dessinateur,
Convert associe la photographie.
L’étude comparative des prises de vue de la fouille de
Délos64 montre que c’est après la Grande Fouille de Delphes,
vers 1905, que l’École française d’Athènes prend l’habitude de
signaler le nom de l’auteur sur le négatif. Par exemple, sur
une vue de Délos de 1906, on peut voir en bas à droite le nom
de « Ducourtioux G. ». Ainsi, contrairement aux auteurs des
61 [Anonyme], « Livres offerts » dans Comptes rendus des séances de l’Académie desInscriptions et Belles-Lettres, volume 40, numéro 3, Paris, Académie des Inscriptionset Belles-Lettres, 1896, pp. 185.62 RIDDER, André de, Catalogue des bronzes trouvés sur l’Acropole d’Athènes, Paris, E.Thorin, 1896 [362 p.].63 JARDÉ, Auguste, « Fouilles de Délos, exécutées aux frais de M. le Duc deLoubat (1903) » dans Bulletin de correspondance hellénique, 1905, volume 29, p. 5. 64 Si l’École française d’Athènes a commencé ses fouilles à Délos dès 1873,c’est au début du XXe, en 1903, que le site bénéficie d’une série decampagnes annuelles grâce à la dotation financière du mécène JosephFlorimont, duc de Loubat (1831 – 1927) mais aussi grâce à l’implication deTh. Homolle et de M. Holleaux.
53
dessins et des plans qui sont toujours mentionnés dans les
remerciements des publications ou même sur la planche imprimée,
les noms des photographes ne sont pas révélés. Cela peut nous
laisser penser que le métier de photographe est moins
honorable, et que les opérateurs ne méritent pas de
remerciements dans les publications. Mais on peut aussi
admettre que les auteurs des prises de vue, qui sont des
photographes amateurs mais surtout des archéologues, ne sont
pas cités car comparée à leur travail sur le chantier, leur
tâche photographique est insignifiante. Les auteurs des clichés
ne sont reconnus qu’après la Grande Fouille, lorsque l’École
française commence à engager des photographes professionnels
comme G. Ducourtioux. La figure d’H. Convert peut être prise
comme témoin de ce changement : ce n’est que par Georges Radet
que nous savons qu’il a pris beaucoup de clichés sur la Grande
Fouille mais il existe plus de références à son activité de
photographe pour Délos.
On a analysé le contexte propice à la généralisation de la
pratique photographique et déterminé les conditions
d'intégration du médium aux travaux archéologiques. Pour la
suite de notre raisonnement, le lien avec le site de Delphes
s'opère aisément puisque la grande fouille apparaît comme le
cadre et le moteur des définitions comme des applications de la
photographie scientifique au temps de ses balbutiements.
Considérons ainsi le témoignage photographique de grande
ampleur que nous livrent les clichés réalisés à Delphes. Une
fois analysées les fonctions accordées au médium
54
photographique, il faudra se livrer à une analyse détaillée des
images quant à leurs prises de vue ainsi qu'aux traitements et
publications dont elle font l'objet.
55
II. Photographier La Grande Fouille de Delphes
A) L’organisation des fouilles et le témoignage de leurs réalisations
Après avoir répondu aux nouvelles exigences d'une
archéologie modernisée par l'investissement dans un matériel
photographique qui se perfectionne, il s'agit de rendre compte
du terrain delphique, du matériel découvert ainsi que des
spécificités de l'organisation et de la réalisation d'un
chantier de très grande ampleur : la Grande Fouille. Enfin,
l'étude des références aux prises de vue dans le Journal de la
Grande Fouille met en lumière la considérable inflation du
nombre de clichés et les connaissances qui en sont extraites.
1. Le matériel photographique : de nouvelles exigences
Si la photographie peut être rapidement considérée comme
un procédé aux nombreuses ressources, il existe encore de
nombreuses limites à la fin du XIXe siècle. Ainsi, les
restrictions du matériel photographique en empêchent la
complète exploitation. Nous pouvons citer la lettre de
56
Théophile Homolle adressée en 1894 au Ministre de l’Instruction
publique, des Beaux-Arts et des cultes65 :
« Depuis, les découvertes se sont renouvelées presque
de jour en jour : je me borne aujourd’hui à vous
adresser seulement une photographie, car nous nous
sommes trouvés à court de plaques. »
Cette phrase prouve le caractère insoluble de la situation. Le
matériel photographique intervenant dans l’exploitation et la
diffusion des études est d’une importance primordiale. Les
contraintes matérielles sont nombreuses mais nous permettent de
louer les efforts des archéologues pour l’utilisation de la
photographie. La prise de vue est méritoire : le matériel
photographique peut facilement peser plus de trente
kilogrammes. Le photographe doit préparer les plaques lui-même,
ces dernières sont d’ailleurs très fragiles. Il n’est pas rare
de casser des plaques, comme nous pouvons le voir sur le cliché
CAT 008 : la plaque s’est brisée après la prise de vue. Une
batterie de précautions permet de lutter contre ce genre
d’incidents de sorte que les archéologues sont généralement
satisfaits du résultat.
L’intégralité du fonds photographique est constitué de
photographies développées avec le procédé au gélatino-bromure
d’argent sur plaque de verre. Cette technique est
commercialisée à la fin des années 1870. Les chercheurs ayant
travaillé à cette invention sont W.H. Harisson, Richard Leach
65 HOMOLLE, Théophile, « Rapport au Ministre de l’Instruction publique, desBeaux-Arts et des cultes, au sujet des fouilles de Delphes » dans Comptesrendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 38, numéro 3, 1894, p. 208.
57
Maddox, puis John Burgess et Richard Kennett66 mais c’est à un
médecin anglais, R. L. Maddox, qu’il revient d’introduire un
nouveau type de plaques sèches efficaces. Il annonce, le 8
septembre 1871, dans le British Journal of Photography67, l’utilisation
d’une solution chaude de gélatine mélangée à du bromure de
cadmium et à du nitrate d’argent, étendue sur une plaque de
verre et séchée. La sensibilité de ces plaques étant toujours
faible, la technique est perfectionnée par Richard Kennett en
1874 et surtout par Charles Harper Bennett (1840 – 1927)68, qui
en 1878, décide de conserver plusieurs jours l’émulsion à une
température de 32C avant le lavage. C’est cette nouvelle
manière de préparer l’émulsion qui permet un gain de
sensibilité considérable. La prise de vue se fait en moins
d’une seconde, introduisant l’instantané en photographie, ce
qui élimine l’obligation d’utiliser des supports comme les
trépieds. Toutefois, en analysant le CAT 135, on remarque qu’à
Delphes les chambres photographiques sont placées sur pieds.
Les premières plaques prêtes à l’emploi sortent à Londres en
1878 sous la marque Wratten et Wainwright69 et sont disponibles
dans d’autres pays dès 1879. La caractéristique de cette
technique est de pouvoir être préparée à l’avance mais aussi
d’être utilisable longtemps (rendu possible par des plaques
bien plus sensibles que le procédé au collodion) ; cette
66 CARTIER-BRESSON, Anne, Vocabulaire technique de la photographie, Paris, ÉditionsMarval, 2008, p. 70 67 MADDOX, Richard Leach, « An experiment with Gelatino Bromide » dans TheBritish Journal of Photography, volume 18, Londres, 8 Septembre 1871, pp. 422-423. 68 Photographe anglais. 69 Frederick Charles Luther Wratten (1840 – 1926) et Henry Wainwright(18..- ?) fondent en 1877 leur entreprise à Croydon, Royaume – Uni. VoirPhotographic news a weekly record of the progress of photography, Londres, Cassell,Petter and Galpin, v. 40, num. 36, 03/07/1896.
58
spécificité du produit fait entrer la photographie dans l’ère
industrielle en lui offrant de nouvelles possibilités de
commercialisation. La technique du gélatino-bromure d’argent
sur plaque de verre est une des techniques les plus utilisées
jusque dans les années 1930 et leur fabrication ne cessera
qu’en 1950-1960. La simplicité d’usage de cette technique
entraîne un nombre grandissant d’amateurs mais aussi de
clichés. On peut remarquer que la photothèque de l’École
française d’Athènes regorge de plus de 14 000 plaques de
verres. Les plaques de verres sont préparées d’une manière
spécifique70 : dans une dissolution chaude de gélatine, on
ajoute du bromure alcalin et du nitrate d’argent de manière à
conserver un excès de bromure d’argent, très sensible à la
lumière et qui reste en suspension. En se refroidissant, cette
émulsion se transforme en gelée, qui est découpée pour être
lavée, puis refondue et coulée sur le verre. Ces plaques de
verre restent sensibles pendant plusieurs mois. Elles sont
exposées en chambre noire lors de la prise de vue, puis
développées immédiatement ou plusieurs jours après. Comme toute
technique photographique, celle-ci subit des altérations
spécifiques. La présence d’humidité peut rapidement provoquer
l’apparition d’un miroir d’argent sur les bords ou la totalité
du négatif, cette altération peut être causée par l’emballage
ou le contact avec l’air. Cet état était fréquent pour les
clichés, ce qui entraînait le recadrage de la plupart des
images avant la publication. Par exemple, nous observons sur le
cliché CAT 034 que le cadre (notamment le bord inférieur-droit)
70 EDER, Josef –Maria, Théorie et pratique du procédé au gélatino-bromure d’argent, Paris,Gauthier-Villars, 1883 [267 p.].
59
est légèrement plus sombre qu’il ne devrait l’être. La gélatine
est également un terrain très favorable pour les micro-
organismes lorsque l’humidité relative est supérieure à 60.
Les variations de température et d’humidité, provoquant des
tensions de la couche de gélatine, peuvent amener celle-ci à se
craqueler, en formant des fragments en croissants de lune, et à
se détacher du support de verre : les bords du cliché CAT 137
ont connu cette dégradation.
C’est au commencement de la fouille de Delphes que l’École
française d’Athènes s’est dotée d’un important matériel
photographique. Néanmoins cela ne veut pas dire que les
archéologues, avant cette date, n’avaient pas accès à la
photographie. Une citation du membre Antoine Grenier (1823 –
1881), reprise par Radet, nous le prouve : « Nous avons passé
ces deux derniers jours à nous daguerréotyper71 ». Grenier
écrit cela le 26 février 1848, des décennies avant la Grande
Fouille et la dotation de chambres photographiques à l’EfA. Il
semblerait qu’avant cette date les archéologues utilisaient
leur propre matériel photographique. Leurs initiatives sont à
saluer car elles sont considérées comme les prémices de la
recherche photographique. Théophile Homolle comprend l’intérêt
des nouvelles techniques pour l’étude, la publication et la
pédagogie. L’École lui doit de posséder à partir de ce moment
un véritable outillage topographique et photographique complet.
A partir de ce moment, l’École va se charger d’améliorer et
d’entretenir son matériel. Comme nous l’apprenons dans le
71 RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, Fontemoing,1901, p. 43.
60
rapport de Réveillac72, plusieurs chambres photographiques de
cette époque sont assez bien datées comme la chambre 13 x 18.
Ainsi, la chambre Sanderson dite « Chamonard » (du nom d’un de
ses plus fervents utilisateurs73) date de 1890-1893. Le rapport
de Réveillac74 fait état de deux chambres de formats
différents, du type de celles qui furent utilisées pour la
fouille de Delphes. Premièrement, nous pouvons voir la chambre
18 x 24, sans marque, et trois châssis. Ce modèle possède un
système de décentrements et de bascules. Elle est équipée d’un
objectif anastigmat Zeiss75 de 285 mm gravé « E. Krauss Paris »
vissé sur une monture « Ilex Optical co, Rochester N.Y.76 »,
d’un diaphragme à lamelles de F 5 à F 25 et d’un obturateur à
rideau. L’anastigmat est un objectif photographique mis au
point par Paul Rudolph chez Zeiss en 1890 : sa principale
caractéristique est sa capacité à corriger les aberrations
sphériques des objectifs précédents. E. Krauss77 est une
72 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 13.73 Joseph Chamonard (1887 – 1936), membre de l’École ayant travaillé àDelphes pendant la première décennie du XXème siècle. Voir FOUCART, PaulFrançois, « Les grands mystères d’Éleusis » dans Mémoires de l’Institut de France,tome 37, partie 1, 1904, p. 125 ; SEYRIQ, Albert, « Nouvellesarchéologiques » dans Syria, Paris, Geuthner, 1937, pp. 411-413. 74 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), fig. 1, p. 13.75 Carl Zeiss (1816 – 1888) est un ingénieur-opticien allemand qui, en 1872,découvre avec Ersnt Abbe (1840 – 1905), la condition des sinus d’Abbe.Cette condition est importante pour s’assurer que la qualité des images nechute pas trop brusquement en dehors de l’axe optique. Les lentilles sontde meilleure qualité. 76 Ilex Manufacturing Co. est un des trois fournisseurs principaux desEtats-Unis. La société est fondée en 1910. Voir LAHUE, Kalton C., Glass, Brass,and Chrome : The American 35mm Miniature Camera, University of Oklahoma Press,2002, p. 341. 77 Eugen Krauss, photographe allemand vendant du matériel photographique àParis. Voir KRAUSS, Eugen, Le Photo-Revolver Krauss : Gebrauchsanleitung der Firma,Paris, Krauss, 1923 [11 p.].
61
société de matériel photographique, fondée à la fin des années
1880. La compagnie bénéficie d’un permis de produire les
objectifs photographiques de Carl Zeiss. Si la chambre a pu
être utilisée sur le chantier de fouille, on peut en conclure
qu’elle a subi plusieurs modifications : par exemple, la
monture Ilex Optical co. de l’objectif est postérieure à la
Grande Fouille de Delphes. Deuxièmement, il s’agit d’une
chambre 13 x 18 de la marque Derogy78. Elle possède
pareillement un système de décentrements et de bascules et est
équipée d’un objectif avec diaphragme à lamelles incorporé de F
8 à F 44 gravé « Derogy » mais sans obturateur. L’École
française d’Athènes se dotant de chambres photographiques ayant
la particularité, contrairement aux appareils portatifs de
l’ère industrielle, de posséder des bascules arrières et des
décentrements permettant de redresser les perceptives, facilite
grandement l’examen des vestiges photographiés. L’École
complète les chambres photographiques par l’achat
d’accessoires, visibles par l’étude des inventaires79. Deux
voiles noirs sont acquis en 1892, tout comme dix châssis.
L’institution achète aussi du matériel pour permettre la mise
en place d’un laboratoire photographique rudimentaire : des
cuves pour le développement des plaques et des entonnoirs sont
ainsi achetés dans cette optique. Ainsi, les photographies sont
traitées sur place à Delphes dès le commencement de la Grande
Fouille, au moins pour le développement du négatif. En effet,
ce n’est qu’en 1893 qu’on voit apparaître sur le cahier
78 Un opticien constructeur de Paris, ayant sa boutique au 33 quai del’Horloge. 79 Cahier d’inventaire (1892), pp. 10-11, Annexe 1 dans Le fonds photographiqueancien de l’école française d’Athènes – La « Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903).
62
d’inventaire la mention de « châssis-presse 18 x 24», qui est
un cadre dans lequel sont placés le négatif et le papier
photosensible afin d’obtenir le positif d’une photographie. La
chambre Sanderson nommée « Chamonard » est équipée d’un niveau
à bulles. Si sa présence n’est pas attestée sur le chantier
delphique, cet accessoire s’applique parfaitement à l’usage
archéologique, pour faciliter la précision des clichés. Les
niveaux à bulle sont associés à l’architecture, les
archéologues cherchent à rendre la technique photographique la
plus exacte possible. Trois formats sont principalement
utilisés pour la Grande Fouille de Delphes : le 13 x 18, le 18
x 24 et enfin le 21 x 27. Les archéologues préfèrent
l’utilisation de la demi-plaque, la 13 x 18 cm, notamment pour
son faible encombrement. D’autre part, l’utilisation de ce
format précis est utile car il permet, à l’aide d’un cadre
mobile, de réaliser des clichés stéréoscopiques destinés à la
projection80. Mais nous n’avons pas trouvé de photographies
présentant les caractéristiques de la stéréoscopie (deux points
de vue, gauche et droit, de la même scène). Cette pratique ne
semble pas avoir été utilisée par l’École française d’Athènes.
On peut se poser la question du développement. En effet, si
nous ne connaissons pas exactement les auteurs des prises de
vue, nous sommes encore moins renseignés sur l’action du
développement. G. Réveillac, dans son rapport, constate que la
médiocrité du traitement des clichés permet d’affirmer qu’il ne
s’agit pas d’un travail de professionnel. Ainsi, les auteurs
des photographies, qu’il s’agisse de fouilleurs, d’architectes
80 Voir III, B, 3 : « Une autre présentation des clichés : leur projectionpendant les séances de l’Institut de correspondance hellénique ».
63
ou de photographes amateurs, assurent probablement eux-mêmes le
travail du traitement des négatifs. Nous pouvons citer G.
Réveillac parlant des catastrophes lors du développement
chimique : « On ne peut que regretter que la phase de
laboratoire n’ait pas été à la hauteur de celle de la prise de
vue81 ». La prise de vue archéologique à la fin du XIXe siècle,
notamment à Delphes, est une spécialisation. Comme nous l’avons
vu, les manuels fleurissent – notamment ceux d’Eugène Trutat
que nous avons étudiés précédemment – et la prise de cliché
devient une action réfléchie. L’éclairage est un des facteurs
les plus importants à étudier pour réussir sa photographie.
Ainsi, un ciel couvert permet de donner le maximum de détails
dans les ombres, alors qu’un soleil fort donne du relief. Une
lumière douce est fortement conseillée pour la prise de
sculptures.
Ainsi, la prise de vue à la fin du XIXe siècle relève
d’une véritable entreprise méritoire en raison du poids du
matériel et des affectations multiples et variées que subissent
les plaques de verres. Pourtant, la fréquence des découvertes
et des clichés est telle que T. Homolle déplore le manque de
plaques vierges dans sa lettre au Ministre de l’Instruction
Publique, des Beaux-arts et du Culte. C’est sous l’autorité du
directeur de l’EfA que l’Ecole se dote d’une véritable
artillerie photographique et topographique alors que les
générations précédentes pratiquaient la photographie à l’aide
81 Citation de Gérard Réveillac dans COLLET, Philippe, « La photographie etl’archéologie : des chemins inverses » dans le Bulletin de CorrespondanceHellénique, volume 120, numéro 1, Athènes, École française d’Athènes, 1996,p. 239.
64
de leur propre matériel. En outre, les avancées techniques
permettant notamment une prise de vue instantanée ainsi que
l’amélioration des procédés de développement accroissent
considérablement le nombre de clichés effectués sur la Grande
Fouille.
2. Les épreuves photographiques : un témoignage de la fouille en elle-même
Aussi les photographies ne se bornent-elles plus seulement
aux découvertes du matériel archéologique mais constituent
également un précieux témoin de l’organisation de la fouille,
une nouveauté permettant d’en figer les grandes étapes telles
que la mise en place des voies de Decauville ou encore la
destruction du village qu’on appellera désormais le vieux
Castri.
L’énormité de la masse des terres à évacuer, sur une pente
très raide, explique que la Grande Fouille de Delphes ait fait
appel à des ingénieurs. Les voies Decauville sont construites
dès le début de la fouille : plus de 1 800 mètres de voies sont
construites pour accueillir les cinquante-sept wagonnets et les
animaux de trait nécessaires. Cette nouvelle infrastructure,
mise au point par H. Convert, fait l’objet de nombreuses prises
de vue. En effet, on peut observer un certain nombre de clichés
dont les points de vue diffèrent. Premièrement nous pouvons
nous attarder sur les vues plongeantes, illustrées par les CAT
018 et CAT 020 : le photographe, se plaçant en haut du site
delphique, cherche à rendre compte de l’ampleur de la fouille.
65
On peut voir un effort de cadrage pour le CAT 018. En effet,
l’oblique de la route permet de montrer l’organisation de la
fouille dans la partie inférieure gauche du cliché. Sont
visibles des ouvriers en train de travailler, particulièrement
grâce au contraste de leurs silhouettes sur la route blanche.
La partie supérieure droite permet de situer le site dans un
paysage : le vide se situe à quelques mètres de la route, comme
pour toutes les routes de montagne. On peut voir la vallée du
Pleistos, la photographie est prise du Nord-Ouest. Cette
photographie n’est pas une photographie d’art mais le travail
de cadrage avec la diagonale des voies permet de témoigner de
l’organisation de la fouille tout en présentant une réflexion
de la part du photographe quant à la prise de vue. Le cliché
CAT 020, dont la compréhension de la topographie du site est le
sujet, est une plongée, mais d’un point de vue plus latéral que
le précédent. Ce cliché permet de comprendre les différentes
routes qui parcourent le site, le fractionnant en terrasses
pour le rendre plus facilement accessible. Cette photographie
nous renseigne sur le fonctionnement des voies Decauville : on
distingue les voies montantes et descendantes. Les wagonnets
descendants (à gauche) sont poussés à bras d’hommes qui
disposaient d’un frein, alors que ceux remontant (à droite)
sont accrochés en groupes et tirés par un cheval. Le
photographe a pris du recul et a choisi son point de vue de
façon à pouvoir montrer la situation du village par rapport aux
fouilles, la vue est prise de l’Ouest. Les autres vues
témoignant de l’infrastructure de Decauville sont prises sur le
site, face aux voies. En effet, on remarque que le photographe
66
installe sa chambre photographique sur la voie ou du moins sur
son bas-côté (CAT 021). Il y a également des vues où la
présence des voies Decauville est jugée moins importante et ne
semble pas en être le sujet principal malgré leur présence
(comme pour les CAT 096 et CAT 025). A part pour le cliché CAT
021, le photographe se place au niveau des hommes présents sur
le chantier. La hauteur de la chambre photographique permet de
donner l’impression d’avoir été prise à hauteur des yeux. Le
cliché CAT 025 permet de voir au plus près le fonctionnement
des voies Decauville : ce sont des wagonnets, que les ouvriers
remplissent de terre, tirés par des animaux (principalement des
chevaux). Les récipients des wagonnets sont mobiles et
permettent de faire tomber la terre à moindre effort par leur
système de bascule. La typographie de ce site de montagne pose
le problème du déblaiement. C’est par le cliché CAT 007 que
l’on peut voir la solution trouvée par les archéologues de la
Grande Fouille. Une décharge est montée pour faire tomber les
déblais dans le Pleistos. Cette glissière est située à
l’extrémité Ouest de la troisième voie et dans l’axe de la
deuxième. Elle présente une pente de 0,77 m par mètre sur 26 m,
ainsi qu’on le voit sur un dessin en profil de Convert82. Le
photographe choisit un point de vue latéral pour sa prise de
vue. Il facilite notre compréhension de l’infrastructure, et en
prenant un peu de recul, permet à la structure d’être visible
par un fort contraste avec le ciel, presque blanc. On peut voir
aux pieds de la décharge un groupe d’ouvriers avec un âne
utilisé pour les déblaiements. Le cadrage de la photographie ne
permet pas de voir le tas de terre déchargé, mais on peut82 CONVERT, Henri, Plan de la glissière, Legs Tournaire, numéro 15261, EfA.
67
imaginer qu’il est situé sur le flanc inférieur de la montagne.
Le nombre important de clichés représentant les voies de
Decauville rendent compte de l’importance de ces
infrastructures pour la fouille. Homolle écrit en 1893 : « Le
total des déblais atteint 28 500 m3 qui ont été transportés à
plus de 650 mètres pour épargner à la fois les cultures
modernes et les ruines antiques83 ». L’ampleur du chantier de
Delphes est impressionnante. Les archives conservées à
l’Institut de France84 nous apprennent que d’avril à août 1895,
environ deux-cent ouvriers, Grecs, Italiens et Ottomans,
travaillent dix heures par jour, sur plusieurs chantiers
couvrant plus de deux hectares. Soixante-quinze wagonnets
remontés par une petite dizaine de chevaux fonctionnent sur 4
km de voies. Les ouvriers transportent 115 748 wagonnets à la
décharge pendant l’année 1895. A la fin de 1896, c’est un total
de 386 561 wagonnets qui ont été comptabilisés depuis 1892,
représentant 193 280 m3 de terres. Le cubage pouvait atteindre
400 m3 par jour85.
Nous observerons plus tard86 les clichés pris du vieux
village de Castri, ainsi que ceux de la reconstruction du
village moderne. En revanche, l’interaction visible sur les
photographies entre les fouilles et le vieux village de Castri
est intéressante à noter dans le cadre de la représentation de83 HOMOLLE, Théophile, « Institut de Correspondance Hellénique » dans Bulletinde correspondance hellénique, volume 17, numéro 2, 1893, p. 611. 84 Carton Ms 3855 « Vues des fouilles de Delphes » dans les archives Homollede la Bibliothèque de l’Institut de France. 85 HELLMANN, Marie-Christine [dir.], Un siècle d’archéologie française à Delphes : Delphesaux sources d’Apollon, Paris, CNRS, 1992, p. 16. 86 Voir II, B, 3 « Le choix de témoigner de son expérience : le caractèreethnologique »
68
l’organisation des fouilles. Les clichés CAT 036 et CAT 061
illustrent bien ce propos. Premièrement, nous pouvons observer
sur la photographie CAT 036 que pendant le dégagement du mur
polygonal, une terrasse servant de soubassement aux maisons du
village est encore en place, ainsi que les dites habitations.
La prise de vue est faite à la fin de 1892 ou au début de 1893,
au commencement de la Grande Fouille, ce qui explique la
présence des maisons. Le photographe décide de prendre une vue
générale, sans se rapprocher de la figure humaine87, afin de
faire apparaître cette interaction peu commune d’un village de
paysans grecs et de vestiges datant de l’Antiquité grecque. Le
cliché CAT 061 est également une vue générale montrant cette
interaction entre Castri et les fouilles. A la photothèque de
l’École française d’Athènes, cette photographie porte comme
titre : Base de Gélos mais les vestiges antiques ne sont visibles
que dans la partie inférieure. Le cliché représente aux deux
tiers le village de Castri et la manière dont ce dernier
s’appuie sur la montagne. On peut voir que les fouilles créent
une sorte de terrassement. La Grande Fouille de Delphes a un
impact considérable sur le village de Castri : en le déplaçant
tout d’abord, et ensuite en changeant la typologie du terrain
du vieux village. La photographie témoigne de ces changements.
On peut affirmer, par les différents choix de cadrages, que les
photographes souhaitaient témoigner de cette interaction.
87 Ce personnage serait Henri Convert d’après la légende de la photothèquede l’École française d’Athènes. Voir II, B, 1 « Le témoignage d’unmétier ».
69
Les archéologues, en documentant leurs fouilles, peuvent
prendre deux sortes de photographies : des photographies
préparées sur lesquelles les ouvriers posent et où on ne les
voit pas réellement travailler, et des photographies plus
improvisées, prises sur le vif. Il est important de rappeler la
présence de temps de poses conséquents qui nous obligent à
relativiser la notion de « pris sur le vif ». Il existe des
photographies où les fouilles sont représentées de manière plus
« véridiques », dans le sens où le site n’est pas débarrassé de
ses outils entre autres. Ainsi, sur le cliché CAT 005, nous
pouvons apercevoir des pioches, des paniers servant à
transporter la terre. La terre n’est pas nettoyée, ne nous
laissant donc pas voir le site d’une façon très nette. Le
cliché CAT 049 nous laisse apercevoir des pioches sur le côté
droit, et la figure humaine étant de dos, nous ne pouvons donc
pas savoir s’il s’agit d’un archéologue ou d’un ouvrier. Ces
épreuves photographiques témoignent de la fouille en elle-même
et de la manière de creuser, principalement avec des pioches.
Il s’agit pour le CAT 005 de premières démolitions et pour le
CAT 049 de déblaiements, ce qui justifie l’utilisation de
pioches. Il n’existe pas de photographies où l’on peut voir
d’autres outils, tels que les piochons, utilisés pour d’autres
situations. Le cliché CAT 070 montre un ouvrier en pleine
action transportant un panier rempli de terre, on peut
s’interroger sur le caractère posé de cette photographie.
S’agit-il d’une rare photographie où le temps de pose a permis
la représentation d’un sujet en mouvement sans pour autant être
floue ? Ou bien s’agit-il d’une image « mise en scène » pour
70
laquelle le photographe a fait poser l’ouvrier de manière très
réfléchie afin qu’il paraisse en plein mouvement ? La première
hypothèse semble être la plus plausible. En effet,
l’inclinaison de la tête et la représentation de l’effort sont
trop étudiées ; les autres photographies sur lesquelles
apparaissent les ouvriers ne sont pas autant travaillées. Le
photographe semble avoir souhaité réaliser le portrait d’un
ouvrier, et pourtant cela ne semble pas être le sujet de la
photographie. Le titre donné par la photothèque de l’École
française d’Athènes est Déblaiement de l’escalier du théâtre : l’action
de l’ouvrier en est le véritable sujet. Les clichés CAT 029 et
CAT 136 sont des photographies où le chantier est le véritable
sujet. En effet, même si les ouvriers ne sont pas en mouvement,
mais immobiles pour le besoin du temps de pose ou pour une
autre raison, on peut voir à quoi ressemblait le chantier
pendant la Grande Fouille. L’ouvrier du CAT 029 au premier plan
actionne le frein des wagonnets Decauville, remplis à l’aide de
couffins. La vie de chantier est aussi représentée par des
photographies à la mise en place plus réfléchie, les
photographes y font poser les ouvriers. Les clichés CAT 096 et
CAT 123 ont été pris pour témoigner de la fouille, mais pas de
l’activité des ouvriers car leurs poses sont complètement
factices. Néanmoins ces poses permettent de nous renseigner sur
l’habillement des ouvriers : on voit qu’ils portent des
vêtements couvrant presque la totalité de leurs corps. On peut
se rendre compte du nombre important d’ouvriers sur le cliché
CAT 096 par exemple. En effet, le stade a mobilisé un nombre
assez élevé d’ouvriers, ce qui s’explique notamment par la
71
grande superficie de ce secteur de fouille. Les épreuves
photographiques peuvent témoigner de la vie de chantier comme
le montre par exemple le CAT 013, la photo de groupe des
ouvriers. Ce genre de photographie de groupe est important, il
en existe pour chaque chantier. En regardant en parallèle le
cliché CAT 124, représentant les membres de l’École française
d’Athènes, on peut se demander s’il existe une différenciation
réfléchie entre ces deux groupes photographiés. Premièrement,
dans le CAT 013, il ne semble pas y avoir d’archéologues. Il ne
s’agit donc pas d’une photographie regroupant tous les acteurs
de la Grande Fouille. La photographie « officielle » des
protagonistes de cette fouille est le CAT 124, où l’on retrouve
E. Pontremoli88 devant L. Sortais89 (tous deux Grand Prix de
Rome), Th. Homolle devant l’ingénieur H. Convert, l’architecte
H. Eustache90 devant les archéologues E. Bourguet et G.
Millet91. Sortais et Eustache ayant voyagé en Grèce et en
Turquie avec Millet et Tournaire, il est possible que ce
dernier, non visible ici, soit l’auteur du cliché92. La Grande
Fouille ayant duré près d’une décennie, les ouvriers se sont
relayés, le CAT 013 est vraisemblablement une photographie
faite pour illustrer une saison de fouille. Cependant il semble
que les archéologues n’ont fait ce genre de photographie qu’une
88 Emmanuel Pontremoli (1865 – 1956) est architecte français, Grand prix deRome en 1890. Voir « Fonds Pontremoli » dans Catalogue des collections, vol. II, 1890-1970, Paris, Académie de Paris, 1997, p. 307-318. 89 Louis Sortais (1860 – 1911), Grand prix de Rome en 1890 (ex-æquo). 90 Henri Eustache (1861 - ?), Grand prix de Rome en 1891. 91 Gabriel Millet (1867 – 1952), membre de l’École française d’Athènes. VoirLANTIER, Raymond, « Éloge funèbre de M. Gabriel Millet, membre ordinaire »dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1953, volume97, numéro 2, pp. 164-169. 92 HELLMANN, Marie-Christine [dir.], Un siècle d’archéologie française à Delphes : Delphesaux sources d’Apollon, Paris, CNRS, 1992, p. 16.
72
seule fois. Ainsi, par leur anonymat, ces ouvriers représentent
l’ensemble des hommes qui ont participé à ce chantier. La vie
communautaire est illustrée par le cliché CAT 171. Il s’agit
d’une photographie témoignant de l’intégration des archéologues
français à la culture grecque. Au vu du caractère exceptionnel
de ce genre de représentation, il s’agit d’une fête castriote
ou du moins grecque, à laquelle les membres de l’École
française d’Athènes ont participé. On peut y voir des membres
déguisés en evzones, soldats grecs, au premier plan. Les
Français et les Grecs sont rassemblés sur cette photographie.
Si les dernières photographies illustrent le côté agréable
de la fouille, il n’en est pas de même pour le CAT 037. En
effet, la fouille de Delphes ne se déroule pas dans les
meilleures conditions : les ouvriers de Castri refusent de
poursuivre le travail et l’armée est obligée d’intervenir. On
ne retrouve pas de traces photographiques de ces déconvenues
dans les archives de l’École, mis à part le cliché CAT 037.
Cette photographie montre que le photographe a eu recours aux
soldats pour servir d’échelle. Les soldats ne sont visibles que
de loin, mais sont très reconnaissables. Nous pouvons déjà
constater que, si la photographie rend compte de la vérité,
toute vérité n’est pas bonne à dire.
On constate donc l’ampleur des informations que nous
livrent les épreuves photographiques quant à l’organisation de
la Grande Fouille et aux différents temps forts qui l’ont
ponctuée. Si les photographies renseignent en elles-mêmes sur
le contexte des fouilles de l’époque, elles constituent en
73
outre un précieux appui pour les rédacteurs du Journal de la
Grande Fouille. Il s’agit alors d’analyser la fréquence des
références aux prises de vue dans l’ouvrage qui s’impose comme
le témoin exhaustif de la mission delphique.
3. Les références aux prises de vue dans le Journal de la Grande Fouille
Le Journal de la Grande Fouille93 est une source
manuscrite, conservée dans les archives de l’École française
d’Athènes. Il s’agit d’un journal, parfois lacunaire, dans
lequel les archéologues rendent compte de leurs avancements
quotidiens. Nous connaissions déjà les noms des archéologues
ayant contribué à la Grande Fouille, mais pas ceux des
rédacteurs du Journal. Lorsque ce dernier devint une pièce
d’archive, Charles Picard y ajouta des commentaires afin d'en
faciliter la lecture. Ses annotations sont facilement
reconnaissables grâce à l’encre violette : sur la table des
matières94 sont inscrits les noms des auteurs et les dates de
leur présence à Delphes :
- L. Couve : campagne d’octobre – novembre 1892
- E. Bourguet : 17 avril – 2 mai 1893
- L. Couve : 3 mai – 9 novembre 1893
- P. Perdrizet : 16 avril – 9 juin 1894 ; 9 aout – 6
septembre 1894 ; 2 octobre – 24 octobre 1894
93 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), École française d’Athènes,DELPHES 2-C DPH 23, [576 p.].94 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p.1.
74
- E. Bourguet : 11 juin – 8 aout 1894
- P. Jouguet : 7 septembre – 1er octobre 1894
- P. Perdrizet : 29 avril – 28 juin 1895 ; 28 aout – 13
octobre 1895
- G. Colin : 1er juillet – 27 aout 1895 ; 14 octobre –
7 novembre 1895
- P. Fournier : 16 avril – 21 mai 1896 ; 30 mai – 23
juin 1896 ; 30 juin – 1 er octobre 1896
- P. Perdrizet : 23 mai – 29 mai 1896
- G. Colin : 25 juin – 29 juin 1896
- G. Colin : 13 juin – 30 aout 1898
- J. Laurent et D. Brizemur : 29 avril – 22 aout 1901
Ces dates et noms d’auteurs nous aident à contextualiser
certaines prises de vue, même si les auteurs des photographies
ne sont pas nécessairement les archéologues responsables. Cette
archive est toujours d’actualité : il en existe une copie à la
maison de fouilles de Delphes; les archéologues peuvent le
consulter pour mieux connaître les découvertes de la Grande
Fouille, pour approfondir leur connaissances concernant le
contexte de celle-ci, très peu présent dans les écrits des
Fouilles de Delphes. Le Journal a fait l’objet d’un article d’Anne
Jacquemin95, le présentant comme un outil historiographique
pour les historiens s’intéressant à la Grande Fouille. Pour
nous, il s’agit de confronter le Journal au fonds
photographique constitué au même moment par les mêmes
personnes. On ne dénombre que dix-huit références à la
95 JACQUEMIN, Anne, « En feuilletant le Journal de la Grande Fouille » dansLa redécouverte de Delphes, pp.149-179.
75
photographie dans le journal mais elles sont nos seules sources
sur les prises de vue. Par ailleurs, la lecture du Journal de
la Grande Fouille fournit de précieuses informations pour
étudier le fonds photographique. Selon A. Jacquemin, il est
considéré comme un support provisoire comme en témoigne le
verso de la page de couverture (en face de la table des
matières page 1), sur lequel est recopiée l’inscription d’un
fragment épigraphique, trouvé le 12 avril 1901. Ce n’est
évidemment pas la fonction du journal, mais celle des notes et
des photographies qui les accompagnent. Le journal sert à
référencer toutes ces notes et photographies : les informations
présentes dans le Journal permettent aux archéologues de s’y
reporter. Nous pouvons signaler que ce manuscrit appartient au
genre nouveau du journal de fouille et que pour se constituer,
il emprunte nombre de codes et d’éléments au genre du journal
de voyage. Il comporte parfois des croquis, des plans
esquissés, des énumérations d’objets et des retranscriptions
d’épisodes importants tels que les découvertes. Paul Perdrizet
le désigne même sous le nom de « registre » le 28 mai 189696 ;
aussi le terme de « journal » n’apparaît-il jamais. Cette
source est donc considérée comme un registre de référence,
auquel il faut se rapporter pour exploiter au mieux les
découvertes de la fouille. En examinant la liste de registre97
du début du Journal, il est possible d’y voir un début de
catalogue dont les auteurs des prises de vue utilisent le
principe. Il inventorie dix-neuf objets (ou groupes d’objets) ;
96 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 471.97 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 2 : deux feuilles deregistre avec dix-neuf entrées collées sur la page 2.
76
leur classement vient fixer les grandes catégories de
matériel : la céramique (vases, figurines et statues),
l’architecture, le marbre (sculpture et architecture), le
bronze, la numismatique et enfin l’épigraphie. Cette volonté de
classement renvoie aux clichés CAT 130 (une figurine), CAT 134
(plusieurs figurines), CAT 141 (quatre vases à décor
géométriques), CAT 142 (dix-huit lampes à huile), CAT 143
(divers objets en bronze) et enfin CAT 144 (un fragment de
céramique). Certains archéologues sont des spécialistes de ces
thèmes : par exemple, L. Couve et E. Bourguet sont des
épigraphistes. On peut se demander si les intérêts respectifs
des archéologues sont perceptibles dans leur utilisation de la
photographie. Mais pour répondre à cette question, il faudrait
pouvoir attribuer les prises de vue à leurs auteurs, ce qui
s’avère presque impossible. Pourtant les dix-huit références
présentes dans le Journal de la Grande Fouille peuvent nous
éclairer sur certains points.
La première campagne référencée dans le Journal de la
Grande Fouille est celle de L. Couve, travaillant d’octobre
1892 à novembre 1892. Le chantier se situe au-dessous de la
Stoa des Athéniens, se plaçant dans la continuité des travaux
de B. Haussollier de 1880. La campagne est très brève et il n’y
a aucune référence faite par L. Couve à la photographie.
Pourtant il y a des photographies présentes dans notre
catalogue, dont la datation et les sujets représentés les
rattachent à cette campagne. La photographie CAT 002,
représentant l’ancien village, aurait été vraisemblablement
77
prise pendant l’été 1892. Elle n’aurait donc pas été référencée
par Couve dans son chapitre sur sa campagne hivernale mais elle
fait office d’annonciatrice de la Grande Fouille. En revanche,
les clichés CAT 005 et CAT 023 représentant respectivement les
premières démolitions et la fouille de l’Aire ont été prises
lors de la campagne de Couve. L’archéologue qui pose au milieu
de ses ouvriers sur le cliché CAT 023 pourrait être Louis Couve
puisque c’est ce dernier qui est en charge de cette campagne.
On peut se demander si le cliché CAT 036 où l’homme pourrait
être Convert a été pris pendant cette première campagne ou plus
tard, début 1893.
E. Bourguet retranscrit la deuxième campagne de fouille,
qui a lieu du 17 avril 1893 au 2 mai 1893. Son texte n’est que
très peu précis, cependant à la date du samedi 22 avril 189398,
nous pouvons voir la première référence au travail
photographique du chantier : « pris photographie du chantier :
voie du bas, [emplacement] Kanello. Liberis ». Une annotation
au crayon à papier à été effectuée concernant cette note : il
s’agit des annotations faites par M.-E. Notara, une archiviste
de l’École française d’Athènes, qui travailla sur le Journal en
197399. En face de la note de E. Bourguet, M.-E. Notara corrige
l’information par cette annotation : « 23 avril Photogr.
Chantier ». « Liberis » fait référence à une des maisons du
vieux Delphes, appartenant à G. Liberis100. Bourguet utilise la
98 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 13.99 JACQUEMIN, Anne, « En feuilletant le Journal de la Grande Fouille » dansRedécouverte de Delphes, p. 149.100 Cadastre et Catalogue des habitants de Delphes, carton Ms 3860 « Plandes fouilles de Delphes, les environs, le Parnasse… » dans archives Homolle
78
maison Liberis en tant que référence topographique, renvoyant
à l’emplacement du Trésor des Athéniens. Dans sa publication de
1932, « Les comptes du IVe siècle101 » on remarque qu’il utilise
trois fois cette référence topographique pour l’étude de
fragments épigraphiques. En revanche, concernant le mot
« Kanello » employé dans l’annonce de projet photographique
par Bourguet en avril 1893, n’ayant pas trouvé de mention dans
nos recherches, nous pouvons imaginer qu’il s’agit également
d’une référence topographique établie d’après une maison d’un
castriote nommé Kanello. Bourguet annonce des photographies des
« voies du bas » : il doit être question de prises de vue
représentant les nouvelles voies Decauville achetées dès 1892
par l’École française d’Athènes. Les notes de Bourguet dans le
Journal de la Grande Fouille sont très succinctes mais on note
au 16 mai une notice consacrée à la découverte de la tête du
Sphinx des Naxiens. Or, la photographie CAT 186, représentant
les fragments du sphinx retrouvés au pied du mur pélasgique, a
été prise quelques temps après la découverte au vu de sa
situation sur le chantier. Nous savons que le sphinx n’a pas
été laissé sur le chantier très longtemps car il a fait l’objet
de plusieurs études photographiques en intérieur et d’un
moulage pour le Musée du Louvre102. Parmi les moyens de
diffusion rapide des résultats des fouilles delphiques, on
remarque en effet une large utilisation des moulages en
plâtre : par exemple, la façade Ouest du Trésor de Siphnos est
reconstituée en 1900 dans l’atelier de moulage du Musée du
de la Bibliothèque de l’Institut de France. 101 BOURGUET, Émile, Les comptes du IVe siècle dans Fouilles de Delphes, 1932 [357 p.].102 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909, p.45.
79
Louvre et est exposée trois fois dans Paris (Exposition
universelle de Paris, sur le palier d’un des escaliers du
Louvre puis enfin dans la cour vitrée de l’École des Beaux-
Arts). Pour en revenir au CAT 186, on peut se demander pourquoi
Bourguet n’inscrit pas la prise de vue dans le journal : était-
il vraiment nécessaire de donner la description de cette
découverte par écrit alors que celle-ci avait précisément été
photographiée sur son lieu de découverte ? Bourguet est un
épigraphiste, il est intéressant de confronter cet intérêt avec
les photographies. Sa spécialité est perceptible dans le
Journal : en effet, il détaille plus ou moins les inscriptions
trouvées. Si l’archéologue n’est pas l’auteur des
photographies, est-ce lui qui guide l’opérateur ? Dans ce cas,
pouvons-nous trouver une corrélation entre l’intérêt que porte
Bourguet à l’épigraphie et les photographies faites pendant ces
campagnes ? La campagne de 1893 semble nous indiquer que non,
mais il faut étudier sa deuxième campagne de fouilles, faite
l’année suivante. La campagne de fouille suivante, qui est
celle de Couve, dure du 3 mai au 9 novembre 1893, ce qui est
considérable ; mais cet archéologue ne fait jamais référence
aux prises de vue effectuées sur son chantier, s'il en a été
faites, ce qui est tout de même probable. Il ne cite pas une
seule fois la méthode photographique lors de l’écriture de ses
notes dans le Journal.
P. Perdrizet est le membre de l’École française d’Athènes
qui détaille le plus ses fouilles. Ce souci de précision vient
apporter tout au long de la Grande Fouille une dizaine de
80
références aux prises de vues dans le Journal. En 1894, il est
chargé plusieurs fois de la bonne tenue du journal : une
première fois du 16 avril au 9 juin, puis du 9 août au 6
septembre, et enfin du 2 octobre au 24 octobre. Au long de sa
rédaction, on peut s’apercevoir qu’il hésite entre l’inventaire
détaillé et le compte rendu de la fouille103. C’est certainement
pour cette raison qu’il est le plus grand collaborateur du
Journal. Son souci du détail le rend plus à même de répertorier
les prises de vue, ce qui prouve que la photographie fait
partie intégrante du chantier de fouille. La première référence
à la photographie faite par Perdrizet date du lundi 7 mai
1894104, on y lit : « Aujourd’hui on a photographié les fouilles
devant le fronton O.- Devant le fronton E. – et depuis le
parvis du temple, le grand mur du Moyen-Âge qui descendait le
long du côté N. » En face, sur la page précédente, on peut voir
une annotation de M.-E. Notara, l’archiviste de l’École
française d’Athènes : « Photographies du temple. Fronton O. »,
qui vient faire écho à l’écrit de Perdrizet. L’archiviste
semble s’être concentré sur les photographies du Fronton Ouest
uniquement. Le jeudi 17 mai 1894105, Perdrizet écrit : « Deux
photographies ont été prises depuis le perron de la maison de
l’éphore : l’une donnera la vue générale du chantier du bas,
et, au bout, le trésor des Siphniens ; l’autre le monument
semi-circulaire des Argiens ». Il s’agit de la référence la
plus connue des chercheurs. En effet, ces photographies sont
parmi les seules à avoir été précisément identifiées : la
103 JACQUEMIN, Anne, « En feuilletant le Journal de la Grande Fouille », p.154.104 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 127.105 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 143.
81
première, la vue du chantier du bas avec le trésor des
Siphniens correspond au cliché CAT 033 alors que la deuxième,
représentant l’Hémicycle d’Argos, est la photographie CAT 029.
Ces clichés ont été pris à la suite, on remarque que les
ouvriers n’ont que très peu changé de place. On observe que
pendant la fouille du Trésor de Sicyone l’hémicycle des Rois
d’Argos est déjà dégagé. On peut remarquer que Perdrizet
emploie le futur : en effet, la prise de vue à la fin du XIXe
siècle ne permet pas un développement immédiat. Perdrizet
connaît les sujets photographiés, il en a peut-être même
commandé les prises de vue, mais n’ayant pas vu le résultat sur
plaque de verre il doit se limiter à l’utilisation du futur.
Cet emploi donne tout son sens à l’action de photographier, qui
passe aussi par le lent développement. Si Perdrizet n’assistait
pas à la prise de vue, il en a tout de même été informé par le
photographe. Cette mention du 17 mai 1894 a été soulignée, ce
qui témoigne de son importance, et annotée106 par Picard. Il ne
reprend que les noms des monuments photographiés, ce qui lui
permet de pouvoir s’y référer plus facilement. La lecture du
Journal nous révèle que quelques jours plus tard, le 24 mai
1894107, Perdrizet voulant réfléchir sur ses trouvailles,
propose une reconstitution de la frise du trésor des Siphniens.
Il illustre le Journal de croquis pour préciser ses recherches.
Ainsi, ce trésor fait partie des préoccupations de Perdrizet à
la fin mai 1894 et il décide de l’intégrer à une prise de vue
(CAT 033). La même année, E. Bourguet reprend son chantier du
11 juin au 8 août (1894). Il note dans le journal deux séries
106 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 143. 107 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 155.
82
de prises de vue durant son chantier. La première série est
faite le jeudi 26 juillet 1894108 : « Photographies du chantier
du haut (plateformes d’accès en avant du temple, N.E. ; et
opisthodomes) ». C’est la première référence photographique à
laquelle Picard ne prête pas attention. S'il n’est pas possible
d’identifier les photographies, il doit s’agir de photographies
faites en 1894 représentant la rampe du Temple ; nous pouvons
citer le cliché CAT 049 : le sujet et la date correspondent
mais ce n’est en fait pas la prise de vue du 26 juillet 1894.
La seconde photographie dont fait état E. Bourguet date du
samedi 4 août 1894109 :
« A l’E des offrandes de Gélon, le mur de mauvaise
époque qui vient perpendiculairement à la ligne du
pilastre et de la colonne trouvés le 30 juillet, et
qui empêche de dégager l’autre colonne (ou les autres
colonnes) qui peuvent faire suite à celle là, doit
être bientôt démoli. Il a été photographié
aujourd’hui.»
La caractérisation « mauvaise époque » est intéressante, fixant
les objectifs de la Grande Fouille au monde hellénique. Nous
sommes en présence d’une des premières références à l’utilité
photographique dans le Journal : la méthode photographique
permet de garder une trace de ce mur condamné à la destruction.
Perdrizet continue du 2 au 24 octobre la fouille qu’il avait
commencée au printemps de la même année. Il note encore une
référence à la prise de vue sur le chantier le jeudi 18 octobre
108 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 219. 109 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 229.
83
1894110 : « M. Convert prend 2 photographies, l’une du Grand
autel (regardant le N., l’autre de la face orientale du temple,
a regardé le N.E. » Pour la première fois, une source donne le
nom d’un des opérateurs des prises de vues : M. Convert111, le
conducteur technique. La lecture du rapport fait ce jour-là
permet de nous éclairer sur les conditions de vie de chantier.
En effet, le 18 octobre, les ouvriers démolissent les maisons
près de l’église, on peut deviner que ce travail ne nécessite
pas de surveillance particulière. Ce temps libre a-t-il
favorisé la décision de Convert de faire des prises de vues ?
Toujours est-il que la photographie peut être faite après la
fouille, sans la présence des ouvriers. Les chantiers se
succèdent entre Bourguet et Jouguet mais on ne retrouve aucune
mention de prises de vue. En revanche, en 1895, Perdrizet fait
référence à six prises de vue. Au jeudi 9 mai 1895112, Perdrizet
mentionne une photographie, mais le paragraphe est illisible.
Quelques jours plus tard, le samedi 11 mai 1895113 il écrit :
« Deux photographies sont prises, l’une des tombeaux romains,
l’autre des tombeaux byzantins (Pythia) ». Le 16 mai 1895114, il
s’agit d’une « photographie de l’Hellinico, depuis la Voie
Sacrée, avant le remblayage ». Perdrizet et les autres
archéologues précisent très souvent l’axe de la prise de vue,
de manière à pouvoir en faciliter l’identification et la
datation : ce qui prouve que ces photographies sont destinées à
être manipulées par des connaisseurs de Delphes et confirme
110 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 271.111 Voir II, B, 1 « Le témoignage d’un métier » 112 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 293.113 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 295.114 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 299.
84
leur valeur scientifique. En lisant la page du 16 mai 1895, on
remarque qu’il peut ne pas exister de rapport entre le travail
des ouvriers et celui du photographe puisque les ouvriers
fouillent « l’église et le théâtre ». Le lundi 20 mai 1895115,
Perdrizet note : « Photographie, le matin, du chantier du N.E.
du [mot illisible] - & du chantier à l’O. de l’École
française ». Cette mention n’est pas écrite de la même main
que le reste de la page et est inscrite au crayon à papier. La
précision concernant l’heure ne permet pas à l’archiviste M.-E.
Notara d’avoir noté cette référence. Le doute est permis, on
peut se demander s’il ne s’agit pas d’un autre archéologue ou
même de l’opérateur des prises de vue. En l’espace d’un mois,
Perdrizet donne cinq références photographiques dans le Journal
de la Grande Fouille : il se peut qu’un photographe amateur ait
été présent à ce moment-là ou bien que Perdrizet ait demandé et
répertorié plus de photographies qu'à son habitude. Quelques
jours plus tard, le samedi 8 juin 1895116, Perdrizet fait état
d’une autre prise de vue mais la mention illisible ne permet
que de deviner le mot « photographie ». En octobre 1895,
Perdrizet mentionne par deux fois l’utilisation des chambres
photographiques sur le site : une première le mercredi 2
octobre 1895117 au Temple et une deuxième série plus importante
faite le mercredi 9 octobre 1895118. La première série annonce :
« Le déblaiement et le travail d’aménagement poursuivis au
temple amènent la découverte de nouvelles [mots illisibles] du
temple, tant sur les dalles de calcaire que sur les blocs de
115 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 301. 116 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 319.117 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 407.118 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 411.
85
tuf. Des photographies en sont prises. » Il s’agit des
photographies de découvertes, alors que l’imposante série du 9
octobre semble être bien plus importante : « Photographies du
chantier (Théâtre ; E. du Théâtre ; chantier du contrebas de
l’Hellenico) ». Il semblerait que l’opérateur ait profité de la
mise en œuvre de sa chambre photographique pour faire état des
résultats des recherches sur une grande partie du chantier.
On a vu dans quelle mesure la photographie s’impose en
tant que témoin des multiples facettes de la Grande Fouille
lorsque les précédentes missions étaient dans l’obligation de
borner leur témoignage aux médiums écrits tels que le Journal de
Fouille. Celui-ci se voit désormais enrichi des références aux
prises de vue permettant une connaissance illustrée des travaux
et du contexte dans lequel ils s’inscrivent. C’est en premier
lieu l’évolution des procédés mécaniques qui permet
l’accroissement exponentiel du nombre de clichés destinés aux
découvertes mais également, et c’est une nouveauté, l’accès à
une vision précise de l’organisation des fouilles et des
événements qui l’agitent. Aussi l’apparition des chambres
photographiques sur le chantier permet-elle un élargissement du
regard porté sur celui-ci.
B) Photographier le vivant
Restent encore les facettes non moins cruciales de la
pratique et de l’attitude de l’archéologue ainsi que celle du
photographe. Ces deux aspects sont renseignés par les nombreux
clichés qui s’y rapportent. C’est la photographie qui semble
86
apporter la réponse la plus précise à ceux qui s’intéressent à
la figure de l’archéologue en Grèce à la fin du XIXe siècle et
à la figure de l’auxiliaire qui désormais l’accompagne. Bien
que certaines photographies soient posées et soient l’objet
d’une mise en scène, la plupart permettent une connaissance
sans filtre du contexte de fouille et de ses acteurs.
Contrairement aux rapports écrits à vocation rétrospective, la
photographie autorise une approche descriptive d’un instant
pris sur le vif sans traitement a posteriori de son auteur.
L’outil photographique, dans sa capacité à élargir le champ de
ses sujets au delà du matériel archéologique, livre également
une véritable connaissance ethnologique. Avec la photographie,
une approche quasi-exhaustive des différents aspects du
chantier devient possible. Au delà de son strict intérêt
archéologique, elle capture le vivant.
1. Le témoignage d’un métier
Interrogeons-nous à présent sur le témoignage du métier
d’archéologue rendu par la photographie. Que représente le fait
d’être archéologue en Grèce à la fin du XIXe siècle ? Les
épreuves photographiques apportent un éclairage sur cette
fonction.
Premièrement, le cliché CAT 124 présente presque tous les
membres de l’Ecole française d’Athènes, comme nous l’avons vu
précédemment119. Cette photographie nous informe d’une
complicité naturelle ou peut-être factice. Le cliché est du
moins une preuve de leur présence collective sur le chantier de119 Voir II, A, 2 : « Conditions d’une photographie scientifique ».
87
fouille. Les politiques extérieures ont un grand impact sur les
fouilles. En effet, Georges Radet nous apprend120 que « entravée
par la guerre gréco – turque, la campagne de 1897, à part
quelques sondages, ne comporta que des travaux d’aménagement ».
Ainsi, comme nous l’avons déjà souligné, le métier
d’archéologue ne se résume pas à fouiller. Il s’agit de
coordonner, d’aménager et d’équiper le site. G. Radet nous
renseigne ensuite sur les principales actions entreprises cette
année-là : « restauration de l’entrée du stade, toilette
générale du champ de fouilles, rapprochement des morceaux épars
d’architecture ou de sculpture, remontage des caryatides,
installation méthodique du Musée.121 »
La situation géographique de Delphes ne facilite pas la
tâche des archéologues. En effet, le site se situe en montagne,
sur un terrain accidenté. On peut citer G. Radet :
« Matériellement d’abord, les fouilles ont été
dirigées d’une façon remarquable. A cette altitude,
sur un terrain aussi violemment accidenté, avec une
population d’un caractère âpre et difficile, en
présence d’obstacles sans cesse renaissants et
toujours imprévus, dont ceux-là seuls qui ont vécu en
Orient peuvent soupçonner la variété énervante, il
fallait une singulière pratique des pays neufs pour
120 RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, Fontemoing,1901, p. 311. 121 RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, Fontemoing,1901, p. 311.
88
tout mettre, rapidement et sûrement, à pied
d’œuvre.122 »
La localisation de Delphes mais surtout la difficile
accessibilité du site est à prendre en compte dans notre étude,
même si on retrouve cette caractéristique dans nombre des sites
fouillés en Grèce. Théophile Homolle répertorie les différentes
tâches des différents membres ou archéologues. Ainsi, comme
nous l’avons déjà observé123, la figure d’Henri Convert est à
retenir pour la logistique interne de la Grande Fouille de
Delphes, mais il n’est pas le seul :
« Scientifiquement, M. Homolle sut grouper autour de
lui une élite de talents rares. Tournaire,
l’architecte des fouilles, lui apporta cette union
intime du savoir et du goût, qui est la marque
distinctive des successeurs de Blouet à l’Académie de
France. Il y a lieu de se féliciter que le plan de
publication de Delphes appelle un artiste de cette
valeur à collaborer dès les premières pages. Couve,
qui ouvrit les chantiers, Bourguet, Perdrizet, qui
suivirent de près, Colin, Fournier, Laurent, qui
furent associés aux dernières campagnes, n’ont pas
moins bien mérité d’Apollon. Les uns eurent la
conscience patiente et robuste ; d’autres, la
vivacité souple et lucide ; tous, l’amour de l’École
et la foi dans la mission à remplir.124 »
122 RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, Fontemoing,1901, p. 311. 123 Voir I, C, 2 : « L’archéologue – photographe à Delphes ».124 RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, Fontemoing,1901, p. 312-313.
89
Les archéologues doivent également faire preuve de diplomatie
constante à l’égard de la population locale. Les prémices de la
Grande Fouille, qui ont été marquées par plus d’une décennie de
négociations, peuvent se ressentir à Delphes pendant la
fouille. Ainsi, comme nous l’avons vu sur le CAT 037, les
archéologues ont dû faire appel aux forces de l’ordre. Le
métier d’archéologue peut relever d’une certaine habileté
politique.
L’archéologue ne participe pas à la fouille véritable :
les membres de l’École française d’Athènes vont en effet
engager des ouvriers et se contenter de surveiller les
différents secteurs. Ainsi, sur le cliché CAT 241 représentant
une vue d’ensemble, nous pouvons observer la différence de
tâches exécutées par les ouvriers, et celles incombant aux
archéologues. L’archéologue est installé à une table en bordure
du chantier, ici du stade. Il semblerait que cette table lui
serve pour écrire, peut être le Journal de la Grande Fouille.
En effet, les différents archéologues remplissent ce journal le
plus souvent sur le chantier. L’homme n’est pas reconnaissable,
il est cependant identifiable en tant qu’archéologue de par sa
position, mais aussi grâce à son habillement : il porte une
veste claire et un chapeau pour se protéger du soleil. Les
ouvriers, eux, posent pour le photographe, contrairement à
l’archéologue et à l’homme de dos qui semble interagir avec
l’archéologue. Ils sont en plein travail, l'un d'eux porte un
panier rempli de terre sur son dos. Grâce à cette photographie,
90
nous pouvons imaginer la vie de chantier des archéologues à
Delphes : ils s’occupent de l’organisation et de superviser.
Leurs notes sont très utiles pour leurs recherches et
publications. Il semblerait qu’ils délèguent une responsabilité
à un ouvrier, peut être celui qui se tient devant l’archéologue
assis ; ou peut-être demandent-ils aux différents ouvriers de
venir leur rendre compte de leurs découvertes, rapports dont
ils se serviront pour leurs notes. La première hypothèse est la
plus plausible, les archéologues ne formant pas tous les
ouvriers à l’archéologie, mais un seul d'entre eux, qu'ils
nomment responsable. Ainsi, le métier d’archéologue de terrain
est complété par des recherches et des publications. Le cliché
représentant l’Adyton du Temple, CAT 045, montre la façon dont
la recherche est concomitante avec le travail d’archéologue, et
comment la photographie peut le prouver. En effet, nous
distinguons les annotations sur la photographie, inscrites en
vue de la publication et de la diffusion des recherches.
Chaque lettre correspond à un bloc de l’Adyton et permet de
faciliter le commentaire de ce vestige. Le cliché CAT 057, une
vue de la terrasse Est, montre un archéologue non identifiable
au milieu des nombreux blocs architecturaux de la terrasse. Les
nombreux morceaux de sculpture découverts dans la zone du Nord-
Est du Temple ont été alignés dans un début d’inventaire et
d’étude. Cette photographie prouve le besoin de se familiariser
avec les objets en vue de les étudier.
91
Lors d’une conférence reproduite dans le Journal of the Royal
Institute of British Architects125, Homolle déclare :
« Après avoir exhumé les monuments, nous étions
tenus d’en assurer la conservation, d’en faciliter
l’accès, d’en rendre l’intelligence aisée aux
amateurs, comme aux savants. […] Quand la
restauration n’était pas possible en original, nous
l’avons faite en moulages, afin de parler aux yeux et
de replacer les œuvres d’art dans les conditions où
leurs auteurs avaient entendu qu’elles fussent
vues. ».
Le rôle de l’archéologue n’est pas seulement d’exhumer et
d’étudier des vestiges anciens mais aussi de les présenter à un
public. On peut renvoyer au CAT 192, une photographie prise
dans le Musée de Delphes, qui présente la colonne des Naxiens
restaurée. Cette idée est importante pour Homolle qui cherche à
présenter la Fouille de Delphes au grand public par l’usage de
la photographie notamment. Ce dernier profite de l’intérêt du
public français pour l’archéologie pour présenter à travers le
journal L’Illustration126 le site de Delphes. L’article est largement
illustré par des gravures réalisées d’après des dessins, mais
également d’après des photographies du fonds. En effet, les
lecteurs profitent de reproductions par la gravure de trois
photographies d’Antinoüs. On peut noter la volonté de présenter
cette statue, pourtant romaine, au grand public. C’est
125 HOMOLLE, Théophile, « Le trésor de Cnide, et les monuments de l’artIonien à Delphes » dans Royal Institute of British Architects Journal, 1904, pp. 29-42. 126 SAGLIO, André, « Les fouilles de l’ancienne Delphes » dans L’Illustration,samedi 8 décembre 1894, pp. 480-481.
92
d’ailleurs la photographie CAT 131, la découverte de
l’Antinoüs, qui devient la plus connue du fonds photographique.
Si ce n’est pas la photographie la plus représentative du
travail de normalisation de la photographie pour une
application archéologique, elle est devenue de nos jours une
parabole du dialogue entre les âges. Le manque de netteté du
visage des ouvriers semble interroger le spectateur et le
confronter à un questionnement sur le temps. Cette
photographie, jamais publiée du temps de la Grande Fouille, car
ne répondant pas aux codes de la photographie archéologique,
est maintenant le cliché le plus demandé à la photothèque de
l’École française d’Athènes.
Ainsi, le témoignage photographique de la fouille
delphique permet d’éloigner la fonction de l’archéologue de son
image d’Epinal de grand explorateur qui prédomine au XIXe
siècle de celle de l’archéologue-chercheur qui lui est
supplantée au XXe siècle. En effet, si l’archéologue ne
participe pas directement aux fouilles, sa fonction ne se borne
pas à la supervision des travaux des ouvriers qu’il dirige. Son
rôle peut même revêtir un aspect politique comme ce fut le cas
avec l’intervention militaire du tout début de la Grande
Fouille ou encore le ralentissement du chantier lié à la guerre
gréco-turque de 1897. En outre, sans avoir la certitude de
l’implication totale et exclusive de H. Convert dans les prises
de vue, la figure de l’archéologue se confond encore à la fin
du XIXe siècle avec celle du photographe. Le travail d’A.
Jacquemin dans son article « En feuilletant le Journal de la
93
Grande Fouille » livre de précieux renseignements sur la
fonction et les modalités du travail photographique à Delphes.
2. Les trois moments de la prise de vue (le Journal de la Grande Fouille) : témoignage du métier de photographe ?
Les images des grandes découvertes de la Grande Fouille de
Delphes et des autres fouilles du XIXe siècle sont ancrées dans
la culture populaire. Ces prises de vue de découvertes
archéologiques renvoient aux photographies des grands
explorateurs, celles-ci faisant partie de l’inconscient
collectif. Les archéologues des premières grandes fouilles
organisées, dont la Grande Fouille fait partie, sont associés à
cette tradition de la découverte fantaisiste. Mais nous devons
souligner la différence majeure entre les grands explorateurs
et l’archéologie institutionnelle : les conditions sont bien
plus propices à la collecte d’informations lors des fouilles.
Les clichés de la Grande Fouille amènent à se questionner
sur la manière de représenter les découvertes archéologiques.
A. Jacquemin127 dans son article « En feuilletant le Journal de
la Grande Fouille » met en lumière les trois moments de la
prise de vue pour cette fonction photographique. La première
occasion pour la prise de vue est celle de la découverte. La
deuxième catégorie de photographies est celle qui représente
les découvertes à même le site peu de temps après leur mise au
jour. Enfin, elles sont photographiées après la mise en
127 JACQUEMIN, Anne, « En feuilletant le Journal de la Grande Fouille » dansLa redécouverte de Delphes, pp. 149-179.
94
condition du matériel ; il s’agit de photographies plus
professionnelles, ou du moins à la composition très arrangée.
Les clichés de la Grande Fouille soulignent une fonction
photographique primordiale au XIXe siècle : celle
d’immortaliser l’archéologue à côté de sa découverte. Ainsi,
lors de la mise au jour de Cléobis, partie intégrante du groupe
des Jumeaux argiens (CAT 137), Homolle pose pour la prise de vue.
Le choix de sa pose est intéressant : en effet, il décide de
tourner la tête vers la statue. Ce soin accordé à la pose
présage la future utilisation de ce cliché à des fins de
promotion personnelle. Homolle sait que ses découvertes lui
permettront d’accéder à des fonds financiers, notamment à
l’Académie des Belles-Lettres. Sa pose nous permet de souligner
cette construction d’image en vue d’une diffusion. La
photographie n’est pas prise à l’instant t de la découverte,
mais dans les moments qui l’ont suivi. En effet, il est fort
probable que Homolle n’ait pas été présent à cet instant
précis, mais plutôt qu’il ait été appelé immédiatement. Le
photographe a attendu que la sculpture, le Biton, soit dégagée
et identifiable pour installer sa chambre photographique. Les
hommes présents autour de ce dernier ne sont pas de simples
fouilleurs comme on peut le déduire non seulement par leur
habillement mais aussi par leur présence autour de la grande
découverte. Cette photographie ne correspond pas au moment de
la découverte par les fouilleurs, mais à celui de l’analyse
primaire des archéologues. On peut même s’interroger sur cette
hypothèse. En effet, il serait plus probable que le moment de
95
l’analyse primaire ait été fait avant de prendre la
photographie. Cette prise de vue permet aux archéologues de
rejouer cette séquence. Homolle va noter à ce moment-là, la
« choquante maladresse » de sa facture, ou encore que « la cage
thoracique, les flancs, l’abdomen et le ventre également mal
venus »128. Homolle ne laisse pas paraître son sentiment de
malaise devant la statue qu’il contemple pour la photographie,
il se comporte en archéologue intéressé par toute découverte,
qu’elle soit mineure ou majeure. L’un des principaux intérêts
du Journal de la Grande Fouille est de donner une idée des
premières réactions pendant les découvertes. Le Journal relate
les découvertes des Jumeaux Argiens, jamais nommés Cléobis et
Biton, mais « statue d’Apollon » et « torse masculin
archaïque ». Pour la découverte de Cléobis, on peut voir la note
suivante au jour du 28 mai 1894129 :
« Dans le mur d’une maison, à l’avancement de la
voie du bas […] on trouve la partie inférieure d’un
torse masculin archaïque : les bras étaient collés au
corps »
On peut souligner qu’il n’y a pas de mention de la prise de vue
à cette entrée du 28 mai 1894. L’analyse n’est que sommaire, il
s’agit d’identifier rapidement la découverte par son lieu de
mise au jour et par une référence à son aspect physique. Le
Journal de la Grande Fouille permet de retrouver facilement les
objets découverts par une note concise. Le cliché CAT 138,
appelé Découverte de « Cléobis », est un autre exemple de
128 Collet, Philippe, « La photographie et l’archéologie : des cheminsinverses » dans Bulletin de correspondance hellénique, vol. 120, 1996, p. 327. 129 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 161.
96
photographie prise d’une découverte encore en terre. Le titre
de la photographie a été écrit postérieurement, comme pour les
autres clichés de ce fonds photographique. C’est pourquoi nous
n’intégrons pas l’analyse des titres à notre étude. L’auteur du
titre a confondu les deux Jumeaux argiens : Cléobis et Biton ;
or, ce cliché CAT 138 représente Biton et non pas Cléobis.
Comme nous l’avons dit ci-dessus, les archéologues de la Grande
Fouille ne nomment pas dans le Journal de la Grande Fouille les
Jumeaux argiens mais les intitule « Apollons archaïques130 ». Le
lieu de découverte et son contexte sont très importants dans
les notes du Journal, ils nous permettent, dans notre étude, de
comprendre la photographie. En effet, on peut remarquer que les
fouilleurs ou archéologues ont placé une planche de bois pour
soutenir la statue. Ils souhaitaient la conserver in situ, dans
la position précise dans laquelle elle avait été découverte peu
de temps auparavant. Sur ce cliché on peut remarquer l’absence
de présence humaine. Cette photographie a été prise avec un
contraste appuyé, ce qui fait ressortir la blancheur du marbre
par rapport à la terre. Un autre cliché (CAT 163) représente
une découverte de statue, celle de l’Aurige, le jour de sa mise
au jour, le 28 Avril 1896. Cette photographie présente la
statue toujours en terre, mais dégagée. La statue n’a pas été
retrouvée verticale, contrairement aux Jumeaux d’Argos qui se
prêtaient bien à la photographie de démonstration par leur
positionnement. La partie basse de l’Aurige, horizontale, ne
facilite pas la prise de vue. En effet, le fait qu’elle soit
horizontale sur le sol ne nous permet pas de bien l’observer
sur une première photographie de découverte. Les chambres130 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 161.
97
photographiques, malgré leur basculement, ne permettent pas de
prendre une photographie aérienne. Ainsi le photographe est
contraint de réfléchir à une autre photographie de découverte.
Cette photographie n’est pas très bien cadrée, les hommes sont
coupés. Cela peut s’expliquer par différentes hypothèses : le
photographe, dans son empressement, n’a pas bien cadré, ou bien
le cliché a subi des modifications, et afin de pouvoir se
focaliser davantage sur l’Aurige, l’auteur de ces modifications
s’est vu dans l’obligation de couper des figures humaines.
Ainsi, comme nous allons le voir131, les modifications de
l’image sont nombreuses et changent la perception que nous
pouvons avoir de ces photographies. Nous pouvons citer les
clichés CAT 182 et CAT 183, respectivement des agrandissements
des photographies étudiées précédemment. En effet, ces
modifications touchent à des éléments caractéristiques des
clichés, comme ici le cadrage, lequel entraîne une analyse
formelle différente.
Le deuxième moment de la prise de vue est celui qui vient
après la découverte et avant la mise en condition des vestiges.
Cela ne veut pas dire que le matériel ne soit pas nettoyé ;
bien au contraire, on peut noter un effort de dégager toute la
terre des découvertes. Ces photographies sont prises à même le
site, les découvertes sont dressées sur leur base ou bien
contre un mur. Ces clichés peuvent être utilisés immédiatement
131 Voir II, C, 3 : « Intervention manuelle sur le cliché en vue de lapublication ».
98
en vue d’un rapport ou dans un but pédagogique. On peut ainsi
lire dans le Bulletin de correspondance hellénique en 1893132 :
« M. Homolle annonce ensuite le commencement des
fouilles de Delphes et en communique les premiers
résultats avec des plans de chantier et les
photographies des inscriptions et des monuments
figurés découverts jusqu’à ce jour »
Les photographies auxquelles fait référence cet article sont
prises peu de temps après le début des fouilles ; on peut donc
se douter qu’il n’y a pas encore de lieu, comme le Musée qui
sera établi en 1903, qui permette de prendre des vues de
manière plus élaborée. La photographie représentant les
fragments du Sphinx (CAT 186) est un bon exemple de
photographie prise quelques temps après la découverte. Les
archéologues ont réfléchi à l’aspect physique du Sphinx dès sa
découverte : les différents fragments sont vite remontés. On
remarque que le Sphinx est pris de profil pour permettre à la
photographie de le représenter intégralement, dans l’entièreté
de ses détails. Le cliché CAT 059 de l’emplacement de la
fouille des Trésors, à l’Ouest du Temple, représente la
fouille en cours : on peut voir des ouvriers en plein travail.
Un groupe d’hommes, sur la droite, est en pleine étude
épigraphique. Ils sont penchés sur un bloc et on peut observer
que leur habillement est différent de celui des fouilleurs –
notamment celui du premier plan qui est pieds nus et en
haillons – en effet, ils portent des vestes, des chemises et on
peut même identifier sur le chercheur du milieu des bottes en
132 HOMOLLE, Théophile, « Institut de Correspondance hellénique » dans Bulletinde correspondance hellénique, vol. 17, 1893, p. 181.
99
cuir. Cette photographie témoigne de l’étude des archéologues
sur le site. En prenant une loupe pour étudier cette
photographie, on peut discerner des inscriptions sur les blocs
du premier plan. Ainsi l’étude se fait directement sur le site,
comme on peut le voir sur le CAT 057. Un élément intéressant
qui émane du fonds photographique est à noter ici, dans le
cadre d’une photographie prise directement sur les sites après
la découverte, mais nous ne nous pencherons pas sur cette
question qui fera l’objet d’une analyse133. Les clichés CAT 133
et CAT 140 représentent des statues entièrement dégagées et
déjà traitées comme matériel archéologique. La photographie CAT
133 montre l’effort que fait le photographe pour avoir des
prises de vues les plus professionnelles possible, malgré les
conditions précaires qu’offre le site de Delphes. Les
archéologues réfléchissent à une manière de représenter au
mieux, le plus scientifiquement possible, ces statues. La mise
en place d’un fond noir, un drap porté à bout de bras par deux
hommes, est ce qui se rapproche le plus d’un studio
photographique. La deuxième photographie est celle d’une statue
d’Apollon Citharède. On observe sur celle-ci que la statue est
référencée ; en effet elle porte la marque « 1876 » sur sa
base. On ne sait pas si elle est située dans son emplacement
d’origine mais elle est posée sur une base plus importante,
certainement pas d’origine.
Les photographies les plus élaborées sont celles qui ne
sont pas effectuées sur la fouille. Elles sont prises dans un
contexte muséal à partir de 1903. Avant cette date, les133 Voir II, C, 1 : « Intervention du photographe dans la mise en scène ».
100
photographies les plus réfléchies – c’est à dire fabriquées
pour mettre en valeur un objet archéologique – sont prises à la
Maison de fouilles ou bien à Athènes lorsque certaines y sont
envoyées. Sur le cliché CAT 126, représentant un décor ionique
du Trésor de Marseille, nous pouvons voir que la photographie
est réfléchie. Les deux fragments ne sont pas placés de manière
véridique, les deux blocs sont placés l’un sur l’autre pour le
cadrage de la photographie. On peut voir un socle pour soutenir
les deux blocs. On voit une attention particulière portée à la
lumière ; cette attention est aussi perceptible sur les
photographies prises sur le site, mais les possibilités
qu’offre la lumière en intérieur sont bien plus importantes. La
lumière est frisante, afin de faire ressortir les reliefs de la
taille. Une photographie de diverses statuettes, CAT 134, est
semblable au cliché étudié précédemment (CAT 126). On remarque
que les statuettes sont prises en intérieur, posées sur des
planches de bois. Le photographe a réfléchi à l’axe de
positionnement de chaque statuette pour exploiter au mieux son
aspect. Ainsi, les statues représentant des corps ou des bustes
humains sont face à la caméra, alors que la tête de cheval est
placée presque de trois-quarts, de façon à mieux rendre compte
de son aspect. On peut noter que les statuettes sont regroupées
pour plus de rapidité et par mesure d’économie. L’Aurige, dont
nous avons étudié la photographie de découverte (CAT 163), est
placé à l’abri des regards, comme nous pouvons le voir sur les
deux clichés à l’entrée CAT 178. L’Aurige est redressé,
réassemblé et placé devant un fond noir à l’intérieur d’une
réserve avant d’être visible au Musée de Delphes. La prise de
101
vue est imparfaite, en effet nous pouvons observer que malgré
l’effort de placer un fond noir pour détourer la statue de
bronze, le champ de la caméra intègre des éléments étrangers à
l’étude. Ces deux prises de vues sont envoyées à l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres pour les comptes rendus que
Théophile Homolle se devait d’illustrer. Cette planche prouve
le caractère peu conventionnel des envois à l’Académie : les
photographies peuvent être celles de fouilles, imparfaites, et
se doivent de retranscrire la réalité de la fouille. Cette même
statue est photographiée à nouveau dans un cadre muséal. Le
Musée de Delphes est inauguré en 1903134, c’est à dire à la fin
de la Grande Fouille de Delphes. Le cliché CAT 161 montre la
statue de l’Aurige sur son socle de marbre dans le Musée. On
peut d’ailleurs voir, coupé par le cadrage de la photographie,
la patte de l’un des chevaux. Le photographe s’est-il efforcé
d’utiliser au mieux la lumière venant du côté supérieur gauche
pour faire ressortir les plis du chiton ? Nous pouvons
observer, par nos analyses de statues delphiques, que les
photographes de la Grande Fouille de Delphes ne privilégient
pas les plans rapprochés des statues. Ils préfèrent rendre
compte de l’aspect de la statue en entier afin de pouvoir en
faire une analyse plus importante. Ceci peut s’expliquer par le
fait qu’il est plus exceptionnel à la fin du XIXe de prendre
plusieurs photographies d’un même matériel archéologique.
Ainsi, les photographes ne peuvent se permettre de prendre un
134 Le musée est inauguré le 2 mai 1903, dessiné par l’architecte AlbertTournaire (1862 – 1958) et financé par le philanthrope Andréas Syngrós(1830 – 1899). Le premier musée est rudimentaire, ne compte que six sallesoù les œuvres ne sont pas placées de manière thématique ni chronologique.La construction d’un nouveau bâtiment commence en 1935.
102
plan rapproché, ainsi que plusieurs autres vues du même sujet.
Toutefois nous observons que la Colonne des Danseuses est une
exception : en effet, le cliché du CAT 132 représente un plan
rapproché d’une des figures féminines de profil. Les détails de
sa coiffure, mais également ceux de son visage, sont ainsi très
visibles et rendent mieux compte du travail de taille. Cinq
photographies présentes dans notre catalogue nous permettent de
nous intéresser aux clichés d’études, pris après le
conditionnement du matériel et le travail de typologie. En
effet, les épreuves représentant quatre vases à décor
géométrique (CAT 141) et la série de lampes à huile (CAT 142)
ont été prises après une classification effectuée selon leur
fonction et leur aspect. Ces typologies permettent d’étudier
plus rapidement les objets par comparaison, mais on perd toute
information – à moins de les avoir référencés individuellement
– sur leur provenance géographique. Ainsi, la série des lampes
à huile va rassembler toutes les lampes retrouvées sur le site
de Delphes, mais sans inclure à l’étude les différentes strates
(et donc la datation) et les différentes localisations. On ne
peut donc pas savoir si les archéologues ont répertorié les
différentes lampes à huiles avec leurs informations
respectives. La planche de divers objets en bronze (CAT 143) ne
résulte pas d’une typologie fonctionnelle mais d’une typologie
effectuée par type de matériel : ici, le bronze. Ces différents
objets n’ont sans doute rien à voir entre eux mais sont
réunis ; les archéologues peuvent, grâce à ce rassemblement,
observer les différentes techniques du travail du bronze. Les
conventions qui existent aujourd’hui pour la photographie de
103
petits objets (monnaies ou lampes à huile par exemple), que
l’on considère comme « à deux dimensions » et qui sont, comme
tels, photographiés en vue de dessus, étaient déjà mises en
pratique à la fin du siècle dernier. Les archéologues, par la
mise en condition du matériel archéologique, peuvent prendre du
temps à observer et à analyser des détails de décors par
exemple, comme pour le cliché CAT 144 qui représente le décor
d’un morceau de lécythe. Le photographe choisit le plan
rapproché pour traiter au mieux ce tesson de céramique et la
focalisation en est parfaite. Il n’y a pas beaucoup de plans
rapprochés dans le fonds photographique de la Grande Fouille.
En effet, le photographe préfère prendre de la statuaire plutôt
que des objets – bien moins présents dans le fonds - et les
fragments de céramiques ne sont pas au centre des
préoccupations archéologiques de la Grande Fouille. Les
rassemblements de matériel archéologique sur une seule épreuve
prouve le caractère exceptionnel de la photographie et le
besoin de faire des économies. Le petit autel à brûle parfum du
CAT 145 montre bien le besoin de restriction dont fait l’objet
la photographie. Le photographe sépare sa planche de 18 x 24 cm
en demi plaques de 18 x 12 cm. Ces deux clichés ont le même
sujet mais le photographe choisit de montrer deux faces
différentes. On a affaire à un manque de rationalité pour ce
cliché : en effet, l’emploi de l’espace est mauvais ; l’autel
n’est pas assez proche de l’objectif pour permettre un bon
discernement des scènes l’illustrant, en dépit du fait que le
photographe avait séparé sa planche de 18 x 24 cm en vue d’une
étude optimale des différentes scènes. Enfin, le cliché CAT 148
104
illustre le soin accordé à la mise en condition du matériel
archéologique et aux photographies qui en résultent.
L’épigraphie oblige le photographe à se soucier davantage de la
lumière. En effet, aussi bien sur le terrain qu’en atelier, les
auteurs des prises de vues doivent utiliser la lumière frisante
nécessaire à la bonne lecture. Cette photographie CAT 148 est
prise devant un fond sombre, le photographe a très bien utilisé
la lumière mais nous pouvons remarquer que le point de vue est
légèrement trop haut.
En raison de l’incertitude qui règne alors quant aux
frontières entre la figure de l’archéologue et celle du
photographe, l’article d’A. Jacquemin et notre propre étude
relative aux fonctions du photographe sur le chantier
renseignent également sur le mode opératoire des archéologues.
On sait ainsi que l’étude épigraphique était le plus souvent
effectuée à même le site. Pour ce qui est du strict travail de
prise de vue on distingue les trois temps d’A. Jacquemin qui
répondent à des impératifs différents d’utilisation des
clichés. Le premier est une prise en terre au moment de la
découverte. Il est le premier outil pédagogique disponible à
l’envoi à l’Académie ou à l’insertion au Journal de la Grande
Fouille. Le deuxième temps est celui d’un premier nettoyage du
matériel et d’une mise en place rudimentaire, à même le site.
Ces clichés étant destinés à l’étude ou au détourage en vue de
la publication de ceux-ci. Enfin le troisième temps est celui
de l’immortalisation définitive du matériel qui constitue en
quelque sorte la photographie officielle. Elle est effectuée en
105
dehors du site de fouille, dans le musée de Delphes à partir de
1903 et au sein de la maison de fouille antérieurement à la
construction de celui-ci ou encore à Athènes où le matériel est
parfois envoyé.
3. Le choix de témoigner de son expérience : le caractère ethnologique
Hormis les clichés qui nous informent sur les activités de
l’archéologue et du photographe sur le site delphique, on
compte nombre d’entre eux adjacents à la photographie du
matériel ou de l’organisation de la fouille. Il s’agit
d’analyser ces photographies à caractère ethnologique qui
constituent un élargissement supplémentaire à l’étude
delphique. Le fonds photographique de la Grande Fouille de
Delphes présente une spécificité qui fait aujourd’hui sa
renommée. En effet, le grand public s’intéressant de plus en
plus à l’anthropologie, l’étude de l’Homme et de ses multiples
spécificités culturelles est devenue au cours du XXe une
discipline à part entière. Pourtant, lorsque les prises de vues
sont faites pendant la Grande Fouille, les archéologues ne s’en
soucient pas autant. En examinant le fonds, nous remarquons
toutefois un certain intérêt pour la vie des habitants de
Castri, ainsi qu’une volonté d’observation des coutumes
locales. Selon le rapport de G. Réveillac135, les photographies
à caractère ethnographique sont les moins nombreuses du fonds :
ce dernier en dénombre vingt-deux. Il précise cependant qu’on
135 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 15.
106
peut aussi qualifier d’ethnographiques certaines photographies
qui ont pour objet la fouille, ce qui élève le nombre à cent
trois prises de vues ethnographiques. En effet, les
photographies des hommes qui travaillent sur le chantier et qui
révèlent leurs vêtements et leurs outils constituent un
témoignage sociologique, comme les vues du village de Castri,
dont les maisons peuvent intéresser une vision ethnologique et
sociologique. Il n’existe qu’une vue (CAT 037) rapportant un
épisode spécifique de la vie du village : les soldats faisant
évacuer le site lors des émeutes de 1892. C’est la seule
photographie que l’on puisse qualifier d’historique,
puisqu’elle témoigne de l’intervention militaire par la
présence de deux soldats sur le Portique des Athéniens. Peu de
temps après l’ouverture du chantier, le 10 octobre 1892, un
conflit éclate avec la population de Castri qui s’oppose à tout
travail avant le paiement de l’indemnité accordée pour leur
expropriation :
« On eut à réprimer une émeute des habitants : les
chantiers furent envahis, les équipes dispersées, les
déblaiements interrompus. On ne put les reprendre que
l’année suivante, de haute lutte, sous la protection
de la force armée.136 »
Les prises de vues du fonds photographique sont assez
évocatrices de la vie des habitants de Castri, notamment de
leur expropriation illustrée par les vues des maisons du vieux
Castri, puis de celles du nouveau Castri. En effet, l’ancien
136 RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris, Fontemoing,1901, p. 307.
107
village de Castri se situe à l’emplacement de l’actuel site de
Delphes. Les clichés CAT 002 et CAT 003 donnent une idée de
l’ampleur de la perturbation que l’ouverture du chantier de
fouille a provoqué dans la vie de village. En effet, le CAT 002
montre son étendue avant la fouille, et il suffit de comparer
avec des vues plus tardives comme le CAT 020, pour se rendre
compte de l’état de destruction du vieux village. La prise de
vue du CAT 002 a en effet été prise au tout début de
l’ouverture du chantier, sans doute en été 1892 ; on peut voir
au centre du cliché des ouvriers commençant à travailler sur le
chantier de l’Aire. Sur le CAT 003 (dont le visuel n’est
malheureusement pas présent dans notre catalogue), qui
représente comme le CAT 002 une vue du village, on peut
distinguer en bas du cliché une équipe d’ouvriers qui
travaillent sur l’installation des voies Decauville. Les
photographies CAT 005 et CAT 008 sont prises à la même période,
en 1892. L’état des chantiers nous montre qu’il s’agit des
premières démolitions au regard du niveau de la terre. Nous
avons une vue du nouveau village de Castri, CAT 017, qui est
prise de la même manière, de loin. Cette photographie montre
les premières maisons du nouveau village. Ces maisons sont
aujourd’hui plus que centenaires, on remarque qu’elles sont
toutes très proches les unes des autres. De nos jours ces
bâtisses sont au centre du village, qui s’est légèrement étendu
au cours du XXe siècle. Cette vue nous permet d’observer le
développement qui s’est effectué pendant un siècle dans le
village, ainsi que l’environnement naturel du site. Par exemple
sur ce cliché nous pouvons – à l’aide d’une loupe placée dans
108
le fond – voir qu’Itéa n’est qu’un village et que le Parnasse
ne connaît pas encore sa future exploitation de bauxite137.
Quelques clichés permettent d’avoir une idée de la vie très
modeste que connaissaient les castriotes. En effet, la maison
de Castri, sujet de la prise de vue CAT 006, semble miséreuse.
En choisissant à dessein cette maison, le photographe cherche à
donner une impression d’extrême pauvreté. Bien sûr, cette
masure a réellement existé mais en décidant de centrer sa
chambre photographique uniquement sur cette maison en bois, on
peut se demander si le photographe ne cherche pas à en faire
une figure représentative, archétypale de toutes les autres
maisons. Toutefois, sur le même cliché, la maison de droite ne
nous semble pas si délabrée : elle est en pierre. Les autres
vues du village semblent confirmer cette hypothèse car les
maisons sont construites dans des matériaux moins précaires,
plus durables, comme le montre la vue de la Fontaine (CAT 009)
et celle de plusieurs maisons de Castri (CAT 011). On peut voir
que les bâtisses sont faites de pierres, de manière à isoler du
froid pendant l’hiver. En effet, les murs de pierres présentent
une forte inertie, emmagasinant la chaleur intérieure et la
restituant. L’été, l’inertie thermique permet de conserver les
températures fraîches de la nuit tout au long de la journée. On
remarque que les toits des maisons (même la plus miséreuse du
cliché CAT 006) sont couverts par des tuiles. Cette technique
limite les déperditions de la chaleur, grâce à une isolation
continue et durable. Castri se situe en effet dans la montagne,
et il n’est pas rare qu’il neige à cet endroit. Dans une
137 CHASSAING, Monique, « Le complexe industriel d’aluminium de Grèce » dansMéditerranée, volume 7, numéro 4, 1966, pp. 295-311.
109
optique de préservation de la mémoire de l’ancien village, la
photographie joue également un rôle d’importance. Il ne reste
que ces plaques de verres pour conserver la mémoire de l’ancien
village détruit. P. Amandry écrit en 1981 : « Castri a disparu
de la mémoire des vivants : les derniers Delphiens qui avaient
joué dans les rues du village sont morts il y a une dizaine
d’années.138 » Le CAT 009 nous montre l’omniprésence de Delphes
dans le village de Castri : elle représente la fontaine où la
Pythie était censée boire de l’eau de source afin de rendre un
oracle. Elle correspond au numéro 335 du plan Convert139.
L’équipement photographique mis en place sur la Grande Fouille
permet de préserver l’image de ce que les ambitions
archéologiques ont détruit. Les archéologues, par leurs
différents cadastres140, cherchent à garder une trace de ce
vieux Castri. Dans ce cas précis l’utilisation de la
photographie inaugure une discipline archéologique responsable,
même lorsque la destruction est inévitable.
Les plaques de verres représentant l’Église Saint Nicolas
du vieux Castri (CAT 004) et la procession des habitants pour
un mariage (CAT 014) sont deux témoignages de la vie culturelle
des castriotes. La photographie de l’église témoigne surtout de
l’apparence d’un lieu de culte utilisé au XIXe siècle en Grèce.
Cependant, il n’existe pas d’étude approfondie sur ce bâtiment
138 AMANDRY, Pierre, « Chronique delphique » dans Bulletin de correspondancehellénique, volume 105, numéro 2, 1981, p. 747. 139 HOMOLLE, Théophile, « Topographie de Delphes » dans Bulletin de correspondancehellénique, volume 21, 1897, Pl. XIV-XV. 140 HOMOLLE, Théophile, « Topographie de Delphes » dans Bulletin de correspondancehellénique, volume 21, 1897, Plan Convert : Pl XIV-XV et plan Tournaire de1896 : Pl. XVII.
110
ou sur les rites pratiqués. Par exemple, on regrette l’absence
d’indication concernant le lieu de l’espace funéraire. Les
auteurs des prises de vues s’intéressent à la vie quotidienne
des castriotes, mais ne peuvent en faire un sujet d’étude à
part entière. La photographie CAT 014 est l’un des clichés les
plus connus du fonds photographique. Ceci peut s’expliquer par
le fait que le port du costume traditionnel est une des
caractéristiques les plus pittoresques, avec ses chemises
bouffantes et fustanelles (la jupe plissée traditionnelle). À
l’époque de la Grande Fouille, cette photographie n’est jamais
publiée : elle a été prise pour témoigner des coutumes
grecques, mais son sujet ne peut s’intégrer à un discours
scientifique de la fin du XIXe - début XXe. De nos jours, le
grand public raffole de ces vues folkloriques. En effet, les
photographies les plus regardées un siècle plus tard sont
celles qui intègrent des éléments humains, donnant à ces images
un caractère pittoresque. On observe ainsi un intérêt
rétroactif pour ce type de clichés permis par les chambres
photographiques, alors que les traces écrites auraient pu
éluder ce genre d’informations, ne permettant que peu de
renseignements sur des éléments adjacents qui ne font pas
strictement partie du matériel archéologique. Il existe dans le
fonds photographique plus d’une dizaine de clichés où l’on voit
que le photographe s’est particulièrement concentré sur les
figures anonymes des ouvriers du chantier. Si le sujet n’en est
pas essentiellement les ouvriers, sujet trop pauvre pour faire
face aux sujets nobles tels que les vestiges découverts, cette
masse ouvrière permet d’illustrer au mieux la fouille et le
111
labeur accompli. Les auteurs des photographies utilisent les
figures anonymes des ouvriers grecs pour mettre le site en
valeur : par comparaison, ces hommes deviennent dans certains
cas les modèles des photographes. La seule photographie sur
laquelle les ouvriers constituent le sujet principal est le
cliché CAT 013 : il représente les ouvriers sur la terrasse
supérieur du Gymnase. On peut dénombrer un peu plus de quatre
vingt dix ouvriers placés en deux rangées bien distinctes. Le
cliché a été bien pensé, l’auteur de la prise de vue cherche à
montrer le visage de chacun des ouvriers : certains vont donc
se mettre plus loin, sur un tas de terre, afin de surplomber
légèrement l’assistance (sur la droite). Cinq ouvriers grimpent
dans l’arbre central et y prennent la pose : il s’agit donc
d’une photographie peu formelle, et l’on pardonne cette prise
de liberté. Ce cliché peut toutefois être très officiel : il
témoigne de l’étendue du site et de la main d’œuvre. Il peut
très bien avoir été montré à l’École française d’Athènes par
fierté, mais nous ne sommes pas en position de l’affirmer.
Cette plaque de verre se place au début de la tradition de la
photographie de groupe pour commémorer une fouille. On remarque
qu’au premier plan, volontairement excentré sur la gauche, un
petit groupe se démarque de la masse ouvrière, notamment par
leurs vêtements : il s’agit des archéologues de l’École. Ils
sont coiffés de canotiers et habillés de vestons et de nœud
papillons, contrastant beaucoup avec les habits plus simples
des ouvriers. Ces derniers sont habillés de costumes
traditionnels grecs divers. En effet, le monde hellénique
comporte une multitude de styles vestimentaires, que l’on peut
112
qualifier de costumes populaires et traditionnels. Après
l’indépendance de la Grèce141, les habits changent, influencés
par les costumes des villes : on remarque une uniformisation.
Le costume rural subit la même évolution. Les costumes locaux
sont à présent associés aux évènements importants, et cette
photographie en fait partie. On peut voir des ouvriers en
chemises, en plastrons et vestes mais surtout en fustanelles,
celles-ci donnant au cliché un caractère très typique. Sur les
clichés CAT 070, CAT 092, CAT 096 et CAT 123 on peut voir plus
facilement les vêtements des ouvriers de Delphes, composés
principalement de chemises blanches, de plastrons, de
fustanelles mais aussi de pantalons souples en tissu. Le cliché
CAT 092 permet de voir un homme grec en fustanelle assis et
posant dans la tribune centrale du stade. On peut se demander
si le photographe, pour rajouter du cachet à sa prise de vue,
n’a pas choisi cet ouvrier à cause de sa fustanelle. Le
pittoresque du cliché serait fabriqué de toute pièce. Les
autres photographies sur lesquelles il est possible d’observer
les ouvriers de plus près sont celles des découvertes. En
effet, sur les clichés CAT 131, CAT 137 et CAT 163, les
ouvriers sont pris en photographie pour assurer la véracité de
la découverte142. Les archéologues, s’ils prennent les prises de
vue, sont aussi les sujets de quelques photographies. Nous
avons déjà pu analyser143 le cliché CAT 124 représentant T.
Homolle et les autres membres. La photographie représentant les
141 Guerre d’indépendance de la Grèce : 1821-1830. 142 Voir II, B, 2 : « Les trois moments de la prise de vue (le Journal de laGrande Fouille) : témoignage du métier de photographe ? ».143 Voir II, A, 2 : « Les épreuves photographiques : un témoignage de lafouille en elle-même ».
113
ouvriers (CAT 013), observée ci-dessus, représentait également
les membres. Il existe en autre un autre cliché montrant les
castriotes et quelques archéologues français lors d’une fête à
Castri (CAT 171). Ce cliché représente les membres D.
Brizemur144, J. Laurent145 et le belge J. de Mot146 en evzones au
centre. Ils ont donc fait des efforts d’intégration pendant
cette fête, ou bien tout simplement ont-ils tenté de créer le
cliché le plus pittoresque possible. Comme précédemment
étudié147, le Journal de la Grande Fouille permet de se rendre
compte de la vie quotidienne de chantier à Delphes. Mais ce
journal manuscrit constitue également un témoignage du
bouleversement provoqué par l’archéologie sur un village grec,
ainsi que de la fin d’une civilisation paysanne. Castri devient
en effet progressivement un village d’accueil pour les
touristes.
L’étude des photographies relatives à la fouille de
Delphes nous a permis en premier lieu de préciser les fonctions
de l’archéologue au moment charnière de la fin du XIXe siècle :
lorsque son statut oscille encore entre celui d’explorateur et
celui d’archéologue scientifique dans le sens moderne qu’il
revêt encore aujourd’hui. L’étude des clichés a permis en outre
l’analyse des divers moments de prises de vue du matériel et
renseigne également sur le métier balbutiant de photographe
144 Daniel Brizemur, membre de l’EfA ayant travaillé sur la Nécropole deDelphes (mémoire présenté à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettresen 1901). Voir Ms DELPHES 5-BRI, Institut de France. 145 Joseph Laurent (1870 – 1955). 146 Jean de Mot (1876 - 1918), membre étranger de l’École de 1900 à 1902. 147 Voir II, A, 3 : « Les références aux prises de vue dans le Journal de laGrande Fouille ».
114
scientifique, celui-ci étant encore si fortement rattaché à
celui de l’archéologue que la distinction des deux figures est
parfois impossible en raison du très grand nombre de clichés
anonymes. Enfin, les prises de vue adjacentes au travail
archéologique ont forgé la postérité ethnologique de certaines
photographies. Si celles-ci pouvaient paraître anecdotique au
moment de leur développement, le XXe siècle et son intérêt
prononcé pour l’étude ethnographique leur donnent leurs lettres
de noblesse. Ainsi la photographie sur le chantier delphique
permet-elle la réunion, le syncrétisme, des informations
désormais liées par un seul et même médium.
C) Des prises de vue à la mise en place réfléchie
Il s’agit dès lors d’analyser le trajet des différentes
étapes de la production d’un cliché scientifique, des prises de
vue à la mise en place réfléchie du sujet au sein de son
environnement. La nécessité de la mise en valeur du matériel
archéologique rend l’intervention du photographe nécessaire
dans la production des clichés. Il doit en outre faire face aux
difficultés techniques de l’outil photographique de l’époque ;
face aux déboires des apprentis opérateurs se met en place une
méthode empirique. Enfin, la dernière étape de l’intervention
du photographe a lieu lors des interventions manuelles sur le
cliché développé, en vue de la publication de celui-ci.
1. Intervention du photographe dans la mise en scène
115
Si toute photographie répond à la vision du photographe et
à ses traductions techniques (cadrage, mise au point,
profondeur de champs…), certaines subissent une intervention
plus intrusive de l’opérateur par une réelle volonté de mise en
scène et de mise en valeur du matériel archéologique. En effet,
presque tous les clichés du fonds ont été pris par un
photographe, lequel, par sa seule présence, modifie son sujet.
Par exemple, les hommes fouillant le Trésor des Athéniens se
retournent pour la prise de vue (CAT 226). Ainsi, l’action
d’installer une chambre photographique devant un sujet donné
devient une intervention dans le cadre de la prise de vue. Le
cliché CAT 135, représentant une chambre photographique sur son
pied au milieu des morceaux de la colonne d’Achante à coté des
rails de Decauville, montre la place prise par le matériel
photographique. Bien sûr, le photographe ne peut influer sur le
contexte environnemental du site de Delphes, mais les
photographies de paysages, comme les deux vues du Stade en 1896
(CAT 235), témoignent des exigences techniques de l’opérateur
et des codes de prises de vue associés au genre du paysage.
Selon Gérard Réveillac, la plupart des 637 clichés de
statuaire148 ont été réalisés à l’aide d’un studio
photographique précaire à même le site149. Il ne s’agit pas
d’une infrastructure éphémère construite sur le site, mais de
l’utilisation de quelques éléments qui font office
d’accessoires photographiques. Nous ne connaissons pas les148 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 15.149 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 17.
116
détails des éléments utilisés car ils ne sont pas inclus dans
le cadrage de la prise de vue, toutefois nous pouvons penser
que l’École française d’Athènes achète des accessoires
photographiques comme elle se munit de matériel de plus en plus
perfectionné. Par l’étude des inventaires150, nous pouvons en
effet observer qu’elle se dote d’instruments scientifiques tels
que des graphomètres, tachéomètres, niveaux de collimateur,
goniomètres et microscopes. Le principal accessoire du studio
photographique est un drap noir qui permet de mettre en valeur
le matériel archéologique. Le fonds de tissu sombre vient
isoler l’objet de son contexte afin d’éviter un détourage du
cliché pour la publication, ou au contraire pour le faciliter.
Ce drap noir est visible sur deux clichés (CAT 133 et CAT 139)
où l’on peut voir clairement que le photographe a dressé sa
chambre photographique à même le site. En effet, sur le cliché
CAT 133 nous voyons la statue posée directement sur la terre de
Delphes alors que sur le CAT 139 le chantier et un ouvrier sont
visibles derrière le torse photographié. Le studio
photographique a pour vocation d’isoler les sujets
photographiés, les statues, afin de pouvoir les photographier
dans des contextes plus acceptables. Un des codes de la
photographie archéologique publiée est l’isolement du sujet
afin d’éviter que des éléments extérieurs à l’objet de l’étude
ne viennent en entraver l’examen. Sur le cliché CAT 133 on peut
observer que pour tendre le drap noir, deux hommes se sont
hissés sur des chaises de chaque côté de la statue. Il s’agit
150 « Extrait des pages 10 à 13 du cahier d’inventaire (1892) » dansRÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La « GrandeFouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 13.
117
d’une statue entièrement dégagée et déjà traitée comme du
matériel archéologique. On peut s’interroger sur l’action de la
mise en valeur : les photographies archéologiques sont-elles
prises pour faire valoir le matériel ? En examinant les
photographies prises dans ce contexte de studio photographique,
on remarque qu’essentiellement les sculptures de ronde-bosse151
ont bénéficié de ce traitement. Est-ce parce que la statuaire
doit faire l’objet d’une photographie esthétique et non pas
technique ? En effet, on peut voir une différence de traitement
d’image entre cette série et celle des petits objets152 (CAT
141, CAT 142, CAT 143, CAT 144 et Cat 145). Ces derniers ont
également été pris dans un contexte de studio photographique
mais certainement en intérieur après considération de leur
composition et de l’utilisation de la lumière. Ils semblent
avoir été pris de manière bien plus scientifique, de face ou de
hauteur, sans mise en valeur apparente, si ce n’est pour le
traitement de la lumière. Ainsi, les CAT 133 et CAT 139 peuvent
être considérés comme des photographies esthétiques prises dans
un contexte scientifique et archéologique. L’analyse du CAT
139, représentant la statue de Sisyphe II, issue du monument de
Daochos, permet de nous intéresser à la question de la
réception de la statuaire antique au XIXe siècle. On remarque
que le drap utilisé normalement pour séparer le sujet du fond
du cadrage (comme pour le CAT 133) n’est pas tendu. Le
photographe, en décidant de mettre en scène la statue de
Sisyphe II de cette façon, est motivé par un désir de rattacher
151 RÉVEILLAC, Gérard, « Photographies de la Grande Fouille » dans LaRedécouverte de Delphes, pp. 185. 152 Voir I, A, 2 : « Conditions d’une photographie scientifique ».
118
cette statuaire antique à l’idée que s’en fait la sphère
artistique du XIXe siècle. En effet, les plâtres de sculptures
antiques, une fois exposés à Paris, ont une visée pédagogique
et participent à la formation du goût des artistes153. Par
exemple, l’assemblage en plâtre du sphinx des Naxiens est
exposé au Musée du Louvre comme le montre le CAT 190. La
photographie de la statue de Sisyphe II est une œuvre qui
témoigne de l’importance que prend l’Antiquité au sein des
arts. Il s’agit d’une idée que se fait le XIXe de l’Antiquité,
promue par l’Académie des beaux-arts, avec des canons
spécifiques comme l’importance du nu anatomique. Le torse
faisant l’objet de la prise de vue est éclairé de manière à
mettre en valeur le travail du sculpteur et la beauté d’un
corps nu. Le drap noir n’est pas placé en fond mais il devient
un accessoire photographique. Ce n’est donc pas une
photographie qui s’attache à représenter son objet de la
manière la plus objective possible, sans la ternir d’une vision
personnelle du photographe ou de l’archéologue. Le CAT 139 est
au contraire une photographie qui a été mise en scène afin de
permettre au photographe de montrer sa propre vision de la
statue.
Ainsi, on constate que le premier degré de l’intervention
du photographe réside dans la simple présence de l’opérateur et
de sa chambre photographique ; ils ne passent pas inaperçus
auprès des ouvriers de la grande fouille et modifient ainsi le
153 MEKOUAR, Mouna. – « Étudier ou rêver l’antique : Félix Ravaisson Mollienet la reproduction de la statuaire antique » dans Images Re-vues, Paris, INHA,numéro 1, 2005.
119
cadre par leur changement de posture, tout imprégnés qu’ils
sont de l’intérêt porté à l’appareil. La modification technique
du cadre a lieu à l’aide des accessoires qui permettent de
répondre aux codes de la photographie scientifique : le sujet
est isolé par un drap noir présent sur de nombreux clichés,
particulièrement ceux traitant de sculptures en ronde-bosse. On
a aussi vu que le traitement des clichés de statuaire répondait
également aux conventions en vigueur à la fin du XIXe siècle,
notamment celles véhiculées par l’Académie. Cette intervention,
afin d’assurer la bonne réception des clichés auprès de la
communauté scientifique de l’époque, se fait parfois au prix
d’une objectivité moindre.
2. Rendre compte de l’information : des méthodes empiriques
Dans la même optique, les photographes d’alors établissent
leurs méthodes empiriques afin de réaliser le meilleur cliché
possible. L’étude du rapport réalisé par G. Réveillac nous
informe des difficultés que rencontrent les opérateurs de
l’époque. Le traitement chimique des clichés, tout comme la
mise au point ou le cadrage relèvent encore du défi face à la
nouveauté de l’outil.
L’action de prise de vue sur un chantier a pour volonté
primordiale de capter une information donnée et d’en rendre
compte sur les clichés pris. Les photographes de la Grande
Fouille ne sont pas connus, nous ne pouvons savoir s’il s’agit
d’amateurs ou de professionnels. Les ouvrages comme le manuel
120
de Trutat154 informent l’apprenti opérateur mais l’apprentissage
empirique est indispensable. G. Réveillac, dans son rapport155,
s’intéresse à évaluer la qualité technique d’un certain nombre
de prises de vue : il se charge de classer par critères définis
(comme par exemple « surexposé » ou « netteté insuffisante »)
les 1066 plaques de verres appartenant au fonds photographique
de la Grande Fouille de Delphes. Ici, il ne s’agit pas de
hiérarchiser subjectivement les différentes prises de vue mais
d’observer les difficultés techniques que rencontrent les
opérateurs sur le chantier. Sur les huit critères imposés par
Réveillac, les six premiers critères s’intéressent au rapport
existant entre la prise de vue et le traitement chimique des
clichés. La notion de traitement chimique ne restreint pas
l’étude aux difficultés rencontrées pendant le développement,
mais également à la pose pour la prise de vue. Les deux
derniers critères, quant à eux, sont le résultat de
l’intervention de l’auteur de la prise de vue avant le
traitement : la mise au point et le cadrage.
Critères Nombre de clichés1 Surexposé 2652 Contrasté 2703 Sous-exposé 1254 Doux 35
154 TRUTAT, Eugène, La photographie appliquée à l’archéologie : reproduction des monuments,œuvres d’art, mobilier, inscriptions, manuscrits, Paris, Gauthier – Villars, 1879 [135p.].155 RÉVEILLAC, Gérard, « Evaluation qualitative du fonds considéré du pointde vue photographique » dans Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes– La « Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 9.
121
5 Voilé 576 Zones de développement 277 Netteté insuffisante 1888 Mauvais cadrage 70
La surexposition des clichés tient de l’apprentissage à tâtons
des opérateurs : ces derniers se fient à leur propre expérience
pour analyser la luminosité pour la prise de vue. Il en est de
même pour les clichés trop contrastés. Par exemple, le CAT 032,
si le sujet est net et reconnaissable (le chantier du Trésor
des Athéniens), la luminosité du ciel n’est pas assez prise en
compte : le détail du contour du flanc de la montagne est noyé
dans le ciel. Le fort contraste sur beaucoup de clichés est
sans doute le résultat de l’emploi de révélateurs dont la
composition favorise de grands écarts de valeur dans l’image
négative. Selon G. Réveillac156, les ouvrages techniques de
cette époque proposent des formules de révélateurs dont le
choix et le dosage des réducteurs peuvent provoquer des images
très contrastées. Les sous-expositions peuvent également
s’expliquer par un manque de maîtrise dans la détermination de
l’exposition. Si elles sont moins nombreuses c’est parce que
les auteurs des prises de vue préféraient alors, par mesure de
sécurité, poser plus longtemps. Un cliché surexposé est, du
moins jusqu’à une certaine limite, tirable alors qu’une forte
sous-exposition rend le cliché inutilisable. Les clichés
« doux » et ceux qui présentent des « zones de développement »
résultent d’un développement trop court. Le manque de netteté156 RÉVEILLAC, Gérard, « Evaluation qualitative du fonds considéré du pointde vue photographique » dans Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes– La « Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 10.
122
est l’une des difficultés liées à une mauvaise maîtrise du
matériel photographique mais également à des mouvements non
contrôlés de l’appareil photographique. Selon G. Réveillac, il
y aurait deux clichés totalement flous157 présents dans le fonds
delphique mais le manque d’information les concernant les
rendent insignifiants. Le manque de profondeur de champ est une
des causes principales de netteté insuffisante concernant
certains clichés : si de nos jours les photographes utilisent
beaucoup le « flou artistique » pour mettre en valeur un sujet
spécifique, les photographies à caractère scientifique ne
peuvent se le permettre. Les marches inférieures du cliché CAT
070 ne sont pas assez nettes car l’opérateur s’est concentré
sur l’ouvrier en train de marcher. Dans certains cas, ce sont
les sujets en mouvement qui rendent le cliché flou car la
vitesse d’obturation est trop rapide : c’est le cas du cliché
représentant la découverte de l’Antinoüs. En effet les ouvriers
ont tourné la tête en même temps vers le photographe pendant le
temps de prise de cliché pour le CAT 131. Les boîtes
photographiques à l’époque de la Grande Fouille peuvent être
portées par le photographe mais on remarque sur le CAT 135 que
l’École française a investi dans des chambres à pieds. Le souci
de netteté pour l’exploitation archéologique des clichés oblige
les opérateurs à utiliser des temps de pose certainement plus
longs et c’est pour cela que les pieds sont conseillés sur le
chantier. Les voiles peuvent être soit partiels soit
généralisés et ils peuvent résulter d’un châssis prenant
157 RÉVEILLAC, Gérard, « Evaluation qualitative du fonds considéré du pointde vue photographique » dans Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes– La « Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 10.
123
légèrement la lumière du jour avant ou pendant l’exposition de
la prise de vue, mais aussi d’une arrivée de lumière pendant le
développement ou avant le fixage. Enfin, certaines prises de
vue présentent un mauvais cadrage : le sujet ou une partie du
sujet est coupé par le cadre sur un bord ou il est plus ou
moins de travers, ceci étant le résultat d’une mauvaise
appréciation à la visée. On peut citer par exemple le CAT 163,
la découverte de la partie basse du corps de l’Aurige le 28
avril 1896. A moins que la plaque de verre n’ait subi un
recadrage ou un agrandissement, la prise de vue est mal
cadrée : les têtes des ouvriers sont coupées et l’Aurige
n’occupe que le coin inférieur gauche du cliché. L’opérateur,
dans l’excitation de la découverte, n’a probablement pas pu
réfléchir à sa composition : la norme des photographies de
découvertes est de placer le vestige au centre, bien visible,
et de capter l’interaction entre les fouilleurs et leur
découverte. Le classement fait par G. Réveillac permet donc de
se rendre compte du tâtonnement des photographes sur la fouille
par l’observation des difficultés qu’ils ont pu rencontrer. Les
photographies présentes dans notre catalogue ne sont pas un
reflet véridique du fonds dans sa totalité : en effet, il
s’agit des photographies les plus accessibles à la photothèque
de l’École française d’Athènes. Il y a eu un choix esthétique
en amont pour ne pas exposer les mauvaises prises de vue. Par
exemple, nous n’avons pas pu voir les deux photographies floues
dont parle G. Réveillac158. Les photographies trouvées dans les
158 RÉVEILLAC, Gérard, « Evaluation qualitative du fonds considéré du pointde vue photographique » dans Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes– La « Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 10.
124
publications, quant à elles, ont étés choisies pour leur
qualité. Nous pouvons aussi citer la méthode empirique
expérimentée par les photographes concernant l’épigraphie :
même si Trutat159 conseille l’utilisation de la lumière frisante
pour faciliter la lecture de blocs épigraphiques, les
opérateurs ont dû vérifier la technique en se servant de leurs
propres expériences.
Après avoir vérifié l’ampleur des difficultés techniques
rencontrées par les photographes de l’époque, il nous faut
analyser la dernière étape de l’intervention de ceux-ci :
l’ensemble des opérations nécessaires à la publication des
clichés. Bien loin du débat contemporain sur l’utilisation de
la retouche, celle-ci fait d’ores et déjà débat parmi la
communauté photographique d’alors.
3. Intervention manuelle sur le cliché en vue de la publication
Les photographies du fonds de la Grande Fouille de Delphes
subissent des interventions manuelles bénignes qui répondent à
un souci de bonne présentation de l’image publiée, ou du moins
présentée. Les retouches constituent un sujet de discorde entre
les différents utilisateurs de la photographie à la fin du XIXe
siècle ; en effet l’intervention manuelle produit différents
discours selon les photographes : « D’autres photographes
159 TRUTAT, Eugène, « Inscriptions » dans La photographie appliquée à l’archéologie :reproduction des monuments, œuvres d’art, mobilier, inscriptions, manuscrits, pp. 75-77.
125
employèrent la retouche avec hésitation, quelquefois même en
s’excusant d’en faire usage160 ».
Généralement, il s’agit de retouches sur les images négatives
quand le format de la plaque de verre est supérieur à 6 x 9 cm.
Sur des plaques inférieures à ce format, les retouches sont
faites sur des agrandissements positifs mais les interventions
se limitent ordinairement au détourage161. Or, s’il n’y a que
très peu de plaques de format 6,5 x 9 cm dans le fonds
delphique162, il n’y a aucune plaque inférieure à ce format :
les retouches auraient donc toutes été faites sur les négatifs.
La lecture de L’art de retoucher les négatifs photographiques163, publié en
1892, apporte des précisions sur la manière de retoucher les
plaques de verres de gélatinobromure d’argent :
« […] il vaut mieux retoucher sur la couche de
gélatine et vernir ensuite le négatif quand cette
retouche est terminée. Tous les portraitistes savent
parfaitement que le travail exécuté de cette manière
est plus agréable, plus rapide, plus fin, et la
retouche est assurément protégée dans les opérations
subséquentes de l’impression des négatifs. De plus,
si elle n’est pas suffisante sur la couche de
160 KLARY, Charles, L’art de retoucher les négatifs photographiques, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1891, p. XII. 161 LAVÉDRINE, Bertrand (sous la dir. de), « Les négatifs sur support deverre » dans Reconnaître et conserver les photographies anciennes, Paris, CTHS, 2009,pp. 243-263.162 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 4.163 KLARY, Charles, L’art de retoucher les négatifs photographiques, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1891 [86 p.].
126
gélatine, elle peut être complétée sur la couche de
vernis.164 »
Si les photographies étudiées ne sont pas des portraits, il en
est de même pour les retouches : le vernissage du négatif est
très commun. La plus importante des interventions manuelles est
le détourage : il est utilisé très fréquemment en vue des
publications. Cette intervention s’attache à isoler une partie
du cliché : soit le sujet du fond, soit l’élément d’un
ensemble. Nous pouvons observer l’opération du détourage sur le
cliché CAT 225 mais le détail est si précis que nous pouvons
nous demander s’il pourrait s’agir d’une photographie prise en
intérieur sur un fond sombre. Si la deuxième hypothèse est
privilégiée, il n’est pas impossible que pour uniformiser le
fond noir, un opérateur ait pu appliquer de la gouache au
pinceau par exemple. En effet, l’opération du détourage est
faite à la crocéine ou à la gouache. La crocéine est un
colorant utilisé dans le domaine de la photographie165. Ne
pouvant pas observer les plaques de verres de la photothèque de
l’École française d’Athènes, c’est l’analyse de Réveillac166 qui
permet l’étude des retouches sur les plaques de verre du fonds
delphique. Il a constaté la présence de toutes les
interventions manuelles possibles sur un échantillonnage de 128
négatifs sur plaques de verres du fonds photographique de la
Grande Fouille. Il répertorie les différentes interventions
manuelles visibles dans le fonds : il cite bien sûr l’opération
164KLARY, Charles, L’art de retoucher les négatifs photographiques, p. 22.165 VILLAIN, A., « Procédé de photo-teinture » dans Paris-Photographe, Paris,Office général de Photographie, Num. 7, 1892, p. 292.166 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 11.
127
du détourage, mais également des retouches au crayon et des
repiques. Les retouches au crayon sont utilisées pour combler
les ombres trop fortes ou cacher les détails indésirables
présents sur la photographie. Selon le manuel de l’artiste
photographe C. Klary (1837 – 19.. ?), le choix du type de
crayon pour cette opération est primordial :
« Le retoucheur de négatifs doit prendre le plus
grand soin dans le choix de ses crayons. Ceci est
jusqu’à un certain point une difficulté, car peu de
fabricants produisent des mines de plomb d’une
qualité uniforme. Les crayons dont on se sert pour
retoucher doivent être d’une fabrication très fine et
très serrée, bien montés et absolument dénués de
grains.167 »
La précision est essentielle pour les retouches car il ne doit
pas y avoir de traces visibles sur la photographie positive
afin de ne pas gêner le lecteur. La troisième opération de
retouche est l’opération de la repique. Il s’agit de cacher les
traces occasionnées par les poussières sur les surfaces
sensibles à l’aide d’une gouache plus ou moins diluée. Les
opérateurs peuvent utiliser de la crocéine ou de l’encre rouge
inactinique (une encre qui n’agit pas sur le négatif sensible).
Ils appliquent leur solution dans les blancs, appelés piqûres,
provoquées par le dépôt de poussière avant le développement de
la plaque. En effet, la spécificité du procédé au
gélatinobromure d’argent est de pouvoir être traité un certain
temps après la prise de vue. Or, sur un chantier archéologique,
la poussière est très fréquente et il n’est donc pas rare167 KLARY, Charles, L’art de retoucher les négatifs photographiques, pp. 3-4.
128
qu’une plaque subisse des altérations provoquées par la
poussière. Ces différentes interventions sur les plaques
négatives sont faites en vue d’une publication et on peut
penser que certaines retouches ont été faites dans le
laboratoire qui se chargeait de la publication de ces mêmes
clichés. Mais il n’y a aucune mention de tels services sur les
factures de ces studios photographiques. Selon G. Réveillac,
certaines de ces retouches [sont manifestement l’œuvre de
personnes peu qualifiées pour faire ce genre de travail]168, ce
qui nous amène à penser que pour certains cas, ces retouches
ont été faites pendant le développement, sur le site de Delphes
ou à l’École française d’Athènes.
La question de la retouche peut nous amener à nous
questionner sur le statut du recadrage : s’agit-il d’une
retouche ? Il est ainsi question d’une intervention manuelle
sur le cliché tiré. Par exemple, on peut voir que les deux
volumes de Fouilles de Delphes169 utilisant le même cliché
représentant le Sphinx des Naxiens ne l’ont pas publié sous le
même format : le format du CAT 186 est bien plus rectangulaire
que celui du CAT 234. Les opérations d’agrandissement
appartiennent au même groupe d’interventions manuelles que les
recadrages. Ainsi, le CAT 182, représentant l’ « Apollon A »
(Biton) et publié en 1909, est un agrandissement du cliché CAT
138. La perte de qualité n’est pas une résultante de168 RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’école Française d’Athènes – La« Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903), p. 11.169 Le CAT 234 est visible dans AMANDRY, Pierre, La Colonne des Naxiens et lePortique des Athéniens dans Fouilles de Delphes, 153, fig.2, Pl. II. ; et le CAT 186est issu de : HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îlesdans Fouilles de Delphes, 1909, p. 41, fig. 16.
129
l’agrandissement mais plutôt du procédé photomécanique mis en
place pour la publication. On voit que c’est la statue en elle-
même qui est mise en lumière alors que son environnement de
découverte est coupé. Il en est de même pour la publication du
cliché représentant la découverte du 28 mai 1894 (CAT 137) : le
contexte de découverte est minimisé dans l’agrandissement
publié (CAT 183). En revanche, on peut noter que cet
agrandissement ne centre pas son image sur la statue mais
plutôt sur le dialogue des regards entre les archéologues et la
statue.
On a ainsi étudié les multiples applications de la
photographie sur la Grande Fouille de Delphes, notamment à
travers ses fonctions de cristallisation et de témoignage de
l'organisation et des réalisations du chantier. La présence et
l'influence de l'outil photographique a été mesuré tant par la
fréquence des références aux prises de vue au sein du Journal
de la Grande Fouille que par son intérêt pour l'étude
ethnologique contemporaine. Il a enfin été question de
l'intervention de l'opérateur en amont du cliché et une fois
son développement réalisé. Aussi notre développement precedent
a-t-il abordé les différents traitements appliqués aux clichés
en vue de leur publication. C'est que l'exploitation de la
photographie au sein des publications scientifiques ayant trait
à Delphes se présente comme la deuxième vie des clichés et
forme le leg sur lequel la présente étude prend appui. Il
s'agit désormais d'étudier les résonances contemporaines à la
fouille et celles, actuelles des photographies delphiques dans
130
la communauté scientifique. Quels sont les ouvrages ayant
garanti l'impact des clichés à l'époque, au cours du XXe siècle
et actuellement ? Quels en ont été les ressorts ?
III. L’édition, un développement pour la photographie
A) L’exploitation de la photographie dans les publicationsscientifiques : l’illustration dans le BCH, CRAI et Les fouilles de Delphes
Les prises de vue ne sauraient se limiter à la fonction
représentative et médiatrice qu'elles assurent entre le lieu du
chantier et le foyer scientifique dont l'Académie est le
centre. Au delà des échanges entre archéologues et
institutions, la photographie va cristalliser les
représentations de la Grande Fouille, notamment au sein des
publications scientifiques telles que le BCH, le CRAI ou encore
Les Fouilles de Delphes.
1. Utilité et fonctions
Pour un chercheur, publier est la concrétisation d’un
travail, l’aboutissement logique d’une recherche : c’est en
effet la proposition d’un état des connaissances sur un sujet
précis à un moment donné. Publier est avant tout un acte de
communication qui suppose un rapport entre celui qui publie, ce
131
rapport prenant la forme d’un message ou d’un enseignement, et
le lecteur, le receveur de l’information. L’image propose au
regard du lecteur une série d’informations ayant pour but de
servir le discours écrit par l’archéologue chercheur.
L’illustration dans les publications scientifiques vient
répondre à une nécessité de représentation des sujets étudiés.
Ce n’est pourtant pas la seule fonction des photographies
exploitées dans les volumes. Premièrement, la traduction
dimensionnelle des objets est la fonction principale en ce qui
concerne l’exploitation de la photographie dans ce contexte :
il s’agit de montrer l’objet étudié. C’est une proposition de
prise de contact visuel avec ce dernier. À l’époque de la
Grande Fouille, la photographie est considérée comme la preuve
de l’existence de ce qu’elle représente. Deuxièmement,
l’utilité de ces photographies publiées consiste à éclairer et
à conforter le discours du chercheur. En effet, bien qu’elle
puisse être considérée comme un argument d’autorité, la
technique photographique devient l’appui visuel d’une
démonstration, devenant la preuve de la véracité de cette
dernière. Ainsi l’illustration dans des publications peut-elle
aider à rendre le texte plus agréable à lire. Nous pouvons
citer les mots d’un dessinateur et graveur du XIXe siècle,
Jules Adeline, qui constate que les impressions d’images
« séduisent au premier coup d’œil et forcent l’attention des
plus distraits170 ». Enfin, l’utilisation des photographies dans
ce contexte de publication permet au lecteur de s’interroger
170 ADELINE, Jules, Les Arts de la reproduction vulgarisés, Paris, Librairie-Imprimerieréunis, 1894 [p. 305].
132
lui-même sur l’objet, même si le discours le condamne à ne se
concentrer que sur une des dimensions qu’elle apporte. Il est
important de noter que les photographies qui apparaissent sur
une publication sont le résultat d’un choix spécifique : en
effet ce dernier répond aux prérogatives des démonstrations du
chercheur. Par exemple, T. Reinach, dans son article « La
musique des hymnes de Delphes171 » publie une héliogravure des
blocs épigraphiques (CAT 172), mais également des
retranscriptions et des études musicales172. Si la publication
des fragments photographiés ne sert pas le discours
scientifique, elle permet à Reinach de présenter l’objet
d’étude au lecteur. La photographie apparaît dans le Bulletin de
Correspondance Hellénique en 1878, alors que le bulletin n’est
édité que depuis 1877. Les techniques d’impression permettaient
de les diffuser, bien que, pour une raison inconnue, la
première année ne compte pas de photographies publiées, mais
uniquement des dessins et des gravures. Le Bulletin de
Correspondance Hellénique compte en moyenne une quinzaine de
planches jusqu’à l’apparition de la similigravure en 1895 et
près de 80 photographies publiées en moyenne par tome ensuite.
On remarque cependant que la rédaction du bulletin choisit de
poursuivre de façon très circonstanciée la parution de planches
en héliographie pour les objets les plus précieux. Cette
politique est d’ailleurs compréhensible lorsque l’on examine
d’un œil critique les premières publications en similigravure
171 REINACH, Théodore, « La musique des hymnes de Delphes » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 17, 1893, pp. 584-610. 172 REINACH, Théodore, « La musique des hymnes de Delphes » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 17, 1893, p. 591. : « Le ton phrygiendiatonique ».
133
qui ne devaient certainement pas donner entière satisfaction au
Comité de Rédaction. On peut citer un article de Louis Couve
dans le premier volume du Bulletin où est utilisé le procédé
(le volume 19 de 1895). Il n’y a pas d’articles traitant de
Delphes utilisant la similigravure dans ce volume et c’est
pourquoi nous renvoyons à l’article « Fouilles à Délos173 ». La
figure 1174, représentant quatre petits masques de stuc, est
reproduite dans le texte grâce à la technique de la
similigravure. Une baisse de qualité importante résulte de
cette reproduction en demi-teintes par une série de points en
relief régulièrement espacés : le tramage de la photographie
peut déformer l’image si par exemple elle est trop agrandie.
L’étude de l’illustration dans le Bulletin de Correspondance Hellénique
nous permet de nous pencher sur la question de l’utilisation de
la photographie dans la publication en rapport avec la Grande
Fouille de Delphes. On remarque qu’Homolle, responsable du
chantier de Delphes mais aussi Directeur de l’École française
d’Athènes, ainsi que les autres membres de rédaction comme
Emile Bourguet ou Louis Couve, utilisent très vite la
photographie pour illustrer les articles, parallèlement au
dessin. Les premiers articles concernant Delphes apparaissent
en 1893 dans le BCH et constituent une dizaine d’articles par
volume jusqu'à la fin de la Grande Fouille. Le Bulletin a pour
vocation de publier le rapport d’activité de l’École française
d’Athènes par des chroniques de fouilles, mais aussi par les
travaux des membres et anciens membres de l’École. Delphes, par
173 COUVE, Louis, « Fouilles à Délos » dans Bulletin de correspondance hellénique,volume 19, 1895, pp. 460-519. 174 COUVE, Louis, « Fouilles à Délos » dans Bulletin de correspondance hellénique,volume 19, 1895, Figure 1, Stucs de Délos, p. 473.
134
son importance au sein de l’École, tient une place primordiale
dans les BCH de l’époque. En analysant le contenu des articles
concernant la Grande Fouille, on remarque que la plupart sont
des analyses épigraphiques. Ceci s’explique par le large corpus
d’inscriptions que présente Delphes au grand bonheur des
épigraphistes comme L. Couve et E. Bourguet175. Ces articles ne
présentent que rarement des photographies publiées : la copie
des inscriptions permet d’étudier plus lisiblement le texte. La
retranscription reste une étude subjective en elle-même et
peut changer considérablement selon le chercheur. Les
archéologues en sont pleinement conscients mais ils ne peuvent
se permettre de n’utiliser que des clichés publiés car la
mauvaise qualité de ces derniers en rend la lecture extrêmement
difficile. Ainsi, dans « La musique des hymnes de Delphes176 »,
la retranscription de Couve a attiré les suspicions de Reinach
alors que les estampages et photographies confirmaient la
véracité de sa lecture :
« L’introduction dans la mélodie d’une note étrangère
[…] est un fait nouveau, si nouveau qu’avant d’avoir
dans les mains les photographies et les estampages,
j’avais hésité à y croire […] ; le témoignage des
documents, qu’on a sous les yeux, ne laisse aucun
doute sur l’exactitude de la lecture de M. Couve177 ».
La photographie peut être sujette à controverse car sans
éclairage adapté au bloc épigraphique, ce dernier peut se175 E. Bourguet devient par la suite Directeur d’études pour l’épigraphie etles institutions grecques à l’École Pratique des Hautes Études. 176 REINACH, Théodore, « La musique des hymnes de Delphes » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 17, 1893, pp. 584-610. 177 REINACH, Théodore, « La musique des hymnes de Delphes » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 17, 1893, p. 599.
135
révéler illisible ou presque178. Par exemple, Émile Bourguet ne
peut joindre de photographies à son étude « Inscription de
Delphes179 » : « Il a été impossible de faire reproduire
mécaniquement l’inscription II ; la surface en est devenue
tellement lisse et les lettres, surtout dans la moitié droite,
sont si effacées, que ni l’estampage ni la photographie n’ont
donné de résultat180 ». Les archéologues chercheurs reçoivent
des photographies imprimées pour alimenter la documentation
destinée à la rédaction de leurs articles ; plus tard, pour la
publication, elles peuvent être associées aux articles en étant
reproduites dans les planches hors-texte. Si le chercheur n’a
pu examiner son matériel de visu et que, par conséquent, son
travail repose sur son impossibilité de l’étudier sans
photographie, sa documentation est très souvent publiée avec
l’article. Par exemple, Henri Weil avec son article « Nouveaux
fragments d’hymnes accompagnés de notes de musique181 », n’a pu
se rendre à Delphes pour examiner les blocs. En expliquant sa
manière de procéder quant à l’analyse de ces hymnes, Weil
écrit : « Après avoir travaillé sur des copies faites par deux
membres de l’École, M.M. Couve et Bourguet nous avons reçu
quelques rectifications, en partie prévues, de M. Homolle, et
enfin des photographies, qui reproduisent assez exactement
l’état des pierres182 ». Ces photographies sont reproduites en178 Voir II, C, 2 : « Rendre compte de l’information ».179 BOURGUET, Émile, « Inscription de Delphes [deux comptes du conseil etdes ΝΑΟΠΟΙΟΙ] » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 20, 1896, pp. 197– 241.180 BOURGUET, Émile, « Inscription de Delphes [deux comptes du conseil etdes ΝΑΟΠΟΙΟΙ] » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 20, 1896, p. 198.181 WEIL, Henri, « Nouveaux fragments d’hymnes accompagnés de notes demusique » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 17, 1893, pp. 569 – 583.182 WEIL, Henri, « Nouveaux fragments d’hymnes accompagnés de notes demusique » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 17, 1893, p. 569.
136
héliogravures à la fin de l’ouvrage. Elles permettent à Weil
d’analyser plastiquement l’objet : « L’inspection des
photographies fournit un indice matériel de la cohérence des
deux fragments183 ». Si les photographies permettent aux
chercheurs d’étudier le matériel archéologique, elles peuvent
aussi leur permettre de s’en servir comme preuves parlantes.
Par exemple, Reinach utilise cette véracité absolue dont fait
l’objet la photographie pour ne pas préciser son discours :
« Cette cantilène (…) se compose, dans son état
actuel des deux grands blocs A et B (planches XXI et
XXIbis), qui font partie du même ensemble : on ne peut
guère conserver de doute à cet égard en présence des
estampages et des photographies184 ».
La planche XXIbis est reproduite dans notre catalogue à l’entrée
CAT 172. Plus tard, Reinach utilise à nouveau la photographie
pour produire un argument d’autorité mais prévient le lecteur
quant à la nature de son argument, lequel n’apporte pas de
preuves exogènes à la photographie : « Chose grave, je dois
demander au lecteur, dans plusieurs cas, de me croire sur
parole ou de préférer mon témoignage, fondé à la fois sur
l’étude de l’estampage et sur celle de photographies directes,
aux indications de l’héliogravure, exécutée d’après l’estampage
seul185 ». La publication archéologique associe deux moyens
d’expressions : la photographie et le dessin, lesquels
deviennent rivaux. En effet, le dessin est progressivement183 WEIL, Henri, « Nouveaux fragments d’hymnes accompagnés de notes demusique » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 17, 1893, p. 571. 184 REINACH, Théodore, « La musique des hymnes de Delphes » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 17, 1893, p. 585. 185 REINACH, Théodore, « La musique du nouvel hymne de Delphes » dans Bulletinde correspondance hellénique, volume 18, 1894, p. 364.
137
remplacé par la photographie. Le dessin est toujours présent
dans le BCH mais cette technique n’est utilisée que
sporadiquement dans les publications. En revanche, les relevés
d’inscriptions et les plans sont toujours effectués par la
technique du dessin. On peut citer le Plan du village de
Castri-Delphes au début de la Grande Fouille publié pour
l’article « Topographie de Delphes186 » en 1897. Le plan187 est
dessiné par H. Convert à l’encre noire, rouge et bleue sur
papier, il mesure 90 x 61 cm. Le plan cadastral à l’échelle
1/1000 reproduit les parcelles construites et non construites,
les quelques restes antiques et les résultats des fouilles
antérieures. Le tracé des fouilles des voies Decauville y est
également matérialisé. Le plan est daté d’octobre 1892. Nous
pouvons noter la présence dans le fonds photographique de
Delphes d’une série de clichés représentés ici en CAT 168, CAT
169 et CAT 170 et ayant pour sujets différents plans de
Delphes, pris par Tournaire en 1893 et 1894188. Ils ont dû faire
l’objet de prises de vue afin d’être transportés plus
facilement.
Ainsi la photographie devient le support privilégié de la
véracité scientifique des découvertes et des recherches qui y
sont associées dans les publications archéologiques en général,
et à fortiori dans celles de Delphes qui correspondent au
moment d’intégration et d’essor de l’image dans les articles
186 Homolle, Théophile, « Topographie de Delphes » dans Bulletin de correspondancehellénique, volume 21, 1897, pp. 256-420, Pl XIV-XV. 187 CONVERT, Henri, Plans et dessins, Legs Tournaire, numéro 15262, EfA.188 Homolle, Théophile, « Topographie de Delphes » dans Bulletin de correspondancehellénique, volume 21, 1897, Pl. XVI.
138
scientifiques. La photographie supplante peu à peu le dessin
ou amène dans certain cas la collaboration des deux techniques
grâce à son avantage en gain de temps et en lisibilité. Cette
intégration de la photographie épouse le mouvement de
scientifisation des publications au XIXe siècle. Celles-ci
incorporent à leur discours de plus en plus d’éléments
techniques et la photographie vient renforcer cette dimension.
Dans le cas de l’épigraphie, la photographie ne sert pas
directement de support de lecture puisqu’on lui préfère le plus
souvent la retranscription du texte. Elle permet en revanche
d’authentifier celle-ci et s’inclut rapidement aux techniques
utilisées par l’épigraphiste aux côtés de l’estampage et du
charbonnage. Ainsi le BCH n’échappe-t-il pas au mouvement
global qui renforce la place qu’occupe la photographie dans les
publications scientifiques de la fin du XIXe.
2. L’image et le texte : la question des légendes et commentaires
L’intégration massive de la photographie aux publications
introduit également la problématique d’une cohabitation de
l’image et du texte. La mise en page devient une nouvelle
contrainte à laquelle les archéologues sont confrontés. La
bonne intégration des illustrations dans un discours est
primordiale pour ces scientifiques, et la publication des
clichés de la Grande Fouille prend une place de plus en plus
importante face aux dessins. L’image et le texte peuvent avoir
deux articulations différentes dans les revues scientifiques.
139
En effet, le premier cas de figure est l’utilisation de
planches en hors-texte : toutes les illustrations sont
concentrées à la fin de l’ouvrage. L’avantage premier est la
simplification de la mise en page et l’économie de
l’impression. En effet, les demi-teintes exigent généralement
une meilleure qualité de papier. Par exemple, les planches
représentant l’Aurige (CAT 179 et CAT 180) permettent à la
photographie d’être imprimée de la meilleure qualité possible,
ainsi qu’en grand format.
La deuxième manière consiste à intégrer les illustrations dans
le texte, ce qui rend l’ouvrage plus agréable à lire et plus
vivant. Le lecteur peut juger des objets décrits sans avoir à
se reporter constamment à la fin de l’ouvrage ou à des tomes
annexes. La lecture peut se dérouler sans que ne se rompe le
lien de compréhension entre le texte et l’image. La
similigravure va permettre l’intégration des images dans le
texte et non plus en annexe comme il en était coutume avec les
héliogravures.
L’image, pour pouvoir être comprise parfaitement, a besoin
d’être accompagnée de renseignements complémentaires car il y
a, entre le créateur de l’image et ses utilisateurs, une
rupture de compréhension189. Ce sont les informations
complémentaires à l’image qui vont établir ou orienter cette
compréhension. Ces ruptures de compréhension sont d’autant plus
importantes que les prises de vue n’ont pas été effectuées par
l’archéologue produisant un discours sur l’objet. Dans le cas
189 FOLLIOT, Philippe, RÉVEILLAC, et Gérard CHÉNÉ, Antoine, De la photographie enarchéologie, Aix, Université d’Aix – Marseille, 1986, p. 389.
140
de la Grande Fouille de Delphes, les archéologues et les
photographes semblent avoir collaboré ensemble, quand il ne
s’agissait pas d’une seule et même personne. Néanmoins, même
pour le commentaire le plus simple sur l’image d’un objet
photographié, il peut y avoir, de la part de celui qui regarde
la photographie, des degrés très divers de compréhension. C’est
pour une homogénéité de la reconnaissance de l’objet que des
commentaires accompagnent le plus souvent la photographie
publiée. Nous savons qu’au moment de la prise de vue sont notés
un certain nombre de renseignements sommaires, informations
nécessaires à une compréhension minimum de l’objet
photographié. Ces commentaires sont publiés dans le but de
permettre au chercheur d’effectuer une remise en situation une
fois le chantier terminé. Ainsi la photographie ne saurait se
suffire à elle-même. Par exemple, le samedi 4 août 1894, le
rédacteur du Journal de Fouille écrit :
« À l’E des offrandes de Gélon, le mur de mauvaise
époque qui vient perpendiculairement à la ligne du
pilastre et de la colonne trouvés le 30 juillet, et
qui empêche de dégager l’autre colonne (ou les autres
colonnes) qui peuvent faire suite à celle là, doit
être bientôt démoli. Il a été photographié
aujourd’hui.190 »
Bourguet écrit quelques informations importantes concernant ce
mur afin d’exploiter au mieux la prise de vue une fois
développée. Si les notes n’ont pas été inscrites spécifiquement
pour documenter la photographie, elles deviennent associées
l’une a l’autre. Dans le cas de l’archéologie, il est190 Journal de la Grande Fouille (1892-1902), p. 219.
141
primordial que l’archéologue, dans ses notes, relie les
références de la photographie avec d’autres éléments tels que
des dessins, des relevés topographiques et le rapport écrit du
travail de la journée. Les informations collectées sur le
terrain sont propres à chaque matériel découvert mais aussi à
l’archéologue. Il suffit de nous référer au Journal de la
Grande Fouille pour voir que les styles narratifs des
différents archéologues ne nous apportent pas les mêmes
informations. L’intérêt particulier que portent E. Bourguet et
L. Couve à l’épigraphie explique les mentions plus ou moins
détaillées des inscriptions. Ces informations peuvent donc être
très variées et intégrer une description sommaire de l’objet,
ses mesures, sa matière, son état de conservation, le lieu de
découverte, une précision sur la fouille, une datation de la
prise de vue… En revanche on peut observer qu’il n’y a pas de
numéros d’enregistrements de musées ou d’inventaires présents
dans les informations complémentaires. Par exemple, les clichés
CAT 192 et CAT 223 ont été pris dans le musée de Delphes et
intègrent cette information dans leurs légendes respectives :
« La colonne du sphinx restaurée, dans le Musée de Delphes –
d’après la photographie (n 24760) et avec l’autorisation de
MM. Alinari frères191 » et « Caryatide du Trésor de Siphnos
(Restauration en plâtre ; Musée de Delphes)192 ». Les auteurs
éclairent le lecteur sur le fait que les photographies ont été
prises en intérieur par la mention du lieu de la prise de vue.
En revanche, les photographies du sphinx (CAT 187 et CAT 191),
191 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909, p. 49, fig. 23.192 PICARD, Charles, Art archaïque (suite) : Les Trésors « ioniques » dans Fouilles de Delphes,1927, p. 27, fig. 33.
142
sûrement prises dans le Musée de Delphes, ont êtes détourées et
ne nécessitent pas d’informations complémentaires sur le lieu
de la prise de vue. Leurs légendes se contentent d’une
description très succincte de la photographie, respectivement :
« La tête du sphinx, de face, de profil et de profil perdu193 »
et « La tête du sphinx, vue par derrière194 ». C’est
l’orientation de la prise de vue qui est jugée importante de
citer pour la statue, afin de permettre aux lecteurs d’en faire
virtuellement le tour. Les indications d’ordre technique
varient en fonction de l’image et de son photographe, mais
également de l’archéologue qui l’utilise pour son discours.
Cependant c’est généralement la fonction ou la nature de
l’objet photographié qui est citée. Plus rarement apparaît le
contexte dans les commentaires de l’image. Les légendes ont
pour fonction de renseigner le lecteur sur l’illustration et
présente donc les informations les plus pertinentes concernant
cette image. Il ne s’agit pas d’indications sur la photographie
mais sur l’objet quelle représente, ce qui prouve qu’elle n’est
pas reconnue par elle-même et qu’elle n’existe que pour les
œuvres qu’elle représente. Pour certaines photographies
reproduites, il a été jugé important de placer une indication
de mesure pour rapporter l’aspect véritable de la photographie.
Sur les photographies publiées CAT 193, la base de
l’ « Apollon », CAT 197, les cuisses d’un Apollon archaïque et
enfin le CAT 198, représentant le torse d’ « Apollon », une
échelle a été faite. Concernant le CAT 193 l’échelle a été
193 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909, p. 42, fig. 17. 194 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909, p. 46, fig. 22.
143
représentée graphiquement par un trait gradué exprimant la
longueur de la base, alors que pour les CAT 193 et CAT 197
l’échelle est indiquée par le rapport entre la longueur réelle
et sa représentation sur la photographie, obligeant le lecteur
à mesurer par lui-même. Mais sans même mesurer, l’indication
d’une échelle permet de donner une idée de la longueur réelle
de la statue. On peut noter que si la photographie bénéficie
d’une confiance absolue à la fin du XIXe siècle, les
scientifiques inventent des moyens alternatifs afin de pallier
le défaut d’échelle sur la photographie du matériel
archéologique.
On accorde un degré de confiance infini à la photographie
car elle est reçue comme une représentation du réel. Il demeure
important de noter qu’une même photographie peut être lue très
différemment selon la légende qui l’accompagne. En effet, les
commentaires mettent l’accent sur un aspect spécifique de
l’image et en imposent une lecture particulière. Cette lecture
monopolise l’attention de l’observateur et ferme la porte à
d’autres lectures possibles. Si la photographie n’est jamais
remise en question à la fin du XIXe c’est parce que les moyens
de modification ne sont pas encore apparus – ou du moins ne
sont pas généralisés. Les seules interventions qu’utilisent les
photographes sont des retouches bénignes pour améliorer la
lecture de l’image195. Mais les images en elles-mêmes, comme
nous l’avons vu précédemment196, peuvent être des constructions
195 Voir II, C, 3 : « Intervention manuelle sur le cliché : en vue de lapublication ».196 Voir II, C, 1 : « Intervention du photographe dans la mise en scène ».
144
factices. Dans ce cas, c’est uniquement le texte accompagnant
les photographies qui pourra rétablir la vérité ou du moins
mentionner qu’il s’agit d’une construction de l’image. Par
exemple, la photographie CAT 123 représente un ouvrier fixant
un mur. Les différentes légendes inscrites sur le souple (fait
d’après la plaque de verre) conservé à l’École française
d’Athènes ne nous permet pas de localiser le lieu de la prise
de vue : plusieurs annotations barrées prouvent cette
incertitude : « Stade », « Fontaine », « Themenos de Neoptolème
( ??) » et « mur de la terrasse du fond ». C’est en raison du
manque de certitude des informations accompagnant ce cliché
qu’il n’a pas été publié, alors que la dernière légende
inscrite sur le souple le dote d’une anecdote très
intéressante : « Ouvrier analphabète faisant semblant de lire
une inscription sur un mur épigraphe ». Cette légende met en
lumière un aspect de la photographie qu’il n’aurait pas été
possible de connaître sans cette mention manuscrite. Il est
impossible de savoir qui a écrit ce commentaire : un archiviste
de l’École ? Le photographe ? Le fait que les autres
informations contenues sur le souple sont très incertaines
s’explique probablement par le fait qu’il doit s’agir d’une
personne étrangère à la Grande Fouille. En conclusion, on peut
dire que cette légende permet de déterminer un certain axe de
lecture, celui de la mise en scène et d’une volonté de
construction de l’information par les images.
La légende devient rapidement inséparable de la
photographie : il n’y a presque pas de photographies non
145
légendées dans les publications scientifiques. En effet,
l’objectif avoué de l’intégration de la photographie dans les
publications est de servir le texte. Il faut dans ce cas que la
photographie puisse être la plus lisible possible. Ainsi, les
légendes servent tout autant le discours scientifique. Si les
scientifiques cherchent à lui donner une consistance
scientifique, on remarque que les légendes ne sont pas
homogènes. Certaines ont pour fonction de décrire l’objet alors
que d’autres orientent la vision du lecteur. Par exemple, pour
le cliché publié de l’ « Apollon » (CAT 196), on remarque que
la légende, « Apollon » attribué à l’atelier de Chios »197 se
concentre sur l’attribution de l’objet étudié plutôt que sur
une autre caractéristique. Le discours d’Homolle sur la statue
donne d’autres informations qui auraient pu figurer dans la
légende, comme par exemple l’ars. Les légendes accompagnant les
photographies publiées peuvent préciser la nature de l’image.
Ainsi, le CAT 224 a pour légende, dans le volume des Fouilles de
Delphes sur l’Art archaïque198 : « trouvailles du 25 juin 1901 à
Marmaria (d’après une photographie ancienne) ». Cela implique
donc que la nature de l’image a changé et que la photographie
ancienne a donné naissance à cette image grâce à quelques
transformations. Les numéros se référant à chacun des blocs ont
été notés pour en faciliter la lecture et nous pouvons donc en
déduire qu’en vue de la publication, l’ancienne photographie a
fait l’objet d’un détourage. Cette image publiée n’ayant plus
l’apparence de la photographie originelle, il a été jugé
197 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque de Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909, p. 58, fig. 28.198 LA COSTE-MESSELIÈRE, Pierre de et PICARD, Charles, Art archaïque (fin) :Sculptures de temples dans Fouilles de Delphes, 1928, p. 7, fig,2.
146
important de le signaler dans la légende. Pourtant toutes les
légendes ne signalent pas les évolutions qui affectent les
photographies de la Grande Fouille. Par exemple les deux
gravures publiées par Théophile Homolle ne signalent pas
qu’elles ont été faites d’après photographies (CAT 185 et CAT
189). En effet, les légendes sont respectivement : « Vue du
trésor de Sicyone, prise de l’Est, en 1894199 » et « Le socle,
tel qu’il fut découvert en 1893, sur des terres rapportées et
avec un tambour de hasard200 ». On remarque une volonté
scientifique pour la première légende, reprenant les
informations d’identification de l’objet d’étude, alors que la
légende du CAT 189 n’est pas conforme aux légendes de revues
scientifiques. En effet, le contexte de découverte n’apparaît
que très rarement dans ces textes et encore moins dans les
légendes d’illustrations. On peut penser que si cette légende
anecdotique a pu être publiée, c’est parce que, sur la même
page201, figure une photographie (CAT 188) du même socle avec
une légende d’identification : « Le socle et les débris du
premier tambour de la colonne du sphinx ».
En conclusion, la recherche d’exhaustivité, la lisibilité
et la bonne traduction des formes sont les trois critères qui
doivent servir de base à la constitution d’une bonne
documentation photographique en archéologie. La légende
participe à cette transmission de l’information mais on199 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909, p. 19, fig. 10.200 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909, p. 44, fig. 20.201 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909, p. 44, fig. 19.
147
remarque que les types de renseignements communiqués ne sont
pas homogènes. En effet, malgré la volonté de rendre la
photographie la plus scientifique possible, les compléments
d’informations ne sont jamais les mêmes et ne permettent donc
pas une analyse de rigueur. Les légendes ne peuvent pas faire
partie d’une méthode scientifique car l’ensemble de canons
guidant le processus de production des connaissances
scientifiques n’est pas respecté. On peut noter aussi le manque
de certitude à l’égard de la fonction du texte accompagnant
l’image : doit-il servir à décrire l’image ? Ou bien est-ce son
rôle d’orienter le lecteur ? Ainsi l’impératif de faire
cohabiter le discours scientifique avec les photographies qui
jouent le rôle de pièce à conviction est une des questions qui
agite savants et éditeurs. Ceux-ci optent dans un premier temps
pour la publication d’héliogravures en annexe du volume,
technique alors prépondérante. L’arrivée et la démocratisation
du procédé de la similigravure en 1895 change la donne. Les
clichés peuvent désormais être intégrés au corps de texte.
C’est alors l’évolution technique qui préside au choix de mise
en forme des photographies. La photographie constitue ainsi le
point de rencontre de différents médiums : légendes, dessins,
relevés topographiques, extraits du journal de fouilles.
3. Variété des utilisations de l’image : publication et envois pour le CRAI
A la diversité des techniques qui viennent combler les
potentielles lacunes de la photographie, répondent et
s’adaptent les diverses utilisations dont elle fait l’objet.
148
Notre catalogue présente les clichés issus du fonds
photographique de la Grande Fouille de Delphes et inclut de
nombreuses images trouvées lors du dépouillement des diverses
publications liées à la fouille. Les photographies utilisées
pour la publication sont bien entendu issues du fonds
photographique ; cependant cette classification entre image
archivée et image publiée nous permet de nous interroger sur
les ressorts et les problématiques qui découlent de la volonté
de publication d’une image dans un contexte scientifique.
L’image est-elle faite pour être publiée ? Existe-t-il des
différences de traitement éditorial et technique suivant leurs
diverses applications ?
La typologie des publications, leur contexte de rédaction
et le public auquel elles s’adressent nous renseignent sur les
différences de traitement des photographies en vue de leur
réception par la communauté scientifique. Ainsi, on peut
premièrement différencier les publications du Comptes rendu des
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (CRAI)
et de l’Institut de correspondance hellénique (ICH), des ouvrages tels
que le BCH et la série de publications Fouilles de Delphes. On
construit ces deux grands ensembles selon le traitement des
photographies qui y sont associées. En effet, le CRAI choisit
simplement de joindre au compte rendu des photographies dites
« brutes », c’est-à-dire envoyées à l’Académie sans traitement
particulier. Dans une optique similaire, l’ICH présente au
public scientifique les diapositives des photographies, elles
non plus sans traitement autre que leur projection qui en
149
diminue la qualité de lecture. Concernant le CRAI et l’ICH, il
s’agit en quelque sorte de la première vie des clichés, de leur
premier usage. Il est important de signaler que certaines
diapositives présentées à la vue du public de l’Institut lors
des séances sont ensuite publiées au sein du BCH. Même dans ces
cas précis, les photographies ne sont que la retranscription
des simples diapositives. On peut remarquer avec les
différentes études consacrées à l’Aurige et leurs supports
photographiques respectifs (CAT 178, CAT 179, CAT 180 et CAT
181), qu’il existe un certain intérêt pour les images
projetées. Si la lettre de Th. Homolle202 présente deux clichés
dits « bruts », c’est à dire non traités, son article suivant203
est illustré de trois photographies traitées en vue d’une
présentation. Les trois clichés (l’Aurige de face, de profil et
la base de l’ex-voto de Polyzalos) ont subi des détourages. On
ne sait quand le traitement de l’image a eu lieu, si Th.
Homolle a choisi ces photographies déjà traitées pour sa
présentation à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
si le photographe l’a fait pour les diapositives ou si le
détourage a eu lieu en vue de la publication. En revanche le
BCH et la série Fouilles de Delphes ne poursuivent pas la même
ambition puisqu’il ne s’agit plus de simples comptes rendus ou
de séances, mais d’ouvrages destinés à une certaine pérennité
scientifique allant au-delà d’une information récapitulative
plus minimaliste. C’est pourquoi les photographies subissent un202 HOMOLLE, Théophile, « Lettre relative à la statue de bronze découverte àDelphes » dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,1896, volume 40, numéro 3, pp. 186-188. 203 HOMOLLE, Théophile, « Statue de bronze découverte à Delphes, séance 5juin 1896, appendice » dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions etBelles-Lettres, 1896, vol. 40, numéro 4, pp. 362-384.
150
réel travail d’édition dans le cadre de ces publications. Leur
traitement technique répond donc au souci de présentation de
ces ouvrages. Notons aussi que les images qu’on retrouve dans
le BCH font l’objet d’un traitement par l’héliogravure, comme
par exemple le détourage des blocs de marbre des Hymnes de
Delphes (CAT 172). Les clichés sont envoyés au préalable à
Paris au sein de maisons d’éditions réputées de l’époque, et
l’on retrouve ces héliographies compilées dans les planches du
BCH qui permettent une lecture exhaustive des images liées à la
Grande Fouille.
On a vu dans quelle mesure et pour quelles raisons la
photographie s’intègre massivement aux publications
archéologiques, et plus précisément delphiques. Il a dès lors
été imposé à la communauté scientifique de définir les
modalités de son intégration au discours des chercheurs. Il
s’agissait de compléter et de potentialiser les arguments
apportés par la photographie. Enfin, on a pu étudier la
diversité des utilisations des clichés au sein des revues
scientifiques et des comptes rendus qui font état de la Grande
Fouille de Delphes. Après s’être attaché aux différents
traitements éditoriaux de l’image, il faut désormais
s’intéresser au bouleversement technique des procédés
photomécaniques ayant eu lieu en amont et qui conditionnent
l’usage fait par l’Ecole française d’Athènes des prises de vue
du site delphique. En effet, quels sont les procédés utilisés
par l’École ? A qui fait-elle appel lorsque vient le moment de
la réalisation des clichés, puis celui de leur publication ? On
151
s’efforcera ainsi d’analyser la véritable industrie
photographique éclose à la fin du XIXe siècle ainsi que ses
relations avec l’Ecole Française d’Athènes.
B) L’industrie photographique au service de l’EfA
On constate ainsi que la photographie permet un mode de
représentation pédagogique et interactif de la fouille,
autorisant débats et dialogues objectifs de la part des
scientifiques rassemblés autour d'un cliché. Les séances de
l'Institut de correspondance hellénique sont le lieu de cette
exposition dynamique des prises de vue.
1. Les nouveaux procédés photomécaniques utilisés par l’EfA
Le XIXe siècle voit une évolution des procédés
photomécaniques grâce à l’amélioration de l’imprimerie
photographique qui apparaît au début des années 1850. La Grande
Fouille de Delphes peut donc utiliser ces procédés qui ont eu
le temps de se perfectionner. L’industrie photographique fait
l’objet de nombreux progrès en devenant l’un des enjeux de
l’ère industrielle où le savoir doit être accessible à tous.
L’École française d’Athènes, en intégrant la photographie à ces
revues scientifiques, comme le Bulletin de correspondance hellénique ou
Les Fouilles de Delphes, bénéficie d’une plus grande diffusion des
images prises sur les chantiers. L’image acquiert désormais une
place prépondérante dans ces publications et bouleverse le
milieu de l’édition. Les progrès techniques des prises de vue
s’accompagnent d’une transformation radicale des procédés
152
d’impression. Les archéologues de la Grande Fouille de Delphes
utilisent le procédé du gélatinobromure d’argent sur plaque
sèche. Le temps des daguerréotypes et des calotypes est révolu.
L’utilisation de la plaque de verre, plus sensible à la lumière
que le papier et donc plus nette, oblige les opticiens à mettre
au point des objectifs bien plus performants. La qualité des
prises de vue s’améliore considérablement. Les procédés
photomécaniques se succèdent rapidement : la lithophotographie
en 1855, le procédé Poitevin de lithophotographie en 1867, la
photoglyptie en 1864 et enfin la phototypie de 1867, sans
compter les multiples travaux sur l’héliogravure tout au long
du XIXe siècle. Ces nouveaux procédés photomécaniques
deviennent de plus en plus économiques et permettent
d’accroître considérablement le nombre de photographies et de
les insérer dans le texte. On note malheureusement une baisse
générale de la qualité des images publiées. Comme nous l’avons
vu précédemment204, la similigravure est une technique
présentant de nombreux avantages mais pas celle de la qualité,
ceci est visible sur les clichés CAT 193, CAT 194, CAT 195 et
CAT 196 publiés en 1909 pour la collection Fouille de Delphes205,
Toutefois, si la qualité des clichés est toujours médiocre, les
procédés photomécaniques résolvent le problème de l’altération
des tirages et leur assurent une pérennité.
L’héliogravure et la similigravure sont les deux procédés
photomécaniques les plus utilisés pour imprimer les ouvrages
204 Voir III, A, 1 : « Utilité et fonctions de l'exploitation de laphotographie dans les publications scientifiques ». 205 HOMOLLE, Théophile, Art primitif, Art archaïque du Péloponnèse et des îles dans Fouilles deDelphes, 1909 [65 p.].
153
d’archéologie. L’héliogravure au grain est un moyen de
photomécanique pour obtenir un tirage en gravure taille-douce à
partir d’une plaque de cuivre qui a reçu auparavant l’empreinte
du cliché à reproduire. Il s’agit du même principe que la
gravure en creux de la taille-douce : les creux de la planche
de cuivre sont remplis d’encre. La surface de la planche est
ensuite essuyée, et l’encre restant dans les creux se dépose
sur le papier. Les ouvrages tels que le Bulletin de correspondance
hellénique illustrent des planches tirées en héliogravure de
bonne qualité mais en nombre restreint. L’héliogravure
contraint les illustrations à être toutes concentrées à la fin
du volume, dans un ensemble que l’on appelle les planches hors-
texte et qui regroupe toute l’illustration (dessins et
photographies). Ceci a l’avantage de simplifier la mise en page
et de rendre l’impression moins onéreuse. En effet, les demi-
teintes exigent une qualité de papier supérieur à celle
utilisée pour les textes. En 1895, la première similigravure
fait son apparition dans le Bulletin de Correspondance Hellénique à la
page 310206. Aucun des trois articles présentant des figures en
similigravure dans ce numéro ne traite de Delphes207, mais on
peut toutefois noter que le nombre d’images par article est
important. Par exemple, pour l’article « Fouilles à Délos208 »,
on dénombre dix-sept photographies reproduites par la206 ORSI, Paolo, « Sur une très antique statue de Mégara Hyblaea » dansBulletin de correspondance hellénique, volume 19, 1895, p. 310, fig. 1. 207 ORSI, Paolo, « Sur une très antique statue de Mégara Hyblaea » dansBulletin de correspondance hellénique, volume 19, 1895, pp. 307-317 ; MILLET,Gabriel, « Les monastères et les églises de Trébizonde » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 19, 1895, pp. 419-459 ; COUVE, Louis,« Fouilles à Délos » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 19, 1895,pp. 460-516. 208 COUVE, Louis, « Fouilles à Délos » dans Bulletin de correspondance hellénique,volume 19, 1895, pp. 460-516.
154
similigravure, ce qui est considérable. Mais c’est en 1896 que
la similigravure est définitivement adoptée car elle est alors
intégrée soit dans le texte, soit dans les planches en annexe à
la fin du volume. Même si cette nouvelle technique est
médiocre, elle permet au lecteur une plus grande aisance dans
la lecture, ne l’obligeant pas à se référer continuellement aux
planches regroupées en fin de volume. Pour le volume 20 (1896)
du Bulletin de correspondance hellénique, on remarque l’importance que
prend la similigravure. En effet, pour trente trois planches de
fin d’ouvrage (d’héliographie et phototypie) il y a quarante et
une similigravures dans le corps de texte. Les CAT 175 et CAT
176, deux planches de numismatique, sont toutes deux des
phototypies de la maison Rhomaïdes à Athènes. La phototypie
permet un rendu à modèle continu non tramé qui se présente
comme une alternative au procédé de similigravure. Toujours
cette même année, M. Homolle dans une note sur une inscription,
écrit :
« Comme d’ailleurs le texte n’est pas établi avec une
exactitude rigoureuse, que l’on diffère sur la
lecture, l’interprétation et la date, il vaut la
peine d’étudier à nouveau ce document, et pour en
faciliter l’examen, on en place ci-contre le fac-
similé photographique209 ».
Homolle gratifie ainsi la photographie de sa confiance,
notamment par l’amélioration de sa qualité de reproduction.
209 HOMOLLE, Théophile, « Le temps delphique du IVe siècle » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 20, 1896, p. 678.
155
Le Bulletin de correspondance hellénique est la principale source
de promotion des fouilles de l’École française d’Athènes, mais
surtout de la Grande Fouille de Delphes. Par l’introduction de
la similigravure dans la revue scientifique, l’École française
d’Athènes témoigne de sa volonté d’utiliser de nouveaux
procédés photomécaniques afin de bénéficier d’avantages, tant
sur le plan économique que sur celui de la lisibilité.
2. Les studios de photographie et d’impression de l’EfA
L’avancée des procédés photomécaniques constitue un socle
solide pour la publication et le commentaire des photographies
effectuées sur le chantier de fouille, soit la seconde vie des
clichés. L’École française d’Athènes renforce encore cette
assise en faisant appel à des professionnels. Il s’agit
d’étudier à travers les archives comptables et financières de
l’École, les organismes auxquels elle a confié les précieux
clichés de fouilles en vue de leur projection ou de leur
publication au sein des revues scientifiques telles que le
Bulletin de correspondance hellénique, les comptes rendus de l’Institut
de correspondance hellénique ou encore les Comptes rendus des
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
La photographie est perçue comme un investissement par
l’École française d’Athènes qui utilise une certaine part de
son budget pour financer ses besoins photographiques. Les
sources consultées pour cette étude ne mentionnent pas le
développement des plaques de verre, mais seulement leur
156
traitement pour une utilisation éditoriale. Les clichés publiés
ne sont pas très nombreux, ils restent luxueux mais
l’investissement en est assuré par la stabilité des épreuves
publiées. La photographie est devenue au cours du XIXe siècle
une industrie que l’École française d’Athènes convoque pour ses
propres besoins. La plupart des photographies publiées du fonds
de la Grande Fouille sont des héliogravures de la maison
parisienne Dujardin. Par exemple, le CAT 173 a été traité
photomécaniquement par l’entreprise Dujardin comme on peut voir
inscrit sur la planche : « Heliog. Dujardin Paris ». Le Bulletin
de Correspondance Hellénique a deux maison d’éditions jusqu’en
1895 : il s’agit d’Edouard Thorin210 à Paris et de Perris
frères211 à Athènes. Par la suite la maison d’édition
Fontemoing, située à Paris, devient la seule maison d’édition
du BCH. Le choix de publier en France plutôt qu’en Grèce peut
s’expliquer par la meilleure qualité des maisons d’édition à
Paris, ou bien par obligation à cause du rattachement de
l’École à l’Institut des Inscriptions et Belles-Lettres.
L’étude d’une facture212 de la maison P. Dujardin nous fournit
des renseignements sur celle-ci. C’est une manufacture située
au 28 rue Vavin dans le 6ème arrondissement de Paris, avec
succursale au 56 rue Notre-Dame des Champs. On peut lire sur la
facture :
« Gravure héliographique – imprimerie – galvanotype210E. Thorin et fils est une société d’édition parisienne s’occupantprincipalement d’ouvrages universitaires pendant la deuxième moitié duXIXème siècle. 211 Il semblerait que l’imprimeur des Bulletin de correspondance hellénique n’ait pasété localisé à Athènes. 212 Facture de P. Dujardin du 21 Août 1903 présente dans le versement desarchives comptables et financières de l’École française d’Athènes, Archivesnationales.
157
Médaille d’Or, Grands Prix, Exp. Universelles 1878,
1889, 1900
(Maison fondée en 1866) »
Il s’agit d’un en-tête à caractère publicitaire qui nous
informe sur la renommée de cette maison. La maison Dujardin est
fondée en 1866, pourtant Paul Dujardin ne débute son activité
d’héliograveur qu’en 1875, après avoir racheté le fonds de
Gustave Alexandre Dujardin. L’entreprise Dujardin est une
manufacture d’épreuves et de planches gravées par procédé
héliographique en taille douce. On peut noter qu’après avoir
reçu son premier prix en 1878, Paul Dujardin reçoit
personnellement la Légion d’Honneur213 et qu’il devient membre
de la Société française de photographie en 1879. Comme nous
l’avons pressenti auparavant, l’École française d’Athènes
choisit une des meilleures entreprises pour le traitement de
ses clichés, en dépit des complications de transport. En effet
les envois sont eux-mêmes un investissement puisque par exemple
le surveillant de l’École fait état d’une réception de caisse
de planches gravées, coûtant 17,40 francs, le 6 juillet 1903214.
La manufacture Dujardin est très réputée, on peut néanmoins se
poser la question de la spécialisation de publication : l’École
française d’Athènes ne choisit pas aveuglément cette entreprise
pour tirer les photographies du fonds delphique. Dujardin est
rompu à la publication documentaire puisqu’il réalise à la même
période les héliogravures de l’ouvrage à vocation documentaire
La Normandie monumentale et pittoresque, édifices publics, églises, châteaux,
213 Dossier de Légion d'honneur, Archives nationales, LH/839/51.214 « Expéditions et transports », le 20 septembre 1902, Archivesnationales.
158
manoirs, etc215. A partir de 1893 ce n’est plus seulement Dujardin
qui réalise les impressions photomécaniques, on trouve aussi
les mentions de « Phototypie Brunner », « phototypie Berthaud »
et « Phototypie Rhomaïdes ». Les CAT 175 et CAT 176 sont des
phototypies exécutées par Rhomaïdes. L’établissement
photographique Rhomaïdes se situe à Athènes et est spécialisé
dans les tirages photomécaniques documentaires, comme le montre
deux publications contemporaines de la Grande Fouille produits
par les frères Rhomaïdes : Catalogue général des antiquités et des
principaux monuments modernes de la Grèce216 et Olympia : Hermès of
Praxiteles217. Cette entreprise tire aussi les phototypies des
ouvrages de l’Institut Allemand d’Archéologie, notamment le
journal annuel Mitteilungen des Deutschen Archäogischen Instituts (MDAI).
Les tirages photomécaniques de leur ouvrage Olympia sont aussi
des phototypies, on peut donc en conclure que l’entreprise en a
fait sa spécialité. Le traitement des photographies à usage
archéologique semble nécessiter un conditionnement spécifique
car l’École ne confie ces tâches qu’à des entreprises
distinctes. Sur le bordereau du 10 février 1904 concernant les
dépenses pour le Bulletin de Correspondance Hellénique218 on
note le nom « Ehrard Frères » pour l’impression des planches.
L’entreprise valorise sa spécialisation dans les travaux liés à
215 MAGRON, Henri, La Normandie monumentale et pittoresque, édifices publics, églises,châteaux, manoirs, etc., / Héliogravures de P. Dujardin, Le Havre, Lemasle, 1893-1899 [112 p.]. 216 RHOMAÏDES, frères, Catalogue général des antiquités et des principaux monumentsmodernes de la Grèce, Athènes, Anestis Constantinidis, 1892 [18 p.].217 RHOMAÏDES, Constantine, Olympia : Hermès of Praxiteles, Athènes, Rhomaïdesfrères, 1894 [33 p.].218 « Exercice 1903 : Bordereau des pièces justificatives des dépensesfaites par l’école Francaise d’Athènes pendant l’année 1903 [concernant leBulletin de correspondance hellénique] », versement des archives comptables etfinancières de l’École française d’Athènes, Archives nationales.
159
la discipline géographique comme on peut le voir sur l’en-tête
de leur facture du 10 octobre 1903219. Cette entreprise est
présente dans un autre bordereau220 à l’instar de Dujardin :
l’École française d’Athènes aurait donc diversifié les
entreprises sous-traitantes en charge du traitement des images.
Si Dujardin s’occupe principalement des héliogravures et autres
tirages photomécaniques, Ehrard s’attacherait davantage à la
gravure, probablement d’après photographies, comme les CAT 185
et CAT 189. Enfin, quand l’image est définitivement intégrée au
texte grâce au procédé de similigravure, la maison d’édition
Fontemoing se charge du traitement des photographies.
Apres avoir étudié l’avancée des procédés photomécaniques
sur lesquels l’Ecole française d’Athènes s’appuie et précisé
les principaux acteurs du traitement des clichés, attachons
nous à une voie supplémentaire d’utilisation des photographies
en dehors des sentiers de la publication scientifique. Il
s’agit de leur projection au sein des séances de l’Institut de
correspondance héllénique, à différencier des comptes rendus de
celles-ci, déjà étudiés précédemment.
3. Une autre présentation des clichés : leur projection pendantles séances de l’Institut de correspondance hellénique
Albert Dumont (1842 – 1884), directeur de l’École
française d’Athènes de 1875 à 1878, met en place l’Institut de
219 Facture de la société Erhard Frères, 29 Octobre 1903, versement desarchives comptables et financières de l’École française d’Athènes, Archivesnationales.220 « Exercice 1903, Bordereau N3 », versement des archives comptables etfinancières de l’École française d’Athènes, Archives nationales.
160
correspondance hellénique à partir de 1876. On peut citer
Homolle, qui en 1891 revient sur l’initiative de Dumont : « il
[Dumont] voulut placer un intermédiaire entre les chercheurs
isolés, les sociétés locales et les universités ou les
académies221 ». L’Institut de correspondance hellénique est
destiné à centraliser l’ensemble des découvertes archéologiques
réalisées dans le monde hellénique. Les membres de l’École
française d’Athènes ne sont pas les seuls intervenants compte
tenu du fait que sont invités des correspondants étrangers,
notamment grecs. Le dessein de cet institut est la création
d’un réseau francophile autour de l’École française
d’Athènes222. Homolle comprend l’importance scientifique de
l’Institut : les séances bimensuelles permettent aux
scientifiques de l’École de se réunir afin de discuter de
l’état des recherches en Grèce. Les séances garantissent
l’émulation scientifique et le dialogue autour des recherches
en cours. Homolle réinstaure l’Institut de correspondance
hellénique en 1891 : en effet il ne s’était pas tenu de séances
à l’École depuis 1878. Le discours d’Homolle est retranscrit
dans le Bulletin de correspondance hellénique223 et nous permet
ainsi de connaître ses motivations : « répandre […] par les
comptes rendus des réunions périodiques qu’il aurait tenues,
par le Bulletin qu’il aurait publié, dans le monde savant tout
221 HOMOLLE, Théophile, « Institut de correspondance hellénique » dans Bulletinde correspondance hellénique, vol. 15, 1891, p. 431. 222 VALENTI, Catherine, « L’École française d’Athènes au cœur des relationsfranco-helleniques » dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, numéro 50-4,Paris, Belin, 2003/4, p.92 223 HOMOLLE, Théophile, « Institut de correspondance hellénique » dans Bulletinde correspondance hellénique, vol. 15, 1891, pp. 431-440.
161
entier.224 » Il souhaite faciliter l’accès aux recherches au
corps scientifique international, afin que la science puisse
être partagée. Les séances de l’Institut sont par la suite très
souvent retranscrites dans le BCH mais aussi dans d’autres
revues, en France et en Grèce, comme dans le Journal des Débats225.
Le BCH résume les séances dans des articles intitulés
« Institut de correspondance hellénique », comme par exemple
les deux articles du volume 17 de 1893226 qui regroupent
plusieurs comptes rendus de séances. Mais à partir de 1900 on
remarque que les séances de l’Institut ne sont plus rapportées
de la même manière dans le Bulletin : en effet, chaque
intervenant écrit un article complet pour être publié dans le
BCH. Notre étude ne s’intéresse pas aux articles des
intervenants mais aux retranscriptions des séances ; ces
rapports sont les témoignages du déroulement de celles-ci. Ils
nous permettent de comprendre de quelle manière les
archéologues de la fin du XIXe travaillaient ensemble dans une
communauté française implantée à Athènes. Ces rapports ne
citent que rapidement l’organisation des séances ; on sait que
plusieurs intervenants dressent un état de leurs travaux afin
que le corps scientifique présent puisse ensuite débattre de
leurs recherches respectives. Le dialogue scientifique est tout
à fait primordial au sein de l’Institut de correspondance
224 HOMOLLE, Théophile, « Institut de correspondance hellénique » dans Bulletinde correspondance hellénique, vol. 15, 1891, p. 431. 225 Par exemple, « L’Hymne à Apollon » dans Journal des Débats, Vendredi soir 15avril 1904, p. 3. 226 HOMOLLE, Théophile, « Institut de Correspondance Hellénique » dans Bulletinde correspondance hellénique, vol. 17, 1893, pp. 181-187 et HOMOLLE, Théophile,« Institut de Correspondance Hellénique » dans Bulletin de correspondancehellénique, vol. 17, 1893, pp. 611-623.
162
hellénique, et dans ce contexte la photographie devient utile
pour rassembler les informations et en faciliter l’accès.
Nous savons par l’étude des comptes administratifs de l’École
française d’Athènes que l’Institut de correspondance
hellénique est l’un des treize pôles du budget accordé par le
Ministère de l’Instruction Publique en 1902 et en 1903227. Pour
le premier semestre de 1902 l’Institut reçoit un budget de
« 400228 » mais on ne sait s’il s’agit de francs ou de drachmes
alors que pour le premier semestre de 1903, l’École française
demande 133,70 francs229. Cette différence de budget peut
s’expliquer par le fait que le premier bordereau est calculé
en drachmes, mais vu qu’il s’agit d’une liste de dépenses
adressée au Ministère de l’Instruction Publique français, il
est peu probable que cette hypothèse soit véridique. L’étude
de ces archives comptables nous apporte des informations sur
l’organisation des réunions de l’Institut de correspondance
hellénique. Premièrement, la photographie y est très présente
car elle sert souvent de support aux intervenants pour
expliquer leurs recherches le plus clairement possible.
L’ « État N5 du Budget de 1902230 », relatif au matériel de
l’École française d’Athènes, répertorie les différentes
dépenses faites spécifiquement par l’Institut de227 Le versement des archives comptables et financières de l’Écolefrançaise d’Athènes, Archives nationales.228 « Budget 1902, Matériel Art. V, Fouilles de Delphes », versement desarchives comptables et financières de l’École française d’Athènes, Archivesnationales.229 « Compte d’Administration de l’exercice 1903 », versement des archivescomptables et financières de l’École française d’Athènes, Archivesnationales.230 « État N5 du Budget de 1902 », versement des archives comptables etfinancières de l’École française d’Athènes, Archives nationales.
163
correspondance hellénique : « Dépenses pour la tenue des
conférences, des dessins et projections ». Si l’impression et
la distribution des cartons d’invitations, la location des
chaises et la production de dessins sont les trois premiers
motifs de dépenses, la production de clichés pour les
projections représente la plus grosse dépense (581 drachmes).
L’Institut de correspondance hellénique utilise la
photographie pour promouvoir l’information mais à l’aide d’un
autre support : celui de la projection. Il s’agit d’une
présentation des clichés photographiques – issus du fonds
delphique ou non – novatrice et différente des techniques
d’impression photomécaniques que l’on a pu analyser. L’étude
des archives comptables231 nous renseigne sur l’organisation des
projections. En 1902, l’École fait l’achat d’une lanterne de
projection. Il s’agit d’une lanterne qui fonctionnait à l’aide
de deux lampes à arc, de la marque parisienne Radiguet-
Massiot. Des factures au nom de Rudolph Roher correspondent
aux premiers achats d’émulsions pour diapositives. On peut se
demander si les projections de diapositives existaient à
l’Institut de correspondance hellénique avant 1902. Le manque
d’information concernant la période pre-1902 nous prive de
tout renseignement. Mais si l’Ecole utilisait déjà ce médium,
c’est à partir de 1902 qu’elle en perfectionne son usage.
Deuxièmement, la présence de ces mentions de photographies
dans les archives comptables nous permet de savoir que c’est
l’École française d’Athènes qui prend en charge le coût de ces
séances scientifiques. Les archéologues présentant leurs
231 « Exercice 1902 », versement des archives comptables et financières del’École française d’Athènes, Archives nationales.
164
recherches se doivent de financer leurs interventions mais
bénéficient du dédommagement de l’institution. D’un point de
vue juridique il est probable que ces photographies
appartiennent à l’École, mais au nom de la recherche les
archéologues peuvent les utiliser très facilement pour
accompagner leurs travaux. La photothèque actuelle de l’École
recense plus de 13 800 diapositives : si elles ne datent pas
toutes de la fin du XIXe siècle – début du XXe siècle, il est
probable que la collection de diapositives ait commencé avec
les séances de l’Institut de Correspondance Hellénique.
Dans les comptes rendus des séances de l’Institut publiés
dans le Bulletin de correspondance hellénique, la manière dont
les clichés sont présentés n’est jamais mentionnée :
« M. Homolle annonce ensuite le commencement des
fouilles de Delphes, inaugurées le 10 octobre, et en
communique les premiers résultats, avec les plans du
chantier et les photographies des inscriptions et des
monuments figurés découverts jusqu’à ce jour232 »
Les photographies sont toujours des supports d’informations,
destinés à une meilleure compréhension du discours. Pour
autant ces clichés ne sont pas publiés dans le Bulletin pour
le lecteur : il s’agit de mentions de photographies réservées
aux séances de l’Institut. Les clichés sont présentés et
projetés pendant les séances afin que tous les scientifiques
présents puissent les analyser en même temps, dans une volonté
de cohésion scientifique. La présentation des clichés par
232 HOMOLLE, Théophile, « Institut de Correspondance Hellénique » dans Bulletinde correspondance hellénique, vol. 17, 1893, p. 184.
165
projection est plus appropriée au dialogue entre les
différents membres présents ; par exemple pour la question de
la localisation du rocher de Sibylle et de l’Aire Sacrée sur
le site de Delphes, Homolle expose les différentes sources sur
lesquelles il s’est appuyé pour émettre l’hypothèse d’une
localisation entre le Trésor des Athéniens et l’angle Est du
mur polygonal :
« M. Homolle en croit reconnaître l’image assez
fidèle sur un vase peint représentant la fuite de
Léto devant le monstre, et dont il rapporte la
photographique du lieu233 »
Les différentes photographies projetées au cours de cette
séance permettent à l’assistance de comprendre la logique
d’Homolle et par conséquent à ce dernier d’appuyer sa
démonstration de la manière la plus scientifique possible. En
revanche, la photographie n’est pas toujours utilisée pour
démontrer des raisonnements scientifiques. Par exemple en 1894
la retranscription d’une intervention d’Homolle n’est pas
fidèle : on observe que l’auteur de l’article, Couve, prend
des libertés et se permet d’ajouter des commentaires, lesquels
n’étaient certainement pas issus du discours d’Homolle :
« M. Homolle décrit brièvement le Trésor des
Athéniens, découvert en 1893, ce monument vénérable
de la première guerre de l’Indépendance, de la
première victoire de l’Hellénisme : il en démontre, à
233 HOMOLLE, Théophile, « Institut de correspondance hellénique » dans Bulletinde correspondance hellénique, volume 17, 1893, p. 619.
166
l’aide des photographies et des moulages exposés dans
la salle, la rare perfection architecturale234 »
Les photographies projetées par Homolle n’avaient sûrement pas
pour objectif de montrer la beauté architecturale du Trésor
mais de servir un véritable discours archéologique. On peut
ajouter que l’auteur de ce rapport de séance réutilise
l’histoire antique au profit d’une filiation avec les
évènements de la Guerre d’indépendance grecque (1821 – 1830).
Le Trésor des Athéniens commémore en effet la Victoire de
Marathon, du début du Ve siècle av. J.C.
Conclusion
Ainsi avons-nous interrogé les apports et les conditions
d’intégration de la photographie à la discipline archéologique.234 COUVE, Louis, « Institut de correspondance hellénique » dans Bulletin decorrespondance hellénique, vol. 18, numéro 1, 1894, p. 173.
167
Le site de Delphes a constitué dans notre étude le prisme, le
laboratoire des diverses applications de la chambre
photographique aux recherches des archéologues qui, lors de la
Grande Fouille, expérimentent la scientifisation et
l’institutionnalisation de leur discipline. Nous avons
déterminé dans quelles mesures et par quels facteurs la
photographie s’est imposée sur le chantier de fouilles. Il nous
a fallu également éclairer l’influence de son intégration aux
techniques archéologiques traditionnelles.
Dès les prémices de l’utilisation de la photographie en
milieu archéologique il existe le terreau nécessaire à
l’accroissement de son usage sur le site de fouilles. On
constate en effet une conjonction de facteurs propres à
favoriser son implantation pérenne. Le premier d’entre eux est
la demande grandissante de chambres photographiques que
plusieurs disciplines commencent à solliciter. Cette demande
permet et encourage le progrès technique. Celui-ci renforce
l’utilisation du médium au sein de la discipline archéologique
grâce à l’apparition -entre autres- de procédés de
développement moins couteux, ou encore de l’instantanéité des
clichés. On note en outre la rédaction de nombreux manuels
relatifs à l’application de la photographie. Enfin, la thèse
d’Anne Lacoste met en lumière la modernisation de la fonction
d’archéologue par une nouvelle génération de savants formés
dans les rangs de l’Ecole Française d’Athènes, de Rome ou
encore de ceux de l’EPHE, et qui se tournent vers la
photographie. L’EfA acquiert à la fin du XIXe et au moment de
168
la Grande Fouille de Delphes tout son poids et
s’institutionnalise davantage. Cependant, la précédente
génération pratiquait déjà la photographie de manière
personnelle à l’aide du daguerréotype. C’est la confluence de
facteurs tels le progrès technique, les manuels d’E. Trutat, de
la Martellière ou encore Maddox qui lient photographie et
archéologie et encouragent son usage. Dès lors, les conditions
d’une photographie scientifique vont être définies dans le
cadre d’une approche documentaire qui renforce l’ambition
exhaustive des recherches et commentaires effectués sur le
matériel archéologique. Cette approche permet en outre une
catégorisation de celui-ci, apporte une vision d’ensemble, un
panorama des découvertes. Si les codes adoptés par les
opérateurs spécialisés dans les prises de vues archéologiques
ne sont pas spécifiques à la discipline, ceux-ci reprennent à
leur avantage et adaptent les codes d’ordre général de la
photographie et les soumettent aux impératifs de
l’archéologie : c’est le cas de l’importance de la lumière en
épigraphie, ou de l’échelle humaine très souvent présente sur
les clichés. Ceux-ci permettent d’ailleurs le renforcement du
dialogue entre institutions puisqu’ils ont pour finalité
institutionnelle et pédagogique leur envoi à l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres qui assure leur rayonnement au
sein de la communauté scientifique. Enfin, la chambre
photographique va définitivement s’associer aux travaux
archéologiques par la confiance unanime dans l’objectivité dont
elle jouit avant la remise en cause du XXe siècle. Après les
premières heures de sa généralisation viennent celles d’un
169
véritable âge d’or de la photographie et de son utilisation
scientifique.
La Grande Fouille de Delphes a été le lieu d’une inflation
photographique de grande ampleur. C’est pourquoi notre étude
s’est concentrée sur le témoignage photographique d’une fouille
sans précédent. On a ainsi vu comment et dans quelle mesure la
photographie a permis une représentation sans filtres du
chantier et de son organisation. L’un des investissements
réalisés par l’EfA -la photographie- met en valeur la totalité
des autres annoncant l’ampleur du chantier. Grâce à l’outil
photographique c’est également, après avoir changé en actes,
l’image de l’archéologue qui évolue pour s’éloigner du lot de
descriptions fantasmagoriques dont la profession faisait
l’objet. La présence de clichés ayant trait à la discipline
ethnologique vont en outre assurer la postérité du fonds
photographique delphique et permettre une contextualisation
fidèle des travaux qui prennent place dans une Grèce encore
chargée d’exotisme pour la majeure partie des savants siégeant
à Paris. La photographie permet l’entrée de la discipline
archéologique dans son ère moderne, tant dans les fonctions
effectives de l’archéologue que dans les consciences. Notre
étude s’est également attachée à l’analyse des différentes
étapes de la production d’un cliché scientifique qui livre de
précieuses informations sur l’intervention de l’opérateur dans
la mise en scène, puis sur le cliché développé en vue de sa
publication. Une véritable méthodologie photographique liée à
la discipline archéologique est fondée à partir des
170
enseignements empiriques tirés de l’expérimentation du médium à
Delphes.
Une fois l’utilisation de la photographie définitivement
intégrée aux méthodes traditionnelles de fouilles et d’études
du matériel, c’est la seconde vie des clichés réalisés à
Delphes par leur publication au sein du CRAI, du BCH ou dans
les Fouilles de Delphes qui retient notre attention. Celle-ci
permet de réaliser l’impact de l’introduction de la
photographie dans la sphère scientifique de la fin du XIXe,
friande de scientifisation et de précisions techniques. Les
reproductions photographiques deviennent le support privilégié
de la véracité scientifique, des découvertes et des recherches
qui y sont associées.
Ce sont ainsi les éléments d’une généralisation de la
pratique, d’un usage croissant du médium et l’ensemble des
externalités positives qu’elle engendre qui permettent de
répondre à notre interrogation sur la force de pénétration de
la photographie dans la discipline archéologique. L’apparition
du médium photographique se présente, par les multiples
applications qui en sont faites sur le site de Delphes, comme
l’un des catalyseurs décisifs de l’archéologie moderne,
scientifique et institutionnalisée qui émerge puis se
consolide, notamment en Grèce, dans les derniers temps du XIXe
siècle.
171
Bibliographie
Sources
Athènes, École française d’Athènes :
- CONVERT, Henri, Plans et dessins, numéro 15261, LegsTournaire.
172
- LAVÉDRINE, Bertrand, Mission sur la conservation des photographies del’École française d’Athènes réalisée entre le 25 juin et le 2 juillet 1992,Dossier Administratif 4.4, carton n5 : collection dephotographies (1989 – 1992), 1992 [4 p.].
- Le Journal de la Grande Fouille (1892 - 1902), DELPHES 2-C DPH 23[576 p.].
- RÉVEILLAC, Gérard, Le fonds photographique ancien de l’Écolefrançaise d’Athènes – La « Grande Fouille » de Delphes (1892 – 1903),Dossier Administratif 4.4, carton n5 : collection dephotographies (1989 – 1992), 1989 [45 p.].
- RÉVEILLAC, Gérard, Rapport de mission exploratoire, DossierAdministratif 4.4, carton n5 : collection de photographies(1989 – 1992), 1988 [4 p.].
Pierrefitte-sur-Seine, Archives Nationales :
- Archives comptables et financières de l’École française d’Athènes 1902– 1975, Carton n1, registre 1901- 1909, 19990001.
Paris, Bibliothèque de l’Institut de France :
- Papiers de Théophile Homolle, Ms 3821-3910. Carton Ms3855 « Vues des fouilles de Delphes » et carton Ms 3860« Plan des fouilles de Delphes, les environs, leParnasse… ». - BRIZEMUR, Daniel, La Nécropole de Delphes, 1901, MsDELPHES 5-BRI.
Archives Municipales, Lyon :
- Archives municipales de Lyon, 925 Wp 299, cartonn°81/2, dossier 4, pièce n° 25-26.
173
Ouvrages à caractère de source
ABOUT, Edmond, La Grèce contemporaine [1854], Paris, Hachette,2000 [304 p.].
[Anonyme], « Informations diverses » dans Comptes rendus desséances de l’Académie des Inscriptions et Belles – Lettres, volume 37, numéro 3,Académie des Inscriptions et Belle-Lettres, Paris, 1893, pp.140 – 141.
[Anonyme], « Livres offerts » dans Comptes rendus des séances del’Académie des Inscriptions et Belles – Lettres, volume 40, numéro 3, Paris,Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1896, pp. 181 –185.
[Anonyme], « Obituary of the year : Richard Leach Maddox,M.D. » dans The British Journal of Photography, Liverpool, T. Bedding,1903, p. 478.
[Anonyme], Recherche des antiquités dans le Nord de l’Afrique. Conseils auxarchéologues et aux voyageurs. Instructions adressées par le Comité des travauxhistoriques et scientifiques aux correspondants du ministère de l’InstructionPublique, Paris, E. Leroux, 1890 [252 p.].
ADELINE, Jules, Les Arts de la reproduction vulgarisés, Paris, Librairie-Imprimerie réunis, 1894 [305 p.].
AMANDRY, Pierre, « Chronique delphique » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 105, numéro 2, Athènes, Écolefrançaise d’Athènes, 1981, pp. 673-769.
AMANDRY, Pierre, La colonne des Naxiens et le portique des Athéniens dansLes Fouilles de Delphes, II, Paris, E. de Boccard, 1953 [128 p.].
AUDIAT, Jean, Le Trésor des Athéniens dans Les Fouilles de Delphes, II,Paris, E. de Boccard, 1933 [109 p.].
AUPERT, Pierre, Le Stade dans Les Fouilles de Delphes, II, Paris, E. deBoccard, 1979 [210 p.]
BANQUART-EVRARD, Louis-Désiré, Traité de photographe sur papier,Paris, Chevalier, 1651 [199 p.].
174
BOURGUET, Émile, « Inscriptions de Delphes [deux comptes duconseil et des ΝΑΟΠΟΙΟΙ] » dans Bulletin de correspondance hellénique,volume 20, numéro 20, Paris, Fontemoing, 1896, pp. 197-241.
BOURGUET, Émile, « Inscriptions de Delphes : Les comptes del’archontat d’Aristonymos » dans Bulletin de correspondance hellénique,volume 26, numéro 20, Paris, Fontemoing, 1902, pp. 5-94.
BOURGUET, Émile, Les comptes du IVe siècle dans Fouilles de Delphes, III,Paris, E. de Boccard, 1932 [357 p.].
BOURGUET, Émile, Les ruines de Delphes, Paris, Fontemoing, 1914 [355p.].
CHAMOUX, François, L’Aurige de Delphes dans Les Fouilles de Delphes, IV,Paris, E. de Boccard, 1955 [85 p.].
COLIN, Gaston, « Notes de chronologie delphique » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 22, numéro 22, Paris, Fontemoing,1898, pp. 1-200.
COLLIGNON, Maxime, « Aquarelle de M. Ronsin représentant lebuste de l’aurige de Delphes » dans Comptes rendus des séances del’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 43, numéro 2, Académiedes Inscriptions et Paris, Belles-Lettres, 1899, pp. 150-151.
COLLIGNON, Maxime, « Les Fouilles de Delphes » dans Comptesrendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 38,numéro 4, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,1894, pp. 301 - 313.
COLLIGNON Maxime, Manuel d’archéologie grecque, Paris, A. Quantin,1881 [368 p.].
COUVE, Louis, « Fouilles sur l’Île de Délos » dans Comptes rendusdes séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 38, numéro6, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1894,pp. 418-420.
COUVE, Louis, « Fouilles à Délos » dans Bulletin de correspondancehellénique, volume 19, 1895, pp. 460-516.
175
COUVE, Louis, « Institut de correspondance hellénique » dansBulletin de correspondance hellénique, volume 18, numéro 1, 1894, pp.161-174.
DAUX, Georges, « Chronologie delphique » dans Les Fouilles deDelphes, III, Paris, E. de Boccard, 1943 [131 p.].
DAUX, Georges, HANSEN, Erik et HELLMANN, Marie-Christine, Letrésor de Siphnos dans Les Fouilles de Delphes, II, E. De Boccard, Paris,1987 [2 vol., 253 p.].
DAUX, Georges et DEMANGEL, Robert, Les temples de tuf par R. Demangel.Les deux Trésors par G. Daux dans Les Fouilles de Delphes, II, Paris, E. deBoccard, 1923-1925 [112 p.].
EDER, Josef–Maria, Théorie et pratique du procédé au gélatino-bromured’argent, Paris, Gauthier-Villars, 1883 [267 p.].
FOUCART, Paul François, « Les grands mystères d’Éleusis » dansMémoires de l’Institut de France, tome 37, partie 1, 1904, [162 p.].
GIRARD, Jules, « Rapport de la Commission des Écoles françaisesd’Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux Écoles pendantles années 1894-1895, lu dans la séance du 28 février 1896 »dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,Volume 40, Numéro 1, Paris, Académie des Inscriptions etBelles-Lettres, 1896, pp. 86-100.
HOMOLLE, Théophile, Art primitif. Art archaïque du Péloponnèse et des îlesdans Les Fouilles de Delphes,IV, Paris, Fontemoing, 1909 [65 p.].
HOMOLLE, Théophile, « Dernières découvertes à Delphes » dansComptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume37, numéro 5, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1893, pp. 290-291.
HOMOLLE, Théophile, « Institut de correspondancehellénique » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 15,numéro 15, Paris, Fontemoing, 1891, pp. 431-440.
176
HOMOLLE, Théophile, « Institut de correspondance hellénique »dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 17, numéro 1, Paris,Fontemoing, 1893, pp. 181-187.
HOMOLLE, Théophile, « Institut de correspondance hellénique »dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 17, numéro 2, Paris,Fontemoing, 1893, pp. 611-623.
HOMOLLE, Théophile, « Le gymnase de Delphes » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 23, numéro 1, Paris, Fontemoing,1899, pp. 560-583.
HOMOLLE, Théophile, « Le trésor de Cnide, et les monuments del’art Ionien à Delphes » dans Royal Institute of British Architects Journal,1904, pp. 29-42.
HOMOLLE, Théophile, « Le temps delphique du IVe siècle » dansBulletin de correspondance hellénique, volume 20, 1896, pp. 677-701.
HOMOLLE, Théophile, « Les fouilles de Delphes » dans Comptesrendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 38,numéro 6, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,1894, pp. 580 – 592.
HOMOLLE, Théophile, « Lettre relative à la statue de bronzedécouverte à Delphes » dans Comptes rendus des séances de l’Académie desInscriptions et Belles-Lettres, volume 40, numéro 3, Paris, Académie desInscriptions et Belles-Lettres, 1896, pp. 186 – 188.
HOMOLLE, Théophile, « Monuments figurés de Delphes. Les frontons du temple d’Apollon » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 25, numéro 1, Paris, Fontemoing, 1901, pp. 457-515.
HOMOLLE, Théophile, « Rapport au Ministre de l’Instructionpublique, des Beaux-Arts et des cultes, au sujet des fouillesde Delphes » dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions etBelles-Lettres, volume 38, numéro 3, Paris, Académie desInscriptions et Belles-Lettres, 1894, pp. 202 – 210.
177
HOMOLLE, Théophile, « Règlements de la phratrie des Labyadai(en grec) » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 19,numéro 1, Paris, Fontemoing, 1895, pp. 5 – 69.
HOMOLLE, Théophile, « Statue de bronze découverte à Delphes,séance du 5 juin 1896, appendice » dans Comptes rendus des séancesde l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 40, numéro 4, Paris,Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1896, pp. 362 –384.
HOMOLLE, Théophile, « Topographie de Delphes » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 21, 1897, pp. 256-420.
JANNORAY, Jean, Le Gymnase de Delphes : étude architecturale dans LesFouilles de Delphes, Paris, E. de Boccard, 1953 [95 p.].
JARDÉ, Auguste, « Fouilles de Délos, exécutées aux frais de M.le Duc de Loubat (1903) » dans Bulletin de correspondance hellénique,volume 29, numéro 1, Paris, E. de Boccard, 1905, pp. 5-54.
KLARY, Charles, L’art de retoucher les négatifs photographiques, Paris,Gauthier-Villars, 1891 [86 p.].
KRAUSS, Eugen, Le Photo-Revolver Krauss : Gebrauchsanleitung der Firma,Paris, Krauss, 1923 [11 p.].
LANTIER, Raymond, « Éloge funèbre de M. Gabriel Millet, membreordinaire » dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions etBelles-Lettres, volume 97, numéro 2, Paris, Académie desInscriptions et Belles-Lettres, 1953, pp. 164-169.
LENORMANT, Charles, « Archéologie » dans Revue archéologique, Ièrepartie, Paris, A. Leleux, 15 avril 1844, pp. 1-17.
LA COSTE-MESSELIÈRE, Pierre de, et PICARD, Charles, Art archaïque :Les Trésors « ioniques » dans Les Fouilles de Delphes, IV, Paris, E. DeBoccard, 1928 [196 p.].
MADDOX, Richard Leach, « An experiment with Gelatino Bromide »dans The British Journal of Photography, volume 18, Londres, J. TraillTaylor, 8 Septembre 1871, pp. 422-423.
178
MAGRON, Henri, La Normandie monumentale et pittoresque, édifices publics,églises, châteaux, manoirs, etc., Le Havre, Lemasle, 1893-1899 [112 p.].
MARTELLIÈRE, Paul, « De la Photographie comme complément desétudes photographiques » dans Bulletin de la Société archéologique etlittéraire du Vendômois, Tome XVIII, Vendôme, Lemercier & Fils, 3èmetrimestre 1879, p. 215-223.
MILLET, Gabriel, « Les monastères et les églises deTrébizonde » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 19,1895, pp. 419-459.
ORSI, Paolo, « Sur une très antique statue de Mégara Hyblaea »dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 19, 1895, pp. 307-317.
PERDRIZET, Paul, « Sur la mitré homérique » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 21, numéro 1, Paris, Fontemoing,1897, pp. 169 – 183.
PERDRIZET, Paul, « Tridacna incisée trouvée à Delphes » dansBulletin de correspondance hellénique, volume 20, numéro 1, Paris,Fontemoing, 1896, pp. 604-605
PERROT, Georges, Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, d’une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, exécutée en 1861et publiée sous les auspices du ministère de l’Instruction publique, Firmin – Didot frères, Paris, 1862 [392 p.].
PERROT, Georges, « Notice sur la vie et les travaux de HenriWeil » dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1910, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 54, numéro 8, pp. 708-762.
PICARD, Charles, Art archaïque (suite) : Les Trésors « ioniques », IV, dansFouilles de Delphes, Paris, E. de Boccard, 1927 [196 p.].
POUILLOUX, Jean, La Région Nord du Sanctuaire : de l’époque archaïque à la findu sanctuaire dans Les Fouilles de Delphes, II, Paris, E. de Boccard, 1960[169 p.].
179
POMTOW, Hans, Beitrage zur topographie von Delfi, G. Reimer, Berlin, 1889 [128 p.].
RADEAU, Rodolphe, La photographie et ses applications scientifiques, Paris,Gauthier-Villars, 1878 [115 p.].
RADET, Georges, L’histoire et l’œuvre de l’École française d’Athènes, Paris,Fontemoing, 1901 [492 p.].
REINACH, Théodore, « La musique des hymnes de Delphes » dansBulletin de correspondance hellénique, volume 17, numéro 1, Paris,Fontemoing, 1893, pp. 584-610.
REINACH, Théodore, « La musique du nouvel hymne de Delphes (pl.XII, XIX – XXVII) » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume18, numéro 1, Paris, Fontemoing, 1894, pp. 363 – 389.
RENAN, Ernest, Mission de Phénicie, Paris, Impr. impériale, 1864-1874 [884 p.].
RHOMAÏDES, Constantine, Olympia : Hermès of Praxiteles, Athènes,Rhomaïdes frères, 1894 [33 p.].
RHOMAÏDES, frères, Catalogue général des antiquités et des principauxmonuments modernes de la Grèce, Athènes, Anestis Constantinidis,1892 [18 p.].
RIDDER, André de, Catalogue des bronzes trouvés sur l’Acropole d’Athènes,Paris, E. Thorin, 1896 [362 p.].
ROUX, Georges, La terrasse d’Attale I dans Les Fouilles de Delphes, II, E. deBoccard, Paris, 1987 [2 vol.].
SAGLIO, André, « Les fouilles de l’ancienne Delphes » dansL’Illustration, Paris, Dubochet, samedi 8 décembre 1894, pp. 480-481.
SALADIN, Henri, « Photographie » dans Recherche des antiquités dans leNord de l’Afrique. Conseils aux archéologues et aux voyageurs. Instructionsadressées par le Comité des travaux historiques et scientifiques aux correspondantsdu ministère de l’Instruction Publique, Paris, E. Leroux, 1890, pp. 10-15.
180
SENART, Émile, « Discours d’ouverture du Président, séancepublique annuelle » dans Comptes rendus des séances de l’Académie desInscriptions et Belles-Lettres, volume 37, numéro 6, Paris, Académie desInscriptions et Belles-Lettres, 1893, pp. 411-429.
SEYRIQ, Albert, « Nouvelles archéologiques » dans Syria, Paris,Geuthner, 1937, pp. 410-414.
SVORONOS, Ioannis, « Nomismatiki ton Delphon » dans Bulletin decorrespondance hellénique, volume 20, numéro 20,Paris, Fontemoing,1896, pp. 5-54.
TRUTAT, Eugène, La photographie appliquée à l’archéologie : reproduction desmonuments, œuvres d’art, mobilier, inscriptions, manuscrits, Paris, Gauthier-Villars, 1879 [139 p.].
TRUTAT, Eugène, La photographie appliquée à l’histoire naturelle, Paris,Gauthier-Villars, 1884 [225 p.].
VILLAIN, A., « Procédé de Photo-teinture » dans Paris-Photographe,Paris, Office général de Photographie, Num. 7, 1892, p. 292.
WEIL, Henri, Études de littérature et de rythmique grecques : textes littérairessur papyrus et sur pierre, Paris, Hachette, 1902 [240 p.].
WEIL, Henri, « Nouveaux fragments d’hymnes accompagnés de notesde musique » dans Bulletin de correspondance hellénique, volume 17,numéro 17, 1893, pp. 569-583.
WEIL, Henri, « Textes poétiques découverts à Delphes parl’École française d’Athènes » dans Comptes rendus des séances del’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 38, Paris, Académie desInscriptions et Belles-Lettres, 1894, pp. 15-16.
Bibliographie
ALCOCK Susan E., Archaeologies of the Greek past, Cambridge, CambridgeUniversity Press, 2002 [222 p.].
181
CARTIER-BRESSON, Anne, Vocabulaire technique de la photographie, Paris,Éditions Marval, 2008 [495 p.].
COLLET, Philippe, « La photographie et l’archéologie : deschemins inverses » dans le Bulletin de correspondance hellénique,volume 120, numéro 1, Athènes, École française d’Athènes, 1996,pp. 325-344.
CHASSAING, Monique, « Le complexe industriel d’aluminium deGrèce » dans Méditerranée, volume 7, numéro 4, Aix-en-Provence,Université d’Aix-Marseille, 1966, pp. 295-311.
DUCLOS, France (sous la dir.), Les Voyageurs photographes et la Sociétéde Géographie, 1850 - 1910, Paris, Bibliothèque nationale de France,1998 [10 p.].
FOLLIOT, Philippe, RÉVEILLAC, Gérard et CHÉNÉ, Antoine, De laphotographie en archéologie, Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille, 1986 [300 f.].
FOLLIOT, Philippe, RÉVEILLAC, Gérard et CHÉNÉ, Antoine, Lapratique de la photographie en archéologie, Aix-en-Provence, Édisud, 1999[143 p.].
FRIZOT, Michel (sous la dir.), Nouvelle histoire de la photographie,Paris, Bordas, 1994 [775 p.].
GIAKOUMÍS Cháris, La Grèce : la croisière des savants, 1896-1912, Paris,Picard, 1998 [259 p.].
GIAKOUMÍS Cháris, L’Acropole d’Athènes : photographies 1839-1959, Paris,Picard, 2000 [275 p.].
GRAN-AYMERICH, Eve, Naissance de l’archéologie moderne, Paris, CNRS,1998 [533 p.].
GUNTHERT, André et POIVERT, Michel, « L’album du voyageur »dans L’art de la photographie : des origines à nos jours, Citadelles &Mazenod, 2007, [605 p.].
182
JACQUEMIN, Anne, « En feuilletant le Journal de la Grande Fouille »dans La Redécouverte de Delphes, pp. 149-179.
LACOSTE, Anne, La photographie et les sciences de l'Antiquité en Orient dans laseconde moitié du XIXe siècle d'après l'étude des fonds photographiques de laBibliothèque de l'Institut de France, thèse pour obtenir legrade de docteur de l'Université de Paris IV Sorbonne, 2008 [1034p.].
LAHUE, Kalton C., Glass, Brass, and Chrome : The American 35mm MiniatureCamera, University of Oklahoma Press, 2002, [346 p.].
LAVÉDRINE, Bertrand (sous la dir. de), « Les négatifs sursupport de verre » dans Reconnaître et conserver les photographiesanciennes, Paris, CTHS, 2009, pp. 243-263.
MARC Jean-Yves, L’invention de la photographie et la naissance de l’archéologiescientifique, Université de Strasbourg, 2013 [7 p.].
MEKOUAR, Mouna. – « Étudier ou rêver l’antique : FélixRavaisson-Mollien et la reproduction de la statuaireantique » dans Images Re-vues, Paris, INHA, n° 1, 2005.
NEWHALL, Beaumont, The History of Photography : from 1839 to the presentday, Londres, Secker & Warburg, 1972 [211 p.].
ORAMAS, Alexandre, Archéologies de la photographie, Paris, UniversitéParis-Sorbonne, 1987 [81 p.].
ORAMAS, Alexandre, Photography in the time of archaeology, Newark,University of Delaware, 1994 [23 p.].
PICARD, Olivier [dir.], La redécouverte de Delphes, École françaised’Athènes, Athènes, Eforeia arhaiotētōn Delfōn, Paris, deBoccard, 1992 [291 p.].
PELTRE, Christine, L’atelier du voyage : les peintres en Orient au XIXèmesiècle, Paris, Gallimard, 1995 [118 p.].
PELTRE, Christine, Le Voyage en Grèce : un atelier en Méditerranée, Paris,Citadelles & Mazenod, 2011 [247 p.].
183
RÉVEILLAC, Gérard, « Photographies de la Grande Fouille » dansLa Redécouverte de Delphes, pp. 180-193.
SCHNAPP, Alain, La conquête du passé, Paris, Éd. Carré, 1993 [511p.].
VALENTI, Catherine, « L’École française d’Athènes au cœur desrelations franco-helleniques » dans Revue d’histoire moderne etcontemporaine, numéro 50-4, Paris, Belin, 2003/4, pp. 92-107.
Catalogues d’expositions
GIAKOUMÍS, Cháris [dir.], La Grèce : voyage photographique et littéraire auXIXème siècle (Athènes, (…) ; Paris, Maison de la Recherche,28/03/2013-12/04/2013), Athènes, Bastas-Plessas, 1998 [222 p.].
HELLMANN, Marie-Christine [dir.], Paris-Rome-Athènes : le voyage enGrèce des architectes français aux XIXe et XXe siècles (Paris, École nationalesupérieure des beaux-arts, 12/05/1982-18/07/1982 ; Athènes,Pinacothèque nationale d’Athènes, Musée Alexandre Soutzos,15/10/1982-15/12/1982 ; Houston, Museum of Fine Arts,17/06/1983-04/09/1983), Paris, EBA, 1982 [436 p.].
HELLMANN, Marie-Christine [dir.], Un siècle d’archéologie française àDelphes : Delphes aux sources d’Apollon (Paris, Chapelle de la Sorbonne,01/1993-10/04/1993), Paris, CNRS, 1992 [39 p.]
LYONS, Claire [dir.], Antiquity and Photography (Malibu, GettyVilla, 28/01/2006-01/05/2006), Los Angeles, J. Paul Gettymuseum, 2005 [226p.].
184