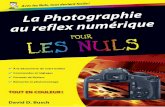Agota Kristof : langue et écriture dans le contexte de l’exil
Photographie, écriture et mémoire: Images d’enfance chez Benjamin et Proust
Transcript of Photographie, écriture et mémoire: Images d’enfance chez Benjamin et Proust
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust 63
Photographie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust
À la mémoire d’Uli Neus
Dans la longue et riche réception de Proust, Walter Benjamin joue un rôle précoce et important. Hormis ses traductions en allemand, avec l’écrivain et traducteur Franz Hessel, des trois premiers tomes d’À la recherche du temps perdu dans les années 1920, Benjamin a consacré plusieurs articles à l’œuvre de Proust dont le fameux « Pour l’image de Proust » 1. La problématique de Benjamin lecteur de Proust a souvent été étudiée depuis les années 1990, du double point de vue des critiques proustienne et benjaminienne 2. Or, s’il ne s’agit pas dans cet article d’une analyse des interprétations dites « savantes » de Proust, force est de constater que Benjamin met à profit la lecture de cet auteur pour ses propres projets, sa propre pensée, surtout quand il s’agit de la photographie 3. Ainsi notre but est-il de dégager quelques pistes d’interprétation des liens entre photographie, écriture et mémoire, et de montrer comment Benjamin a mis la mémoire proustienne au service de ses propres réflexions sur la photographie, dans le contexte non seulement de la théorie de la photographie mais également des récits autobiographiques.
Tout comme Benjamin, auteur très sensible aux détails, ma réflexion se fonde sur des détails particuliers et significatifs présents dans quelques-uns de ses travaux des années 1930 : « Petite histoire de la photographie » 4, Enfance berlinoise vers
1. Ce texte a récemment été retraduit. Voir Walter Benjamin, Sur Proust, trad. fr. Robert Kahn, Caen, Nous, 2010.2. Cinq ouvrages sont explicitement consacrés aux rapports intellectuels et théoriques entre Benjamin et Proust. Voir Ursula Link-Heer, Benjamin liest Proust, Cologne, Société allemande de Proust, 1997 ; Robert Kahn, Images, Passages : Marcel Proust et Walter Benjamin, Paris, Éditions Kimé, 1998 ; Henning Teschke, Proust und Benjamin. Unwillkürliche Erinnerung und dialektisches Bild, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2000 ; Johannes Bittel, Proust-Benjamin, Benjamin-Proust : Traum, Rausch, Erwachen, Francfort-sur-le-Main, Verlag Neue Wissenschaft, 2001 ; Dominik Finkelde, Benjamin liest Proust : Mimesislehre, Sprachtheorie, Poetologie, Munich, Fink, 2003.3. Cette perspective est également celle de Marco Piazza, sans qu’il s’intéresse à la photographie : « Proust et Benjamin. Le critique rédempteur et son phare », in Marcel Proust 8 : lecteurs de Proust au xxe siècle et au début du xxie, Joseph Brami (éd.), Caen, Lettres modernes Minard, 2010, p. 1-40.4. Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », trad. fr. André Gunthert, Études photographiques, no 1, 1996.
Kat
hrin
Yac
avon
e
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust64
1900 1, ainsi que « Sur quelques thèmes baudelairiens » 2 – à savoir certaines relations entre textes et images autour de photographies d’enfance, de lui-même, mais surtout d’une photographie de Franz Kafka enfant. Or c’est aussi grâce à Proust, ou, plus précisément, grâce au concept de la mémoire involontaire, que cette dernière est entrelacée dans un discours qui met en œuvre l’expérience unique et individuelle de cette photographie exceptionnelle d’un point de vue existentiel (et non esthétique) – discours qui s’oriente vers une « rédemption », au sens benjaminien de sauvegarde de ce qui est voué à disparaître ou qui a déjà disparu et qui, dans notre contexte, ne reste avec nous que sous la forme d’une image photographique.
Dans l’œuvre de Benjamin, la relation entre photographie et mémoire est étroitement liée non seulement à ses réflexions sur la modernité et l’histoire collective (à savoir ses ouvrages de la fin des années 1930, notamment par rapport à son projet inachevé du Livre des passages), mais aussi à sa biographie personnelle (dans des textes antérieurs). C’est dans le premier contexte qu’il théorise l’effet négatif et nuisible de la photographie pour la mémoire, alors que dans le deuxième il établit des réciprocités entre l’image photographique et la mémoire involontaire. La dialectique de la mémoire volontaire et involontaire qu’il emprunte à Proust va de pair avec une dialectique entre la photographie en général comme nouvelle technologie de reproduction et les images photographiques particulières (les portraits) comme objets d’un regard affectif. Il s’agira donc de suivre ce cheminement de la pensée de Benjamin de la photographie en général à la photographie en particulier. Je me propose de le faire à rebours de la chronologie génétique de ses ouvrages, et je commencerai donc avec quelques remarques sur un texte tardif intitulé « Sur quelques thèmes baudelairiens » (1938).
Entre Baudelaire et Proust : les effets nuisibles de la photographie sur la mémoire
Ce texte a été conçu par Benjamin comme le « modèle-miniature de l’ensemble » du Livre des passages 3, à savoir son grand projet sur les passages parisiens qui représente une histoire (inachevée et par conséquent fragmentaire) de la modernité à partir d’une analyse du xixe siècle. Dans la perspective large du texte sur Baudelaire (qui porte plus sur Proust que le titre ne l’indique), la photographie est exclusivement présentée comme un médium de masse et une technologie de reproduction, liée à de plus grands changements sociaux, culturels et technologiques à la suite de la révolution industrielle. Soulignons que ce point de vue ne tient pas compte des images individuelles et de leurs effets potentiels sur celui ou celle qui les regarde.
Selon une dialectique marxiste un peu bancale, voire inconséquente, Benjamin aborde l’impact nuisible de la photographie sur un certain genre d’expérience qu’il appelle Erfahrung – expérience profonde et riche qui disparaît avec l’avènement de la
1. Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900 (version dite de Giessen), trad. fr. Pierre Rusch, Paris, L’Herme, 2012.2. Walter Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens », Œuvres, trad. fr. Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, Paris, Gallimard, 2000, t. III, p. 329-390.3. Walter Benjamin, Correspondance 1929-1940, éd. Gershom Scholem et Theodor W. Adorno, trad. fr. Guy Petitdemange, Paris, Aubier Montaigne, 1979, t. II, p. 240. Cette remarque se trouve dans une lettre adressée à Max Horkheimer le 16 avril 1938.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust 65
modernité et qu’il oppose à une expérience plus superficielle qu’il appelle Erlebnis. Pour souligner cette dialectique entre la base matérielle (technologie comprise) et la superstructure qui en découle, Benjamin se sert d’une référence à la critique du « Salon de 1859 » de Baudelaire, – celui où pour la première fois la photographie, dont Baudelaire s’est beaucoup méfié, a été exposée à côté de la peinture. Comme Baudelaire, Benjamin présente la photographie comme un moyen technologique pour l’enregistrement des événements éphémères de la vie quotidienne, afin de les déposer dans les « archives de notre mémoire 1 ». D’après le poète, lorsque cet outil utilitaire empiète sur les domaines de l’art et de la beauté, tous deux sont mis en péril. En fait, Baudelaire attaque ici, implicitement du moins, l’industrie qui s’était développée à la suite de l’invention du portrait carte-de-visite par André Disdéri en 1854, laquelle représentait le premier moyen d’une production de masse des portraits photographiques. Selon Baudelaire, cette industrie émousse l’imagination créatrice, qu’il considère comme étant la « reine des facultés 2 ». Benjamin, quant à lui, souligne cette opposition baudelairienne entre la photographie et l’art, le banal et le factuel d’une part, l’esthétique et la créativité d’autre part, et y ajoute une référence à Proust, constatant que la mémoire documentaire dont Baudelaire parle et qui est associée à la photographie est d’ailleurs identique à la mémoire volontaire de Proust.
Malgré une contradiction avec Jean Santeuil où cette mémoire documentaire est liée à la mémoire involontaire 3, ce dont il ne semble pas se rendre compte ici, Benjamin pousse cette idée d’une affinité entre photographie et mémoire volontaire encore plus loin et suggère que la photographie a effectivement un effet nuisible sur la mémoire involontaire. Il évoque un passage de la Recherche où le narrateur compare la photographie avec de pauvres images mentales de Venise :
Lorsque Proust constate la pauvreté et le manque de profondeur des images de Venise que lui fournit la mémoire volontaire, il écrit que le mot de « Venise » lui avait suffi pour lui faire trouver ce trésor d’images aussi ennuyeux qu’une exposition de photographies 4.
Ici, la référence au roman de Proust offre à Benjamin un moyen de problématiser l’idée reçue que la photographie est douée d’un pouvoir de remémoration, et il présente ainsi la Recherche pour sa propre démonstration comme un roman anti-photographique. En fait, cette interprétation de l’œuvre proustienne comme opposée à la photographie est un trait caractéristique récurrent chez les interprètes de cette première génération en Allemagne, y compris Siegfried Kracauer qui se penche sur le roman proustien pour justifier l’argument de son caractère aliénant en se référant avant tout à l’épisode où le héros, de retour de Doncières, surprend sa grand-mère à Paris, et compare son observation détachée à celle d’un photographe 5.
1. Charles Baudelaire, « Salon de 1859 », Œuvres complètes, éd. Yves-Gérard Le Dantec, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1954, p. 771.2. Ibid., p. 772-776.3. Voir JS, p. 897-898.4. Walter Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens », op. cit., p. 381. Le passage chez Proust est le suivant : « J’essayais maintenant de tirer de ma mémoire d’autres “instantanés”, notamment des instantanés qu’elle avait pris à Venise, mais rien que ce mot me la rendait ennuyeuse comme une exposition de photographies, et je ne me sentais pas plus de goût, plus de talent, pour décrire maintenant ce que j’avais vu autrefois, qu’hier ce que j’observais d’un œil minutieux et morne, au moment même » (TR, IV, p. 444).5. Voir CG, II, p. 438-440. Siegfried Kracauer, Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle,
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust66
Benjamin enfonce le clou quant à l’analogie entre photographie et mémoire volontaire, revenant sur cette comparaison de Proust entre les images mentales pauvres et la mémoire volontaire, et la met en parallèle avec sa notion historique d’une déchéance de l’aura. Il constate que :
Si l’on admet que les images surgies de la mémoire involontaire se distinguent des autres parce qu’elles possèdent une aura, il est clair que, dans le phénomène du « déclin de l’aura », la photographie aura joué un rôle décisif 1.
Même si cette thèse d’une réciprocité historique entre l’effacement de l’aura et l’émergence des technologies industrielles modernes n’est pas nouvelle – elle se trouve par exemple aussi dans le texte fameux sur « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » – ce qui frappe, c’est la mesure dans laquelle la photographie elle-même est en opposition directe avec l’aura. Benjamin, en fait, renverse l’éloge (antérieur) qu’il avait fait des merveilleux résultats de la techno-logie photographique dans « Petite histoire de la photographie » (un texte de 1931 sur lequel je vais revenir), et avance, au contraire, que la photographie possède un effet mortel sur le modèle. Je cite intégralement le passage qui donne également une idée de ce qu’il entend par aura :
Ce qui devait paraître inhumain, on pourrait même dire mortel, dans la daguerréotypie, c’est le fait que l’on regardait (longuement d’ailleurs) un appareil qui recevait l’image de l’homme sans lui rendre son regard. Or, le regard est habité par l’attente d’une réponse de celui auquel il s’offre. Que cette attente reçoive une réponse [...], l’expérience [Erfahrung] de l’aura connaît alors sa plénitude. [...] L’expérience de l’aura repose donc sur le transfert, au niveau des rapports entre l’inanimé – ou la nature – et l’homme, d’une forme de réaction courante dans la société humaine. Dès qu’on est – ou se croit – regardé, on lève les yeux. Sentir l’aura d’un phénomène, c’est lui conférer le pouvoir de lever les yeux 2.
Ce passage fait écho à une description de l’aura comme phénomène de perception que Benjamin a proposée dans « Petite histoire de la photographie » par rapport à certaines images photographiques (toutes des portraits), dont celles du photo-graphe écossais David Octavius Hill et son œuvre des années 1840 : à partir de l’une de ces images, celle d’une marchande de poisson (reproduite en marge de son texte), Benjamin parle de la nature indicielle des images photographiques en général, c’est-à-dire du fait que l’image entretient une relation de contact physique avec ce qui est représenté (le référent) ; et il aborde en des termes presque phénoménologiques l’effet affectif qui est suscité par le référent de la photo, à savoir une exigence du portrait qui suscite une réaction éthique de la part de l’observateur (je reviendrai à cette idée). Or ce que Benjamin théorise ici d’une manière abstraite est mis en œuvre dans ses descriptions de sa rencontre avec un portrait de Kafka, comme nous allons le voir. Quant à l’aura, je précise que dans ce texte sur l’histoire de la photographie elle n’est pas l’une des caractéristiques d’un objet – comme le suggère le texte sur la reproductibilité de l’œuvre d’art où la peinture, par exemple, perd son aura dans la reproduction photographique – mais plutôt un phénomène de perception, une dynamique entre cet objet et le spectateur. Cette dynamique, dialectique et marxiste aux yeux de Benjamin, est
trad. fr. Daniel Blanchard et Claude Orsoni, Paris, Flammarion, 2010, p. 42-47.1. Walter Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens », op. cit., p. 381.2. Ibid., p. 381-382.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust 67
surtout liée aux photographies du xixe siècle et elle se raréfie au fur et à mesure du processus de la modernité, y compris avec le développement de la technologie photographique.
Pourtant, selon le passage cité du texte « Sur quelques thèmes baudelairiens », Benjamin souligne qu’une telle dynamique réciproque des regards est diamétralement opposée à l’enregistrement de l’image qu’il définit comme étant véritablement nuisible, voire « mortel », pour le modèle. De plus, Benjamin affirme que Proust serait sans aucun doute d’accord avec lui. Cet accord, soutient-il, concerne la relation entre l’aura et le regard dans le sens d’un acte réciproque qui est transféré d’une réaction instinctive parmi les êtres humains à l’œuvre d’art ou à un objet inanimé. Benjamin cite ici un bref passage du dernier tome, Le Temps retrouvé. Je cite Proust, alors que Benjamin le cite dans sa propre traduction allemande où il remplace astucieusement « les yeux » par « le regard » : « Certains esprits qui aiment le mystère veulent croire que les objets conservent quelque chose des yeux qui les regardèrent 1. » Et Benjamin de remarquer : « il s’agit, de toute évidence, du pouvoir de répondre à leur regard 2. » Ce que Benjamin emprunte à Proust pour avancer sa propre réflexion est donc l’idée d’une relation dialogique entre un objet qui a été regardé et qui conserve quelque chose de ce regard, et le retour de ce regard vers celui ou celle qui regarde l’objet à son tour. Le verbe « regarder » exprime bien cette réciprocité 3.
En somme, selon « Sur quelques thèmes baudelairiens », la photographie est conçue comme une technologie qui a un impact négatif sur la nature même de l’expérience humaine. Mais ce point de vue ne tient évidemment pas compte du fait que des images photographiques peuvent bien sûr être perçues d’une manière qui transcende ou même s’oppose à ces effets historiques et, que, de surcroît, elles peuvent avoir un potentiel créateur « proustien », comme les textes antérieurs de Benjamin le montrent.
Une photographie singulièreDans « Petite histoire de la photographie », Benjamin retrace l’évolution de la
photographie d’un artisanat spécialisé pendant les années 1840-1850 à un médium de masse industrialisé, entraîné par la commercialisation du portrait carte-de-visite, ce qui résulte vers la fin du siècle en un déclin de l’aura de la photographie en termes d’une réciprocité des regards. Pourtant, en termes phénoménologiques et psychologiques, c’est-à-dire du point de vue de la description de l’expérience concrète provoquée par une image photographique, ainsi que de la dimension existentielle due à la rencontre avec la présence en effigie d’un être humain, une photographie de Kafka enfant (fig. 1) est au cœur de l’œuvre de Benjamin sur la photographie et échappe à ces dynamiques historiques. Mais la signification de ce portrait ne se dégage que par sa récurrence dans d’autres textes, ce qui apporte non seulement un nouvel éclairage sur la première description de cette image dans
1. TR, IV, p. 463.2. Walter Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens », op. cit., p. 383 (traduction revue).3. Voir à ce sujet le titre d’un livre de Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, 1992, où il fait référence à l’aura de Benjamin (p. 103).
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust68
son essai sur la photographie (1931), mais établit également un réseau complexe de relations entre texte et image, et entre la théorie de la photographie et l’écriture autobiographique. L’importance émotionnelle du portrait de Kafka pour Benjamin devient ainsi encore plus claire dans son récit quasi autobiographique Enfance berlinoise vers 1900, rédigé entre 1931 et 1938 – texte explicitement proustien – où cette photographie de Kafka vient illustrer un investissement affectif, imaginaire et existentiel lié à la rencontre singulière entre le spectateur et l’être qui est représenté.
Demandons-nous d’abord pourquoi, dans « Petite histoire de la photographie », le portrait de Kafka, qui date de 1888 ou 1889, représente une exception dans le genre cliché de la photographie de la fin du siècle, période où la photographie de famille a été à la mode, un genre marqué par un décor artificiel et des poses stéréotypées ; genre auquel néanmoins elle appartient. Contrairement à d’autres images reproduites dans l’ouvrage, la photographie de Kafka est significativement absente, et cela en dépit du fait qu’elle appartenait à Benjamin et qu’il a lui-même choisi les illustrations pour son essai 1. Au-delà des raisons pratiques pour lesquelles il n’a peut-être pas pu l’inclure (raisons que nous ne connaîtrons fort probablement
1. Voir à ce sujet les commentaires éditoriaux des œuvres allemandes, Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, 7 tomes, éd. Rolf Tiedemann et Hermann Schweppenhäuser, avec la collaboration de Theodor W. Adorno et Gershom Scholem, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1972-1989, t. II, p. 1141.
Franz Kafka enfant, 1888-1889. Collection Walter Benjamin Archiv, Akademie der Künste, Berlin.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust 69
jamais), l’absence de cette image clé dans l’échantillon des images reproduites est frappante, et évoque d’ailleurs, par anticipation, l’absence du portrait de la mère de Roland Barthes dans La Chambre claire. Chez Benjamin, son absence peut donc refléter soit une stratégie très volontaire de la part du philosophe, soit une impulsion moins consciente, mais non moins révélatrice. Peu importe : au lieu de l’image, Benjamin nous fournit une description détaillée du portrait, mettant en évidence le contraste éclatant, selon lui, entre le décor et le modèle :
C’est à cette époque que sont apparus ces ateliers avec leurs draperies et leurs palmiers, leurs tapisseries et leurs chevalets, à mi-chemin de la représentation et de l’exécution, de la salle du trône et de la chambre de torture, dont un portrait du jeune Kafka fournit un témoignage poignant. Debout dans un costume d’enfant trop étroit et presque humiliant, chargé de passe-menteries, le garçonnet, âgé d’environ six ans, est placé dans un décor de jardin d’hiver. Des rameaux de palmier se dressent à l’arrière-plan. Et comme pour rendre ces tropiques capitonnés encore plus étouffants, le modèle tient dans sa main gauche un chapeau démesuré à larges bords, comme en portent les Espagnols. Sans doute disparaîtrait-il dans cet arrangement, si les yeux d’une insondable tristesse ne dominaient ce paysage fait pour eux 1.
Hormis l’exactitude de la description historique de l’essor et de l’esthétique du portrait carte-de-visite, le traitement en profondeur d’une image absente de son texte – une telle attention minutieuse n’est accordée à aucune autre photographie après 1880 – suggère fortement que, pour Benjamin, elle représentait plus qu’un simple document historique de goût bourgeois.
De fait, bien que la pose artificielle et formelle de Kafka enfant échappe à l’expression d’une identité individuelle, apparaissant plutôt comme la représentation d’une aspiration sociale à la classe bourgeoise 2, de façon plus significative, Benjamin souligne la mélancolie du portrait et la vulnérabilité du garçon dans ce décor aliénant. Cette impression est encore accentuée par le costume humiliant de Kafka, qui nous rappelle les costumes que Benjamin et son frère ont dû porter pour la prise d’une photographie dont le style et la pose ne sont pas très éloignés (fig. 2) 3. Tandis que la photographie de Kafka enfant au jardin d’hiver est un exemple de ces photographies de famille que Benjamin décrit comme la preuve d’un « déclin du goût 4 » qu’il date des années 1860-1880, le portrait de Kafka dérange cette chronologie en vertu d’un détail, à savoir « les yeux d’une insondable tristesse ». En effet, à cause de ce détail important pour Benjamin, cette image se dérobe à toute classification historique mise en place dans ce même essai.
Ainsi, la signification et la valeur mémorative du portrait de Kafka pour Benjamin ne sont pas en premier lieu ancrées dans les caractéristiques formelles ou esthétiques de cette image. Plutôt, l’importance du portrait est fonction du spectateur individuel (Benjamin) par rapport au contenu représenté dans la photographie. La façon dont le modèle (Kafka enfant) et ses yeux « regardent » Benjamin est d’une intensité si
1. Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », op. cit., p. 17-18.2. Voir, au sujet de la pose dans la photographie de la fin du xixe siècle comme expression d’une classe sociale, Bernd Busch, Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der Fotografie, Munich et Vienne, Carl Hanser, 1989, p. 311.3. Ce double portrait est l’image la plus souvent représentée dans le contexte d’une interprétation de ce texte. Or il y a d’autres portraits qu’il conviendrait de citer ici ; voir ma discussion dans Benjamin, Barthes and the Singularity of Photography, New York et Londres, Continuum, 2012, p. 62-66.4. Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », op. cit., p. 17.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust70
forte et si singulière qu’elle est à même de pouvoir déclencher un potentiel créateur chez ce dernier, qui en vient dès lors à entrelacer la photographie à la mémoire et à l’écriture d’une façon à la fois proustienne et rédemptrice.
Les portraits d’enfance et leur potentiel créateurPeu de temps après la rédaction de « Petite histoire de la photographie », Benjamin
commence à travailler à un récit autobiographique situé à Berlin à la fin du siècle. Intitulé Enfance berlinoise vers 1900, ce texte n’a été publié qu’à titre posthume. Ni la première esquisse, Chronique berlinoise (sur laquelle Benjamin a travaillé à partir de 1931), ni la dernière version (1938) ne comprennent de référence directe au portrait de Kafka. Seule la version de 1932 (traduite en français en 2012), version dite de Giessen, contient un passage clé à cet égard.
Walter et Georg Benjamin, Schreiberhau, 1902. Reproduit avec la permission de Gerhard Oberschlick ;
collection Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek Wien,
Nachlass Günther Anders (ÖLA 237/04).
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust 71
Dans un chapitre de cette dernière version, Benjamin se rappelle avoir été photographié à l’âge d’environ six ans et la description de ce souvenir se confond avec la description du portrait de Kafka enfant. Cette superposition de la description du portrait dans « Petite histoire de la photographie », que je viens de citer, et de celle du souvenir a été souvent reconnue 1. Pourtant, la différence entre ces deux passages qui relèvent de l’ekphrasis tient au fait que Benjamin ne décrit pas la photographie de Kafka comme un portrait de l’autre, mais comme un autoportrait, en échangeant les pronoms personnels : il remplace le « il » (désignant Kafka) par le « je » (Benjamin), en une sorte de métamorphose de l’enfant. Je cite le passage entier pour souligner la ressemblance frappante avec la description déjà citée :
Où que se portassent mes regards, je me voyais entouré d’écrans, de coussins, de socles qui réclamaient mon image comme les ombres de l’Hadès le sang de l’animal sacrifié. À la fin, on me livrait à une vue grossièrement barbouillée des Alpes, et ma main droite, qui devait lever un petit chapeau à aigrette, jetait son ombre sur les nuages et les névés de la toile tendue. Mais le sourire torturé sur les lèvres du petit montagnard n’est pas si désolant que le regard que plonge en moi le visage de l’enfant à l’ombre du palmier d’appartement. Celui-ci provient d’un de ces ateliers qui, avec leurs tabourets et leurs guéridons, leurs tapisseries et leurs chevalets, tiennent à la fois du boudoir et de la chambre de tortures. Je suis debout, nu-tête ; dans la main gauche un formidable sombrero que je laisse pendre avec une grâce étudiée. La main droite tient une canne dont le pommeau baissé apparaît au premier plan, tandis que la pointe disparaît dans une gerbe de plumes, qui s’épandent d’une table de jardin 2.
Le portrait de Kafka est ici de plus en plus présenté par Benjamin comme une image de lui-même. À certains égards, cette description correspond aux deux photographies représentées ici (fig. 1 et 2), mais elle ne coïncide jamais parfaitement avec une seule d’entre elles. Ni le portrait réel de Kafka enfant, ni les différents portraits de Benjamin enfant ne sont inclus dans le texte, ce qui permet un jeu imaginaire par rapport aux photographies réelles. Si on compare ces photographies avec les descriptions ekphrastiques de Benjamin, il est clair que dans ses textes autobiographiques les images sont enrichies par l’imagination et la mémoire. La photographie n’est pas ici simplement perçue comme une image déjà remplie du « réel ». Au contraire, sa réalité est actualisée et animée par le spectateur, ne servant que de point de départ pour un vol de l’imagination créatrice, qui résulte en une superposition – ce qui a, paradoxalement peut-être, son point de départ dans le portrait photographique qui témoigne d’une manière indicielle et incontournable d’une réalité passée. De fait, l’ekphrasis de Benjamin dans Enfance berlinoise est comme une plaque du souvenir qui a été exposée à plusieurs images en tant que vues et rappelées, justement comme la surimpression d’une plaque photographique ou d’un négatif, ce qui a pour résultat une image composite 3. Dans le cas du portrait de Kafka, l’enjeu est celui d’une rencontre imaginaire avec l’écrivain juif envers lequel Benjamin ressentait une affinité culturelle et intellectuelle. Ainsi, la surimpression de sa propre image à celle de Kafka enfant témoigne d’une dyna-mique d’affect et de projection, ou bien d’identification 4, qui permet à Benjamin
1. Anna Stüssi a été la première à y prêter attention : Erinnerung an die Zukunft. Walter Benjamins ‘Berliner Kindheit um Neunzehnhundert’, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, p. 189-192.2. Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900, op. cit., p. 29.3. Benjamin quant à lui établit cette analogie entre mémoire et développement photographique dans la première esquisse de son Enfance berlinoise. Voir Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, op. cit., t. VI, p. 516.4. Voir, au sujet de l’identification de Benjamin à Kafka, André Gunthert, « Le temps retrouvé. Walter
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust72
de retourner d’une manière imaginaire à sa propre enfance, laquelle, à son tour, est la source de son récit autobiographique.
Or ce jeu créateur à partir d’images d’enfance est à mettre en parallèle avec Proust et ses références aux portraits photographiques, notamment la transformation d’un portrait du petit frère (dans le Contre Sainte-Beuve) en une image du narrateur lui-même (dans Du côté de chez Swann) 1. Le premier épisode, « Robert et le chevreau », publié dans l’édition de Bernard de Fallois, est moins l’ekphrasis d’une photographie qu’une description du modèle – le petit frère à l’âge de « cinq ans et demi 2 » – qui vient de se faire photographier :
Elle [la mère] devait partir, je l’ai dit, avec mon petit frère, et comme il quittait la maison mon oncle l’avait emmené pour le faire photographier à Évreux. On lui avait frisé ses cheveux comme aux enfants de concierge quand on les photographie, sa grosse figure était entourée d’un casque de cheveux noirs bouffants avec des grands nœuds plantés comme les papillons d’une infante de Velasquez ; je l’avais regardé avec le sourire d’un enfant plus âgé pour un frère qu’il aime, sourire où l’on ne sait pas trop s’il y a plus d’admiration, de supériorité ironique ou de tendresse. Maman et moi nous partîmes le chercher pour que je lui dise adieu, mais impossible de le trouver. Il avait appris qu’il ne pourrait pas emmener le chevreau qu’on lui avait donné, et qui était, avec le tombereau magnifique qu’il traînait toujours avec lui, toute sa tendresse, et qu’il « prêtait » quelquefois à mon père, par bonté. [...] assis par terre contre son chevreau et lui caressant tendrement la tête avec la main, l’embrassant sur son nez pur et un peu rouge de bellâtre couperosé, insignifiant et cornu, ce groupe ne rappelait que bien peu celui que les peintres anglais ont souvent reproduit d’un enfant caressant un animal 3.
Même s’il existe une photographie d’enfance de Robert et Marcel Proust qui s’impose par association (fig. 3), force est de constater que malgré quelques détails comme la coiffure un peu apprêtée de Robert et « la petite robe des grands jours et sa jupe de dentelle 4 », qui rapprochent la photographie réelle de la narration imaginaire, les relations entre texte et image sont beaucoup plus floues et incertaines que celles que je viens de dégager chez Benjamin. De surcroît, chez Proust, la référence à la photographie au début de cet épisode est suivie par un tableau sentimental : le petit frère caressant son chevreau qui est calqué, selon la description proustienne, sur les « enfants anglais près de l’animal 5 ». Grâce à Philip Kolb nous savons que ce passage du Contre Sainte-Beuve est à mettre en relation avec une lettre de Proust à Auguste Marguillier (datée d’avant le 8 janvier 1908), où l’écrivain demande au rédacteur de la Gazette des Beaux-Arts de lui envoyer « quelques-unes de vos gravures anglaises 6 ». Pyra Wise a plus récemment identifié (à partir d’une facture de chez Hopilliart & Leroy) quelles gravures auraient pu servir d’inspiration pour
Benjamin et la photographie », in Marie-D. Garnier (dir.), Jardins d’hiver. Littérature et photographie, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1997, p. 53.1. Je tiens à remercier Nathalie Mauriac Dyer qui a attiré mon attention sur ce parallèle ainsi que sur les articles de Bernard Brun, Philip Kolb et Pyra Wise par rapport à la problématique des gravures anglaises chez Proust lors d’une discussion à la suite de mon exposé au séminaire Proust à l’ITEM/ENS (11 février 2013).2. Contre Sainte-Beuve, éd. Bernard de Fallois, Paris, Gallimard, 1954, p. 288.3. Ibid., p. 286-287.4. Ibid., p. 287.5. Id.6. Corr., VIII, p. 25. Voir également la note 10 de Philip Kolb, p. 26-27 ; et Bernard Brun, « Le mystère des gravures anglaises et la naissance de l’équipe Proust », BIP, no 34, 2004, p. 50.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust 73
« Robert et le chevreau », dont deux d’Edwin Henry Landseer 1. Elle avance, d’une façon très convaincante, que l’abandon des références aux gravures anglaises dans la Recherche serait dû à la « mièvrerie » qui imprègne les gravures en question 2. Effectivement, si Proust abandonne les références aux gravures anglaises dans l’épisode de « L’adieu aux aubépines », ce qui revient, en revanche, est la référence à la photographie. Voici l’épisode du premier tome de la Recherche :
Cette année-là, quand, un peu plus tôt que d’habitude, mes parents eurent fixé le jour de rentrer à Paris, le matin du départ, comme on m’avait fait friser pour être photographié, coiffer avec précaution un chapeau que je n’avais encore jamais mis et revêtir une douillette de velours, après m’avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit raidillon contigu à Tansonville, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branches piquantes, et, comme une princesse de tragédie à qui pèseraient ces vains ornements, ingrat envers l’importune main qui en formant tous ces nœuds avait pris soin sur mon front d’assembler mes cheveux, foulant aux pieds mes papillotes arrachées et mon chapeau neuf 3.
Le frère bien coiffé du passage du Contre Sainte-Beuve a été remplacé par le narrateur, en une transformation d’un enfant en un autre, comme plus tard chez Benjamin. De plus, chez Proust comme chez Benjamin, la métamorphose est
1. Il s’agit de la gravure intitulée The Pets et de Sutherland Children. Voir Pyra Wise, « Un nouveau mystère des gravures anglaises : Marcel Proust chez Hopilliart », BIP, no 38, 2008, p. 20-21. 2. Ibid., p. 21.3. CS, I, p. 143.
Robert et Marcel Proust, 1877. Tous droits réservés.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust74
étroitement liée à la photographie, aboutissant à une dynamique entre textes et images. Si l’on sait que Benjamin connaissait bien ce passage de la Recherche (où le chapeau dans la photographie du narrateur fait écho à celui sur lequel Benjamin attire l’attention dans ses descriptions d’images d’enfance – celle de Kafka et la sienne), il n’a pas pu connaître la transformation de la photographie des esquisses du Contre Sainte-Beuve dans le passage ci-dessus. Cela n’empêche cependant pas de mettre en relation intertextuelle les similarités ainsi que les différences dans l’usage de la photographie chez Benjamin et chez Proust. Chez l’un comme chez l’autre, il s’agit de la transformation créatrice d’une scène représentée qui se veut idyllique (l’enfant dans la nature et parmi les animaux dans le cas des gravures anglaises d’une part, et l’enfant dans l’intérieur bourgeois de l’autre) en une scène d’aliénation et de tristesse. Et, dans les deux cas, il est fort probable que les auteurs se réfèrent également à leurs propres souvenirs de séances chez le photographe, dont témoignent les photographies d’enfance réelles de Benjamin et de Proust.
Malgré ces parallèles, il est pertinent de souligner une différence importante quant à la fonction des images d’enfance chez Benjamin et Proust. Cette différence est de degré mais également de nature quant à la transformation en question, à savoir que chez Proust, il s’agit d’une fabulation narrative où la photographie est déjà un objet imaginaire et qui est, dans notre contexte, liée aux antécédents visuels de la photographie (dans le sens historique ainsi que génétique) : les gravures anglaises. En revanche, chez Benjamin, il s’agit de la transformation d’une photographie réelle en photographie imaginaire. Cette différence ontologique a des implications cruciales pour la notion de rédemption : l’usage de la photographie de Kafka chez Benjamin montre que dans des cas bien particuliers et exceptionnels, la photographie devient transparente sous le regard du spectateur et lui permet ainsi une rencontre existentielle avec l’autre, rencontre qui consiste pour Benjamin à devenir l’alter ego de Kafka enfant. Or, chez Benjamin, c’est la mémoire proustienne qui sert de référence importante pour y ajouter le pouvoir rédempteur qui fait sortir cette image privilégiée de l’oubli et de « l’écrasement du Temps 1 », comme le dit Barthes. Et il s’agit là de suivre ce dernier rebondissement de la réception benjaminienne de Proust par rapport à la photographie.
Mémoire involontaire et rédemptionOn a vu comment, dans l’œuvre tardive de Benjamin, la photographie comme
technologie de reproduction est opposée à la mémoire involontaire (que la photographie semble même menacer), et comment, dans ces textes antérieurs, le philosophe protège la photographie de Kafka enfant de ces dynamiques historiques en l’entrelaçant dans un discours marqué par un investissement plus personnel. Pour éclaircir cette dialectique, il est maintenant nécessaire de montrer comment cette image singulière est associée à la mémoire involontaire et en particulier à son pouvoir rédempteur.
Cela nous incite à revenir à Enfance berlinoise par une parenthèse importante, à savoir un texte fragmentaire où Benjamin met en évidence la parenté entre des
1. Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, PAris, Cahiers du cinéma/Gallimard/Le Seuil, 1980, p. 150.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust 75
images photographiques particulières et la mémoire involontaire. Il s’agit d’un court texte (traduit en français en 2010) qui nous permet de relier ses réflexions sur des images photographiques et des souvenirs d’enfance avec la mémoire involontaire. Il a été rédigé dans le contexte des « Notes manuscrites sur Proust » qui sont des corrections possibles au texte très connu « Pour l’image de Proust ». Un passage des ses manuscrits, intitulé « D’un petit discours sur Proust, prononcé lors de mon quarantième anniversaire » et qui date de la même année que la deuxième version d’Enfance berlinoise de 1932, suggère alors une analogie significative entre les images photographiques et la mémoire involontaire. Pour souligner ce que Benjamin considère comme le caractère paradoxal de la mémoire involontaire, il fait l’hypothèse que ses images « n’apparaissent pas seulement de manière inopinée, [qu’]il s’agit plutôt avec elles d’images que nous n’avions jamais vues, avant de nous en souvenir 1 ». Or ce paradoxe s’applique également à l’image photographique, et Benjamin continue ainsi :
C’est ce qui ressort le plus nettement de ces images sur lesquelles – tout comme dans certains rêves – nous figurons nous-mêmes. Nous voilà devant nous-mêmes, comme nous l’avons certainement été dans le passé le plus lointain, mais jamais sous notre propre regard. Et ce sont justement les images les plus importantes – celles qui ont été développées dans la chambre noire de l’instant vécu – qui s’offrent à notre regard. On pourrait dire que nos moments les plus intenses sont accompagnés d’une prime, comme ces paquets de cigarettes, une petite image, une photo de notre moi. Et cette « vie entière » qui, comme on l’entend souvent, défile devant les mourants ou ceux qui se trouvent en danger de mort, se compose justement de ces petites images 2.
D’après ce passage, les images remémorées de soi-même, qu’on n’a d’ailleurs jamais vues auparavant, sont analogues aux autoportraits photographiques (une « photo de notre moi »). Contrairement au portrait peint, un portrait photographique témoigne d’une manière incontestable d’une présence passée, du fait qu’il ou elle a été là, devant l’objectif du photographe, et pas seulement dans l’imagination du peintre. Grâce à la préservation latente d’une trace de lumière, le portrait photographique fournit à Benjamin une analogie pertinente pour le paradoxe de la mémoire involontaire – image d’un moment passé jusqu’alors inconscient ou oublié qui nous renvoie à notre propre regard dans ce moment passé – image d’un moment de notre vie dont nous n’avons pas de conscience directe 3. Plutôt que de voir cette dynamique comme un simple oubli, la suggestion que les images les plus importantes sont développées « dans la chambre noire de l’instant vécu » indique une certaine période de latence au cours de laquelle le moment vécu est déposé pour un développement potentiel ultérieur.
Or la question suivante s’impose : comment le portrait de Kafka est-il lié à ce paradoxe ? Pour y répondre, il convient de revenir à la version de 1932 d’Enfance berlinoise, puisque le passage cité nous permet de concevoir le portrait de Kafka enfant sous un nouvel angle. Ce lien met davantage en évidence la façon dont le dispositif proustien contribue à un discours rédempteur, ce qui, à son tour, met au
1. Walter Benjamin, « D’un petit discours sur Proust, prononcé lors de mon quarantième anniversaire », Sur Proust, op. cit., p. 105.2. Ibid., p. 105-106.3. D’un point de vue plus général, Benjamin n’était bien sûr pas le premier à remarquer cette analogie entre mémoire et photographie. De fait, dès l’émergence du daguerréotype, photographie unique sur plaque argentée, on parlait d’un miroir de la mémoire. Il y également, chez Sigmund Freud, de nombreuses analogies similaires. Voir à ce sujet Sarah Kofman, Camera obscura. De l’idéologie, Paris, Galilée, 1973.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust76
premier plan les considérations éthiques implicites dans les passages de Benjamin sur la photographie de Kafka.
L’idée benjaminienne, à la fin de « Petit discours sur Proust », que les moments les plus profonds de notre vie sont rappelés sous une forme semblable aux images photographiques de soi-même est citée – quoique légèrement reformulée – dans le dernier chapitre de la version d’Enfance berlinoise où se trouve également l’ekphrasis du portrait de Kafka que, je le rappelle, Benjamin présente comme un portrait d’un autre moi. Ainsi, nous lisons dans le dernier chapitre : « Je pense que cette “vie entière” dont on dit qu’elle défile devant les yeux des mourants se compose de ces images 1. » Bien que Benjamin continue ici à évoquer la photographie de manière implicite, comme des images qui anticipent la cinématographie, la genèse du texte montre la proximité entre la version de 1932 de son récit autobiographique et le discours fragmentaire sur Proust, car dans les versions allemandes, les deux passages sont presque identiques. Par conséquent, même si la relation entre les photographies et la mémoire involontaire n’est généralement qu’une analogie métaphorique, le contexte autobiographique nous rappelle la relation réelle entre le portrait de Kafka comme alter ego de Benjamin et la mémoire involontaire, et son pouvoir rédempteur.
À cet égard, l’évocation récurrente de la photographie de Kafka dans l’œuvre de Benjamin, comme je viens de le montrer, comporte une latence dont ressort enfin la pleine signifiance : en dépit de la place exceptionnelle qu’elle occupait déjà dans « Petite histoire de la photographie » en 1931, ce n’est que dans le miroir de ses propres souvenirs d’enfance, écrits peu de temps après, que l’image de Kafka est liée à l’idée d’une rédemption ou sauvegarde du passé et de l’autre enfant comme enfant en soi-même. De fait, d’après Sigrid Weigel – grande critique benjaminienne en Allemagne – les images que Benjamin a vues pendant sa vie (peinture, photographie, etc.) demeuraient latentes jusqu’au moment de leur « développement » dans une image de pensée (ou Denkbild) qui est caractéristique de sa philosophie 2. De même, le portrait de Kafka restait un alter ego imaginaire jusqu’au moment de l’écriture d’un récit autobiographique, d’une narration rédemptrice, où il l’a intégré. De plus, la description du portrait de Kafka dans Enfance berlinoise exemplifie également la dynamique paradoxale de l’oubli et du souvenir qui, selon « Discours sur Proust », constitue la similitude entre l’autoportrait photographique et la mémoire involontaire : comme nous l’avons vu, Benjamin décrit la mémoire involontaire en des termes analogiques à l’autoportrait photographique qui montre un moi antérieur ou un alter ego.
Le côté rédempteur ou bien éthique de sa discussion de la photographie est proustien dans la mesure où dans le roman de Proust, en particulier dans Le Temps retrouvé, il n’y a aucun doute que la mémoire involontaire a le pouvoir de sauver un passé perdu, en raison de sa capacité à défier le temps et la mort, ce qui n’aurait pu échapper à Benjamin. La description benjaminienne du portrait de Kafka fixe une image qui défile devant les yeux des mourants et le soulève ainsi
1. Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900, op. cit., p. 137 (traduction revue). Je reprends ici le lexique de la traduction du « Petit discours sur Proust » par Robert Kahn.2. Voir Sigrid Weigel, Walter Benjamin : Die Kreatur, das Heilige, die Bilder, Francfort-sur-le-Main, Fischer, 2008, p. 276-277.
PhotograPhie, écriture et mémoire : images d’enfance chez Benjamin et Proust 77
hors du temps, comme d’ailleurs le décor du jardin d’hiver arrête le passage des saisons. Bien entendu, Benjamin met la mémoire proustienne au service de son propre but, mais il est juste de dire, me semble-t-il, que les mémoires volontaire et involontaire fournissent à Benjamin un cadre puissamment évocateur au cœur duquel on trouve et retrouve le portrait de Kafka enfant, qui est sauvé de l’oubli et du temps en étant associé au fonctionnement de la mémoire involontaire. De plus, le portrait photographique d’un être suscite ce que Giorgio Agamben a appelé « une exigence de rédemption 1 », dans un commentaire sur « Petite histoire de la photographie » où il dégage cette idée à partir de la description benjaminienne du portrait de la marchande de poisson écossaise dont le portrait adresse selon Benjamin une demande au spectateur. Il écrit que dans son portrait « il reste quelque chose qui ne se réduit pas au témoignage de l’art de Hill, quelque chose qu’on ne soumettra pas au silence, qui réclame insolemment le nom de celle qui a vécu là 2 [...] ». Ainsi, l’exigence de la photographie « n’a rien d’esthétique », comme Agamben le souligne 3, mais se montre sous l’angle d’une éthique – une réponse du spectateur au visage photographié. Agamben suggère qu’une dédicace au dos d’un portrait photographique qu’Edgar Aubert a présenté à Proust « exprime parfaitement l’exigence qui anime chaque photographie 4... ». Or, si Proust était conscient de l’exigence éthique de la photographie, toujours est-il que son usage de la photographie dans la Recherche se présente sous l’angle esthétique. Autrement dit, la fonction de la photographie dans les épisodes cités (du Contre Sainte-Beuve et de la Recherche) est esthétique dans la mesure où les images servent d’inspiration pour sa création imaginaire 5. La transformation du frère en narrateur est un moyen de mettre en lumière un épisode charnière de la Recherche (« L’adieu aux aubépines »), alors que chez Benjamin la transformation de Kafka en Benjamin est une métamorphose qui souligne la singularité de la photographie ainsi que celle du modèle (Kafka et Benjamin) en l’entrelaçant à un discours à la fois rédempteur et proustien. Ainsi, Benjamin tâche d’accomplir cette responsabilité dont Agamben parle en répondant à l’exigence éthique de l’image de Kafka par une écriture qui met en valeur la singularité de cette photographie pour lui. Et il le fait en s’inspirant de Proust et de sa mémoire involontaire.
1. Giorgio Agamben, « Le Jour du Jugement », Profanations, trad. fr. Martin Rueff, Paris, Payot et Rivages, 2005, p. 26.2. Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », op. cit., p. 9.3. Giorgio Agamben, « Le Jour du Jugement », op. cit., p. 26.4. Ibid., p. 27. La dédicace est la suivante : « Regarde mon visage : mon nom est Aurait Pu Être ; on m’appelle aussi Plus Jamais, Trop Tard, Adieu ».5. Voir à ce sujet Brassaï, Marcel Proust sous l’emprise de la photographie, Paris, Gallimard, 1997.