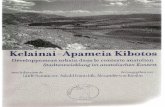I-PRISE DE CONNAISSANCE ET ANALYSE GENERALE DES RISQUES POTENTIELS
Connaissance semiotique et Mathematisation – semiogenese et explicitation
Transcript of Connaissance semiotique et Mathematisation – semiogenese et explicitation
1
David Piotrowski & Yves M. Visetti* Connaissance sémiotique et Mathématisation sémiogenèse et explicitation. Manuscrit d’un texte paru dans Versus - Quaderni di Studi Semiotici, 2014, 118, pp. 141-170. Résumé L’article examine les formes d’intervention des mathématiques dans les disciplines sémiolinguistiques, au double point de vue des régimes d’objectivation et des principes d’intelligibilité engagés. Après un rapide examen des problématiques logico-formelles, on discute plus précisément l’approche morphodynamique héritée de la Théorie des Catastrophes. Prenant acte des difficultés rencontrées par l’usage déterminant et objectivant du schématisme mathématique, et considérant l’exigence de dimensions sémiogénétiques et herméneutiques à placer au fondement de toute connaissance sémiotique, on plaide alors pour une épistémologie de l’explicitation, soutenue par une intelligence diagrammatique délivrant la portée la plus authentique de la mathématisation dans ces domaines. Mots clés. Diagrammatique, explicitation, sémiogénèse, schématisme, morphodynamique, théories linguistiques Abstract This paper examines the use of mathematics in semiolinguistic studies, from the double point of view of principles of objectivation and intelligibility. After a brief survey of logicist approaches, we discuss the paradigm of Morphodynamics and the legacy of Catastrophe Theory. This leads us to criticize the use of mathematics in terms of schemas of objectivation and determination for semiotic phenomena. Taking into account the necessity of inscribing semiogenetic and hermeneutic dimensions at the basis of semiotic knowledge, we propose a view of semiotic science as a process of explicitation (in contrast to objectivation) supported by a diagrammatic intelligence which uncovers the most authentic meaning of mathematics in those fields. Keywords. Diagrammatics, explicitation, semiogenesis, schematism, morphodynamics, linguistic theory.
1. Formes l inguistiques et mathématisation : quelques jalons
Dans ses aspects les plus obvies, la mathématisation dans les sciences humaines et sociales aura pu se présenter comme la forme aboutie d’un idéal de connaissance dont on considère que les sciences empiriques – plus exactement empirico-formelles – fournissent le modèle triomphant, tel qu’inauguré par la physique newtonienne. À terme, l’écriture mathématique et la géométrisation se sont imposées comme garantes de la précision et de l’univocité des concepts théoriques ainsi que de la rectitude de raisonnements désormais cadrés au format défini d’un certain calcul. Plus avant, la mathématisation a fondé la prédictibilité, en tout cas a obligé à certaines conséquences, et ouvert sur une confrontation des théories à l’empirique, pierre de touche de leur validité.
* Institute Marcel Mauss - LIAS (CNRS-EHESS), [email protected] , [email protected]
2
La possibilité d’un tel accomplissement épistémique, où les déterminations mathématiques captent et restituent dans leur intégralité la raison et la diversité d’un plan bien circonscrit de phénomènes, pour en produire l’intelligibilité et la valeur objective, ne va toutefois pas sans poser d’immenses problèmes, dont la philosophie s’est depuis longtemps emparée. Différents types épistémologiques ont pu se différencier à partir de cette référence. Les uns, dans une tradition que l’on peut rattacher à Kant, ont mis l’accent sur la teneur des relations contractées entre une donation phénoménale et un système catégoriel à portée objectivante, cela par l’entremise d’un schématisme. D’autres, au titre d’un certain modèle formel de rationalité, et estimant disposer d’un matériau empirique formaté à la stricte mesure de leur appareil théorique, ont mis l’accent, sous couvert d’un impératif de rigueur, sur la structure logique de leur dispositif et se sont employés à définir univoquement leurs entités et leurs procédures démonstratives. Pour ne pas parler d’autres encore qui, essentiellement préoccupés d’effectivité pratique, ont réduit la valeur objective du savoir à une grille instrumentale – d’où l’ambivalence des entreprises contemporaines de modélisation quant à leur finalité première.
Il reste que dans tous ces cas de figure le mode de jonction des concepts mathématisés à une diversité empirique, quoique différemment posé, fait toujours problème et de facto amène à introduire des plans intermédiaires qui assurent une jonction entre les concepts théoriques et l’ordre du concret. À l’intérieur de l’espace ainsi creusé entre le conceptuel et l’empirique, chaque dispositif théorique tend à déterminer son plan d’objectivité spécifique, ceci au risque de perdre de vue l’être même de ses phénomènes. Ainsi dépourvus de prise descriptive directe sur les phénomènes, les concepts théoriques ne valent plus que comme pièces d’un dispositif formel. La jonction à un empirique reconstruit se faisant donc à travers des plans de qualification intermédiaires qui opèrent dualement comme autant de “ systèmes d’observation ”. Et il va sans dire que de tels systèmes ne sont pas neutres : ils ont une portée “ constituante ”, au double sens où ils instituent les faits étudiés suivant un système de déterminations compatibles avec les appareils théoriques, et en même temps produisent le “ théâtre ” d’une manifestation empirique – c’est-à-dire ce que chaque courant veut bien retenir de l’empirique.
Ainsi le positivisme logique a-t-il, dans sa radicalité, postulé l’existence d’énoncés protocolaires qui logicisent d’emblée les données ; l’épistémologie poppérienne a introduit les espaces “ d’énoncés de base ”, lesquels correspondent peu ou prou aux “ modèles de données ” des courants dits “ sémantiques ” de l’épistémologie contemporaine (Van Fraassen, Suppes, Giere…).
Les a priori suivant lesquels ces interfaces, qui administrent donc l’observation, saisissent et calibrent les faits empiriques, appellent à une explicitation critique. On observera surtout que l’introduction de telles interfaces, qui façonnent et restituent les univers d’expérience au gré de structures logico-mathématiques déliées des formes premières d’appréhension des phénomènes, est venue compliquer et de fait brouiller le dispositif kantien dans lequel le mode premier d’appréhension – les formes de l’intuition – est pensé comme immédiatement attenant à une imagination mathématique déterminante.
Ces a priori logico-formalistes ont notamment eu pour effets de fermer de nombreux angles d’intelligibilité et d’interrogation. Ainsi, la notion de forme naturelle, dont le statut déjà faisait difficulté dans les épistémologies post-kantiennes, s’est trouvée de fait liquidée par la réduction exclusive du dispositif de connaissance à un système catégorial que les courants logicistes du XX° siècle ont pensé pouvoir identifier à telle ou telle guise de la formalité logique.
Une même radicalité formaliste a frappé le champ sémiolinguistique où les formats observationnels, suivant lesquels donc les phénomènes retenus ont été appréhendés comme de simples factualités, ont été profondément marqués par des décennies de pensée logiciste, et tout particulièrement par le format du signe logico-symbolique : entité atomique unitaire, passible d’une “ présentation ” comme complexe graphique discret, support de connexions formelles établissant son identité systémique, et dont le contenu est attribué par voie conventionnelle. Les faces d’expression et de contenu sont donc déliées, et on se situe ainsi sur un plan d’appréhension empirique où les phénomènes, assimilés à de simples événements spatio-temporels, sont traités comme des données stabilisées, bien circonscrites (segmentées) et valant comme supports d’identités abstraites. Encouragé par des siècles d’écriture alphabétique, et relayé par les développements de l’informatique, cet assemblage, paradoxal pour des grandeurs sémiolinguistiques, de token matériels et d’identités formelles, tend à se substituer à d’authentiques observables pour devenir une matière première de l’enquête linguistique. Matière première dont on recherche la raison interne (système/procès, type/token) à travers une formalisation
3
logique qui en définitive confond sous un même format les écritures du théoricien et ce qui dans ce cadre fait fonction d’observable.
Pour le dire autrement, si une formalisation (tenant lieu ici de mathématisation) a été considérée comme possible, c’est en raison d’une idée de forme abstraite et discrétisée, et de surcroît ambivalente en ce qu’on ne sait plus très bien si elle relève seulement de l’appareil connaissant (la science) ou bien si, dans une veine quelque peu réaliste, elle vaut aussi comme image d’un système matériellement instancié (vision reprise par différents cognitivismes, qui l’ont complétée par le biais d’un physicalisme propre au dispositif informatique).
Cet angle d’approche et de détermination de la nature des faits sémiotiques conduisait directement à la conception d’un dispositif sémiolinguistique centré sur une syntaxe purement formelle. Abstraction, discrétisation et dissociation postulée des plans d’expression et de contenu, sont ici les maîtres-mots. Tributaire de la conception formaliste des mathématiques (où les écritures logico-formelles sont censées restituer toute la vérité des mathématiques et le sens de leurs objets), le phénomène sémiolinguistique se voit d’emblée réduit à une concaténation de signes discrets dont la dualité constitutive forme/sens (ou expression/contenu, dorénavant E/C) se trouve alors approchée suivant le principe d’une correspondance conventionnelle entre une marque graphique et une entité puisée dans un univers d’objets indépendamment accessibles. Mais là ne s’arrête pas le mouvement de formalisation : tout ce qui pourrait rester de concret ou de substantiel dans la détermination de la marque ou de l’entité se voit bientôt liquidé pour faire place à des caractérisations entièrement formelles.
Ainsi la sémiose, qui dans un sens plus authentique renvoie à l’émergence et à la constitution des signes en discours, n’est plus qu’assemblage de signes prédéfinis (sous une forme particulièrement radicale de discrétisation des loci sémiotiques), tandis que le signe subit une série de dégradations. Perdant d’abord sa nature indivise au profit d’une connexion conventionnelle entre ses deux faces E/C alors autonomisées, ses faces se trouvent repoussées en bordure pour laisser place à des structures purement formelles qui prétendent alors délivrer l’essentiel des langues et détenir une valeur objective. Des dualités sémiotiques fondamentales ne restent que des arborescences de catégories formelles censées supporter un appariement entre syntaxe et sémantique, venu se substituer dans ce dispositif à la donation originaire des langues en expression et contenu. Ce que la tradition grammaticale avait pensé comprendre des langues, à savoir les jeux de segmentations, de classifications, de hiérarchies, de dépendances, de régularités, s’est trouvé ainsi entièrement ressaisi sous les espèces d’une syntaxe logique, considérée comme le parachèvement d’un usage discipliné d’une langue véhicule de la pensée.
Ainsi autonomisées, les formes propres du langage, à commencer par celles de ses unités élémentaires, ne doivent rien à une dynamique interne de constitution, pour ne répondre qu’à un ensemble de rôles fonctionnels dans des dynamiques externes de combinaison : dynamiques abstraites s’il en est dont la raison formelle peut parfaitement se concevoir hors de toute inscription dans le concret des langues. Notamment, toute idée d’inscription nécessaire dans une “ substance ”, ou d’émergence (à partir d’une “ matière ”) à laquelle les structures devraient leur existence, et par là certaines conditions de leur identité et de leur valeur, se trouve ainsi mise de côté — et cela que l’on se situe dans une perspective naturaliste ou culturaliste quant à ces matières ou substances.
C’est ainsi, d’un seul et même mouvement, que la perspective logico-formaliste a disjoint (quand ce n’est pas ignoré) les plans de l’expression et du contenu, et secondarisé les articulations entre formes et substances, reconnues en revanche par la théorie hjelmslevienne comme constitutives de chacun d’eux. Les phénomènes, où qu’on les situait (dans l’ordre du vivant, du physique, du psychique, du social…) n’étaient jamais plus que prétextes à leur investissement par des identités abstraites. Et ainsi se trouvaient écartées d’autres dimensions, inhérentes à d’autres conceptions de la forme (modalités de présence/absence, stabilité/fluctuation, reconnaissance et perceptibilité, valeur et interprétation).
On se trouvait au total dans la situation épistémique où formes théoriques et formes d’observation se recouvrent pour partie, les signes (dans leur format logique attribué) en constituant l’élément commun. C’est donc d’un matériau empirique ainsi formaté, et de ses régularités, que la théorie se devait de rendre compte.
4
2. La morphodynamique et les grandes dualités 2.1. Hjelmslev : les formes comme modes d’articulation d’une substance
En contraste, et tout en conservant une conception formaliste des structures, la perspective hjelmslévienne a fait droit à ce qu’elle a nommé substance : le divers des occurrences de phonie et de signification se trouvait saisi par un protocole descriptif (défini comme application réglée des concepts de la théorie) qui ambitionnait d’y enregistrer la présence sensible d’items dont la valeur sémiolinguistique soit alors reconnue et intégralement assimilée à un faisceau de rapports de dépendance.
Il s’agissait donc toujours de rapporter l’objectivité linguistique à un ensemble de structures, avec ce que cela suppose de régimes de déterminations positifs, et complets dans leur abstraction même. Mais ici, d’une part, les relations priment sur les éléments (qui n’en sont que les extrémités), et, d’autre part, ces relations si formelles qu’elles soient habitent les substances qui les manifestent et où la méthode glossématique entend les reconnaître. Le cœur de l’objectivité linguistique est donc toujours considéré comme abstrait et formel, mais reste attaché à diverses substances (au moins d’expression et de contenu). Ce mixte de formalité et de matérialité apparaît clairement dans le choix des concepts primitifs de la glossématique qui relèvent d’une catégorialité logique et épistémique (condition, nécessité…) en même temps que phénoménologique (présence, absence…).
Quoique la méthode glossématique ne pose pas la question des principes d’organisation des substances, il n’en reste pas moins qu’elle rend possible l’intervention à ce niveau d’une théorie des formes et des organisations qui soit fondatrice pour les relations structurales, objet spécifique de son enquête. L’objectivité linguistique reste formelle, mais cette formalité se trouve dans l’étroite dépendance d’une catégorisation opérant à même les substances, corrélativement pensées comme “ matières formées ”.
Ainsi, le durcissement formaliste-logiciste de la linguistique dans sa prétention à la scientificité (Chomsky, ses épigones, jusqu’à sa descendance cognitiviste) se sera accompli en réduisant la problématique de la forme à celle d’une structure logique conçue dans l’esprit de Hilbert, puis de Turing, comme montage d’écritures dites formelles. En contraste, la problématique hjelmslévienne se laisse accorder à des problématiques schématisantes, où la question des formalismes et des catégories se pose toujours en rapport avec un cadre “ substantiel ” de donation, engageant à une intuition propre.
Par là une épistémologie d’inspiration kantienne, quelles que soient ses limites pour une pleine reconnaissance des faits sémiotiques, retrouve de sa pertinence – sous la condition toutefois d’un progrès des mathématiques elles-mêmes, c'est-à-dire d’un schématisme spécifique visant la manifestation sémiotique en tant qu’elle se construit dans une intuition appropriée.
En même temps, dans la glossématique, la conception des substances comme formations inscrites en des substrats séparés tend à reconduire une séparation ontologique entre expression et contenu, et à exclure du champ de la connaissance linguistique les principes de leur unité et de leur possible différentiation. Dans la théorie glossématique, la différentiation et l’interdépendance des plans d’expression et de contenu se trouvent rejetées dans un amont certes nécessaire mais inaccessible à une connaissance linguistique qui ne vise qu’à restituer, à travers des cheminements d’analyse parallèles, les formes abstraites se manifestant en chacun des plans. De fait, dans l’architecture théorique, la distinction entre expression et contenu est antérieure à celle entre forme et substance.
Dans cette optique, aussi, le signe, et plus généralement tout formant sémiotique, ne réside pas dans le moment d’une différentiation conjointe, à son propre niveau, d’une expression et d’un contenu, mais se trouve reconstitué à partir des rapports enregistrés en chacun des plans, supposés porteur chacun d’une organisation formelle/substantielle autonome.
Pour le dire en des termes qui nous sont plus propres, la sémiose ainsi conçue ne semble toujours pas coïncider avec l’événement du signe, en tant que celui-ci existe essentiellement comme une transition, une zone de délimitation dans un flot, et un moment de différentiation métabolique en ses deux “ faces ”. À nouveau nous sommes reconduits à l’image d’une construction dont seuls les résultats (les agencements de signes) seraient saisissables comme des objets pour une linguistique. Une reconstruction hjelmslevienne du signe qui voudrait en ressaisir l’unité ne pourrait y intégrer sa
5
nature foncièrement sémiogénétique : c’est-à-dire le fait même de sa prise dans un flux, dans une genèse interne, qui est part d’une identité toujours à-déterminer, et où se jouent unité et différence d’appréhension entre expression et contenu.
En somme, l’ambition formelle aura connu deux grandes tendances : d’une part, strictement formaliste, qui aura eu recours à des idéalités indifférentes à leurs modes de prise dans des substances, et, d’autre part, comme c’est le cas pour la glossématique ou plus récemment pour le courant des linguistiques cognitives, qui aura voulu mettre en rapport, voire identifier, les idéalités linguistiques avec des morceaux de substance catégorisés, expression et contenu se laissant saisir et déterminer séparément1. Jamais l’on n’y retrouve le signe, plus généralement tout formant sémiotique, dans leur nature indivise, et avec les modulations possiblement indéfinies de leur complexion en expression et contenu.
2.2. La Morphodynamique D’autres approches, retournant aux grands moments de la pensée structurale (de Goethe à Lévi-Strauss) et sans jamais la disjoindre d’une pensée génétique des formes, ont tenté d’intégrer dans une théorisation unique un certain nombre de traits reconnus comme essentiels : holisme et méréologie (touts et parties dans la tradition gestaltiste), différentialité et interdéfinition des valeurs, et surtout conciliation de l’abstrait et du concret dans l’idée de structure égalée à la catégorisation d’une substance.
Au plan des schématisations mathématiques et des modèles, l’événement capital a été l’ouverture, avec la Théorie des Catastrophes de René Thom (dorénavant TC), d’une ligne de travaux qui a permis de reconstruire le structuralisme dans un cadre dynamiciste, et de dépasser certaines apories liées à son enfermement dans un univers de représentations discrètes, rétablissant du même coup un lien avec les domaines physique, biologique et psychologique – dans le prolongement de la grande idée gestaltiste d’un “ isomorphisme ”, i.e. d’un corps de schématisations qui soit commun à tous ces niveaux. Un des apports essentiels de la théorie a été de substituer, à la vision logico-algébrique de la généricité, celle, topologico-dynamique, d’un germe instable, qui anticipe sur les chemins de stabilisation à la faveur desquels se nouent les phénomènes centraux de la détermination réciproque des valeurs (glissement, fusion, dissociation, identification dialectique des contraires). Les mêmes modèles ont pu être mis à contribution pour schématiser des types d’interactions entre positionnements dynamiques, considérés alors comme des formes de proto-actantialité.
Ces innovations considérables ont libéré l’imaginaire scientifique, et fourni de nouvelles motivations aux appareils catégoriels de différentes sciences humaines (anthropologie, sémiotique greimassienne, linguistique), en soutenant que leurs objets s’enracinaient dans certains schèmes très génériques de la perception et de l’action. L’un des legs principaux de la TC aura finalement consisté en l’invention d’une diagrammatique originale (nous revenons en dernière section sur cette notion de diagrammatique) : fondée sur une déduction que l’on pourrait dire à la fois mathématique et transcendantale d’une certaine catégorie de forme, elle s’est trouvée validée a posteriori par sa capacité à soutenir l’intuition dans de nombreuses disciplines concernées à un titre ou à un autre par cette notion, ou par celle de structure.
Plus précisément, la problématique thomienne, qualifiée de morphogénétique, a joué un rôle décisif en montrant comment l’on pouvait concilier gestaltisme, structuralisme et genèse formelle, en faisant usage d’un concept mathématique d’instabilité, à la fois très général et rigoureusement défini.
1 Avec cette différence que dans la perspective glossématique les unités sémantiques sont les catégorisations de la substance du contenu, tandis que pour les linguistiques cognitives, les unités linguistiques se trouvent directement rapportées à des catégorisations de l’expérience. De leur côté, les approches faisant fond sur la représentation logique ont bien tenté de rattacher les identités formelles constitutives de leur objet à d’éventuelles substances. Elles n’ont trouvé d’issue que dans l’exploitation du modèle ou de la métaphore informatique à travers lesquelles on tente de concilier les caractérisations fonctionnelles d’un certain niveau symbolique avec les régimes (qui se veulent) physicalistes d’un supposé substrat.
6
Thom s’est demandé comment déterminer la différentiation morphologique, quand elle relève d’un type englobant : il peut s’agir de forme naturelle ou culturelle, se ramifiant en variantes locales, et dans tous les cas, la différentiation d’un “ genre ” ou d’une “ espèce ” constitue, en un sens éventuellement imagé, une “ morphologie ” dans un “ espace de variantes ”.
Identifiant toute entité à un système dynamique, Thom montre comment attribuer un type qualitatif à une dynamique et sur cette base distingue les dynamiques stables de celles qui sont structurellement instables. Il propose alors de comprendre toute morphogenèse comme un processus de stabilisation d’une dynamique initiale, originairement instable, qui définit le noyau identitaire du processus morphogénétique étudié.
Une morphogenèse, dans quelque domaine qu’elle se présente, correspond à une évolution de cette dynamique régulatrice privilégiant les états les plus stables. La morphologie étudiée apparaît alors comme le déploiement simultané d’une famille de variantes plus ou moins stabilisées de la dynamique instable tenant lieu de germe initial, chacune de ces variantes régulant une portion seulement de l’espace occupé par la morphologie. À ce point, intervient une dialectique essentielle entre espaces dits internes et externes : la morphologie se présente dans un espace externe (en général un espace-temps physique) sous les espèces d’un partitionnement en régions connexes, chacune d’entre elles relevant de dynamiques internes de type qualitatif constant. L’ensemble des dynamiques internes, paramétrées par les positions de l’espace externe où se manifeste la morphologie, détermine ainsi la différentiation des qualités, ou valeurs, régulant les composantes externes de cette même morphologie. Ainsi dispose-t-on d’un schème mathématique très générique constituant un imaginaire rigoureux et fécond de l’installation d’une forme (ici donc réduite à l’acception de morphologie) dans une substance qu’elle vient organiser. Plus précisément, ce qui importe ici c’est une dialectique interne/externe en tant qu’elle couple une famille de dynamiques (pourvues d’identités qualitatives) à une manifestation morphologique assimilable à une cartographie d’un espace de déploiement tenant lieu de substance.
Ce schème s’inscrit fort bien, quoique incomplètement, dans la lignée gestaltiste2. Thom reprend explicitement à son compte la thèse de l’isomorphisme entre physique, biologie et psychologie, avec l’idée de structures organisationnelles transposables d’un ordre à l’autre, constituant par exemple ce qu’il appelle la figure de régulation d’un être vivant.
En reconstruisant sur un mode très spéculatif, mais mathématiquement opératoire, les idées de stabilité, de genèse et d’actualisation, de différentiation et d’interaction, Thom a frayé la voie, d’une façon très générique valant pour toutes sortes de disciplines, à une réunification des perspectives génétiques et des perspectives structurales, qui débouche sur une co-constitution. Loin de s’opposer, structure et genèse deviennent dans son approche inhérentes l’une à l’autre.
L’idée de restructuration du champ, par exemple dans le cas d’un basculement perceptif, plus généralement dans tous les cas de configurations alternatives relatives à une même diversité sensible, se trouve remarquablement éclairée par le concept de bifurcation, qui renvoie à la modification qualitative brusque d’une dynamique organisatrice à la suite d’une petite perturbation de ses paramètres de contrôle. De même, l’on comprend mieux comment les systèmes peuvent préserver leur organisation interne au sein d’un environnement qui change continûment, et comment en même temps ils peuvent, à la traversée de certains seuils critiques dans cet environnement, modifier substantiellement leur réponse, et leur organisation, de façon quasi-discontinue.
2Une réserve peut être faite, pour ce qui est de la conformité au legs de la Gestalt : les concepts d’isomorphisme, de formes physiques, de transposabilité, sont bien là ; mais il manque ce qui devait les fonder, le champ gestaltiste, qui se réduit chez Thom à un espace-temps physique donné au départ. Les lois d’organisation à la Wertheimer ont disparu au profit de la vision, excessivement unifiante et immanentiste, d’un schème germinal instable, déterminant par lui-même la variété entière de ses stabilisations, et par conséquent la morphologie des régions où il est amené à se déployer.
7
2.3. Bilan Ce type de modèle, remarquable en ce qu’il traite en même temps, de façon holiste, la synthèse des unités et des relations, et les transformations de la structure, peut s’appliquer en droit, à un niveau très générique, à tout domaine où se manifestent des phénomènes structuraux.
La notion de structure se trouve ainsi mise en continuité avec celle de forme : le schématisme morphologique d’esprit continuiste faisant jonction avec les opérations discrètes de la catégorisation. Une structure (au sens visé par les formalistes) se recomprend en effet comme le résultat d’une opération de discrétisation (d’une catégorisation) procédant d’une morphologie continuiste-dynamiciste convenablement schématisée.
2.4. Retour au structuralisme sémiotique Reprenant et prolongeant les premières esquisses thomiennes en sciences humaines, Jean Petitot a pu ainsi montrer que la conception différentielle de la valeur d’un “ terme ” au sein d’un paradigme se laisse schématiser, en bon accord finalement avec les approches structuralistes, à partir d’un même genre de dispositif dynamique.
On part du principe qu’un certain continu précède l’actualisation de toute valeur, dans la mesure où : (i) celle-ci présuppose conflits et coordinations avec un ensemble d’autres valeurs, s’organisant en un paradigme de référence, (ii) la variation des valeurs, d’un contexte à l’autre, doit pouvoir se comprendre dans certains cas comme une modulation continue, et dans d’autres comme une transition discontinue. L’actualisation d’une valeur se représente alors comme la différentiation d’une certaine position, relativement à un fond d’alternatives réparties sur un continuum constituant l’espace substrat du paradigme. Elle est instaurée sur ce continuum au travers d’une famille de systèmes dynamiques, qui définit des positions privilégiées (attracteurs), et conditionne des parcours d’une position à l’autre. Le paradigme global connaît ainsi plusieurs états de différentiation, suivant la dynamique qui l’organise (Petitot, 1985, ch. 1).
Dans la même perspective, Petitot reprend les modèles thomiens de proto-actantialité, et reconstruit les grammaires casuelles (Petitot 1985), puis resitue ces mêmes modèles (Petitot 1992) dans une fonction médiatrice entre les structures perceptives proprement dites, et certaines catégories fondamentales (thymiques) organisant l’espace des valeurs poursuivies dans l’action. Ce dernier point de vue – celui d’une Physique du sens – représente une sorte de conversion réaliste-naturalisante de la sémiotique greimassienne, en syncrétisme avec le pan-sémiotisme biophysique de René Thom : la strate morphodynamique de la perception visuelle, relevant des sciences cognitives, venant alors au premier plan, devant le niveau discursif/figuratif du modèle narratif.
2.5. Discussion
On constate sur tous ces exemples une ambivalence des modèles proposés, relativement aux champs plus ou moins empiriques qu’ils sont censés déterminer. Leur remarquable et féconde généricité s’accompagne d’une interrogation non résolue sur le statut ou la nature substantielle des espaces externes ou internes convoqués : l’espace externe est-il toujours un espace de physiciens ou bien parfois quelque espace sur lequel une intuition structurale pourrait avoir directement prise ? l’espace interne est-il pensé comme le cadre d’inscription d’un énigmatique contenu culturel, ou bien est-ce un espace déjà naturalisé ? par ailleurs, sur quelles phénoménologies ces espaces sont-ils indexés ? et comment ces différentes versions se combinent-elles ?
De surcroît, une autre ambiguïté fondatrice traverse toutes ces entreprises. S’agit-il, avec elles, de reconduire une perspective causale, ou du moins générative, sur les phénomènes ? Ou s’agit-il plutôt de déployer les formes d’un possible, en revenant à ce qui nous semble être le cœur de la conception thomienne des morphologies comme formes du sens ? Si l’on est dans ce deuxième cas, la question n’est pas d’engendrer causalement des résultats (mécanisme), mais d’abord d’expliciter les configurations sur lesquelles repose le sens des phénomènes (différentiation et couplage de
8
microstructures, ou qualités locales, formellement représentées par des systèmes dynamiques variables).
L’explication par une générativité cède alors le pas devant la recherche de généricités, comprises elles-mêmes comme champs de formes et dynamicité.
C’est ainsi le statut épistémologique de ces mathématiques morphologiques qui demande à être réfléchi. Peut-on le concevoir comme une extension stricte du cadre kantien, et dans ce cas le schématisme ne ferait qu’organiser une intuition de type physique (comme dans une perspective thomienne) en la reliant à une catégorialité étendue comprenant le répertoire propre au structuralisme ? Ou bien cette extension est-elle “ analogique ”, au sens où l’intuition sollicitée présenterait d’emblée, par elle-même, des phénomènes de nature structurale (comme l’a soutenu Petitot) ? Faut-il alors sortir du cadre kantien, et, dans une filiation déjà plus phénoménologique, plutôt que d’intuition parler de perception, comportant par elle-même des dimensions d’organisation, de qualification et d’anticipation que le dispositif kantien délègue à l’imagination, à l’entendement et aux idées de la raison ? Que signifie en fin de compte la dynamicité du modèle – et en particulier quel est le sens du paramètre temporel ? s’agit-il d’un temps de processus physique ? d’un simple paramètre indexant un continuum d’états pour un ensemble de figures ? ou bien encore, s’agit-il du temps d’une herméneutique empruntant à un principe logique ou microgénétique, scandant la progression des interprétations ?
Ces questions sont d’autant plus patentes que maintes applications sémiotico-sémantiques des schèmes catastrophistes ne se préoccupent pas de rendre compte des substances qui pourraient porter les morphologies étudiées, mais se présentent plutôt comme des avancées formelles, sur un terrain occupé majoritairement par les approches logicistes : carré sémiotique (Petitot), modalités (Per Aage Brandt), et même formule canonique du mythe chez Lévi-Strauss (Petitot encore ; pour une discussion approfondie, cf. Scubla, 1998).
Sans entrer dans les détails, rappelons quelques-unes des objections qui ont pu être adressées à l’ensemble des approches morphodynamiques, non par opposition d’école mais au contraire avec la volonté d’approfondir les exigences constitutives de la perspective dynamiciste.
Parmi ces points critiques, on aura noté : une conception par trop immanentiste des systèmes portée par l’unification des paradigmes à partir d’un germe unique ; un abandon de la structure fond/forme3 ; le peu de place faite à l’idée d’une variété de phases co-existantes, comme il conviendrait dans une théorie des champs sémiotiques. Les phases instables n’ont donc pas d’autres valeurs que de servir de point d’entrée et de principe d’unité à des paradigmes de formes stabilisées. Certes le principe structuraliste de détermination réciproque des valeurs a été remarquablement capté, mais le point de vue génétique initial s’est trouvé réduit à la restitution d’entités stabilisées, qui ne feraient que rejoindre des identités acquises autrement.
Par ailleurs, et qu’il s’agisse de langage ou de cognition, l’intégration des dimensions de l’action et de l’expression au sémantisme fondamental des unités analysées a toujours été différée. Si bien que toute la généricité s’est trouvée concentrée dans les seuls principes configurationnels retenus4. Du fait d’avoir privilégié dans la problématique les questions d’organisation en paradigme et de structures actantielles, les dimensions énonciatives et textuelles ont été délaissées, laissant finalement intact le problème de bâtir une théorie à la fois perceptive, praxéologique et discursive des formes sémiotiques. Et alors qu’une telle conciliation du dynamicisme et du structuralisme aurait pu contribuer au développement de théories culturalistes et historicistes des formes, la théorie sémiotique attenante est restée handicapée par ses a priori : elle a favorisé la recherche d’archétypes universels, plutôt que la modélisation de formes émergeant de façon imprévisible dans une histoire.
Le schématisme catastrophiste, à qui l’on doit la relance la plus aboutie des approches dynamicistes depuis l’école gestaltiste berlinoise, n’a finalement pas manifesté dans les sciences humaines l’autonomie et la capacité générative que certains en attendaient, à l’image de ce qui avait pu se
3 On ne saurait trop insister sur ce point, qui a une portée très générale : le fait de ne pas intégrer une structure fond/forme à titre d’articulation organique tend à dégrader l’idée même de forme et reconduit à un clivage de type forme/substance. On voit alors revenir des conceptions de type hylémorphique où une forme séparément schématisée s’en vient informer une substance posée comme extérieure. 4 Cf. la discussion dans Cadiot & Visetti (2001:60-63) ; également Visetti (2004b).
9
produire dans les sciences physiques depuis Galilée et Newton. En sémiotique et en anthropologie, il s’est agi plutôt de conforter et d’amender des propositions déjà existantes, par le fait même de projeter sur elles l’éclairage des modèles, convenablement glosés. Tout cela, qui est déjà considérable, n’a pas entraîné le renouvellement espéré au niveau des dispositifs plus spécifiquement disciplinaires, faute sans doute de descriptions empiriques diversifiées, qui dépendent, jusque dans le détail, de la nouvelle perspective dynamiciste5. En anthropologie structurale, la percée épistémologique n’a finalement servi qu’à refonder un appareil théorique et descriptif laissé pour l’essentiel intact. Il n’en a pas été tout à fait de même en linguistique, puisque plusieurs des tenants du paradigme catastrophiste se sont ralliés aux thèses générales de la linguistique cognitive, dans la mesure où ils y retrouvaient le type de schématisme qui avait leur faveur. L’introduction de nouveaux schématismes topologico-dynamiques a certes permis d’approfondir les théories structuralistes, en rapprochant l’accès aux significations d’une perception de formes sensibles. Mais elle a aussi poussé à endosser un certain nombre de positions théoriques, ou de simplifications, que nous avons eu l’occasion de critiquer. Pour le dire d’une formule, il nous a semblé nécessaire de passer de ce premier dynamicisme morphodynamique à un autre dynamicisme, qui soit plus authentiquement génétique, et d’abord microgénétique (dans un sens affine à celui de Rosenthal 2004).
En somme, tout s’est passé comme si ces théories n’avaient servi qu’à rejoindre en les “ rétro-éclairant ” des systèmes d’entités déjà définies et élaborées par des cadres théoriques antérieurs ou parallèles (linguistiques cognitives) — d’où le reproche souvent entendu de ne faire que conforter des analyses et des théories existantes, en en produisant certes une nouvelle intelligibilité.
Pour des raisons tenant tant au schématisme catastrophiste initial qu’à des héritages problématiques sur la notion de forme, la morphodynamique n’a traité de genèse des structures que suivant l’a priori de substances préalablement données et bien distinguées, en somme autonomisées, en tout cas déjà constituées en dehors de toute perspective sémiotique. Et en raison d’hypothèses restrictives sur le mode de schématisation adéquat, elle n’a restitué qu’un jeu systémique clos à la source de l’émergence des formes.
Mais surtout – et cela nous ramène aux questions fondationnelles abordées dans la première section – la morphodynamique s’est engagée dans une impasse en traitant la question de la mise en forme des substances séparément de celle (supposée résolue) de la différentiation du flot sémiotique suivant deux versants d’expression et de contenu (cf. infra). Différentiation qui demande à être pensée comme un déploiement en états microgénétiques évolutifs, comprenant chacun une diversité de phases co-existantes et hétérogènes. Différentiation qui engage de surcroît les dimensions de l’action et de l’expressivité, et, partant, celles de norme, de motivation, d’engagement.
3. Dynamicisme et Sémiogenèse
Le principe hylémorphique d’une certaine vulgate aristotélicienne traverse de façon plus ou moins rigoureuse les fondations de la sémiologie. Sous différentes terminologies on retrouve l’idée d’une matière passive et informe (une masse amorphe) dont se saisirait une série stratifiée de formes, répondant de toute régularité, pour l’articuler ainsi en substance (au sens de Hjelmslev). L’enquête scientifique dans sa globalité se trouve dès lors engagée dans la reconstitution d’une hiérarchie de strates formelles organisatrices, et ambitionne même, dans le cas des programmes réductionnistes, de parvenir à déterminer des modalités d’inscription dans un espace-temps de type physique.
5 Pour ce qui concerne les fondations communes de la sémiotique et de la linguistique, on se reportera aux premiers travaux du triumvirat Brandt, Petitot, Wildgen, ainsi qu’à certains de leurs ouvrages plus récents, où l’héritage thomien se trouve reversé dans une problématique plus riche : anthropologie culturelle dans la filiation de Cassirer, origine et évolution du langage, esthétique. Il existe également des travaux qui se sont appuyés au schématisme catastrophiste pour en tirer des effets théoriques et descriptifs différents. Mais ledit schématisme y est alors convoqué comme un principe général, sans être exploité dans la précision et la variété de ses figures. En sémantique linguistique, signalons ainsi le modèle de polysémie de B. Victorri.
10
Le problème dans le cas des disciplines sémiotiques serait alors (i) la multiplicité des substances (pour autant que cette notion soit pertinente6), que l’on pense devoir être convoquées pour rendre compte de factualités ne se donnant pas d’emblée comme objets, mais comme configurations de valeurs, et (ii) outre son caractère foisonnant et hétérogène, la valeur en cause dans de tels “ objets ” est différentielle et, à la différence des objets des sciences de la nature, semble ne pouvoir jamais se réduire au format d’un paramètre.
D’où, considérant ce dernier point, l’avancée remarquable de la TC qui montra de façon convaincante comment comprendre cette notion de valeur au travers d’un schème propre : celui d’un couplage de dynamiques internes, paramétrées sur des espaces externes qui héritent ainsi d’une géométrie positionnelle qualitative, trace extériorisée de l’existence et de la variation des valeurs.
Ainsi pouvait-on penser objectiver le “ théâtre ” de la manifestation sémiotique, dans la mesure où un seul et même schème allait permettre d’articuler une détermination différentielle de la valeur à une connaissance positive de ses formes de manifestation7.
Mais sans doute avons-nous suffisamment commenté les difficultés rencontrées par ce type d’approche structuraliste et morphodynamique, pour pouvoir à présent poser un diagnostic : en bref, ces difficultés tiennent à la non prise en compte du moment sémiotique premier, celui où les plans et les formants de l’expression et du contenu viennent à se différencier au sein du mouvement expressif — cela même qui est ici nommé sémiogenèse (enveloppant une dynamique de différentiation et une perspective expressiviste que le terme de sémiose ne prend pas suffisamment en charge).
À travers la perspective sémiogénétique que nous souhaiterions promouvoir, c’est tout un horizon philosophique et sémiologique qui se trouve réactivé, dont l’inspiration vient pour nous au premier chef de Saussure et de Merleau-Ponty : l’un nous engageant à concevoir des linguistiques de la langue par essence tributaires d’une linguistique de la parole (comme il ressort des plus récentes lectures du corpus saussurien), le second, dans sa suite, distinguant et entremêlant parole parlante et parole parlée dans l’être du langage. Il en ressort une conception de la langue, comme de toute ressource langagière, qui n’est ni formelle ni substantielle, mais qui est celle d’un “ paysage ” où s’inscrit et que travaille l’activité de langage. Ce qu’a fort bien exprimé d’une autre façon E. Coseriu : “ ainsi, ce ne serait pas bien définir le langage que de prétendre qu’il s’agit d’une activité dans laquelle on emploie des signes (déjà établis) car il représenterait plutôt une activité créatrice de signes (Coseriu 1958) ” (ce qui n’est évidemment pas sans effet sur la conception même d’un système, et la notion attenante de norme).
Notre propos ici n’est pas d’élaborer un tel dispositif, ni de le confronter à d’autres problématiques pouvant lui être rattachées, comme celle du pragmatisme. Nous renvoyons pour cela à d’autres textes où ce travail a été amorcé (cf. nos travaux cités en bibliographie). Tout juste voudrions nous ici rappeler que la démarche scientifique en matière de langage ne peut s’entamer qu’à partir du lieu et du moment natif de son “ objet ”, qui n’est pas “ substance ” (i.e. forme prise dans une matière) mais champ d’action et d’expression. La parole comme geste spécifique faisant alors constamment advenir les formes d’un discours et conjointement l’arrière-plan du langage (comme ressource capacitante et normative pour des parcours disposant des valeurs propres à des jeux ou genres). En sorte que nous soutiendrons que toute connaissance linguistique doit intégrer ce “ moment ” à son objet et en comprendre les implications dans l’édification de son appareil théorique, et le cas échéant, dans ce que peut en traduire une possible mathématisation.
6 Substances qui ne sont jamais que des points de vue idéalisants, distribués en instances corporelles, psychiques, cérébrales, sociales, instaurant une homogénéité minimale, pensée comme le corrélat concret d’une systématicité à mettre en place, et dont on tenta de neutraliser la foisonnante et inhérente intrication à travers la notion de niveau d’organisation. 7 De même alors que la physique newtonienne (reconstruite par Kant) semblait pouvoir se réduire à un théâtre de corps matériels idéalisés dans un espace-temps géométrisé (car on avait dans ce cas trouvé un juste plan de détermination catégoriel, avec les modalités empiriques de comparution d’une matière), de même en irait-il pour les choses du signe à travers ce schème articulant des “ formes ” internes et externes. Et pour certains, partisans d’une naturalisation radicale, cette conjonction “ sémiophysique ” pouvait même devenir entièrement physique à la faveur d’une assimilation des dynamiques internes aux dynamiques formatrices des substances (pour l’essentiel neuronales).
11
Ce qui importe donc en premier lieu, tout particulièrement dans la perspective d’emploi des mathématiques, c’est bien la sémiogenèse, i.e. l’émergence d’une dualité E/C sur l’arrière-plan d’un langage, la dynamique même de différentiation menant à l’existence de tout formant sémiotique qu’il s’agirait de reconnaître. Cela autant pour des figures diffuses et/ou étales (rythmes, isotopies, périodes) que pour des figures compactes comme celles privilégiées par la tradition lexico-grammaticale (mots, construction, idiomatismes…).
Le principe, en tout cas l’utopie directrice, animant l’entreprise de la linguistique sera donc de répercuter dans ses montages théoriques et descriptifs les modalités mêmes de l’émergence des formants sémiotiques dans leur nature indivise E/C avec leurs différentes modulations – tout en respectant la spécificité du mode de détermination des valeurs sémiotiques, qui ne sauraient procéder du modèle de l’objet stable, identique à soi et porteur de ses propres déterminations.
En opposition aux conceptions “ abstractionnistes ” de la théorie, la connaissance des faits linguistiques ne peut donc jamais être détachée d’une certaine étoffe phénoménale de leur donation. Aucune logique purement conceptuelle ne peut s’y substituer. Dans cette perspective épistémique, connaître n’équivaut pas à déterminer un objet à partir d’un registre de catégories préalables, c’est essentiellement expliciter (au sens, inspiré du courant herméneutique de la phénoménologie, de clarifier et d’articuler en produisant de nouvelles images)8 les modalités, les conditions et les horizons les plus significatifs d’un apparaître expressif, minimalement recompris dans les termes d’une dynamique de constitution d’un champ de formes-valeurs.
Se pose alors la question d’intégrer à l’épistémè dynamiciste ici assumée les principes que nous venons d’exposer. Nous avons abondamment discuté plus haut les limites des dispositifs morphodynamiques. Ce type d’approche toutefois n’est pas entièrement dénué de prise sur la question de la sémiogenèse, auquel il peut offrir un premier cadre d’exploration et de détermination. On a en effet voulu montrer dans des travaux antérieurs (cf. Piotrowski 1997, 2010, 2013) que la théorie saussurienne du signe, dont certains des principaux concepts, de nature topologique et dynamique, trouvent dans l’approche morphodynamique une expression mathématique adéquate, se laissaient caractériser en ces termes au format d’un “ diagramme ” qui discerne différentes phases d’un déploiement sémiogénétique, se résolvant et s’annulant dans les pôles achevés du signifiant et du signifié (cf. figure page suivante — diagramme introduit et discuté dans les travaux ci-dessus référencés).
8 Une telle notion d’explicitation a été en effet travaillée dans le cadre du courant dit herméneutique de la phénoménologie (Heidegger, Gadamer, Ricœur). Nous pensons toutefois qu’il est nécessaire de la reprendre dans un cadre d’emblée sémiotique, qui n’en appelle pas à un fond premier libre de toute teneur, héritage ou enjeu sémiogénétiques. En même temps il convient de maintenir le principe, de filiation husserlienne, d’un primat de la perception. Cela implique en somme une profonde réorientation sémiotique de la phénoménologie — l’œuvre de Merleau-Ponty en fournissant un point de départ. En retour, on pourra d’autant mieux soutenir la nécessité d’une intégration forte de fondements phénoménologiques à la linguistique, comme sans doute à toute sémiotique.
12
Au compte des apports de la morphodynamique, il faut noter ici qu’un tel diagramme, qui n’est pas
sans signification fonctionnelle, tisse une intelligibilité ne se réduisant pas à celle de modèles fonctionnalistes (enchainements d’opérations produisant une succession d’objets mentaux de différentes natures). Le point essentiel par lequel le diagramme morphodynamique se démarque des architectures fonctionnelles et computationnelles réside dans ce qu’il administre en son point “ aboutissant ” l’émergence de régimes différentiateurs instituant des signifiés, et donc administre l’existence versus l’absence de contenus sémiolinguistiques. C’est cette caractéristique qui confère à l’architecture morphodynamique du signe saussurien une teneur holiste qui n’est pas sans la rapprocher de la problématique des champs gestaltistes. En effet, un tel diagramme est à comprendre, non plus, donc, comme une série d’opérations unidirectionnellement orientée, qui débuterait au niveau d’entrée des phonèmes et aboutirait à la production d’un contenu signifié (ainsi que par défaut le représente la figure ci-dessous qui fatalement en appauvrit et dénature la portée)9, mais comme une totalité systémique qui appréhende dans un seul et même moment structural différentes matières de contenu et d’expression, pour y instituer, suivant des jeux de déterminations réciproques, des identités sémiotiques E/C, et ainsi rendre compte de la “ consubstantialité ” des deux faces du signe. Mais plus encore, ce diagramme morphodynamique, travaillant différentes matières, y institue des positions relationnelles et fonctionnelles suivant un gradient d’abstraction, qui distribue des engagements sémantiques de détermination croissante, et corrélativement, des phases de conscience sémiotique dont la série restitue en première approche le mouvement sémiogénétique de polarisation du signe en signifiant et signifié. On peut en effet, à un stade premier de la sémiogenèse, distinguer la simple position diagrammatique d’un contrôle, abstraction faite de son identité spécifique et même de son effectivité. Cette position institue une simple conscience de “ disponibilité ” sémiotique : le matériau phonétique se trouve ici porté au seuil du sens : il ne signifie rien, mais se présente comme disposé à participer d’un sens à venir lorsque, dans le discours, il aura trouvé sa place pour former un signifiant. Augmenté de sa fonction de contrôle, mais toujours abstraction faite de l’orientation spécifique de cette dernière, l’état de simple disponibilité se trouve porté en état d’” engagement ” au sens : à ce 9 Une part de la difficulté revient à représenter des états dynamiques non stabilisés et cependant déjà quelque peu qualifiés au plan des physionomies sonores et sémantiques.
F : Espace interne de dynamiques
fH
A H
B
K
fA fB
m1 m1 m1
m2 m2 m2 σ
β α #
Syntagmatique & Paradigmatique
Système Linguistique
Substance du Contenu (SdC)
Substance de l’Expression (SdE)
σ : contrôle de SdC → F # : différence « distinctive » : différence « négative »
13
stade, la matière phonique est promue en signe en tant qu’elle ouvre sur du sens mais sans détermination encore de ce dernier. Au stade d’intégration diagrammatique suivant, l’identité spécifique de la fonction de contrôle se trouve prise en considération, et le signifiant se trouve ainsi chargé d’un contenu en propre mais aux contours encore fluctuants. C’est seulement dans la phase de complexité supérieure, lorsque la fonction de contrôle exerce plus avant son office et détermine des seuils différentiateurs dans la substance du contenu, donc des identités négatives de signification, que le signifiant renvoie à un signifié spécifique auquel, par ailleurs, comme il en contrôle l’émergence, il se trouve consubstantiellement rattaché.
En somme une telle diagrammatique ressaisit et scande à travers ses différents “ états ” l’émergence d’une différentiation couplée d’expression et de contenu susceptible de se développer sans qu’un terminus ad quem ni même quelque régime catégorial définitivement arrêté ne vienne l’orienter a priori. Même si, en vertu d’habitudes très contestables, on peut être tenté d’en limiter l’application au cas de la reconnaissance d’unités “ régulières ” (lexèmes ou même constructions), on y verra bien plus généralement une parmi les composantes dynamiques de formation d’un champ sémiotique, par essence soumis à d’autres suggestions de signe et sens, débordant la seule mise en syntagme (ainsi qu’en attestent manifestement les régimes poétiques du langage).
4 . Diagrammatisation et mathématisation dans une conception sémiogénétique
Il n’est pas question d’aborder véritablement dans les limites de cet article l’examen d’une linguistique phénoménologique de la parole et de ses principaux attendus. Nous n’en retiendrons ici que l’exigence d’une dimension sémiogénétique : toute intelligibilité sémiotique doit se construire à travers les moments et les phases principales de sémiogenèses qui lui correspondent, entendant par là les “ moments ” ou “ phases ” principaux de différentiation des formants sémiotiques (expression et contenu) qui lui correspondent.
Non sans rapport avec notre conception du sémiotique et considérant (cf. supra) que connaître, en matière de sémiotique, s’identifie à un procès sémiotique particulier par lequel se trouve institué et méthodiquement retracé un champ de phénomènes, nous prenons parti pour une épistémè de l’explicitation que nous distinguons donc d’une épistémè de la détermination d’objet (qui cependant pourra valoir pour des champs corrélés, par exemple en neurosciences, en restant attentif à la nature de la corrélation).
Dans cette épistémè de l’explicitation, dont la portée déborde celle des disciplines sémiotiques10, connaître c’est expliciter ensemble l’” acte ” et l’ “ objet ” de la connaissance, sans jamais perdre de vue leur dépendance réciproque au sein d’un dispositif sémiotique et pragmatique11. Dépendance qui conduit alors à prendre des distances vis-à-vis de tout programme de réduction des phénomènes à une détermination d’objet aussi bien que vis-à-vis de toute tentative de formalisation exhaustive des opérations de la connaissance. Non pas évidemment que nous récusions l’horizon d’objectivation de la démarche scientifique, mais nous voulons nous départir de l’idée d’une détermination possible (au sens kantien) d’une d’objectivité dont on reconnaîtrait par ailleurs qu’elle comporte une part phénoménale irréductible, en vertu même de sa dimension de sens (et du reste il faut réciproquement reconnaître que cette même dimension de sens, en tant que passant par la médiation sémiotique, ne peut être ni constitution ni simple donation mais toujours institution et rencontre, tracé d’interprétations à travers une phénoménologie de passages, et non de simples présentations). Pour toutes ces raisons d’autres dispositifs de réflexion et de figuration seront ici opérants.
Expliciter ensemble l’acte et les objets du connaître signifie avant tout les rendre plus clairs, plus manifestes, plus articulés, et finalement les faire exister comme des appuis nouveaux pour l’interprétation et l’action. Théoriser, dans cette perspective, se conçoit plutôt comme la proposition
10 Voir par exemple la discussion liée sur les constructivismes (Visetti 2004a). 11 Il importe alors de distinguer ces actes de ceux d’une conscience constituante transcendantale, et de se rappeler que ces “ objets ” sont tout à la fois conditions, formes, et modalités d’un champ phénoménal. Ainsi on comprendra le devenir mutuel des “ actes ” et des “ objets ” dans les termes d’une modalisation réciproque des appareils sémiotiques et des acteurs de la connaissance.
14
d’un canevas, d’un format générique pour une pensée herméneutique modélisante, tenant-lieu toujours provisoire pour un horizon d’explicitation. Cela reste de part en part exercice sémiotique, conscient de ses modalités “ énonciatives ” et de la dépendance vis-à-vis de conditions herméneutiques/ pragmatiques spécifiques.
D’où, s’agissant en tout cas des disciplines sémiotiques, la distance prise vis-à-vis des conceptions historiques de la théorisation comme élaboration d’un métalangage formel, notion souvent associée à des types épistémologiques incompatibles avec la perspective ici esquissée. Nous ne recherchons pas en effet des théories qui s’appliqueraient mécaniquement à un objet réduit, mais plutôt des théories qui définissent un type de thématique scientifique, une méthode générale de mise en forme de l’analyse, qu’il faut reprendre et transposer à chaque étude nouvelle. Récuser ainsi la perspective d’un métalangage, ce n’est pas nécessairement, par exemple, se passer de tout glossaire, mais le considérer, si besoin est, non comme un ensemble conceptuel épuisant son objet, mais comme un index, ou un dictionnaire de figures locales, pour une famille de genres sémiotiques (pour un “ discours ”, si l’on veut).
Notons en passant l’ambivalence présentée par bien des appareils théoriques solidarisant étroitement vues épistémologiques et dispositifs de modélisation. Ainsi, encore, de la TC qui ayant avancé une certaine forme du topologique-dynamique comme répondant qualitatif du géométrique-mécanique se trouve faire pont entre lois déterminantes et principes réfléchissants, entre interprétation du dynamicisme comme générativité (immanence et détermination d’objet) et interprétation comme généricité (reconnaissance par rattachement à une signification). Nous tenons cette équivoque pour authentique et féconde, sous la condition toutefois de la comprendre dans le cadre d’une épistémè de l’explicitation opérant à la jonction des sciences de la nature et de la culture.
Pour ce qui est par exemple des modèles dynamicistes, on se gardera de leur attribuer simplement le sens d’une reconstruction causale. Le temps des dynamiques de “ constitution des signes et du sens ” n’y renvoie pas à quelque processus physique ou psychologique avéré (ni davantage à quelque principe génératif abstrait, par lui-même déterminant pour un domaine d’objets) : il représente d’abord le temps d’une prise d’effet, d’une détermination mutuelle progressive, de différents aspects émergents. C’est le temps d’une herméneutique rationnelle qui cherche à matérialiser sa propre progression. Historiquement, les stabilisations sur des attracteurs en sont des moments privilégiés, correspondant à un équilibre atteint dans la pesée réciproque de tous les facteurs. Cela n’exclut pas, bien sûr, qu’une part de cette temporalité s’aligne sur celle d’une causalité parallèle (convenant, par exemple, à un modèle de neurosciences). Mais cette homologation signifie essentiellement indexation sur le temps physique, et localisation dans des dispositifs matériels, d’un flux d’interprétation qui ne fait que passer par là, dans la mesure où il s’appuie aussi, de façon essentielle, sur des règles et sur des concepts qui ne relèvent pas d’une légalité scientifique de type physique. De même, on acceptera que de tels modèles ne soient pas nécessairement rigoureusement situés relativement à des axes départageant l’individuel et le collectif, le psychique et le social, ou encore les vécus de conscience et les significations publiques, avec les diverses temporalités attenantes.
Il s’agira en somme de construire des appareillages dynamiques, du moins certaines composantes, ou phases, de ces appareillages, qui pourront être décrites sans que leur synthèse exacte au sein d’un éventuel processus ne soit elle-même déterminée. Modèles dont on dira qu’ils structurent le temps intime des sémiogenèses “ vives ”, en même temps qu’ils réalisent comme une sémiographie, ou stratigraphie, de ce qui se trame dans le temps long du dépôt, de la transmission, de la réinterprétation (Rosenthal & Visetti 2008).
Revenant de façon plus large à la question de la théorisation, nous souhaitons apporter un accent phénoménologique particulier à l’idée d’explicitation en confiant à l’appareil théorique la fonction d’un “ opérateur de phénomènes ”. D’une part, les généricités à reconnaître étant caractéristiques de champs de formes, le premier effet d’une telle reconnaissance devrait être de mieux saisir le champ, et littéralement de mieux le percevoir, à la lumière d’un certain projet gnoséologique concernant la signification : perception, par conséquent, autant que possible reconduite aux sémiogenèses qu’elle enveloppe. D’autre part, et plus profondément, les disciplines sémiotiques elles-mêmes n’ont pas affaire, comme nous l’avons dit, à des objets, mais à des champs-matrices, qui s’organisent de façon indéfiniment variée suivant les horizons de signification qu’ils peuvent recevoir. Ainsi, en
15
métabolisant en permanence leur propre engagement dans de tels champs, ces disciplines y précipitent comme des “ tracés ” qui prennent pour elles valeur de données.
Se pose alors la question des critères de réussite pour une théorisation en sémiotique, toujours à considérer sous l’angle de son appareillage (incluant notations, figures, canevas descriptif, modèle analytique …). De notre point de vue, la réussite d’une théorisation tient à autre chose qu’à la classique confrontation à l’empirique suivant le régime hypothético-déductif. Elle tient, déjà, bien sûr, à la fonction (essentielle) d’un guide pour des relevés comparatifs, au fouillé analytique ou aux vues d’ensemble qu’ouvre son usage, mais aussi à une illumination particulière du plan de l’expression, à une façon de le dessiner qui en rehausse les reliefs, les accents, le place dans un réseau de réminiscences : en somme une méthode, un exercice raisonné, conditionnant un nouvel apparaître. La question préliminaire d’un “ langage théorique ” n’est donc pas seulement que voulons-nous/pouvons-nous savoir ?, ou encore comment délimiter le plan de phénomènes soumis au mouvement d’objectivation ?, elle est aussi à quoi voulons-nous nous rendre mieux sensibles, à quoi devons-nous prêter attention ?
Connaître, dans ce registre, reviendra ainsi en grande partie à retracer méthodiquement des “ diagrammes ” organisant un champ de phénomènes, pour, à travers ce que nous avons appelé une sémiographie, donner forme à la sémiogenèse. C’est donc à partir de cet enjeu ainsi reformulé d’une diagrammatisation de la sémiogenèse que nous voudrions pour finir reprendre la question de la mathématisation.
On sait la richesse des travaux accomplis, souvent dans une lignée peircienne, sur les dimensions diagrammatiques (plus généralement iconiques) de la sémiose, et sur les fonctions essentielles que les diagrammes (au sens courant du terme) jouent dans les dispositifs de connaissance – notamment dans les mathématiques (cf. Bordron, Chauviré, Dondero, Fontanille). Sans entrer dans toute cette complexité nous résumerons ici la perspective sous laquelle nous envisageons l’opération de diagrammatiser, et le sens diagrammatique, dans les domaines qui nous concernent.
D’une façon générale nous voudrions penser la diagrammatisation sans la réduire – bien au contraire –, à l’image déjà discrétisée, souvent statique, ou alors intégralement reconstructible par assemblage, qu’en donnent les tableaux et les réseaux de termes et de relations bien catégorisés, d’usage courant dans bien des disciplines. C’est que, d’abord, nous voudrions parler de diagrammatisation (concept génétique), et non de diagrammes, qui n’en sont que des lieux ou des moments-clés, émergeant d’un arrière-plan expressif et praxéologique, lequel n’est pas que dispositif iconique. Nous ne nous préoccuperons pas non plus de placer notre réflexion dans la suite rigoureuse de quelque doctrine que l’on aurait tirée de l’œuvre de Peirce, en effet essentielle sur ce sujet, et dont on ne manquera pas, de fait, de recouper les conceptions dans les quelques lignes qui suivent (cf. par exemple Paolucci 2010).
L’inspiration première d’une diagrammatisation, pour nous, serait celle d’une opération à même le champ sémiotique, entrainant comme un épaississement effectif et des modulations originales, et permettant par là d’y faire surgir de nouveaux ensembles ou de nouvelles formations significatives : à la façon d’une peinture ou d’un texte dont on souligne la composition et les motifs et que l’on place dans un réseau de réminiscences et de variations. Soulignons qu’il ne s’agit pas ici simplement d’adjoindre un appareil notationnel, mais de rendre manifeste, à même un plan d’expression, une rencontre entre généricités (variétés de configurations typifiantes) et présentations singulières (repérées par conformité et mise en tension auxdites configurations) : dialectique constitutive, sous un certain régime de connaissance, d’un procès de déploiement/reconnaissance de formes.
Pour mettre en place jusque dans les disciplines sémiotiques les notions de diagramme et de diagrammatisation, il n’est pas inutile de rappeler leur diversité de fonction et de statut, encore une fois non toujours dépourvus d’ambigüité.
Pourquoi en effet proposer des diagrammes, et comment leurs rôles se modulent-ils suivant l’accent (épistémologique, analytique, descriptif…) choisi ?
À un premier niveau, où se dessinent ensemble langage et imaginaire scientifiques, on écartera sans doute l’idée de diagrammes valant comme plans, organigrammes, ou machines abstraites. Ces diagrammes ne présenteront pas nécessairement, non plus, le mixte de précision et de stylisation caractéristiques de planches d’anatomie, ou de dessins d’architectes, susceptibles de valoir comme des grilles de perception directement opératoires. Ils s’apparenteront peut-être d’abord à des résonateurs, à
16
des figures susceptibles de faire écho à d’autres, d’origine philosophique ou ludique, traditionnellement évocatrices d’un univers de formes et de problèmes. On a ainsi souvent comparé le jeu d’une telle diagrammatique à celui de la métaphore, ou plus simplement à l’analogie. Comme d’ailleurs cela a été dit de la modélisation en général, il s’agirait alors d’une fiction, plus ou moins surveillée. Sans doute, mais à la condition de souligner que cette fiction est d’abord une figuration plurivoque, vouée à plusieurs jeux sémiotiques, dont chaque lecture pourrait redéfinir le nombre et les règles. En physique, ou en mathématique, on a pu y voir une symbiose de l’image et du calcul, du dessin et de la notation : à la fois perception directe, synopsis, base de constructions, et réserve de virtualités susceptibles de faire surgir de nouveaux questionnements. La grande richesse d’exemples dans ces domaines permet de retrouver un large spectre de fonctions et de modes de vie du diagramme dans la pensée, différents sans doute de ceux que l’on attend de l’ingénieur ou de l’architecte : à une extrémité, motif formel indéfiniment répété et stabilisé dans son apport, le diagramme devient, à l’autre, passage critique, forme en gestation, insight vécu au ralenti. On retrouve dans cette dernière guise la notion de motif-diagramme avancée par Deleuze, certes dans des cadres différents, qui l’éloignent des régimes sémiocognitifs et pragmatiques favorisés par nombres d’analyses peirciennes12.
Débordant alors l’acception traditionnelle, qui en ferait l’icône d’un jeu arrêté de termes et de relations, ou bien la simple représentation graphique d’un processus, un diagramme, ou plutôt une diagrammatisation, naît de la différentiation d’un ensemble opératoire au sein d’une figure en devenir, travaillée à la façon d’une matière première : différentiation donc de lignes, de zones, de points singuliers et de motifs non délimités, à travers lesquels se profile comme une articulation fonctionnelle, canalisant l’advenue de toute une série d’autres figures. À la fois geste, forme, et trace-ouverture d’un avenir, le diagramme, en ce sens que l’on pourrait dire deleuzien, mais aussi merleau-pontien, précipite une histoire singulière, ou tout aussi bien, inaugure une série générique de variations, fondant ainsi une “ dynastie de problèmes ”, ainsi que le disait Châtelet dans son livre sur Les enjeux du mobile.
Une condition pour cette acception élargie de la diagrammatisation est sans doute que le diagramme ne se sépare jamais des figures qui le portent ; c’est-à-dire qu’on ne puisse exactement, ou définitivement, arrêter ce que de la figure il capte, ingère, et métabolise en projet. Cela n’empêche pas, cependant, que des formalisations puissent ultérieurement prendre le relais, si quelque profil bien circonscrit s’en dégage.
Mise à l’épreuve d’une pensée qu’il spatialise sur un mode imaginaire, et peut-être substitut provisoire d’une schématisation à concevoir, un diagramme, même si en apparence il n’est pas annoté, ne peut fonctionner sans une légende, ou une esquisse de “ dramaturgie ”. Il y a toujours une textualité, une lexicalité, qui soutient l’épure scénographique du diagramme, et participe à la mise en place de ses usages.
Pour soutenir notre propos, évoquons rapidement quelques cas ou intentions de diagrammatisation en sémiolinguistique et sémantique, avec les ambivalences qui les accompagnent.
1) De Greimas à Rastier. Dans les années 1960, Greimas programmait d’élaborer ce qu’il appelait une sémiotique formelle, à côté d’une sémantique interprétative :13 mais il n’en propose guère
12 Par exemple Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, dont on extraira juste la citation suivante, fort éloquente [105] : “ Le diagramme, c’est exactement ce que Cézanne appelle le motif. En effet, le motif est fait de deux choses, sensation et charpente. C’est leur entrelacement. Une sensation, ou un point de vue, ne suffisent pas à faire motif : même colorante la sensation est éphémère et confuse, elle manque de dureté et de clarté (d’où la critique de l’impressionnisme). Mais la charpente suffit encore moins : elle est abstraite. A la fois rendre la géométrie concrète ou sentie, et donner à la sensation la durée et la clarté. Alors quelque chose sortira du motif ou du diagramme ”. Sur ces questions, voir l’ouvrage édité et introduit par Batt (2004). En dépit (selon nous) d’une différence significative, les deux notions, peircienne et deleuzienne, ont ceci de commun qu’elles sont tournées vers un “ non encore pensé ” travaillé à même du sensible : support de modulations/métamorphoses (Deleuze) ou support de constructions synthétisant du nouveau, ou à caractère heuristique (Peirce). 13 “ À côté d’une sémantique interprétative dont le droit à l’existence n’est plus contesté, la possibilité d’une sémiotique formelle qui ne chercherait à rendre compte que des articulations et des manipulations des contenus quelconques se précise un peu plus chaque jour ” (Greimas, 1970:17). Sémiotique formelle, dont la
17
d’amorce, si l’on excepte le célèbre carré sémiotique – initialement un travail en collaboration avec Rastier. Ce dernier, dans la suite de son itinéraire ne reprend pas à son compte ce projet d’une sémiotique formelle, mais étaye fréquemment ses analyses de tableaux, ou de diagrammes, passablement évocateurs (imités par exemple des graphes conceptuels de Peirce-Sowa, ou même, ensuite, des diagrammes de la TC). Mais il s’agit plus d’une notation libre, jouant sur des configurations spatiales donnant à voir des positions, des ensembles et des rythmes. Cette notation agrège aussi ces éléments pseudo-algébriques que sont les sèmes, rémanence de l’idée d’un système, ou tout au moins d’un ensemble d’éléments, que l’on pourrait disposer dans une notation cohérente, renouant ainsi fugitivement avec l’illusion d’un métalangage. Les figures qui en résultent rendent certes plus intuitif le dispositif conceptuel mais ne semblent toutefois pas offrir une synthèse à laquelle pourraient s’appuyer des prolongements inédits. Sans doute pour cela aurait-il fallu repenser le concept de sème et lui reconnaitre une formalité autre, mieux en phase avec la problématique ultérieure des “ formes sémantiques ”.
2) Diagrammes de Langacker. Expression et Contenu y sont pris en charge, mais simplement accolés sur le mode d’un couplage mentaliste, et en tout état de cause, sans apparaître comme des moments dans un procès de différentiation global. La problématique se veut non générativiste mais paradoxalement toutes les analyses reconduisent une problématique lexico-grammaticale qui assemble et recolle des unités linguistiques présegmentées et de types largement prédéfinis. La diagrammatique de Langacker est exceptionnelle de fidélité et de systématicité vis-à-vis de sa théorie, qui lui doit une part de son grand succès et en même temps son enfermement dans une problématique naïvement spatialiste. Les diagrammes de Langacker font doublement résonner l’imaginaire du linguiste : d’une part dans le recours à une méréologie simplifiée du champ visuel en tant qu’il serait configuré par l’énoncé, et, d’autre part, dans l’application parallèle de ces mêmes concepts “ perceptivistes ” à la structure sémiotique de l’énoncé (permettant notamment de réinterpréter l’organisation en constituants…). Mais deux carences majeures bloquent très vite ce jeu diagrammatique. D’une part, comme on a dit, aucune place n’est faite à une sémiogenèse comportant différentiation en phases, dynamiques de motivation, transitions à travers une variété de formants (ainsi les formants expressifs, peu travaillés, ne font que délimiter les constituants ordinaires de la tradition grammaticale). Et, d’autre part, la dimension textuelle se trouve omise ou renvoyée à des formations thématiques sur lesquelles la diagrammatique n’a pas prise. Les dimensions valorisées par les motifs-diagrammes deleuziens, tout comme celles mises en œuvre dans les diagrammes constructivistes peirciens (extensions, heuristiques) sont absentes.
3) Diagrammes d’analyse de données : à la différence des deux cas précédents mettant en avant certains auteurs précis et dont la théorie ne comporte pas de développements mathématiques, on pense ici aux innombrables méthodes de calcul et de présentation de données reposant sur différents procédés matriciels14. Ces méthodes passent en général par un formatage et une catégorisation préalables des données étrangers à toute idée de sémiogenèse. L’objectif est celui d’un rendu graphique et/ou géométrique servant des intuitions de proximité, de similarité, de densité, de polarité… Une fois admis ce cadre herméneutique général, la simple vision de ces diagrammes, fruits d’un calcul dont les motivations phénoménologiques dans le champ original restent opaques, concourt à stabiliser et à ordonner un ensemble d’index constituant (pense-t-on) une sémiologie de substitution acceptable. Plus avant, elle sert à suggérer des classifications et des corrélations, dans un sens aussi bien attendu, et confortateur, qu’inattendu, et alors interrogateur. Mais là s’arrête la portée du dispositif mathématique et de son rendu diagrammatique. S’il en est ainsi, sans doute, c’est que les intuitions premières par rapport aux plans de sémiotisation sont d’emblée dégradées en paramétrages et segmentations passablement arbitraires. Reste que les schèmes mathématiques employés ne sont pas dénués de toute pertinence par rapport à un projet d’organisation général, revenant à des catégories de
fonction serait ainsi de dégager “ les cadres formels à l’intérieur desquels les contenus pourront être versés et correctement analysés ” (ibidem:199). 14 Concernant les modélisations du lexique, on mentionnera par exemple les travaux de Ploux & Victorri et Gaume.
18
classification ou de rangement, qu’ils schématisent bel et bien, en un sens, à travers la mise en scène formelle de distributions et de repères dans des espaces vectoriels.
4) Un dernier cas de figure est celui déjà amplement discuté de la TC comme partie intégrante d’une théorie des formes et des structures. Nous n’y revenons que pour souligner les aspects suivants. La TC a d’emblée été conçue pour procurer un schématisme convenant à des catégories de forme et de structure en même temps qu’à certaines conditions jugées transcendantales d’une intuition de ces formes et structures. En tant que corps de savoir mathématique elle s’inscrit au sein d’un ensemble bien plus vaste et ouvre sur une grande diversité de schèmes génériques susceptibles, peut-on penser, de rencontrer des régimes de formation très variés, cela quand bien même les notions de champ et de forme viendraient elles-mêmes à évoluer. Rien d’étonnant à cela si on se souvient de ce que ces mathématiques restent profondément liées aux dimensions intuitives du mouvement et du sensible, et elles-mêmes s’accompagnent dans leur travail d’une diagrammatique de même nature. Enfin, l’idée physico-mathématique d’” états dynamiques ” (états de phase en physique) a semble-t-il une portée universelle s’il s’agit de schématiser ou au moins de figurer un procès de différentiation dans une “ matière ” quelconque.
5. Conclusion Après ces brèves mises au point, et revenant à notre propos général, nous proposerons à titre de
conclusion ouverte les considérations suivantes. Dès lors qu’une problématique de la diagrammatisation dans les champs sémiotiques nous éloigne de toute reprise de la problématique kantienne du schématisme, le rôle de la mathématisation doit se comprendre sous un jour différent. La détermination portée par les mathématiques ne sert pas à convertir le phénomène en objet. Son rôle est de produire la part démontrable, constructible, d’un dispositif diagrammatique. Mais un tel “ schéma ” ne peut plus correspondre au concept d’imagination de la philosophie kantienne : ce dernier a pour fonction de procurer à chaque concept son intuition, c'est-à-dire d’assurer une médiation entre deux régimes de formation extérieurs l’un à l’autre, à savoir l’entendement et la sensibilité. Rien de tel ici. Ce que l’on pourrait éventuellement nommer imagination, c’est très généralement un procès de “ fictionnement ”, définissant le lieu d’une rencontre pratique, sensible et diagrammatiquement organisée entre deux jeux sémiotiques : celui de la mathématique, d’une part, celui de l’enquête sémiotique, d’autre part, chacune avec ses formes et principes propres. Le diagramme est donc une tentative d’hybridation, au statut foncièrement incertain, entre détermination et figuration, entre postulation et enregistrement, qui institue ou prolonge une tradition d’homologation entre certaines composantes de l’appareil mathématique, et la forme (composition, architecture, procès…) prêtée à, ou captée dans, un parcours sémiogénétique.
On conçoit bien sûr l’extrême difficulté du défi : une sémiogenèse est avant tout une émergence et un déroulement de formants-valeurs reconnus autant que possible dans l’épaisseur croissante d’un champ d’expression. Et on doit se demander en quoi les mathématiques sont à même non pas tant de légitimer mais d’étayer, au moins d’appuyer, ce mouvement de dévoilement, d’aider à expliciter certaines lignes de force d’une telle émergence. L’avantage à cet égard des modèles continuistes et dynamicistes que nous privilégions se laisse décliner au travers d’une série de traits familiers aux approches sémiotiques perceptivistes, pour lesquelles les plans de contenu comme d’expression se laissent appréhender dans les termes d’une “ perception généralisée ”, dont les caractéristiques (au moins spatiales et temporelles) motivent directement une diagrammatisation (prise alors au sens large et non technique du terme). Les mots clés suivants en témoignent sans doute suffisamment, au niveau d’abstraction d’une pensée dynamiciste générale qui constitue de nos jours le meilleur lieu scientifique commun pour une pensée du devenir : flux, spatialité, temporalité, phase, émergence, gradualité, différentialité, couplage, dialectique continu/discontinu… (cf. par exemple Visetti 2004a, 2004b). C’est tout un imaginaire transversal aux sciences de la nature et de la culture qui réside dans ces modèles, et qui peut motiver des constructions théoriques sans mathématisation explicite, certes, mais avec néanmoins un pouvoir de description suffisamment systématique qui repose en filigrane sur une diagrammatisation de même facture (cf. Cadiot & Visetti 2001).
19
Un problème demeure cependant : nous avons parlé plus haut d’homologation et de diagrammatisation comme se nourrissant réciproquement, et soutenant une connaissance par explicitation, distincte d’une connaissance par détermination d’objet. À quels critères soumettre alors une telle forme de connaissance : comment juger de la légitimité de ses principes, comme d’ailleurs de la justesse de ses “ résultats ” ? L’intervention des mathématiques ne peut plus ici être invoquée en soutien d’un régime hypothético-déductif tourné vers l’expérimentation, ni même comme détermination première d’un champ d’objets. Elle n’en reste pas moins gage de rigueur et de méthode dans la part prise à l’élaboration des diagrammes, qui héritent alors d’une certaine puissance constructive et d’un pouvoir d’universalisation (non au sens d’un surplomb mais à celui d’un partage avec d’autres champs disciplinaires).
Ces valeurs, indéniables, restent cependant subordonnées aux enjeux de sens auxquels se trouve confrontée l’enquête scientifique. Celle-ci, en effet, ne se sépare pas d’une exigence de signification que tout appareil théorique doit rencontrer, serait-ce pour la décevoir. Ce que nous avons appelé diagrammatisation voudrait s’inscrire à la jointure de cette exigence et des impératifs théorétiques. Cependant, l’idéal scientifique reste marqué par l’idée d’une communication impersonnelle, ou plus concrètement par une confrontation entre pairs rivalisant dans la construction d’un “ juste impersonnel ” : l’appel à toute idiosyncrasie d’auteurs, d’œuvres, de circonstances est censément exclu. Si cependant sens ou signification ne sont pas des objets, mais doivent être explicités, peut-on se passer en ultime instance d’une dimension cruciale qui serait celle de l’attestation, revenant à quelque Sujet de la science ? Un sujet de la science, qui ne soit ni individu ni impersonnel, ni je ni on, mais institution énonciative mobilisant et identifiant un pour-nous des sujets auteurs et destinataires du savoir.
Aménageant en quelque sorte le principe de la connaissance issu de la phénoménologie husserlienne, on pourra dire, reprenant ici les termes de la discussion menée par J-M. Salanskis dans l’ouvrage Usages contemporains de la phénoménologie (2008 :260-284), que connaître un “ objet ” ce serait restituer ses modalités de constitution pour nous, un pour-nous qui apparaîtrait à la fois comme instance pratique, énonciative et expérientielle. Le texte de Salanskis, dans le détail duquel nous n’entrerons pas ici, analyse en réalité un double désir, celui d’une attestation et celui d’un fondement, caractéristique selon lui des divers projets phénoménologiques. Il énonce ainsi une première version de l’attestation, qui semble liée au rapport intime que toute conscience entretient avec le flux de ses vécus. Ainsi : “ Il n’y a pas de discours qui ne soit comptable devant une expérience – c’est-à-dire une évidence susceptible d’être avouée – et le fond de tout propos ne tient que dans la limite de cette garantie ” (Salanskis 2008 :267). D’autres versions de l’attestation sont ensuite examinées, à la faveur d’une confrontation à d’autres programmes philosophiques (phénoménologiques ou non) qui majorent la part du langage : par exemple comme diction de l’événement de l’apparaître (Heidegger), ou comme possession conjointe de la signification et de la vérité dans l’énoncé (philosophie analytique). Salanskis offre aussi sa propre version, en cela qu’il conçoit l’avenir de la phénoménologie dans l’ouverture de son milieu d’investigation et de témoignage au triple champ des vécus, du langage et des pratiques, milieu constituant alors ce qu’il désigne sous le nom d’ethos.
On acquiescera bien volontiers à l’équilibre de cette dernière formulation, mais sous la condition sans doute d’un léger décalage. Le milieu dans lequel nous voyons installés les sujets d’une telle expérience de l’ethos nous apparaît sémiotique de part en part, dans une acception large du terme qui déborde la seule activité de langage. La texture même des vécus ou des pratiques enveloppe ainsi des sémiogenèses, actuelles comme imminentes, dont on ne la sépare pas. Plus encore, toute reconstruction reste tributaire des tribulations et transactions sémiotiques dont on attend cependant qu’elles aboutissent, quand bien même provisoirement, à la cristallisation des enjeux de sens en significations communes. C’est à cela et rien davantage que contribue avec ses pouvoirs propres l’expérience diagrammatique dans les disciplines sémiotiques.
20
Bibliographie
Batt, N. (éd.) 2004 « Penser par le diagramme, de Gilles Deleuze à Gilles Châtelet », Théorie Littérature Enseignement, 22. Bordron, J.F. 2013 Image et vérité. Essais sur les dimensions iconiques de la connaissance, Liège : Presses universitaires de Liège. Brandt, P.A. 1992 Charpente modale du sens: Pour une sémiolinguistique morphogénétique et dynamique, John Benjamins. Cadiot, P., Visetti, Y.-M. 2001 Pour une théorie des formes sémantiques – motifs, profils, thèmes, Paris : Presses Universitaires de France. Chauviré, Ch. 2008 L’œil mathématique. Essai sur la philosophie mathématique de Peirce, Paris : Editions Kimé. Dondero, M.G., Fontanille, J. 2012 Des images à problèmes. Le sens du visuel à l’épreuve de l’image scientifique, Limoges : Presses Universitaires de Limoges. Greimas, A.-J. 1970 Du sens, Essais sémiotiques, Paris: Le Seuil. Paolucci, C. 2010 Strutturalismo e interpretazione. Ambizioni per una semiotica « minore », Milano, Bompiani. Petitot, J. 1985a Les catastrophes de la parole, Paris: Maloine.1985b Morphogenèse du sens : 1, Pour un schématisme de la structure, Paris : PUF.1992 Physique du sens : de la théorie des singularités aux structures sémio-narratives, Paris : Editions du CNRS. Piotrowski, D. 1997 Dynamiques et Structures en Langue, Paris : Éditions du CNRS.2009 Phénoménalité et Objectivité Linguistiques, Paris : Honoré Champion.2010 “Morphodynamique du signe ; I – L’architecture fonctionnelle”, in Cahiers Ferdinand de Saussure, n. 63:185-203.2011 “Morphodynamique du signe ; II – Retour sur quelques concepts saussuriens”, in Cahiers Ferdinand de Saussure, n. 64: 101-118.2012 “Morphodynamique du signe ; III – Signification phénoménologique”, in Cahiers Ferdinand de Saussure, n. 65: 103-123.2013 “L’opposition sémiotique/sémantique comme articulation de la conscience verbale”, in Versus, n. 117: 27-52. Rosenthal, V. 2004a “Microgenesis, immediate experience and visual processes in reading” in A. Carsetti (Ed.) Seeing, Thinking and Knowing: Meaning and Self-Organisation in Visual Cognition and Thought. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 221-243. 2004b “Perception comme anticipation : vie perceptive et microgenèse” in R. Sock et B. Vaxelaire (Eds.) L’Anticipation à l’horizon du Présent. Liège, Mardaga (Collection Psychologie et Sciences Humaines), 13-32. Rosenthal, V., Visetti, Y.-M. 2008 “Modèles et pensées de l’expression: perspectives microgénétiques”, Intellectica, n. 50: 177-252.2010 “Expression et sémiose – pour une phénoménologie sémiotique”, in Rue Descartes, n. 70: 26-63. Sebbah, F., Salanskis, J.M. 2008 Usages contemporains de la phénoménologie, Paris :Sens & Tonka. Thom, R. 1972 Stabilité structurelle et morphogenèse, Paris: Édiscience.
21
Visetti, Y.-M. 2004a “Constructivismes, émergences : une analyse sémantique et thématique”, inIntellectica, 2004/2, n. 39: 229-259. 2004b “Le Continu en sémantique – une question de Formes, Cahiers de praxématique”, n. 42: , 39-74. 2004c “Anticipations linguistiques et phases du sens”, in Sock, R. ;Vaxelaire, B., L’Anticipation à l’horizon du présent,Bruxelles: Mardaga: 33-52. Visetti, Y.-M . Cadiot, P. 2006. Motifs et proverbes – Essai de sémantique proverbiale, Paris, Presses Universitaires de France.