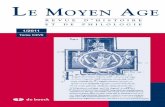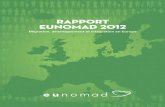70 Dossier I Diaspora arménienne et territorialités I La communauté arménienne de Thessalonique...
Transcript of 70 Dossier I Diaspora arménienne et territorialités I La communauté arménienne de Thessalonique...
70 Dossier I Diaspora arménienne et territorialités I
La communautéarménienne
de Thessalonique Organisation, idéologie, intégration
Par Ioannis K. Hassiotis, Professeur, université Aristote de Thessalonique
Pose de la première pierre de fondation de l’église de la vierge Marie, fin 1902. © D.R.
En 1881, la communauté arménienne de Thessalonique
ne comptait qu’une vingtaine de familles. L’ampleur
des variations démographiques et des mutations sociales qui
ont marqué le siècle suivant, puis l’intégration progressive à
la société hellénique reflètent toute l’histoire politique,
sociale et religieuse de la diaspora arménienne en Grèce.
I hommes & migrations n° 1265 71
On peut distinguer dans l’histoire moderne des communautés arméniennes del’espace hellénique deux entités temporelles distinctes : une période précoce, particu-lièrement longue, qui inclut la période de la domination ottomane ; une périodecontemporaine, du XIXe siècle à nos jours. Dans certains cas, ces deux entités s’entre-mêlent, présentant une continuité relative qui s’est imprimée dans l’histoire généalo-gique de certaines anciennes familles grecques et arméniennes. Toutefois, le caractèrefragmentaire de ces données et, surtout, les différences qualitatives et quantitativesentre les deux périodes ne nous permettent pas de les examiner ensemble.Nous situons donc conventionnellement le début de l’histoire moderne desArméniens de la Grèce aux premières décennies du XIXe siècle. C’est alors, en effet,que commencèrent à se constituer et à s’organiser les communautés arméniennesde Didymoteicho, qui se dota d’un lieu privé de culte en 1828 ; de Komotini, quifonda son temple en novembre 1834 ; puis, à partir de la seconde moitié du siècle,celle de Thessalonique, où nous disposons des premiers enregistrements dans lesregistres de la communauté, en mars 1881, des familles arméniennes établies defaçon permanente dans la ville.(1)
Des variations démographiques d’une grande ampleur
Le noyau identifié à l’origine était alors composé de 20 à 25 familles (70 à 80 per-sonnes)(2). D’après d’autres données datant de la même année 1881, le total desArméniens de la ville atteignait 157 personnes (201 selon d’autres sources)(3).Quelques années plus tard, en 1885, la communauté était composée de 35 famillesenregistrées (soit 183 âmes)(4). Dix ans après les premiers enregistrements, la popu-lation de la communauté avait doublé, pour atteindre 324 membres. Enfin, d’a-près le recensement ottoman de 1906-1907, le nombre des habitants arméniensde la région de Thessalonique s’élevait à 637 personnes, celui de la ville à 538
(5).
Ces écarts semblent dus au fait que tous les Arméniens de Thessalonique ne figu-raient pas dans les registres de la communauté – en particulier les Arménienscatholiques, sur lesquels il existe cependant des témoignages attestant alors leurprésence à Thessalonique. Par ailleurs, plusieurs Arméniens apostoliques ne rési-daient pas de façon permanente en ville et se déplaçaient dans les différentes pro-vinces de l’Empire ottoman(6).Lorsque les Ottomans furent chassés de Macédoine (1912) et que Thessaloniquefut incorporée au territoire grec, le nombre des membres de la communauté dimi-nua sensiblement. Ainsi, au début de la Première Guerre mondiale, seules 50 à
72 Dossier I Diaspora arménienne et territorialités I
60 familles (250 à 274 personnes) étaient enregistrées. Cette diminution pourraits’expliquer par le choix de certains Arméniens fonctionnaires de l’État de suivreles autorités ottomanes plutôt que de dépendre des autorités grecques qui les rem-placèrent. Néanmoins, quelques années plus tard, en 1917, la taille de la commu-nauté avait doublé (500 à 600 personnes). À la même époque, la population totaledes Arméniens de Grèce était estimée à 1 500 âmes(7).L’augmentation significative des membres de la communauté – ainsi que de la popu-lation arménienne totale de la Grèce – fut sensible après le désastre d’Asie Mineure.D’après les estimations, 85 000 réfugiés Arméniens auraient suivi les Grecs en 1919-1923 et quitté précipitamment la Thrace orientale, la Cilicie et, surtout, l’Ionie. Si lamajorité d’entre eux s’installa en Attique, un nombre important (10 000 à 11 000personnes) s’établit à Thessalonique(8). Ce nombre diminuera bientôt à la suite desmigrations vers l’Europe occidentale, l’Amérique et l’Arménie soviétique. En 1929,la communauté comptait approximativement 6 500 membres. Quinze ans plus tard,en juillet 1946, on dénombrait 6 010 Arméniens à Thessalonique. Au cours dumême été, on observa le “retour” en Arménie soviétique de 18 000 Arméniens, ce quireprésentait quasiment les deux tiers de la population arménienne de la Grèce. Parmieux, 4 600 étaient originaires de Thessalonique – soit les 5/6 de la communauté dela ville, qui ne conserva que 1 399 membres. Ce nombre diminuera encore à la suitedes migrations vers l’Occident (principalement à destination de la France, du
Canada et de l’Argentine). Ainsi, au début desannées soixante, la communauté comptait 1 100à 1 200 personnes (et celle de Grèce, 9 600 à9 700), nombre qui se maintiendra d’unemanière relativement constante jusqu’à la findes années quatre-vingt. Après la dissolution de l’Union soviétique et laproclamation de l’indépendance de la répu-blique d’Arménie, la communauté verra à nou-veau sa taille augmenter dramatiquement. Del’hiver 1988 jusqu’à l’année 2000, 18 000 à20 000 Arméniens ou Gréco-Arméniens seréfugièrent en Grèce, dont une grande partie en
Attique, 10 000 à 11 000 personnes s’installant dans la région de Thessalonique.Quelques milliers d’autres s’établirent dans les centres urbains de la Macédoineorientale et de la Thrace occidentale, redonnant ainsi vie à quelques-uns des plusanciens foyers arméniens de ces régions qui, après les départs de 1946-1947,avaient perdu la quasi-totalité de leur potentiel humain(9).
Les liens avec le
catholicossat
d’Etchmiadzine,
historiquement central
et toujours respecté,
se renforcèrent après
la déstalinisation
et plus encore après
l’indépendance de la
république d’Arménie.
I hommes & migrations n° 1265 73
L’arrivée massive de réfugiés entre 1919 et 1923
À la fin du XIXe siècle, les Arméniens de Thessalonique constituaient un échan-tillon caractéristique des sujets chrétiens et juifs du sultan qui favorisaient l’occi-dentalisation de la société ottomane. Les Arméniens de la ville travaillaientcomme mécaniciens, employés des sociétés des chemins de fer de l’Orient, ou despostes ottomanes et étrangères et des services forestiers, ou encore ils étaient méde-cins militaires ou pharmaciens. Ils étaient également présents dans le commerceet dans l’artisanat, en particulier dans les secteurs traditionnels de l’argenterie etde l’orfèvrerie. Certains étaient professeurs de langues étrangères ou dispensaientun enseignement technique dans les écoles ottomanes ; d’autres travaillaient entant qu’agronomes et scientifiques spécialisés à l’école d’agriculture (américaine)fondée en 1888 dans la partie est de Thessalonique(10). Cette image commence à se modifier après 1912. Au départ, comme on l’a vu, unepartie des Arméniens de Thessalonique, fonctionnaires des services de l’État, a pré-féré se déplacer avec l’administration ottomane vers d’autres parties de l’Empire.Les commerçants et les artisans toutefois, de même que certains fonctionnaires,choisirent de rester, représentant depuis une partie remarquable du monde desaffaires de la capitale macédonienne. Ce n’est pas un hasard si, en dépit de leurnombre restreint, les commerçants et artisans arméniens de la ville participèrent àla Foire internationale de Thessalonique dès 1926, année de son inauguration(11). Les grandes mutations sociales eurent lieu après l’arrivée massive, entre 1919 et1923, de milliers de réfugiés arméniens, misérables et sans logement. Dès cetteépoque et pendant environ trois décennies, la majorité des Arméniens deThessalonique survécut grâce au petit commerce et au revenu, maigre et précaire,d’un travail d’ouvrier non qualifié et saisonnier. Cette population vécut ainsi desconditions semblables à celles que subirent les réfugiés grecs qui s’établirent dansles grands centres urbains après le désastre d’Asie Mineure. La similarité des conditions de vie se retrouve dans la répartition géographique.Ceux qui, parmi les nouveaux venus, purent rester aux côtés des entrepreneursarméniens déjà établis habitaient dans le centre de la ville. Mais la grande majo-rité des Arméniens partageait les conditions problématiques de survie des réfugiésgrecs dans les nouveaux quartiers pauvres qui émergèrent aux abords du com-plexe urbain de Thessalonique – la plupart du temps dans des logement de for-tune faits de cartons, de planches et de tôles. C’est de ces quartiers défavorisés qu’é-tait issus la quasi-totalité des Arméniens qui quittèrent la Grèce en 1946-1947, àla recherche d’un meilleur sort en Arménie soviétique(12).
74 Dossier I Diaspora arménienne et territorialités I
L’organisation de l’église arménienne
L’organisation des Arméniens de Grèce, tant au niveau local que national, s’ins-crit dans un parcours relativement stable. Cela vaut d’une manière générale pourles Arméniens apostoliques – qui constituent la quasi-totalité (95 %) de la popula-tion arménienne du pays. Après le désastre d’Asie Mineure, deux petits noyauxd’Ar méniens catholiques et évangélistes, qui comptèrent parfois jusqu’à 1 000 per -sonnes au total, se formèrent à Thessalonique. Toutefois, l’émigration – surtoutcelle de l’après-guerre – en restreignit drastiquement le nombre : au début desannées soixante, ils n’étaient plus que 30 à 35 personnes (sur un total de 1 000 per-sonnes dans l’ensemble de la Grèce)(13)
Les premiers témoignages concernant l’organisation de la communauté desArméniens de Thessalonique sont liés à l’établissement, en 1881, du registre de lacommunauté et, surtout, à l’élection en 1884 du premier Conseil national, com-posé de six membres élus par les membres inscrits de la communauté. Jusqu’audésastre de l’Asie Mineure, les Arméniens apostoliques de Grèce relevaient de lajuridiction du patriarcat arménien de Constantinople, qui veillait également à lasélection des curés des communautés(14). Mais, dans les années qui suivirent, lesdirigeants des communautés – particulièrement ceux de la Fédération armé-nienne révolutionnaire (Dashnaktsoutiun) – refusèrent d’être soumis à un centrereligieux qui, dans les faits, dépendait des choix politiques de la Turquie kéma-lienne. Après trente ans de contestation, le 30 mars 1958, la convention nationalead hoc des Arméniens, nouvellement élue, choisit comme métropolite d’Athènesl’évêque chypriote-arménien Sahak Aïvazian (1930-2003), diplômé de l’école dethéologie d’Antélias, au Liban.Le 5 octobre de la même année 1958, il fut décidé que l’archevêché arméniend’Athènes (et de toutes les communautés arméniennes de Grèce) relèverait de lajuridiction ecclésiastique du catholicossat de Cilicie (Antélias). Cette décision nerompit pas pour autant les liens spirituels entre les Arméniens de Grèce et lepatriarcat (catholicossat), historiquement central et toujours respecté,d’Etchmiadzine. Ces liens se renforcèrent après la déstalinisation et plus encoreaprès l’indépendance de la république d’Arménie. Aïvazian continua à diriger sesouailles d’une main ferme (en tant qu’archevêque à partir de 1964) pendantpresque un demi-siècle, jusqu’à son décès le 30 novembre 2003. HorenDogramadzian, dirigeant du clergé de la communauté arménienne deThessalonique pour plusieurs années, lui succéda début 2004(15).La communauté arménienne de Thessalonique avait, à son niveau, connu un breftrouble pendant l’entre-deux-guerres : la métropole de Thrace et de Macédoine fut
I hommes & migrations n° 1265 75
constituée en 1922 (avec le transfert et le changement arbitraire du nom de l’ex-archevêché d’Adrianople et Raidestos), dirigée par l’ebiskopos GervantBerdakhtsian. Ce fait entraîna des réactions de plusieurs membres de la commu-nauté, mais aussi de l’archevêché arménien d’Athènes, qui considérait ce siège(thema) ecclésiastique comme un siège concurrent. Début 1925, Berdakhtsiandémissionna et en 1931 l’administration grecque de la Macédoine procéda à l’a-bolition formelle de cette “métropole” arménienne particulière(16).Au départ, les Arméniens apostoliques de Thessalonique pratiquaient leur cultedans des temples grecs orthodoxes, et les quelques catholiques, dans l’église dite“franque”. Ils utilisèrent ensuite divers locaux provisoires jusqu’à ce que, fin1902, le chantier de construction, dans le centre-ville, d’une église appartenant àla communauté débuta enfin. Les plans étaient dus à une personnalité connue del’histoire architecturale de Thessalonique, l’architecte italien Vitaliano Poselli(1838-1918), que des liens de parenté unissaient à la communauté arménienne. Laconstruction de l’église, consacrée à la Vierge Marie (Sourp Astvatzatzin), fut ache-vée un an plus tard, en novembre 1903(17).
Le fonctionnement des écoles
Les premières écoles de la communauté se tinrent en 1887 dans divers locaux et,à partir de 1907, dans un bâtiment à deux étages qui fut construit à côté de l’église.Après 1922, ce bâtiment — qui servit de siège au métropolite arménien de Thraceet de Macédoine – fut transformé pour héberger, à la fois, un jardin d’enfants, uneécole primaire et un orphelinat, pour faire face à l’urgence d’accueillir des centai-nes d’enfants réfugiés sans abri.Le fonctionnement des écoles s’appuyait sur différentes organisations caritativeslocales : le Comité arménien de secours aux réfugiés (depuis 1922), l’Union desdames, la Croix-Rouge arménienne, la fondation Gulbenkian et l’antenne localede l’Union arménienne générale de bienfaisance (AGBU), ainsi que la Croix bleuearménienne(18).La diminution du nombre des membres de la communauté au cours de l’après-guerre eut également un impact sur le fonctionnement de ses écoles, qui fut d’a-bord dramatiquement réduit, puis totalement interrompu. À partir de 1956, uneécole du soir fonctionna à raison de deux fois par semaine. Environ 60 enfantsArméniens âgés de 6 à 17 ans y suivaient des cours de langue arménienne, d’his-toire et de religion. En 1960, la communauté ne disposait plus d’école fonction-nant dans la journée à l’exception d’une école hebdomadaire (“école du samedi”),
76 Dossier I Diaspora arménienne et territorialités I
uniquement destinée à l’enseignement de la langue arménienne. Néanmoins, à lafin du XXe siècle, le nombre d’élèves de cette école connut une augmentation expo-nentielle à la suite d’une nouvelle vague de réfugiés Arméniens venus deTranscaucasie. Elle accueille aujourd’hui 150 élèves(19).La réduction du nombre et de l’importance des écoles arméniennes deThessalonique n’est pas due au seul facteur démographique d’une baisse du nom-bre d’habitants – surtout après le “retour” de 1946-1947 : elle s’explique aussi parl’intégration sociale des membres de la communauté arménienne à la sociétégrecque. L’État grec joua en la matière un rôle négatif. Depuis la période de l’en-tre-deux-guerres, pour des raisons politiques et économiques, les gouvernementsgrecs refusaient de reconnaître aux écoles arméniennes le statut d’établissements“minoritaires”. Ces écoles ont souvent failli fermer – comme ce fut le cas en 1936– précisément parce que leur fonctionnement n’était légal qu’en tant qu’écoles“privées” et non en tant qu’écoles minoritaires. Depuis plusieurs années, l’Étatgrec soutient cependant indirectement, au moyen de la nomination d’enseignants,certaines écoles arméniennes de l’Attique, où les cours sont dispensés en grec et enarménien. De nos jours, dans toute la Grèce, il existe trois jardins d’enfants, troisécoles primaires et un gymnase (premier cycle du secondaire), tous en Attique. Desécoles d’un jour fonctionnent à Thessalonique et, avec la coopération de la com-munauté, à Kavala, Serres, Xanthi, Komotini et Alexandroupoli(20).
Les premières initiatives politiques
En raison du nombre restreint de ses membres et de sa composition sociale, la com-munauté ne fut pas liée au départ au mouvement national arménien du XIXe siècle.Les Arméniens de Thessalonique ne participèrent pas au mouvement des Jeunes-Turcs en 1908, ni aux mobilisations ouvrières qui eurent lieu en 1909 àThessalonique, en dépit de la présence des délégués des deux partis révolutionnairesarméniens les plus importants d’Istanbul, les partis Hünchak et Dashnak, aux prin-cipales manifestations organisées dans la ville par la Fédération ouvrière socialiste(21).La situation commença à changer après les massacres d’Adana. En 1910, la com-munauté créa une antenne de l’Union arménienne générale de bienfaisance, dont lamission était de trouver des fonds pour secourir les victimes de Cilicie. La commu-nauté commence cependant à entreprendre de réelles initiatives politiques aumoment où éclate la Première Guerre mondiale. À l’été 1915, en plein génocide, lesArméniens de Thessalonique s’efforcèrent de sensibiliser l’opinion publiquegrecque au moyen de plusieurs manifestations. En mars 1917, ils constituèrent un
I hommes & migrations n° 1265 77
comité féminin composé de trois membres dont la mission était de collecter desfonds afin de secourir les premiers réfugiés, Grecs et Arméniens, venus de la Thraceet d’Asie Mineure occidentale. En 1918, ils s’impliquèrent dans le recrutement devolontaires arméniens à destination des fronts du Caucase et du Moyen-Orient,principalement lors de la constitution de la “légion d’Orient”(22). Au cours de lamême année, les plus jeunes fondèrent l’Union de la jeunesse arménienne qui, aprèsune période d’inertie, sera fortement active au sein de la communauté jusqu’à laDeuxième Guerre mondiale. Cette association sera reconstituée au cours des annéescinquante en tant que section de la Fédération arménienne des jeunes de Grèce(23).
Du repli communautaire à l’ouverture sur la Grèce et le monde
Dans l’entre-deux-guerres, aux prises avec les problèmes économiques et sociaux cau-sés par l’afflux des réfugiés, une importante partie de la population arménienne dupays se tourna vers la gauche, ne voyant d’autre issue que celle du “retour” à la seulepatrie qui restait, en Transcaucasie(24). Les porte-parole de ce mouvement étaient, outreles marxistes arméniens, le parti radical Hünchak et le parti républicain-libéralRamgavar Azadagan – qui fut restructuré dès 1921. Le mouvement de “retour” desannées 1946-1947 ramena la partie de la population arménienne qui était restée àThessalonique (ainsi qu’ailleurs en Grèce) aux préférences idéologiques d’avant laguerre. À partir des années cinquante, la vie des Arméniens de la ville se caractérisaitainsi par le recueillement et par la reproduction d’une idéologie au sein de la commu-nauté ; les relations de celle-ci avec le monde extérieur, avec l’environnement social,étaient cependant marquées par le souci d’être en phase avec le développement écono-mique et social de ses concitoyens grecs. Au milieu des années soixante, la commu-nauté commença à faire preuve d’une mobilité idéologique à l’étendue et à l’intensitéinattendues, caractérisée d’une part par la renaissance du caractère arménien des com-munautés et par l’abandon d’une attitude de repli communautaire d’autre part(25).Cette mobilité ne caractérise évidemment pas uniquement les Arméniens de Grèce;elle était alors manifeste dans la majorité des communautés de la diaspora (y com-pris dans les organisations jusqu’alors idéologiquement plutôt aseptisées desArméniens d’Union soviétique, particulièrement parmi les intellectuels et les artis-tes). La diffusion de l’“arménicité” d’une communauté à l’autre est d’ailleurs attes-tée non seulement par les manifestations communes (camps de vacances, conféren-ces, etc.), mais aussi par les manifestations publiques parallèles, et quasimentsimilaires, de commémoration du génocide.
78 Dossier I Diaspora arménienne et territorialités I
La communauté de Thessalonique, par l’intermédiaire de son Comité national,fut à l’avant-garde de toutes ces manifestations – peut-être parce que l’environne-ment social de la Macédoine centrale, surtout celui des réfugiés, y était favorable.L’effondrement de l’URSS et l’indépendance de la république d’Arménie qui suivitfurent deux données historiques majeures qui influencèrent inévitablement les orien-tations idéologiques des communautés arméniennes de la Grèce. En tout premier lieu,cette réalité nouvelle les conduisit à définir de nouvelles bases dans leurs rapports avecle centre national. Cela apparut clairement dans la façon dont les Arméniens se mobi-lisèrent pour répondre à certains des énormes besoins auxquels l’Arménie fut confron-tée dès les débuts de sa vie indépendante. Cette mobilisation consista à envoyer régu-lièrement de Thessalonique à Erevan des quantités importantes de matériel médical etpharmaceutique, d’aide alimentaire et d’autres équipements (initialement destinés àsoulager les victimes des tremblements de terre du 7 décembre 1988 à Gumri etSpitak) ; puis à faire face aux graves problèmes alimentaires que connut l’Arménie, dusà la guerre de Nagorno-Karabakh et à l’embargo imposé par la Turquie.Ces initiatives de la communauté arménienne de Thessalonique firent de la villeune étape obligée pour les missions d’aide provenant d’Occident à destination de larépublique d’Arménie(26).
Une intense activité éditoriale et culturelle
Il est impressionnant de constater que, en dépit des graves problèmes de survie aux-quels étaient confrontés les Arméniens de Thessalonique, ils réussirent à publier,entre 1923 et 1938, plus de dix quotidiens en langue arménienne. Plusieurs d’entreeux eurent la vie courte ; d’autres n’étaient pas imprimés mais simplement polygra-phiés. Cela n’empêcha pas qu’ils jouèrent un rôle important dans la vie de la com-munauté, à une époque où des mutations idéologiques particulièrement intéressan-tes avaient lieu au sein de sa population. De ce point de vue, il exista des casremarquables tels le quotidien Alik (“Vague”, 1923-1927), probablement le premierquotidien arménien de Thessalonique, son concurrent le quotidien Nor Alik(“Nouvelle Vague”, 1924-1927), Horizon, le successeur d’Alik (1927-1937),Askhatank (“Travail”, le quotidien de gauche le plus combattif de la ville, 1926-1927), et Arevelk (“Orient”, dont la parution couvrit les années 1930 à 1938)(27). La diminution de la population arménienne de Thessalonique, surtout aux débutsdes années trente, ne permettait pas la circulation d’autant d’imprimés. En outre, ladiffusion en Grèce du Nord de la presse en langue arménienne d’Athènes, qui dispo-sait de plus de collaborateurs et de plus de moyens financiers, limitait d’autant les
I hommes & migrations n° 1265 79
possibilités des éditions locales. Ainsi, à partir de 1938, il n’y eut plus de journauxarméniens à parution régulière à Thessalonique. La communauté de Thessaloniquedisposait toutefois, et dispose encore aujourd’hui, d’une imprimerie arménienneéditant des publications aux contenus variés (littéraire, historique, politique etsocial), dues particulièrement au Comité national arménien local.Les divers aléas, notamment démographiques, que subit la communauté ont certai-nement influencé ses activités culturelles. Pendant l’entre-deux-guerres, en dépit deleur caractère amateur, ces activités étaient nombreuses et variées. Quelques-unesétaient dues à l’initiative d’associations sportives comme l’Union des athlètes armé-niens (Homenetmen) qui, entre 1923 et 1939, fut l’association arménienne de jeunesathlètes la plus importante de Thessalonique. Cette association, largement recon-nue comme “arménienne” et qui représente un chapitre important de l’histoiresportive de Thessalonique fut également active,jusqu’au “retour” de 1947, dans le domaine de l’éducation et de la culture. En 1927, ellepublia même son propre magazine, le NorSeround (“Nouvelle génération”). L’Association de théâtre Bedros Atamian, fon-dée en 1933, réussit à survivre jusqu’en 1939.La chute démographique consécutive à laguerre imposa le recours à des ensembles artis-tiques de taille plus restreinte, principalementen ce qui concerne les chœurs. À partir de 1978, l’Association du théâtre dépenditde la section locale de l’association culturelle Hamaskaïn, qui coordonne depuis –avec des performances remarquables pour un groupe ethnique aussi restreint – lesactivités théâtrales, artistiques, musicales, etc. de la communauté. Certains memb-res de la communauté se sont également distingués à titre individuel dans plusieursdomaines culturels : en littérature, avec pour principal représentant l’œuvre de tra-duction, mais aussi l’œuvre poétique originale d’Agop Kassapian (1946-1990), etplus encore dans le domaine de la musique et du théâtre, avec des artistes qui se dis-tinguent aujourd’hui sur la scène artistique, tant grecque qu’internationale(28).
L’intégration à la société hellénique
Les efforts assidus dont ont fait preuve les Arméniens de Thessalonique en vue depréserver leur arménicité ne les empêchèrent pas d’être organiquement liés à leurenvironnement social. Ce lien fut rompu entre 1920 et 1947, lorsque l’importance
Depuis les années
soixante, la troisième
génération des
Arméniens de
Thessalonique
est enfin passée à
un processus
d’intégration sociale
accélérée.
80 Dossier I Diaspora arménienne et territorialités I
numérique de la population arménienne de Thessalonique et sa concentration dansdes quartiers précis favorisèrent une attitude d’introversion. Durant cette mêmepériode, une importante partie des Arméniens de Grèce aspirait à retrouver unepatrie perdue, que ce soit en retournant en Arménie soviétique ou en rejoignant descommunautés plus florissantes, déjà installées en Europe occidentale ou aux États-Unis. Ces facteurs expliquent sans doute le nombre restreint de membres de la com-munauté qui acquirent la nationalité grecque pendant l’entre-deux-guerres. La cristallisation du profil idéologique de la communauté, une fois achevée la périodedes retours et des vagues d’émigration successives, favorisa l’intégration sociale. Celaapparaît d’abord dans l’amenuisement spectaculaire, depuis le milieu des années cin-quante, des différenciations géographiques et socio-économiques que l’on pouvaitnoter auparavant entre l’élément arménien et l’environnement social deThessalonique dans son ensemble. À partir du début des années soixante, la popula-tion constituée par les réfugiés, dorénavant stabilisée d’un point de vue démogra-phique, commença un processus d’intégration dans la société bourgeoise hellénique ;les anciens quartiers de réfugiés – arméniens comme grecs – perdirent non seulementleur caractère provisoire et prolétaire, mais aussi leurs particularités urbanistiques etleur “pittoresque ethnique”. Les arrivées relativement récentes à Thessalonique deréfugiés arméniens venus de Transcaucasie suivent en cela les tendances de la réparti-tion géographique des réfugiés grecs des autres républiques de l’ex-Union soviétique.Depuis les années soixante, la troisième génération des Arméniens de Thessaloniqueest enfin passée à un processus d’intégration sociale accélérée. Un bref examen desdonnées figurant aux registres des baptêmes, des mariages et des décès de la com-munauté depuis 1948 – et surtout depuis la période 1990-2002 – permet de notertant la tendance à la baisse démographique que l’augmentation du nombre demariages mixtes. Ainsi, le nombre de naissances entre 1948 à 2002 a été divisé parquatre, tandis que le taux de décès augmentait proportionnellement. Ce renverse-ment de tendance a commencé à devenir sensible depuis le début des annéessoixante. Entre 1960 et 1993, on a enregistré par exemple 218 naissances, 573 décèset 130 mariages. La divergence notable entre naissances et décès, même si elle estinfluencée par l’inclusion dans le calcul des personnes du troisième âge qu’accueillela maison arménienne de repos de Thessalonique, n’en indique pas moins la réduc-tion physique de la communauté. Par ailleurs, sur les mêmes périodes, la moyennedes mariages mixtes apparaît croissante : alors qu’entre 1960 et 1980, leur nombreétait nettement inférieur aux mariages entre Arméniens (38 contre 64), entre 1981et 1992, la tendance est inversée (17 mariages mixtes contre 11 mariages entreArméniens). Ce rapport demeure stable, si l’on considère les données des dix annéessuivantes (1993-2002) : 25 mariages entre Arméniens contre 35 mariages mixtes(29).
I hommes & migrations n° 1265 81
Néanmoins, avec le passage au XXIe siècle, d’autres facteurs ont émergé qui pour-raient renverser cette tendance : l’établissement en Grèce du Nord de plusieursmilliers de réfugiés économiques arméniens et de refugiés de Transcaucasie aug-mente la population de la communauté. D’autre part, la pleine indépendance dela république d’Arménie modifie les rapports entre la diaspora arménienne dansle monde et le centre national, désormais indépendant, en déplaçant consécutive-ment certains des points de référence de son arménicité, mais aussi en modifiantles conditions de son évolution à venir. ■
1. Cf. I. K. Hassiotis, “Armenians”, in Richard Clogg (ed.), Minorities in Greece : Aspects of a Plural Society, Londres, Hurst & Co.,2002, p. 94.2. Asadur H. Magarian, Hushakirk Tragio yev Makedonio Hai kaghutneru (“Mémoire sur les communautés arméniennes de Thraceet de Macédoine”), Thessalonique 1929, p. 86-87.3. Kemal H. Karpat, Ottoman Population, 1830-1914. Demographic and Social Characteristics, Madison, Wisconsin, 1985,p. 124 (tableau I.8.A), 152 (tableau I.9), 156, (tableau I.11).4. I. K. Hassiotis et Giula Kassapian, “The Armenian Colony in Thessaloniki”, Balkan Studies, 31/2, 1990, p. 214.5. Karpat, op. cit., p. 166, table. I.16.A.6. Garo Kevorkian, “Dasn’evyotu dari hunahai kaghutin het, 1922-1939” (“Dix-sept ans de communauté gréco-arménienne,1922-1939”), Amenun Darekirk. 7, Beyrouth, 1960, p. 354.7. Hassiotis et Kassapian, op. cit., p. 215.8. Hassiotis et Kassapian, op. cit., p. 216. 9. Hassiotis, “The Armenian Community : A Chronicle”, dans l’édition bilingue (grec-anglais) illustrée, I.K. Hassiotis éd., TheArmenian Community of Thessaloniki : History, Present Situation and Prospects, Thessalonique, Univ. Studio Press, 2005, p. 27-31.10. Magarian, op.cit., p. 86-87, 145-159.11. Magarian, op.cit., p. 133, 270-278, où le lecteur trouvera de brèves notices biographiques sur les entrepreneurs arméniens de la ville.12. Hassiotis, “Armenians”, p. 97-98, 100-101.13. Hassiotis, “The Armenian Community : A Chronicle”, p. 37, 40.14. Sur les membres du clergé liés à la communauté, cf. Hassiotis, “The Armenian Community : A Chronicle”, p. 50-53.15. Hassiotis, op. cit., p. 41-46.16. Hassiotis, op. cit., p. 46-48.17. Khoren Dogramatzian, Thessagonigei S. Astvatzatzin Haiastaniats Arakelagan S. Iegegetsvo. Himnatrutian 100-amiak, 1903-2003 (“L’église apostolique de la Vierge de Thessalonique, 100 ans depuis sa fondation, 1903-2003”), Thessalonique, 2003. 18. Hassiotis, op. cit., p. 68-73.19. Giula Kassapian, “The Armenian Community Today”, inHassiotis (éd.), The Armenian Community of Thessaloniki, p. 149-151.20. Hassiotis, ”The Armenian Community : A Chronicle”, p. 74-77.21. Hassiotis et Kassapian, op. cit., p. 222-223.22. Arthur Beylerian, “Les Grandes puissances, l’Empire ottoman et les Arméniens dans les archives françaises (1914-1918)”,Recueil de documents, Paris, 1983, p. 489, 716.23. Hassiotis, “The Armenian Community : A Chronicle”, p. 83, 86-87.24. Le mouvement arménien de la gauche a été étudié par Bedros Kokinos [Hadjik G. Gogayan], Hunahai kaghuti batmutiunits,1918-1927 (“De l’histoire de la communauté gréco-arménienne, 1918-1927”), Erivan, 1965.25. Cf. I. K. Hassiotis, “The Armenian Community in Thessaloniki : Origin, Organisation and Ideological Evolution”, in I. K. Hassiotis (éd.), Queen of the Worthy : Thessaloniki, History and Culture, vol. I, Thessalonique, Paratiritis, 1997, p. 301-303.26. Hassiotis, “The Armenian Community : A Chronicle”, p. 98-101.27. Cf. Yorgos Toussimis, “O armenikos typos tis Thessalonikis gyro sta 1930” (“La presse arménienne de Thessalonique versl930”), Actes du VIIe congrès de la Société des historiens grecs, Thessalonique, 1986, p. 109-118.28. Kassapian, “The Armenian Community Today”, p.157-158.29. Hassiotis, “The Armenian Community : A Chronicle”, p. 132-133.
Notes