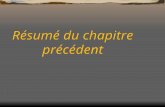La collégiale Saint-Seurin de Bordeaux aux XIIIe et XIVe siècles et son élaboration d'une...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La collégiale Saint-Seurin de Bordeaux aux XIIIe et XIVe siècles et son élaboration d'une...
R E V U E D ’ H I S T O I R E
E T D E P H I L O L O G I E
LE MOYEN AGE
Tome CXVII
LE M
OYE
N A
GE
1/2011
ISBN 978-2-8041-6536-9
RMA-N.11/1
ISSN 0027-2841-:HSMIKE=V[ZX[^:
LE MOYEN AGE
Tome CXVII
1/2011
Pour faire œuvre d’historien, il faut disposer d’une infor-mation étendue sur les progrès de la recherchepartout dans le monde. C’est le rôle des revues : pour les médiévistes de langue française il est tenu notamment par Le Moyen Age.
Revue critique, largement ouverte aux contributions universitaires internationales, Le Moyen Age mêle aux travaux des historiens ceux des spécialistes des littératures médiévales pour faire ressortir les aspects les plus variés de la société et de la civilisation européennes entre les Ve et XVe siècles.
1
2011
Revue publiée avec le soutien du Centre national de la recherche scientifique.
RMA_couv_I-IV.indd 1RMA_couv_I-IV.indd 1 15/11/2011 10:00:2715/11/2011 10:00:27
DOI : 10.3917/rma.162.0043
La collégiale Saint-Seurin de Bordeaux aux XIIIe–XIVe siècles et
son élaboration d’une historiographie et d’une idéologie
du duché d’Aquitaine anglo-gascon*
Si le duché d’Aquitaine anglo-gascon nous a laissé une documentation administrative abondante en particulier aux archives nationales anglaises1, ce dernier type d’archives étant bien plus rare ailleurs2, on ne peut en dire autant concernant d’autres types de sources comme les chroniques ou les écrits historiques et/ou politiques3. Les historiens qui se sont intéressés à l’histoire du duché n’ont donc logiquement pas orienté leurs travaux en vue de déceler si l’on avait développé une identité politique de ce duché d’Aquitaine (ou de Guyenne) anglo-gascon. Pourtant, si les textes histo-riques et politiques élaborés dans cette Aquitaine sont très rares, il en existe quelques-uns qui, bien que connus depuis plus d’un siècle, ont été négligés jusqu’à présent.
Les historiens s’intéressant au Bordeaux médiéval connaissent depuis longtemps deux textes présents dans les deux cartulaires municipaux de
* AUTEUR : Guilhem PÉPIN, Université d’Oxford, gaifi [email protected]. LONDRES, The National Archives (= TNA), auparavant Public Record Offi ce
(PRO).2. Les archives du duché d’Aquitaine qui étaient conservées au château de
l’Ombrière de Bordeaux et qui furent transférées dans les années 1460 au Trésor des Chartes de Paris sur l’île de la Cité, furent détruites au cours de l’incendie de la Chambre des comptes en 1737.
3. Il s’agit apparemment d’une tendance de fonds puisque, pour la période située avant 1200, T.N. BISON, Unheroed pasts : History and Commemoration in South Frankland before the Albigensian Crusades, Speculum, t. 65, 1990, p. 281–308, fait le même constat pour l’ensemble des régions méridionales.
44 G. PÉPIN
Bordeaux publiés à la fi n du XIXe siècle : le Livre des Bouillons et le Livre des Coutumes (ce dernier étant conservé en plusieurs manuscrits distincts). Le premier est constitué par une description des terres que le roi d’Angleterre devrait dominer en Guyenne et en Gascogne. Le récit légendaire de Sénebrun (ou Cénebrun) constitue le second texte examiné ici. Jusqu’à présent, peu d’attention a été portée sur eux pour diverses raisons, l’absence d’indices permettant d’expliquer leur élaboration n’étant pas le moindre des facteurs expliquant cet oubli. Grâce à des indications inconnues auparavant, il nous semble possible de rattacher leur élaboration à la collégiale Saint-Seurin de Bordeaux4 et d’expliciter l’idéologie qui la sous-tend ; ce qui peut donner un nouvel éclairage sur l’histoire du duché d’Aquitaine anglo-gascon. Par conséquent, ces deux textes peuvent être rétablis dans un contexte plus général et leur existence permet aussi de mieux comprendre l’organisation d’une cérémonie à Saint-Seurin autour du Prince Noir en septembre 1355.
Les textes élaborés à Saint-Seurin et la thèse de l’allodialité de la Gascogne
Les textes et leurs manuscrits
Débutons d’abord par le recensement des textes et des manuscrits dans lesquels ils nous sont parvenus. Un résumé de leur contenu respectif sera ensuite nécessaire.
La description géographique de ce que le roi d’Angleterre doit dominer en Guyenne et en Gascogne se trouve dans plusieurs manuscrits du Livre des Coutumes de Bordeaux5 :– Cartulaire de Baurein, BORDEAUX, Archives Municipales (= AM), ms. AA 4,
ff. 70v–716. Langue : essentiellement du français utilisant parfois une graphie « gasconnisante » ; un peu de gascon.
– Ms. Péry, BORDEAUX, AM, ms. AA 6, fol. 79r–v7. Langue : idem.– BORDEAUX, AM, ms. AA 7, fol. 1r–v8. Langue : gascon.
4. Signalons la récente publication d’un colloque portant sur cet établissement religieux : Autour de Saint-Seurin : lieu, mémoire et pouvoir, des premiers temps chrétiens à la fi n du Moyen Âge. Actes du colloque de Bordeaux (12–14 octobre 2006), éd. I. CARTRON, D. BARRAUD, P. HENRIET et A. MICHEL, Bordeaux, 2009.
5. Livre des Coutumes, éd. H. BARCKHAUSEN, Bordeaux, 1890. Nous tenons à remercier ici toute l’équipe des Archives Municipales de Bordeaux pour leur aide précieuse.
6. Ibid., 2d append., p. 607–609, no V. Ms. nommé B par H. Barckhausen.7. Ibid., p. 610–614, no VII, n. Ms. nommé D par H. Barckhausen.8. Ibid. Ms. nommé C par H. Barckhausen.
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 45
Les deux premiers manuscrits datent de la première moitié du XVe siècle, tandis que le AA 7 remonte à la seconde moitié du XVe siècle.
Mais ce texte se trouve aussi dans trois manuscrits inédits et ces variantes sont passées inaperçues jusqu’à présent :– LONDRES, British Library (= BL), ms. Harley 4763, ff. 169r–170r. Le manus-
crit date de la première moitié du XVe siècle et a été composé en Angleterre. Langue : essentiellement du français utilisant parfois une graphie « gas-connisante » ; un peu de gascon.
– LONDRES, BL, ms. Add. 10146, ff. 7–8r. Selon les armoiries représentées à deux reprises au début du manuscrit, ce dernier a été élaboré pour un membre de la famille Pichon, une importante famille bordelaise installée à Bordeaux après 1453. Ce manuscrit date de la seconde moitié du XVe siècle. Langue : idem.
– OSLO et LONDRES, Collection Schøyen, ms. 0339, fol. 184v. Ce manuscrit date du dernier quart du XIVe siècle et a été élaboré en Angleterre. Langue : abrégé en languedocien du même texte.
Le récit en latin de l’histoire de Sénebrun se trouve dans les deux cartulaires municipaux de Bordeaux et dans celui de Libourne :– Livre des Bouillons, BORDEAUX, AM, ms. AA 1, ff. 122r–124v10. Le Livre des
Bouillons est un manuscrit de la première moitié du XVe siècle.– Cartulaire de Baurein, BORDEAUX, AM, ms. AA 4, ff. 46v–49v11. Première
moitié du XVe siècle.– Livre des Coutumes, BORDEAUX, AM, ms. AA 3, ff. 214r–223r. Probablement
élaboré entre 1388 et 139912.– Livre Velu, LIBOURNE, AM, conservé à la Médiathèque de Libourne,
ms. AA 1, ff. 139r–142v13. L’élaboration de ce cartulaire remonte à la seconde moitié du XVe siècle.
9. Une description du contenu du ms. 033 de la Collection Shøyen se trouve dans J. GRIFFITHS, Manuscripts in the Schøyen Collection Copied or Owned in the British Isles before 1700, English Manuscript Studies, t. 5, éd. P. BEAL et J. GRIFFITHS, 1994, p. 37–38. Je tiens ici à remercier E. SØRENSSEN, Bibliothécaire de la Collection Shøyen, qui m’a amicalement envoyé des clichés de ce manuscrit conservé de nos jours à Oslo, ainsi que M. SCHØYEN, le propriétaire de cette collection. Je remercie également P. MORGAN de l’Université de Keele (Royaume-Uni) pour m’avoir indi-qué l’existence de cette collection privée de manuscrits. Le catalogue complet de la Collection Shøyen est disponible sur : http://www.schoyencollection.com/
10. Livre des Bouillons, éd. H. BARCKHAUSEN, Bordeaux, 1867, p. 473–483, no CXXXIX.11. Livre des Coutumes, p. 380–394, no XXXVIII.12. Ms. nommé A par H. Barckhausen.13. Version qui est restée inédite. Je remercie M.T. PELLERIN, Directrice de la
Médiathèque de Libourne, pour m’avoir permis de consulter le Livre Velu.
46 G. PÉPIN
Nous avons repéré une version inconnue de ce texte, elle aussi en latin :– OSLO et LONDRES, Collection Schøyen, ms. 033, ff. 113r–116v. Ce manuscrit
date du dernier quart du XIVe siècle et fut composé en Angleterre.
Description rapide du contenu de chacun de ces textes
Dans cet article, nous n’avons hélas guère la place de décrire en détail ces deux textes et donc d’en effectuer une critique serrée suivant leurs différentes leçons. Nous pensons donc effectuer ce travail dans l’une de nos prochaines études.
Le texte de la description de la Guyenne et de la Gascogne commence par circonscrire l’Aquitaine comme étant l’espace compris entre la Loire et la Dordogne puisqu’elle en exclut la Gascogne. Puis elle énumère les terres que doit dominer le roi d’Angleterre dans cet espace et place dans le duché d’Aquitaine (de Guyenne), le diocèse d’Agen qui est bien en Aquitaine, mais aussi les diocèses d’Angers et de Tours qui, bien que situés sur la Loire, la limite symbolique et « simplifi ée » de l’Aquitaine, n’en fi rent jamais partie. À l’est du Limousin, aucune précision n’est apportée si ce n’est que le duché commence au Puy-Notre-Dame (Le Puy-en-Velay) « où la Loire passe14 ». La liste des diocèses nous en fournit certains qui n’ont été créés qu’en 1317 (Tulle, Luçon et Sarlat), ce qui permet d’affi rmer que cette description est postérieure à cette dernière date. La Gascogne est décrite comme l’espace compris schématiquement entre la Garonne (dont l’essentiel du cours est appelé ici « Gironde ») et les Pyrénées. En bref, elle correspond presque trait pour trait aux limites de la Gascogne linguistique telle que l’ont défi nie les études modernes15, si ce n’est l’inclusion de la terra de Bascos (Labourd, Soule et future Basse-Navarre) bascophone, mais dont la langue romane d’usage courant était le gascon. Le roi-duc devait posséder tout cet ensemble à l’exception des terres situées à l’est de la Gimone, un affl uent de la Garonne passant à l’est d’Auch qui, ainsi que la rivière voisine et parallèle de l’Arrats, marquait schématiquement au XIIIe siècle la limite entre les terres vassales du roi-duc situées à l’ouest de ces rivières et celles qui ne l’étaient pas. Ces descriptions se terminent par cette phrase péremptoire : « Et tout cela doit être [possession] du roi, notre seigneur duc, et de son ressort16. » Ces descriptions, en particulier celles de l’Aquitaine (ou Guyenne) permettent de placer l’écriture de ce texte avant le traité de Brétigny-Calais de 1360,
14. Le Puy-en-Velay est très proche de la Loire, mais est situé sur la Borne qui est l’un de ses affl uents.
15. Voir la carte couleur Carta de Gasconha – Hitas lingüisticas établie par P. LARTIGUE en se basant sur les résultats de l’enquête menée en 1895 par É. BOURCIEZ. Carte publiée conjointement avec P. LARTIGUE, Les racines de la langue gasconne. Identité culturelle, limites linguistiques, Belin–Beliet, 1998.
16. Livre des Coutumes, p. 614, no VII.
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 47
puisque, après cette date, l’Aquitaine (ou Guyenne) est toujours circonscrite aux limites défi nies lors de ce traité. Par conséquent, il nous semble que la description de la Guyenne et de la Gascogne a été écrite entre 1317 et 1360.
Pour l’histoire de Sénebrun, on se limitera ici à résumer le premier tiers de ce document, les deux autres tiers étant probablement d’un auteur différent, plus intéressé par le seul Médoc et qui n’avait pas les mêmes préoccupa-tions politiques que le premier auteur. Dans cette première partie, on conte l’histoire de Sénebrun, second fi ls de l’empereur Vespasien, qui le nomme roi de Bordeaux. S’ensuit un certain nombre d’anecdotes concernant ce Sénebrun, sa femme Galiène – qui aurait construit le Palais Gallien17 – et Sénebrun, leur second fi ls, comte du Médoc18. L’auteur utilise ensuite des éléments de la Vita prolixior19, un écrit hagiographique composé à Limoges au XIe siècle qui met en scène saint Martial, le saint de l’Aquitaine (dont la virga, ou bâton, était par ailleurs conservée à Saint-Seurin en 1419), sainte Valérie et le duc d’Aquitaine Étienne pour expliquer le passage du royaume de Bordeaux au duché d’Aquitaine. Puis, il brosse succinctement un tableau historique jusqu’à ce que le duché d’Aquitaine devienne possession des rois d’Angleterre. Le reste du récit est un roman exotique narrant les aventures extraordinaires du comte du Médoc Sénebrun.
Saint-Seurin à l’origine de ces textes
Jusqu’à présent l’origine de ces textes n’a jamais soulevé de questions. Il faut dire que les indications permettant de leur en attribuer une manquent tota-lement dans les manuscrits conservés à Bordeaux. Heureusement, les deux manuscrits composés en Angleterre que nous avons cités précédemment nous indiquent que la collégiale Saint-Seurin de Bordeaux est sans doute le cadre d’origine de l’élaboration de ces deux textes. Dans le ms. Harley 4763 de la British Library, la description de la Guyenne et de la Gascogne se trouve ainsi précédé du titre Extractum ab originali libri antiqui cronicarum Sancti Severini Burdegalensis, ce que l’on peut traduire en français par Extrait d’un livre ancien de chroniques dont l’original se trouve à Saint-Seurin de Bordeaux20. Notre description se place ici dans un manuscrit anglais de la première moitié du XVe siècle de 299 folios où se trouvent copiés divers documents concernant
17. Nom populaire de l’amphithéâtre romain de Bordeaux.18. Sénebrun (ou Cénebrun) est l’un des deux noms lignagers de la famille des sei-
gneurs de Lesparre, les plus puissants seigneurs du Médoc (Bordelais, dép. Gironde).19. Traduction française de ce texte : Naissance d’apôtre. La vie de saint Martial de
Limoges, éd. R. LANDES et C. PAUPERT, Turnhout, 1991.20. LONDRES, BL, ms. Harley 4763, fol. 169r. Un bourgeois d’Agen copia en 1358
cette description de la Guyenne et de la Gascogne sur un livre de(s) Chronique(s) de Bourdeaux. Voir cette description dans Bulletin de la Société scientifi que, historique et archéologique de la Corrèze, t. 12, 1890, p. 258–260 (Extrait d’un ancien cayer manuscrit de la Chambre des comptes de Paris, PARIS, Bibliothèque nationale de France (= BnF), Coll. Baluze, t. 17, ff. 137–138).
48 G. PÉPIN
la Guerre de Cent ans, de la période s’étendant entre 1360 et 1435. Quant au récit sur Sénebrun de Bordeaux, le ms. 033 de la Collection Schøyen, qui est probablement un manuscrit copié en Angleterre, nous fournit ce bien curieux texte situé après ce récit au verso du folio 11621 que l’on peut traduire ainsi en français : « Maître Bidau de Saint-Sever, chanoine de Saint-Seurin de Bordeaux, découvrit cette histoire, écrite en français, dans les chroniques de l’église de Vienne, et il la transcrivit. Et par la suite, grâce à cette transcription, maître Arnaut de Listrac la découvrit dans l’abbaye de Santo-Domingo de Silos du diocèse de Burgos22 au début d’un certain livre de physique qu’il transcrivit de la même façon ; laquelle copie fut par la suite retrouvée par maître Ramon-Guilhem dans l’église qui est située près de la chapelle du seigneur roi d’Angleterre à la fi n de ce livre de chroniques. Pour qu’ensuite les futures générations la gardent en mémoire, et que la vérité ne reste pas ignorée mais soit connue de tous, le même maître Ramon-Guilhem la fi t copier à la fi n de ce livre de chroniques, à Londres, par Bernard de Graves, clerc de la province de Gascogne. Que Dieu soit le seigneur de sa vie et qu’il soit favorable à son âme. Amen. »
On ne peut totalement rejeter la découverte de l’histoire de Sénebrun dans un manuscrit de l’église de Vienne puisque l’on trouve à plusieurs reprises le personnage mythique de Sénebrun de Bordeaux dans la chanson de geste vraisemblablement d’origine bourguignonne de Girart de Roussillon, dont le personnage est basé sur le comte de Vienne du même nom († ca 877)23. On ne peut donc écarter absolument l’hypothèse d’un récit relatant une véritable transmission textuelle. Toutefois, selon nous, les éléments accréditant une autre hypothèse semblent l’emporter. Il faut tout d’abord se demander com-ment le récit très bordelais dit « de Sénebrun » tel qu’on le connaît aujourd’hui
21. OSLO et LONDRES, Collection Schøyen, ms. 033, fol. 116v : Hanc ystoriam invenit magister Vitalis de Sancto Severo, canonicus Sancti Severini Burdegalensis, gallice scriptam in cronicis ecclesie Viennensis quam transcripsit, et per ipsum transcriptam, postmodum invenit eam magister Arnaldus de Listrac in abbacia Sancti Dominici Exiliensis Burgensis diocesis in principio cuiusdam libri phisice quam similiter transcripsit qua transcripta fuit postmodum per magistrum Raymundum Guillelmi reperta in ecclesia prope capellam que adiacet domini regis Anglie in fi ne cuiusdam libri cronicorum. Quam post in memoriam futurorum idem magister Ramundus Guillelmi postmodum ne ignoretur ymo potius sciatur rei veritas premissorum in fi ne istius libri cronicarum infra civitatem Londonii fecit annexari per Bernardum de Grava, clericum Vasconie provincie cuius vite rector sit deus et anime propicius. Amen. Avant 1884, P. Meyer a lu dans un manuscrit appartenant au comte d’Ashburnham (probablement conservé aujourd’hui à la BL) une notice similaire plus courte s’arrêtant à cuiusdam libri phisice. Girart de Roussillon, chanson de geste, éd. P. MEYER, Paris, 1884, p. 76 n.
22. Je remercie particulièrement F. LAINÉ pour l’identifi cation de cet établissement religieux. Le prénom Arnaut se prononce en gascon [ar’naṷt] (« Arnaout »).
23. Girart de Roussillon. Chanson de Geste, éd. W.M. HACKETT, t. 1, Paris, 1953 : cinq mentions de Sénebrun de Bordeaux.
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 49
aurait pu intéresser quelqu’un de l’église de Vienne. Ensuite, pourquoi un tel texte originellement écrit en français se retrouverait-il, au fi nal, traduit en latin et non en gascon par un chanoine de Bordeaux. Enfi n, comment se fait-il que ce texte, copié uniquement par des Gascons, ne s’arrête jamais en Gascogne, mais passe du Dauphiné en Castille pour arriver fi nalement en Angleterre.
Il est nécessaire de souligner ici que le personnage désigné comme étant à l’origine de la « découverte » du récit de Sénebrun n’est autre qu’un cha-noine de Saint-Seurin de Bordeaux dénommé Bidau de Saint-Sever24. Il faut sans doute le reconnaître comme étant l’auteur du premier tiers de l’histoire de Sénebrun. La localisation de l’origine de ce récit à Vienne provient sans doute de la présence d’un Sénebrun de Bordeaux dans Girart de Roussillon, mais aussi du prestige quelque peu lointain de l’église de Vienne. De même que pour la seconde localisation du texte à Santo-Domingo de Silos dans le diocèse de Burgos, ou que la troisième dans une église située près de la chapelle du roi d’Angleterre à Londres, il faut plutôt penser à des inventions destinées à donner du crédit à l’histoire de Sénebrun qui était alors une narration considérée comme un véritable récit historique et non comme un récit légendaire. Après tout, personne ne remettait alors en cause la véra-cité historique du rôle des Troyens dans l’origine du royaume de France. Il nous semble également possible que les deux derniers tiers de l’histoire de Sénebrun, consacrés uniquement au comte du Médoc Sénebrun, pourraient être l’œuvre du maître Arnaut de Listrac, puisque ce nom semble indiquer une origine médocaine. À Londres, un certain maître Ramon-Guilhem aurait ensuite confi é la transcription de cette histoire au clerc gascon nommé Bernard de Graves pour le copier dans ms. 033 de la Collection Schøyen.
Il semble donc que les textes de la description de la Guyenne et de la Gascogne et du premier tiers de l’histoire de Sénebrun ont été composés par des clercs de la collégiale de Saint-Seurin de Bordeaux. D’ailleurs des éléments de ces deux textes permettent d’accréditer cette dernière thèse.
Un doyen de Saint-Seurin à l’origine de la thèse allodiale
À ce stade de notre réfl exion, il est nécessaire de souligner le rôle essen-tiel de Ramon de la Ferreyre25, chanoine, puis à partir de 1288 doyen de Saint-Seurin, dans la formation de la thèse de l’allodialité de la Gascogne26.
24. Le nom Vitalis donne Bidau ou Vidau en gascon (prononcer [ßi’ðaṷ], « Bidaou », en gascon) et Vital en français. Ce chanoine n’est pas connu, mais nous sommes loin de connaître tous les chanoines de Saint-Seurin.
25. La traduction française de son nom est « Raymond de la Ferrière ».26. P. CHAPLAIS, Le traité de Paris de 1259 et l’inféodation de la Gascogne allodiale,
Le Moyen Âge, t. 61, 1955, p. 121–137. Reproduit dans ID., Essays in Medieval Diplomacy and Administration, Londres, 1981, Art. II.
50 G. PÉPIN
P. Chaplais a bien mis en évidence que le premier mémorandum27 affi rmant que la Gascogne avait le statut d’un alleu (terre libre) vis-à-vis du royaume de France fut présenté au roi-duc Édouard Ier par Ramon de la Ferreyre entre 1294 et 129828. Maître Ramon de la Ferreyre était non seulement un impor-tant ecclésiastique gascon de stature locale, mais aussi un clerc du roi-duc Édouard Ier dont il était devenu le représentant le plus renommé auprès du parlement de Paris depuis sa première nomination en 1277. Au parlement de Paris, il agissait bien sûr en tant que juriste chargé de défendre le roi-duc contre les appels gascons présentés contre lui.
Son mémorandum souligne implicitement, que sur l’ensemble des terres du duché de Guyenne (ou d’Aquitaine) possédées par le roi-duc à la suite du traité de Paris de 125929, seulement le Périgord, le Limousin et le Quercy faisaient partie du duché d’Aquitaine originel, la Gascogne en étant dis-tinguée à cause d’un statut différent. Selon lui, cette dernière était en fait avant 1259 un franc-alleu, soit une terre libre qui ne dépendait pas du roi de France, contrairement au duché d’Aquitaine stricto sensu. À l’évidence, il s’agit ici de l’élaboration d’une thèse qui pouvait servir d’alternative au traité de Paris et donc se substituer au statut de vassalité que connaissait le duché d’Aquitaine depuis 1259. Pour des raisons diverses que nous ne pouvons traiter ici, le traité de Paris n’était alors plus en vigueur, avec l’occupation du duché par les troupes du roi de France Philippe le Bel (1294) et la guerre qui s’ensuivit avec les Anglo-Gascons (1294–1297). Il fallait donc trouver une solution alternative à l’hommage au roi de France et aux multiples tracasseries que pouvait causer la supériorité juridique du roi de France et de son Parlement de Paris. Selon le mémorandum de Ferreyre, la Gascogne n’avait pas perdu son statut d’alleu avec le traité de Paris de 1259, car les rois de France n’avaient pas respecté ce traité en particulier dans la remise de territoires promis aux rois-ducs. Ramon de la Ferreyre présenta sa thèse à Rome devant le pape Boniface VIII qui rendit le 30 juin 1298 une sentence en tant que personne privée qui replaçait le duché d’Aquitaine dans le statu quo antérieur à 1294. Il allait d’ailleurs décéder lors de ce séjour romain (1er août 1298)30.
27. Mémorandum reproduit dans H. ROTHWELL, Edward I’s Case against Philip the Fair over Gascony in 1298, English Historical Review, t. 42, 1927, p. 577–582.
28. P. CHAPLAIS, Le duché-pairie de Guyenne : l’hommage et les services féodaux de 1259 à 1303, Annales du Midi, t. 69, 1957, p. 29. Reproduit dans ID., Essays, Art. III.
29. Sur ce traité, voir M. GAVRILOVITCH, Études sur le traité de Paris de 1259, Paris, 1899. Téléchargeable sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33085h
30. CHAPLAIS, Le duché-pairie, p. 34–35.
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 51
Une thèse basée sur un passé historique bien réel
On peut penser que Ramon de la Ferreyre a créé ex nihilo cette thèse de l’allodialité de la Gascogne pour servir les intérêts de son maître lors de la guerre avec le roi de France déclenchée en 1294. En effet, on serait bien en peine de trouver des textes antérieurs à 1294–1298 qui nous exposeraient cette thèse ou même une version moins élaborée31, même si on ne peut tota-lement écarter la possibilité d’une perte documentaire. Il semble toutefois que Ferreyre se basait indubitablement sur un passé historique bien réel de la Gascogne. En fait, jusqu’à son rattachement au duché d’Aquitaine-comté de Poitou vers le milieu du XIe siècle, le duché-comté de Gascogne et ses princes n’avaient quasiment aucun rapport avec les rois des Francs32. La situation d’indépendance de fait du duché-comté de Gascogne à l’intérieur du royaume des Francs occidentaux était sûrement équivalente à celle des comtés de Barcelone, de Gérone et de Vic à la même époque33. Pour la Gascogne, tout comme pour ces comtés, il faudrait sûrement se méfi er de la portée réelle des procédés de datations usités mentionnant les rois des Francs34. L’utilisation régulière de leurs dates de règne dans les protocoles fi naux des chartes témoigne certes que la Gascogne faisait partie en droit du royaume de Francia occidentale, mais l’autorité du roi y était totalement théorique à l’égal, par exemple, de celle des rois de Bourgogne puis des empe-reurs sur la Provence. L’attraction du duché-comté de Gascogne dans l’orbite d’un royaume hispanique n’était alors pas totalement impensable puisque l’on voit son duc-comte Sants-Guilhem (1010–1032) fréquenter régulière-ment la cour de son cousin35, le roi de Pampelune Sancho-Garcia III le Grand (1004–1035)36. Cette situation d’indépendance de fait de la Gascogne était
31. Cela est reconnu par Ibid., p. 30.32. La seule rencontre connue entre un duc-comte de Gascogne (Guilhem-Sants)
et un roi des Francs (Robert le Pieux) a lieu en 1016, en présence du duc d’Aquitaine et du roi de Pampelune, lors des fêtes célébrant l’invention des reliques de saint Jean à Angély,
33. Voir à ce sujet Procès d’independència de Catalunya (ss. VIII–XI). La fi ta del 988, Barcelone, 1989.
34. Ibid., p. 42 et 82.35. Guilhem-Sants, duc-comte de Gascogne (av. 977–ca 996) était marié à Urraca,
la demi-sœur du roi de Pampelune Sancho-Garcia II (970–994). Raoul Glaber le cite comme « duc de Navarre » combattant Al-Mansûr, ce qui signifi e probablement qu’il dirigeait l’armée du roi de Pampelune lors des attaques d’Al-Mansûr contre le royaume de Pampelune en 978 et/ou en 991–992.
36. Collección documental de Sancho Garcés III, el Mayor, rey de Pamplona (1004–1035), éd. R. JIMENO et A. PESCADOR, Pampelune, 2003, passim. Sants-Guilhem est présent en 1024–1025 et 1030 à la cour du roi de Pampelune qui, après sa mort, prétendit brièvement régner sur « toute la Gascogne » (1032–1033). Voir aussi J.M. LACARRA, La projecció política de Sanç el Major als contats de Barcelona i Gascunya, Estudis d’Història medieval, Estudis dedicats a Ferran Soldevila, t. 3, Barcelone, 1970, p. 1–9, et la
52 G. PÉPIN
alors bien connue comme le démontre la célèbre remarque ironique de l’abbé de Fleury Abbon quand il aperçut le monastère de la Réole censé être sous son autorité (1004) : « Maintenant je suis plus puissant que notre seigneur le roi des Francs à l’intérieur de ce territoire [la Gascogne] où sa puissance n’est redoutée de personne, puisque je possède une telle maison37. » Cette situation de fait ne semble pas avoir été entièrement bouleversée quand les ducs d’Aquitaine-comtes de Poitou devinrent ducs-comtes de Gascogne puisque les ducs d’Aquitaine Plantagenêt ne fi rent hommage (de 1156 à 1200) aux rois capétiens que pour le seul Poitou et jamais pour la Gascogne38. Cette perception de la situation gasconne est ainsi présente dans la chanson de geste Garin le Lorrain (XIIe siècle) où le roi se plaignait que [les Bordelais] ne me prisent vaillant .I. angevin,/ Neïs a moi ne daingnierent venir/ Ne reconnoistre que de moi rien tenist,/ Lui ne toz cex qui la dedenz sunt mis39. En effet, la Gascogne était alors perçue en Francia comme un pays bien éloigné, ce qu’exprime bien la chanson de geste Les Narbonnais (composée ca 1205–1210) : « […] en Gascogne, cette terre lointaine40 ».
L’allodialité de la Gascogne serait donc la théorisation d’une longue situation de fait à laquelle personne n’avait songé donner un cadre légal avant 1294–1298.
reprise de cet article en catalan traduit en espagnol dans ID., Historia politica del reino de Navarra, t. 1, Pampelune, 1972, p. 196–203.
37. AIMOIN DE FLEURY, Vie d’Abbon, abbé de Fleury, L’abbaye de Fleury en l’an Mil, éd. R.H. BAUTIER et G. LABORY, Paris, 2004, p. 120–121.
38. J. BOUSSARD, Philippe Auguste et les Plantagenêts, La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations. Actes du Colloque international organisé par le C.N.R.S. (Paris, 29 septembre–4 octobre 1980), éd. R.H. BAUTIER, Paris, 1982, p. 265 n. 6.
39. Garin le Loheren, éd. J.E. VALLERIE, New York, 1947, p. 240, v. 5346–5349, sur la base du ms. A (PARIS, BnF, Arsenal, 2983). Dans Garin le Loherenc, éd. A. IKER-GITTLEMAN, t. 1, Paris, 1996, p. 221, v. 5185–5187, d’après le ms. F (PARIS, BnF, fr. 1582), la comparaison se fait avec un parisi : Il ne me prisent vaillant .i. parisi,/ ne il a moi ne daignent [sic, daingnent] ci venir/ ne reconoistre que rien teignent de mi.
40. Les Narbonnais, éd. H. SUCHIER, t. 1, Paris, 1898, p. 11, v. 233 : […] en Gascongne, cele terre lontaingne. Soulignons que la Gascogne fut la seule possession continentale de Jean sans Terre que le roi de France Philippe Auguste ne tenta jamais d’attaquer et d’annexer à son domaine entre 1203–1204 et la fi n de son règne (1223). Même son fi ls Louis VIII qui conquit le Poitou, La Rochelle et la Saintonge en 1224 ne s’occupa pas de la Gascogne et se contenta de déléguer sans grande conviction sa conquête au comte de la Marche Hugues X de Lusignan. Enfi n, Louis IX n’attaqua pas non plus la Gascogne à la suite de la « rencontre » de Taillebourg et de la bataille de Saintes (1242).
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 53
La thèse de l’allodialité dans nos deux textes : une confi rmation de leur origine sévérienne
Au vu du rôle central joué par un doyen de Saint-Seurin dans l’élaboration et la diffusion de la thèse de l’allodialité de la Gascogne, il n’est donc pas étonnant de déceler dans nos deux textes des éléments appuyant cette thèse, ce qui renforce leur attribution à cet établissement. Dans celui décrivant la Guyenne et la Gascogne, l’auteur indique que la Guyenne (ou Aquitaine) s’étendant de la Loire aux Pyrénées était possédée par Girart de Roussillon « exceptée la Gascogne où il y avait un roi41 ». C’est une affi rmation, certes bien vague, d’une souveraineté de la Gascogne ancrée dans un passé loin-tain. À quel roi de Gascogne ce texte peut-il faire allusion ? On peut penser au roi de Gascogne Yon, présent dans les chansons de geste Renaud de Montauban (ou Les Quatre fi ls Aymon) ou encore Gerbert de Metz et qui serait inspiré du personnage historique nommé Eudes, prince d’Aquitaine-Gas-cogne (ca 714–735)42. L’auteur de la description pouvait également se référer au « roi de Bordeaux » Gaifi er, fi gurant dans plusieurs chansons de geste, dont le modèle historique était Gaïfi er ou Waïfre, le prince d’Aquitaine-Gas-cogne (745–768), petit-fi ls d’Eudes. Ou encore au roi Adrien évoqué dans la charte du duc et comte de Gascogne Guilhem-Sants lors de sa fondation de l’abbaye de Saint-Sever (988). Mais ce passage avait avant tout pour but de souligner le statut souverain immémorial de la Gascogne. La description énumère ensuite quatre traités de paix passés entre les rois d’Angleterre et les rois de France : les traité de Paris (1259), d’Amiens (1279), de Paris de 1286 et celui de 1303, mettant fi n à la guerre entre Édouard Ier et Philippe le Bel. Son auteur conclut cette série de traités par un argument qui sous-tend toute sa description : « En l’an mille deux cent cinquante neuf, au mois d’octobre, le roi Henri [III] fi t hommage, de Bordeaux, de Bayonne et de toute la terre de Gascogne qui était franche et aleu [franc-alleu], au roi de France43. » Cette affi rmation est répétée une deuxième fois avec insistance à la fi n de la description dans toutes les versions du texte à l’exception d’une : « Et sachez que cette Gascogne fut la [terre la] plus franche en alleu que le roi d’Angleterre possédait avant que le roi Henri la prit en hommage du roi de France en l’an mil deux cent cinquante neuf44. »
41. Livre des Coutumes, p. 607 et 610, nos V et VII : et asso tine Girart de Rossilhon, exceptat de Guasconha, on[t] abe [ave] rey.
42. M. ROUCHE, L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes, 418–781, Paris, 1979, p. 108, considère qu’il acquit le titre de roi en 717. Sur le roi Yon de Gascogne et ses rapports avec Eudes d’Aquitaine-Gascogne, sur les chansons de geste où se trouve Yon, sur le titre royal d’Eudes, voir A. LONGNON, Les Quatre fi ls Aymon, Revue des Questions historiques, t. 13, 1879, p. 173–196, 192–193, 185 n. 3 ; J. BÉDIER, Les légendes épiques, 3e éd., t. 4, Paris, 1929 (1re éd., Paris, 1913), p. 222 s.
43. Livre des Coutumes, p. 608 et 612, nos V et VII.44. Ibid., p. 614, no VII.
54 G. PÉPIN
Si, comme nous l’avons vu plus haut, les deux derniers tiers de l’histoire de Sénebrun tiennent plus du roman médiéval que du récit à visée histo-rique, le premier tiers est un récit des origines de l’Aquitaine-Gascogne45. Le « royaume de Bordeaux », dont il est question dans ce récit, s’étendrait de la Loire aux Pyrénées. L’utilisation de la Vita prolixior de saint Martial permet à l’auteur de l’histoire de Sénebrun de tenter d’expliquer la trans-formation de ce « royaume de Bordeaux » en « duché d’Aquitaine » sous le règne du duc Étienne, mais cela suggère que le duché d’Aquitaine était à l’origine un royaume et qu’il devait donc être considéré comme une prin-cipauté souveraine, même sans le titre de royaume. Le passage suivant fait allusion à l’élection par les Gascons en 872 de Sants Mitarra, le fondateur semi-légendaire des ducs-comtes de Gascogne, nommé ici Sancius Gayta, une référence semi-historique présente dans les cartulaires gascons d’Auch et de Lescar. Son assassinat fait référence au probable assassinat du duc-comte de Gascogne Bernard-Guilhem († 1009), perpétré sans doute par le miles Ramon Paba, peut-être à l’instigation de Sants-Guilhem, frère du premier et son successeur jusqu’en 103246. Le comte de Poitiers fut ensuite élu duc et vengea la mort de Sancius Gayta, puis un mariage fi t passer le duché dans les mains du roi d’Angleterre. Ces derniers passages veulent montrer que les Gascons sont libres d’élire leur duc en l’absence d’héritier légitime au duché d’Aquitaine47. Il s’agit d’une affi rmation supplémentaire de souve-raineté. Par ailleurs, il est important de souligner que ce dernier texte ne mentionne jamais l’existence du royaume de France. Enfi n, contrairement à la description de la Guyenne et de la Gascogne, l’Aquitaine (ou Guyenne) et la Gascogne semblent confondues et les habitants du duché d’Aquitaine sont uniquement des Gascons, ce qui correspond à la perception que l’on pouvait en avoir au XIVe siècle.
Il ressort toutefois que ces deux textes défendent chacun à leur manière la thèse de l’allodialité de la Gascogne promue à l’origine par Ramon de la Ferreyre, doyen de Saint-Seurin. Il nous semble donc très plausible que la description de la Guyenne et de la Gascogne provienne bien d’un livre de chroniques de Saint-Seurin de Bordeaux et que le chanoine de Saint-Seurin Bidau de Saint-Sever soit l’auteur du premier tiers de l’histoire de Sénebrun. Dans le désert historiographique gascon – du moins selon nos connaissances actuelles –, ces deux textes auraient alors servi de références pour expliquer
45. Sur la partie de ce récit touchant l’histoire romaine de Bordeaux, voir J. CLEMENS, L’histoire de Cénebrun et la fondation de Bordeaux par les Flaviens, Soulac et les pays médocains. Actes du XLIe Congrès d’études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest, Soulac, Pauillac, Saint-Germain-d’Esteuil, 16 et 17 avril 1988, organisé par la Fondation médullienne, par la Société archéologique et historique du Médoc et par Lasasge, les Amis du site archéologique de Saint-Germain-d’Esteuil, Bordeaux, 1989, p. 209–220.
46. R. MUSSOT-GOULARD, Les princes de Gascogne, Marsolan, 1982, p. 168–169.47. À noter une histoire similaire dans le préambule des Fors de Béarn.
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 55
le passé de l’Aquitaine-Gascogne et justifi er la revendication d’un statut de souveraineté de l’Aquitaine et de la Gascogne vis-à-vis du royaume de France. Cela explique sans doute leur présence dans les cartulaires muni-cipaux de Bordeaux et de Libourne. Il est d’ailleurs très probable que les annales historiques du Livre des Coutumes48 et du Livre Velu de Libourne, ou le récit de la transmission de l’Aquitaine aux rois d’Angleterre présent dans le Livre des Bouillons49 furent aussi à l’origine des composantes du Livre de chroniques, aujourd’hui perdu, de Saint-Seurin de Bordeaux mentionné dans le Harley ms. 4763 de la British Library.
La cérémonie de Saint-Seurin organisée autour du Prince Noir (septembre 1355)
La datation de l’arrivée du Prince Noir à Bordeaux
Cette production historiographique permet de bien mieux comprendre et de replacer dans son contexte un autre texte « curieux » qui se trouve copié dans le cartulaire de Saint-Seurin. Il s’agit de la description d’une cérémonie se déroulant à la collégiale Saint-Seurin autour d’Édouard de Woodstock, prince de Galles (dit le Prince Noir50), peu après son arrivée à Bordeaux à la tête de l’expédition qui était sur le point d’être menée en Gascogne orientale et dans « la langue d’oc » contre le roi de France et ses vassaux (septembre 1355)51. Jusqu’à présent, ce document n’a pas reçu tout l’intérêt qu’il mérite. Il donne pourtant la date exacte de l’entrée à Bordeaux du prince Édouard suivie de son armée anglaise (16 septembre 1355)52, alors que la plupart des
48. Livre des Coutumes, p. 395–402 (BORDEAUX, AM, ms. AA 3, ff. 223r–225v). Elles se terminent ici à l’année 1345, mais dans le Livre Velu de Libourne (ff. 132r–133v), elles se concluent à l’année 1346 (fol. 133v). Les annales reproduites p. 685–692 sont distinctes des premières et se poursuivent jusqu’à l’année 1442. Ces dernières se trouvent également dans une autre copie des Coutumes de Bordeaux composée à Libourne en 1438 et conservée à la BnF (ms. fr. 5361) et elles ont été publiées dans : Petite chronique de Guyenne, jusqu’à l’an 1442, éd. G. LEFÈVRE-PONTALIS, Bibliothèque de l’École des chartes, t. 47, 1886, p. 53–79.
49. Livre des Bouillons, p. 527–528 (BORDEAUX, AM, ms. AA 1, fol. 139r, texte n° 163).50. Le surnom de « Prince Noir » pour désigner Édouard de Woodstock n’est
documenté qu’à partir du XVIe siècle.51. Cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, éd. J.A. BRUTAILS,
Bordeaux, 1897, p. 4–5, no V. Original nommé « le Petit Sancius » conservé à BORDEAUX, Archives Départementales de la Gironde, fol. 7r.
52. Ibid., p. 4, trad. française : « L’année du Seigneur mille trois cent cinquante-cinq, c’est-à-dire le seizième jour du mois de septembre, le seigneur Édouard, prince de Galles, fi ls aîné de notre seigneur le roi d’Angleterre, entra dans la ville de Bordeaux suivi d’une importante armée composée de comtes et de barons d’Angleterre. »
56 G. PÉPIN
historiens actuels placent au 20 septembre l’arrivée à Bordeaux de la fl otte les transportant. L’arrivée de cette fl otte devrait donc être placée au 16 sep-tembre, voire au 15, le débarquement de l’armée et l’entrée offi cielle dans la ville demandant quelque temps et une organisation préalable. La fl otte étant partie du port de Plymouth le 9 septembre, cela donne un voyage d’une durée de 7 ou 8 jours au lieu des 12 jours habituellement avancés. Ce délai est en réalité bien plus conforme à la durée moyenne d’un voyage entre un port du sud de l’Angleterre et Bordeaux quand le temps était clément et les vents favorables, ce qui fut apparemment le cas lors de cette traversée.
En fait, la datation de l’arrivée de la fl otte anglaise au 20 septembre pro-vient d’une mauvaise interprétation d’un passage de l’ouvrage classique de G.F. Beltz portant sur l’Ordre de la Jarretière sous les règnes d’Édouard III et Richard II publié en 184153. Cette datation a été reprise depuis par J.H. Hewitt dans son étude portant sur les deux expéditions menées par le Prince en 1355 et 135654, ce qui a infl uencé tous les travaux modernes sur ce point précis. Ces deux historiens se sont tous deux basés sur le compte de certaines dépenses et paiements effectués lors de ces deux expéditions par John Henxeworth, contrôleur pour le prince55. La première date et le premier lieu mentionné par ce compte est le dimanche 20 septembre à Bordeaux56 et c’est donc sur cette information que s’est basé Hewitt pour dater l’arrivée de la fl otte à Bordeaux. Mais Henxeworth ne donnait dans ce compte que les dates où il effectuait des paiements qui concernaient des dépenses antérieures et il ne tenait donc pas un journal de l’expédition au jour le jour. Par conséquent, cette source ne permet pas du tout d’écarter le témoignage contenu dans le cartulaire de Saint-Seurin, bien au contraire, et il faut donc replacer l’arrivée à Bordeaux de la fl otte transportant l’armée du prince au 15 ou au 16 septembre 135557.
53. G.F. BELTZ, Memorials of the Order of the Garter, Londres, 1841.54. H.J. HEWITT, The Black Prince’s Expedition of 1355–1357, Manchester, 1958, p. 42
n. 169.55. Le compte de John Henxeworth est conservé dans les archives du Duchy
of Cornwall Offi ce à Londres. Je remercie E.A. STUART, l’archiviste de ce fonds, de m’avoir permis de consulter cette très intéressante source. BELTZ, Memorials, a consulté ces comptes mais il ne se prononce pas sur la date d’arrivée (p. 15). Il en publie des extraits (p. 15 n. 3) et surtout à l’append. IV, p. 390–392.
56. LONDRES, Duchy of Cornwall Offi ce, Compte Henxeworth, fol. 1r.57. Le seul historien qui, à notre connaissance, ait pris en considération la date
donnée par le cartulaire de Saint-Seurin est M. WADE-LABARGE dans son Gascony, England’s First Colony (sic), 1204–1453, Londres, 1980, p. 137. À noter aussi la pru-dence, à ce sujet, de J. MOISANT, Le Prince Noir en Aquitaine, 1355–1356 / 1362–1370, Paris, 1894, p. 31.
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 57
L’investiture des comtes de Bordeaux du XIe siècle à Saint-Seurin
Cependant l’intérêt de ce texte est loin de se limiter à cette simple question de datation, même si les précédentes remarques sur ce sujet plaident pour la fi abilité du récit qu’il nous transmet. Il nous montre le doyen et le chapitre de Saint-Seurin occupés à remettre au goût du jour un ancien cérémonial censé avoir servi à l’investiture des comtes de Bordeaux au XIe siècle. L’existence de ce cérémonial, mentionné dans un passage écrit par le chanoine Rufat dans la deuxième moitié du XIIe siècle58 ainsi que dans une notice résumant la charte d’avènement du comte de Bordeaux-duc et comte de Gascogne Sants-Guilhem (1010) et celle de son successeur Eudes (1032 ou ca 1036)59, a été contestée60. Pourtant, une cérémonie du même type est documentée presque à la même époque à Rennes pour l’investiture au comté de Rennes, cette investiture permettant apparemment la domination sur l’ensemble de la Bretagne (Conan II ca 1047 et Alain Fergent ca 108461). Nous pensons donc que cette cérémonie d’investiture au comté de Bordeaux a réellement existé62. D’ailleurs, tout comme pour la cérémonie rennaise, il est possible qu’elle ait alors également servi d’investiture pour le duché-comté de Gascogne, comme semblent l’indiquer la note introductive à la description du cérémonial rédigé par Rufat63, ainsi que la notice rapportant l’avènement du duc-comte Eudes à Saint-Seurin. En effet, ce dernier était alors accom-pagné de l’évêque de Gascogne ou encore des vicomtes de Béarn, de Dax et de Marsan, personnages qui n’avaient en fait pas grand-chose à voir avec une cérémonie dont la portée serait limitée au seul comté de Bordeaux. Lors de cette cérémonie le rôle de l’archevêque de Bordeaux, chargé d’investir
58. Cartulaire de Saint-Seurin, p. 6–8, no VII.59. Ibid., p. 10, no IX. L’épée et la bannière ne sont pas mentionnées dans cette
notice.60. C. HIGOUNET, Histoire de Bordeaux. Bordeaux pendant le haut Moyen Âge,
Bordeaux, 1963, p. 50 ; F. BOUTOULLE, Le duc et la société. Pouvoirs et groupes sociaux dans la Gascogne bordelaise au XIIe siècle (1075–1199), Bordeaux, 2007, p. 79–80 ; ID., Le « rite d’investiture » au comté de Bordeaux à Saint-Seurin : emprunts et intentions d’une construction sans précédents locaux, Autour de Saint-Seurin, p. 255–265.
61. A. CHÉDEVILLE et N.Y. TONNERRE, La Bretagne féodale, XIe–XIIIe siècle, Rennes, 1987, p. 47 et 65 ; A. LE MOYNE DE LA BORDERIE, Histoire de Bretagne, t. 3, Rennes–Paris, 1899, p. 15 n. 3, p. 30.
62. Sur les cérémonies d’investitures princières, voir G. PÉPIN, Les couronnements et les investitures des ducs d’Aquitaine (XIe–XIIe siècle), Francia, t. 36, 2009, p. 35–65, et pour l’investiture de Saint-Seurin, p. 48, 50–52.
63. Cartulaire de Saint-Seurin, p. 6, no VI : il mentionne dans cette note introductive le comes Gasconie et non le comte de Bordeaux. Aux Xe et XIe siècles, la Gascogne était distinguée du comté (et diocèse) de Bordeaux et correspondait à la province ecclésias-tique d’Auch, soit l’ancienne province romaine de Novempopulanie. Cependant, à partir du milieu du XIIe siècle, le comté (et diocèse) de Bordeaux est considéré comme une partie de la Gascogne. Il en sera ainsi pendant tout le bas Moyen Âge.
58 G. PÉPIN
le nouveau comte sous l’autorité de saint Seurin64, et la remise d’une épée et d’un étendard à ce dernier semblent aussi des éléments très plausibles65. La cérémonie est sans doute tombée en désuétude à la suite de la réunion de Bordeaux et de la Gascogne au duché d’Aquitaine-comté de Poitiers. Mais cela n’est pas totalement certain : il est très possible que l’archevêque de Bordeaux présent à la cérémonie d’investiture de Richard Cœur de Lion à Poitiers (en 1172), où ce dernier reçut au moins une bannière66, fût chargé de l’investir du comté de Bordeaux, voire de la Gascogne entière, alors que l’évêque de Poitiers l’investissait uniquement du comté de Poitiers. À cette occasion, la cérémonie aurait été alors déplacée à Poitiers et associée à celle concernant le comté de Poitou, ce qui explique sans doute le besoin du cha-noine Rufat de souligner le fait que cette cérémonie devait être la prérogative exclusive de son église collégiale67.
Une interprétation restreinte de ce cérémonial adaptée à la situation politique contemporaine
Il est inutile de trop insister ici sur l’importance du sanctuaire sévérien au niveau du diocèse et de la ville de Bordeaux, ainsi que sur sa renommée dépassant largement les limites de la Gascogne et de l’Aquitaine. Son grand cimetière antique y était pour beaucoup ainsi que ses reliques, mais son importance symbolique peut être aussi perçue par le fait qu’il est l’établis-sement religieux de la région le plus souvent mentionné (et de loin) dans les chansons de geste68. De même chaque nouveau maire de Bordeaux devait
64. Cartulaire de Saint-Seurin, p. 7, no VII. Dans ce texte, l’archevêque de Bordeaux saint Amand transmet le comté de Bordeaux à saint Seurin, mais on comprend aisément ici que les archevêques de Bordeaux étaient chargés de cette investiture. L’archevêque de Bordeaux aurait donc ici le même rôle que l’évêque de Rennes dans la cérémonie rennaise.
65. Ibid., p. 7. À noter qu’il est documenté à partir de l’avènement de Jean Ier le Roux (1237) que les ducs-comtes de Bretagne-comtes de Rennes étaient également investis avec une épée et un étendard. Voir LE MOYNE DE LA BORDERIE, Histoire de Bretagne, p. 336 n. 2. Sur l’étendard et l’épée comme insignia utilisés par les ducs et comtes d’Europe occidentale, voir D. CROUCH, The Image of Aristocracy in Britain, 1000–1300, Londres–New York, 1992, p. 180–198. Sur ces cérémonies d’investiture ducales et comtales, voir l’article classique de H. HOFFMANN, Französische Fürstenweihen des Hochmittelalters, Deutsches Archiv, t. 18, 1962, p. 92–118. Concernant celle de Saint-Seurin, il ne pense pas qu’elle soit une forgerie (p. 103).
66. La seconde cérémonie d’investiture de 1172, qui se passait à Limoges, ne concernait que le duché d’Aquitaine stricto sensu, s’étendant donc de la Dordogne à la Loire, et non Bordeaux et la Gascogne.
67. Idée exprimée également, bien qu’avec moins de précision, par CROUCH, op. cit., p. 184.
68. Voir M. CIROT DE LA VILLE, Origines chrétiennes de Bordeaux ou histoire et des-cription de l’église Saint-Seurin, Bordeaux, 1867 ; A. DE MAILLÉ, Recherches sur les ori-
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 59
prêter serment à Saint-Seurin69 et chaque nouvel archevêque de Bordeaux devait y résider la nuit précédant son investiture défi nitive dans la cathé-drale70. Forts de cette réputation prestigieuse, sans aucun doute inégalée à Bordeaux et dans le reste de la Gascogne, le doyen71 et les chanoines de Saint-Seurin profi tèrent du séjour que fi t le prince à Bordeaux avant d’aller « contre les ennemis de notre seigneur le roi d’Angleterre qui détenaient sa terre du duché [d’Aquitaine]72 » pour le rencontrer. Ils lui présentèrent alors leur privilège octroyé par saint Amand, archevêque de Bordeaux et (supposé) premier comte de Bordeaux, selon lequel tout comte de Bordeaux désirant lancer une expédition victorieuse contre ses ennemis avait à prendre auparavant les armes, soit l’épée et l’étendard, sur l’autel de Saint-Seurin73. Le prince Édouard voulut alors « respecter la loi de saint Amand et ordonna au doyen et aux chanoines de la dite église de Saint-Seurin qu’ils se préparent à célébrer la messe solennelle74 ».
Cette démarche inédite nécessite quelques explications. Tout d’abord, s’il est vrai que dans la description de la cérémonie écrite par le chanoine Rufat dans la seconde moitié du XIIe siècle, l’épée et l’étendard pris sur l’autel de Saint-Seurin pouvaient servir au comte de Bordeaux partant en guerre, la mention de leur usage pour servir à l’investiture des comtes de Bordeaux est totalement absente de notre texte. Et pour cause : celui qui tenait lieu de « comte de Bordeaux » à l’époque n’était autre que le duc d’Aquitaine, soit le roi d’Angleterre Édouard III, et non son fi ls qui n’était que le lieutenant de ce dernier en Aquitaine. Le doyen et les chanoines de Saint-Seurin ne pouvaient donc proposer une cérémonie d’investiture au prince Édouard. L’accord, semble-t-il assez rapide, du prince et de ses conseillers pour parti-ciper à cette cérémonie religieuse d’un genre peu commun, puisque associée à la seule cérémonie d’investiture connue à Bordeaux et en Gascogne, laisse quelque peu sceptique sur l’histoire rapportée dans le cartulaire. Il semble
gines chrétiennes de Bordeaux, Paris, 1960. À noter la Chronique dite Saintongeaise, une adaptation locale de la Chronique du Pseudo-Turpin très centrée sur Saint-Seurin de Bordeaux car peut-être rédigée par un Saintongeais lié à ce chapitre : Chronique dite Saintongeaise, éd. A. DE MANDACH, Tübingen, 1970.
69. Livre des Coutumes, p. 344, no XXV.70. Bien que visiblement plus ancienne, la première référence à cette cérémonie
remonte à 1380. Voir DE MAILLÉ, Recherches, p. 245 n. 2 et 4.71. Le doyen de Saint-Seurin était à cette époque Pey de la Gleyse (ca 1352–ca 1361).72. Cartulaire de Saint-Seurin, p. 4, no V.73. Ibid., p. 4–5. On ne comprend pas trop pourquoi l’auteur de cette notice utilise
successivement deux termes distinct (gladius et ensis) pour désigner l’épée unique (gladius) servant dans le cérémonial décrit par Rufat. À moins qu’il y ait eu ici une innovation par rapport à l’ancienne cérémonie et qu’un terme désignait ici l’épée et l’autre une dague, soit les deux armes portées couramment par les chevaliers du XIVe siècle.
74. Ibid., p. 5.
60 G. PÉPIN
en effet peu probable que le chapitre collégial de Saint-Seurin l’ait proposée sans que le prince Édouard n’ait eu vent de ce projet à l’avance. En fait, en replaçant cet événement dans son contexte historique, nous pouvons mieux comprendre comment une telle solennité a pu être organisée.
Une expédition et une cérémonie voulues par les dirigeants gascons
Selon le Héraut Chandos, les Gascons « anglais » auraient délégué aupara-vant en Angleterre le captal de Buch Jean75 III de Grailly afi n de demander au roi Édouard III de leur envoyer son fi ls aîné pour diriger la lutte contre les Français76. Selon Froissart, l’ambassade gasconne était constituée des seigneurs de Pommiers, de Rauzan, de Lesparre et de Mussidan77, mais aucun document d’archives ne vient appuyer ce passage. Il est en revanche sûr que le captal de Buch était bien présent en Angleterre en 1354 puisqu’il reconnaît, dans un document daté de Londres le 20 avril 1354, devoir de l’argent au seigneur d’Albret Bernard-Edz V qui le lui prêtait pour payer son séjour londonien78. Il apparaît toutefois assez clairement que l’ambas-sade menée, semble-t-il, par le captal de Buch était le fruit d’une démarche collective menée par les seigneurs gascons les plus importants de Bordeaux et des alentours, soit les plus proches du gouvernement anglo-gascon basé au château de l’Ombrière de Bordeaux. En fait, la demande de l’envoi d’une grande expédition en Aquitaine-Gascogne sous la conduite du jeune prince de Galles79 ne pouvait être faite de la seule initiative du tout aussi jeune captal de Buch80. Les Gascons gravitant à Bordeaux dans les cercles diri-geants de l’Aquitaine anglo-gasconne ont dû tous plus ou moins participer au choix des buts suivis par cette mission. Le besoin de la présence d’un personnage de stature royale ou issu de la famille directe du roi se faisait cruellement sentir dans le duché qui n’avait plus vu son duc d’Aquitaine depuis qu’Édouard Ier l’avait quitté pour la dernière fois en 1289. En 1355, cela faisait donc à peu près 67 ans que les Gascons « anglais » ne connaissaient que les sénéchaux de Gascogne ou les lieutenants du roi en Gascogne, mais aucun roi-duc en personne ou même un fi ls aîné de ce dernier. De plus, la situation militaire du duché nécessitait l’envoi de secours pour contrer les
75. Johan [jo’an] en gascon médiéval.76. HÉRAUT CHANDOS, Vie du Prince Noir, éd. D.B. TYSON, Tübingen, 1975, p. 62–63,
partie du titre du chapitre : […] vient le captal de Buche en Engleterre pur avoir le Prince lour chieftayn en Gascoigne.
77. JEAN FROISSART, Œuvres, éd. J.B.M.C. KERVYN DE LETTENHOVE, t. 5, Bruxelles, 1868, p. 316.
78. PAU, Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques (= ADPA), E 37.79. Le prince est âgé de 25 ans à son arrivée à Bordeaux80. Le captal devait alors avoir une vingtaine d’années. Pour sa biographie, voir
M. VALE, Oxford Dictionary of National Biography, t. 23, Oxford, 2004, p. 257–258.
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 61
récentes offensives vigoureuses (1353–1354)81 du lieutenant en « la langue d’oc » pour le roi de France qui n’était autre alors que le Gascon Jean Ier, comte d’Armagnac82. Les dirigeants gascons du parti anglais ont donc élaboré un projet ambitieux pour reprendre le dessus sur le plan militaire, mais aussi pour frapper les esprits des Gascons « anglais » et donc renforcer leur cohé-sion et leur soutien en faveur du duché anglo-gascon. Il fallait par conséquent donner du lustre à l’arrivée du prince et de son armée à Bordeaux tout en soulignant le respect du prince pour le statut spécifi que du duché au sein de la couronne d’Angleterre. C’est dans ce contexte que sont vraisembla-blement intervenus le doyen et les chanoines de Saint-Seurin car ils ont pu arguer de l’existence de l’ancienne cérémonie d’investiture des comtes de Bordeaux qui se déroulait dans leur église. Il s’agissait d’un ancien rite doté d’une certaine aura de prestige car il n’en existait aucun autre d’équivalent dans les limites du duché d’Aquitaine de l’époque. Ils ont donc interprété la prise des armes sur l’autel de Saint-Seurin en mettant uniquement en avant son aspect de rite préalable à toute expédition victorieuse.
Cette cérémonie a probablement été ensuite suggérée au prince et à la cour royale lors de l’ambassade du captal de Buch en Angleterre. D’ailleurs la délégation gasconne envoyée en Angleterre était sans doute bien plus modeste que ne le supposait Froissart puisque le document daté du 20 avril 1354 qui prouve que le captal de Buch était alors présent à Londres ne cite comme témoin de rang équivalent que le seul seigneur de Montferrand83. Ce dernier était déjà à Londres le 2 avril 1354 où il demandait ses gages de guerre et où il transmettait à la chancellerie une « charte » du seigneur de Mussidan, ce qui prouve bien que ce dernier n’était pas un membre de cette
81. Voir A. BREUIL, Jean Ier, comte d’Armagnac et le mouvement national dans le Midi au temps du Prince Noir, Revue des Questions historiques, t. 59, 1896, p. 44–52.
82. La lettre du prince Édouard adressée à l’évêque de Winchester relatant son expédition de 1355 copiée par Robert de Avesbury dans sa chronique est explicite sur la volonté des Gascons « anglais » de se venger des menées du comte d’Armagnac, ROBERT DE AVESBURY, De Gestis Mirabilibus Regis Edwardi Tertii, éd. E.M. THOMPSON, Londres, 1889, p. 434 : accorde estoit par avys et conseil de touz les seignurs esteauntz entour nous et de seignurs et barons de Gascoigne, par cause qe le counte Dermynak estoit chevetein des guerres nostre adversarie et soen lieutenaunt en tout le pais de Langue de ok, et plus avoit grevé et destruit les lieges gens nostre très honuré seignur et pière le roy [les Gascons « anglais »] et son pays [la Gascogne occidentale] qe nulle autre en ycelles par-ties, qe nous deverons trere vers son pays Dermynak […] Si chivachasmes après parmy la pays Dermynak, grevantz et destruantz le pais, de qoi les lieges [gascons de] nostre dit très honuré seignur, as qeux il avoit devaunt grevé, estoient mult recomfortez.
83. PAU, ADPA, E 37. Les autres témoins de cet acte étaient Guiraut du Puch, juge-mage de Gascogne, ainsi que le chevalier Guillaume de Montendre, l’homme de confi ance du captal de Buch.
62 G. PÉPIN
ambassade et que la liste donnée par Froissart est fautive84. Si l’on suppose que le captal de Buch et le seigneur de Montferrand85 proposèrent cette céré-monie à la cour anglaise lors de cette ambassade d’avril 135486, il n’est donc pas trop étonnant qu’ils soient ensuite les deux seuls seigneurs gascons dont la présence soit explicitement mentionnée dans la notice rapportant cette même cérémonie87. Le prince Édouard n’a donc sûrement pas découvert le « privilège » de Saint-Seurin88 lorsque que le doyen et ses chanoines le lui présentèrent peu après son arrivée à Bordeaux.
84. LONDRES, TNA, C 61/66, membrane 14, v. Guiraut du Puch était allé partici-per à l’élaboration du traité de paix de Guînes (signé le 6 avril 1354) accompagné de Bertran Ferrand, un éminent membre du conseil royal de Bordeaux. Puis ces deux hommes se sont ensuite rendus en Angleterre où ils ont rejoint le captal de Buch et le seigneur de Montferrand pour sans doute former une seule délégation gasconne auprès d’Édouard III. Le séjour des deux offi ciers à Guînes et à Calais, puis en Angleterre a duré du 1er mars au 1er juillet 1354. P. CAPRA, L’administration anglo-gasconne au temps de la lieutenance du Prince Noir, 1354–1362, t. 3, Thèse inédite, Paris, 1972, p. 312 n. 38 et 39. À noter que les prénoms gascons Guiraut et Bertran se prononcent respectivement γi’raṷt et ßer’tran (« Guiraout » et « Bertran’ »).
85. Il nous apparaît que le captal de Buch († 1377) et Bertran, seigneur de Montferrand († 1361), devaient être des frères d’armes, même si Montferrand était probablement plus âgé que le captal. En effet, ils sont encore associés lors d’une petite expédition menée en Saintonge pendant l’hiver 1355–1356 où ils prirent et occupèrent quelques places fortes, comme l’indique une lettre de John Wingfi eld, un offi cier du prince, adressée à Richard Stafford (Libourne, 22 janvier 1356) copiée par ROBERT DE AVESBURY, op. cit., p. 446–447.
86. L’ambassade du captal de Buch, de Bertrand, seigneur de Montferrand, de Guiraut du Puch et de Bertran Ferrand se trouvait en Angleterre pendant le mois d’avril 1354. Le seigneur de Montferrand était de retour en Gascogne dès l’été 1354, donc bien avant l’arrivée de l’expédition du Prince Noir. Il nous semble donc que c’est une erreur de placer cette ambassade gasconne en 1355.
87. Cartulaire de Saint-Seurin, p. 5, trad. franç. : « Et à ces évènements susdits furent présents […] les seigneurs Johan de Grailly [le captal de Buch] et de Montferrand avec plusieurs autres [seigneurs] de Gascogne. » Notre texte mentionne aussi juste auparavant (lu ici sur l’original) : Et in predictis fuerunt domini comites de Vervic, de Oxoniaford, de Sent-Folc, cum pluribus aliis baronibus et militibus de Anglia, « Et à ces évènements susdits furent présents les seigneurs comtes de Warwick, d’Oxford et de Suffolk avec plusieurs barons et chevaliers d’Angleterre. » Il s’agissait des trois principaux chefs militaires expérimentés que le roi Édouard III avait désignés pour épauler son fi ls au cours de la future expédition.
88. Cartulaire de Saint-Seurin, p. 5, no V. Le privilège « comme on le trouve écrit selon la forme écrite ci-dessous » est-il précisé dans notre texte. Il s’agit donc de la notice écrite dans la seconde moitié du XIIe siècle par le chanoine Rufat (Ibid., p. 5–8, nos VI et VII) qui se trouve placée dans notre cartulaire à la suite de notre texte.
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 63
La bénédiction des armes du prince Édouard à Saint-Seurin
À la suite de l’accord public du prince concernant l’organisation de la « messe solennelle » à Saint-Seurin, le prince suivi de sa suite s’y rendit lorsque les préparatifs furent terminés. Puis, sous le patronage des saints Amand et Seurin, les deux saints du sanctuaire, il « prit humblement sur l’autel [de Saint-Seurin] son épée et son étendard89 » comme le « privilège » de Rufat l’indiquait, ce qui implique un rôle essentiel de l’archevêque de Bordeaux Amaniu de la Mothe lors de la bénédiction et de la remise des armes90. Ensuite, comme on pouvait s’y attendre, le prince alla visiter les tombeaux des saints Amand et Seurin91. Il demanda également aux chanoines de Saint-Seurin de « l’avoir en recommandation dans leurs messes et leurs prières92 », requête tout à fait habituelle pour un grand seigneur de cette époque. Puis il ordonna à ses offi ciers que le « cens » prévu par le privilège soit payé en totalité. Dans le privilège, ce cens, présenté comme annuel, était en nature93, mais il est plus que probable qu’il était plus pratique pour le prince et son administration de donner son équivalent sous la forme de numéraire. Il faut probablement voir ce « cens » dans « l’argent offert par notre seigneur [le prince] à Saint-Seurin près de Bordeaux : 67 sous et 6 deniers » mentionné dans le compte de John Henxeworth lorsqu’il effectue des paiements le 5 octobre 135594. Dans ce compte, il s’agit de la seule somme d’argent donnée à un établissement religieux avant le début de l’expédition de 1355. Cette somme est en fait assez modeste car il s’agit ici d’un simple cens recognitif, donc d’un droit à payer à celui que l’on reconnaissait pour seigneur, mais dont le montant en argent était rarement élevé. Lors des deux campagnes de 1355–1356 le prince Édouard n’a d’ailleurs pas trop exagéré dans sa géné-rosité envers les établissements ecclésiastiques95. Mais plus de largesses en période de guerre, qui était une situation nécessitant beaucoup d’argent, était très mal vu des trésoriers suivant un prince engageant de telles dépenses,
89. Ibid., p. 5.90. Cité à la fi n de notre texte, Ibid., p.5 : Amanevo, Burdegale archiepiscopo. Le
prénom gascon Amaniu se prononce ama’niṷ. À noter aussi la présence de John de Chiverston, sénéchal de Gascogne, dénommé ici sous la forme populaire de « séné-chal de Bordeaux » : Johanne de Cavestrona, senescallo Burdegale.
91. Ils étaient alors probablement situés dans la crypte du Xe siècle qui existe toujours de nos jours.
92. Ibid., p. 5.93. Cartulaire de Saint-Seurin, p. 7, no VII.94. LONDRES, Duchy of Cornwall Offi ce, Compte Henxeworth, fol. 3r : Item in
denariis pro domino oblatis apud Sancti Ceveryni iuxta Bordeux LXVII s. VI d. Cette somme fut donnée avant la date du 5 octobre 1355.
95. Ibid., ff. 3v et 4r : le prince donne 100 sous aux franciscains de Samatan et 142 léopards aux frères et aux sœurs du couvent dominicain de Prouille où le prince avait séjourné le 15 novembre 1355 et où il avait été admis dans la confraternité spirituelle de ce couvent.
64 G. PÉPIN
comme c’était le cas avec le dévot Charles de Blois († 1364), l’un des deux prétendants au trône ducal breton96. Soulignons ici qu’après son expédition de 1355, le prince donna 7 léopards à Saint-Seurin (somme mentionnée au 18 janvier 1356), mais attendit bien plus pour faire preuve d’une générosité similaire (don de 4 nobles) envers l’église cathédrale de Bordeaux (somme mentionnée au 29 juin 1356), ce qui appuie un peu plus notre démonstration portant sur la réalité de la cérémonie qui fut organisée à Saint-Seurin en septembre 135597.
Le texte du cartulaire ne précise pas le jour précis où fut organisée cette cérémonie de bénédiction des armes à Saint-Seurin, et si elle est évidemment antérieure au début de l’expédition (5 octobre), on ignore quand la placer par rapport à la cérémonie plus classique qui fut organisée dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux, le 21 septembre 1355. Cette dernière ne soulève aucun problème majeur : le prince, en présence d’un large public, fi t lire les lettres de son père qui le nommaient lieutenant en Aquitaine, puis il jura aux Bordelais de respecter leurs franchises et privilèges, enfi n, il reçut leur serment de fi délité en tant que lieutenant du roi98.
* * *
Les renseignements qui nous sont fournis par deux manuscrits anglais nous font donc penser que les deux textes copiés dans les cartulaires municipaux bordelais que nous avons abordés au cours de cette étude ont été composés à la collégiale Saint-Seurin de Bordeaux. Leur adhésion à la thèse de l’allo-dialité de la Gascogne confi rme cette provenance puisque la personne qui exposa cette thèse pour la première fois (vers 1294–1298) fut Ramon de la Ferreyre, doyen de Saint-Seurin. Bien que les éléments parvenus jusqu’à nous soient parcellaires et très probablement incomplets, nombre de ma-nuscrits sévériens ayant disparu99, il nous semble possible d’envisager que Saint-Seurin de Bordeaux fut autour de la première moitié du XIVe siècle le lieu de création d’une historiographie, certes modeste mais signifi cative, et d’une idéologie soutenant l’existence du duché d’Aquitaine anglo-gascon. Cette idéologie se fondait essentiellement sur l’idée que le statut originel de la Gascogne était celui d’une terre libre et souveraine face au royaume de France et que ce statut pouvait – et même devait – être restauré. Cette thèse
96. J.C. CASSARD, Charles de Blois (1319–1364), duc de Bretagne et bienheureux, Brest, 1994, p. 39.
97. LONDRES, Duchy of Cornwall Offi ce, Compte Henxeworth, ff. 11r et 26r.98. Livre des Coutumes, p. 439–444, no XLVI.99. Cartulaire de Saint-Seurin, p. IX : « [Les] archives [du chapitre collégial de
Saint-Seurin de Bordeaux], brûlées peut-être au XIIIe siècle, furent mises au pillage en décembre 1542 par un parti de lansquenets et souffrirent d’un vol important en 1606 ou peu avant. »
LA COLLÉGIALE SAINT-SEURIN DE BORDEAUX AUX XIIIE–XIVE SIÈCLES 65
avait bien sûr pour but de régler les nombreux problèmes posés par le fait que le roi d’Angleterre était vassal du roi de France pour son duché d’Aqui-taine. Il est possible que ces idées aient pu inspirer en partie la demande par Édouard III d’une grande Aquitaine souveraine au traité de Brétigny–Calais de 1360, et même la création de la principauté d’Aquitaine en juin 1362. Il est à se demander même si elles n’ont pas inspiré le comte de Foix-vicomte de Béarn Gaston Fébus qui affi rma à partir de 1347 que le Béarn était un franc-alleu dont il ne devait l’hommage à quiconque, en bref un alleu souverain100.
Le texte de la description de la Guyenne et de la Gascogne date sans doute d’une période comprise entre 1317 et 1360. L’histoire de Sénebrun se trouve copiée dans le ms. 033 de la Collection Schøyen, un manuscrit anglais qui fut composé au cours du règne du roi-duc de Bordeaux Richard II (1377–1399). Donc cette histoire fut vraisemblablement écrite antérieurement et l’on peut supposer qu’elle date peu ou prou de la même période que la description de la Guyenne et de la Gascogne. La cérémonie de bénédiction des armes du Prince Noir organisée à Saint-Seurin en septembre 1355 entre dans ce contexte d’élaboration d’une idéologie soutenant l’idée d’une Aquitaine souveraine. Ce cérémonial, inspiré d’un ancien rite d’investiture au comté de Bordeaux, permettait de souder les Gascons du parti anglais avant le début d’une expédition menée contre les Français. Les dirigeants gascons du duché d’Aquitaine avaient souhaité l’envoi d’une armée pour contrer les offensives françaises menées par le comte d’Armagnac, le plus grand sei-gneur de la Gascogne orientale. Et ils avaient insisté pour que le fi ls aîné du roi Édouard III dirige cette expédition militaire. Connaissant la production historiographique sévérienne, il n’est donc pas trop surprenant que le doyen et le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux aient alors proposé une cérémonie soulignant, entre autres, la spécifi cité du duché d’Aquitaine anglo-gascon. Conforté par le succès de l’expédition de 1355 et la victoire de Poitiers, cet événement resta par la suite dans les mémoires au moins jusqu’en 1419, date à laquelle le chapitre de Saint-Seurin affi rmait au pape Martin V que les princes anglais qui venaient combattre en Aquitaine devaient prendre les armes dans leur basilique101.
Par conséquent, il va sans dire que l’idéologie royale française qui se développait à la même époque102 n’avait aucune infl uence dans le duché
100. P. TUCOO-CHALA, Gaston Fébus et la vicomté de Béarn, 1343–1391, Bordeaux, 1960, p. 62 ; ID., La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté des origines à 1620, Bordeaux, 1961, p. 83–85.
101. H. DENIFLE, La désolation des églises, monastères et hôpitaux en France pendant la guerre de Cent ans, t. 1, Paris, 1897, p. 132–133, no 350 (lettre du pape Martin V, 27 octobre 1419) : et in qua etiam incliti regni Anglie principes, dum ad Aquitanie partes se transferunt bellaturos, arma ex ordinatione prefati Sancti Amandi recipere consueverunt. On ignore si cette cérémonie fut réellement organisée à nouveau après 1355.
102. Voir C. BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris, 1985.
66 G. PÉPIN
d’Aquitaine (ou de Guyenne) anglo-gascon qui en connaissait une autre affi rmant son statut souverain face au royaume de France et son union perpétuelle avec le royaume d’Angleterre103. Cette dernière idéologie est d’ailleurs très visible en 1395 dans les revendications des trois états de Guyenne face aux prétentions de Jean de Gand à devenir duc de Guyenne (ou d’Aquitaine)104. Nourri par une tradition fondée et entretenue par ses prédécesseurs, il n’est pas non plus très étonnant que le doyen de Saint-Seurin Pey du Taste, envoyé en Angleterre par les trois états de Guyenne en 1449, ait été le Gascon le plus infl uent alors présent en Angleterre au point qu’il devint même membre du conseil royal d’Angleterre en février 1453105. À la suite des deux conquêtes françaises, il se fi t d’ailleurs l’avocat constant d’une reconquête du duché.
University of Oxford, History Faculty Guilhem PÉPIN
103. Voir aussi G. PÉPIN, Les cris de guerre « Guyenne ! » et « Saint Georges ! ». L’expression d’une identité politique du duché d’Aquitaine anglo-gascon, Le Moyen Âge, t. 112, 2006, p. 263–281.
104. Voir TNA, E 30/1232.105. M.G.A. VALE, English Gascony, 1399–1453, Oxford, 1970, p. 144–145 et
Y. PÉROTIN, Les chapitres bordelais contre Charles VII, Annales du Midi, t. 63, 1951, p. 34, 36 et 39–41. Le prénom Pèy, aboutissement gascon du latin Petrus (Pierre), se prononce [pε̯̯̯i].