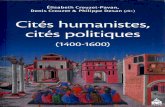Abraham ibn Ezra et Moïse Maïmonide cités par Spinoza ou l'impossibilité d'une philosophie juive
-
Upload
sorbonne-universite -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Abraham ibn Ezra et Moïse Maïmonide cités par Spinoza ou l'impossibilité d'une philosophie juive
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 415
Revue des études juives, 168 (3-4), juillet-décembre 2009, pp. 415-464.doi: 10.2143/REJ.168.3.2044662
D a v i d L E M L E R
École Normale Supérieure (Paris)
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDECITÉS PAR SPINOZA OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UNE
PHILOSOPHIE JUIVE*
RÉSUMÉ
Le Traité théologico-politique, écrit en latin, se présente comme un texte destiné àun lecteur chrétien. On y trouve pourtant un nombre non négligeable de citations deMoïse Maïmonide et d’Abraham Ibn Ezra, citations en hébreu d’ouvrages adressésen priorité à des Juifs. L’analyse proposée dans cet article part du postulat que c’esten effet à un lectorat juif que Spinoza a souhaité s’adresser à travers ces citations.Une citation du Mishneh Torah concernant le noachisme et une citation du Guidedes égarés à propos de la création du monde servent à montrer les limites du ratio-nalisme maïmonidien. Spinoza les utilise pour montrer que la philosophie deMaïmonide repose entièrement sur le caractère révélé de la Torah. Or c’est précisé-ment à une déconstruction de ce dogme que sert la mise en œuvre d’une lecture cri-tique de l’Écriture, appuyée sur l’autorité d’Ibn Ezra. Spinoza a, en effet, donné unelecture radicale de certains textes qu’Ibn Ezra avait délibérément laissés ouverts àl’interprétation, de manière à en faire un hérétique au regard de la tradition. La lec-ture spinozienne de Maïmonide et d’Ibn Ezra admet en réalité de lourds partis prisqu’il convient de mettre en lumière et n’a d’autre but que de contester la possibilitémême d’une philosophie juive.
SUMMARY
The Theologico-political Treatise, written in Latin, appears to be addressed to aChristian reader. However, it contains a significant number of quotations from textsby Moses Maimonides and Abraham Ibn Ezra, destined first and foremost to a Jew-ish reader. The analysis proposed in this essay is based on the hypothesis thatSpinoza actually wished, through these quotations, to address a Jewish readership.A quotation from the Mishneh Torah, relating to noachism, and one from the Guidefor the perplexed about the creation of the world, tend to show Maimonides’ ration-alism as limited. They are used by Spinoza to illustrate the fact that his philosophyas a whole depends on Torah as a revealed text. Now the implementation of a criti-
* Cet article est tiré d’un mémoire de Master 2, mené dans le cadre de la Section dessciences religieuses de l’ÉPHÉ, en association avec le Centre Alberto Benveniste dirigé parM. Jean-Christophe Attias.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am415
416 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
cal reading of the Scriptures, backed up by the authority of Ibn Ezra, aims preciselyat deconstructing this dogma. Indeed, Spinoza reads some texts Ibn Ezra deliber-ately left open to diverse interpretations in such a manner that he appears to be aheretic in regard to the tradition. In fact, Spinoza’s reading of Maimonides and IbnEzra is biased in a way that has to be brought to light and has no other aim thandenying the very possibility of a Jewish philosophy.
Les conclusions mêmes du Traité théologico-politique ne laissent quepeu de doute sur l’opinion de Spinoza concernant la possibilité de toute phi-losophie religieuse. Dans la mesure où il entend clairement dissocier philo-sophie et théologie et réduire la théologie à une doctrine de l’obéissance etde la charité, il laisse peu de place à une pensée qui s’en remettrait à la foisà la raison et à la révélation. Pourtant, malgré cet effort pour construire unedémonstration de l’incompatibilité de la philosophie et de la théologie, dansun texte qui s’adresse en latin, de façon assez explicite à un lecteur chré-tien1, Spinoza a jugé nécessaire à maints endroits stratégiques du Traité deciter de longs extraits des commentaires bibliques d’Abraham Ibn Ezra,ainsi que du Mishneh Torah et du Guide des égarés de Maïmonide.
Nous souhaitons montrer dans cet article qu’il a expressément souhaitépointer certains aspects problématiques au sein de l’œuvre de Maïmonidepour contester la légitimité d’une philosophie spécifiquement juive etqu’Ibn Ezra constitue l’un des instruments de cette contestation. S’adres-sant à des Juifs familiers de la philosophie, Spinoza présente l’image d’unMaïmonide démystifié et celle d’un Ibn Ezra hérétique, ayant contesté, defaçon cryptique, le caractère révélé de la Torah et par conséquent sa capa-cité à livrer des enseignements de quelque sorte que ce soit et particulière-ment de type philosophique.
Par delà la thèse principale du Traité qui concerne la philosophie et lareligion en général, Spinoza a souhaité dire quelque chose de la philosophiejuive en particulier. Exhibant des textes problématiques d’auteurs tels queMaïmonide et Ibn Ezra, Spinoza élargit le spectre de ses lecteurs, pour yinclure ceux que Maïmonide lui-même avait qualifiés «d’égarés» ou de«perplexes»: ces Juifs élevés dans la tradition et l’observance mais qui,ayant été initiés à la philosophie, sont pris de «troubles violents» devant le«sens extérieur de la Loi»2. C’est à une contestation de la tentative
1. Cf. L. STRAUSS, La Critique de la religion chez Spinoza ou les fondements de la sciencespinoziste de la Bible. Recherches pour une étude du Traité théologico-politique, trad.G. ALMALEH, A. BARAQUIN et M. DEPADT-EJCHENBAUM, Paris, 1996 [1930], p. 120 et passim.
2. Cf. Guide des égarés. Traité de théologie et de philosophie, trad. S. MUNK, Paris, 2003[1866], I, Introduction. Par la suite, nous noterons simplement Guide.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am416
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 417
maïmonidienne de réconciliation du judaïsme et de la raison que s’adonneSpinoza dans le Traité. Il le fait en pointant les contradictions deMaïmonide, avec l’aide d’Ibn Ezra. Les citations juives du Traité en fontdès lors une sorte de Guide des égarés inversé.
Nous étudierons successivement pour le montrer deux citations deMaïmonide, une citation du Mishneh Torah et une citation du Guide deségarés, et trois citations d’Ibn Ezra, qui constituent les citations principalesde ces deux auteurs dans le Traité3.
A. Maïmonide
1. Le Mishneh Torah
a) La citation
Au chapitre V, consacré aux raisons du culte cérémoniel et des récits demiracles, une citation du Mishneh Torah sert à illustrer le caractère pure-ment légal et irrationaliste de la religion juive. Le judaïsme, contrairementau christianisme et surtout à la religion «naturelle» (fondée sur la lumièrenaturelle) que prône Spinoza, est réduit par lui à la pure soumission àune législation que l’on suppose d’origine divine, promettant un accès à labéatitude après la mort.
Le texte de Maïmonide qui sert «d’illustration» à cette thèse sur lejudaïsme est paradoxalement un texte qui concerne le noachisme, autrementdit les Gentils. Le statut de fils de Noé (בן נח) ou de noachide est en effetun statut juridique que, selon les sages du Talmud4, la Torah attribue àtout homme. Il correspond à l’idée selon laquelle Noé, voire avant luiAdam, qui a donné naissance à toute l’humanité, a reçu directement deDieu un certain nombre de commandements fondamentaux. L’institution dunoachisme témoigne, de la part des sages du Talmud, d’un souci de l’huma-nité tout entière et fait du judaïsme une religion qui concerne tous les hom-mes, juifs comme non juifs. On peut considérer que la liste que Maïmonidedresse de ces commandements noachiques, fait consensus au sein dujudaïsme: l’interdit de l’idolâtrie, du blasphème, du meurtre, de l’inceste,du vol, de manger le membre d’un animal vivant et l’obligation d’établirdes tribunaux5. Ces sept commandements peuvent être compris comme des
3. On trouve en outre quelques autres occurrences des noms d’Ibn Ezra et de Maïmonidemais elles relèvent pour la plupart de la simple mention plutôt que de la citation et se prêtentmoins à l’analyse.
4. Cf. notamment, TB Sanhedrin, 56a et b.5. Cf. Mishneh Torah, Hilkhot Melakhim, IX, 1-2.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am417
418 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
lois strictement rationnelles, universellement reconnues en dehors mêmede toute révélation. On est tenté de rapprocher cette liste de celle que leTalmud donne pour illustrer les «lois» (משפטים), par opposition aux «dé-crets» (חוקות), dans le traité Yoma (67b):
«Vous mettrez en œuvre mes lois (משפטים)» (Lv 18, 4): il s'agit des chosesque, si elles n'étaient pas inscrites dans la Torah, il serait logique de les yinscrire, telles que la prohibition de l'idolâtrie, les lois concernant les relationsinterdites, les interdits du meurtre, du vol et du blasphème.
Lois qui auraient sans doute été édictées par les hommes si elle n’avaitpas été énoncées par Dieu, les lois noachiques sont cela même qui au seindu judaïsme ressemble le plus aux prescriptions d’une religion de la raisonque Spinoza appelle de ses vœux. Si Spinoza choisit précisément un textesur le noachisme pour démontrer le caractère irrationnel du judaïsme, c’estparce qu’il entend neutraliser l’objection que pourrait constituer contre luila législation noachique, en tant que symbole d’un judaïsme universaliste.Le noachisme est ramené à une institution qui distingue les Juifs des autrespeuples sous le rapport du nombre des commandements et par conséquentde l’accès à la béatitude. Une note sur les lois noachiques6 est l'occasiond'une réflexion sur les commandements en général et leur statut dans lejudaïsme. Ils sont directement pensés dans leur rapport à une récompense etplus spécifiquement à une récompense eschatologique. Le judaïsme, danscette perspective, apparaît comme le type même de la religion supersti-tieuse qui ne fait qu’alimenter deux passions fondamentales: la crainte (dela punition) et l’espérance (du bonheur dans ce monde et de la béatitudeaprès la mort).
Mais l’instrument principal de la neutralisation par Spinoza dunoachisme comme argument en faveur d’un universalisme et rationalismejuif est sa citation d’un passage du Mishneh Torah:
[…] celui qui ignore totalement [les chroniques et les récits bibliques] et qui anéanmoins des opinions salutaires et une vraie règle de vie, celui-là connaît lavraie béatitude et l’esprit du Christ est véritablement en lui. Or les Juifs pen-sent exactement le contraire. Ils posent en effet que les opinions vraies ou lavraie règle de vie ne servent en rien à la béatitude tant que les hommes lesembrassent par la seule lumière naturelle, et non à titre d’enseignements révé-lés à Moïse par prophétie. Cela, Maïmonide ose l’affirmer ouvertement en cestermes (chapitre 8 des Rois, Loi 11): כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זהמחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוהבהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על יד משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן אבל
6. TTP, p. 235 (note de bas de page). Dans l’ensemble de cet article, nous notons TTPpour renvoyer à l’édition suivante du Traité théologico-politique: Spinoza, Œuvres III. Traitéthéologico-politique, trad. J. LAGRÉE et P.-F. MOREAU, Paris, 1999.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am418
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 419
אם עשהן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ואינו מחכמיהם.«Quiconque a pris sur soi (omnis, qui ad se sucipit) les sept préceptes et les aobservés avec zèle fait partie des pieux des nations et sera héritier du monde àvenir; à condition toutefois de les prendre sur soi et de les observer parce queDieu les a prescrits dans la Loi et nous a révélé par l’intermédiaire de Moïsequ’ils avaient été prescrits auparavant aux fils de Noé: mais s’il les observeconduit par la raison, il n’habite par parmi nous et ne fait pas partie des pieuxni des sages des nations7.»
Ce texte entre parfaitement dans le cadre de l’argumentation de Spinoza.Il montre Maïmonide, celui-là même qui a la réputation d’être le plus grandrationaliste juif du Moyen Âge, se refusant à penser le noachisme commeune législation purement rationnelle. Il ne nie pas que l’on puisse arriver àdéduire les commandements noachiques à partir de purs raisonnements,mais il interdit tout accès à la béatitude, voire le simple statut de «sage desnations», à qui ne les pratiquerait pas parce qu’ils ont été révélés à Moïseau mont Sinaï, mais parce que sa raison les lui prescrit. D’un certain pointde vue — et de ce point de vue seulement —, Spinoza est fondé à identifierici la position de Maïmonide avec celle du judaïsme: si le plus rationalistedes Juifs refuse de penser la plus rationaliste des institutions légales dujudaïsme comme une loi uniquement rationnelle, alors à plus forte raisontous les autres Juifs. Tel est l’enjeu le plus apparent de cette citationdu Mishneh Torah par Spinoza: donner une preuve «de l’intérieur» de lavérité de sa présentation du judaïsme comme religion légaliste, supersti-tieuse et irrationaliste.
Avec la citation du texte du Mishneh Torah par Spinoza à la fin duchapitre V, Maïmonide fait son entrée dans le Traité sous les traits d’unreprésentant d’un judaïsme particulariste et étriqué. Cette image trancheavec la réputation générale de Maïmonide auprès d’un public juif aussi bienque chrétien. Le monde latin le connaît notamment à travers les traductionsde son Guide des égarés par Jan Mantino (Paris, 1520) et par Jean Buxtorf(Bâle, 1629) qui témoignent de l’existence d’un intérêt philosophique pourcet ouvrage dépassant le cadre du judaïsme. Parmi les Juifs, on garde enmémoire les deux grandes et violentes querelles autour du Guide qui ontdivisé une partie du monde juif, entre le XIIe et le XIIIe siècle, et au coursdesquelles de nombreux anti-maïmonidiens lui reprochaient précisémentson usage de la philosophie et des sciences profanes, autrement dit sa tropgrande «ouverture». La citation du Mishneh Torah par Spinoza a donc
7. TTP, p. 233-235 (traduction légèrement modifiée). Nous citons le texte dans sa traduc-tion française en y intercalant le texte en hébreu qui figure, dans notre édition de référence,uniquement dans le texte latin.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am419
420 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
un enjeu très clairement polémique, à l’encontre de cette image d’unMaïmonide-juif-philosophe-éclairé.
Cette dimension polémique ressort avec plus d’évidence encore de laparaphrase d’un extrait du Kebod Elohim de Yosef Ibn Shem ™ob8, qui suitimmédiatement la citation de Maïmonide, dans le texte de Spinoza. Cettecitation-paraphrase d’un auteur mineur comparé à Maïmonide n’apporterien à l’argumentaire de Spinoza si ce n’est d’appliquer précisément àAristote, le Philosophe par excellence, les conséquences de la sentencehalakhique du Mishneh Torah. Quand bien même, en effet, il aurait déduitrationnellement les sept commandements noachiques dans l'Éthique àNicomaque, il n'aurait pas eu accès au monde à venir. Maïmonide, qui apourtant beaucoup emprunté à Aristote et à de nombreux autres philosophesgrecs et arabes en matière de sciences et de philosophie, leur interdit, dansce passage du Mishneh Torah, un accès au monde à venir ainsi que le sim-ple statut de «sage des nations». Le Maïmonide que Spinoza entend pré-senter à ses lecteurs, loin d’être un penseur universaliste et intellectualiste,apparaît comme exclusiviste et humiliant la raison devant la révélationsinaïtique.
b) Un texte étonnant au sein de l’œuvre de Maïmonide
Spinoza n’est pas le premier à utiliser ce texte pour mettre en questionl’image d’un Maïmonide intellectualiste et à certains égards peu regardantde la tradition rabbinique. Il est clair que ce texte et les propos qu’ilcontient font figure d’hapax au sein de l’œuvre de Maïmonide. Ainsi, dansune intention radicalement inverse à celle de Spinoza, ce texte a pu être misen avant pour défendre l’orthodoxie de Maïmonide, mise en question parcertains anti-maïmonidiens au sein du judaïsme. Au début du XVIe siècle,Mosheh Alaskar utilise le même passage du Mishneh Torah, pour défendreMaïmonide des accusations d’intellectualisme formulées dans le Seferha-emunot de Shem ™ob Ibn Shem ™ob.
En outre et de manière assez étonnante, Maïmonide a été utilisé pourdéfendre une thèse totalement opposée en matière d’accès des Gentils aumonde à venir. Dans son Nishmat Îayyim9, Menasheh ben Israël, dont onsait qu’il fut un des maîtres de Spinoza, appuie la thèse selon laquelle lespieux parmi les nations du monde ont part au monde à venir10 sur des réfé-
8. TTP, p. 235. Sur cet auteur, cf. J.-P. ROTHSCHILD, «Le dessein philosophique de JosephIbn Shem Tob (flor. 1442-1455)», Revue des études juives (162), 2003, p. 97-122.
9. Menasheh ben Israël, Sefer nishmat Ìayyim, Leipzig, 1862, II, 7, fol. 38b-39a.10. Certes une part moindre que celle d’Israël.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am420
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 421
rences au Zohar et au Kuzari, mais aussi sur des propos de Maïmonide. Ilcite notamment un passage du Guide des égarés, III, 1711 ainsi qu’une lettrede Maïmonide à Îasdai Ha-levi, dans laquelle on peut lire:
Concernant ce que tu as demandé sur les Nations. Sache que c’est au cœur quele Miséricordieux demande des comptes et que les choses [sont jugées] selonl’intention du cœur. C’est pourquoi les sages de vérité, nos Maîtres, que lapaix soit sur eux, ont dit que les pieux des nations du monde ont une part aumonde à venir…
Cependant, il suffit de poursuivre la lecture de cette lettre pour s’aperce-voir que Maïmonide y rapporte également le salut du Gentil à sa reconnais-sance de la Torah. Ainsi:
Il ne fait, en effet, aucun doute que celui qui dispose son âme à la vertu et à lascience, dans la croyance au Créateur Béni ('באמונת הבורא ית), a évidemmentsa place au monde à venir. Ainsi, nos Maîtres, la paix soit sur eux, ont-ils dit:«Même un Gentil qui s’affaire à la Torah de Moïse notre Maître, la paix soitsur lui, est comme un grand prêtre.»
Moses Mendelssohn, dans le cadre de sa défense du judaïsme au cours dece que l’on a appelé «l’affaire Lavater», fait montre d’un embarras sembla-ble face aux décisions halakhiques du Rambam. Un de ses principaux argu-ments pour défendre la compatibilité du judaïsme et de la philosophie desLumière est l’absence de prosélytisme juif. Conformément aux thèses sou-tenues par la suite dans sa Jérusalem, Mendelssohn présente le judaïsmeprincipalement comme une loi positive liant les seuls Juifs, mais ne signi-fiant en rien une quelconque supériorité du peuple juif. Le noachismeconstitue à cet égard une preuve de la thèse mendelssohnienne. Or, dans laLettre à Lavater de 1769, Mendelssohn s’appuie sur la liste des sept loisnoachiques établie par Maïmonide dans le Mishneh Torah mais se sent enmême temps obligé de mentionner le texte cité par Spinoza, en précisantque la restriction maïmonidienne concernant l’accès des non-juifs au
11. «Partout [nos docteurs] disent clairement que, pour Dieu, la justice est une choseabsolument nécessaire, c'est-à-dire qu’il récompense l’homme pieux pour tous ses actes depiété et de droiture, quand même ils ne lui auraient pas été commandés par un prophète, etqu’il punit chaque mauvaise action qu’un individu a commise, quand même elle ne lui auraitpas été défendue par un prophète; car elle lui est interdite par le sentiment naturel [IbnTibbon: שכל] qui défend l’injustice et l’iniquité. “Le Très-Saint, disent-ils, n’enlève à aucunecréature ce qu’elle a mérité." Ils disent encore: “Quiconque dit que Dieu est prodigue (dansle pardon) mérite d’avoir les entrailles déchirées; il est vrai que Dieu use de longanimité maisil réclame ce qui lui est dû." Ailleurs il est dit: “Celui qui accomplit un devoir qui lui estprescrit (par la religion) n’est pas comparable à celui qui l’accomplit sans qu’il lui ait étéprescrit"; ils disent donc clairement que celui-là même à qui la chose n’est pas imposée (parla religion) en est récompensé.» (Guide, III, 17, p. 126-128.)
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am421
422 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
monde à venir n’a pas de source dans le Talmud12. Nous reviendrons ulté-rieurement sur cette question.
Il est donc clair que le texte du Mishneh Torah cité par Spinoza faitproblème au sein même de l’œuvre de Maïmonide13. Il est tout à fait possi-ble de trouver d’autres textes dans lesquels Maïmonide lui-même sembleenseigner le contraire. Il est d’ailleurs plus que probable que cet effort pourtrouver des textes de Maïmonide qui enseignent le contraire de ce passagedu Mishneh Torah est une manière d’invalider les propos du passage enquestion. Si l’on peut trouver un texte du Guide qui contredit cette halakha,on affirmera que la véritable thèse de Maïmonide est à chercher dans sonouvrage philosophique ésotérique et non dans son code légal exotérique, oùil s’adresse au commun des fidèles. Cependant, que les propos du MishnehTorah soient répétés ailleurs dans l’œuvre de Maïmonide et qu’ils le soientdans une correspondance privée rend cette argumentation problématique.Spinoza, en citant ce texte du Mishneh Torah, pointe une difficulté doctri-nale chez Maïmonide, qu’on ne résoudra pas facilement par des argumentsphilologiques ou en niant tout simplement que ce texte reflète la véritablepensée de Maïmonide.
c) Parenthèse philologique
Il existe certes une controverse philologique à propos de ce textedes Hilkhot Melakhim. Une autre version que la version mentionnée parSpinoza figure en effet dans certains manuscrits. Ainsi, de nombreuseséditions modernes «corrigées» du Mishneh Torah, dont par exemple l’édi-tion Fränkel14, donnent, conformément à ces manuscrits, «et il n’est pas unpieux des nations du monde, mais (אלא) un de leurs sages» à la place de«et il n’est ni un pieux des nations du monde, ni (ואינו) un de leurs sages».
12. Lettres juives du célèbre Mendels-sohn, philosophe de Berlin; avec les remarqueset réponses de Monsieur le Docteur Kölble et autres savants hommes. Recueil mémorableconcernant le judaïsme, Francfort et la Haye, 1771, p. 18-19 (traduction modifiée à partir dutexte allemand, Moses MENDELSSOHN, Schreiben an den Herrn Diaconus Lavater zu Zürick,Berlin et Stettin, 1770, p. 14-17).
13. Témoin du caractère problématique de ce texte et d’autre textes où Maïmonide sembleréserver l’accès au monde à venir aux Juifs, le commentaire suivant du R. ∑vi Hirsch Îayyot:«Gemara: “Sache que le monde à venir n’est fait que pour les justes et Israël etc." LeRambam a écrit, dans le chapitre 14 des Lois sur les relations interdites, cinquième loi:“Sache que le monde à venir n’est réservé qu’aux justes et il s’agit d’Israël" (voir là bas).Mais, outre que cela n’est pas écrit ainsi dans le Talmud, le Rambam lui-même a écrit dans lechapitre 3 des Lois sur la Teshubah et dans le chapitre 21 [sic. en réalité 11] des Lois sur letémoignage que les pieux des nations du monde ont part au monde à venir. C’est pourquoi [ilsemble qu’] une erreur de copiste ait eu lieu dans le [texte du] Rambam.» (cf. Îiddusheima-ha-RaÒ Îayyot, TB Yebamot, 47a).
14. Mishneh Torah. Hu’ ha-yad ha-Ìazaqah le-ha-Rambam, Jérusalem, 1989.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am422
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 423
Une différence de quelques lettres modifie quelque peu la perspective.S. S. Schwarzschild, par exemple, s’est prononcé pour cette seconde ver-sion qui, selon lui, est beaucoup plus compréhensible15. Que Maïmoniderefuse même le statut de «sage» à quelqu’un qui par l’usage de sa raisonserait arrivé à déduire les commandements noachiques a en effet de quoisurprendre. Cependant, d’un point de vue philologique, cela constitue préci-sément un argument pour la thèse adverse. Ainsi, José Faur a-t-il pu avan-cer deux arguments assez convaincants en faveur de la version la plusrestrictive, celle de Spinoza: 1° cette version figure dans de nombreuxmanuscrits et dans des manuscrits très fiables; 2° entre deux leçons figurantsur les manuscrits d’un même texte, la leçon la plus difficile est probable-ment la plus exacte16. Qu’un copiste ait jugé bon en effet de remplacer uneleçon difficile, qui tranche avec ce qu’il attendrait de l’auteur dont il copiele texte, par une leçon moins surprenante, paraît en effet plus probable quel’inverse.
Concernant Spinoza, il est certain qu’il n’a fait que citer la version duMishneh Torah dont il disposait. Il est également certain qu’il avaitconnaissance à travers du Kebod Elohim de Yosef ben Shem ™ob d’uneversion différente. Cependant, il n’avait pas de raison valable pour supposerque cette version citée dans une source secondaire fût plus fiable que laversion qui figurait dans l’édition imprimée du Mishneh Torah qu’ilconnaissait17. En ce qui nous concerne, cette querelle est somme toute depeu d'importance. Quand bien même, en effet, la véritable version du texteserait moins restrictive que celle de Spinoza, la difficulté qu’il pointe chezMaïmonide sur le plan doctrinal persiste: il n’en interdit pas moins l’accèsà la béatitude au Gentil qui ne reconnaît pas la Torah comme loi révélée.
Cette question doctrinale est d’autant plus difficile qu’il se trouve quece texte du Mishneh Torah n’a pas de source talmudique facilement identi-fiable. Ainsi, Yosef Caro, dont le commentaire Kesef Mishneh est consacréà la recherche des sources du Mishneh Torah, note à propos de notrehalakha l’absence totale de source concernant la restriction formulée parMaïmonide à propos de l'accès au monde à venir. Ce serait donc de sapropre initiative que celui-ci aurait restreint l’accès au monde à venir au
15. S. S. SCHWARZSCHILD, «Do Noachites Have to Believe in Revelation? A Passage inDispute between Maimonides, Spinoza, Mendelssohn and H. Cohen. A Contribution to aJewish View of Natural Law», Jewish Quarterly Review (52), Londres, 1962, p. 302.
16. J. FAUR, «Meqor Ìiyyuban shel ha-miÒwot be-da‘at ha-Rambam», TarbiÒ (38),Jérusalem, 1968, p. 47, n. 45. F. Niewöhner se prononce dans le même sens (F. NIEWÖHNER,«Ein schwieriges Maimonides-Zitat im Tractatus theologico-politicus und Hermann CohensKritik an Spinoza», Zeitschrift für philosophische Forschung [31], 1977, p. 623.)
17. Cf. TTP, p. 729-730, n. 40.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am423
424 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
Gentil ne reconnaissant pas la Torah comme source de tout commande-ment. Spinoza feint, en identifiant la position de Maïmonide avec celle desJuifs en général, de ne pas savoir que ce texte n’a pas de source dans leTalmud. Ce n’est pas sans ironie qu’il note à propos du texte du MishnehTorah qu’il vient de citer que «tout lecteur attentif reconnaîtra assez claire-ment, je pense, que tout cela est pure invention, et n’est étayé ni par desraisons ni par l’autorité de l’Écriture»18. Il n’est d’ailleurs pas improbableque Spinoza ait eu connaissance du commentaire de Yosef Caro, impriméen marge de certaines éditions du Mishneh Torah dès le XVIe siècle19. C’estau lecteur traditionnel du Rambam, lecteur à la fois juif et philosophe, queSpinoza s’adresse ici. Il lui indique que son héros, Maïmonide, exprime ici,de son propre chef, un jugement particulièrement restrictif au sein même dela tradition juive, concernant l’accès au monde à venir.
Les tentatives n’ont pas manqué pour contredire Caro et trouver dessources talmudiques à cette halakha. Si l’on pouvait montrer queMaïmonide n’a fait que transcrire un texte de la tradition, conformément àl’objectif qu’il s’est assigné en rédigeant le Mishneh Torah et qu'il men-tionne dans sa préface, alors il se trouverait en partie déchargé de la respon-sabilité de ses propos. Ainsi, en 1693, Îayyim Îazan a proposé, une telletentative, de manière assez concluante:
Dès lors qu’il a été dit (Baba qamma, 38a) que l’on a autorisé [aux noachidesla transgression de leurs sept commandements, dans la mesure où ils ne lesappliquaient pas] et qu'ils ne recevront par conséquent pas de récompense[même s’ils les appliquent], cela signifie que pour accéder à la récompense[réservée aux noachides], à savoir une part au monde à venir, il faut désormaisque [le Gentil] réaffirme qu’il prend sur lui le joug des commandementset qu’il se fasse étranger résident (גר תושב). De même que celui qui se faitétranger de justice (גר צדק) [c'est-à-dire celui qui se convertit], devient désor-mais juif en toute chose, de même, celui qui se fait étranger résident, doitse convertir aux sept commandements des fils de Noé, dont la transgression[lui] était autorisée auparavant. C’est pourquoi notre Maître a dit (HilkhotMelakhim, VIII, 11) quiconque prend sur soi (כל המקבל) etc∞20.
L’argumentation est subtile. Îazan reconstruit une source, à partir d’unréseau de passages épars du Talmud. L’argument repose entièrement surl’usage dans la halakha citée par Spinoza de deux termes: «étranger rési-dent» (גר תושב) et «prendre sur soi» (המקבל). Maïmonide insiste en effetsur la nécessité, pour qu’il accède au monde à venir, d’une acceptation
18. TTP, p. 235. Nous soulignons.19. Par exemple, Mishneh Torah le-ha-Rambam, Venise, 1574.20. Îayyim ÎAZAN, Shenot Îayyim, Venise, 1693, 40b.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am424
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 425
volontaire de la part du noachide du joug de sept commandements qui luiincombent. Il semble identifier, en outre, le «pieux des nations du monde»avec «l’étranger résident» (גר תושב). Ce statut «d’étranger résident» cor-respond au droit, pour un non-juif qui ne souhaite pas se convertir aujudaïsme, de résider en terre d’Israël. Ainsi dans la halakha qui précèdedirectement la nôtre (Melakhim, VIII, 10) Maïmonide écrit:
והמקבל אותם בכל מקום הוא הנקרא גר תושב וצריך לקבל עליו בפני שלושהחברים.
Et celui qui prend sur lui [les lois noachiques], quel que soit l’endroit (où il lefait), c’est lui que l’on appelle «étranger résident». Et il faut qu’il les prennesur lui devant trois juges [d’un tribunal rabbinique].
Il y va donc en effet d’une véritable conversion au noachisme devant desreprésentants de la Loi juive. Or, Maïmonide dit également à deux endroitsdu Mishneh Torah (Issurei Bi'ah, XIV, 8 et Milah, I, 6), que l’on ne peutaccepter d’étranger résident «qu’au moment où la loi du jubilé s’applique»-autrement dit pas avant la restau ,(אין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג)ration du royaume d’Israël aux temps messianiques.
Ainsi, toute tentative de reconstruction des sources de la halakha citéepar Spinoza, même satisfaisante, ne fait qu’accroître dramatiquement larestriction à l’accès des non-juifs au monde à venir. De plus, une tellereconstruction ne consistera jamais qu’à rassembler divers passages éparsdu Talmud. Cela suppose que Maïmonide lui-même se serait efforcé de ras-sembler ces divers passages. Qu’il dispose ou non de sources talmudiques,quelque chose de la pensée de Maïmonide est en jeu dans ce texte problé-matique magistralement choisi par Spinoza.
d) Raison limitée et Torah
Dans le texte cité des Hilkhot Melakhim, Maïmonide refuse à la raison lacapacité de fonder un droit, une législation, fût-elle aussi minimale que lessept lois noachiques. Seule la Torah garantit une récompense pour l’accom-plissement d’un commandement, quand bien même il correspond à une loique la raison aurait pu déduire par elle-même.
Raison et praxis
Ce texte du Mishneh Torah tend à prouver que Maïmonide n’admet pasl’existence d’une loi naturelle21, d’une morale rationnelle. D’autres textes
21. Cf. S. S. SCHWARZSCHILD, «Do Noachites Have to Believe in Revelation? A Passagein Dispute between Maimonides, Spinoza, Mendelssohn and H. Cohen. A Contribution to a
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am425
426 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
du corpus maïmonidien vont dans le même sens. Ainsi, dans le chapitreVIII du Traité de logique, Maïmonide se penche sur les jugements que l’ontient pour vrais sans en avoir de démonstration. Ce type de jugements adeux sources, les opinions généralement admises ou «autorisées» et latradition22. Or les jugements moraux font assurément partie de cette classede jugements incertains. Dans la lignée d’Aristote, Maïmonide sembleconsidérer les jugements de type pratique comme relevant du domaine de lasimple opinion, toujours incertaine, et de la convention. Selon ces textes dumoins23, le domaine du jugement pratique est nettement dévalorisé. Laraison dans l’ordre pratique ne peut que s’appuyer sur des conventions etdes traditions. Elle ne peut pas fonder une morale sur une démonstration.Les opinions dans le domaine pratique n’ont pas de garantie de stabilité.C’est pourquoi, quand bien même un individu serait arrivé par la raison àdéduire les sept commandements noachiques, rien ne leur garantirait unestabilité. Il serait toujours possible que l’individu en question se laisseséduire par un sophisme qui le conduirait à abandonner ces commande-ments. Seule la Torah, garantie par une tradition qui remonte jusqu’au montSinaï24, permet de fonder une législation universellement valable. Toute loiuniverselle tire nécessairement, pour Maimonide, sa source d’une révéla-tion25.
Ce que Spinoza cherche donc à pointer chez Maïmonide est l’affirmationd’une limitation de la raison dans le domaine pratique et la nécessité de laTorah pour y remédier. La raison maïmonidienne est totalement impuis-sante dans le domaine de la praxis. Par conséquent, la pensée de Maïmo-nide est, en la matière, totalement tributaire d’une révélation.
Jewish View of Natural Law (Continued)», Jewish Quarterly Review (53), Londres, 1962,p. 40 sq. J. Faur argumente dans le même sens (art. cit.).
22. «Les [opinions] autorisées, comme notre connaissance de ce que découvrir la nuditéest honteux, et de ce que répondre par des bonnes actions à un bienfaiteur est beau» et «Lesopinions reçues, […] c’est tout ce que nous recevons de la part d’une seule personne deconfiance ou d’un ensemble de gens en qui nous avons confiance.» (Moïse Maïmonide,Traité de logique, trad. R. BRAGUE, Paris, 1996, chapitre VIII, p. 60-61.)
23. Comme souvent s’agissant de Maïmonide, on trouve sur ce point des textes contradic-toires. Ainsi un passage du même Traité de logique, laisse ouverte la possibilité d’une saisiedu bien et du mal par le logos (ibid, p. 94). On peut y opposer un texte du Guide (I, 2). Selonl’interprétation célèbre que Maïmonide y donne de la faute d’Adam, la connaissance acquisepar l’homme du bien et du mal, qui relèvent de l’opinion simplement probable, a mis fin àune période où il était uniquement régi par son intellect et la connaissance des choses néces-saires (Guide, I, p 40-41). Pour ce qui nous importe ici, ce débat est secondaire. Contentonsnous de remarquer que Spinoza, renvoyant à ce passage précis du Mishneh Torah, donne àlire Maïmonide comme niant que la morale relève de la connaissance démonstrative.
24. Cf. les introductions au Mishneh Torah et au Commentaire sur la Michna.25. Cf. sur ce point, J. FAUR, art. cit.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am426
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 427
Commandements et béatitude
Cet argument ne rend compte que d’un aspect du texte du MishnehTorah cité, à savoir la prévalence de la Torah sur la raison en tant quesource de droit. Le texte en question dit pourtant autre chose encore: que larécompense, en l’occurrence l’accès au monde à venir, n’est garantie qu’àcelui qui pratique les sept commandements parce qu’ils ont été révélés dansla Torah. Il faut ici se rapporter à la conception maïmonidienne du monde àvenir, que l’on trouve notamment dans le chapitre X des Hilkhot Teshubah(«lois sur le retour [ou la pénitence]») à la fin du Sefer ha-madda‘, le célè-bre premier livre du Mishneh Torah:
Dans le monde à venir, il n’y a ni matière ni corps, mais les âmes des justesexclusivement, dépourvues de corps à l’instar des anges du service. […] Lespremiers des sages ont dit: «dans le monde à venir on ne boit ni on ne mangeet l’on n'a pas de rapports sexuels, mais les justes y restent assis, leurs têtesornées de leurs diadèmes, à se délecter de l’éclat de la Présence divine.» […]«Leurs têtes ornées de leurs diadèmes»: cette expression signifie que l’intel-lect qu’ils ont acquis et grâce auquel ils ont obtenu la vie du monde à venirpersiste avec eux. […] Et que signifie l’expression «à se délecter de l’éclatde la Présence divine»? Que les justes dans le monde à venir connaissent etsaisissent de la vérité du Saint, Béni soit-Il, ce sur quoi ils n’avaient point deprise lorsqu’ils étaient dans un corps de ténèbres et d’abjection (Halakha 2)26.
Maïmonide donne donc une présentation intellectualiste de la vie dumonde à venir, sous la forme d’une béatitude purement contemplative.Il affirme par ailleurs deux choses concernant l’accès au monde à venir:1° que l’accès à ce monde de contemplation est proportionné à l’intellectacquis (c'est-à-dire la partie de l’intellect constituée de l’ensemble desintelligibles qu’un homme a saisis au cours de son existence) et 2° que cemonde est la récompense de l’accomplissement des commandements. Ordans le texte des Hilkhot Melakhim cité par Spinoza, Maïmonide dit plusque cela: il y affirme que l’accomplissement des commandements est unecondition nécessaire à l’accès au monde de la pure contemplation intellec-tuelle qu’est le monde à venir. La reconnaissance de la Torah est non seule-ment le seul moyen de fonder un droit mais c’est aussi le seul moyend’accéder à la perfection de l’intellect dans le monde à venir. Ceci est enaccord avec la conception des commandements, élaborée dans la troisièmepartie du Guide, comme purs moyens en vue de préparer le corps et l’intel-lect à la saisie des intelligibles27.
26. Moïse Maïmonide, Le Livre de la connaissance, trad. V. NIKIPOWETZKY et A. ZAOUI,Paris, 1961, p. 409 (traduction modifiée).
27. «[…] c’est en se livrant à tous ces détails pratiques [des commandements] et en les
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am427
428 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
L’accès à la béatitude intellectuelle passe par la reconnaissance d’une loirévélée qui, tout à la fois, prépare l’intellect à sa véritable destination, lacontemplation, et le libère du souci de la détermination de la volonté dansl’action. S’en remettre à une loi révélée est en effet une manière de selibérer de la question des règles de la vie bonne. Dans le cadre d’une révé-lation, on présuppose que ces règles sont toujours déjà données. Si l’onn’admet pas une telle loi, la question pratique occupe nécessairementl’intellect qui n’est pas libre pour la pure contemplation28. Maïmonideconditionne l’accès à la perfection intellectuelle à la reconnaissance de laTorah. On comprend dès lors qu’il puisse même refuser le statut de «sagesdes nations du monde» (חכמי אומות העולם) aux Gentils qui ne reconnaissentpas la Torah. Qu’il soit juif ou non, celui qui ne reconnaît pas la révélationtoraïque est nécessairement empêché dans l’usage de son intellect parl’obligation de déterminer les règles de la vie bonne. En ce sens, on ne sau-rait le qualifier de «sage».
C’est cela nous semble-t-il que Spinoza a voulu mettre en avant à traverssa citation du Mishneh Torah. Cette citation ne sert pas seulement d’illus-tration au caractère irrationnel du judaïsme. Elle sert aussi et surtout derévélateur du caractère fondamental que revêt la Torah en tant que texterévélé dans la philosophie de Maïmonide. C’est là sans doute égalementune façon pour Spinoza de marquer une différence entre sa propre pensée etcelle de Maïmonide. Car, sur deux points au moins, la pensée de Maïmo-nide est ici très proche de celle de Spinoza: la dépréciation des notions debien et de mal29 et la conception intellectualiste de la béatitude. Mettre ledoigt sur le fait que Maïmonide pense la raison comme fondamentalementlimitée est une façon pour lui de s’en démarquer. Ce n’est pas en effet uneloi révélée qui permet chez Spinoza d’accéder à la félicité mais la construc-tion d’une éthique totalement rationnelle.
Si cette citation du Mishneh Torah au chapitre V du Traité insiste sur lanécessité de la Torah pour suppléer aux limitations de la raison en matière
répétant, que certains hommes d’élite s’exerceront pour arriver à la perfection humain, demanière à craindre Dieu, à le respecter et à le révérer […]» (Guide, III, 52, p. 453.)
28. L. Strauss a magistralement exposé ce point dans le texte d’une conférence projetéeen 1931 sur le thème «Cohen et Maïmonide»: «Parce qu’ils sont de fait sous la loi, [lesphilosophes à l’époque des religions révélées] n’ont plus besoin comme Platon de chercher laloi, la Cité: l’ordre contraignant du vivre-ensemble leur est donné par un prophète. Ils sontpour cette raison autorisés par la loi, libres pour la compréhension dans une liberté aristoté-licienne. Ils peuvent par conséquent aristotéliser.» (L. STRAUSS et C. PELLUCHON, «Cohen etMaïmonide», Revue de métaphysique et de morale (38), 2003, p. 273.)
29. Sur la proximité de Spinoza et de Maïmonide sur ce point, cf. S. PINES, «Note sur laconception spinoziste de la liberté humaine», in La liberté de philosopher, op. cit., p. 464-468.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am428
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 429
de praxis, la citation du Guide, au chapitre VII, met en avant le rôle de laTorah en tant que complément à une raison limitée du point de vue théori-que.
2. Le Guide
a) La citation
Rappelons la longue citation du Guide des égarés que fait Spinoza à lafin du chapitre VII du Traité, «De l’interprétation». Après avoir exposé sapropre méthode exégétique, fondée sur la connaissance de la langue hébraï-que et l'interprétation de l’Écriture qu’à partir de l’Écriture elle-même(i.e. ni à la raison, ni à une tradition herméneutique quelconque), Spinozas’adonne à la critique de la position de Maïmonide:
S’il se trouve que son sens littéral contredit la raison, quelle que soit sa clarté,ce passage, pense-t-il [Maïmonide], doit être interprété autrement; ce qu’ilindique très clairement au chapitre 25 de la deuxième partie du Guide deségarés. Il dit en effet: דע כי אין בריחתנו מן המאמר בקדמות העולם מפני הכתוביםאשר באו בתורה בהיות העולם מחודש כי אין הכתובים המורים על חדוש העולם יותר מןהכתובים המורים על היות השם גשם ולא שערי הפירוש סתומים בפנינו ולא נמנעים לנובעניין חדוש העולם אבל היה אפשר לנו לפרשם כמו שעשינו בהרחקת הגשמות ואולי זההיה יותר קל הרבה והיינו יכולים יותר לפרש הפסוקים ההם ולהעמיד קדמות העולםSachez que ce ne sont pas les» כמו שפרשנו הפסוקים והרחקנו היות יתברך גשם וגו'textes de l’Écriture sur la création du monde qui nous détournent de dire que lemonde est éternel. Car les passages qui enseignent que le monde a été créé nesont pas plus nombreux que ceux qui enseignent que Dieu est corporel; et lesmoyens d’expliquer ces textes qui traitent de la création du monde ne seraientpour nous ni inaccessibles ni même gênants: nous aurions pu les expliquercomme nous l’avons fait quand nous avons rejeté de Dieu la corporéité. Peut-être même cela eût-il été beaucoup plus facile à faire et peut-être mêmeaurions-nous pu plus aisément les expliquer et fonder l’éternité du monde quelorsque nous avons, dans notre explication de l’Écriture, rejeté la thèse selonlaquelle Dieu béni est corporel. Mais deux causes me poussent à ne pas le faireet à ne pas le croire (que le monde est éternel): premièrement parce qu’unedémonstration claire établit que Dieu n’est pas corporel et qu’il est nécessaired’expliquer tous les passages dont le sens littéral est en contradiction avec ladémonstration; car il est certain que ces passages admettent alors nécessaire-ment une explication (autre que littérale). Mais aucune démonstration ne mon-tre l’éternité du monde: il n’est donc pas nécessaire de faire violence aux Écri-tures et de les expliquer à cause d’une opinion apparente dont nous pourrionsêtre détournés par quelque raison persuasive qui nous ferait pencher vers lathèse contraire. La deuxième cause est la suivante: croire que Dieu est incor-porel ne contredit pas les fondements de la Loi; mais croire le monde éternel àla manière d’Aristote enlève à la Loi son fondement30.»
30. TTP, p. 317.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am429
430 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
Il semble que Spinoza en citant précisément ce texte poursuive deuxobjectifs. Le premier est le plus manifeste: mettre en avant un véritableaveu de la part de Maïmonide que sa méthode exégétique ne vise pas à ren-dre compte fidèlement du texte biblique, mais à le rendre compatible avecce dont la raison fournit une démonstration. Quelques phrases après la cita-tion, Spinoza en donne en effet le commentaire suivant:
Cette thèse suppose qu’il nous est permis, selon nos opinions préconçues,d’expliquer et de forcer les paroles de l’Écriture, de nier le sens littéral, si clairet explicite soit-il, et de le changer en un autre31.
Contrairement à la méthode historico-critique qu'il propose, la méthodeallégorique maïmonidienne ne part pas, selon Spinoza, du texte lui-mêmemais d’opinions préconçues. Exposée dans un Guide pour le perplexe, qui,ayant goûté à la philosophie, s’est trouvé pris de «troubles violents» devantle «sens extérieur» de la Loi32, cette méthode ne viserait qu’à sauver laTorah de la menace de la raison qui contredit le sens littéral de nombreuxversets. Maïmonide ne proposerait pas une herméneutique s’attachant serei-nement à rendre compte du «sens véritable»33 de l’Écriture, mais une exé-gèse entièrement orientée vers une conciliation de la révélation et de laraison, fût-ce au risque de faire violence aux versets34. Le texte cité duchapitre 25 de la deuxième partie du Guide des égarés ne serait rien d’autreque la confession par Maïmonide de ce biais résidant au fondement de sonherméneutique35.
31. Ibid., p. 319. Nous soulignons.32. Cf. Guide, I, Introduction, p. 6-8.33. Chercher le «sens véritable» de l’Écriture, telle est la tâche que s’assigne Spinoza
lorsqu’il élabore sa méthode exégétique. Cf. TTP, p. 285 et passim. Voir aussi sur ce pointC. CHALIER, Spinoza lecteur de Maïmonide. La question théologico-politique, Paris, 2006,p. 34 sq.
34. Ce type de critique de la méthode allégorique et surtout de ses abus se trouve déjàchez Eliya Delmedigo, qui ne concentre cependant pas ses attaques contre Maïmonide lui-même: «Ces hommes [les prétendus philosophes] ont voulu changer le sens obvie des versetsde la plupart des parties et des récits bibliques, comme s’ils cherchaient à embellir les parolesde la Torah en les convertissant en termes de syllogismes intellectuels.» (Eliya DELMEDIGO,Examen de la religion. Le testament philosophique du judaïsme d’Espagne à la veille de l’ex-pulsion, trad. M.-R. HAYOUN, Paris, 1992, p. 80.) Nous savons que Spinoza possédait ce textequi figurait dans un recueil publié par le petit-fils de l’auteur (cf. A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN,Inventaire des livres formant la bibliothèque de Bénédict Spinoza, publié d’après un docu-ment inédit, La Haye et Paris, 1888, reproduit dans Spinoza, Éthique, trad. B. PAUTRAT, Paris,Seuil, 1988, p. 627-695).
35. C’est du moins ce que laisse entendre la paraphrase de Spinoza qui suit immédiate-ment la citation: «Voilà les propos de Maïmonide d’où découle avec évidence ce que nousvenons de dire: si, pour lui, il était établi par la raison que le monde est éternel, il n’hésiteraitpas à forcer l’Écriture et à l’expliquer de telle sorte qu’elle finisse par avoir l’air d’enseignercela même.» (TTP, p. 317.)
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am430
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 431
Or, non seulement Maïmonide ne se contente pas d’affirmer cela dans letexte cité, mais en outre cela ne correspond pas exactement à ce qu’il y dit.Il attribue en effet à sa compréhension littérale des versets consacrés aurécit de la création du monde deux causes et non pas une seule, comme lelaisse entendre Spinoza: 1° qu’il ne dispose pas d’une démonstration del’éternité du monde et 2° que la thèse éternaliste sape les fondements de lareligion. Spinoza, dans sa paraphrase, ne prend en compte que la premièrecause et tronque ainsi les propos de Maïmonide qu’il vient pourtant deciter. Or, alors qu’il aurait pu se contenter de ne livrer dans sa citation quela première cause, Spinoza prend la peine de la prolonger jusqu’à laseconde cause, au prix d’une incohérence entre la citation et sa paraphrase.Mieux, sa manière même de citer le texte indique qu’il a souhaité inclure lamention de la seconde cause dans sa citation. En effet, Spinoza donne, dansun premier temps, le début de la citation en hébreu, dans sa traduction parSamuel Ibn Tibbon36. Puis il interrompt la citation du texte hébreu, en laponctuant d’un 'וגו («etc.»), juste avant l’énoncé des deux causes. Suit latraduction du texte en latin. Cette traduction est relativement fidèle jusqu’àla fin de l’énoncé de la première cause. La seconde cause, en revanche, estsimplement résumée en une phrase, tandis que son énoncé dans le Guide estrelativement long et détaillé.
Sans en donner le moindre commentaire ni une citation en bonne et dueforme, Spinoza pointe l’existence de cette seconde cause, qui n’entre pasdans le cadre de l’argumentation qui est ici la sienne. Tout se passe commes’il avait souhaité indiquer à un lecteur attentif que quelque chose est égale-ment problématique dans cette seconde cause. Cela nous amène à dire quecette longue citation du Guide n’a pas pour seul but d’extorquer deMaïmonide l'aveu du caractère non valide de son exégèse. Elle vise enoutre à mettre en avant ce que Spinoza considère comme une inconsé-quence philosophique de Maïmonide, son attachement à la Torah en tantque texte fondateur du judaïsme.
b) Maïmonide et le problème de l’origine du monde
Le chapitre 25 de la deuxième partie du Guide des égarés fait partied’une série de chapitres consacrés à question cruciale du débat philosophi-que entre partisans de l’éternité et de la création du monde. Maïmonidedémonte tour à tour les arguments du kalam qui visent à démontrer que lemonde a été créé ex nihilo, mais au prix, selon lui, de la construction d’unecosmologie atomiste contre-intuitive, et des péripatéticiens qui appuient
36. Nous savons que Spinoza disposait de cette version (cf. A. J. SERVAAS van ROOIJEN,op. cit.).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am431
432 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
leur démonstration de l’éternité sur l’ordre immuable du monde. Cette réfu-tation des mutakallimun et des péripatéticiens montre l’ambivalence deMaïmonide. Il affirme que la démonstration de l’éternité est la plus pro-bante, dans la mesure où elle s’appuie sur «la nature de l’être», et il necesse en même temps de se poser en défenseur de la thèse de la création.L’ensemble des chapitres consacrés à la question est jalonné d’expressionscomme «mais nous ne pensons pas ainsi»37 ou «conformément à l’opinionde notre Loi»38 qui peuvent être comprises comme laissant entendre que ladéfense maïmonidienne de la création relève du parti pris théologique etnon de la conviction rationnelle.
A. Ravitzky a mis en avant l’existence depuis le XIIIe siècle et jusqu’auXXe siècle de diverses écoles en matière d’interprétation des «secrets» deMaïmonide39. Le Guide est en effet présenté par son auteur comme conte-nant une doctrine ésotérique, qu’il convient à son lecteur philosophe et per-plexe de découvrir. Les commentateurs se sont attachés, dès les premièresgénérations de lecteurs, à exposer ces doctrines secrètes diversement com-prises. La détermination de la véritable doctrine de Maïmonide concernantla question de la création ou de l’éternité a, dans ce contexte, fait l’objetd’une controverse entre les différents interprètes. À titre d’exemple, YosefIbn Kaspi, dans son commentaire Maskiyyot Kesef composé au XIVe siècle,écrit à propos du chapitre XIII:
L’intention [divine] n’est mentionnée qu’à propos de la [thèse] de la créationex nihilo. Cela entre en contradiction avec ce que [Maïmonide] affirme auchapitre XXI de la deuxième partie, à savoir que [certains] défenseurs del’éternité du monde affirment également que le Nom l’a voulu [le monde] parson intention et par sa volonté et que la seule différence entre eux et nous tientà ce qu’ils affirment que cette intention est éternelle tandis que nous disonsqu’elle a été créée [en vue du monde]. Et en vérité cette contradiction relèvede la septième cause40.
La septième cause de contradiction est définie par Maïmonide dans l’In-troduction du Guide de la manière suivante: «Septième cause: la nécessitédu discours, quand il s’agit de choses très obscures dont les détails doiventêtre en partie dérobés et en partie révélés»41. En relevant une contradiction
37. Guide, II, 15, p. 125.38. Guide, II, 16, p. 129.39. A. RAVITZKY, «The Secrets of Maimonides: Between the Thirteenth and the Twentieth
Centuries», in History and Faith. Studies in Jewish Philosophy, Amsterdam, 1996, p. 246-303.
40. Yosef IBN KASPI, ‘Amudei Kesef u-Maskiyyot Kesef. Shenei perushim ‘al sefer ha-Moreh le-ha-Rambam, Francfort-sur-le-Main, 1848, in Sheloshah qadmonei mefarshei ha-Moreh, Jérusalem, 1961, p. 125 (notre traduction).
41. Guide, Introduction, I, p. 29.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am432
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 433
de la septième cause entre les propos du chapitre XIII et ceux du chapitreXXI de la deuxième partie, Ibn Kaspi suppose donc que Maïmonide necroyait pas sincèrement dans la thèse de la création ex nihilo. Au contraire,cette contradiction indiquerait au lecteur assez attentif pour la relever quesa véritable thèse est celle de l’éternité du monde. L’insistance deMaïmonide sur sa défense de l’opinion de «notre Loi» s’expliquerait alorspar le fait que la croyance en la création du monde est une «croyancenécessaire»42 à l’édifice religieux, mais en rien une «croyance vraie»,fondée sur une démonstration.
Inversement, un autre commentateur, que Ravitzky classe pourtant parmiles commentateurs «ésotériques» du Guide au même titre qu’Ibn Kaspi43,Shem ™ob Falaqera, auteur au XIIIe siècle du Moreh ha-Moreh («Guidepour le Guide»), semble souscrire à la thèse d’une croyance sincère deMaïmonide à la création :
Et il me semble que, du fait qu’il est possible de se tromper au sujet [de l’ori-gine du monde] à cause du sens obvie de nombreux versets et des propos dessages de mémoire bénie dans certains midrashim, ainsi que [Maïmonide] l’arappelé à propos des Pirqei de-R. Eliezer, il a dit «que rien d’autre que cela[la thèse de la création] ne te vienne à l’esprit». Et les midrashim de cette sortedoivent être soigneusement étudiés44.
Si Maïmonide insiste tellement sur le fait que l’opinion de «notre Loi»est que le monde a été créé, c’est que certains versets et midrashim sem-blent enseigner le contraire. Malgré le sens obvie de certains textes de latradition, Maïmonide défend la thèse de la création à partir d'une matièreéternelle, sinon ex nihilo. Sa défense de la création est donc sincère et necache pas une secrète position éternaliste. Son insistance sur l’opinion de«notre Loi» ne serait donc pas le signe de l’énoncé d’une croyance simple-ment «nécessaire», mais une véritable confession de foi: il prend parti pourune position qui n’a pas de démonstration rationnelle simplement parcequ’il se revendique du judaïsme et de la croyance en l’autorité de la Torah.
Nous pensons qu’en mentionnant comme il le fait la seconde cause duchapitre 25 dans sa citation, Spinoza prend parti dans ce débat en mettanten avant l’aspect fidéiste de l’argumentation de Maïmonide. Le Maïmonidede Spinoza est un croyant sincère et par là-même, pour lui, un philosopheinaccompli.
42. Sur ces croyances nécessaires et leur opposition aux croyances vraies, cf. Guide, III,28. Par exemple: «La Loi nous a invités de même à croire certaines choses dont la croyanceest nécessaire pour la bonne organisation de l’état social […].» (Guide, III, 28, p. 214.)
43. A. RAVITZKY, op. cit., p. 250 sq.44. SHEM ™OB FALAQERA, Sefer Moreh ha-Moreh, Pressburg, Anton v. Schmidt, 1837, in
Sheloshah qadmonei mefarshei ha-Moreh, op. cit., p. 95.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am433
434 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
c) Maïmonide le croyant
Les chapitres consacrés au problème de l’origine du monde sont sansdoute parmi les chapitres du Guide où Maïmonide se présente peut-être leplus explicitement comme un philosophe guidé par la foi. Dans le chapitreII, 1645, c'est ainsi qu'il présente sa démarche: devant l’impossibilité dedémontrer l’éternité de même que la création du monde, il opte pour lathèse que semble enseigner la prophétie, autrement dit les versets consacrésau récit de la création. La Torah fournit ici un palliatif aux insuffisances dela raison. Quand la raison est en défaut, il faut s’en remettre à l’enseigne-ment de la Torah. C’est là l’inverse de la thèse que Spinoza attribue explici-tement à Maïmonide, notamment dans le chapitre VII du Traité. Cependant,au chapitre 25, cité par Spinoza, Maïmonide présente encore la chose autre-ment. C’est parce que la thèse de l’éternité du monde, dont une démonstra-tion est impossible, détruit les fondements de la religion qu’il faut s’enremettre au sens littéral des versets et accepter la thèse de la création exnihilo. Il y a entre les deux démarches une légère différence qu’il convientde noter. La première accepte la création parce qu’elle est enseignée par larévélation, la seconde parce que la thèse de la création rend précisémentimpossible de lire la Torah comme enseignement révélé.
Pour bien mesurer cet écart, la lecture de l’exposé par Maïmonide de la«deuxième cause» du chapitre 25 dans son ensemble, et non uniquementson résumé par Spinoza, s’impose:
La seconde raison est celle-ci: notre croyance de l’incorporalité de Dieu nerenverse aucune des bases de notre religion, ni ne donne de démenti à rien dece qu’ont proclamé les prophètes. Il n’y a en cela (aucun inconvénient), si cen’est qu’au dire des ignorants, ce serait contraire aux textes (de l’Écriture);mais, ainsi que nous l’avons montré, il n’y a là rien qui lui soit contraire, etc’est là plutôt le but de l’Écriture. Mais, admettre l’éternité (du monde) telleque la croit Aristote, c'est-à-dire comme une nécessité, de sorte qu’aucune loide la nature ne puisse être changée et que rien ne puisse sortir de son courshabituel, ce serait saper la religion par sa base, taxer nécessairement de men-songe tous les miracles, et nier tout ce que la religion a fait espérer ou crain-dre, à moins, par Dieu! qu’on ne veuille aussi interpréter allégoriquement lesmiracles, comme le font les Bâtenis (ou allégoristes) parmi les musulmans, cequi conduirait à une espèce de folie. […]46 Nous prenons plutôt les textes dansleur sens littéral, et nous disons que la religion nous a fait connaître une choseque nous sommes incapables de concevoir, et le miracle témoigne de la véritéde ce que nous soutenons (והאות מעיד על אמתת טענותינו). Il faut savoir que, dès
45. Guide, II, 16, p. 129.46. Ici Maïmonide affirme que la conception de l’éternité selon Platon est, elle, compati-
ble avec la religion. Mais il rejette néanmoins cette opinion parce qu’elle n’est pas non plusdémontrée.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am434
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 435
qu’on admet la nouveauté du monde, tous les miracles deviennent possibles etla Torah devient possible (ותהיה התורה אפשרית), et toutes les questions qu’onpourrait faire à ce sujet s’évanouissent. Si donc on demandait: Pourquoi Dieus’est-il révélé à tel homme et pas à tel autre? Pourquoi Dieu a-t-il donné cetteLoi à une nation particulière, sans en donner une à d’autres? Pourquoi l’a-t-ildonnée à telle époque et ne l’a-t-il donnée ni avant ni après? Pourquoi a-t-ilordonné de faire telles choses et défendu de faire telles autres? Pourquoi a-t-ilsignalé le prophète par tels miracles qu’on rapporte, sans qu’il y en eûtd’autres? Qu’est-ce que Dieu avait pour but dans cette législation? Pourquoienfin n’a-t-il pas inspiré à notre nature le sentiment de ces choses ordonnéesou défendues, si tel a été son but? — la réponse à toutes ces questions seraitcelle-ci: «c’est ainsi qu’il l’a voulu» ou bien: «c’est ainsi que l’a exigé sasagesse»47.
Deux remarques s’imposent ici. 1° Ce texte lu dans sa totalité met large-ment en question la présentation faite par Spinoza de la méthode allégori-que maïmonidienne. Il faut dire, avec C. Touati, que la méthode allégoriquen’autorise pas, selon ce qu’en dit Maïmonide, le philosophe à interprétern’importe quel verset dans le sens qu’il souhaite. Ici, notamment, Maïmo-nide se refuse à mettre en doute le sens littéral des versets consacrés auxrécits de miracles, certainement parce qu’ils sont clairs et explicites. Oninterprétera un verset allégoriquement lorsque le texte même l’autorise etnon simplement lorsque la raison y invite48. 2° Le choix fait pour la thèsede la création est motivé par des raisons d’ordre théologique. D’une part lathèse de la création permet de fournir une réponse à des questions demeu-rées autrement insolubles. D’autre part, et plus fondamentalement encore,la thèse de la création rend la Torah «possible», parce qu’un Dieu créateur,à la différence du Dieu d’Aristote, est un Dieu pourvu d’une volonté etayant conçu le monde avec un dessein49. En affirmant que seule la thèse dela création rend la Torah «possible», il affirme par là même que seule cettethèse permet de lire la Torah comme un texte révélé. Si l’on admet l’éter-nité, alors tout l’édifice religieux s’effondre et la question de l’exégèse nese pose même plus, puisque la Torah ne peut plus être comme considéréerévélée50.
47. Guide, II, 25, p. 197-199 (traduction légèrement modifiée en fonction d’Ibn Tibbon etc’est nous qui soulignons).
48. Cf. Ch. TOUATI, «Le problème de l’inerrance prophétique dans la théologie juive duMoyen Âge», Revue de l’histoire des religions (174), 1968, p. 176.
49. Au chapitre II, 16, Maïmonide affirme certes que «la prophétie n’est pas une chosevaine même pour les défenseurs de l’éternité.» (Guide, II, p. 129.) Cependant, il exposeraplus loin que la prophétie revêt pour eux une fonction purement intellectuelle et non législa-trice (cf. Guide, II, 32 sq.).
50. C’est ce que Maïmonide affirme à la fin du chapitre: «Mais, si l’on soutenait que lemonde est ainsi par nécessité, il faudrait nécessairement faire toutes ces questions, et on ne
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am435
436 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
La position de Maïmonide sur l’origine du monde est complexe et cen-trale pour la compréhension du statut qu’il accorde à la Torah dans sonentreprise philosophique. Maïmonide semble en effet, à la fois, défendre lathèse de la création parce qu’elle est enseignée par la prophétie et pour pré-server la religion. Les deux aspects sont en fait intimement liés. La Torahen tant que résultat de la prophétie apparaît comme un supplétif aux limita-tions de la raison (en l’occurrence son impuissance à trancher la question del’origine du monde). Mais on ne peut lire la Torah en tant que résultat de laprophétie qu’à condition de croire à la création. Il y a là un véritable cerclequi met à nu chez Maïmonide un élément de foi qui est à la fois philosophi-quement et théologiquement motivé: croire en la création du monde, c'est-à-dire in fine en la révélation de la Torah, est un acte de foi qui permet degagner, sur le plan philosophique, la garantie de trouver des solutions à desproblèmes qu’une raison limitée ne saurait trancher51.
Spinoza, en choisissant précisément le texte qu’il cite et en y incluant lamention de la deuxième cause, a souhaité pointer cet élément de foi, quifait dépendre tout l’édifice philosophique de Maïmonide de la vérité de laTorah, en tant que texte révélé. L’enjeu de la citation serait donc de faireapparaître deux limitations de la pensée de Maïmonide, le plus grand desphilosophes juifs du Moyen Âge: son inconséquence exégétique (il lit letexte en y plaquant des opinions préconçues) et philosophique (sa philoso-phie se nourrit d’une foi). Si donc la destruction de l’autorité de la Torahen tant que texte révélé, dans la suite du Traité, vise principalement àdétruire l’autorité politique des théologiens, elle n’en n’est pas moinségalement orientée contre Maïmonide. Si l’autorité de la Torah s’effondre,l’édifice philosophique maïmonidien dans son ensemble sera lui-mêmeruiné. Et ce n’est sûrement pas par hasard que Spinoza s’est autorisé, dansle cadre de cette déconstruction du caractère révélé de la Torah, dès lechapitre VIII, qui suit immédiatement cette citation du chapitre II, 25du Guide, d’un auteur juif quasi contemporain de Maïmonide, AbrahamIbn Ezra.
pourrait en sortir que par de méchantes réponses, qui renfermeraient le démenti et la négationde tous ces textes de la Loi dont un homme ne saurait mettre en doute l’acceptation littérale.[…] Je t’ai déjà exposé que tout dépend de cette question; sache le bien.» (Guide, II, 25,p. 199.)
51. Dans la tradition philosophique juive médiévale, le fait que Maïmonide souscrive à lathèse de la création comme acte de foi a été jugée insuffisante, notamment par Gersonide quis’est efforcé de produire une démonstration de la création du monde. (Cf. Ch. TOUATI, Lapensée philosophique et théologique de Gersonide, Paris, 1973, p. 161 sq.)
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am436
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 437
B. Ibn Ezra
Abraham Ibn Ezra sert avant tout de détracteur juif de l’autorité de laTorah comme texte révélé. Ibn Ezra apparaît, dès lors, comme l’instrumentjuif de Spinoza dans la démolition de l’édifice philosophique de Maïmo-nide. Cependant, cela n’a été rendu possible que parce que Spinoza a unparti pris de lecture marqué dans son approche d’Ibn Ezra, qui vise à eninvalider, voire en interdire, d’autres lectures possibles. Nous nous efforce-rons à présent de démonter les tenants et les aboutissants de ce parti pris.
Ibn Ezra est assurément un auteur difficile. Son écriture est délibérémentobscure, jouant sur les ambigüités de la langue hébraïque, aussi bien sur leplan lexical que syntaxique. On peut formuler une hypothèse concernant laraison d’un tel mode d’écriture. La vie d’Ibn Ezra (environ 1090 – environ1165) est marquée par une rupture en 1140. Avant cette date, Ibn Ezras’est surtout illustré par la rédaction de poèmes en hébreu, participant ainsiavec son ami Yehuda Hallévi à la renaissance de la poésie hébraïque enEspagne. En 1140 — soit cinq ans avant le début des persécutions almora-vides, Ibn Ezra décide, de façon assez mystérieuse, de quitter l’Espagne etde passer le reste de son existence dans d’incessants voyages entre l’Italie,la France et l’Angleterre, dans des conditions misérables. Lors de ces voya-ges, il s’est notamment consacré à la rédaction de commentaires bibliquesen hébreu, à l’usage des différentes communautés dans lesquelles il aséjourné. On peut supposer qu’il y a, dans ce choix de l’exil en Europelatine, une dimension proprement idéologique: Ibn Ezra s’est comme donnépour mission d’éduquer les communautés juives en monde chrétien, depuislongtemps coupées de la pensée juive écrite en langue arabe. Cette entre-prise aurait essentiellement visé à rendre à l’hébreu toute sa centralité,ce que confirme l’introduction par Ibn Ezra d’une réflexion sur la langueelle-même. Parmi les nombreuses œuvres de sa période post-espagnole,Ibn Ezra a en effet écrit trois traités de grammaire. Par ailleurs, ses com-mentaires bibliques sont centrés, comme il l’affirme dans l’Introduction àson commentaire sur la Torah, sur la grammaire. Or, en faisant le choixd’écrire exclusivement en hébreu, Ibn Ezra s’est privé du moyen de sélec-tionner un lectorat cultivé, en employant la langue de l’élite, du moins enEspagne, l’arabe. Par conséquent, il a dû glisser, dans ses commentairesbibliques, des idées à l’adresse d’un lecteur cultivé sans qu’elles soientaccessibles à la foule52. Telle serait l’origine du véritable «art d’écrire» quel’on peut observer dans les textes d’Ibn Ezra.
52. Voir I. LANCASTER, Deconstructing the Bible. Abraham Ibn Ezra’s Introduction to theTorah, Londres, 2003.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am437
438 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
Nous voulons montrer 1) à quel point Spinoza a su jouer du caractèrecryptique de l’écriture d’Ibn Ezra, 2) que la lecture qu’il donne des com-mentaires qu’il cite est particulièrement radicale. À titre préliminaire, l’ana-lyse de deux références mineures à Ibn Ezra par Spinoza, dans le Traité,donnera un éclairage sur la façon dont Spinoza a lu cet auteur.
1. Le biais de la lecture de Spinoza: le commentaire sur Esther
Au chapitre X du Traité, Spinoza fait mention d’Ibn Ezra, dans le cadrede son enquête sur l’auteur du livre d’Esther.
Il ne faut pas croire que ce livre [le livre d’Esther] est le même qu’écrivitMardochée. Car au chap. 9, v. 20, 21, 22, c’est un autre qui raconte queMardochée a envoyé des lettres et ce qu’elles contenaient. Ensuite, au v. 31[sic. en réalité 32] du même chapitre, il est dit que la reine Esther a, par unédit, confirmé des rites concernant la fête des sorts (Pourim) et que cela futécrit dans le livre — c'est-à-dire (comme on l’entend en hébreu) dans le livreque tous connaissaient alors, au moment où cela fut écrit —; et ce livre, IbnEzra le reconnaît et tous sont tenus de le reconnaître, a péri avec d’autresencore53.
Les versets, invoqués par Spinoza (Est 9, 20-22) pour réfuter l’attributiontraditionnelle de la rédaction du livre d’Esther à Mardochée54 concernenttrès précisément l’institution de la fête de Pourim: «
20Et Mardochée mit par
écrit (ויכתב מרדכי) ces événements et il envoya des lettres (וישלח ספרים) àtous les Juifs, proches et éloignés, dans toutes les provinces du roi Assuérus
21leur enjoignant de s’engager à observer, année par année, le quatorzième
jour du mois d’Adar et le quinzième jour 22
— c'est-à-dire les jours où lesJuifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis, et le mois où leur tristesses’était changée en joie et leur deuil en fête — à en faire des jours de festinet de réjouissances et une occasion d’envoyer des présents l’un à l’autre etdes dons aux pauvres55.» C’est très spécifiquement au commentaire deRashi sur Est 9, 20 qu’il entend ici s’opposer. D’après lui, ce qu’a écritMardochée selon ce verset n’est rien d’autre que ce même rouleau dontnous disposons et que nous lisons aujourd’hui en tant que «livre d’Es-ther56». Rashi voit donc dans ce verset (Est 9, 20), la preuve que lelivre d’Esther a été écrit par Mardochée.
53. TTP, p. 395.54. Cf. TB Baba batra, 15a: אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר דניאל ומגילת אסתר
(«Les hommes de la Grande Assemblée [dont faisait partie Mardochée, selon la tradition] ontécrit Ézéchiel, les douze [petits prophètes], Daniel et le rouleau d’Esther»).
55. Traduction du rabbinat.56. היא המגילה הזאת כמות שהיא .יכדרמ בותכיו (Et Mardochée mit par écrit. Il s’agit de
ce rouleau, tel qu’il est [aujourd’hui]).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am438
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 439
Ibn Ezra est ici convoqué par Spinoza contre Rashi et, à travers lui,contre la thèse traditionnelle concernant Esther. Il le fait en s’appuyant surson commentaire d'Est 9, 3257 («L’ordre d’Esther fortifia ces règles relati-ves à Pourim; et il fut consigné dans un document écrit ( ספרַונכתב ב ).»):
בפתיחות הבי"ת הוא הידוע בימיהם ואבד הספר כאשר לא מצאנו .רפסב בתכנומדרש עדו וספרי שלמה וספרי דברי הימים למלכי ישראל וספר מלחמות ה' וספר
הישר.Et il fut consigné dans un document écrit: La lettre «ב» [du mot ba-sefer] estvocalisée pataÌ, ce qui indique qu’il s’agit d’un écrit connu et déterminé decette époque, mais celui-ci a été perdu, de même que nous ne disposons plusdu Midrash [du prophète] ‘Iddo, de [certains] livres de Salomon, des chroni-ques des rois d’Israël, du livre des Guerres du Seigneur [dont parle Nb 21, 14]et du Sefer ha-yashar.
Spinoza, affirmant que le livre qu’a écrit Mardochée «a péri avecd’autres encore», ne fait apparemment que paraphraser les propos ici tenuspar Ibn Ezra. Cependant, il ne s’agit véritablement d’une paraphrase qu’à lacondition de supposer qu’Ibn Ezra identifie «le document écrit» (ספר) dontparle ce verset avec le livre d’Esther en tant que tel, à l’instar de la plupartdes commentateurs classiques58. Or, cela est loin d’être acquis. En effet,dans la préface à son commentaire classique sur Esther, Ibn Ezra affirmeexpressément que Mardochée est bien l’auteur du livre. Dans le cadre d’unediscussion sur le problème que constitue l’absence de tout nom divin dansce livre figurant pourtant au sein du canon, il affirme:
והנכון בעיניי, שזאת המגילה חיברה מרדכי. וזה טעם "וישלח ספרים", וכולם משנה ספראחד, שהוא המגילה, כטעם "פתשגן". והעתיקוה הפרסיים, ונכתבה בדברי הימים שלמלכיהם. והם היו עובדי עבודה זרה, והיו כותבין תחת השם הנכבד והנורא
שם תועבתם.Pour moi, ce rouleau a été écrit par Mardochée. Ainsi s’explique «Et ilenvoya des lettres» (Est 9, 20) — lettres qui n’étaient que des copies d’un seul
57. Il faut ici préciser qu’Ibn Ezra a, en réalité, écrit deux commentaires sur Esther. Lecommentaire qui figure dans les éditions usuelles des Miqra’ot gedolot (bibles rabbiniques) etqui sert assurément de source à Spinoza a été écrit en Italie, certainement lors du séjour d’IbnEzra à Rome en 1142. Le second commentaire est nettement moins célèbre et a peu circuléavant sa première édition au milieu du XIXe siècle (J. ZEDNER, Abraham Aben Ezra’sCommentary on the Book of Esther. After Another Version, Londres, 1850). Il s’agit d’uncommentaire écrit en France vers 1155 et vraisemblablement destiné à un public moinsinstruit. On trouvera une étude comparée de ces deux commentaires dans B. WALFISH, «TheTwo Commentaries of Abraham Ibn Ezra on the Book of Esther», The Jewish QuarterlyReview, (79), 1989, p. 323-343.
58. Voir par exemple le commentaire de Rashi sur ce verset: ומאמר אסתר קים וגו'. אסתרL’ordre d’Esther) בקשה מאת חכמי הדור (...) לכתוב ספר זה עם שאר הכתובים וזהו "ונכתב בספר"fortifia etc. Esther demanda aux Sages de sa génération […] d’inscrire ce livre [le livred’Esther] parmi les autres livres des Hagiographes. C’est là la signification de «Et cela futconsigné dans un document écrit»).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am439
440 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
écrit, à savoir le rouleau [d’Esther] — de même [s’explique l’expression]«décret» (Est 8, 13). Et les Perses le copieraient et il serait inscrit dans leschroniques de leurs rois. Or, ils étaient des idolâtres et ils écrivaient à la placedu Nom vénéré et terrible, le nom de leur abominable [divinité]59.
L’absence de mention du nom de Dieu dans le livre d’Esther s’expliqueainsi, selon Ibn Ezra, précisément par le mérite de son auteur, Mardochée.Celui-ci se serait abstenu de toute mention du nom divin pour éviter que lesscribes perses, dont il savait qu’ils seraient amenés à copier son texte dansles chroniques de leurs rois, ne remplacent le nom de Dieu par celui d’uneautre divinité. Non seulement Spinoza tire du commentaire d’Ibn Ezra surEst 9, 32, le contraire de ce que celui-ci affirme dans sa préface, mais ilutilise pour ce faire le verset même (Est 9, 20) que celui-ci utilise pourjustifier que Mardochée a bien écrit Esther.
Nous disposons là d’un véritable modèle de la manière dont Spinoza litIbn Ezra. Il semble, en effet, que Spinoza ne se soit pas contenté d’extraireun commentaire d’Ibn Ezra de son contexte à l’appui de sa propre remiseen cause de l’attribution traditionnelle du livre d’Esther. En comprenant lecommentaire d’Ibn Ezra sur Est 9, 32 comme il le fait, il donne égalementune lecture de la préface au commentaire sur Esther. Spinoza lit en quelquesorte Ibn Ezra, de la même manière que Strauss lit Maïmonide60. Entredeux thèses contradictoires défendues par Ibn Ezra dans un même texte,Spinoza suppose en effet que sa véritable opinion était celle de ces deuxthèses qui se trouvait être la moins conforme à l’opinion communémentadmise. Ainsi, si Ibn Ezra affirme dans sa préface, la partie la plus exposéede son texte, que Mardochée a écrit Esther et s’il laisse entendre en Est 9,32 (soit pratiquement à la fin de son commentaire) que le document danslequel était consigné l’ordre d’Esther a été perdu, c’est cette deuxième thèsequ’il faut lui attribuer. À supposer qu’Ibn Ezra identifie ce document avecle livre d’Esther lui-même, cette seconde thèse signifierait en effet ce quesoutient Spinoza, à savoir que ce n’est pas Mardochée qui en était l’auteur,mais un «historien» plus tardif.
C’est donc en toute cohérence que Spinoza cite le verset Est 9, 20 pourcontester la thèse traditionnelle. Si l’on suit bien Spinoza, qui pense qu’IbnEzra n’était pas en mesure d’exprimer ouvertement sa pensée, les proposque celui-ci tient dans sa préface doivent contenir des indices que sa
59. Nous soulignons.60. «[…] de deux énoncés contradictoires faits par [Maïmonide], [celui-ci] a dû considé-
rer comme vrai celui qui est le plus secret.» (L. STRAUSS, «Le caractère littéraire du Guidedes perplexes», in L. STRAUSS, Maïmonide, trad. R. BRAGUE, Paris, 1988, p. 250-251).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am440
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 441
défense apparente de la thèse traditionnelle ne correspond pas à sa véritableopinion. Ainsi, Spinoza comprend la référence au verset Est 9, 20 commeun indice de ce type. Si Ibn Ezra l’a cité, dans sa préface, à l’appui de sadéfense de la thèse traditionnelle, ce serait précisément pour insinuer que ceverset rend cette thèse problématique, parce que, comme le dit Spinoza, ilsemble avoir été écrit par un écrivain narrant à la troisième personne etau passé les événements de la vie de Mardochée. Citer ce verset dans cecontexte aurait donc été pour Ibn Ezra une manière de dire en creux ce queSpinoza n’hésite pas à lui faire dire tout haut.
La lettre du texte d’Ibn Ezra n’interdit en rien la lecture qu’en donneSpinoza. Celle-ci n’en repose pas moins sur un présupposé. Spinoza a sutirer profit du caractère cryptique de l’écriture d’Ibn Ezra pour y trouver lesprémices de ses propres thèses anti-traditionalistes. Mais il n’a pu le fairequ’en présupposant qu’Ibn Ezra était effectivement son prédécesseur enmatière d’exégèse. Spinoza lit en effet Ibn Ezra en cherchant à y trouverdes thèses établies a priori. On peut en somme adresser à Spinoza lisant IbnEzra la même critique qu’il formule à l’égard de Maïmonide lisant laTorah. Il y a un parti pris dans sa lecture d’Ibn Ezra. La preuve en est qued’autres compréhensions de ses commentaires bibliques sont tout à la foisradicalement différentes de celle de Spinoza et supportées par la lettre dutexte d’Ibn Ezra.
De manière exemplaire, concernant le commentaire sur Esther, une autrelecture que celle de Spinoza est possible et, en l’occurrence, plus naturelle.Il n’y a en effet, à y regarder de près, pas de réelle contradiction entre lapréface établissant que Mardochée est l’auteur d’Esther et le commentairesur Est 9, 32, dans la mesure où il n’est pas évident qu’Ibn Ezra identifie le«document écrit» évoqué dans ce verset avec le livre d’Esther. Il est possi-ble de comprendre le commentaire d’Ibn Ezra comme se contentant d’affir-mer qu’Esther a, d’après Est 9, 32, commandé la rédaction d’un documentécrit indépendant du livre d’Esther, écrit, lui, par Mardochée, et que celivre indépendant à été perdu61. Ainsi, les propos de la préface et du com-
61. Il est amusant de noter que le commentaire français d’Ibn Ezra sur le même verset(Est 9, 32) donne: זאת המגלה שיקראוה ישראל בכל שנה ככתוב בדברי הקבלה .רפסב בתכנו («Etil fut consigné dans un document écrit: il s’agit du rouleau qu’Israël lira chaque année, selonce qu’enseigne la tradition.», J. ZEDNER, op. cit., p. 35). Si cela est peu pertinent en tantqu’objection à Spinoza, dans la mesure où il ne disposait certainement pas de ce texte, la con-tradiction entre le commentaire italien et le commentaire français sur ce verset, outre qu’elleillustre la complexité du personnage d’Ibn Ezra, indique qu’il y a, en effet, dans le commen-taire italien à Est 9, 32 des propos qu’Ibn Ezra a jugé bon de ne pas adresser à un public troplarge. Si l’on suit Spinoza, la raison en est que le commentaire italien à Est 9, 32 contient despropos clairement hérétiques. Un défenseur orthodoxe d’Ibn Ezra dirait au contraire que ce-
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am441
442 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
mentaire à Est 9, 32 ne parleraient tout simplement pas de la même chose etne constitueraient alors en rien un exemple de contradiction délibérée rele-vant d’un quelconque «art d’écrire». La lecture d’Ibn Ezra par Spinozarepose donc sur un biais fondamental. Spinoza entend, a priori, trouverchez celui-ci ses propres thèses, ou du moins leurs prémices, au sujet desauteurs des livres du canon. L’écriture elliptique d’Ibn Ezra permet àSpinoza de construire une lecture de ses commentaires bibliques qui, sansforcer le texte, les accorde parfaitement avec ses propres thèses.
2. Une lecture radicale autorisée par la langue d’Ibn Ezra: le commentairesur Dt 31, 16
La lecture par Spinoza du commentaire sur Dt 31, 16 illustre elle-aussi sagrande capacité à donner une lecture originale, quoique formellement auto-risée, du commentaire d’Ibn Ezra afin d’y trouver ses propres thèses danstoute leur radicalité. Au chapitre II, Spinoza s’autorise d’Ibn Ezra pouraffirmer que Moïse considérait que le Dieu d’Israël n’était qu’un dieunational et régional, réclamant un culte particulier sur une terre particulière:
En outre, [Moïse] a enseigné que cet être a mis en ordre le monde visible àpartir du chaos (cf. Gn 1, 2), a semé les germes de la nature, et a donc sur tou-tes choses droit suprême et souveraineté; et (cf. Dt 10, 14-15) qu’en vertu dece droit et de cette puissance souveraine il a élu la nation des Hébreux pour luiseul, avec une certaine région du monde (cf. Dt 4, 19; 32, 8-9), et laissé lesautres nations et régions aux soins des autres dieux, chargés par lui de l’y rem-placer. Et c’est pourquoi il était appelé Dieu d’Israël et Dieu de Jérusalem (cf.II Ch 32, 19) et les autres dieux étaient appelés dieux des autres nations. C’estaussi pourquoi les Juifs croyaient que cette région que Dieu s’était réservéeexigeait un culte de Dieu particulier et tout à fait différent du culte pratiquédans les autres régions; bien plus: qu’elle ne pouvait souffrir le culte desautres dieux, propre aux autres régions. En effet on croyait que les nations quele roi d’Assyrie avait conduites dans les terres des Juifs avaient été dévoréespar les lions parce qu’elles ignoraient le culte des dieux de cette terre (II Rois17, 25-26 etc.). Et c’est pour cela que Jacob, suivant l’opinion d’Ibn Ezra,lorsqu’il voulut retourner dans sa patrie, dit à ses fils de se préparer à un cultenouveau et d’abandonner les dieux étrangers, c'est-à-dire les dieux du pays oùils vivaient jusque-là (cf. Gn 35, 2-3)62.
«L’opinion d’Ibn Ezra» à laquelle renvoie ici Spinoza est à chercherdans son commentaire sur Dt 31, 16 («Tandis que tu reposeras avec tes
lui-ci était conscient du risque que comportent ses propos pour un esprit faible: celui-ci pour-rait croire qu’il entendait contester ici que Mardochée a écrit Esther. Il aurait donc, seloncette lecture, censuré sa véritable opinion pour préserver la foi de son public peu cultivé, dansson commentaire français.
62. TTP, p. 137.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am442
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 443
pères, ce peuple se laissera débaucher par les divinités de l’étranger de laterre (אלהי נכר-הארץ) où il va pénétrer…»63):
ידענו כי השם אחד והשינוי יבוא מהמקבלים (...). .ץראה רכנ יהלא ירחאומעבודת השם לשמור כח הקיבול כפי המקום (...). והמשכיל יבין.
Par les dieux de l’étranger de la terre: Nous savons que Dieu est un. Et lamultiplication [des divinités] ne vient que de ceux qui reçoivent. […] Et celarelève du culte de Dieu de prendre garde à la [différence] d’intensité de laréception selon l’endroit [où l’on se trouve]. […] Et l’homme perspicace com-prendra.
Dans ce commentaire extrêmement obscur, Ibn Ezra associe deux théma-tiques: celle de l’unité de Dieu et celle de la différence de culte et d’inten-sité de la présence divine selon l’endroit où l’on se trouve (en particulierentre la Terre d’Israël et le reste du monde). Il semble ici pointer une con-tradiction entre ces deux éléments. Le commentaire s’achève, comme denombreux autres commentaires d’Ibn Ezra, par la formule והמשכיל יבין (etl’homme intelligent ou perspicace comprendra). L’obscurité de ce com-mentaire et la difficulté à comprendre ce que voulait y dire Ibn Ezra pro-vient en particulier de la grande ambiguïté du mot מקבלים (meqabbelim),littéralement «ceux qui reçoivent». Ibn Ezra fait en effet ici un usageintransitif du verbe qibbel (recevoir) qui réclame normalement un complé-ment. Il laisse ce complément indéterminé ouvrant la compréhension de soncommentaire à de multiples interprétations.
Spinoza n’a pas choisi ce texte par hasard. Il n’a pu en effet ignorer quece commentaire a donné lieu à de multiples méditations de la part des sur-commentateurs médiévaux d’Ibn Ezra64. Nombre d’entre eux ont comprisce texte en relation avec les enseignements d’Ibn Ezra en matière d’astro-logie. Certains, au sein des cercles néoplatoniciens juifs du XIVe siècle,largement inspirés par Ibn Ezra, sont allés jusqu’à voir dans ce commen-taire l’élaboration par leur maître d’une forme d’antinomisme, déniant toutcaractère contraignant à une partie des commandements toraïques en dehorsde la terre d’Israël, du fait de la différence d’intensité de l’influx divin
63. Traduction du rabbinat modifiée.64. Le commentaire d’Ibn Ezra sur la Torah a en effet donné lieu à un nombre impres-
sionnant de sur-commentaires du XIIe jusqu’au XXe siècle. Dès le XIVe siècle, Judah Léon benMosheh Moskoni, auteur auquel Moritz Steinschneider a consacré une étude canonique,affirme avoir pu consulter pas moins de trente commentaires d’Ibn Ezra. (Pour une listecomplète de tous les sur-commentaires existant sur Ibn Ezra, cf. U. SIMON, «R. AbrahamIbn ‘Ezra – Ha-mefaresh she-hayah li-meforash. Toldot ketibat perushim le-ferushawme-re’shitah we-‘ad teÌillat ha-me'ah ha-XV», in S. JAPHET (dir.), The Bible in the Light ofits Interpreters — Ha-Miqra’ bi-re’i mefarshaw: sefer zikkaron le-Sarah Kamin, Jérusalem,1994, p. 406-411).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am443
444 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
exercé par l’intermédiaire des astres sur les différentes régions du monde65.Spinoza n’a pas pu être insensible à ce type de lecture qui relativise la vali-dité des commandements de la Torah et a donc délibérément choisi de citerce texte ayant donné lieu avant lui à des lectures problématiques au regardde la tradition juive.
Cependant Spinoza ne saurait s’autoriser d’un Ibn Ezra, partisan d’unescience astrologique déjà périmée. En réalité, il ne vise en rien à donner unelecture d’Ibn Ezra conforme à l’esprit dans lequel il a écrit son commen-taire sur la Torah. Ce qu’il cherche chez Ibn Ezra, c’est un auteur de la tra-dition rabbinique dont le texte supporte les thèses qu'il entend lui-mêmedéfendre. Ainsi, en inscrivant le commentaire d’Ibn Ezra sur Dt 31, 16 dansle cadre d’une argumentation visant à dénier, contre Maïmonide, la perfec-tion intellectuelle aux prophètes, Spinoza en donne implicitement une lec-ture qui comprend le terme qibbul (réception) comme lié à la thématique dela prophétie. Spinoza comprend en effet ce commentaire comme laissantentendre que Moïse concevait le Dieu d’Israël comme une divinité natio-nale et régionale, réclamant un culte qui ne s’applique que sur une terresingulière. Il lit donc le début de ce commentaire de la manière suivante:«Nous savons que Dieu est un et la multiplication [des divinités] provientde ceux qui reçoivent [la prophétie].» Toute lecture de ce commentaireréclame d’extrapoler le complément du verbe qibbel qu’Ibn Ezra s’estabstenu d’exprimer. Spinoza opte donc pour (את הנבואה) מקבלים, «ceux quireçoivent la prophétie». Ibn Ezra affirmerait donc ici que nous, Ibn Ezralui-même ainsi que le lecteur intelligent (maskil) à qui il s’adresse ici, sau-rions, à la différence des prophètes, que Dieu est un. Si Moïse – à supposerqu’il soit bien l’auteur du verset commenté – a pu employer l’expressionc’est qu’il pensait que («les dieux de l’étranger de la terre») אלהי נכר הארץles étrangers qui résidaient sur la Terre promise à son époque avaient desdieux qui existaient réellement et non uniquement dans leur imagination.Ibn Ezra établirait donc ici deux thèses pour le moins problématiques auregard de la tradition: 1° que nous avons des connaissances plus étenduesque les prophètes et, spécifiquement, que le «prince des prophètes»,Moïse; 2° que ce dernier, loin de se considérer comme le prophète du Dieu
65. Cf. D. SCHWARZ, «EreÒ, maqom we-khokhab. Ma‘amadah shel EreÒ-Yisra’el bi-tefusato shel ha-Ìug ha-ne’oplatoni be-me’ah ha-XIV», in M. ÎALLAMISH et A. RAVITZKY(dir.), EreÒ-Yisra’el be-hagut ha-yehudit bi-ymei ha-beinayim, Jérusalem, 1991, p. 146-149.D. Schwarz renvoie notamment aux sur-commentaires de Salomon Franco, de Samuel ∑arÒa(Meqor Îayyim), de Ezra ben Salomon Gatinio (Sod H' li-yre’aw), de Shem ™ob ibn Shapru†(∑afenat Pa‘neaÌ [à ne pas confondre avec le sur-commentaire du même titre de Yosef«Bonfils»]) et Shem ™ob ibn Mayor (Ha-me’or ha-gadol).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am444
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 445
unique, pensait au contraire qu’il existait, outre le Dieu d’Israël, quantité dedivinités nationales.
Si Ibn Ezra, dans la suite du commentaire ici cité, évoque la différencede culte que la Torah impose entre la Terre d’Israël et le reste du monde, ceserait, selon Spinoza, pour souligner que cette différence est fondée sur uneconception erronée de la nature de Dieu – conception que nous sommes enmesure de dépasser. Spinoza comprend donc l’expression והמשכיל יבין («etl’homme perspicace comprendra») comme l’indice délibérément laissé parIbn Ezra qu’il est en train d’énoncer une thèse que seul l’homme intelligentdoit comprendre et que la foule, en revanche, ne doit pas s’efforcer desaisir. Ibn Ezra a en effet ponctué ses commentaires de cette expression oud’expressions apparentées, à chaque fois qu’il a souhaité pointer un passagedifficile qui réclame de la part de son lecteur un effort de réflexion. PourSpinoza, la difficulté qu’Ibn Ezra a en l’occurrence souhaité mettre enexergue réside tout simplement dans le fait qu’il énonce sciemment dansce commentaire, de manière cryptique, des thèses radicalement contrairesaux enseignements de la tradition. L’usage d’une expression comme «etl’homme perspicace comprendra» serait alors une manière d’indiquer aulecteur éclairé qu’il y a là à chercher une critique de la tradition et de seprémunir contre la censure. Contre un lecteur qui dénoncerait Ibn Ezracomme un hérétique, celui-ci pourrait en effet toujours lui rétorquer qu’iln’a pas compris ce qu’il a voulu dire, autrement dit qu’il ne fait pas partiede ces «hommes perspicaces», seuls capables de le comprendre. Parce qu’ilinterprète la référence au maskil (l’intelligent) comme l’indice de thèses hé-térodoxes au sein du commentaire d’Ibn Ezra, Spinoza s’est penché, dans leTraité, en priorité, sur les commentaires qui contiennent ce type d’expres-sion.
Le Perush ha-sodot shel Rabbi Abraham Ibn ‘Ezra ‘al ha-Torah, com-mentaire du XIVe siècle consacré aux passages obscurs du commentaired’Ibn Ezra sur la Torah, attribué à Yosef Ibn Kaspi et probablement issu dela plume d'un autre auteur, livre une compréhension radicalement diffé-rente du commentaire sur Dt 31, 16. L’auteur soutient en substance qu’étantimpossible que la Torah affirme l’existence réelle d’autres dieux, Ibn Ezra aexpliqué l’expression les dieux de l’étranger de la terre comme signifiantsimplement que l’étranger qui résidait sur la Terre promise à l’époque deMoïse croyait, lui, en l’existence de ses dieux. De manière assez surpre-nante, il répond comme par avance à la lecture d'Ibn Ezra que fait Spinoza.Il s’interdit de penser que le prophète qui a écrit la Torah ait pu croire enune hérésie telle que l’existence réelle d’une multitude de divinités nationa-les. C’est là, semble-t-il, un des a priori herméneutiques de tout lecteur de
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am445
446 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
la Torah qui s’inscrit dans la tradition juive. Le Pseudo-Ibn Kaspi lit IbnEzra comme un auteur qui, lui aussi, s’efforce de comprendre le verset envertu de cet a priori ; il le lit, à la différence de Spinoza, comme un com-mentateur qui s’inscrit totalement dans la tradition rabbinique. Ainsi, ilcomplète tout autrement que Spinoza le verbe qibbel employé par Ibn Ezra.Pour lui, il faut lire: והשינוי יבא מ(בני אדם) המקבלים «et la multiplication[des divinités] provient des [hommes] qui reçoivent [l’opinion selon la-quelle les dieux qu’ils ont eux-mêmes créés ont une existence effective]»66.En accord avec cette compréhension du début du commentaire, on en com-prend la fin comme l’indication par Ibn Ezra d’une difficulté qu’il revient àchacun de s’efforcer de surmonter, par le recours à son intelligence. Selonl'auteur, Ibn Ezra aurait exposé, dans la suite de son commentaire, le para-doxe qui naît de l’affirmation par la Torah, d’une part, de l’unicité et del’omniprésence de Dieu sur la terre et, d’autre part, de la singularité de laTerre d’Israël eu égard à la providence divine et au culte. Pour lui, Ibn Ezran’a fait que pointer cette difficulté qu’il y a à penser un Dieu à la fois uni-que, régnant par conséquent sur toute la terre, et entretenant avec un peupleet une terre singuliers une relation particulière. L’expression והמשכיל יבין(«et l’homme perspicace comprendra»), loin de renvoyer à une classeélitaire de lecteurs qui seuls auraient accès au véritable sens du commen-taire, signifie donc qu’il revient à chacun de se faire maskil (intelligent) ens’efforçant de démêler ce paradoxe.
C’est donc une compréhension générale de l’œuvre exégétique d’IbnEzra qui est ici en jeu. Spinoza la comprend comme truffée de thèses hété-rodoxes que l’auteur aurait pris soin d’exprimer de manière cryptique touten livrant aux lecteurs avisés des indices suffisants pour les décrypter. LePseudo-Ibn Kaspi comprend au contraire l’écriture délibérément obscured’Ibn Ezra comme une invitation de l’auteur à son lecteur, quel qu’il soit, àfaire usage de son intelligence. Selon cette lecture, Ibn Ezra se serait, dansune perspective pédagogique, contenté de pointer des difficultés et desparadoxes qu’il décèle dans la Torah, afin que chacun s’efforce de les dé-mêler. Selon la lecture que l’on adopte, l’image qui ressort d’Ibn Ezra etdes intentions qui gouvernent son œuvre est radicalement différente, voireopposée. Ce qui fait sans doute la richesse de l’œuvre d’Ibn Ezra est préci-sément qu’elle supporte chacune de ces deux lectures. De cela, Spinoza a sulargement tirer profit. Mais en présentant dans le Traité sa lecture radicaled’Ibn Ezra, il fait plus que d’en proposer une lecture possible, il a voulu par
66. Yosef IBN KASPI (!), Perush ha-sodot shel Rabbi Abraham Ibn ‘Ezra ‘al ha-Torah, in‘Asarah Kelei Kesef, Bratislava, 1903, p. 170-171.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am446
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 447
là même interdire toute lecture alternative en prétendant livrer la véritabledoctrine secrète d’Ibn Ezra. «L'interdiction» dont il s'agit n'est pas uneforme de censure. Cela serait radicalement opposé à la démarche de penséede Spinoza. Néanmoins, Spinoza, présentant Ibn Ezra comme un commen-tateur hérétique, dans un ouvrage destiné à un public débordant largementles rangs du judaïsme, rend difficile d'en soutenir une autre lecture.
3. La citation de Dt 1, 2
a) Introduction
Nous pouvons désormais nous attacher à l’analyse de la citation princi-pale d’Ibn Ezra, celle du commentaire sur Dt 1,2, au chapitre VIII. Cettecitation a la particularité de faire l’objet d’un très long commentaire de lapart de Spinoza. L’enjeu de ce long développement est la contestation de lathèse traditionnelle qui fait de Moïse l’auteur de la Torah. Nous avons déjàvu à l’œuvre la lecture spinoziste des commentaires d’Ibn Ezra. Cependant,si précédemment les partis pris de Spinoza étaient largement implicites, ici,il livre sa compréhension d’Ibn Ezra dans un commentaire quasi linéaire deses propos. Nous nous proposons de suivre à notre tour la même méthode etde donner un commentaire suivi de la longue analyse de Spinoza sur cecommentaire. La citation d’Ibn Ezra est introduite par un paragraphe oùSpinoza en explicite l’enjeu:
Pour procéder avec ordre, j’aborderai en premier lieu les préjugés concernantles véritables rédacteurs des Livres Saints. Commençons par l’auteur du Penta-teuque; presque tous ont cru que c’était Moïse: bien plus, les pharisiens l’ontdéfendu avec tant d’opiniâtreté qu’ils ont tenu pour hérétique quiconque avaitune autre position: et c’est ainsi qu’Ibn Ezra, homme d’une complexion pluslibre et d’une grande érudition, et qui le premier (de tous ceux que j’ai lus) aremarqué ce préjugé, n’a pas osé expliquer ouvertement sa pensée, mais s’estcontenté d’indiquer la question en termes assez obscurs. Je ne craindrai pasde rendre ces termes plus clairs et d’exposer la question elle-même de façonmanifeste67.
Spinoza, en rappelant que la négation de la mosaïcité de la Torah estconsidérée comme une hérésie auprès des pharisiens, revendique pour lui-même ce statut d’hérétique. Il l’attribue par là-même à Ibn Ezra. Spinozadit ici en quelque sorte que si Ibn Ezra avait exprimé ouvertement sa pen-sée, il aurait été totalement rejeté par les tenants de l’orthodoxie juive. S’ilne l’a pas été, au point d’être rapidement reconnu comme un des plusgrands commentateurs non seulement de la Torah, mais aussi de certains
67. TTP, p. 327.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am447
448 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
prophètes et hagiographes, et de figurer auprès de Rashi dans les premièreséditions des bibles rabbiniques68, ce n’est que parce qu’il s’est contenté«d’indiquer» certains problèmes qui découlent de l’attribution à Moïsede la rédaction de la Torah. Il y a donc là un véritable geste de la part deSpinoza. Le Juif mis au ban par les parnasim (dirigeants administratifs) dela communauté d’Amsterdam, s’efforce de tirer à lui, à l’extérieur du cerclede la communauté, celui que celle-ci reconnaît habituellement comme unde ses maîtres.
Voici donc ce que dit Ibn Ezra dans ses commentaires sur le Deutéronome:בעבר הירדן וגו' ואם תבין סוד השנים עשר גם ויכתוב משה והכנעני אז בארץ בהר ה'Au-delà du Jourdain, etc.; pourvu» יראה גם הנה ערשו ערש ברזל תכיר האמת.que tu comprennes le mystère des douze; et aussi Moïse a écrit la Loi: et leCananéen était alors dans le pays; sur la montagne de Dieu il sera révélé: etaussi voilà son lit, un lit de fer; alors tu connais la vérité.» Par ces quelquesmots, il indique, et en même temps établit, que ce ne fut pas Moïse qui rédigeale Pentateuque mais quelqu’un d’autre qui vécut bien plus tard, et enfin que lelivre écrit par Moïse était un autre ouvrage69.
Le passage cité par Spinoza, qui est un court extrait du long commentaired’Ibn Ezra sur le verset Dt 1,2, est constitué par une série de passages issusde différents livres de la Torah, souvent fort éloignés du verset qu’Ibn Ezraest ici supposé commenter. Ces versets n’ont comme seul point communque de contenir chacun un élément qui rend difficile de supposer que c’estbien Moïse qui les a écrits. Ibn Ezra précise, en s’adressant à son lecteur,que s’il «comprend» ces différents passages alors il «connaît la vérité». Ilne fait cependant, comme à son habitude, que mettre en avant des passagesdifficiles; il n’explicite en rien ce qu’il faut en comprendre et en quoiconsiste la «vérité» à laquelle il fait ici allusion. L’enjeu de ce passage,Spinoza l’a bien compris, est de taille. S’il vise bien à affirmer que les ver-sets en question n’ont pas été écrits par Moïse, il semble en effet contredirela croyance largement établie et qui fait quasiment office de dogme au seindu judaïsme70, selon laquelle Moïse a écrit toute la Torah, révélée à lui par
68. Notamment les bibles de Buxdorf et de Bomberg dont disposait Spinoza (cf. A. J.SERVAAS VAN ROOIJEN, op. cit.)
69. TTP, p. 347. (La traduction française du texte hébreu, qui n’est pas en l’occurrencetrès heureuse, est en fait la traduction française de la traduction latine proposée par Spinoza.)
70. Maïmonide inscrit cette croyance dans le huitième de ses fameux treize «principesde la religion» qu’il énonce dans la préface à son commentaire sur le pereq Ìeleq (dixièmechapitre du traité Sanhedrin): היסוד השמיני. היות התורה מן השמים. והוא שנאמין כי כל התורה הזאתהנתונה ע"י משה רבנו ע"ה, שהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה אליו כולה מאת ה' יתברך (...) וכיHuitième principe: que la Torah vient du ciel. Il) הוא היה כמו סופר, שקוראים לו והוא כותבconsiste en ce que nous croyons que toute cette Torah qui fut donnée par le biais de Moïsenotre Maître, la paix soit sur lui, provient dans sa totalité de la bouche de Dieu, autrement dit,qu’elle est arrivée [à Moïse] dans sa totalité de Dieu, Béni-soit-Il. Et [Moïse] était ainsicomme un scribe qui écrit sous la dictée).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am448
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 449
voie de prophétie. On ne s’étonnera donc pas que les nombreux sur-com-mentateurs d’Ibn Ezra se soient efforcés, avant comme après Spinoza, decomprendre ce commentaire et l’intention qui a poussé Ibn Ezra à l’écrire.Dans la compréhension de ce commentaire, c’est l'autorité de toute l’œuvred’Ibn Ezra qui est en jeu. S’il en ressort qu’Ibn Ezra énonce ici de manièrevoilée des propos hérétiques, c’est en effet tous les propos d’Ibn Ezra qui setrouvent invalidés aux yeux d’un lecteur juif orthodoxe. La lecture qu’enpropose Spinoza est entièrement orientée dans cette direction.
b) La «préface» du Deutéronome (Dt 1,1)
Reprenons notre lecture suivie de Spinoza:
Pour le montrer [que Moïse n’a pas écrit le Pentateuque mais un historien plustardif et que le livre écrit par Moïse est un autre livre]:1° [Ibn Ezra] remarque que la préface même du Deutéronome n’a pu êtreécrite par Moïse, qui ne passa pas le Jourdain71.
Spinoza explique ici pourquoi Ibn Ezra insère ces propos à cet endroitprècis de son commentaire. En effet, l’expression בעבר הירדן («au-delàdu Jourdain», c'est-à-dire sur sa rive Est), en Dt 1,1, laisse entendre enhébreu que la personne qui l’énonce se trouve, elle, sur l’autre rive duJourdain. Comme Moïse n’a pas traversé ce fleuve, Spinoza en conclut queselon Ibn Ezra ce verset avait été écrit bien après la mort de Moïse. Spinozan’est pas le premier à comprendre ainsi le commentaire d’Ibn Ezra. Le sur-commentaire Megillat Setarim du philosophe et kabbaliste espagnol de lafin du XVIe siècle, Samuel Ibn Mo†o†, comprend, lui aussi, la référence à«au-delà du Jourdain» comme une invitation par Ibn Ezra à examiner leverset 1,1. Il n’en tire pas moins des conclusions diamétralement opposéesà celle de Spinoza72.
Il donne une lecture tout à la fois proche de Spinoza et radicalementopposée dans sa compréhension des intentions qui animent Ibn Ezra. Ilcomprend comme Spinoza qu’Ibn Ezra met en avant un nombre importantde versets qui semblent ne pas avoir été écrits par Moïse. Typiquement,Mo†o† indique qu’il n’est pas naturel pour Moïse de mentionner qu’il setrouve «au-delà (ou à l’Est) du Jourdain» lorsqu’il s’adresse au peuple la
71. TTP, p. 327.72. Abraham ben Me’ir Ibn Ezra, Margaliyyot ™obah, Amsterdam, 1722, fol. 134b. À
propos de la compréhension de ce commentaire sur Dt 1, 2 dans les sur-commentaires figurantdans cette édition Margaliyyot ™obah, cf. R. JOSPE, «Biblical Exegesis as a PhilosophicLiterary Genre: Abraham Ibn Ezra and Moses Mendelssohn», in E. L. FACKENHEIM etR. JOSPE (dir.), Jewish Philosophy and the Academy, Londres, 1996, p. 57. Les sur-commen-taires en question sont: Meqor Îayyim (1368) de Samuel ibn ∑arÒa, Ohel Yosef (1386)de Yosef ben Eliezer ™ob ‘Elem dit «Bonfils» et Megillat Setarim (fin du XIVe siècle) deSamuel Ibn Mo†o†.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am449
450 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
quarantième année, puisque c’est quelque chose que chacun savait bien à cemoment-là. Cependant, alors que Spinoza en déduit que, selon Ibn Ezra, lapréface du Deutéronome, comme les autres versets mentionnés, n’ont paspu être écrits par Moïse, Mo†o† suppose au contraire qu’Ibn Ezra ne peutpas croire qu’il ne les a pas écrits. Il en déduit qu’Ibn Ezra a souhaité poin-ter ces versets «problématiques» pour indiquer 1° qu’ils ont été écrits parMoïse, par voie de prophétie (בדרך נבואה), 2° que ces versets et, par consé-quent, ceux de la Torah en général, sont écrits à destination de leurs lec-teurs futurs, ce qu’affirme clairement une citation du Talmud73. Si Moïse aprécisé qu’il se trouvait à l’Est du Jourdain lorsqu’il a énoncé ces paroles,au cours de la quarantième année, c’est parce qu’il s’y adresse, de manièreprophétique, aux lecteurs du futur, qui auront, eux, traversé le Jourdain. Onmesure bien là la distance qui sépare un Mo†o†, pour qui la Torah est fonda-mentalement, dans son écriture même, un texte destiné à être lu par lesgénérations futures tout au long de l’histoire, d’un Spinoza qui, au fil duTraité, tente de la réduire à la loi caduque d’un peuple «archaïque»74.
c) Le «mystère des douze»
Poursuivons notre lecture de Spinoza.
2° [Ibn Ezra] remarque que le livre de Moïse tout entier a été transcrit sur leseul pourtour d’un unique autel (cf. Dt 27 et Jos 8, 31, etc.), qui, d’après lerécit des rabbins, ne se composait que de douze pierres: d’où il ressort que lelivre de Moïse avait beaucoup moins d’ampleur que le Pentateuque. C’est cela,à mon sens, que l’auteur a voulu signifier par le mystère des douze. À moinspeut-être qu’il n’ait entendu par là les douze malédictions qui se trouvent dansce chapitre du Deutéronome, et dont il a cru sans doute qu’elles n’étaient pastranscrites dans le livre de la Loi (puisque Moïse, après avoir transcrit la Loi,ordonne aux Lévites de réciter ces malédictions pour contraindre le peuple parserment à observer les lois qu’il a transcrites). Ou encore il a voulu parler dudernier chapitre du Deutéronome, sur la mort de Moïse, qui se compose dedouze versets. Mais il est inutile d’examiner avec trop de soin ces hypothèseset celles que d’autres ont échafaudées (hariolantur).
,Est-ce que la Torah [parle] en vue de [son lecteur] futur? Oui) ומי כתב תורה לעתיד אין .73TB Ketubbot, 10b).
74. Au début du chapitre XV, Spinoza caractérise le Pentateuque comme adapté aux«préjugés d’un ancien peuple» (antiqui vulgi praejudicia, TTP, p. 483). «Cette désignationhistorique a un double sens: ancien signifie originaire, authentique, pur et donc ce qui vautcomme norme pour la religion de la révélation qui reconnaît le texte original comme le seulet unique fondement de son enseignement, et ancien signifie originel, primitif, grossier, noncultivé, barbare, tout ce que la conscience formée à la science doit par conséquent rejeter.»(L. STRAUSS, La Critique de la religion chez Spinoza, op. cit., p. 154).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am450
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 451
L’interprétation livrée ici de ce qu'Ibn Ezra appelle «mystère desdouze» est d’une importance fondamentale. Spinoza y indique très claire-ment qu’il s’inscrit en faux contre une longue tradition de sur-commenta-teurs d’Ibn Ezra. C’est ce qu’il livre dans la dernière phrase de la citation.Spinoza concède qu’il ne fait, lorsqu’il donne une lecture d’Ibn Ezra, queproposer une hypothèse de lecture. En l’occurrence, fait unique parmi tou-tes les citations du Traité, il examine plusieurs hypothèses. Il concède éga-lement qu’il n’est pas le premier à s’efforcer d’élaborer de telles hypothèseset que d’autres commentateurs, avant lui, ont proposé des interprétationsdifférentes d’Ibn Ezra. En désignant ces autres interprétations par le verberare et ici employé de manière très péjorative hariolari, il les présentecomme des lectures tout à fait artificielles qui ne rendent pas compte de lavéritable intention d’Ibn Ezra. On peut supposer que Spinoza vise ici dessur-commentateurs d’Ibn Ezra qui ont donné une compréhension de sonœuvre, comme étant en parfait accord avec les thèses traditionnelles. Enmentionnant de la sorte l’existence d’autres hypothèses de lecture que cellequ’il élabore, Spinoza entend les invalider en les présentant comme des lec-tures artificiellement apologétiques et, par là même, se poser comme le seulvéritable interprète d’Ibn Ezra.
Première hypothèse de lecture: les douze derniers versets de la Torah
Précisons d’emblée que la compréhension la plus communément admiseparmi les sur-commentateurs médiévaux, du moins ceux que nous avons puconsulter75, concernant ce «mystère des douze», est la troisième hypothèseprésentée par Spinoza: il s’agirait des douze derniers versets de la Torahqui rapportent la mort de Moïse (Dt 34, 1-12). À propos du verset 1, IbnEzra écrit en effet:
לפי דעתי כי מזה הפסוק כתב יהושע. כי אחר שעלה משה לא כתב, .השמ לעיוובדרך נבאוה כתבו. והעד ויראהו ה', גם ויאמר ה' אליו, גם ויקבור.
Et Moïse monta. Mon opinion est qu’à partir de ce verset, c’est Josué qui aécrit. Car après qu’il soit monté, Moïse n’a plus écrit et c’est par voie de pro-phétie qu’il a écrit. Et remarque [que les versets disent] Dieu lui fit voir(Dt 34, 1), ainsi que et Dieu lui dit (Dt 34, 4), et aussi et il fut enterré(Dt 34, 6).
75. La plupart des sur-commentaires médiévaux ne sont disponibles que sous formemanuscrite. Pour notre part, nous avons pu consulter, à la bibliothèque de l’Alliance IsraéliteUniverselle, certains sur-commentaires publiés. Pour le Moyen Âge: l’édition Margaliyyot™obah (cf. supra), le ∑afenat Pa‘neaÌ de Yosef ben Eliezer ™ob ‘Elem dit «Bonfils» etle Perush ha-sodot shel Ibn ‘Ezra du Pseudo-Yosef Ibn Kaspi et pour l’époque moderne etcontemporaine: Be’er YiÒÌaq de YiÒÌaq Sarim, Abi ‘Ezer de Shlomoh Kohen Melisa et leOrot me-ofel de Yehoshua Rosenkranz.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am451
452 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
De manière assez surprenante, Mo†o† comme Samuel Ibn Seneh ∑arÒa— philosophe espagnol du XIVe siècle, auteur du sur-commentaire MeqorÎayyim — refusent de comprendre ce commentaire d’Ibn Ezra, pourtantplutôt limpide, comme affirmant que c’est Josué et non Moïse qui a écrit lesdouze derniers versets de la Torah. Ils s’appuient pour ce faire sur l’ambi-guïté de l’expression ובדרך נבאוה כתבו («et c’est par voie de prophétie qu’ila écrit»). Le il en question ne renverrait pas à Josué mais à Moïse. Cettelecture ne prend absolument pas en compte le début du commentaire(«à partir de ce verset c’est Josué qui a écrit»). C’est sans doute ce type delecture que Spinoza entendait rejeter comme artificiel. De manière plus sur-prenante encore, ce refus d'admettre que, selon Ibn Ezra, Moïse n'auraitpas écrit la totalité des versets de la Torah, et en particulier les douze der-niers, se retrouve chez des commentateurs modernes jusqu’au XXe siècle76.
Pourtant, on trouve au sein même du Talmud77 une discussion relative àl’auteur des huit derniers versets de la Torah:
אמר מר יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. כמאן דאמר. שמונה פסוקיםשבתורה יהושע כתבן. דתני: וימת שם משה עבד ה' אפשר משה חי (מת) וכתב וימת שםמשה אלא עד כאן ואילך כתב יהושע. דברי ר"י ואמר לה ר' נחמיה אמר לו ר"ש: אפשרס"ת חסר אות אחד וכתיב לקח את ספר התורה הזה אלא, עד כאן הקב"ה
אומר ומשה אומר וכתב מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע.Un maître a dit: Josué a écrit son livre et huit versets qui sont dans la Torah78.Cette proposition va dans le sens de celui qui a dit: il y a huit versets qui sontdans la Torah qui ont été écrits par Josué, puisqu’il a été enseigné: «Et Moïse,serviteur de Dieu, mourut là» (Dt 34, 5). Est-il possible, en effet, que Moïse,vivant (autre version: mort), ait écrit «Et Moïse mourut là»? Ainsi, à partir dece verset, c’est Josué qui a écrit. Tels sont les propos de R. Yehuda. MaisR. NeÌemyia lui a répondu au nom de R. Simon: est-il possible qu’il manqueun seul signe au livre de la Torah? Or, il est écrit [dès le verset Dt 31, 26].«Prenez ce livre de la Torah [et déposez le à côté de l’arche d’alliance]»Ainsi, jusqu’au verset [«Et Moïse, serviteur de Dieu, mourut là.»] Dieu dictaitet Moïse répétait et écrivait; à partir de ce verset, Dieu dictait et Moïse écrivaiten larmes.
Le débat n’est pas tranché dans la gemara. Le Talmud laisse ouverte laréponse à la question de l’auteur des derniers versets de la Torah. Chacundes deux avis exprimés doit donc avoir à sa façon une validité du point devue de la tradition orale. Les maîtres du Talmud ne s’interdisent en tout caspas de penser que certains versets de la Torah n’ont pas été écrits parMoïse. Il est inhabituel de trouver chez les sages du Talmud ce type de
76. Cf. à ce sujet, R. JOSPE, op. cit., p. 55-57.77. TB Baba batra, 15a.78. Rashi précise qu’il s’agit des huit versets à partir de Et Moïse mourut (Dt 34, 5) jus-
qu’à la fin de la Torah.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am452
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 453
questionnement mettant en cause la possibilité pour un prophète et plusencore pour Moïse d’énoncer un propos quel qu’il soit. Quel peut être, deleur point de vue, l’intérêt de supposer que les huit derniers versets de laTorah ont été écrits par Josué? L’enjeu, nous semble-t-il, est l’articulationde la Torah écrite et de la Torah orale. Affirmer que Josué, le premier àavoir reçu l’enseignement de la Torah orale de la bouche de Moïse d’aprèsla première Michna des Pirqei Abot, a écrit les derniers versets de la Torahrevient en effet à introduire, au sein même de la Torah écrite, l’amorced’une tradition orale. On trouverait ainsi dans la Torah écrite elle-mêmecomme une dynamique de tradition. Cela revient également à affirmer laconsubstantialité de la Torah écrite et de la Torah orale. Nous serions doncen présence d’une manière originale, de la part des maîtres du Talmud, dedire que la Torah écrite resterait incompréhensible sans une tradition d’in-terprétation remontant à Moïse lui-même. Quoi qu’il en soit, comme s’enétonne Raphael Jospe79, les sur-commentateurs traditionalistes d’Ibn Ezras’interdisent de penser que celui-ci puisse ici simplement se prononcer pourl’avis, énoncé dans le Talmud, selon lequel Josué aurait écrit les derniersversets de la Torah. Assurément, quand bien même il ne ferait que trancherdans ce débat talmudique, encore faudrait-il rendre compte de la surenchèrequ’il pratique sur cet avis, en déniant que Moïse a écrit non pas les huitmais les douze derniers versets de la Torah.
Deuxième hypothèse de lecture: les douze pierres
Les deux autres hypothèses de Spinoza sont strictement originales et nefigurent pas dans les sur-commentaires que nous avons pu consulter. Selonla première, le «mystère des douze» renverrait aux douze pierres sur les-quelles Moïse prescrit au peuple, au chapitre 27 du Deutéronome, d’inscriretoute la Torah au moment où il traverserait le Jourdain. («Et tu écriras surles pierres tout le contenu de cette Torah, très distinctement»80.) Dans lelivre de Josué, le récit correspondant à la mise en œuvre de ce commande-ment81, au moment du passage du Jourdain, précise que ce sont douze pier-res qui ont finalement été érigées (une par tribu). À travers l’expression le«mystère des douze», Ibn Ezra aurait invité le lecteur de son commentaireà s’interroger sur le fait qu’il a été possible d’inscrire «toutes les paroles decette Torah» sur seulement douze pierres. La question devient plus difficileencore si l’on suit l’enseignement du Talmud de Babylone (So†ah, 36a)
79. R. JOSPE, op. cit., p. 55-57.Traduction du rabbinat .(Dt 27, 8) וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. .80
modifiée.81. Jos 4, 3-9; 8, 30-31.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am453
454 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
selon lequel toute la Torah a été non seulement écrite sur ces douze pierresmais l’a été, traduite en soixante-dix langues82. Or, Ibn Ezra donne unetoute autre compréhension de ces versets. Dans son commentaire sur leverset 1, il écrit:
שמר את כל המצוה. ומה היא, והקמת לך אבנים גדולות. להכיל התורה. ויאמר הגאוןז"ל כי כתוב עליהן מספר המצות, (...). ויפה אמר.
Observez toute la loi. De quelle loi s’agit-il? «Tu érigeras pour toi de grandespierres» (27:2), afin de contenir la Torah. Et [Sa‘adia] Gaon de mémoirebénie a dit qu’il était écrit sur elles l’énoncé des commandements […]. Et il abien parlé.
Puis, à propos du verset 8:
באר היטב. הכתיבה.Très distinctement. L’écriture.
Contre la tradition talmudique, Ibn Ezra comprend cette précision «trèsdistinctement», comme se rapportant simplement à la manière dont les motsétaient écrits sur les pierres et non comme indiquant qu’ils ont été traduits.De plus, il s’appuie sur Sa‘adia Gaon pour affirmer que, ce qui était écrit surces pierres, n’était qu’une liste des commandements que l’on trouve dans laTorah. Or le verset dit bien «tu écriras sur les pierres toutes les paroles decette Torah» (וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת). Spinoza en conclutqu’Ibn Ezra a voulu laisser entendre que le livre de Moïse, autrement dit«cette Torah» dont parle le verset, n’était rien d’autre que cette liste decommandements et non le Pentateuque tel que nous le connaissons. Quel’interprétation donnée ici par Ibn Ezra sur ce verset pose problème au re-gard de la tradition fait peu de doute. Néanmoins, supposer qu’Ibn Ezra ren-voie à ces douze pierres lorsqu’il invoque «le mystère des douze» est déli-cat. D’abord, dans ses commentaires à propos de ces pierres au chapitre 27,il ne fait jamais mention du nombre douze. Ensuite, supposer qu’Ibn Ezra avoulu insinuer ici que tout le livre de Moïse se réduisait à la liste des com-mandements est loin d’être évident. La lecture que Spinoza met en œuvre àpartir de cette hypothèse relève elle aussi du type de construction artificiellequ’il reproche aux commentateurs traditionalistes d’Ibn Ezra.
Troisième hypothèse de lecture: les douze malédictions
La dernière hypothèse concernant le «mystère des douze» est nettementmoins argumentée mais elle peut néanmoins nous intéresser, moins pour
82. C’est ainsi que la gemara, rapportée par Rashi dans son commentaire sur ces versets,comprend l’expression «très distinctement»: וכתבו עליהם את כל דברי התורה בשבעים לשוןEt ils écrivirent dessus toute la Torah dans soixante-dix langues, ainsi qu’il) שנאמר באר היטבest dit: «Très distinctement» [Dt 27, 8]).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am454
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 455
elle-même que pour ce qu’elle laisse entendre. Ce mystère renverrait auxdouze malédictions qui figurent dans le même chapitre 27 du Deutéronome(versets 15 à 26). Comme Moïse a déjà ordonné auparavant, au début duchapitre, d’écrire «toutes les paroles de cette Torah», Spinoza supposequ’Ibn Ezra a laissé entendre que le texte du livre, que Moïse désigne dansce contexte comme «Torah», était déjà clos avant l’énoncé des malédic-tions et que, par conséquent, ce n’est pas lui qui les a écrites. Cette hypo-thèse de Spinoza est assez fantaisiste. Le commentaire d’Ibn Ezra sur cesmalédictions ne laisse rien entendre de tel. Ce qui est ici néanmoins intéres-sant est la manière de lire la Torah que Spinoza prête à Ibn Ezra. À le sui-vre, Ibn Ezra appréhenderait la Torah comme un texte strictement chrono-logique. On peut schématiser ainsi la pensée qu’il attribue à Ibn Ezra: si unverset parle de la Torah comme d’un texte clos, alors tous les versets qui lesuivent ne font nécessairement pas partie de cette Torah originelle et ensont par conséquent des ajouts tardifs. Or il est un principe, issu du Talmud,selon lequel la Torah ne respecte précisément pas l’ordre chronologique83 etil se trouve qu’Ibn Ezra a fait usage de ce principe à propos des versets 24 à26 du chapitre 31 du Deutéronome, qui rapportent précisément l’achève-ment de la rédaction de la Torah par Moïse:
24Or, lorsque Moïse eut achevé de transcrire les paroles de cette Loi sur unlivre, jusqu’au bout, 25il ordonna aux Lévites, porteurs de l’arche d’alliancedu Seigneur, ce qui suit: 26«Prenez ce livre de la Loi et déposez-le à côté del’arche d’alliance de l’Éternel, votre Dieu; il y restera comme un témoincontre toi»84.
Le chapitre 33 du Deutéronome constitue le récit des bénédictions queMoïse a adressées à chaque tribu avant de mourir. Or celles-ci ne sont pasannoncées avant le verset Dt 31, 26. À supposer que Moïse soit bienl’auteur de toute la Torah, il est nécessaire que les bénédictions du chapitre33 aient été prononcées et inscrites dans la Torah avant que celle-ci ne soitplacée dans l’arche. Or, précisément, à propos du verset Dt 31, 1 («Moïsealla ensuite adresser les paroles suivantes à tout Israël»85), Ibn Ezra écrit:
(...) ולפי דעתי, כי אז ברך השבטים, ואם ברכותיהם מאוחרות במכתב. .ךליו[Moïse] alla. […] Et, à mon avis, c’est à ce moment-là qu’il a béni les tribus,bien que leurs bénédictions ne figurent qu’après dans le texte86.
Au grand dam de Spinoza, Ibn Ezra ne lit pas la Torah comme un texteordinaire supposé suivre une démarche chronologique. Il n’est pas de
83. PesaÌim, 6b: אין מוקדם ומאוחר בתורה (Il n’y pas d’avant et d’après dans la Torah).84. Traduction du rabbinat.85. Idem.86. NaÌmanide, dans son commentaire sur Dt 31, 24-26, s’appuie sur ce passage d’Ibn
Ezra pour défendre la totale mosaïcité de la Torah.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am455
456 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
ce point de vue son prédécesseur. C’est pourtant ce que le philosophed’Amsterdam laisse entendre dans cette troisième hypothèse de lecture du«mystère des douze».
d) Le Cananéen
Revenons à notre lecture suivie de Spinoza, en sautant le point 3 quin’apporte pas d’éléments proprement originaux87, pour nous pencher direc-tement sur le point 4:
4° [Ibn Ezra] remarque que le passage de la Genèse (12, 6) où, en racontantqu’Abraham parcourait le pays des Cananéens, l’historien ajoute: le Cananéenétait alors dans le pays. Cela exclut donc clairement qu’il en soit encore ainsiau moment où il écrit. Donc ces mots ont dû être écrits après la mort de Moïse,c'est-à-dire lorsque les Cananéens, expulsés, ne possédaient plus ces territoi-res. Ibn Ezra le donne à entendre aussi en commentant ce passage, והכנעני אזבארץ. יתכן שארץ כנען תפשה כנען מיד אחר ואם איננו כן יש לו סוד והמשכיל ידום.«Et le Cananéen était alors dans ce pays; il semble que Canaan (petit-fils deNoé) a pris le pays du Cananéen, qui était possédé par un autre; si ce n’est pasvrai, il y a là un mystère, et que se taise celui qui l’a compris.» C'est-à-dire: siCanaan a envahi ces territoires, alors le sens sera: «le Cananéen était déjàdans ce pays», par opposition à une époque antérieure où une autre nationl’habitait. Mais si c’est Canaan qui le premier a habité ces territoires (ce quiest établi par Gn 10), le texte doit être compris par opposition à l’époque pré-sente, c'est-à-dire celle du rédacteur. Donc il ne s’agit pas de Moïse, puisqu’àson époque, les Cananéens possédaient encore ces territoires. Et voilà le mys-tère qu’Ibn Ezra recommande de taire.
Le commentaire d’Ibn Ezra sur ce verset se concentre sur l’ambiguïté dumot אז (alors). C’est du moins la lecture qu’en donnent la plupart des sur-commentateurs suivis sur ce point par Spinoza. Ainsi, selon le commentaireMeqor Îayyim de Samuel Ibn ∑arÒa,88 le mot אז (alors) peut aussi biensignifier «à cette époque et pas auparavant», que «à cette époque et plusaujourd’hui». Ibn Ezra explique que si ce mot est employé dans le premiersens, le verset ne pose pas de difficulté. Il enseigne simplement qu’aumoment où Abram est arrivé dans le pays, destiné à devenir la terred’Israël, celui-ci était dominé par Canaan contrairement à une époque anté-rieure. Si, au contraire, il faut entendre le mot אז comme signifiant à l’épo-que d’Abram et plus aujourd’hui, à l’époque de la rédaction de ce verset,il y a un mystère, puisqu’à l’époque de Moïse, le pays en question était
87. «3° Il remarque qu’il est dit (Dt 31, 9): Et Moïse écrivit la Loi – termes qui ne peu-vent être de Moïse, mais sont d’un autre rédacteur qui rapporte les actes et les écrits deMoïse». (TTP, p. 329).
88. Abraham ben Me’ir Ibn Ezra, Margaliyyot ™obah, op. cit., fol. 19a.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am456
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 457
toujours occupé par les Cananéens. De plus, celui qui comprend ce mystèreest sommé de le taire.
Deux manières de comprendre les propos d’Ibn Ezra restent donc autori-sées. Soit il a lui-même pensé que Moïse avait écrit ce verset et il a souhaitéécarter une interprétation qui laisserait entendre le contraire. Si, dès lors,celui qui comprend le mot אז comme signifiant «alors et plus maintenant»doit se taire, c’est que celui-là est un hérétique qu’il convient de faire taire(c’est là la compréhension de Mo†o† et des autres sur-commentateurs tradi-tionalistes). Soit Ibn Ezra a lui-même pensé que ce verset n’a pas été écritpar Moïse. Dans ce cas, il y a deux manières de comprendre l’appel d’IbnEzra à taire ce mystère: 1) il convient de taire ce secret sous peine d’êtreaccusé d’hérésie (c’est ainsi que le comprend Spinoza), 2) ce secret n’estpas proprement hérétique, cependant il convient de le taire car il risqueraitde nuire à la foi de la foule qui n’est pas en mesure de le comprendre89.
Il ressort de notre lecture suivie de la lecture suivie d’Ibn Ezra parSpinoza que celui-ci s’inscrit tout à fait sciemment dans une traditionherméneutique qui voit dans Ibn Ezra l'auteur de commentaires «proto-critiques». Il prétend cependant livrer la véritable intention d’Ibn Ezra enaffirmant que celui-ci pensait non seulement que certains versets particuliè-rement problématiques n’ont pas pu être écrits par Moïse mais aussi quecela met en cause la mosaïcité de toute la Torah. Ce faisant, Spinoza entend«interdire», au sens précédemment indiqué, toute autre compréhensiond’Ibn Ezra et lui donner définitivement l’image d’un hérétique au sein dujudaïsme.
e) Le véritable enjeu de la citation
Le recours de Spinoza à Ibn Ezra et la longue analyse qu’il suscite dansle cadre de l’élaboration d’une exégèse historico-critique est tout autrechose qu’un argument d’autorité. Cela apparaît clairement lorsque l’onprend en compte l’Annotation 190 du Traité, selon laquelle «Ibn Ezra […]ne sait pas vraiment l’hébreu»91. Comment Spinoza pourrait-il s’autoriserd’un auteur qu’il juge si incompétent en hébreu pour mettre en œuvre unelecture critique des Écritures précisément fondée sur la connaissance deleur langue de rédaction? Le véritable enjeu de cette citation réside donc,
89. Voir la note d’A. Weizer sur ce commentaire (Abraham ben Me’ir Ibn Ezra, Perusheiha-torah, A. WEIZER (éd.), Jérusalem, 1976, III).
90. Les «Adnotationes» sont pour l’essentiel des notes manuscrites trouvées sur l’exem-plaire du Traité que possédait Spinoza et qui sont reproduites dans toutes les éditions moder-nes du texte.
91. TTP, p. 655.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am457
458 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
très précisément, dans la volonté de Spinoza de rendre caduque une autrecompréhension d’Ibn Ezra. On peut donner une représentation schématiquedes différentes compréhensions possibles des commentaires «proto-criti-ques» d’Ibn Ezra.
Première compréhension. Dans ces commentaires, Ibn Ezra s’estcontenté de pointer des versets problématiques, mais il n’a jamais contestéqu’ils aient été écrits par Moïse. Au contraire, il a souhaité indiquer qu’illes a écrits de manière prophétique, à destination des lecteurs futurs de laTorah. C’est là la position des sur-commentateurs traditionalistes, qui a étésoutenue par des sur-commentateurs médiévaux (nous l’avons trouvée chezMo†o† et Ibn ∑arÒa, mais aussi implicitement chez NaÌmanide) et quecertains sur-commentateurs modernes ont continué de soutenir (par exem-ple Yehuda Leib Krinsky, Shlomoh Zalman Netter92).
Deuxième compréhension. Dans ces commentaires, Ibn Ezra indique quecertains versets n’ont pas été écrits par Moïse. Cette position place assuré-ment Ibn Ezra dans un rapport de tension avec la tradition, malgré le pas-sage talmudique mentionné sur les huit derniers versets de la Torah. C’estpourquoi de cette deuxième lecture d’Ibn Ezra découle l'alternative sui-vante:
1. Le rejet d’Ibn Ezra hors la tradition juive comme hérétique. Cetteaccusation d’hérésie à l’égard d’Ibn Ezra semble avoir existé dès lespremiers siècles ayant suivi sa vie. C’est ainsi pour lutter contre cetteaccusation d’hérésie que de nombreux sur-commentateurs affirmentavoir rédigé un commentaire sur Ibn Ezra93. Spinoza, en affirmantqu’Ibn Ezra doutait de la mosaïcité de toute la Torah, opte très claire-ment pour cette position. Cependant, à la différence des détracteursorthodoxes d’Ibn Ezra, c’est pour le louer qu’il en fait un hérétique.
2. L’effort pour comprendre ce que cela peut signifier, dans le cadre dela tradition juive, d’affirmer que certains versets de la Torah n’ontpas été écrits par Moïse. Cet effort a existé chez certains sur-com-mentateurs médiévaux d’Ibn Ezra. Nous pensons que c’est précisé-ment ce type d’interprétation que Spinoza a essayé d’«interdire».
92. Cf. R. JOSPE, loc. cit.93. La préface du commentaire ∑afenat Pa‘neaÌ de Yosef «Bonfils» est à cet égard
exemplaire. L’auteur y justifie ainsi l’écriture de son commentaire: ובעבור שדבריו קצרים מאודהוצרך אנשים לפרש רמזי סודותיו. (...) ורבו הוציאו דבריו ממשמע (...) ואשר שמעו דברי המבארים ההםEt, parce que ses propos sont très elliptiques, il faut des») (…) חשדו אותו שנטה לדרכי מינותhommes pour expliciter les allusions à ses mystères. […] Et nombreux sont ceux qui ont faitsortir ses propos de leur sens véritable. […] Et ceux qui ont entendu les explications deces interprètes l’ont accusé d’avoir emprunté la voie de l’hérésie.», Yosef ben Eliezer ™ob‘Elem dit «Bonfils», ∑afenat Pa‘neaÌ. Ein Beitrag zur Pentateuchexegese des Mittelalters,D. HERZOG (éd.), Heidelberg, 1911, p. 7).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am458
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 459
Le sur-commentaire ∑afenat Pa‘neaÌ est un bon exemple d'un tel effort.À propos de Gn 12, 6 («et le Cananéen était alors dans la terre»), l’auteur,Yosef «Bonfils», écrit en effet:
Nous savons que le Cananéen ne s’est écarté [de la terre] qu’après la mort deMoïse, lorsque Josué l’a conquise. Par conséquent, il semble que ce n’est pasMoïse qui a écrit ce mot (אז, alors) ici, mais que ce n’est que Josué ou un desautres prophètes qui l’a écrit. […] On avait transmis oralement, au sein dupeuple d’Israël, qu’à l’époque d’Abraham, le Cananéen était dans la terre et undes prophètes l’a mis par écrit ici [dans la Torah]. Et, dans la mesure où ilnous faut croire aux paroles de la tradition [orale] et de la prophétie, quelledifférence cela fait-il que ce soit Moïse qui l’ait écrit ou un autre prophète,puisque les paroles de tous sont vraies et relèvent de la prophétie? Si tu objec-tes qu’il est écrit Tu n’y ajouteras rien (Dt 13, 1), sache que Rabbi Abraham[Ibn Ezra] lui-même a expliqué94 […] que Tu n’y ajouteras rien n’a été ditqu’au sujet des commandements. Autrement dit, si la Torah n’a prescrit de nerien ajouter, ce n’est qu’à propos de l’énoncé des commandements (מספרet de leur principe et non des mots. C’est pourquoi, si un prophète (המצותajoute un ou plusieurs mots pour expliciter une chose conformément à la tradi-tion [orale] qu’il a reçue, il ne s’agit pas d’un ajout (אין זו תוספת). […] Et telest le secret qu’il ne convient pas de dévoiler à tout homme afin qu’il ne mé-prise pas la Torah. Car qui n’est pas avisé (משכיל) ne sait pas faire la diffé-rence entre les versets dans lesquels sont formulés des commandements etceux qui relèvent du récit95.
Nous sommes là en présence d’une réflexion particulièrement oséeconcernant le statut du texte biblique. Il y va d’une véritable démystifica-tion de la sacralité absolue attribuée à la Torah écrite, fondée sur une nettedistinction entre ses passages aggadiques (récits) et ses passages halakhi-ques (commandements). Cette distinction s’appuie, semble-t-il, sur le rôlequ’Ibn Ezra attribue aux commandements. Dans son commentaire sur Ex33, 2396, il écrit:
Tout ce que la configuration des étoiles a décrété sur un individu au momentde sa naissance lui arrivera nécessairement à moins qu’il soit protégé par unepuissance supérieure à celle des étoiles. S’il s’en remet [à cette puissance], iléchappera à leur décret. […] Tel est ce que les Sages de mémoire bénie ontdit: «Israël n’a pas d'étoile» (אין מזל לישראל)97 tant qu’ils observent la Torah.Mais s’ils ne l’observent pas, ils seront régis par les étoiles98.
94. Il convient de noter qu’Ibn Ezra n’a pas, explicitement du moins, affirmé cela dansson commentaire sur la Torah.
95. Ibid., p. 91.96. Ibn Ezra a écrit deux commentaires sur l’Exode. Il s’agit en l’occurrence d’un passage
que l’on trouve dans le «long» commentaire, celui qui figure dans la plupart des bibles rabbi-niques.
97. TB Shabbat, 156a et b; Nedarim, 32a.98. Voir aussi son commentaire sur Dt 4, 19: «Qu’il a alloué. C’est une chose que l’on
peut observer qu’il y a pour chaque peuple une étoile déterminée et une constellation et il y aégalement une constellation pour chaque ville. Mais Dieu a établi Israël dans une position
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am459
460 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
Ainsi, seule la Torah, en tant que Loi, permet à Israël d’échapper audéterminisme astral qui est le lot de tous les autres peuples99. Les comman-dements sont, selon Ibn Ezra, ce qui permet qu’une liberté puisse émergerdans un monde totalement régi par la loi de la nécessité. Ils sont pour lui lecœur même de la Torah. On comprend mieux, dès lors, sa compréhensiondu verset Dt 27, 8 sur les douze pierres, qui ne contenaient que l’énoncé descommandements (מספר המצות). Il s’agit moins de contester que les partiesaggadiques de la Torah ne font pas partie du livre de Moïse, que d’affirmerla centralité des commandements, qui forment en quelque sorte la substancede la Torah.
À partir de cette importance accordée par Ibn Ezra aux commandements,l’auteur du ∑afenat Pa‘neaÌ comprend l'affirmation que certains versets dela Torah n’ont pas été écrits par Moïse, non pas comme une attaque contrel’authenticité de la Torah, mais bien comme une défense de la traditionorale. D’une part, le cœur même de la Torah, que constituent les comman-dements, est préservé en tant que loi divine révélée à Moïse et visant àémanciper un peuple de la nécessité. D’autre part, l’attribution de certainsversets aggadiques à des prophètes postérieurs à Moïse introduit unedimension de tradition orale au sein même de la Torah écrite. La foi dansles récits historiques de la Torah est ramenée à une foi dans le témoignagede ceux qui en ont transmis la mémoire100. Avec cette introduction d’une«dynamique» de transmission au sein même de la Torah écrite, on enrevient à l’enjeu de la discussion talmudique sur les huit derniers versets dela Torah (Baba batra, 15a).
Reste qu’Ibn Ezra surenchérit sur ce passage talmudique, en doutant dela mosaïcité des douze et non des huit derniers versets de la Torah et en leuradjoignant de nombreux autres versets dispersés dans tout le Pentateu-que101. Il faut rappeler ici le contexte de la rédaction du commentaire d’IbnEzra sur la Torah et en particulier le fait qu’il est en grande partie écritcontre le karaïsme. Dans l’introduction à son commentaire, Ibn Ezra fait lacritique de cinq types d’exégèse, parmi lesquelles le karaïsme, dont le rejet
très élevée en se faisant son conseiller et en ne lui attribuant pas d’étoile. Ainsi Israël est lapropriété de Dieu (נחלת השם).»
99. Cf. à ce sujet, Y. ∑VI LANGERMANN, «Astrological Themes in Ibn Ezra», inI. TWERSKY et J. M. HARRIS (éd.), Abraham Ibn Ezra. Studies in the Writings of a Twelfth-Century Jewish Polymath, Cambridge (Massachussetts) et Londres, 1993, p. 49 sq.
100. C’est là une thématique que l’on trouve également dans le Kuzari de YehudaHallévi, ami intime d’Ibn Ezra. Cf. Juda Hallévi, Le Kuzari. Apologie de la religion méprisée,trad. Ch. TOUATI, Paris, 2001, livre I notamment.
101. Cf. à ce sujet, les propos d’A. Weizer dans ses notes sur le commentaire à Dt 1, 2:Abraham ben Me’ir Ibn Ezra, op. cit., III, p. 214, n. 18-23.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am460
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 461
de la tradition orale conduit, selon lui, à une approche subjective du texte,particulièrement en matière de halakha. Dans ce contexte, il nie l’auto-suffisance de la Torah écrite: «Tu ne trouveras pas dans la Torah un seulcommandement assez expliqué pour couvrir tous les cas de son applica-tion» (לא תמצה בתורה מצוה אחת בכל צרכיה מבוארה). Amos Funkenstein,qui considérait pourtant Ibn Ezra comme un auteur conservateur qui n’ajamais douté de la mosaïcité de la Torah, reconnaît à la fois que celui-ciutilise souvent des arguments que l’on trouve originellement dans lekaraïsme et que ses commentaires «proto-critiques» sont dirigés contreeux102. En d’autres termes, la surenchère d’Ibn Ezra sur les propos de Bababatra (15a) se justifie totalement par la polémique anti-karaïte. Ibn Ezra«désacralise» en quelque sorte la Torah écrite en l’inscrivant elle-mêmedans une dynamique de transmission humaine, tout en employant uneméthode de lecture littéraliste et grammaticale audible par des lecteurskaraïtes.
Ainsi comprises, les remarques proto-critiques d’Ibn Ezra, non seule-ment n’en font pas un hérétique parmi les pharisiens, mais elles en font unfervent défenseur de la tradition orale. La tradition est nécessaire parcequ’elle seule permet de mettre en pratique les commandements. Or les com-mandements sont cela même qui permet à Israël d’échapper au détermi-nisme et d’accéder à une forme de liberté. Ibn Ezra, lu notamment par soncommentateur Yosef «Bonfils», fournit donc par avance, une sérieuse neu-tralisation des attaques de la critique biblique contre l’autorité de la Torahet de la tradition. Toute la complexité de l’œuvre d’Ibn Ezra est là. Il faitmontre d’une liberté critique à l’égard des propos des sages de la traditiontout en se posant, contre les karaïtes, en défenseur de la tradition. C’est quela Torah orale, qui pour lui commence, nous l’avons vu, au sein même dutexte biblique, est précisément destinée à faire une place à la penséehumaine, à la libérer du poids écrasant d’un texte d’origine divine érigé enabsolu103. Une philosophie juive, dès lors, est assurément possible. Que l’onpuisse comprendre ainsi Ibn Ezra, Spinoza ne pouvait l’admettre.
Nous sommes donc fondés à conclure que Spinoza poursuit deux objec-tifs en donnant sa lecture d’Ibn Ezra: 1) Il fait entendre une voix qui, ausein même de la tradition juive, aurait mis en cause l’autorité de la Torahécrite et son caractère révélé. Contre Maïmonide notamment, il entend
102. A. FUNKENSTEIN, Signonot be-farshanut ha-Miqra’ bi-ymei ha-beinayim, Tel Aviv,1990, p. 33.
103. En cela, il inscrit son œuvre dans la lignée du célèbre passage du Talmud à proposdu four d’Akhnaï (TB Baba meÒia, 59b), dans lequel Rabbi Yehoshua‘ interdit littéralement àDieu d’intervenir dans les débats entre les sages.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am461
462 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
dénier à la Torah toute capacité à servir de source de méditation philosophi-que. 2) Il «interdit» une lecture d’Ibn Ezra qui rend compatibles des remar-ques de type critique ou proto-critique avec une stricte fidélité à la traditionorale et une stricte orthodoxie en matière d’observance des commande-ments, compris comme condition de la liberté et, en particulier, de la libertéde penser. Assurément, il a réussi dans cette entreprise. Jusqu’au XXe siècle,Ibn Ezra a gardé, auprès de l’orthodoxie juive, une image entachée dusoupçon d’hérésie. Ainsi, Samuel David Luzzatto justifie la rédaction deson commentaire sur la Torah, Ha-mishtaddel, au milieu du XIXe siècle, parla diffusion de la pensée de Spinoza en monde juif. Malgré son aversion àl’endroit de Maïmonide et d’Ibn Ezra dont il condamne l’usage de la philo-sophie dans le cadre de l’exégèse, il énonce une défense d’Ibn Ezra enmontrant que Spinoza n’était en rien fondé à étendre le doute que celui-ciformule à propos de certains versets à l’ensemble de la Torah104. Spinoza aainsi durablement pesé sur la réception d’Ibn Ezra. Deux tendances existentparmi les sur-commentaires modernes d’Ibn Ezra: une tendance à en faire,avec Spinoza, un véritable hérétique que ce soit pour le louer ou le dénon-cer105, la tendance inverse qui en donne, en grande partie contre Spinoza,une lecture conservatrice106. On peine en tous cas à trouver une lecture dutype de celle du ∑afenat Pa‘neaÌ qui réconcilie Ibn Ezra dans toute sonoriginalité avec la tradition rabbinique. Sur ce point du moins, Spinoza peutse targuer d’un succès.
C. Conclusion: comment Spinoza a ébranlé le projet d’une philosophiejuive
Nous avons démonté les mécanismes de lecture de Spinoza. Outre lacritique manifeste de Maïmonide, dans le Traité, en tant qu’exégète sacri-
104. «Et du fait que, dans cette génération, les livres de Spinoza se sont déjà répandus depar le monde, qu’ils ont d’ores et déjà été traduits en allemand et en français, et que les louan-ges de cet individu ont d’ores et déjà été écrites même dans la langue sacrée et que, parconséquent, les lecteurs de ses livres se multiplient aussi bien au sein d’Israël que dans denombreux (autres) peuples, je me vois obligé de faire savoir que Spinoza a écrit des menson-ges et des duperies au début du chapitre VIII de son livre Tractatus theologico-politicus [enlatin dans le texte], lorsqu’il a dit que le Rav Abraham Ibn Ezra a écrit par allusion que Moïsen’a pas écrit la Torah». (Samuel David LUZZATTO, Ha-mishtaddel, Vienne, 1847, fol. 12b,notre traduction).
105. En 1900, un certain Rosenkranz a ainsi proposé un commentaire sur Ibn Ezra quien fait un prédécesseur non seulement de Spinoza mais aussi de Darwin. (YehoshuaROSENKRANZ, Orot me-ofel, Varsovie, 1900).
106. Sur la réception d’Ibn Ezra après Spinoza, cf. J. M. HARRIS, «Ibn Ezra in ModernJewish Perspective», in Rabbi Abraham Ibn Ezra: Studies in the Writings of a Twelfth-Century Jewish Polymath, op. cit., p. 129-170 et I. LANCASTER, op. cit., p. 22-35.
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am462
ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA 463
fiant le sens véritable des versets à son entreprise de conciliation de la révé-lation et de la raison, se déploie une critique plus imficite de Maïmonide entant que philosophe incomplet, soumis à un texte révélé. Mieux, Spinozamontre que la soumission de l’Écriture à la raison, position «dogmatique»en matière d’exégèse, est par là même soumission de la raison à l’Écriture.Il fait apparaître le rationalisme maïmonidien comme un rationalisme limitépar une révélation. Spinoza pointe chez Maïmonide des textes problémati-ques qui le font apparaître, contrairement aux idées reçues, comme un ratio-naliste tout à fait modéré, aussi bien dans le domaine éthique que dans ledomaine théorétique. Pour remédier à ces deux limitations fondamentalesde la raison, la Torah, en tant que texte révélé est nécessaire: elle fournitune règle de la vie bonne et une source d’investigation philosophique, quidonne des réponses théoriques là où la raison échoue à le faire. Nous avonsvu que d’autres compréhensions de l’œuvre de Maïmonide étaient possi-bles. Mais Spinoza induit cette lecture à travers les textes qu’il choisit deciter et la manière qu’il a eu de les citer et de les commenter.
Ibn Ezra, quant à lui, est lu comme un auteur cachant une doctrine héré-tique au sein de ses commentaires bibliques par de complexes procédésd’écriture. Dans la mesure où il est effectivement un écrivain ésotérique, ilfaut, pour commencer à le lire, un parti pris de lecture. Celui de Spinoza estclair: Ibn Ezra est son prédécesseur en matière de critique biblique. Commelui, il a remis en cause l’attribution traditionnelle des textes du canon juifet, comme lui, il l’a fait parce qu’il ne pensait pas que ces textes fussentrévélés. Un autre parti pris de lecture, radicalement opposé, est, nousl’avons vu, possible. On peut lire Ibn Ezra comme un fervent défenseur dela tradition rabbanite. Ses remarques proto-critiques seraient, dès lors, nonpas une mise en cause de la révélation en tant que telle, mais l’affirmationque celle-ci a une histoire, qui est fondamentalement l’histoire de sa trans-mission. Dans cette histoire, il y a une place pour la pensée individuelle,dans la mesure où le texte n’écrase pas l’individu de son autorité. De cepoint de vue, Ibn Ezra apparaît comme un partisan de la liberté de philoso-pher au sein même de la tradition juive. C’est aussi sans doute, cette com-préhension de l’œuvre d’Ibn Ezra que Spinoza a souhaité «interdire» en li-vrant la lecture qu’il en donne. Ibn Ezra a une position en constante tensionentre l’inscription dans la tradition et l’affirmation d’une individualité.C’est ce qui fait de lui un auteur tellement ambigu, pouvant être lu de diver-ses manières et notamment, à l’instar de Spinoza, comme un hérétique.
*
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am463
464 ABRAHAM IBN EZRA ET MOÏSE MAÏMONIDE CITÉS PAR SPINOZA
Dans le Traité théologico-politique, Spinoza s’adresse assurémentd'abord à un chrétien, qu’il s’agit de «convertir» à la philosophie107. Maisles citations de Maïmonide et d’Ibn Ezra qui y figurent montrent, si onleur accorde le crédit de prétendre livrer une interprétation de ces deuxauteurs, que le Juif philosophe fait également partie des cibles du «Juifd’Amsterdam». Dans sa déconstruction de la possibilité d’une philosophiejuive, Spinoza a mis en avant la centralité du rôle de la Torah dans lesphilosophies juives de ses prédécesseurs médiévaux, avant de démonter lapossibilité même d’utiliser la Torah comme un réservoir philosophique. Il atenté de neutraliser au passage une institution qui peut faire apparaître lejudaïsme comme une religion rationaliste et universaliste, le noachisme. Ilreviendra aux philosophes de la refondation post-spinoziste de l’entreprisephilosophique juive, au cours d’un long XIXe siècle allant de MosesMendelssohn à Hermann Cohen, en passant par Nachman Krochmal, dedigérer la critique biblique et la critique du noachisme. Spinoza, par sacritique de la philosophie juive à travers ses citations de Maïmonide etd’Ibn Ezra, a ainsi durablement et lourdement marqué la pensée philosophi-que moderne en monde juif qui peine à se libérer de son héritage spinozienou – ce qui revient au même – anti-spinozien: son caractère apologétique.
David LEMLER
107. Sur ce point, on ne peut que suivre L. Strauss (L. STRAUSS, La Critique de la religionchez Spinoza, op. cit.).
2363-09-REJ09/3-4_05_Lemler 4/12/09, 8:39 am464