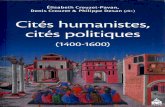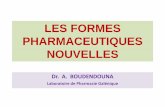Formes et enjeux d'une médicalisation médiévale: réflexions sur les cités italiennes (XIIIe-XVe...
-
Upload
univ-avignon -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Formes et enjeux d'une médicalisation médiévale: réflexions sur les cités italiennes (XIIIe-XVe...
FORMES ET ENJEUX D'UNE MÉDICALISATION MÉDIÉVALE :RÉFLEXIONS SUR LES CITÉS ITALIENNES (XIIIE-XVE SIÈCLES) Marilyn Nicoud Belin | Genèses 2011/1 - n° 82pages 7 à 30
ISSN 1155-3219
Article disponible en ligne à l'adresse:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-geneses-2011-1-page-7.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nicoud Marilyn , « Formes et enjeux d'une médicalisation médiévale : réflexions sur les cités italiennes (xiiie-xvesiècles) » , Genèses, 2011/1 n° 82, p. 7-30. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Belin.© Belin. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Formes et enjeux d’une médicalisationmédiévale : réflexions sur les cités italiennes(XIIIe-XVe siècles)*
Marilyn Nicoud PP. 7-30
DO
SS
IE
R
Il pourrait paraître étonnant, voire peu pertinent, pour parler des sociétés duMoyen Âge, d’utiliser un terme qui fut avant tout employé pour définir l’avè-nement de la médecine moderne. Ce mot a toutefois été repris avec profit par
des historiens de la médecine médiévale, tels Michael McVaugh ou Joseph Shatz-miller, dans le cadre d’études d’histoire sociale de l’art médical. De leurs travaux,se dégage une image positive de la médicalisation, éloignée pour partie de l’accep-tion plus critique qu’en donnaient nombre de sociologues et philosophes, à savoird’une extension des pouvoirs médicaux dans des domaines de plus en plus vastes,jusqu’alors non qualifiés de pathologiques, avec pour corollaire une perte deliberté pour les individus soumis à ce bio-pouvoir (Foucault 1979, 1994 ; Nye2003). Pour Joseph Shatzmiller, le terme recouvre l’offre de services médicaux etleur degré de pénétration dans les sociétés médiévales, tandis que MichaelMcVaugh privilégie plutôt les formes d’expertise médicale, ce qui introduit ladimension des savoirs spécialisés (McVaugh 1994 ; Shatzmiller 1989, 1994).
Plusieurs transformations à l’œuvre aux derniers siècles du Moyen Âge, dansles sociétés urbaines méridionales et tout particulièrement italiennes, justifient uneinterrogation sur les formes et les enjeux d’une possible médicalisation et l’ouver-ture d’un débat sur un terme controversé, en lui donnant une définition et descontours plus adaptés à la pluralité des situations médiévales. La première innova-tion consiste dans la création des universités, et en leur sein de facultés de méde-cine : la constitution d’un cursus spécifique, fondé sur un programme d’enseigne-ment, un corpus doctrinal, et sur un diplôme (licence et doctorat), marque en effetl’institutionnalisation des études médicales et un effort de professionnalisation; lalicentia docendi et practicandi qui sanctionne la fin de la formation universitaireautorise son détenteur à enseigner et à pratiquer partout l’art médical (Agrimi etCrisciani 1994b ; Crisciani 2007; Siraisi 2001). Face aux autres modes d’apprentis-sage, la figure du médecin issu de l’Université, formé à la méthode scolastique du
Genèses 82, mars 2011 7
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 7
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…8
DO
SS
IE
R
Le développement de l’enseignement de la médecinedans les universités et de sa pratique dans le mondeurbain s’est accompagné d’un essor et d’une diversifi-cation des écrits médicaux qui se partagent en deuxgroupes : le premier se destine au public des profes-seurs et des étudiants et sert à la formation de ces der-niers. Il est principalement constitué de commentairesaux œuvres des médecins antiques et de ceux issus dumonde arabo-musulman qui constituaient le fonde-ment des savoirs enseignés (Agrimi et Crisciani 1988).Le second informe la pratique et regroupe unensemble varié de textes qui prennent souvent laforme de traités (sur le pouls et l’urine en vue d’établirle diagnostic, sur le pronostic, sur les maladies enfonction de leur localisation dans le corps, sur despathologies particulières telles la lèpre ou la peste, surles opérations chirurgicales…). Au sein de cetensemble, certains genres ont donné lieu à une pro-duction particulièrement importante qui se mesure aunombre de textes recensés et aux manuscrits conser-vés et ne se destinent pas automatiquement à unpublic de spécialistes.Les régimes de santé (regimina sanitatis) fournissentdes conseils, voire des règles de vie à suivre pour l’indi-vidu en bonne santé qui désire la conserver. Composéspar des médecins, ils se constituent progressivementen une écriture assez formalisée qui énumère lesdiverses « choses non naturelles » ou paramètres del’environnement indispensables à la vie : l’air, l’alimen-tation et la boisson, le sommeil et la veille, le faitd’ingérer et d’expulser, l’exercice et le repos, les pas-sions de l’âme, ainsi que les bains et l’activité sexuelle,voire la saignée, font donc l’objet de régulation enfonction de la personne à laquelle ils s’adressent. Cestraités à vocation pratique se destinent prioritairementaux élites, laïques et ecclésiastiques qui sont du restesouvent à l’origine de leur composition ; par le biais detraductions ou de rédaction dans des langues vulgaires,ces régimes ont progressivement fait l’objet d’une dif-fusion plus ample, auprès d’un plus large public (GilSotres 1995 ; Nicoud 2007).Les conseils (consilia) constituent des sortes de pres-criptions (Agrimi et Crisciani 1994a). Rédigés par unmédecin de renom, ils s’adressent le plus souvent àun confrère, mais aussi à des patients, en réponse àune demande de consultation à distance à proposd’un cas précis qui pose des difficultés. Ils se compo-
sent de trois parties : 1- l’examen du cas à traiter, danslequel figurent, de manière plus ou moins détaillée, lenom, l’âge du patient, voire d’autres informations per-sonnelles, ainsi que les principaux signes de sa patho-logie qui autorisent l’établissement du diagnostic ; 2- lapartie diététique qui fournit les règles d’hygiène àsuivre en fonction des choses non naturelles ; 3- lespréparations des médecines à prescrire au patient envue de sa guérison. Les premiers conseils remontentaux dernières décennies du XIIIe siècle et ils sontl’œuvre du célèbre médecin Taddeo Alderotti (Siraisi1981). Par la suite, un grand nombre de praticiens derenom, surtout dans le domaine italien, en rédigèrentà leur tour, qui furent souvent conservés, copiés dansdes collections de consilia, regroupant dans un mêmemanuscrit soit les prescriptions d’un même auteur, soitdifférentes prescriptions traitant d’une semblablemaladie.Il n’existe pas à proprement parler de littérature déon-tologique pour la période médiévale. Toutefois, sou-vent les auteurs n’hésitent pas à délivrer des conseils àleurs jeunes confrères, qui visent à orienter leur pra-tique. Ces suggestions, souvent assez contraignantescar généralement partagées par la communauté pro-fessionnelle, traitent des relations avec le patient, avecl’entourage, avec les confrères et touchent plus géné-ralement le comportement à adopter lors de la visite,l’établissement du diagnostic, du pronostic et durant letraitement (Crisciani 2004).
«Médecin, […], cherches à obtenir de qui est venu techercher des informations sur le temps passé depuisque celui auprès de qui tu as été appelé a commencé àse sentir mal et sur la manière dont la maladie s’estemparée de lui. En fait, ces informations sont néces-saires afin que, lorsque tu seras introduit au chevet dupatient, tu ne paraisses pas totalement ignorant de samaladie; au contraire, si après avoir examiné l’urine et lepouls — même si tu n’as pas reconnu la pathologie àpartir de ces premières inspections — tu énonces lessymptômes que tu te seras fait dire précédemment, lepatient aura confiance en toi, comme si tu étais l’artificierde sa santé; et ceci est l’effet qui doit être recherché.»
(Archimatteus, De instructione medici, dans Collectio salernitana,
vol. 2, Naples, Tipografia del Filiatre-Sebezio, 1853, p. 74)
Quelques sources pour l’étude de la pratique médicale médiévale
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 8
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
Rcommentaire des textes d’autorités, constitue donc bien, à partir du XIIIe siècle, unerévolution, d’autant qu’il cherche souvent à jeter le discrédit sur ses autresconfrères, les qualifiant au mieux d’empirici, au pire de charlatans et revendique lemonopole d’un certain nombre de compétences de lui seul détenues1. En transfor-mant radicalement les conditions d’accès aux connaissances, et en imposant leurcertification par le biais d’un diplôme officiel, la médecine universitaire instauredonc une professionnalisation du métier, favorise l’expansion de son domained’intervention et vise à renforcer la confiance envers ceux qu’elle a formés (Becchiet Ferrari 2010). L’effort de régulation de l’art médical passe aussi par la constitu-tion d’associations de métier (pour les médecins, les chirurgiens, les apothi-caires…) dans quantité de cités de la péninsule ; dotées de statuts validés par lesautorités de la ville, elles formalisent les normes d’accès au métier et définissent lesrègles de son exercice. Elles opèrent la transformation de compétences en servicesqui justifient une juste rétribution du praticien (García Ballester 1993). Le modèled’excellence qui ressort de ces statuts est bien souvent le praticien diplômé.
Dès le XIIIe siècle aussi, il n’est pas rare de voir des médecins intervenir dans desprocès, à la demande de plaignants ou des autorités judiciaires, pour délivrer un avisautorisé ; de même certains sont embauchés au service des cités, salariés par ellespour garantir un minimum de soins aux plus défavorisés ou aux armées (Nutton1988); d’autres encore sont consultés pour délivrer des conseils à valeur individuelleou de portée générale, qui visent à conserver la santé, à prévenir ou soigner lesmaladies. En résulte l’émergence de nouveaux genres d’écritures, tels les régimes desanté ou les conseils (consilia) dont les premiers exemples furent rédigés dans lapéninsule au XIIIe siècle (Agrimi et Crisciani 1994a ; Gil Sotres 1995 ; Nicoud2007). Enfin, les archives notariées attestent l’existence de rapports contractualisés,dès le XIIIe siècle, entre médecins et patients, définissant pour chacun sa part de res-ponsabilité (Pomata 1994; Sandrini 2009). Au total, cet ensemble d’innovations oude réinventions médiévales de réalités antiques forme les premiers éléments d’unemédicalisation, certes non aboutie, et nous pousse à nous interroger sur cequ’étaient au Moyen Âge la demande médicale et le marché de la santé.
Ce dernier terme est employé de préférence à celui, plus classique, de marchéthérapeutique2 dans la mesure où l’attente en matière de soins, telle qu’on la voitexprimée, ne se résume pas au traitement des maladies, mais rend compte aussi dusouci de prévenir des pathologies et de conserver la santé individuelle. Comme auxépoques successives, ce marché prend nécessairement en compte la variété des pro-fils de praticiens en exercice, sans se limiter aux seules corporations professionnelles(Brockliss et Jones 1997 ; Rieder 2005, 2006) : car si la médecine universitairecherche à s’imposer comme la seule autorisée, elle ne représente pas l’ensemble desacteurs : aux côtés de ceux qui, formés à la faculté, pratiquent légalement la méde-cine, le marché est aussi constitué par ceux qui ont appris sur le terrain et exercentparfois illégalement, de manière intermittente, à côté d’une autre profession oud’autres activités. J’ajouterais, pour le Moyen Âge, les interventions, aux côtés des
Genèses 82, mars 2011 9
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 9
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…10
DO
SS
IE
R classiques médecins, chirurgiens, barbiers, apothicaires et autres «matrones» quiservaient de sages-femmes, de praticiens juifs dans le Sud du royaume de France,dans les péninsules ibérique et italienne, et de musulmans en Espagne (Friedenwald1944; García Ballester 1976a, 1976b, 1993; McVaugh 1994: 49-64; Shatzmiller1969). Devant ce large éventail de situations, et face aux sources certes diversifiéesmais lacunaires à notre disposition, se pose d’évidence la question des limites decette médicalisation; si la présence du médecin notamment universitaire est deve-nue familière pour les élites, qu’elles soient laïques ou ecclésiastiques, elle l’étaitassurément moins pour d’autres milieux, sans pour autant être totalement absentecomme en témoigne aussi bien la littérature savante que la documentation relative àla pratique (Naso 1981; Paravicini Bagliani 1991, 1994; Park 1985).
Dans cette tentative pour en délimiter les aspects et les contours, il faut garderà l’esprit que cette médicalisation ne saurait se résumer à un duo médecins-autori-tés publiques au sein d’une seule relation savoir-pouvoir qui confinerait les patientsà un rôle simplement passif. C’est bien dans un «ménage à trois», associant cesautorités, le corps médical et tous ceux qui sont susceptibles d’avoir affaire à eux,qu’il faut entendre le terme, en restituant à chacun des acteurs la part qu’il luirevient : aux praticiens, une volonté de reconnaissance intellectuelle et sociale et lamaîtrise de savoirs particuliers ; aux pouvoirs publics, une capacité d’intervention etde régulation de certains domaines grâce aux savoirs des médecins3 ; aux individusenfin, une possibilité de choix et de recours à ces professionnels, plutôt qu’àd’autres formes de soins, comme l’intercession4 ou les pratiques magiques (Gentil-core 1998; Weill-Parot 2002). Surtout, la médicalisation doit aussi être comprise àune double échelle : au niveau individuel mais aussi collectif, comme on le voit sur-tout, pour le Moyen Âge, à propos de la peste, mais aussi de la lèpre.
Dans cette tentative de redéfinition d’un concept, qui peut ainsi s’entendreen termes d’extension du domaine de compétences des médecins, de diffusion deleurs savoirs hors des sphères savantes, d’intervention en tant qu’experts (mediciperiti ou experti) dans un certain nombre d’instances publiques de décision, maisaussi d’accès élargi des populations à leurs soins, je m’efforcerai ici, en privilé-giant un domaine italien plus connu et surtout mieux documenté, d’examinerl’état du marché de la santé et les types de régulation qui s’y exerçaient ; lesformes de l’expertise qu’on y trouve attestées ; avant d’étudier certains desdomaines spécifiques auxquels s’est intéressé le discours médical.
Des médecins diplômés aux empiriques : la diversité du marché de la santé
Le monde des praticiens exerçant aux derniers siècles du Moyen Âge appa-raît foisonnant et diversifié, constitué d’individus aux multiples statuts. Lesétudes locales et régionales disponibles révèlent une moyenne d’un praticien
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 10
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
R
Genèses 82, mars 2011 11
pour quatre cent cinquante à cinq cents habitants, et ceci aussi bien pour degrandes que pour de petites cités de l’Occident5. Et si la part de ceux formés àl’Université et détenteurs d’un diplôme est minoritaire, elle n’en est pas pourautant inexistante. Ils partagent avec d’autres un marché de la santé qui tend às’étoffer, puisque là encore les travaux montrent un recours de plus en plus fré-quent aux hommes de l’art plutôt qu’à d’autres formes de soins, tels l’intercessiondes saints et l’intervention des prêtres qui deviennent des secours ultimes. Lestextes médicaux, à commencer par les conseils (consilia) adressés à un confrère ouà un patient, de même que les sources de la pratique (contrats notariés, législa-tions urbaines, actes de justice…) témoignent de ce recours aux médecins etd’une attention croissante portée aux soins du corps, non seulement lorsqu’on estmalade, mais aussi en vue de conserver sa santé (Agrimi et Crisciani 1994a ;Nicoud 2007 : 529-681). La concurrence ecclésiastique diminue également, nonseulement en vertu des interdictions conciliaires, mais aussi parce que ce marchéoffrant des attraits économiques, la profession médicale tend à se laïciser(Amundsen 1978).
Si, dans l’ensemble, les praticiens se partagent entre, d’un côté, les spécia-listes des opérations manuelles (chirurgiens et, à un moindre degré, barbiers)et, de l’autre, ceux des organes internes (les medici qui, en raison de leur savoirfondé sur la philosophie naturelle, se font appeler plutôt phisici), ce marchédemeure concurrentiel et diversifié ; certes l’accès aux praticiens les plus répu-tés demeure le privilège d’une élite, mais la demande de soins médicaux, voired’assistance préventive émanant de groupes sociaux plus modestes n’est pas unphénomène rare (Shatzmiller 1989 : 123-124 ; McVaugh 2004, 1994 : 175-176)6.
Toutefois, notamment dans les villes qui abritent une université ou qui ensont proches, tend à se dégager progressivement un modèle de praticien savantqui se voudrait dominant, et qui surtout se revendique comme l’unique déten-teur de connaissances susceptibles d’expliquer, rationnellement, les phénomènesobservés aussi bien sur le corps humain que dans la nature en général, là oùd’autres opèrent sans comprendre, sur la seule base d’un savoir-faire fondé sur larépétition de mêmes gestes. Il s’affirme maître d’un ensemble cohérent deconnaissances, transmissible par l’enseignement. C’est dans cette dichotomieentre deux mondes et deux conceptions du savoir que se perçoit comme un écholointain des querelles opposant les cliniciens aux médecins traditionnels. C’estce modèle universitaire qui cherche l’appui des autorités publiques pour tenterde réguler ce marché, et c’est dans ce groupe, préférentiellement mais pas uni-quement, que les gouvernants recrutent ceux qu’ils emploient7. Du reste, lesautorités ont bien souvent aussi fortement soutenu les studia, lorsqu’elles nesont pas à l’origine de leur création8, universités qui représentaient, non seule-ment dans le domaine médical mais aussi juridique, un idéal de formation(Siraisi 1990).
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 11
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…12
DO
SS
IE
R Cependant, notons d’emblée que ce schéma vaut prioritairement dans lespays méditerranéens, et bien sûr dans les villes9, tandis qu’il peine, ailleurs, às’imposer. En effet, aussi bien dans l’Italie communale que dans les royaumesibériques chrétiens, le verus medicus, celui qui ne risque pas de mettre en dangerla vie de ceux qu’il soigne10, paraît bien être, aux yeux des autorités, celui capablede comprendre et d’expliquer ce qu’il observe, et la garantie en est, le plus sou-vent, le cursus d’études suivi à la faculté. Aussi bien du côté de la législationespagnole11, provençale12, qu’italienne, à partir du XIIIe siècle13, voire un siècleplus tôt dans le royaume normand de Sicile14, les pouvoirs publics s’efforcent deréserver la pratique à ceux qui ont suivi au moins quatre années d’études dans unstudium generale, préférant le diplôme, ou au moins la formation universitaire, àla seule bonne réputation (Pastore 1995). Ils imposent la plupart du temps unexamen au candidat, de plus en plus fréquemment confié à des médecins recon-nus15, voire aux organisations professionnelles (les artes) qui se constituent (Park1992 : 77-82 ; Pasi 1990). Certes, le mouvement n’est pas uniforme et l’on voitainsi la commune de Pérouse, en 1279 – au moment où la ville ne dispose pasencore d’université – se contenter de recruter pour ses propres besoins deux «bons médecins, l’un physicien et l’autre chirurgien» (Caprioli 1996 : 98)16.
Qu’elles deviennent comme à Florence, à partir de 1349, les seules instancesdélivrant les autorisations à pratiquer l’art (Ciasca 1927, 1922 : 184)17 ou qu’ilfaille y être inscrit pour exercer18, les associations de métier tendent elles aussi àse fermer à tous ceux qui n’auraient pas de diplôme19 afin, comme l’énoncentclairement les statuts du collège des médecins de Milan, datés de 1385, de pré-server aussi bien les populations que les hommes de l’art des fraudes dont sontcoupables les empiriques et les ignorants. Santé publique et intérêt corporatistese rejoignent donc dans un idéal de fermeture du métier à tout individu jugéincompétent, voire dangereux ; dans ce mouvement non linéaire, où la pratiquetendrait à devenir interdite aux empiriques, comme à Florence dès 1314, Véroneen 1327, Trévise en 1426, Parme en 1440 ou Bergame en 144620, la médicalisa-tion apparaît donc comme le souci de garantir une qualité minimale à l’assistancemédicale face aux mauvaises pratiques qui n’en continuent toutefois pas moins às’exercer (Gentilcore 1998, 2006 ; Nicoud 2009).
Ce n’est donc pas tant le résultat d’une volonté de régulation du métier qu’ilconvient ici de retenir que les tentatives pour la mener. Malgré les efforts desgroupes professionnels et des autorités publiques, l’offre médicale, en effet, restaplurielle, et les moments de crise comme la peste et ses recrudescences favorisè-rent ainsi la multiplication d’opérateurs susceptibles de promettre des guérisonslà où les médecins identifiaient une maladie mortelle ( Jacquart 2004). Il n’enreste pas moins que la communauté des praticiens apparaît scindée, au moinslorsqu’existent des associations professionnelles qui s’efforcent, pour renforcerleur cohésion, d’exclure les non-diplômés. Ce faisant, elles expriment uneconscience collective et une identité propre.
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 12
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
RLe medicus expertus ou les prémisses de l’expertise médicale
Les diverses législations conservées témoignent de l’intérêt porté par les auto-rités publiques, qu’elles soient royales ou communales, aux questions de santépublique, parce que le souci de conservation de la santé (conservatio sanitatis)n’était pas sans effet sur la préservation de la ville (conservatio civitatis) dont ellesétaient les garantes. Que la santé devienne un sujet récurrent de certaines déci-sions urbaines, on en trouve donc des échos dès le Moyen Âge, et ce avant mêmela grande crise épidémiologique que représenta le surgissement de la peste en1347-1348. Cette préoccupation prit diverses formes, à commencer par une pre-mière garantie de soins délivrés par un employé des villes, le médecin communalau service des populations (Nutton 1988). Mais elle passa aussi par la transforma-tion de l’hôpital, de lieu charitable en lieu de soins, avec le recrutement de prati-ciens régulièrement appointés (Henderson 2006), et par les efforts, dont on aparlé, de régulation de la pratique médicale, avec la possibilité de dénoncer enjustice les mauvaises pratiques (Pomata 1994). Surtout, elle s’est accompagnée dela reconnaissance de capacités particulières dévolues au médecin et de fonctionsqui lui furent confiées par lesquelles il se présentait comme un expertus21.
Deux domaines en particulier, la justice et les cas de maladies réputées conta-gieuses, devinrent des lieux de mobilisation de l’avis médical, parce que les doutes,voire les conflits qu’ils suscitaient, justifiaient le recours à un arbitrage. Là encore,les exemples empruntés au monde méditerranéen sont les plus précoces (Pastore1998 ; Volk et Warlo 1973)22. Plusieurs études ont ainsi montré, à partir de laseconde moitié du XIIIe siècle, l’intervention de médecins dans des pratiques judi-ciaires, dans des cas variés (homicides, blessures, empoisonnements, décès inopi-nés, stérilités, infanticides…) (Dall’Osso 1956 ; Münster 1943, 1955 ; Ortalli1969)23. À Venise, c’est l’ensemble du corps médical de la cité, celui inscrit à l’Art,qui s’est vu obligé de dénoncer auprès d’une magistrature mineure, les Cinq de lapaix, tous ceux qu’il soignait et auprès des Seigneurs de la nuit, la justice crimi-nelle, ceux qui étaient en danger de mort (Cecchetti 1883; Ruggiero 1978, 1981;Stefanutti 1961). Il pouvait ainsi se retrouver à l’origine de la procédure. ÀBologne, dès les statuts de 1252, des consultations médicales décidées par lepodestat furent envisagées, dont les modalités d’accomplissement furent progressi-vement définies dans les normes ultérieures ; en 1288, une liste des médecins ins-tallés depuis au moins dix ans dans les différents quartiers de la ville était établie,au sein de laquelle étaient tirés au sort les experts24. Les statuts de 1376 introdui-sent une innovation majeure : le recrutement des experts auprès du tribunal, fondéjusqu’alors sur des paramètres économiques à partir de l’estime des biens, est rem-placé par un pré-requis de trois années d’études et de deux ans de pratique.
L’intervention des médecins en justice se partageait selon les deux régimesalors en vigueur : en vertu de la procédure accusatoire lorsqu’ils agissaient à lademande de l’une des parties, souvent la victime, pour définir la gravité du
Genèses 82, mars 2011 13
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 13
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…14
DO
SS
IE
R
crime ; ou selon la nouvelle procédure inquisitoire, décidée ex officio par la courde justice, sans nécessaire accusation préalable (Fraher 1992 ; Vallerani 2005)25.Ces témoignages d’une expertise médicale dans les cours de justice donnèrentlieu à des formes documentaires différentes. À Bologne, nombre de comptesrendus des visites auprès des blessés ou des défunts sont conservés dans les docu-ments isolés qui accompagnaient l’enregistrement du procès (carte di corredo) :rédigés sur des feuilles séparées par le notaire de la cour du podestat, ce qui leurdonne une valeur légale, ils sont parfois signés par les médecins-experts (RubinBlanshei 1981)26 (voir document 1) ; ailleurs, l’avis des praticiens – car ils sont laplupart du temps au moins deux à enquêter – est rapporté dans les actes mêmesdu procès, au même titre que la déposition des témoins, et signé27. L’interven-tion des praticiens permettait, comme le rappellent les formules employées,l’établissement de la vérité des faits (les experts jurent de dicere veritatem) confor-mément à ce que se proposait de mener l’enquête inquisitoire. La consultationmédicale visait prioritairement à définir la gravité des blessures et le coup fatal
«Maître Bartolomeo da Varignana et maître Bertola-cio Saracenus, sur ordre et volonté du seigneurPierre, juge aux crimes, sont tous deux allés voir Giliaet les signes et accidents qu’ils ont trouvés sur elleont été scrupuleusement examinés. De même, lesdeux médecins ont envoyé deux sages-femmessavantes pour toucher ladite Gilia comme les philo-sophes de la médecine le recommandent, d’où [ilressort], une fois examinés les signes et les accidents
que nous avons vus et entendus chez la patiente etqui nous ont été aussi rapportés par lesdites sages-femmes, que nous la pensons rationnellementenceinte».
Alessandro Simili, «Un referto medico legale inedito e autografo
di Bartolomeo da Varignana», Il Policlinico, sezione pratica, vol. 58, n° 5,
1951, pp. 150-155; nous traduisons.
Document 1. Expertise médicale. Archivio di Stato di Bologna, Curia del Podestà, Carte di Corredo, 1bis, s.d.
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 14
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
Rdans un système de compensation où la condamnation doit être proportionnelleà la faute et où il peut y avoir autant d’accusés qu’il y a de blessures mortellesidentifiées. Il servait donc à l’établissement des faits et n’était pas sans influencerla qualification du crime (Vallerani 2001). En cas de doute sur la survie de la vic-time, le médecin proposait un pronostic. Dans ce système, le conseil permettaitde limiter les formes de la violence et de la vengeance privée, mais il jouait aussiun rôle dans la prise de décision, puisqu’il était censé empêcher de possiblesdécisions arbitraires et subjectives du juge grâce à des preuves rationnelles et à unrégime probabiliste dont la qualité était toutefois laissée à la libre évaluation dela justice (Crawford 1993, 1994 ; Théry 2003).
Dans les sources italiennes, il n’est pas rare de voir de grands noms de lamédecine scolastique au service de la justice, tels les célèbres Ugo Borgognoni daLucca (1180-1258) ou Bartolomeo da Varignana (décédé après 1321)28. C’est entout cas au nom de leur savoir, parce qu’ils étaient à la fois periti, experti, maisaussi dignes de foi (fide digni), qu’ils étaient recrutés par la cour et c’est ce quifondait la validité de leur avis. Aussi, à certaines occasions, citaient-ils volontiersles autorités savantes grâce auxquelles ils avaient pu établir leur diagnostic et leurpronostic, et ne manquaient-ils pas de dire qu’ils avaient agi selon leur art.
Qu’ils déposent devant la justice ou rendent compte devant notaire de leursobservations, les experts médecins parlent souvent de manière unanime etconcordante (unanimiter et concordaliter) ; si le consensus accroît à l’évidence lavaleur probatoire du conseil (Leveleux-Teixeira 2007)29, il est aussi conforme auxrègles mêmes de la visite médicale, telle que les traités de déontologie médiévauxont eu tendance à la définir. De la visite auprès du patient, doit en effet découler,après une consultation collective (collatio), une vision unanime qui renforce lareprésentation de cohésion du groupe (Crisciani 2004). Aussi, les médecinss’exprimaient-ils soit ensemble, soit déposaient-ils séparément pour dire lamême chose, selon les formules identiques patiemment retranscrites par lesnotaires. Ils racontaient ce qu’ils avaient fait (visite de la victime, palpation, opé-ration éventuelle), ce qu’ils avaient découvert par l’expérience (probare), puis seprononçaient (pronunciare). Leur rapport se fondait sur une auscultation (devisu), éventuellement aussi sur un examen des urines.
À ces procédures, on ajoutera d’autres formes d’interventions médicales quirelèvent plus de la certification et qui ne valent pas seulement en justice. Si exis-tent des témoignages médicaux qui servirent à justifier l’absence d’un accusé àson procès (excusatio), empêchant ainsi l’accusation de contumace30, on trouveaussi dans le cadre du travail des certificats médicaux, ou simplement des men-tions de visites médicales attestant l’incapacité momentanée de l’employé ou duserviteur pour raison de santé.
Épidémies et maladies considérées comme contagieuses, susceptibles doncde mettre en danger l’ensemble de la population, sont un autre lieu a priori privi-
Genèses 82, mars 2011 15
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 15
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…16
DO
SS
IE
R légié pour l’exercice d’une expertise médicale, en vertu des connaissances recon-nues aux hommes de l’art. Dans le cas du diagnostic de la lèpre, une pathologielongtemps interprétée comme la maladie par excellence symptomatique d’unecorruption morale, la médicalisation a aussi progressé (Demaitre 2007) ; pouvantfacilement être confondue avec d’autres dermatoses selon son degré d’avance-ment, la lèpre donna lieu à des interventions programmées de praticiens dontl’avis, parfois contesté d’ailleurs, paraît avoir joué un rôle décisif dans la prise dedécision ; c’est par exemple le cas dans la péninsule italienne à Chianciano, dès1287, et plus tard à Marsciano, en 1531, où les statuts de ces communes ruralesimpliquaient non seulement la visite du suspect par un ou deux praticiens en casde doute, mais aussi sa séparation du reste de la communauté s’il était reconnumalade (ou, au contraire, son autorisation à rester, s’il était déclaré sain) (Ascheri1987 : 153 ; Scentoni 1992 : 150-151)31.
La peste, quant à elle, et plus largement toutes les formes de pestilences ontsouvent fourni l’occasion aux historiens, non seulement de déclarer l’inanité dessoins médicaux, mais plus encore d’invalider le recours à cette profession de lapart des autorités publiques. Ces dernières sont alors présentées comme lesseules susceptibles de fournir une réponse rationnelle à l’épidémie, à travers lareconnaissance de la contagiosité de la maladie et l’émergence d’offices de santédans un certain nombre de cités italiennes (Cipolla 1973, 1985 ; Palmer 1979).Pourtant, la recherche par les communes de médecins en temps de peste, et dès1293, l’obligation faite au célèbre Taddeo Alderotti (décédé en 1295), professeurà Bologne et sous contrat avec Venise, de fournir des conseils en cas d’épidémie(des avis que les gouvernants s’engageaient à rendre publics [Monticalo 1896 :283 ; Siraisi 1981]), expriment plutôt la confiance dans le corps médical ; ce n’estdu reste pas du côté des soins qu’ils étaient censés intervenir, la maladie étantreconnue comme mortelle, que du côté de la prévention, à travers une produc-tion écrite qui prit le titre générique de regimina contra pestem. Plusieurs travauxportant sur le Moyen Âge comme sur l’époque moderne ont étudié les enquêtesmenées par les médecins sur les causes et les spécificités de la maladie, à traversun ensemble de traités dont la circulation ne s’est pas limitée à la sphère profes-sionnelle (Arrizabalaga 1994 ; Coste 2007 ; Henderson 1989) : cette littérature aucaractère de moins en moins spéculatif et de plus en plus normatif et préventif areprésenté l’une des réponses les plus immédiates du monde médical au surgisse-ment de l’épidémie.
Quoique de Boccace à Pétrarque, nombre d’auteurs médiévaux aient critiquéles médecins pour l’inanité de leurs soins, leur appât du gain quand ce n’était pasleur couardise, ces derniers n’en furent pas moins très recherchés par les com-munes qui leur offraient souvent des contrats, bien plus intéressants que ceux envigueur dans les décennies précédant la peste, en vertu de leur capacité à recon-naître les signes apparents de la maladie sur les corps des malades. De ce point de
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 16
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
Rvue, la documentation issue de l’Office de santé de Milan, d’abord charge singu-lière instituée par le duc, Gian Galeazzo Visconti en 1399, avant de devenir collé-giale, permanente et constituée, aux côtés d’un personnel administratif, d’unmédecin et d’un chirurgien, offre le témoignage exceptionnel de la participationdes médecins aux tentatives pour circonscrire l’épidémie (Pasi Testa 1976). Certesla situation ne saurait être généralisée à l’ensemble de la péninsule, mais elle sug-
Genèses 82, mars 2011 17
Document 2.Nécrologe. Archivio di Stato di Milano, Popolazione 74, 5 janvier 1476
Vendredi 5 janvier
Porte Ticinese, paroisse de Sainte-Marie au cercle
Arasmo Parpaglioni, âgé de 80 ans, de paralysie. Jugement de maître Sillano Nigri
est décédé
Porte Neuve, paroisse de Saint-Bar-thélemy (intra muros)
Catherine, fille de Beltramo d’Assi, âgée de 5 ans, de fièvre éthique. Jugement de Catellano
est décédée
Porte Comasina, paroisse de Sainte-Marie secrète
Marguerite, fille de Bernard de Maino, âgée de deux mois est décédée
Porte Neuve, paroisse de Saint-Protais-aux-moines
Taddeo de Ponte, âgé de 50 ans, d’une fièvre avec unedouleur de côté. Jugement de Catellano
est décédé
Porte Romaine, paroisse de Saint-Calimer
Melo Ortigari, âgé de 90 ans, d’asthme et de catarrhe. Jugement de Catellano
est décédé
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 17
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…18
DO
SS
IE
R gère bien ici une médicalisation de la peste. Elle montre en effet une interventiondes médecins à différents niveaux : au plus près du prince, lorsque les praticiens decour étaient convoqués pour aider, avec les médecins de la ville, à définir lesmesures à prendre ; à l’échelle communale, par le biais des visites opérées par despraticiens de la ville et par le recrutement par l’Office de santé d’un medicus etd’un ciroicus epidemie. La participation de professionnels non seulement sur le ter-rain, mais aussi au sein même des instances décisionnelles me paraît importante,mais singulière. Si, en dernier lieu, ces praticiens ne décidaient pas de l’enferme-ment ou de l’isolement des contaminés, c’est tout de même en grande partie sur labase de leur diagnostic que la décision était prise. L’expertise dont rend compteles listes des morts conservées dans les archives de Milan à partir du milieu duXVe siècle, portant le jugement du médecin ayant effectué la consultation,témoigne d’une transmission de responsabilités : quelques décennies plus tôt,c’était l’administration locale (les Anciens des paroisses) qui était chargée d’iden-tifier les cas suspects ; désormais les compétences devenaient strictement médi-cales, qui plus est aux mains des praticiens membres de l’Art (Nicoud 2005).
Dans un domaine où l’exclusion était synonyme de mort sociale, l’extensiondu champ de compétences reconnues au médecin s’est bien sûr heurtée à desformes de résistances individuelles et isolées, dont rend parfois compte la docu-mentation conservée. La remise en cause de leurs compétences, de leurs capaci-tés à porter un jugement sûr quant à la maladie (lorsque le faisceau de symp-tômes convoqué est susceptible de signifier d’autres pathologies), parfois relayéepar les autorités publiques, n’a pour autant jamais débouché, à ma connaissanceet pour la période considérée, sur un démenti et une critique de leurs positions.Au contraire, la confiance dans leur intervention paraît renouvelée et sa nécessitéfut constamment réitérée face aux critiques. La conservation exceptionnelle denécrologes, registres tenus par l’Office de santé où sont rapportées les listes quo-tidiennes des décès survenus dans la ville et qui portent la trace de ces expertisesmédicales, en fournit un témoignage d’autant plus frappant qu’à partir desannées 1470, l’expertise médicale ne se limite plus au diagnostic de la peste maiss’étend à l’ensemble des pathologies reconnues responsables du décès des indivi-dus (voir document 2, p. 17).
De la maladie à la santé : les domaines de l’intervention médicale
Le dernier volet de ces formes de médicalisation que je désirerais examinerrenvoie à une conception assez classique du terme, celle d’une extension dessavoirs, et donc des pouvoirs médicaux sur les individus. En enquêtant ici plusparticulièrement sur deux objets spécifiques, d’un côté les régimes de santé, del’autre le thermalisme, je souhaite montrer que s’ils sont pour partie le fruit deconnaissances nouvelles et d’un intérêt spéculatif, ils résultent également d’une
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 18
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
Rdemande sociale, qu’il s’agisse de patients réclamant des conseils préventifs ou decommunes à la recherche d’un avis médical sur les eaux minérales de leur terri-toire. Enfin, ils expriment aussi la force d’une médecine scolastique, une méde-cine savante, plus à même que les autres formes de pratique d’imposer ses vues àtravers une vaste gamme de productions écrites dont la diffusion ne se limitaitpas aux sphères professionnelles.
La capacité de la médecine à intervenir dans le domaine préventif et plusencore conservatoire n’est pas une invention médiévale. Elle apparaît dansnombres d’ouvrages de la tradition hippocratique et galénique (Vegetti et Manuli1989). Cette dimension, sur laquelle on insiste à nouveau aujourd’hui, a donnénaissance, dès l’Antiquité, à une branche du savoir médical, dans ses dimensionsintellectuelles et pratiques : la diététique. Entendue au sens d’hygiène de vie et deconnaissances des facteurs externes au corps humain influençant son niveau desanté et susceptibles de causer des maladies, la diététique a été reconnue, dans lecadre de l’enseignement médical à l’Université, comme l’une des parties de l’artmédical, au même titre que la pharmacopée et la chirurgie. Elle agit principale-ment à l’échelle de l’individu ; les éléments qui la composent (les « choses nonnaturelles» – air, alimentation et boisson, sommeil et veille, exercice et repos, ina-nition et réplétion, passions de l’âme) sont à la fois indispensables à la vie et fac-teurs de déséquilibres des complexions et donc de maladies, s’ils ne sont pas régléspar un régime de vie adapté à l’individu. Cette idée, affirmée avec force par lesmédecins, implique un nécessaire contrôle sur tous les aspects du quotidien d’unepersonne, de sa naissance à sa mort, puisque sa santé, conçue comme un mélangeéquilibré des qualités premières dans le corps, subit des changements dus à des fac-teurs naturels (le vieillissement) et accidentels (les paramètres environnementaux).À cette médicalisation revendiquée de tous les moments de l’existence, répond untype de littérature, concentré des savoirs du médecin à l’usage d’un public de non-spécialistes : les régimes de santé (Gil Sotres 1995; Nicoud 2007). À la différenced’un savoir antique qui n’a jamais vraiment constitué un ensemble doctrinal cohé-rent (Lloyd 1987), le Moyen Âge a donné naissance, dans le domaine diététiqueen particulier, à un genre de textes dont la fonction apparaît pour ainsi dire anti-thétique : dans un sens, ils visent à médicaliser tous les moments de la vie, à asseoirla nécessité de connaissances diététiques et d’une juste régulation de l’existenceselon des principes médicaux; de l’autre, là où les conceptions antiques insistaientsur la collaboration étroite entre médecin et patient, ils chercheraient plutôtpresque à exclure le praticien du champ d’intervention puisque le but de ces textesest de divulguer à un public profane des règles de vie indispensables au maintien dela santé qui rendent théoriquement inutile l’intervention de l’homme de l’art.
Ces régimes de santé, dont il existe plus d’une centaine d’exemplaires conser-vés en latin et des rédactions en vulgaire, posent le problème de leur propre sta-tut : de quelle médicalisation témoignent-ils ? Doit-on les concevoir comme destextes normatifs qui établissent des règles de vie à suivre, imposant un ordre et
Genèses 82, mars 2011 19
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 19
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…20
DO
SS
IE
R nécessitant la pleine et entière obéissance du lecteur, comme le suggère le terme leplus couramment utilisé pour les désigner (regimen) ? Ou bien doit-on plutôt lesappréhender comme des conseils, des propositions faites par le médecin en vued’éduquer son lecteur, en mettant à sa disposition des connaissances jusqu’alorsréservées à la sphère savante ? Dans ce cas, ces régimes fourniraient plutôt lesbases d’un savoir sur lequel l’individu peut exercer sa propre délibération.
Ce domaine du régime de santé est intéressant parce qu’il montre l’empiète-ment du savoir médical sur le champ de la santé et non plus seulement de lamaladie. Or cette littérature répond tout à la fois à un intérêt des médecins pourun domaine ouvert aux changements d’habitudes et de goûts des populations et àune demande sociale puisque nombre de ces ouvrages ont été écrits sur com-mande. Au-delà des habituelles formules de recommandation, les auteurs ontsouvent rédigé leurs traités à la demande des puissants qui les employaient. Ils’agit donc pour une bonne part d’une littérature, issue des savoirs universitaires,mais souvent écrite en milieu de cour. En même temps qu’ils expriment la reven-dication des médecins à agir dans le domaine de la santé et l’intérêt des patientspour ces connaissances, ces régimes rendent compte aussi de tensions qui se fontjour dès lors que les conseils prodigués vont à l’encontre des usages, des intérêtsou des désirs du récipiendaire. Ces témoignages montrent les difficultés dumédecin à obtenir l’obéissance de son patient en matière d’hygiène, dès lors quel’individu est bien portant et que la nécessité de la règle paraît sans objet. La dié-tétique, dans son aspect conservatoire, offre donc l’image contrastée d’un nouvelespace assez fortement médicalisé, du moins dans les élites de la fin du MoyenÂge, et en même temps d’un lieu de résistance où la perception de son proprebien-être se heurte à une conception d’une santé en équilibre précaire, nécessai-rement médicalisée. Ces ouvrages furent, par le biais de copies manuscrites, detraductions en langues vulgaires et d’éditions, assez largement diffusés, souventauprès d’un public de non-spécialistes, aristocraties, bourgeoisies urbaines,membres du clergé, mais parfois aussi auprès de milieux plus modestesd’artisans ; ils représentent sans doute l’un des types d’ouvrages médicaux médié-vaux les plus répandus, comme le montrent les exemplaires manuscrits et les édi-tions des XVe et XVIe siècles.
Dans le domaine thermal, l’intervention du corps médical paraît facile àdater, si l’on se fonde notamment sur l’émergence, à partir du milieu du XIVe
siècle, d’un corpus de textes, écrits par des praticiens reconnus, et visant à définirles propriétés minérales et thérapeutiques d’un certain nombre de sites bal-néaires. Le phénomène, particulièrement évident en Italie, n’est pourtant pasgénéralisable : à l’exception de l’espace germanique où l’on note un semblablephénomène, par ailleurs influencé par la péninsule (Fürberth 1996, 2010), on nevoit pas d’équivalent ailleurs pour le Moyen Âge, même là où des sources d’eauxchaudes étaient déjà connues et utilisées, comme dans les royaumes ibériques parexemple.
5770_02_xp_p001_139 12/05/11 11:05 Page 20
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
REn revanche, l’articulation entre l’émergence de ce savoir sur les eaux et les pra-tiques balnéaires est moins claire : si dans quelques cas, on peut penser que dès leXIIe siècle, voire plus tôt, des sites, parfois déjà connus dans l’Antiquité, ont été fré-quentés, il apparaît aussi que nombre de bains antiques se sont perdus ou que lesthermes médiévaux ne sont pas toujours ceux qui étaient en vogue à l’époqueromaine (Guérin-Beauvois et Martin 2007). Les témoignages ne permettent pas desavoir non plus avec assurance si ces eaux étaient utilisées à des fins récréatives outhérapeutiques, sauf quelques rares cas comme celles de Baïa en Campanie. Cepen-dant, il me semble qu’on assiste dans les deux derniers siècles du Moyen Âge à unmouvement de médicalisation des pratiques thermales qui s’exprime de différentesmanières : d’abord, dans la capacité que revendiquent les médecins, mais que leurreconnaissent aussi les autorités publiques, de comprendre un phénomène restéjusqu’alors inexpliqué, voire considéré comme merveilleux: l’eau qui sort chaude dela source; ensuite, dans leur capacité à définir les composantes minérales de l’eau etleurs vertus thérapeutiques à travers la rédaction de traités ; enfin, dans la produc-tion de règles d’usages du séjour au bain (Nicoud 2003; Park 1999).
Au total, les formes de médicalisation du thermalisme prennent différentsaspects : le premier revêt celui d’une production intellectuelle qui vise à formerles confrères, mais aussi, à travers des ouvrages de vulgarisation, parfois traduits,à diffuser des conseils d’utilisation dans la communauté des curistes ; le secondconcerne la présence au bain de médecins, soit qu’ils accompagnent leurs clients,soit qu’ils résident dans les stations, rendant toujours moins prégnants les aspectsrécréatifs au profit d’un séjour thérapeutique ; le troisième, enfin, s’incarne dansles expertises commandées à des médecins par les autorités publiques ou dansleurs conseils en termes d’aménagements des bassins ou de construction dedouches (Boisseuil 2008).
Cette extension du domaine de compétence médical à des domaines commela conservation de la santé et le thermalisme rencontre l’intérêt des particulierssoucieux de leur bien-être ou d’autorités publiques, mues par un souci sanitaireou économique, dans le cadre de l’émergence de nouvelles cultures du corps etd’une culture balnéaire qui, pour les élites du moins, fait comme un écho auxpratiques thermales du XIXe siècle, ou aux soucis de santé, de beauté et de diètede nos sociétés contemporaines.
* **
Parler de formes de médicalisation pour les sociétés urbaines de l’Italiemédiévale ne signifie aucunement rendre compte d’un processus achevé, maisporter l’attention sur des configurations singulières qui renvoient à un rôle et uneposition caractéristique occupés par la médecine savante. La création des univer-
Genèses 82, mars 2011 21
5770_02_xp_p001_139 12/05/11 11:05 Page 21
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…22
DO
SS
IE
R sités avec un enseignement spécifique dans l’art médical, marqué par un cursuset sanctionné par un diplôme d’un côté, la constitution d’associations de métierde l’autre, sont autant de signes de formes de professionnalisation et d’un désirde qualités de soins, quand bien même l’ensemble des praticiens en exercice nese limiterait pas aux seuls détenteurs d’un titre. L’attention des individus pourleur santé, qu’ils soient malades ou bien portants, ainsi que celle des pouvoirspublics pour des questions d’ordre sanitaire – et pas seulement en période épidé-mique – voire pour l’apport des savoirs médicaux dans les procédures judiciaires,se marque par un recours privilégié à des hommes de l’art aux qualités et auxcompétences reconnues. Cette médecine officielle, en quelque sorte, qui se des-sine aux derniers siècles du Moyen Âge, cherche de son côté à s’affirmer commela seule légitime, la seule dépositaire d’un savoir rationnel, capable d’expliquer lesphénomènes aussi bien naturels que merveilleux et d’opérer de façon raisonnéeet non au gré du hasard. Cette autorité revendiquée passe aussi par la maîtrise del’écrit et s’exprime de manière préférentielle à travers des pratiques discursivesqui fondent ou réinvestissent des domaines parfois abordés par les auteursantiques ou de langue arabe, à l’image de la conservation de la santé. Elle sou-ligne, comme un écho lointain des conceptions foucaldiennes, la nécessité pourle médecin d’exercer son pouvoir sur tous les instants de la vie d’un individu, dela naissance à la mort. Mais cette médicalisation qui en découle revêt des atoursplus positifs, qui se déclinent en termes d’offres de soins qualifiés, de tentativesd’exclusions des mauvaises pratiques, de protection de la santé individuelle etcollective au nom de l’utilité publique de la profession médicale et du bien com-mun, chers aux légistes médiévaux.
AGRIMI, Jole et Chiara CRISCIANI. 1988.Edocere medicos. Medicina scolastica nei secoli XIII-XV. Naples, Guerrini(Hippocratica civitas).— 1994a. Les « consilia » médicaux. Turnhout,Brepols (Typologie des sources du Moyen Âge occidental).— 1994b. « Curricula e contenutidell’insegnamento : la medicina dalle originial sec. XV», in Gian Paolo Brizzi (éd.), Storiadelle Università in Italia, vol. 2. Milan, Pizzi : 239-276.
AMUNDSEN, Darrel W. 1978. «MedievalCanon Law on Medical and Surgical Practiceby the Clergy», Bulletin of the History of Medicine, n° 52 : 39-56.— et Gary B. FERNGREN. 1977. «The Physician as Expert Witness in Athenian Law», Bulletin of the History of Medicine, vol. 51, n° 2 : 202-213.
ARRIZABALAGA, Jon. 1994. «Facing the BlackDeath : Perception and Reactions ofUniversity Medical Practitionners », in Luis
Ouvrages cités
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 22
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
R
Genèses 82, mars 2011 23
García Ballester et al. (éd.), Practical Medicinefrom Salerno to the Black Death. Cambridge,Cambridge University Press : 237-288.
ASCHERI, Mario (éd.). 1987. Chianciano1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio. Rome, Viella.
BACKOUCHE, Isabelle (éd.). 2008. Genèses, n° 70, «Devenir expert » : 2-3.
BECCHI, Egle et Monica FERRARI (éd.).2010. Formare alle professione. Diventaremedico dall’evo antico all’evo moderno. Milan,Franco Angeli (Storia dell’educazione).
BETTO, Bianca. 1981. I collegi dei notai, dei giudici, dei medici e dei nobili in Treviso,secc. XIII-XVI, storia e documenti. Venise,Deputazione di storia patria per le Venezie(Miscellanea di studi e memorie).
BOISSEUIL, Didier. 2008. «La douchethermale, une technique thérapeutiquenouvelle dans la Toscane du Quattrocento ? »,in Aline Durand (éd.), Jeux d’eau. Moulins,meuniers et machines hydrauliques, XIe-XXe siècles, Études offertes à Georges Comet.Aix-en-Provence, Publications de l’Universitéde Provence (Cahier d’histoire des techniques) : 59-72.
BROCKLISS, Laurence W. et Colin JONES.1997. The Medical World of Early ModernFrance. Oxford, Clarendon Press.
BUZZI, Corrado (éd.). 2004. Lo statuto del Comune di Viterbo del 1469. Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo(Fonti per la storia dell’Italia medievale).
CAPRIOLI, Severino (éd.). 1996. Statuto del Comune di Perugia del 1279, vol. 1 : Testo. Pérouse, Deputazione di storia patriaper l’Umbria (Fonti per la storia dell’Umbria).
CAPUTO, Vincenzo. 1962. I Collegi dottorali e l’esame di dottorato nello Studio ferrarese. Gli Statuti del Collegio ferrarese dei dottorimedici ed artisti (secolo XV-XVIII). Ferrare,Università degli studi di Ferrara.
CASINI, Bruno (éd.). 1968. Statuto del comunedi Montopoli, 1360. Florence, Olschki (Fonti sui comuni rurali toscani).
CECCHETTI, Bartolomeo. 1883. «La medicinain Venezia nel 1300», Archivio veneto, vol.25-26 : 77-111 et 251-270.
CIASCA, Raffaele (éd.). 1922. Statuti dell’artedei medici e speziali. Florence, Olschki.— 1927. L’Arte dei medici e speziali, nella storia e nel commercio fiorentino dal secoloXII al XV. Florence, Olschki (Biblioteca storicatoscana).
CIPOLLA, Carlo Maria. 1973. «Origine e sviluppo degli uffici di sanita’ in Italia »,Annales cisalpines d’histoire sociale, n° 4 : 83-101.— 1985. Contro un nemico invisibile. Epidemiee strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento.Bologne, Il Mulino (Biblioteca storica).
COSTE, Joël. 2007. Représentations et comportements en temps d’épidémie dans la littérature imprimée de peste (1490-1725). Contribution à l’histoire culturellede la peste en France à l’époque moderne. Paris, Champion (Sciences, techniques et civilisations du Moyen Âge à l’aube des Lumières).
COTTURI, Enrico. 1982. Medici e medicina a Pistoia nel medioevo. Pistoia, Società pistoiese di storia patria (Incontri pistoiesi di storia, arte, cultura).
CRAWFORD, Catherine. 1993. «Medicineand the Law», in William F. Bynum et Roy Porter (éd.), Compagnion Encyclopediaof the History of Medicine, vol. 2. Londres, Routledge (Routledge reference) :1619-1640.— 1994. «Legalizing Medicine : EarlyModern Legal Systems and the Growth of Medico-legal Knowledge», in MichaelClarck et Catherine Crawford (éd.), Legal Medicine in History. Cambridge,Cambridge University Press (CambridgeHistory of Medicine) : 89-116.
CRISCIANI, Chiara. 2004. «Éthique des consilia et de la consultation (XIIIe-XIVe siècles) », Médiévales, n° 46,Laurence Moulinier-Brogi et MarilynNicoud (éd.), « Éthique et pratiques médicales » : 23-44.— 2007. « Curricula e contenutidell’insegnamento : la medicina dalle originial sec. XV », in Gian Paolo Brizzi, Piero Del Negro et Andrea Romano (éd.),Storia delle Università in Italia, vol. 2. Messine, Sicania : 183-204.
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 23
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…24
DO
SS
IE
R DALL’OSSO, Eugenio. 1956.L’organizzazione medico-legale a Bologna e a Venezia nei secoli XII-XIV. Césène, Orfanelli Addolorata.
DE LA TORRE Y DEL CERRO, Antonio. 1971.Documentos para la historia de la Universidadde Barcelona, vol. 1 : Preliminares (1291-1451). Barcelone, Universidad, Facultad de Filosofía y Letras.
DEMAITRE, Luke. 2007. Leprosy in Premodern Medicine. A Malady of the Whole Body. Baltimore, The JohnsHopkins University Press.
ERMINI, Giuseppe. 1971. Storia dell’Università di Perugia. Florence,Olshki (Storia delle università italiane), 2 vol.
FASOLI, Gina et Pietro SELLA (éd.). 1937.Statuti di Bologna dell’anno 1288. Cité du Vatican, Biblioteca ApostolicaVaticana (Studi e testi).
FOUCAULT, Michel. 1979 [1976]. «La politique de santé au XVIIIe siècle », in Michel Foucault et al. (éd.), Les machines à guérir : aux origines de l’hôpital moderne.Bruxelles ; Liège, P. Mardaga (Architecture +archives), (1re éd., in Généalogie des équipements de normalisation : les équipements sanitaires. Fontenay-sous-Bois,Cerfi : 1-11) : 7-18.— 1994. Dits et écrits, vol. 1 : 1954-1969.Paris, Gallimard (Bibliothèque des scienceshumaines).
FRAHER, Richard M. 1992. « IV Lateran’sRevolution in Criminal Procedure : The Birth of inquisitio, the End of Ordealsand Innocent III’s Vision of EcclesiasticalPolitics », in Rosalio J. Castillo Lara (éd.),Studia in honorem eminentissimi cardinalisAlphonsi M. Stickler. Rome, Libreria AteneoSalesiano (Studia et textus historie juriscanonici) : 97-111.
FRIEDENWALD, Harry. 1944. The Jews and Medicine : Essays. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2 vol.
FROVA, Carla. 2007a. «Università degli studidi Perugia », in Gian Paolo Brizzi, Piero del Negro et Andrea Romano (éd.),Storia delle università in Italia, vol. 3.Messine, Sicania : 133-164.
— 2007b. «Université et pouvoirs urbainsdans une ville communale : Pérouse», in Patrick Gilli, Jacques Verger et Daniel Le Blévec (éd.), Les universités et la ville au Moyen Âge. Cohabitation et tension. Leyde-Boston, Brill (Education and Society in the Middle Agesand Renaissance) : 205-215.
FÜRBERTH, Frank. 1996. «Die ältestenMineralquellenanalysen des GasteinerThermalwasser durch Sigmund Gotzkircher(um 1450), Johannes Hartlieb (1467/68) und Caspar Schober (um 1530) »,Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger, n° 136 : 7-18.— 2010. «L’essor de la balnéologie dans le monde germanique à la fin du Moyen Âge», in Didier Boisseuil et Marilyn Nicoud (éd.) Séjourner au bain. Le thermalisme entre médecine et société (XIVe-XVIe siècles). Lyon, Pul (Collectiond’histoire et d’archéologie médiévales) : 99-109.
GARCÍA BALLESTER, Luis. 1976a. «A Marginal Learned Medical World :Jewish, Muslim and Christian MedicalPractitioners, and the Use of Arabic Medical Sources in Late Medieval Spain», in L. García Ballester et al. (éd.), Practical Medicine from Salerno to the Black Death. Cambridge, Cambridge University Press : 353-394.— 1976b. Historia social de la medicina en la España de los siglos XIII al XVI, vol. 1 : La minoría musulmana y moresca.Madrid, Akal Editor.— 1993. «Medical Ethics in Transition in the Latin Medicine of Thirteenth and Fourteenth Centuries : New Perspectiveson the Physician-Patient Relationship and the Doctor’s Fee», in Andrew Wear,Johanna Geyer-Kordesch et Roger French K. (éd.), Doctors and Ethics. The Earlier Historical Setting of ProfessionalEthics. Amsterdam, Rodopi (The Wellcome Series in the History of Medicine) : 38-71.— 2004. «La profesión médica en un tiempode cambio», in L. García Ballester, Artifex factivus sanitatis. Saberes y ejercicioprofesional de la medicina en la Europa
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 24
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
R
Genèses 82, mars 2011 25
pluricultural de la Baja Edad Media, Grenade, Universidad de Grenada (Biblioteca de Bolsillo) : 53-79.— et Agustin RUBIO-VELA. 1985. «L’influence de Montpellier dans le contrôlesocial de la profession médicale dans le Royaume de Valence au XIVe siècle »,in Actes du 110e congrès national des sociétéssavantes (Montpellier, 1985), Section d’histoiredes sciences et des techniques, vol. 2 : Histoire de l’École médicale de Montpellier. Paris, CTHS : 19-30.GARCÍA BALLESTER, Luis, Michael R.MCVAUGH et Agustin RUBIO-VELA. 1989.Medical Licensing and Learning in FourteenthCentury Valencia. Philadelphie, TheAmerican Philosophial Society (Transactions of the American Philosophical Society).GAROSI, Alcide. 1938. «Perizie e periti medico legali in alcuni capitoli di legislazione statutaria medioevale », Rivista di Storia delle scienze mediche enaturali, n° 20 : 157-167.GENTILCORE, David. 1998. Healers andHealing in Early Modern Italy. Manchester ;New York, Manchester University Press(Social and Cultural Values in Early ModernEurope).— 2006. Medical Charlatanism in Early Modern Italy. Oxford, Oxford University Press.GERMAIN, Alexandre (éd.). 1890.Le Cartulaire de l’Université de Montpellier,vol. 1 : 1181-1400. Montpellier, Ricard Frères.GILLI Patrick et Julien THÉRY. 2010. Le gouvernement pontifical et l’Italie des villesau temps de la théocratie, fin XIIe-mi-XIVe s.Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée (Orientalia Monspeliensia).GIL SOTRES, Pedro. 1995 [1993]. «Les régimes de santé », in Mirko D. Grmek(éd.), Histoire de la pensée médicale en Occident,vol. 1 : Antiquité et Moyen Âge. Paris, Seuil(Science ouverte), (éd. orig., «Le regole della salute », in M. D. Grmek (éd.), Storia del pensiero medico occidentale, vol. 1 : Antichità e medioevo. Bari, Laterza : 399-438) : 257-281.
GOTTFRIED, Robert S. 1986. Doctors and Medicine in Early Renaissance England1340-1530. Princeton (NJ), Princeton University Press.
GUALAZZINI, Ugo (éd.). 1978 [1946]. Corpus statutorum almi studii parmensis, saec. XV. Milan, A. Giuffrè (Monografie sulla storia dell’ Ateneo).
GUÉRIN-BEAUVOIS, Marie et Jean-Marie MARTIN. 2007. Bains curatifset bains hygiéniques en Italie de l’Antiquité au Moyen Âge [actes du colloque tenu à Rome les 22 et 23 mars 2004]. Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome).
GUILLERÉ, Christian. 1987. «Le milieumédical géronais au XIVe siècle », in Actes du 110e Congrès national des sociétéssavantes (Montpellier, 1985), vol. 1 : Santé, médecine et assistance au MoyenÂge. Paris, CTHS, 1987 : 263-281.
HENDERSON, John. 1989. «Epidemics and Renaissance Florence : Medical Theoryand Government Response», in NeithardtBulst et Robert Delort (éd.), Maladies et société (XIIe-XVIIIe siècles). Actes du colloque de Bielefeld, novembre 1986. Paris, CNRS: 165-186.— 2006. The Renaissance Hospital. Healing the Body and Healing the Soul. New Haven ;Londres, Yale University Press.
JACQUART, Danielle. 1981. Le milieu médicalen France du XIIe au XVe siècle. Genève, Droz (Hautes Études médiévales et modernes).— 2004. «Le difficile pronostic de mort(XIVe-XVe siècles) », Médiévales, n° 46,Laurence Moulinier-Brogi et Marilyn Nicoud(éd.), «Éthique et pratiques médicales» : 11-22.
LEVELEUX-TEIXEIRA, Corinne. 2007. «La pratique du conseil devant l’Inquisition(1323-1329) », Cahiers de Fanjeaux, n° 42, «Les justices d’Église dans le Midi(XIe-XVe siècle) » : 165-198.
LLOYD, Geoffrey E. R. 1987. The Revolutions of Wisdom. Berkeley,University of California Press (SatherClassical Lectures).
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 25
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…26
DO
SS
IE
R MCVAUGH, Michael R. 1994. Medicine beforethe Plague. Practitioners and their Patients in the Crown of Aragon 1285-1345.Cambridge, Cambridge University Press.— 2004. «Le coût de la pratique et l’accès aux soins au XIVe siècle : l’exemple de la ville catalane de Manresa », Médiévales,n° 46, Laurence Moulinier-Brogi et Marilyn Nicoud (éd.), «Éthique et pratiquesmédicales » : 45-54.
MOEGLIN, Jean-Marie (éd.). 2004.L’intercession du Moyen Âge à l’époque moderne :autour d’une pratique sociale [actes de la table-ronde des 3-4 novembre 2000organisée par le Centre de recherche en histoire européenne et comparée(CREPHE)]. Genève, Droz (Hautes Études médiévales et modernes).
MONTICALO, Giovanni (éd.). 1896.I Capitolari delle arti veneziane, vol. 1 : Statuti,secoli XIII-XIV. Rome, Forzani (Fonti per la Storia d’Italia).
MÜNSTER, Ladislao. 1943. «Su i primordi e sulla procedura della medicina legale in Bologna», Atti e memorie dell’Accademia di storia dell’arte sanitaria, série II, n° 9 : 41-56.— 1954. «Alcuni episodi sconosciuti o poconoti sulla vita e sull’attività di Bartolomeo da Varignana», Castalia. Rivista di storia della medicina, n° 10 : 207-215.— 1955. «La medicina legale in Bologna dai suoi albori fino alla fine del secolo XIV »,Bollettino dell’Accademia medica pistoieseFilippo Pacini, n° 26 : 257-271.
NASO, Irma. 1979. « Il collegio dei medici di Novara negli ultimi anni del Quattrocento.Contributo allo studio dei gruppiprofessionali al termine del medioevo», Studi di storia medievale e diplomatica, n° 4 : 265-311.— 1981. Medici e strutture sanitarie nella società tardo-medievale. Il Piemonte dei secoli XIV e XV. Milan, FrancoAngeli.
NICOUD, Marilyn. 2003. «Le bain thermaldans la tradition médicale occidentale »,Médiévales, n° 43, Didier Boisseuil (éd.), «Le bain : espaces et pratiques » : 13-40.— 2005. «Les médecins et l’Office de santé :Milan face à la peste au XVe siècle »,
in Anne-Marie Flambard Héricher et Yannick Marec (éd.), Médecine et société, de l’Antiquité à nos jours. Mont-Saint-Aignan,Publications de l’université de Rouen et du Havre (Cahiers du GRHIS n°16) : 49-74.— 2007. Les régimes de santé au Moyen Âge.Naissance et diffusion d’une écriture médicale,XIIIe-XVe siècle. Rome, École française de Rome (Bibliothèque des Écoles françaisesd’Athènes et de Rome), 2 vol.— 2009. «Pratiquer la médecine dans l’Italiede la fin du Moyen Âge : enquête sur les statuts communaux et les statuts de métier », in Jacqueline Vons (éd.), Pratique et pensée médicales à la Renaissance,actes du 51e Colloque international d’étudeshumanistes (Tours, 2-6 juillet 2007). Paris, De Boccard (Medic@) : 9-23.
NUTTON, Vivian. 1988 [1981]. «Continuity or rediscovery ? The CityPhysician in Classical Antiquity andMedieval Italy », in V. Nutton, From Democedes to Harvey. Studies in the History of Medicine. Londres, VariorumReprints (Collected Studies Series), (1re éd., in Andrew W. Russel (éd.), The Town and State Physician in Europe, from the Middle Ages to the Enlightenment.Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek :11-25) : 9-46.— 1992. «Healers in the Medical MarketPlace : Towards a Social History of Graeco-Roman Medicine», in Andrew Wear (éd.), Medicine in Society.Historical Essays. Cambridge, Cambridge University Press : 15-58.
NYE, Robert A. 2003. «The Evolution of the Concept of Medicalization in the Late Twentieth Century », Journal of History of the Behavioral sciences, vol. 39, n° 2 : 115-129.
ORTALLI, Gherardo. 1969. «La periziamedica a Bologna nei secoli XII e XIV.Normativa e pratica di un istitutogiudiziario », Deputazione di storia patria per le province di Romagna. Atti e memorie,n° 17-19 : 223-259.
PALMER, Robert J. 1979. «L’azione della Repubblica di Venezia nel controllo
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 26
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
R
Genèses 82, mars 2011 27
della peste. Lo sviluppo della politicagovernativa», in Comune de Venezia-Assessorato alla cultura e belle arti, Venezia e lapeste 1348-1797. Venise, Marsilio : 103-110.
PARAVICINI BAGLIANI, Agostino. 1991.Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel Duecento. Spolète, Centro italianodi studi sull’alto medioevo (Biblioteca di medioevo latino).— 1997 [1994]. Le corps du pape. Paris, Seuil(éd. orig., Il corpo del Papa. Turin, Einaudi).
PARK, Katharine. 1985. Doctors and Medicinein Early Renaissance Florence. Princeton, Princeton University press.— 1992. «Medicine and Society in MedievalEurope, 500-1500», in Andrew Wear (éd.),Medicine in Society. Historical Essays. Cambridge,Cambridge University Press : 59-90.— 1999. «Natural particulars : MedicalEpistemology, Practice, and the Literature of Healing Springs », in Anthony Grafton et Nancy G. Siraisi (éd.), Natural particulars.Nature and the Disciplines in RenaissanceEurope. Cambridge (Mass.), MIT Press(Dibner Institute Studies in the History of Science and Technology) : 347-367.
PASI, Antonia. 1990. «Medici e chirurghitoscani alle soglie della rivoluzione scientifica»,Nuova rivista storica, n° 74: 537-578.
PASI TESTA, Antonia. 1976. «Alle originidell’Ufficio di Sanità nel ducato di Milano e principato di Pavia », Archivio storicolombardo, série III, n° 102 : 376-386.
PASTORE, Alessandro. 1995. «Le regole di un corpo professionale : gli statuti dei collegi medici (sec. XV-XVII) », Archiviostorico ticinese, vol. 32, n° 118 : 219-236.— 1998. Il medico in tribunale. La periziamedica nella procedura penale d’antico regime(secoli XVI-XVIII). Bellinzona, Casagrande(Biblioteca dell’Archivio storico ticinese).
POMATA, Gianna. 1994. La promessa di guarigione. Malati e curatori in anticoregime : Bologna XVI-XVIII secolo. Rome-Bari,Laterza (Collezione Storica).
RAZO. CAHIERS DU CENTRE D’ÉTUDES
MÉDIÉVALES DE NICE. 1984. n° 4, «Guérir au Moyen Âge : médecine et sociétéau XIVe et XIVe siècle ».
RIEDER, Philip. 2005. «Médecins et patientsà Genève : offre et consommationsthérapeutiques à l’époque moderne», Revued’histoire moderne et contemporaine, vol. 52,n° 1 : 39-63.— 2006. «The Poor and the Patient :Protestant Geneva in the Early ModernPeriod», Hygiea Internationalis : AnInterdisciplinary Journal for the History ofPublic Health, vol. 5, n° 1 : 33-50.
RUBIN BLANSHEI, Sarah. 1981. «Criminal Law and Politics in MedievalBologna», Criminal Justice History, n° 2 : 1-30.
RUGGIERO, Guido. 1978. «The Cooperationof Physicians and the State in the Control of Violence in Renaissance Venice », Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, vol. 33, n° 2 : 156-166.— 1981. «The Status of Physicians and Surgeons in Renaissance Venice »,Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, vol. 36, n° 2 : 168-184.
SANDRINI, Enrico. 2009. La professionemedica nella dottrina del diritto comune : secoli XIII-XVI. Parte II. Padoue, CEDAM (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Università degli studi di Parma. Nuova serie).
SARTI, Mauro et Mauro FATTORINI. 1888-1896. De claris archigymnasiiBononiensis professoribus a saeculo XI
usque ad saeculum XIV, vol. 1. Bologne, Regia fratrum Merlani.
SCENTONI, Gina (éd.). 1992. Lo statuto diMarsciano del 1531. Spolète, FondazioneCISAM (Quaderni del Centro per ilCollegamento degli studi medievali eumanistici in Umbria).
SHATZMILLER, Joseph. 1969. «Notes sur les médecins juifs en Provence au Moyen Âge», Revue des études juives,n° 128 : 259-266.— (éd.). 1989. Médecine et justice en Provence médiévale. Documents de Manosque1262-1348. Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence.— 1994. Jews, Medicine and Medieval Society.Berkeley, University of California Press.
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 27
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…28
DO
SS
IE
R SIRAISI, Nancy G. 1981. Taddeo Alderotti and His Pupils. Two Generations of ItalianMedical Learning. Princeton (NJ), Princeton University Press.— 1990. Medieval and Early Renaissancemedicine : An Introduction to Knowledge and Practice. Chicago, Londres, The University of Chicago press.— 2001. Medicine and the Italian Universities,1250-1600. Leyde, Brill (Education andSociety in the Middle Ages and Renaissance).STEFANUTTI, Ugo. 1961. Documentazionicronologiche per la storia della medicina,chirurgia e farmacia in Venezia dal 1258 al 1332. Venise, Ongania.TALBOT, Charles H. 1967. Medicine in Medieval England. Londres, Oldbourne(Oldbourne History of Science Library).THÉRY, Julien. 2003. « Fama : l’opinionpublique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècle) », in Bruno Lemesle (éd.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours. Rennes, Pur (Histoire) : 119-147.VALLERANI, Massimo. 2001. « I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive », Quaderni storici, vol. 108, n° 3 : 665-694.— 2005. La giustizia pubblica medievale.Bologne, Il Mulino (Ricerca).VARIUS, Domenicus Alfenus. 1773.Constitutionum Regni Siciliarum, libri III, tit. 45, 47. Naples, A. Cervoni.VEGETTI, Mario. 1994. «L’immagine del medico e lo statuto epistemologico della medicina in Galeno», in Wolfgang Haaseet Hildegard Temporini (éd.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, vol. 37.2.Berlin ; New York, De Gruyter : 1672-1717.
— 2010 [2004]. «Le originidell’insegnamento medico», in Monica Ferrari et Paolo Mazzarelo (éd.),Formare alle professioni. Diventare medicodall’evo antico all’evo moderno. Milan,FrancoAngeli (Storia dell’educazione), (éd. orig., Medicina nei secoli, vol. 16, n° 2 : 237-251) : 23-35.— et Paola MANULI. 1989. «La medicina e l’igiene», in Arnaldo Momigliano et Aldo Schiavone (éd.), Storia di Roma, vol. 4 : Caratteri e morfologie. Turin, Einaudi(Storia di Roma) : 389-429.VOLK, Peter et Hans Jurgen WARLO. 1973. «The Role of Medical Experts in Court Proceedings in the MedievalTown», in Heinrich Karplus, InternationalSymposium on Society, Medicine and Law,Jerusalem, March 1972. Amsterdam;Londres ; New York, Elsevier : 101-116.WEILL-PAROT. Nicolas. 2002. Les « imagesastrologiques » au Moyen Âge et à la Renaissance.Spéculations intellectuelles et pratiques magiques(XIIe-XVe siècle). Paris, Champion (Sciences, techniques et civilisations du Moyen Âge à l’aube des Lumières).WOLFF, Philippe. 1978. «Recherches sur les médecins de Toulouse aux XIVe
et XVe siècles », in Ph. Wolff, Regards sur leMidi médiéval. Toulouse, Privat : 125-147.
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 28
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
DO
SS
IE
R
Genèses 82, mars 2011 29
Notes* Je souhaite vivement remercier Luc Berlivet etMichael R. McVaugh pour leurs relectures atten-tives, ainsi qu’Arnaud Fossier et Sylvain Parentpour leurs conseils en matière de procédure judi-ciaire médiévale.
1. Notons en effet qu’il n’existe pas pour le mondeantique, de formation régulée, de contrôle dessavoirs et de règlement juridique de la pratique.Voir Vegetti (2010, 1994) ; Nutton (1992).
2. Le terme anglo-saxon utilisé est medical market-place. Il me semble que santé renvoie à une accep-tion plus large, dans laquelle il est possibled’englober non seulement les pratiques strictementthérapeutiques, mais aussi toutes les autres formesd’interventions médicales, en matière de conseilnotamment, qui ne sont pas seulement liées à unesituation pathologique, mais peuvent aussi concer-ner l’homme en bonne santé, désireux d’être guidédans la conservation de sa santé, ou dans l’évite-ment de certaines maladies.
3. Je laisserai ici volontairement de côté le pro-blème des relations entre Église et médecine quinous entraînerait vers d’autres directions.
4. Pour une étude générale de ce phénomène, voirMoeglin 2004.
5. Voir Cotturi (1982) ; García Ballester (2004) ;Gottfried (1986 : 42-48) : Guilleré (1987) ; Jac-quart (1981) ; McVaugh (1994 : 35-67) ; Park(1985 : 54-58) ; Talbot (1967) ; Wolff (1978).
6. Il s’agit de contrats individuels ou collectifs,signés avec un médecin qui s’engage à prendre soind’une famille ou d’un ensemble d’individus pourune durée déterminée qui peut s’étendre à plusieursannées. Ces premières formes de médecine de pré-voyance sont attestées dès le début du XIVe siècle,en Provence et en Catalogne plus particulière-ment.
7. Parmi les médecins recrutés par Venise, figurentcertains des plus illustres médecins des XIIIe-XIVe siècles comme Taddeo Alderotti, Mondinoda’Luzzi ou encore Bartolomeo da Varignana, tousqualifiés dans la documentation, à la différence deleurs confrères, simples maîtres (magister), de doc-teurs en physique (doctor physice), titulaires du doc-torat.
8. C’est par exemple le cas à Naples pour Frédéric II,Lerida, pour l’Aragon, et à Pavie pour les Visconti.
9. À Montopoli, commune rurale de la Toscane, ilest possible à quiconque de pratiquer librement la
médecine et de s’inscrire au collège sans obligationd’examen (Casini 1968 : 405).10. L’idée du danger, encouru lorsqu’on se fait soi-gner par des charlatans, est souvent présente dansla législation, comme dans les décisions de l’infantPierre d’Aragon, prises en 1334 (De la Torre y delCerro 1971).11. Voir Cervera, 1291, Valls, 1299, ou encoreValence, 1329 (García Ballester, McVaugh etRubio-Vela 1989).12. Voir Montpellier, 1239 (Germain 1890 : 185-186, doc. 4).13. Par exemple, dans la législation d’Alphonse IV,en 1329, dans les Cortes de Valence (García Bal-lester, McVaugh et Rubio-Vela 1989 : 59).14. Dès le règne de Roger II (1130-1154), puis ànouveau dans les constitutions de Melfi, en 1231,sous Frédéric II (Varius 1773).15. Ainsi à Viterbe (en 1469) où aucun étrangerne peut pratiquer sans avoir été examiné par deux «bons médecins » en présence du prieur des frèresmineurs (Buzzi 2004 : 316). À Montpellier, en1307, l’autorisation à pratiquer en ville est obtenuepar le candidat après un examen public passédevant une commission formée par le vicaire del’évêque et par deux maîtres en médecine qui choi-sissent l’œuvre médicale qui fera l’objet de la lec-ture (lectio). Voir García Ballester et Rubio-Vela(1985).16. L’acte de création officiel du studium remonte àune bulle pontificale de Clément V, le 8 septembre1308. Voir Ermini (1971); Frova (2007a, 2007b).17. Même configuration à Trévise, à partir de1426 (Betto 1981: chap. III) et à Ferrare en 1486(Caputo 1962).18. C’était le cas, dès le début du XIVe siècle, àVenise, quoiqu’on voit parfois le grand conseilautoriser des praticiens non inscrits, voire refuséspar le collège car illettrés, à exercer pour despathologies très spécifiques.19. À Florence, ce ne sera le cas qu’à partir dumilieu du XVIe siècle. À Novare, il convient aumoins d’avoir étudié dans un studium quatre ans ouplus, même sans obtenir de diplôme (Naso 1979).20. Dans les statuts du collège des docteurs enmédecine de Parme, il est clairement précisé qu’enraison de l’expérience trompeuse (citation desAphorismes d’Hippocrate), ne sont autorisés à pra-tiquer que ceux qui ont le doctorat ou la licence(Gualazzini 1978 : 65-66).
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 29
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin
Marilyn Nicoud !Formes et enjeux d’une médicalisation médiévale…30
DO
SS
IE
R 21. Isabelle Backouche rappelle que « l’affirmationde la qualité d’expert, propre à chaque contexte,fait jouer l’expérience acquise, la reconnaissanceinstitutionnelle, le rapport au pouvoir politique, lamaîtrise des savoirs ou, encore, la revendicationd’une proximité avec le “monde indigène”observé » (2008 : 2).22. Sur les précédents antiques, voir Amundsen etFerngren (1977). De semblables procédures sontmises en place à partir des XVe et XVIe siècles dansles espaces septentrionaux.23. Les exemples sont très nombreux, y comprisdans de petites localités comme Ascoli Piceno (en1377) pour les blessures avec effusion de sang, oupour Foligno.24. Outre une longévité en ville, gage d’une recon-naissance du savoir, une fortune estimée à aumoins 100 livres de Bologne est requise ; ils per-çoivent, selon la distance à parcourir, entre 10 et20 sous (Fasoli et Sella 1937 : 172-173).25. Cette procédure se met donc très tôt en placepour Bologne, dès le milieu du XIIIe siècle. C’est àpartir de 1324 que les statuts vénitiens prévoientaussi la possibilité faite aux Seigneurs de la nuit demener par eux-mêmes une enquête sur les délits etde mandater des experts médecins choisis par eux,au sein du collège urbain.26. Ils sont également reportés de manière plus oumoins détaillée dans le procès-verbal du procès.
Respectivement conservés dans Archivio di Statodi Bologna, Archivio del Comune-Curia delPodestà, Carte di Corredo et Atti del Podestà.27. Nombreux exemples, issus des registres desSeigneurs de la nuit, dans Monticalo (1896).28. Ugo da Lucca fit l’essentiel de sa carrière àBologne, employé comme chirurgien communal.Bartolomeo da Varignana enseigna dans la mêmecité ; la documentation bolonaise conserve la tracedes autopsies qu’ils ont effectuées au service de lajustice. Voir Sarti et Fattorini 1888-1896 : 568-571 ; Münster 1954).29. De ce point de vue, le conseil médical apparaîttrès différent d’autres formes de conseils.30. Je remercie Julien Théry de m’avoir signalé uncas de ce type, daté de 1273, relatif à l’évêque deBrindisi cité à comparaître par la Curie et excusépar le témoignage de son médecin traitant, quijustifie par la vieillesse et par la maladie l’incapa-cité de ce dernier à se rendre à Rome (Gilli etThéry 2010).31. Parmi les exemples les plus précoces de dia-gnostics faits par des médecins, il faut noter les sta-tuts de Sienne, dès 1250 (Carosi 1938). Nombreuxcas aussi d’expertises médicales en Aragon, à partirdu XIVe siècle, ainsi qu’en Sicile et en Provence.Voir par exemple les documents cités dans le dos-sier «Guérir au Moyen Âge. Médecine et sociétéau XIVe et au XVe siècle», (Razo 1984 : 109-126).
0000_02_xp_p001_139 11/03/11 12:25 Page 30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
88.
183.
11.2
41 -
29/0
6/20
11 2
3h04
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 88.183.11.241 - 29/06/2011 23h04. © Belin