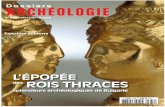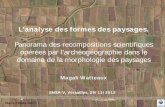Formes, paysages et sols de la zone d’étude du projet SMAP. Feriana, Kasserine (Tunisie)
Transcript of Formes, paysages et sols de la zone d’étude du projet SMAP. Feriana, Kasserine (Tunisie)
PROGRAMME D’ACTIONS PRIORITAIRES A COURT ET MOYEN TERME POUR L’ENVIRONNEMENT (SMAP)
Projet :“PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5
PROJET COORDONNE PAR PROF. ENNE GIUSEPPE
Formes, paysages et sols de la zone d’étude du projet SMAP Feriana, Kasserine (Tunisie)
CLAUDIO ZUCCA FRANCESCA JULITTA NABIL GASMI ET FRANCO PREVITALI
PROGRAMME D’ACTIONS PRIORITAIRES A COURT ET MOYEN TERME POUR L’ENVIRONNEMENT (SMAP)
Formes, paysages et sols de la zone d’étude du projet SMAP Feriana, Kasserine (Tunisie)
CLAUDIO ZUCCA FRANCESCA JULITTA NABIL GASMI ET FRANCO PREVITALI
Études réalisés dans le cadre des missions techniques organisées par le projet.
Etude géomorpho-pédologique: rapport final
Membres de l’équipe scientifique:
FRANCO PREVITALI, coordinateur scientifique
CLAUDIO ZUCCA, FRANCESCA JULITTA, NABIL GASMI, SALVATORE MADRAU, DAVIDE BELLAVITE, DAVIDE CANTELLI, ANNA MARIA URGEGHE.
Analyses chimiques et physiques réalisées dans les laboratoires de l’Université de Sassari et du DISAT-Milano-Bicocca, sous la supervision de MARIO DEROMA et de FRANCESCA JULITTA
Juin 2007
Le contenu de la présente publication relève de la seule responsabilité de NRD et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant de l’avis de la commission Européenne.
2007 - Centro Interdipartimentale di Ateneo – NRD Nucleo Ricerca Desertificazione Università degli Studi di Sassari V.le Italia, 57 I-07100 Sassari (ITALY) Tel: + 39 079 21.11.016 Fax: + 39 079 21.79.01 E-mail: [email protected]
Ce projet est financé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme d’Actions Prioritaires à Court et Moyen Terme pour l’Environnement. Contract n. ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
En adoptant une approche multidisciplinaire, le Projet a réalisé une série d’études techniques complémentaires aux activités directes sur le terrain et qui ont pour but le renforcement des capacités et des connaissances locales concernant les techniques de restauration et de gestion des parcours dégradés.
Ci-dessous les 7 études réalisées:
1- Potentialités d’utilisation stratégique des plantes des genres Atriplex et Opuntia dans la lutte contre la désertification.
2- Intégration de l’approche participative dans le projet SMAP.
3- Evaluation pastorale des plantations réalisées dans les zones du projet SMAP.
4- Utilisation des SIG et télédétection pour le suivi-évaluation dans la zone du projet en Tunisie.
5- Apport de la géomantique et de la télédétection aux études de reproductibilité du projet SMAP.
6- Sols et paysages de la zone d’étude du projet SMAP dans la commune rurale d’Ouled Dlim, Marrakech \ Maroc.
7- Formes, paysages et sols de la zone d’études du projet SMAP à Feriana, Kasserine, Tunisie.
Coordination des équipes scientifiques et définition des lignes directrices, par
Bellavite Davide, Zucca Claudio
EDITEURS:
Bellavite Davide, Zucca Claudio, Belkheiri Oumelkheir, Saidi Helmi
A citer comme suit:
Zucca C., Julitta F., Gasmi N., Previtali F., 2007. Formes, paysages et sols de la zone d’études du projet SMAP à Feriana, Kasserine, Tunisie. In Bellavite D., Zucca C., Belkheiri O., Saidi H. [Eds] Etudes techniques et scientifiques à l’appui de l’implémentation du projet démonstratif SMAP de Lutte Contre la Désertification. NRD, Université des Etudes de Sassari, Italie.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
TABLE DE MATIERES
1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS .................................................................................. 1
2. ETUDE DES ASPECTS GEOMORPHOLOGIQUES DE LA REGION DE SKHIRAT 2
2.1. Les aspects topographiques : « un paysage bien contrasté » ...................................... 2
2.1.1. L´ensemble montagneux : Jbals Serraguia-Goubel ............................................. 2
2.1.2. Les plateaux ......................................................................................................... 2
2.1.3. Les plaines ........................................................................................................... 3
2.1.4. Les collines .......................................................................................................... 4
2.1.5. Le réseau hydrographique ................................................................................... 4
2.2. Les affleurements géologiques ................................................................................... 5
2.2.1. Le Campanien ...................................................................................................... 5
2.2.2. Campanien supérieur / Maestrichtien inférieur ................................................... 5
2.2.3. Le Néogène .......................................................................................................... 5
2.3. Les aspects de géomorphologie structurale ................................................................ 6
2.3.1. l’anticlinal de jbal serraguia ................................................................................ 6
2.3.2. l’anticlinal de jbal Goubel ................................................................................... 7
2.3.3. Le mont dérivé ..................................................................................................... 7
2.3.4. Les chevrons ........................................................................................................ 7
2.3.5. Les combes .......................................................................................................... 8
2.3.6. Les crêts ............................................................................................................... 8
2.3.7. Les demi-cluses ................................................................................................... 9
2.3.8. Les cluses ............................................................................................................. 9
2.3.9. Les Formes de graviter ...................................................................................... 10
2.4. Les formes quaternaires liées à l’action de l’eau ...................................................... 10
2.4.1. Le Glacis 5 ......................................................................................................... 11
2.4.2. Le Glacis 4 ......................................................................................................... 13
2.4.3. Le niveau 3 (cône -terrasse ou glacis- cône) ..................................................... 15
2.5. Les formes éoliennes héritées ................................................................................... 23
2.5.1. Répartition géographique .................................................................................. 23
2.5.2. Les caractéristiques géomorphologiques ........................................................... 23
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
2.5.3. Les caractéristiques sédimentologiques ............................................................. 24
2.6. Aperçu sur les différents aspects des formes éoliennes actuelles ............................. 25
2.6.1. Répartition géographique des formes éoliennes actuelles ................................. 25
2.6.2. Caractéristiques géomorphologiques et dynamiques des formes éoliennes actuelles ....................................................................................................................... 26
2.7. Conclusion ................................................................................................................ 29
3. ÉTUDE PÉDOLOGIQUE: TECHNIQUES ANALITIQUES ET IMPLICATIONS TAXONOMIQUES ............................................................................................................. 30
3.1. Les analyses pour les sols salins. .............................................................................. 30
3.1.1. Conductivité électrique ...................................................................................... 30
3.1.2. Extrait en pâte saturée ....................................................................................... 32
3.1.3. Extrait 1:5 .......................................................................................................... 32
3.1.4. Pourcentage de saturation .................................................................................. 32
3.1.5. Capacité d’échange cationique .......................................................................... 33
3.1.6. Cations échangeables ......................................................................................... 34
3.1.7. Cations solubles ................................................................................................. 35
3.1.8. Absorption atomique à flamme ......................................................................... 35
3.2. La classification des sols selon le système WRBSR 2006 ....................................... 36
4. LA MISE AU POINT D’UNE APPROCHE CARTOGRAPHIQUE MULTIDISCIPLINAIRE .................................................................................................... 37
4.1. Schéma méthodologique........................................................................................... 38
4.2. Acquisition des photos aériennes, des images satellitaires et de la cartographie disponible ........................................................................................................................ 39
4.3. Connaissance préliminaire du territoire .................................................................... 39
4.4. Première rédaction de la Carte des Unités de Paysage ............................................. 40
4.5. Vérification de terrain de la Carte des Unités de Paysage et implémentation des données ............................................................................................................................ 41
5. LA CARTE DES UNITÉS PÉDOMORPHOLOGIQUES ............................................. 41
5.1. Les unités pédomorphologiques ............................................................................... 44
5.1.1. Unité 1 : Affleurements rocheux ....................................................................... 45
5.1.2. Unité 2: Glacis (Pédiments) ............................................................................... 49
5.1.3. Unité 3: Surface de transition entre pédiments et terrasses alluviales .............. 56
5.1.4. Unité 4 : zone sujette à salinisation et hydromorphie ........................................ 74
5.1.5. Unité 5: Zone de sédimentation éolienne .......................................................... 84
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
5.1.6. Unité 6 : Zone d’endoreisme ancien avec des dunes fossiles ............................ 96
5.1.7. Unité 7 : Terrasses alluviales ........................................................................... 104
5.1.8. Unité 8-9. Lit et bords fluviaux des Oueds Saboun et Saf Saf ........................ 124
6. Conclusions ................................................................................................................... 128
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................ 131
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
1
1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS
Cette étude s’est proposé l’objectif d’effectuer des approfondissements profitables pour une évaluation du type “ex-ante”, c’est-à-dire finalisée à la détermination d’Unités morphopédopaysagistiques et de leur caractérisation pédologique, dans le but de fournir au projet et à ses partenaires locales des indications d’application pour une gestion soutenable et pour une possible valorisation des sols de la zone, en vue d’orienter en manière cohérente les mesures futures de requalification.
La rédaction de la Carte des Unité Pédomorphologiques a exigé la mise au point d’une approche expérimentale intégrée et multidisciplinaire et a comporté un travail approfondi d’interprétation du paysage physique, sous aspects divers et à divers niveaux, avec une attention particulière aux dynamiques géomorphologiques. Ce programme a été réalisé au cours de deux campagnes de reconnaissance et de relèvement pédologique (Mars 2006 et Janvier 2007).
Le travail d’analyse chimique des sols, de classification taxonomique, d’interprétation des résultats a été accompli près le Département de Sciences de l’Environnement et du Territoire (DISAT) de l’Université de Milano Bicocca (Italie).
Cette étude-ci est organisée dans la manière suivante :
- Une section d’introduction comprenant l’étude géomorphologique
- Une partie de matériaux et méthodes relative à la réalisation de la Carte des Unités
Pédomorphologiques, avec des approfondissements sur les techniques utilisées
pour la caractérisation des sols échantillonnés
- Une description des techniques de cartographie mises au point pour dresser cette
Carte
- Une dernière partie illustrant et discutant les résultats et comprenant la description
de toutes les Unité cartographiées.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
2
2. ETUDE DES ASPECTS GEOMORPHOLOGIQUES DE LA REGION DE SKHIRAT
2.1. Les aspects topographiques : « un paysage bien contrasté » L’agencement des différentes unités de relief dans le paysage témoigne d’un remarquable contraste entre quatre ensembles orographiques : Montagnes, plateaux, plaines et basse colline.
2.1.1. L´ensemble montagneux : Jbals Serraguia-Goubel En premier lieu la région est dominée par un ensemble montagneux qui se compose du segment oriental de la chaîne de l´Atlas saharien étendu d’Est en Ouest sur une distance longue d’environ 25km. Cette dernière constitue la limite septentrionale du secteur étudié. Les traits majeurs de la configuration du versant méridional montrent l’alignement de crêtes plus ou moins parallèles enserrant ainsi des couloirs déprimés. Le cœur de cet ensemble est matérialisé par un véritable bombement qui présente un aspect massif.
Figure 1. L´ensemble montagneux Serraguia- Goubel
La succession des crêtes confère à ce segment un aspect typique. On distingue ainsi entre 2 et 3 crêtes. Leur orientation coïncide globalement avec celle de la chaîne de Botna Goubel à l’exception d’une légère torsion visible entre jbal Goubel et Serraguia dont l’orientation devient SO/NE. Le tracé de ces crêtes se trouve souvent perturbé par les nombreux ravins qui se jettent dans les plaines à partir de la voûte située au milieu du système montagneux. Le passage de ces ravins se traduit par la formation de nombreuses gorges à parois verticales. Toutefois, on note l’aspect relativement rectiligne des lignes de crêtes.
2.1.2. Les plateaux Les plateaux sont également bien représentés. Leurs extensions dans le paysage suivent deux configurations :
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
3
* Dans la première configuration, les plateaux jouxtent et /ou prolongent le système montagneux :
On distingue cet ensemble tout au long du piémont Sud de la chaîne montagneuse. Son développement se réalise progressivement en direction de l’Ouest. Il peut atteindre ainsi 1,5 km de largeur. Les valeurs d’altitude mesurées varient entre 850 m et 920 m avec une inclinaison de surface dirigée souvent vers le Sud (la plaine de Skhirat).
La surface de cet ensemble de plateaux est matérialisée par des lanières relativement planes et allongées souvent à partir des versants du système montagneux en direction de la plaine. Elle est, par endroits, parcourue par de nombreux oueds souvent secs dont les entailles peuvent atteindre 20 m particulièrement à l’approche des zones de contact avec les versants.
Cet aspect de morcellement de surface est visible tout au long des piémonts méridionaux de la chaîne montagneuse.
Toutefois, on peut noter que l’intensité de la discontinuité de surface est de plus en plus importante à l’approche des multiples gorges visibles dans les versants méridionaux de la chaîne montagneuse (gorge de Serraguia et gorge de Goubel).
* Dans la deuxième configuration, on distingue plutôt des plateaux individualisés (éloignés d’environs 0,5 à 1 km du système montagneux). L’originalité de cet ensemble provient de la parfaite platitude qui caractérise la surface sommitale. Ici, le plateau a une altitude moyenne d’environ 850 m et la surface s’incline lentement en direction de la plaine. L’irrégularité de surface est visible essentiellement à l’approche des zones de contacts avec la plaine. En effet, la concentration de petits vallons à écoulement saisonnier dans les secteurs de passage dans la plaine présente une configuration en promontoires étroits très découpée. On comprend ainsi la signification de l’appellation de « Chebket » accordée à ces endroits.
2.1.3. Les plaines Malgré leur position orographique déprimée, les plaines représentent une caractéristique primordiale du paysage. Il s’agit, en fait, d’une véritable surface monotone qui occupe un peu plus de la moitié de l’ensemble de la zone d’étude. Les plaines correspondent également à une extension relativement allongée d’Est en ouest.
De forme rectangulaire, les plaines de Skhirat constituent le prolongement oriental des vastes steppes Algériennes. Les valeurs d’altitude varient entre 800m à l’Ouest et 750m dans le secteur oriental. Il s’agit, en effet, de l’endroit le plus bas de la région. L’inclinaison de surface est désormais relativement insensible et la monotonie du paysage devient l’aspect caractéristique. En revanche, on remarque une irrégularité de surface peu développée visible dans les secteurs de passage de l’oued Safsaf et Goubel (entailles inférieures à 2 m). Elle s’explique également par la forte ramification des artères hydrographiques dans ces endroits.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
4
2.1.4. Les collines Situé à l’extrémité méridionale du secteur de l´étude, les collines de Gour Essoua sont marquées par une altitude moyenne d’environ 850 m. Elles s’étalent d’Est en Ouest sur presque 10 km avec une largeur qui oscille entre 1 et 4 km.
La surface de ces collines s’abaisse d’une façon inégale. On note ainsi, des valeurs de pente plus élevées dans la partie septentrionale qui surplombe le village de Skhirat (10°- 20°). Inversement, les valeurs de pente diminuent sensiblement en direction du secteur méridional (5°).
Figure 2. L´ensemble de collines est bien dégagé dans le paysage
L´escarpement des versants explique en grande partie la convergence des ravins et par conséquent le développement d’importantes entailles dans les secteurs déprimés. Les valeurs de profondeurs enregistrées ici oscillent entre 5 m et 20 m. Citons par exemple, les Oued situé a l´aval de la route SERGAZ, qui s’écoule en direction de l´oued El Gsob.
2.1.5. Le réseau hydrographique La région de Skhirat et ses environs constituent en grande partie le secteur amont du bassin El kebir- Bayech. Elles englobent un réseau hydrographique assez développé (Oued Safsaf et Oued Saboun), lequel se caractérise principalement par son régime endoréique. En effet, le quasi totalité du drainage converge vers les dépressions fermées situées à l´aval.
Oued Safsaf
Il représente le plus grand chenal d’écoulement visible dans la région d’étude. Il est visible à partir de la gorge de Serraguia jusqu'à sa confluence avec Oued El Gsob sur une distance estimée d´environ 30 km. Cette vallée est drainée par un écoulement intermittent, qui s’alimente principalement des eaux issues des affluents situés sur sa rive droite et des terres situées au Nord du segment montagneux et situées dans le territoire Algérien.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
5
Oued Saboun
Cet Oued au régime saisonnier est visible à partir de la gorge de Goubel. Il est alimenté principalement par le bassin versant situé au Nord du segment montagneux Goubel. Il reçoit aussi des apports réguliers et non négligeables de l’ensemble des affluents qui drainent le bassin de Skhirat.
2.2. Les affleurements géologiques La série stratigraphique de la région d’étude s’étale du Crétacé jusqu’au Néogène. Ces sédiments sont d’origine variable. En effet, les cycles sédimentaires lagunaires, lacustres et marins (Campanien maastrichtien) expliquent en grande partie les différentes phases sédimentaires. Toutefois, la série sédimentaire Néogène (formation Beglia et formation Segui) est principalement marquée par un environnement sédimentaire fluvio-deltaique.
2.2.1. Le Campanien L’étage Campanien caractérise le flanc méridional Du segment montagneux Serraguia -Goubel. Les terrains correspondants sont bien visibles également dans la terminaison périclinale occidentale du jebel Safsaf. Le Campanien est matérialisé par les termes suivants :
- une alternance de calcaire marneux jaunâtre et d’argiles sableuses à interlits de calcaire; - des bancs décimétriques de grès friable à interlits d’argiles gypseuses (15 m) ; - une couche calcaire en bancs métriques avec des interlits d’argiles légèrement gypseuses
2.2.2. Campanien supérieur / Maestrichtien inférieur Les dépôts relatifs à cet âge sont peu représentés sur le flanc Sud de la chaîne Serraguia-Goubel. Par contre, ils connaissent une extension spatiale considérable particulièrement en allant vers l´ouest. Cet affleurement est constitué à la base par des alternances marno - calcaires. Au sommet, on distingue l’affleurement de calcaires en bancs massifs avec la présence de multiples rognons de silex.
2.2.3. Le Néogène Les affleurements du Néogène sont bien représentés dans notre secteur d’étude.
. La formation Beglia (argile verdâtre et sable jaunâtre)
Les affleurements attribués à cette formation enveloppent la majorité des segments montagneux. Leur épaisseur varie entre 50m et 400m. Il est vraisemblable que la dimension de cette épaisseur progresse en direction de l’Ouest. Ces affleurements se distinguent nettement des dépôts antérieurs. Cela est plus remarquable dans le flanc méridional de la chaîne montagneuse. Ici, les termes fluvio-déltaique de la formation Beglia reposent en discordance sur les terrains crétacés d’origine marine. Le faciès de cette formation se caractérise par la succession suivante :
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
6
- le contact avec les affleurements sou jacents (crétacé et par endroits Miocène inférieur) est matérialisé par l’individualisation d’un horizon peu épais (quelques centimètres) constitué par des éléments conglomératiques ;
- la partie moyenne est beaucoup plus épaisse (environ 2/3 de l’épaisseur totale de la formation). Elle est constituée d’une alternance de termes sableux relativement fins et à stratification entrecroisée avec des lits décimétriques d’argiles vertes et gypseuses ;
- la partie supérieure se distingue par la raréfaction des lits d’argiles gypseuses et la dominance de sables blancs - jaunâtres et riches en dragées de silice.
. La formation Ségui : (argile rouge)
Il s’agit de l’élément lithologique supérieur du « complexe continental ».Il constitue une épaisse couche (150m- 500m) qui enveloppe la quasi-totalité des affleurements de Beglia. Les meilleures coupes sont visibles au Sud de la route SERGAZ. La lithologie de cet affleurement se distingue par la succession suivante :
- à la base par un banc conglomératique de quelques mètres d’épaisseur ;
- au dessus du premier banc conglomératique s’accumule une épaisse couche (presque la moitié de l’épaisseur totale) composée d’argiles rouges relativement consolidées. On constate également l’omniprésence de gypse qui se manifeste principalement par des nodules et localement des amas à structure farineuse ;
- le terme supérieur est marqué par la succession des bancs conglomératiques. Ce dépôt continental est dominé par les éléments grossiers (blocs et cailloux calcaires) issues des systèmes montagneux. Il s’agit ainsi du terme le plus résistant des affleurements néogènes. Cette consolidation se trouve soutenue par le développement d’une épaisse croûte gypseuse en surface.
2.3. Les aspects de géomorphologie structurale L’étude détaillée de cette mégastructure fait apparaître de multiples plis anticlinaux de style coffré et dissymétrique dont le flanc méridional est déversé vers le Sud, c’est le cas des anticlinaux suivants :
2.3.1. L’anticlinal de jbal serraguia Ce pli anticlinal figure dans le segment moyen de la chaîne atlasique Botna - Goubel. Son axe cartographique oscille entre N80° et N60°. Le style de plissement montre également un déversement du pli vers le Sud. Le flanc septentrional enregistre ainsi des valeurs de pendage qui oscillent entre 12°-25°. Tandis que sur le flanc méridional les valeurs de pendage s’élèvent à 45°.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
7
2.3.2. L’anticlinal de jbal Goubel
Cet anticlinal est individualisé dans la bordure Nord Est du secteur d’étude. L’orientation de son axe cartographique (N80°) épouse approximativement celle de l´anticlinal Serraguia. L’ensemble des valeurs de pendages témoigne de l’aspect dissymétrique de l’anticlinal. On note ainsi des valeurs de pendages de 10° à 15° pour le flanc septentrional et de 40° à 60° pour le flanc méridional. Le déversement s’effectue alors vers le sud.
Ce pli adopte une extension spatiale en configuration arquée dont le coté convexe regarde vers le Nord. Cet aspect s’explique vraisemblablement par la faille à jeu décrochant dextre visible dans la bordure occidentale.
En gros, la configuration du relief plissé visible dans la région de Skhirat offre une riche gamme de formes structurales dérivées. Elle est fortement liée au développement de l’érosion différentielle au sein d’une structure anticlinale formée d’une remarquable succession des roches dures (grès calcaire, dolomie) et de roches tendres (argiles, marnes) d’âge crétacé.
2.3.3. Le mont dérivé C’est un relief haut visible au sein de l’anticlinal (l’emplacement de la charnière) est dégagé dans la roche dure. Le démantèlement des couches peu résistantes du cœur de l’anticlinal de Goubel depuis la fin du Tertiaire a contribué au dégagement d’un mont dérivé déterminé par l’affleurement des couches de calcaires et dolomies du Campanien Maestrichtien (Mésozoïque). Il s’agit d’une voûte dont le sommet est relativement arrondi. La surface substructurale du mont dérivé est relativement dégradée suite au développement de multiples ravins.
2.3.4. Les chevrons Ils sont visibles sur les flancs de l’anticlinal de Goubel. Leurs configurations se distingue par le dégagement d’une forme triangulaire dont la pointe est dirigée vers le sommet de la montagne, (ou de V renversé) façonnée aux dépenses de la roche dure (calcaire de Maastrichtien). Ces chevrons ont des sommets pointus vers le haut et des bases larges. La dimension du chevron est strictement liée à l’action des ravins (Ruz), qui le ceinturent. Elle est déterminée également par les caractéristiques lithologiques des termes tendres insérés dans la couche dure qui forme la voûte anticlinale.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
8
Figure 3. Versants structuraux découpés en multiples chevrons
2.3.5. Les combes Une Combe est une dépression creusée au sein d’un anticlinal.
Les combes développées au milieu de l’anticlinal de Goubel ont souvent deux aspects; un aspect allongé, qui correspond aux couloirs intramontagnards et un aspect en croissant, qui occupe des espaces plus vastes dans les terminaisons périclinales (Occidentale et orientale). La dimension de la combe est déterminée principalement par l’extension de la couche tendre. Le fond de la combe épouse le plus souvent une configuration concave est il est bordé par des versants raides.
2.3.6. Les crêts Un crêt est une forme dissymétrique dégagée dans la roche dure. Le crêt se distingue par deux versants; un versant de front concave et un versant de revers convexe.
Les crêts de jbel Goubel sont visibles essentiellement sur le flanc méridional dont les valeurs de pendage ne dépassent pas 45°. Généralement on distingue deux catégories de crêts:
- Un crêt principal qui domine le mont dérivé et sculpté dans les bancs calcaires et grès calcaires du Campanien
- Le crêt secondaire qui est moins important et qui domine la combe externe. Il est défini principalement par la couche calcaire du Maestrichtien.
Les versants de revers des crêts correspondent à l’affleurement de roches dures (surface substructurale). Par contre, le versant de front montre deux aspects, un aspect abrupte dans les calcaires et coïncide avec une corniche (abrupt) et un aspect concave correspondant à la partie basale constituée des marnes et argiles.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
9
Figure 4. Succession de crêts calcaires
2.3.7. Les demi-cluses Une demi-cluse est une profonde entaille qui constitue une rupture de la ligne de crête. Sa configuration est liée principalement à l’importance du ruissellement et à la résistance des roches. Les combes de jbel Goubel sont drainées par des ravins orthoclinaux, qui ont un régime saisonnier. Ces derniers se jettent à l’extérieur à travers l’exutoire, situé souvent dans la terminaison périclinale. On assiste ainsi au développement d’une véritable coupure du flanc Sud de l’anticlinal. Il faut noter que cette rupture est le résultat d’autres facteurs; tels que l’existence de failles.
Figure 5. Les crêts sont fréquemment perturbés par les demi-cluses
2.3.8. Les cluses Il s’agit de vallées qui recoupent transversalement ou obliquement un axe anticlinal. On distingue essentiellement Oued Safsaf à travers jbal Serraguia et Oued Saboun, qui découpent de part en part l’anticlinal de Goubel dont la voûte est constituée principalement de calcaires Campanien. Il faut signaler que le développement de la cluse se détermine
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
10
primordialement par le passage d’une faille. Cette zone de faiblesse se trouve drainée par les artères hydrographiques qui ne cessent de développer leurs sections d’écoulement, particulièrement lors des phases pluviales (Plus humides que l’actuel).
Figure 6. La gorge de Goubel
2.3.9. Les Formes de graviter Ces formes sont très répandues à l’intérieur du massif montagneux et principalement au pied des escarpements façonnés dans les roches découpées par des fissures béantes. Les parties basales des versants rocheux sont jonchées de débris calcaires généralement anguleux qui montrent des dispositions souvent chaotiques et de taille variable : Amas de blocs relativement stables, éboulis de pierraille, colluvions ... Ces mouvements de masses donnent quelquefois des formes originales comme les abris sous roche ou l"arche" naturel rehaussant le lit étroit d’un oued et déterminé par le glissement de quelques blocs rocheux patinés sur un versant.
Ces phénomènes sont favorisés par de nombreux facteurs dont le soutirage et l’affaissement des matériaux et des roches meubles lors des averses, la gravité (ou appel au vide des blocs suspendus ou en porte-à-faux), la raideur de la pente…etc.
2.4. Les formes quaternaires liées à l’action de l’eau L’omniprésence des formes liées au ruissellement au niveau des piémonts attire l’attention sur l’importance de l’action hydrique. Au contraire les conditions climatiques actuelles ne peuvent pas expliquer une telle manifestation. En effet, cette dernière remonte à des périodes plus humides, dont les apports hydriques, sont plus importants qu’actuellement et l’ensemble des formes étudiées ici est hérité des phases pluviales qui ont jalonnés l’Ere Quaternaire. L’examen des multiples formes quaternaires liées aux eaux courantes nous a permis de concevoir un dénombrement global basé primordialement sur le critère altitudinal. On distingue alors, cinq niveaux : deux glacis, une forme de transition (cone - terrasse) et deux terrasses. Le dénombrement des niveaux stratigraphiques s’effectue du plus récent au plus ancien.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
11
2.4.1. Le Glacis 5 2.4.1.1. Réparation géographique Le glacis 5 est rarement représenté dans le paysage. Les meilleurs témoins de ce glacis sont souvent visibles à l’approche des versants les plus élevés. Ils sont bien conservés en contrebas des versants structuraux du segment montagneux. On peut observer d´autres témoins situés à une grande distance du système montagneux.
Figure 7. Lanières du glacis 5
Dans le paysage, le glacis 5 s’exprime essentiellement par des lanières allongées, qui bordent des oueds incisés (10 m – 20 m). Cette situation se développe à l’amont de plusieurs oueds. (ex ; oued chabet es srerig ; oued Douria …etc). Ici, les glacis en lanières occupent une position d’interfluve très exposée aux multiples morsures d’érosion. Cela explique la déconnection de nombreuses lanières des versants et l’émergence de quelques témoins de glacis 5 en forme de butte souvent isolée. Cette configuration est visible principalement en direction de l’Ouest de la chaîne Serraguia-Goubel.
2.4.1.2. Caractéristiques géomorphologiques - le profil longitudinal Le contact du glacis avec le versant est souvent marqué par un aspect concave. Cet aspect est d’autant plus marqué que le pendage des couches à laquelle se raccorde le glacis est faible. Cette séquence est véritablement représentée dans le secteur situé entre Garet El Arar et oued Safsaf du versant méridional de la chaîne Serraguia-Goubel.
Dans ces endroits, les obliquités des versants oscillent entre 30% et 50% alors que l’inclinaison du glacis 5 au niveau du contact avec le versant n’excède pas 15% soit environ 9°.
Par ailleurs, les rares témoins du glacis 5 qui prennent place en contrebas de versant méridional de Goubel (entre Garet El Arar et Oued Saboun) se distinguent plutôt par un contact brusque.
En effet, les couches de l’Eocène qui constituent la partie supérieure du flanc méridional ont des valeurs de pendage assez élevées (40°-60°) et elles surplombent des glacis faiblement inclinés (<8%). La transition entre le versant et le piémont est ainsi, très courte et elle ressemble à une véritable rupture de pente.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
12
Ça et là le profil longitudinal du glacis 5 se distingue par une profonde discontinuité. Malgré cette difficulté l’examen détaillé des rares lanières et/ou buttes prolongées révèlent que les valeurs de pentes déclinent vers l’aval (15% et 5%).
- Le profil transversal À l’échelle transversale les surfaces du glacis 5 dessinent un paysage très compartimenté. Cette dissection est liée au passage de multiples cours d’eaux qui assurent l’évacuation du système montagneux à travers les différentes percées « Chaabat », «Khanga » et « Dakhla » développées sur les versants.
Les entailles enregistrées à proximité du système montagneux varient entre 10m et 25m de profondeur. Ces encaissements diminuent rapidement en direction de l’aval.
En vue de cette importante discontinuité transversale, il est très difficile de suivre et/ou estimer la configuration des surfaces résiduelles.
Toutefois, on peut remarquer une légère convexité identifiée au niveau des lambeaux de glacis qui jouxtent les versants de montagnes. Une meilleure illustration de cet aspect est visible à l’approche des versants de jebel Serraguia.
Malgré sa fréquence assez rare, le glacis 5 est bien dégagé sur les piémonts. Il constitue, en effet, le niveau quaternaire lié au ruissellement le plus élevé. La dénivellation par rapport au glacis 4, qui lui succède varie entre 6 m à l’approche de la montagne et 2 m au niveau des buttes et collines distant de 500 mètres à 4000 mètres du système montagneux.
2.4.1.3. La couverture du glacis Partout le glacis 5 est constitué d’une couverture détritique. L’épaisseur de cette dernière est souvent variable mais elle n’excède pas 3.5 mètres. Les coupes examinées relatives à cette forme montrent un amincissement de la couverture en direction de l’aval.
Le rapport de cette couverture avec le substratum s’exprime toujours par un contact irrégulier. Cela traduit l’action de ravinement développée sur le substratum Néogène composé en grande partie de quatre termes lithologiques (Argile, Sable, Gypse et Conglomérats).
Dans l’ensemble des coupes examinées le recouvrement détritique de glacis 5 est caractérisé de trois aspects essentiels.
On note premièrement la disposition chaotique de l’ensemble des éléments qui composent cette couverture. Cet aspect caractérise la totalité des coupes situées à proximité des versants, hormis les rares témoins de glacis 5 en forme de buttes, distants d’environs 500m des versants structuraux, qui se distinguent par une amorce de litage.
Une telle séquence est bien illustrée tout au long des coupes levées au niveau des collines de Gour Es Soua. Ici le litage se distingue particulièrement dans la partie supérieure de la couverture détritique.
Deuxièmement, les galets et les blocs calcaires issus du système montagneux sont très fréquents. Ils constituent le plus souvent une proportion dominante, environ 2/3 de l’ensemble de recouvrement. Ces éléments grossiers se caractérisent par un degré d’usure très faible. En effet l’aspect anguleux est conservé pour la plupart des fragments observés.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
13
Troisièmement, on distingue l’omniprésence du calcaire au sein de la couverture détritique. La concentration et la cristallisation de calcaire au niveau supérieur de la couverture contribuent à la formation d’une véritable croûte fortement consolidée. Son épaisseur varie entre 0.5 m et 1 m.
2.4.2. Le Glacis 4 2.4.2.1. Répartition géographique Ce niveau quaternaire est très fréquent dans le paysage et en particulier à l’approche des versants. Son agencement est marqué par deux aspects essentiels :
- Sur le piémont : l’extension de glacis est assez étendue. Ici, les multiples lanières observées se prolongent depuis les premières pentes de versant en allant vers l’aval sur environ 1.5 km. Le piémont méridional de jebel Goubel constitue une bonne illustration de cette séquence.
- Loin des versants structuraux, les témoins du Glacis 4 sont relativement représentés. Ils épousent ainsi la configuration de buttes ou lanières allongées vers l´aval.
2.4.2.2. Les caractéristiques géomorphologiques La transition du versant montagneux vers la surface du glacis 4 s’exprime généralement par une pente concave. Cette dernière est aisément visible dans les piémonts des versants méridionaux du segment montagneux Serraguia.
Cet aspect s’explique en grande partie par l’inclinaison modérée du versant méridional dans ces endroits.
Inversement, l’inclinaison relativement élevée du versant sud de jebel Goubel contribue à une transition brusque vers le piémont traduite par une véritable rupture de pente.
En allant vers l’aval le glacis 4 conserve une inclinaison presque insensible. L’ensemble des valeurs enregistrées oscillent entre 2° et 10° et cela en fonction de l’éloignement des versants montagneux.
La meilleure conservation de ce glacis à l’amont se traduit par une véritable continuité de surface. Il est d‘ailleurs, très fréquent d’observer des surfaces planes parfaitement continues, qui assurent le raccordement entre le versant montagneux et les plaines. Cette configuration est bien visible dans le secteur de Gareet El Arar. Il est vraisemblable que l’omniprésence du glacis 4 dans ces endroits est liée à l’importance de cette phase d’aplanissement et aussi à l’ampleur moindre des dynamiques érosives qui lui ont succédé.
Cet aspect ne peut pas exclure par endroit le phénomène du morcellement intense. On observe ainsi, de multiples témoins au niveau du piémont Sud de Jbal Serraguia. Le glacis 4 est conservé ici, uniquement sous la forme de buttes ou de rares lanières assez allongées (30m -100 m).
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
14
Figure 8. Entaille dans le glacis 4
La fréquence du morcellement est liée principalement à la puissance des artères hydrographiques qui proviennent du système montagneux. Pour cette raison les entailles les plus profondes sont visibles à l’approche des versants. Les encaissements enregistrés par rapport au talweg actuel déclinent rapidement vers l’aval (15m - 3m).
Par ailleurs, le glacis 4 conserve partout un rapport d’emboîtement avec le glacis 5. Les rapports entre les glacis sont des emboîtements, vue l’importance de la couverture et/ou l’insignifiance du creusement entre les différents niveaux.
2.4.2.3. La couverture du glacis 4 La transition entre la couverture alluviale du glacis et le substratum (Néogène ou Crétacé) est matérialisée par un profil irrégulier. Cela traduit alors l’aspect ravinant du recouvrement détritique. L’épaisseur de ce recouvrement est très variable. On enregistre ainsi des valeurs assez élevées (3 m – 6 m) en contre bas des versants de revers de la chaîne Serraguia - Goubel. On signale également que l’ensemble des épaisseurs mesurées se distingue par un amincissement en direction de l’aval.
Par endroits, cette couverture détritique fait défaut et la surface du glacis 4 correspond à un plan incliné taillé aux dépens des affleurements d’argiles néogènes. On peut distinguer une telle configuration en contre bas des versants sud de la chaîne Serraguia - Goubel et particulièrement dans les secteurs éloignés des versants. Ici les éléments détritiques se limitent à des blocs et cailloux calcaires éparpillés et qui jonchent les argiles néogènes.
A l’inverse de cette configuration, les témoins du glacis couvert sont plus fréquents. On distingue alors une couverture relativement structurée en lits de variable épaisseur. Les éléments grossiers ont une forte dominance essentiellement dans la moitié inférieure du recouvrement. La proportion dominante de ces éléments se caractérise par un aspect anguleux et hétérométrique. L’ensemble des fragments calcaires est pris dans une matrice sableuse de couleur beige foncé et de faible consolidation.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
15
Figure 9. Couverture du Glacis 4
La continuité des lits est souvent perturbée par l’apparition de grosses lentilles (1m-3m de long) dont la disposition de ses éléments est strictement chaotique.
Dans la moitié supérieure du recouvrement, on remarque plutôt une dominance des éléments fins. On note aussi un enrichissement progressif en calcaire poudreux ou sous la forme de concrétions. Cet enrichissement assure le développement d’une véritable croûte calcaire, qui fossilise l’ensemble du recouvrement de glacis 4.
2.4.3. Le niveau 3 (cône -terrasse ou glacis- cône) 2.4.3.1. Répartition géographique Les secteurs dotés des témoins du niveau 3 sont bien représentés dans le paysage. Ont peut ainsi observer de multiples lanières ou/et lambeaux développées dans les secteurs situés entre 0,5 et 1 Km des versants structuraux. Plusieurs témoins sont aussi identifiés dans les secteurs de confluence des affluents et principalement à la hauteur de Farch el Hannachi et Aouled Sidi Rabeh. On observe également aisément les témoins du niveau 3 sur les auréoles proches de l’axe principal de l’écoulement Oued Safsaf. Ces édifices figurent principalement dans le tronçon qui succède le village El Ganzou.
En revanche le niveau 3 est moins représenté sur les environs de l´Oued Saboun. Les rares témoins sont rencontrés essentiellement dans la partie Moyenne de la dite vallée. On observe ainsi quelques témoins encore conservés sous la forme de lambeaux et constituants principalement les berges.
2.4.3.2. Les caractéristiques géomorphologiques L’ensemble des témoins du niveau 3 identifiés est développé entre le niveau 4 et la basse terrasse. Ces endroits sont parcourus par de nombreuses artères hydrographiques provenant du système montagneux et de niveaux quaternaires plus élevés. La fréquence de ces incisions donne au paysage un aspect très compartimenté. Cet inconvénient s’amplifie par endroits, avec la rareté des témoins de niveau 3.
Cette disposition s’explique vraisemblablement par l’agressivité de l’érosion enregistrée dans les premiers mètres qui jouxtent les multiples percées des versants (Chaabat). Le
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
16
niveau 3 figure ainsi en forme de lambeaux peu allongés dans le sens de l’écoulement. Cette configuration est visible dans plusieurs endroits dotés d’un tracé d’oued ondulé et particulièrement au niveau des cotés convexes des berges. Sur le plan transversal, le niveau 3 occupe souvent une position intermédiaire. Il se trouve ainsi en contre bas d’un niveau quaternaire défini par le glacis 4 ou le glacis 5.
Figure 10. Rapport d´emboîtement entre le glacis 4 et le niveau 3
Toutefois le niveau 3 est perchée d’environ 2m à 3m par rapport à la section d’écoulement et il surplombe la basse terrasse ou dans une disposition moins fréquente le talweg. Concernant ses rapports avec les autres niveaux quaternaires on constate sa disposition d’emboîtement avec le glacis 4 ou le glacis 5. Cet aspect signifie outre que l’insignifiance des entailles, la compétence des pulsations d’accumulation par rapport à celles de l´érosion durant le Pléistocène.
Le profil longitudinal intègre deux aspects essentiels. Il débute par un aspect arqué, mais plutôt à grand rayon de courbure. En direction de l’aval, ce profil se transforme progressivement vers un aspect subrectiligne. En fait, la transition vers les vastes plaines de Skhirat se réalise d’une manière presque inaperçue.
Le profil transversal est matérialisé par une légère convexité. Cet aspect se trouve par endroits perturbé à cause du phénomène de coalescence des cônes terrasses. Par conséquent le passage latéral entre ces édifices est marqué par le dégagement d’un petit palier topographique élevé de 0.5 m à 1 m. Certes, cette rupture est strictement liée à la convergence des ravins qui sillonnent les versants de cônes terrasses. Il est possible d’observer une meilleure séquence de cette configuration dans le secteur de Farch el Hannachi. Ici, les ruptures qui s’intercalent entre les cônes terrasses sont peu profondes et possèdent une hiérarchie assez développée d’affluents. Il est ainsi utile de noter que les sous bassins de ces affluents englobent les versants de cônes terrasses. Le développement du réseau hydrographique peut engendrer avec le phénomène de morcellement de surface un paysage très discontinu. Cette manifestation est très répandue particulièrement dans les secteurs qui jouxtent les lanières de glacis 4.
En revanche, l’aspect de continuité de surface trouve une meilleure illustration dans le cas des cônes terrasses les plus étendus. On évoque par exemple le cas.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
17
de cône terrasse situé dans le secteur de Sidi Rabeh. On peut suivre, ici, le versant de cône terrasse sur plus de 400 m sans aucune rupture. Il est aussi possible d’apercevoir cette continuité dans le compartiment aval de la majorité des cônes terrasses.
2.4.3.3. Le dépôt du niveau Indépendamment de secteurs étudiés, les coupes qui ont été levées dans le niveau 3 montrent les caractéristiques suivantes :
- l’épaisseur visible des dépôts qui constituent le niveau 3 varie de 2 m à 4 m. Il est important de signaler que par endroits on décrit seulement la partie visible de dépôt puisque le niveau quaternaire situé en contre bas s’emboîte dans le niveau 3.
- La structure de la couverture alluviale est marquée souvent par un aspect de litage. On remarque ainsi l’alternance de lits composés de gravier et d’éléments sableux de différentes catégories. Les galets calcaires sont également disposés en lits mais ils ont une faible fréquence. En gros, les éléments grossiers occupent le 1/3 inférieur de la couverture. Tandis que le reste de la couverture est essentiellement composé de matériaux fins à dominance sableuse. Par ailleurs, il est important de signaler que cet aspect lité des dépôts se trouve par endroits perturbé par l’apparition d’une structure sédimentaire lenticulaire. Sa dimension varie de quelques centimètres à 1 mètre de diamètre. Ces lentilles englobent des matériaux à la fois hétérogènes et hétérométriques.
- La consolidation des dépôts de la couverture est pratiquement faible. Cela explique en grande partie le développement de multiples griffures et localement des festons sur les parois des berges.
La concentration d’éléments gypseux et particulièrement calcaire dans la partie supérieure des dépôts, l’enrichissement considérable en calcaire et le durcissement localisé des dépôts plaident en faveur d’un probable ébauche de croûte calcaire.
i. La Terrasse 2
a. Répartition géographique
Les vestiges de la terrasse 2 sont bien représentés dans le paysage. Elles ont une extension soit allongée et épousent ainsi, la sinuosité des artères hydrographiques. Par conséquent la largeur des multiples témoins de cette terrasse varie entre 5 m et 30 m. Les édifices les plus étendus sont observés particulièrement aux seuils des confluences des oueds, qui se réalisent fréquemment dans les secteurs qui jouxtent les versants structuraux.
L’épanouissement de la terrasse 2 est enregistré principalement au niveau des surfaces de plaines. Dans ces endroits la terrasse 2 occupe de véritables surfaces planes, dont l’extension peut atteindre quelques milliers de m².
L’extension de la terrasse 2 n’est plus déterminée par le passage d’une artère hydrographique. Au contraire, ces endroits sont alimentés à partir de nombreux secteurs. Les cas des plaines environnantes du village Skhirat constituent les meilleurs exemples.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
18
b. Les caractéristiques géomorphologiques L’accumulation qui forme la terrasse se trouve le plus souvent perchée par rapport au talweg actuel. Les valeurs de commandement oscillent entre 1m et 2m et enregistrent un léger abaissement en direction de l’aval. Les secteurs situés à l’aval du crêt mineur se caractérisent plutôt par un encaissement très faible. Désormais, les entailles dépassent rarement 2 m.
Dans la majorité des coupes examinées, la terrasse 2 est dominée par un niveau quaternaire supérieur défini soit par le niveau 3, le glacis 4 ou le glacis 5. Au contraire, le niveau inférieur est défini souvent par le talweg actuel. Très rarement, on peut observer un dépôt alluvial peu développé en contre bas de la terrasse 2.
La disposition de la terrasse 2 en contre bas des niveaux quaternaires de glacis (soit le glacis 4 ou 5), est marquée principalement par un rapport d’emboîtement et très rarement par un rapport d´étagement.
Les surfaces de la terrasse 2 constituent des profils subrectilignes et peu inclinés. Les valeurs d’inclinaison augmentent sensiblement en direction des versants structuraux.
Concernant la continuité de surface, on évoque également la distinction de deux aspects.
Le premier aspect caractérise les nombreux témoins qui se développent sur les rives des artères hydrographiques situés aux environs proches du système montagneux. On observe ici, une discontinuité relativement intense qui se manifeste par l’épanouissement de nombreuses morsures de ravinement.
En revanche, la continuité de surface constitue le deuxième aspect typique de paysage dans les vastes étendues situées à l’aval du crêt mineur. Les entailles demeurent ainsi inférieures à 1 m et le ruissellement s’effectue par endroits à fleur du sol.
c. Le dépôt de la Terrasse 2 Les meilleures coupes, visibles dans les accumulations qui constituent la terrasse 2, figurent sur les abords des Oueds. Elles sont dégagées suite au développement de la section actuelle de l’écoulement. Par conséquent, l’épaisseur visible de la couverture de la terrasse 2 est très variable. Les valeurs mesurées oscillent entre 1.5 m au niveau des rives convexes et seulement 0.5 m dans les secteurs très exposés à l’érosion.
L’observation détaillée du dépôt alluvial, montre la présence de deux faciès essentiels. La partie basale des alluvions englobe essentiellement des éléments conglomératiques mais d’aspect relativement émoussé.
Cela dit que la partie dominante de ces dépôts provient vraisemblablement d’un remaniement des niveaux quaternaires antérieurs. Ces éléments grossiers présentent une disposition peu stratifiée voire même chaotique. L’ensemble de ces matériaux est enveloppé dans une matrice sableuse peu consolidée.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
19
Figure 11. Le contact ravinant entre la couverture de la terrasse 2 et les
affleurements de Néogène
Au contraire, la fraction fine devient dominante dans la partie sommitale de l’ensemble des coupes levées dans la terrasse 2. Les éléments sableux constituent ainsi la proportion dominante. Ils sont déposés dans des lits successifs peu épais (1 cm à 5 cm). Cette homogénéité se trouve localement perturbée par l’apparition de quelques galets calcaires, relativement émoussés. Cette couverture incorpore également une importante quantité de cristaux de gypse et de calcaire. La proportion de ces derniers augmente progressivement vers le haut. Cette omniprésence s’oppose avec le degré de consolidation très faible de l’ensemble du dépôt.
ii. La Terrasse 1
a – Répartition géographique Par opposition à l’ensemble des niveaux quaternaires observés, les vestiges de la terrasse 1 sont très peu représentés dans le paysage. Les meilleures coupes sont identifiées, seulement, loin des systèmes montagneux et plus précisément dans les berges des Oueds. La rareté de ces édifices quaternaires ne concerne pas seulement les secteurs drainés par les artères hydrographiques issues de la chaîne de Serraguia - Goubel. Certes, elle se vérifie également tout au long de l’axe principal de l’écoulement oued Safsaf et Oued Saboun.
b- Les caractéristiques géomorphologiques Le développement très limité de la terrasse 1 dans le paysage ne permet pas d’étudier systématiquement les différents aspects géomorphologiques. Néanmoins, la synthèse des données récoltées, particulièrement à partir des coupes observées dans le fond de l’oued Saboun, nous a permis de distinguer les aspects suivants :
Sur le plan transversal, on note que la terrasse 1 domine directement le niveau actuel de l’écoulement. La hauteur des berges façonnées dans cette terrasse est très limitée. Elle peut atteindre rarement 1 m. L’ensemble des mesures de hauteur effectuées indique un léger abaissement en direction de l’aval. Le développement de cette terrasse se réalise en contre
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
20
bas de la terrasse 2. Le contact entre ces deux niveaux quaternaires est matérialisé seulement dans le dépôt alluvial. Il s’agit ainsi d’un rapport d’emboîtement.
En raison de l’épaisseur peu importante de ce dépôt alluvial de la terrasse 1, il est vraisemblable que l’emboîtement s’explique primordialement par la faiblesse d’incision qui a succédé l’établissement de la terrasse 2. Dans le même sens, on signale que la rareté des témoins de la terrasse 1 plaide en faveur de la faiblesse de la pulsation d’alluvionnement.
Concernant le profil longitudinal, il est très difficile de se prononcer d’une façon précise sur l’ensemble des aspects. Toutefois, il est possible de mentionner l’immense discontinuité qui caractérise les surfaces limitées de cette terrasse. La totalité des témoins identifiés au niveau des affluents se manifeste par des minces lanières très perturbées par les flux latéraux. Le morcellement de paysage devient ainsi la propriété marquante. Excepté ces endroits, les surfaces occupées par la terrasse 1 dans le lit mineur de l’oued sont mieux conservées. Désormais le développement longitudinal de la terrasse 1 peut s’effectuer sur des distances non négligeables (50 m à 150 m). Ce développement nous a permis de distinguer le profil subrectiligne et l’inclinaison presque inaperçue de la surface.
c- Le dépôt de la Terrasse 1 L’examen de dépôt de la terrasse 1 laisse observer une accumulation alluviale peu homogène. Une importante proportion de ces éléments se compose de sable de taille variable. En fait, ce dernier constitue presque les 2/3 supérieurs de l’accumulation alluviale. Sa structuration se distingue par une succession de lits peu épais (1 cm – 5 cm). La consolidation de ces éléments demeure très faible.
On peut observer également quelques éléments grossiers répartis d’une façon éparse. Il s’agit principalement de galets calcaires et quelques fragments de fossiles issus des affleurements crétacés. On note ici, que l’usure assez développée sur les parois des galets plaide en faveur de leur appartenance aux niveaux quaternaires antérieurs. Ces éléments grossiers sont toujours enveloppés dans une matrice sableuse et résidants essentiellement dans la partie basale de l‘accumulation alluviale.
En somme, les dépôts qui constituent la terrasse 1 englobent une importante quantité d’éléments gypseux et calcaires conservés essentiellement en forme de cristaux et nodules. La teneur en calcaire peut être très importante. Cela est vérifié sur les parois des berges définies dans la terrasse 1. On enregistre ainsi, l’apparition d’une mince pellicule de calcaire. On peut trouver une telle manifestation essentiellement sur les rives de l’oued Saboun.
Cet enrichissement en calcaire et gypse est assuré par la convergence du ruissellement intermittent. Des quantités considérables sont alors acheminées à partir particulièrement, des affleurements Néogènes et crétacé.
iii. Attribution chronologique des formes et dépôts quaternaires liés au ruissellement
Le passage en revue de toutes les formes quaternaires dégagées nous a permis de dresser des coupes synthétiques qui résument l’évolution morphologique du secteur d’étude.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
21
L’interprétation de ces coupes constitue l’ossature du schéma stratigraphique établi. Les assises chronologiques utilisées lors du calage de l’ensemble des niveaux quaternaires identifiés sont peu nombreuses. Les rares trouvailles archéologiques se raccordent uniquement aux périodes Néolithique et Historique. Les autres dépôts quaternaires n’ont pas livrés des éléments de datation. Afin de résoudre cette complexité nous avons opté pour les méthodes suivantes :
- La distinction de l’ensemble des niveaux quaternaires se base sur le critère altimétrique. La variation des hauteurs à travers les différents dépôts quaternaires constitue l’argument primordial de calage chronologique. En effet, la succession chronologique débute de niveau le plus ancien qui correspond au niveau le plus haut. Inversement le niveau le plus récent coïncide avec le niveau le plus bas.
- La corrélation avec les deux échelles chronostratigraphiques proposées par Coque R. en 1962 et Ben Ouezdou H. en 1994 demeure un outil essentiel pour mieux dater les différents niveaux pléistocènes. Il est certain que l’attribution chronologique par rapprochement entre des régions éloignées et sans arguments de datation est très dangereux. Cependant, cette attribution chronologique par corrélation s’avère plausible du fait que ce secteur d’étude appartient en grande partie à la même région étudiée par les deux auteurs déjà signalés.
L’examen de l’ensemble des coupes dégagées fait apparaître cinq niveaux quaternaires liés au ruissellement. Du plus ancien au plus récent nous avons.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
22
Tableau 1. Corrélation des chronologies dressées pour la région de Skhirat
Préhistoire
et archéologie
Chronologie de la partie méridionale
des steppes tunisiennes (BEN OUEZDOU, 1994)
Chronologie de la Tunisie
présaharienne (COQUE, 1962)
Chronologie adoptée pour la région de Skhirat
(GASMI, 2007)
Historique Terrasse 1 Terrasse 1
Néolithique Terrasse et cône 2 Terrasse 2
Capsien Glacis 1
Terrasse, glacis- cône et cône terrasse 3
Ibéromaurusien ou industrie à lamelles
Troisième génération des sables éoliens
Terrasse, glacis et cône 3
Glacis 2
Glacis 4 Atérien
Moustérien
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
23
Acheuléen final Deuxième génération des sables éoliens
Glacis 5
Acheuléen évolué
Glacis 3 Terrasse, glacis et cône 4
Acheuléen moyen Première génération des sables éoliens
Glacis 5 Glacis 4
Glacis 6
2.5. Les formes éoliennes héritées 2.5.1. Répartition géographique En gros, les dépôts éoliens hérités observés dans le paysage se développent dans deux secteurs distincts :
- les secteurs escarpés situés au Sud du village Skhirat enveloppent plusieurs témoins, soit sur les parois rocheux qui domine le village soit sur les revers des versants ;
- le secteur des plaines situé entre Oued Saboun et Oued Safsaf est largement occupé par ces dépôts.
2.5.1.1. Les surfaces escarpées Les secteurs en question sont marqués par le développement de multiples dépressions ou/et couloirs. Ces derniers se trouvent partiellement encombrés par des dépôts éoliens hérités. L’extension de ces dépôts épouse le plus souvent la configuration allongée (Est / Ouest) des dépressions. Les dépôts de sable les mieux conservés sont visibles au niveau de Draa El Golla situé à l´Est de village de Skhirat. L’étendu de dépôts éoliens peut atteindre, ici, 200 de long et 50 m de large. Toutefois, on signale que cette dimension est très variable à travers l’ensemble des secteurs.
2.5.1.2. Les surfaces planes Les dépôts éoliens hérités réalisent une extension considérable sur les plaines limitrophes des grandes vallées telle que Oued Saboun. Il s’agit de l’endroit le plus riche en témoins de dunes héritées. Ce secteur s’étend à partir des marges Ouest de cet Oued et englobe la quasi-totalité des surfaces de plaines.
2.5.2. Les caractéristiques géomorphologiques Ces dépôts s’adossent en placage sur les versants septentrionaux et méridionaux du relief escarpé qui domine le village de Skhirat. Ils constituent ainsi un revêtement discontinu de
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
24
sable éolien et ils reposent essentiellement sur les versants qui regardent vers le Nord et partiellement sur le piémont. Par conséquence ce dépôt éolien hérité moule en grande partie les pentes concaves situées dans les secteurs de transition entre les versants et les piémonts. La configuration de surface de ce revêtement ne correspond pas à une forme caractéristique. Toutefois elle se distingue par une forte inclinaison qui varie entre 15° et 45°. Il est important de signaler également qu´une bonne partie de ces surfaces se trouvent ensevelie par les dépôts actuels de sable éolien. Dans les endroits ou la surface de cette génération de sables hérités est exhumée on enregistre le déclenchement rapide des processus de déflation. Cette manifestation est visible dans les secteurs de placage éolien situés en contre bas de Draa el Golla et Margueb Ettir.
La mise en place de ces dépôts est déterminée principalement par la disposition latitudinal de l’ensemble du relief escarpé. Par conséquent, les versants septentrionaux de ce relief constituent un véritable obstacle particulièrement devant l’avancement des sables transportés à partir des secteurs nord ouest et nord.
Figure 12. Des couvertures éoliennes très épaisses qui constituent actuellement
les berges des oueds
2.5.3. Les caractéristiques sédimentologiques Les dépôts éoliens hérités ont des épaisseurs fortement variables dans ces endroits. La valeur maximale de cette épaisseur peut atteindre 3 m particulièrement dans les couloirs et dépressions bien développés dans le versant Nord de l´escarpement qui domine le village de Skhirat.
Figure 13. Couverture de sable éolien a l´amont de village de Skhirat
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
25
Au contraire ce recouvrement éolien devient plus mince lorsqu’il repose sur les revers du susdit relief. Les valeurs d’épaisseurs oscillent ainsi entre 0,5 m et 1 m.
Indifféremment de l’affleurement qui constitue le soubassement, le membre éolien hérité se distingue facilement. En apparence se dépôt est relativement homogène et possède une couleur jaunâtre foncé. Il se distingue localement par une lamination oblique d’origine éolienne. Les éléments sableux sont ainsi disposés en multiples horizons peu épais (1 cm – 5 cm) et orientés vers des directions opposées. L’induration de l’ensemble des horizons est peu développée. On signale ici qu’il est possible d’observer une induration plus poussée mais très discontinue localisée dans les horizons supérieurs du dépôt.
En détail ce recouvrement est loin d’être homogène. La matrice sableuse enveloppe de nombreuses concrétions gypseuses et nodules calcaires. On note aussi la présence de plusieurs traces de terriers et tubulures de racines gypsifères, qui se concentre essentiellement dans la partie supérieure du recouvrement. La présence de ces éléments explique en grande partie la teinte peu claire du membre éolien hérité et qui contraste nettement avec les dépôts éoliens actuels. Ceci laisse penser au développement des processus de pédogenisation associés à une ambiance climatique favorable au développement du couvert végétal et l’atténuation de l’action éolienne. Cette ambiance conduit le plus souvent à l’immobilisation partielle ou totale des dunes. Parallèlement à cette dynamique les éléments gypseux et calcaires, plus fréquents, ce concentre sur les parois des systèmes radiculaires (racines gainées par le gypse et calcaire).
2.6. Aperçu sur les différents aspects des formes éoliennes actuelles 2.6.1. Répartition géographique des formes éoliennes actuelles La répartition de l’ensemble des formes liées à l’action du vent est étroitement liée à la configuration des différentes unités de relief. L’analyse en fonction de ce critère de disparité peut contribuer à mieux comprendre l’agencement des différentes formes éoliennes visibles dans la région.
Dans l’ensemble les plaines sont à peine affectées par les manifestations éoliennes majeures. Toutefois, on indique que ce contexte orographique renferme des disparités assez remarquables. Les surfaces d’une bonne partie des plaines qui jouxtent les grands Oueds sont systématiquement pavées par un recouvrement éolien. Le paysage des plaines se distingue particulièrement par une submersion progressive sous un tapis de sable éolien en direction de l´Ouest (oued Safsaf). Désormais, Les surfaces alluviales deviennent très discontinues. Elles se contrastent et se substituts avec les vastes surfaces affectées par le saupoudrage éolien. L’importance d’ensablement est attestée également par l’apparition des multiples champs de micro Nebkas particulièrement et particulièrement les Rebdou.
En gros la forte fréquence de ces formes est d’autant plus importante qu’on se rapproche des principales zones d’épandages. Les meilleures manifestations sont visibles dans le lit moyen de oued Saboun et Oued Safsaf parsemé de grosses dunes buissonnantes.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
26
2.6.2. Caractéristiques géomorphologiques et dynamiques des formes éoliennes actuelles 2.6.2.1. Les Nebkas Les formes des nebkas sont préférentiellement représentées dans l’ensemble des secteurs de plaine. Cette forme d’accumulation se manifeste dans le paysage soit par un aspect massif, matérialisé par le regroupement de multiples « essaims » ou « champs » de nebkas. Une telle configuration est bien visible dans le secteur d´Aouled Brahim.
Figure 14. Un champ de Nebkas
Inversement, les nebkas dessinent une configuration moins importante dans le paysage et se manifestent par des formes isolées. La répartition devient ainsi sporadique. Cet aspect concerne particulièrement les nebkas qui occupent des surfaces dégagées. Indifféremment de leurs configurations surfaciques les nebkas consistent à un dépôt de sable éolien associé à un obstacle. En effet les courants aériens chargés en éléments sableux se trouvent partiellement freiner ou/et bloquer par l’écran qui constitue l’obstacle. Ce dernier joue alors le rôle d’un véritable butoir. Sachant ici, que tout type d’obstacle peut produire une sédimentation (touffe de végétation, fragment de roche…etc.). Suite à cette disposition, le vent dépose en partie sa charge en contre bas de l’obstacle et particulièrement dans la zone protégée qu’il délimite. Ce processus de sédimentation explique en grande partie le profil dissymétrique de l’amas sableux. Il s’agit ainsi d’un versant face au vent caractérisé par une forte obliquité (environs 30° à 45°) et une courte distance qui dépasse rarement le 1/3 de son homologue sous le vent. Ce dernier enregistre des valeurs d’inclinaison moins élevées. Elle dépasse rarement 20°.
Les formes de nebkas observées montrent souvent des configurations de monticules de variables dimensions. Les exemples les plus développes en terme de dimension sont observés au niveau des plaines qui jouxtent la partie aval de L´oued Saboun et Oued Safsaf. Ici, les hauteurs des dunes oscillent entre 0.5 m et 1 m tandis que la densité peut atteindre 4 nebkas par 10 m². En effet, les espaces inter-dunaires devient peu visibles et les
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
27
dunes ont tendance à se juxtaposées. La prolifération des nebkas dans ces endroits est souvent encouragée par la position orographique déprimée de ces secteurs de dépôts. Une telle position est très favorable à la convergence des multiples artères hydrographiques capables d’assurer le renouvellement du matériel sableux lors des crues. Une fois asséché, les lits d’oueds deviennent de véritables sources de sables transportables par le vent.
Au contraire, la fréquence des nebkas devient de plus en plus faible en direction des secteurs relativement dégagés (plateaux et basses collines). Les valeurs des densités dépassent rarement 2 nebkas par 10 m². Désormais ces coussinets sont à peine dégagés du sol (10 cm à 30 cm) et garnis principalement de maigres gypsophytes (Astragales…etc.).Cela est dû naturellement à la forte fréquence des processus de déflations dans les endroits dégagés et la rareté des apports hydriques qui puissent acheminer le matériel sableux.
Par ailleurs, La consolidation de l’amas sableux est très variable. Elle augmente en profondeur dont on peut distinguer un litage entrecroisé. Cette structure interne des nebkas est caractérisée par une variable et forte inclinaison des horizons de dépôt (10° à 45°). Il s’agit en effet d’une séquence sédimentaire éolienne typique. L’ébauche d’induration soulevée à l’intérieure de l’amas sableux se trouve soutenu par le développement important du système radiculaires des psammophytes (Rtem...etc.). Par contre la mobilité des éléments sableux augmente brusquement vers la surface. La pérennité de ce type de dune est fortement liée au cycle biologique de la « plante obstacle ». Autrement dit une détérioration par assèchement ou/et déchaussement de la plante peut générer des processus de destruction souvent irréversibles du Nebka.
2.6.2.2. Les Grosses dunes « les rebdous » Les grosses dunes sont quasiment visibles dans les lits moyens des grandes artères hydrographiques. Les meilleures formes se rencontrent aux environs de l´oued Safsaf. Il est également possible d’observer des illustrations typiques de cette forme d'accumulation sur les marges septentrionale de village de Skhirat.
Figure 15. Rebdou très fréquente dans la plaine de Skhirat
Ça et la, les grosses dunes se distinguent dans le paysage par leurs dispositions en ruban relativement étroit et qui se prolonge tout au long des principales artères hydrographiques.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
28
La dimension de ces dunes est largement supérieure à celle des Nebkas. On enregistre le plus souvent des valeurs de hauteurs qui oscillent entre 2 m et 3 m. Cette remarquable progression en terme de dimension peut s’expliquer par différents facteurs :
- Le premier facteur est lié à l’abondance des éléments sableux, puisque les grosses dunes jouxtent les lits mineurs assez larges des Oueds. Ces derniers sont occupés principalement par une couverture sableuse mobile bien fournie. Il s’agit vraisemblablement de la première source de sables constitutifs de ces dunes.
Figure 16. Les lits des oueds constituent une importante source de sable
- Deuxièmement, les Oueds en question épousent presque la même direction des vents dominants (Nord/ouest- Sud/est). Cette coïncidence favorise la canalisation des courants d’air et favorise ainsi la concentration de l’énergie éolienne. On assiste alors à une progression du potentiel de transport du vent au niveau des sillons hydrographiques et qui devient désormais des véritables « rivières éoliennes ». Le sable véhiculé tout au long de ces Oueds peut ainsi être piégé par les arbustes environnants.
- Troisièmement, une bonne partie des ligneuses borde les Oueds. Elle profite ainsi des eaux de ruissellement lors des crues mais principalement de l’écoulement hypodermique (Under Flow). Ce potentiel hydrique exceptionnel explique alors l’épanouissement des arbustes et particulièrement le développement de la partie aérienne des plantes xérophytes (Tamarix, Zizifus lotus…). Cette configuration provoque une intense action de piégeage de sables transportés par le vent. L’engraissement de la dune piqueté par une telle plante se réalise alors, avec un rythme relativement accéléré.
Le corps presque arrondi de la grosse dune ressemble en grande partie à celui d’un simple Nebka. Néanmoins, les traits sédimentologiques sont remarquablement différents. Sans doute la proportion dominante de ce dépôt est d’origine éolienne. Ce la est matérialisé par la structuration interne de l’amas sableux qui montre souvent un litage entrecroisé des éléments sableux. Cette homogénéité se trouve par endroits perturbée suite à l’apparition de cailloux minuscule ou/et lentilles de graviers et argiles. Ces éléments d’origine hydrique
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
29
sont ainsi disséminés dans la matrice éolienne. Leurs présences interrompent la séquence sédimentologique éolienne.
La succession de ces minces horizons (2 cm à 10 cm) d’origine hydrique peut traduire la fréquence des épisodes de crues. Lors de ces épisodes les grosses dunes se trouvent entièrement encercler par l’eau, formant ainsi de petites îles isolées. La récurrence de cette dynamique explique en grande partie la conjugaison des nombreuses formes d’érosion sur les versants des grosses dunes. Cette destruction peut concerner l’ensemble de l’amas sableux et provoquée le déchaussement de la plante édificatrice de la dune. Le démantèlement du système radiculaire de cette plante déclenche un processus irréversible de l’élimination de la grosse dune.
2.7. Conclusion Le passage en revu de l’ensemble des aspects naturels de la région de Skhirat particulièrement ceux qui influents sensiblement le phénomène éolien (vent, rugosité et sédiments mobiles), place ce secteur dans une position hautement propice pour l´ensablement. En effet, l’action conjuguée du phénomène éolien dans ces endroits a provoqué de multiples témoins de dégradations de paysage.
Par ailleurs l´émergence des pratiques attentatoires au mépris de la fragilité de milieu et en dépit de ses maigres ressources naturelles ne peut pas ne pas aboutir au phénomène de la désertification. Ainsi, le secteur de Skhirat est marqué par des activités humaines exorbitantes. Ces pratiques d’intensification de l’exploitation (céréaliculture et arboriculture) se réalisent, hélas, dans une ambiance bioclimatique rude. En effet, l’aridité soutenue de ces endroits couplée avec les réelles menaces de désertification incite une sérieuse réflexion sur les seuils d’exploitations équitables. Ces pratiques irrationnelles contribuent massivement à la régression du couvert végétal. Ces stades de destruction de paysage naturel habituel ne cessent d’évoluer. Ils atteignent par endroits des phases irréversibles, qui ne permettent plus la résurrection de paysage. Les terres qui jouxtent le village de Skhirat sont en fait des meilleurs exemples. Elles sont les plus affectées par le phénomène de surpâturage. L’anthropisation de ces endroits a provoqué l’entière disparition des chaméphytes capables de piéger les sables mobiles. On enregistre aussi, la raréfaction des Nebkas, infaillibles face à l’action des vents actifs. Désormais, on assiste à l’installation d’une nouvelle dynamique éolienne caractérisée par l’accélération de l’érosion éolienne.
En bref, le degré de détérioration des conditions de milieu naturel a priori précaire, est en grande partie lié aux pratiques de forçages d´origine anthropique. Il est évident que l’analyse de ces pratiques contribue à mieux expliquer leurs impacts sur les dynamiques naturelles.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
30
3. ÉTUDE PÉDOLOGIQUE: TECHNIQUES ANALITIQUES ET IMPLICATIONS TAXONOMIQUES
Au cours de l’étude pédologique, l’effectuation des analyses de laboratoire a constitué une partie dominante du travail. Après une première caractérisation des sols sur le terrain, en effet, des approfondissements sur les propriétés chimiques des échantillons récoltés se sont rendus nécessaires pour permettre la classification taxonomique des sols et la compréhension des processus pédogénétiques qui ont porté à leur formation et pour les pouvoir mettre en relation avec les autres composantes du paysage. Pendant le déroulement des analyses, on a rencontré des difficultés à cause des hautes concentrations salines relevées. Ces dernières n’ont pas permis de traiter les échantillons par les typiques méthodologies standards, impliquant au contraire l’utilisation de techniques spécifiques pour les sols salins, avec les complexités qui en découlent.
Tous les échantillons de sol ont été asséchés à l’air et tamisés pour sélectionner les particules de diamètre inférieur à 2 mm. Les analyses effectuées sur la fraction fine ainsi obtenue sont subdivisées en analyses pédologiques standard et analyses spécifiques pour les sols salins.
Les analyses standard comprennent la détermination du pH dans l’eau et dans KCl ; de la texture à 5 fractions (méthode de la pipette), des carbonates (détermination gaz volumétrique), du carbone organique et de la substance organique selon la méthode Walkley-Black ou par analyseur élémentaire.
Les analyses spécifiques pour les sols salins comprennent par contre les déterminations suivantes : conductivité électrique en pâte saturée (ECes) ; capacité d’échange cationique (CEC) par extraction à l’acétate d’ammonium; cations extractibles, cations solubles et cations d’échange (déterminés par absorption atomique à flamme), pourcentage de saturation (SP). On a en outre calculé des paramètres et des indices dérivés : TSB (taux de saturation en bases), pourcentage de sels solubles, ESP et SAR.
3.1. Les analyses pour les sols salins. 3.1.1. Conductivité électrique Ce paramètre représente une mesure indirecte de la concentration de sels dissous en des extraits aqueux du terrain. Sa détermination permet d’avoir une indication sur les dommages potentiels et sur la réduction de rendement des cultures, en fonction de leur sensibilité, plus ou moins élevée, à la salinité. La détermination de la conductivité, en outre, est indispensable pour la classification des terrains salins ou alcalins. La détermination est effectuée par voie conductimétrique sur des extraits avec différents rapports sol/eau, ou sur extrait en pâte saturée.
Dato che la corrente elettrica che passa attraverso una soluzione salina in condizioni standard cresce all’aumentare della concentrazione di sali in soluzione (vedi Error! Reference source not found.), il valore della conducibilità elettrica della soluzione acquosa estratta dalla pasta satura del suolo è una misura indiretta della concentrazione
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
31
salina dello stesso. La percentuale di sali solubili nel suolo è stata stimata a partire dal valore della conducibilità tramite la seguente equazione:
Sali nel suolo (%) = ECes *0,64 * (SP/100)
Le courant électrique qui passe à travers une solution saline en conditions standard croît avec l’augmentation de la concentration de sels en solution (Fig. 17); par conséquent, la valeur de la conductivité électrique de la solution aqueuse extraite de la pâte saturée du sol est une mesure indirecte de la concentration saline du sol même. Le pourcentage de sels solubles dans le sol a été évalué à partir de la valeur de la conductivité selon l’équation suivante :
Sels dans le sol (%) = ECes*0,64* (SP/100)
Figure 17. Développement de la concentration saline de l’extrait saturé selon la variation
de la conductivité (Saline and Alkali Soils, US Salinity Laboratory, 1954)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
32
La conductivité électrique mesurée sur l’extrait en pâte saturée permet de corréler la salinité d’un sol avec la croissance des plantes.
Le pourcentage de saturation est directement corrélé aux valeurs de la capacité au champ (on peut approximer que la SP soit équivalent à 4 fois environ la capacité au champ = 15 atmosphères).
La concentration de sels solubles dans l’extrait en pâte saturé tend donc à être la moitié environ de la concentration dans la solution du sol à la limite supérieure des valeurs de capacité au champ et un quart environ de la concentration que la solution du sol aurait à l’extrémité inférieure des valeurs de capacité au champ.
L’effet de dilution des sels dans les sols argileux à cause de leur élevée capacité de rétention hydrique est automatiquement pris en considération en utilisant l’extrait en pâte saturée. C’est pourquoi que la conductivité électrique en extrait de pâte saturée peut être employée pour évaluer l’effet de la salinité du sol sur la croissance des plantes.
3.1.2. Extrait en pâte saturée La pâte saturée est préparée en imbibant d’eau distillée 150 grammes ou plus d’échantillon de sol, jusqu’à obtenir une pâte fluide et brillante atteignant le point de saturation. Cette condition est obtenue lorsque l’échantillon apparaît fluide au point que, en exerçant une pression par une spatule, il revient à sa position originale et il n’y a présence d’eau libre. La réalisation du point de saturation dépend surtout de la texture du sol, parce que les sols à texture fine ont une plus grande capacité d’emmagasinage de l’eau. La saturation obtenue, l’échantillon doit être couvert et laissé au repos pendant plusieurs heures (de 4 à 16).
Pour obtenir l’extrait, le combiné ainsi réalisé doit être posé sur un filtre dans un entonnoir de Büchner, qui est à son tour relié avec une pompe à vide capable d’extraire la solution aqueuse sur laquelle on mesure la conductivité électrique par un conductimètre et le pH. On conserve l’extrait pour effectuer les lectures des cations solubles (voir plus loin).
3.1.3. Extrait 1:5 On prépare l’extrait 1:5 lorsqu’on veut déterminer la conductivité électrique avec peu d’échantillon de sol à disposition, ou bien lorsqu’on veut que la donnée soit répétable, pour mesurer les variations dans le temps de la salinité.
La fiabilité du résultat dépend du type de sels présents : les chlorures ne sont qu’en moindre partie influencés par le teneur en humidité, tandis que, dans le cas des sulfates et des carbonates, ayant une solubilité relativement basse, la quantité apparente de sels solubles est influencée par le rapport sol/eau.
3.1.4. Pourcentage de saturation Ce pourcentage a été obtenu en faisant dessécher dans une poêle à 105° C une certaine quantité d’échantillon de pâte saturée (à peu près 10 g) selon la formule suivante:
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
33
pourcentage de saturation (SP) = [poids de l’échantillon de pâte saturée (g) – poids de l’échantillon desséché (g)] *100/poids de l’échantillon desséché (g)
3.1.5. Capacité d’échange cationique C’est la capacité de certaines composantes du sol d’absorber et de relâcher les cations dissous dans la solution aqueuse en circulation. Il s’agit donc d’une donnée de première importance pour connaître le taux de saturation basique, la fertilité potentielle et la nature des minéraux argileux présents dans un sol.
Dans l’échange ne sont pas impliquées des réactions chimiques: les molécules humiques et les minéraux argileux présentant en effet des propriétés colloïdales et des charges négatives libres, capables de retenir les cations en solution dans le fluide environnant. Les cations sont faiblement liés; ils peuvent ainsi être aisément substitués par d’autres.
Il existe deux types d’adsorption : pH-dépendante et non-pH-dépendante. La première est essentiellement à la charge des substances humiques ; elle est due à la dissociation de groupes fonctionnels acides. La deuxième est à la charge des minéraux argileux ; elle est due à des substitutions isomorphes dans le réseau cristallin.
Dans les sols agraires, en général, la CEC varie dans l’intervalle 5-50 cmol/kg Elle est évaluée selon le schéma :
faible <cmol/kg de sol
moyenne 10-20 cmol/kg de sol
élevée > 20 cmol/kg de sol.
En ce qui concerne les bases échangeables, entre les cations adsorbés il y a toujours Ca, Mg, Na et K. Dans les sols basiques, ils représentent presque la totalité des cations adsorbés et circulants. Dans les sols acides il y a surtout H+ et Al+.
Le TSB est en général corrélé au pH: à pH bas correspondent TSB bas.
Dans le cas des sols salins (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, US Salinity Laboratory, 1954), la détermination de la CEC est effectuée en saturant tout d’abord le complexe d’échange de l’échantillon par une solution de sodium acétate 1N, ensuite on traite plusieurs fois l’échantillon par éthanol pour éliminer le sodium en excédent et enfin, en utilisant une solution d’ammonium acétate 1N comme extractif, le sodium lié aux sites d’échange du complexe est substitué par le ion ammonium et porté en solution. On effectue enfin sa lecture par absorption atomique à flamme.
La CEC est calculée sur la base de la concentration du sodium extrait selon la formule suivante :
CEC (méq/100 g) = [concentration de Na (méq/l) x 10] / poids de l’échantillon (g)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
34
3.1.6. Cations échangeables Lorsqu’un échantillon de sol est trempé dans une solution saline (d’ammonium acétate, par exemple), les ions ammonium sont absorbés par le sol et une quantité égale de cations passe du sol à la solution. Ces cations sont appelés “cations échangeables”.
La connaissance de la quantité et des proportions relatives des cations d’échanges dans un sol est importante, puisqu’ils influencent considérablement d’un point de vue chimique et physique les propriétés des terrains. Les procédures analytiques pour leur détermination rencontrent des difficultés considérables dans le cas de sols salins et alcalins de régions arides et semi-arides. Des concentrations élevées de carbonates alcalino-terreux et de sels solubles, en effet, y sont souvent présentes.
Ces derniers ont une basse perméabilité aux solutions aqueuses et aux alcools. Des solutions capables de déplacer les cations échangeables du sol en solution dissolvent la plupart, sinon tous, des cations solubles et aussi des quantités significatives de carbonates de calcium et de magnésium, s’ils y sont présents.
Les sels solubles ne devraient pas être lavés du sol avant d’extraire les sels échangeables, à cause des variations qui pourraient en sortir dans le résultat, comme effet des dilutions et des hydrolyses.
Le sel d’ammonium 1N est la solution qu’on préfère utiliser, dans le cas des sols salins, comme extractif des cations échangeables et pour saturer le complexe d’échange dans la détermination de la CEC.
Pour la détermination des cations d’échange a été adopté le schéma suivant (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, US Salinity Laboratory, 1954):
• Traitement de l’échantillon de sol par excès d’acétate d’ammonium 1N et détermination par absorption atomique à flamme des cations totales exprimés en méq/100 g de sol. Cations totales (méq/100 g) = [concentration cations en extrait d’ammonium acétate (méq/l) x 10] / [poids échantillon sol (g)]
• Préparation de l’extrait en pâte saturée à partir du même échantillon de sol et analyse de l’extrait par absorption atomique à flamme pour obtenir les quantités de cations solubles exprimés en méq/100g de sol. Cations solubles (méq/100g) = [concentration cations extrait pâte saturée méq/l) x SP] / 1000
• Calcul du contenu de cations échangeables par la soustraction des solubles présents dans l’extrait en pâte saturée des totaux extraits par la solution d’ammonium acétate, selon la formule suivante: Cations échangeables (méq/100g) = cations totales (méq/100g) – cations solubles (méq/100g)
En général, dans les sols des régions arides (Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, Us Salinity Laboratory, 1954), le calcium et le magnésium sont les principaux cations présents en solution et sur le complexe d’échange. Lorsque des sels en excès s’accumulent, le sodium devient le cation le plus abondant en solution. Si la solution devient plus concentrée à la suite d’évapotranspiration ou d’absorption d’eau par les plantes, la limite de solubilité du sulfate de calcium, du carbonate de calcium et du
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
35
carbonate de magnésium est dépassé; par conséquent ces composés précipitent et la proportion relative du sodium augmente. En ces conditions, une partie du calcium et du magnésium qui étaient présents originairement sur le complexe d’échange est remplacée par le sodium.
Le calcium et le magnésium, par rapport au sodium, sont plus fortement absorbés par le complexe d’échange; à égalité de concentration de ces cations en solution, donc, le calcium et le magnésium sont présents en bien plus grandes quantités sur le complexe d’échange. En général, la moitié au moins des cations solubles doit être constituée de sodium, avant d’avoir une quantité significative de cet élément en forme échangeable. Dans les sols salins, il peut arriver qu’il y ait presque seulement du sodium en solution et qu’il soit donc le cation adsorbé dominant.
3.1.7. Cations solubles La détermination des cations solubles est utilisée pour obtenir la corrélation entre las concentration totale des cations et les autres propriétés de la solution saline, comme la conductivité électrique et la pression osmotique. La concentration relative des différents cations dans l’extrait sol-eau fournit en outre des indications sur la composition des cations échangeables dans le sol. Les cations solubles déterminés sont le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium; leurs concentrations sont fortement influencées par la teneur d’humidité alors que l’extraction a lieu. L’accroissement ou la diminution des ions par rapport à l’accroissement de l’humidité dépend de la nature de l’ion même ; en général on peut toutefois affirmer que le contenu total en sels est corrélé positivement à l’humidité. Parmi les processus responsables de cette évolution on retrouve l’échange cationique et l’hydrolyse. La détermination des cations solubles se réalise par absorption atomique à flamme, qui permet d’obtenir leur concentration dans l’extrait en pâte saturée.
3.1.8. Absorption atomique à flamme La spectrophotométrie d’absorption atomique est une technique analytique employée pour la détermination aussi bien quantitative que qualitative des ions métalliques en solution. Elle se base sur le fait que les niveaux énergétiques sont discrets; par conséquent, les transitions électroniques permises par excitation radiative (hv) sont caractéristiques pour chaque atome. Dans le cas des atomes, l’absorption d’une radiation électromagnétique par excitation à un niveau énergétique plus élevé n’a pas lieu dans une bande de fréquence, ma à une seule fréquence et longueur d’onde; chaque atome a donc son spectre d’absorption caractéristique. Pour chaque longueur d’onde, à la quelle corresponde une transition suffisamment probable, est donc possible effectuer des mesures quantitatives en appliquant la loi de Lambert-Beer. Le spectromètre d’absorption atomique utilisé pour l’analyse des cations comprend:
• Une source de radiations électromagnétique, c’est-à-dire une lampe à cathode creux (Hollow Catode Lamp, HCL), qui émet avec un spectre très étroit et caractéristique de l’élément dont la cathode même est constituée.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
36
• Un système d’atomisation à flamme, qui est le système par lequel l’échantillon en analyse est ramené à l’état de gaz monoatomique. Pendant l’atomisation, on mesure la différence d’intensité de la radiation électromagnétique avant et après le passage à travers l’échantillon atomisé qui absorbe de l’énergie par les électrodes du niveau le plus extérieur. L’échantillon est aspiré, au moyen d’un mélange de gaz, dans une chambre de prémélange où il est mêlé. Ensuite, le mélange est vaporisé et envoyé à la tête du brûleur pour être atomisé. Dans le cas des métaux alcalino-terreux on utilise des mélanges qui contiennent de l’air: la flamme atteint des températures qui vont de 1700° à 2400°C. La flamme est divisée principalement en trois régions: la zone de combustion primaire, la zone entre les cônes et le cône extérieur. Dans toutes ces régions on atteint des températures différentes et on obtient des réactions différentes. Selon la nature de l’analyse, il y a une position où le pourcentage de l’élément à l’état libre est plus élevé, allant ainsi à augmenter des facteurs comme la précision et la justesse.
• Un système optique et un monochromateur. Ce dernier c’est un système de lentilles et de miroirs pour viser, diriger et gérer la radiation provenant de la lampe et sortant de l’échantillon, et pour rendre la radiation électromagnétique la plus monochromatique possible, avant de l’envoyer au révélateur. Ce système exerce sa fonction en exploitant les principes de diffraction de la lumière.
• Le révélateur est l’organe sensoriel de l’appareil. Il s’agit d’une photoélectrode qui exploite la propriété de particules de la lumière pour mettre en évidence une radiation incidente sur une électrode au moyen d’une différence de potentiel. Les différences, toutefois, peuvent être minimes; on recourt alors à un photomultiplicateur, qui multiplie plusieurs fois le signal originaire, en permettant ainsi une interprétation meilleure (au détriment, en partie, de la justesse analytique).
• Un système d’élaboration, pour l’interprétation, le calcul et la sauvegarde des données.
3.2. La classification des sols selon le système WRBSR 2006 Sur la base des observations sur terrain et des résultats analytiques, les sols des zones d’étude on été classifiés selon le système taxonomique de référence World Reference Base for Soil Resources du 2006. L’individuation du processus pédogénétique principal et des traits pédologiques les plus caractéristiques, a permis d’attribuer le sol au premier niveau de catégorisation RSG (Reference Soil Groups), tandis que les processus pédogénétiques secondaires et les caractères intergrades avec des sols différents ont été exprimés au moyen de qualificatifs (préfixes et suffixes).
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
37
4. LA MISE AU POINT D’UNE APPROCHE CARTOGRAPHIQUE MULTIDISCIPLINAIRE
Ainsi que nous avons dit, l’objectif de l’étude était de projeter et dresser une cartographie avec des contenus convenables à fournir le support cognitif du territoire nécessaire pour la mise en œuvre et la planification de mesures de requalification et de projet dans le secteur rural.
Les conditions de travail particulières rencontrées dans la zone ont provoqué plusieurs difficultés dans le domaine de l’organisation et de la logistique: la distance de la zone d’étude, d’où l’impossibilité de multiplier les observations de terrain, le caractère fragmentaire et difficile à retrouver de la documentation bibliographique disponible, l’échelle, bien souvent trop petite, de la cartographie à notre disposition. La complexité des formes et des processus géomorphologiques relevée dans cette zone et, de plus, l’influence évidente exercée par ces processus sur la distribution des typologies pédologiques, aussi bien que l’exigence de travailler sur une base réduite d’informations et au moyen de ressources limitées, ont déconseillé d’employer des techniques de cartographie pédologique traditionnelles et ont au contraire suggéré la mise au point d’une stratégie visée à la valorisation la plus grande possible des informations disponibles de différente nature.
Une approche multidisciplinaire s’est rendue donc indispensable, pour intégrer au mieux des informations qui découlaient de plusieurs disciplines, comme la botanique, la pédologie, la climatologie, la géologie et la géomorphologie. Ces informations, pour la plupart des cas, ont été recueillies directement sur le terrain, jusqu’à établir enfin une Carte des Unités Pédomorphologiques. Au cours de la première campagne de relèvement on a observé que l’étude et la compréhension des formes et des processus géomorphologiques jouaient un rôle prédominant dans l’interprétation du paysage et des processus pédogénétiques; c’est pour cela que dans le phases successives on a attribué un poids particulier à ces facteurs.
La Carte finale, qui représente un document de synthèse, s’est avant tout basée sur l’individuation d’Unités de Terres (Land Units), définies selon l’approche de la FAO (1976). À la suite de toute une série de considérations, toutefois, on a choisi d’employer dans ce travail le terme d’Unité Pédomorphologique au lieu d’Unité de Terres, a cause du poids dominant attribué aux processus pédologiques et géomorphologiques, par rapport aux autres composantes, dans l’individuation des unités.
Une description détaillée du schéma méthodologique employé est rapportée dans les paragraphes suivants.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
38
4.1. Schéma méthodologique
Le schéma ci-dessous met en évidence les passages qui ont amené à dresser la Carte finale:
• acquisition de photos aériennes, images satellitaires, matériaux
bibliographiques et cartographie disponible ; • connaissance préliminaire du territoire grâce au relèvement pédologique et
interprétation des processus géomorphologiques au cours d’une première mission effectuée en Tunisie, en Mars 2006;
• interprétation des images à disposition et des données préliminaires, croisement des thématismes à l’aide de techniques GIS, formulation d’une première hypothèse de Carte d’Unité de Paysage;
• validation et achèvement des Unités Pédomorphologiques par une deuxième mission en Tunisie en Janvier 2007 ;
• synthèse de toutes les informations recueillies et intégration avec les résultats analytiques des sols; photointerprétation et analyse d’images satellitaires et d’orthophotos aériennes pour la délimitation définitive des Unités par les techniques de digitalisation.
ACQUISITION PHOTOS AÉRIENNES ET DONNÉES DE BASES
PREMIÈRE MISSION EN TUNISIE MARS 2006
CAMPAGNE DE RELÈVEMENT POUR REPÉRER LES PRINCIPALES UNITÉS PÉDOLOGIQUES ET GÉOMORPHOLOGIQUES
PREMIÈRES ANALYSES DE LABORATOIRE ET ÉLABORATIONS RELATIVES SUR LES
ÉCHANTILLONS PÉDOLOGIQUES
PREMIER ÉBAUCHE DE CARTE GÉOMORPHOLOGIQUE
PREMIÈRE HYPOTHÈSE DES UNITÉS PÉDOMORPHOLOGIQUES
DEUXIÈME MISSION EN TUNISIE
AFFINEMENT CARTE GÉOMORPHOLOGIQUE
• VALIDATION CARTE DES UNITÉS PÉDOMORPHOLOGIQUES
• REPÉRAGE UNITÉS PAS DÉCRITES PAR LE RELÈVEMENT PRÉCEDENT
ACQUISITION LAND COVER MAP
ULTÉRIEURES ANALYSES DE LABORATOIRE DÉTERMINATION DES SENSIBILITÉS ET DES POTENTIALITÉS DES UNITÉS
CARTE DES UNITÉS PÉDOMORPHOLOGIQUES
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
39
4.2. Acquisition des photos aériennes, des images satellitaires et de la cartographie disponible Voilà, ci-dessous, la liste du matériel acquis au cours du présent travail et employé pour les élaborations:
- Carte Topographique échelle 1:50.000 (Feuille NI-32-XV-Sd_Jbal As-Sarragivya);
- Carte Géologique 1:200.000;
- Carte d’Occupation du Sol 1:50.000, produite au cours du projet SMAP (Marini et al., inédite);
- Carte d’Occupation du Sol 1:50.000 (Carte Agricole, 1999-2004, acquise au format digitale vectoriel);
- Carte Géomorphologique 1:50.000, produite au cours du projet SMAP (N. Gasmi, inédite);
- Carte des Ressources en Sol, échelle 1:100.000 (Carte Agricole, 1999-2004, acquise au format digital vectoriel);
- Photos aériennes b/n orthorectifiées, acquises au format digital (pixel 2m, 2000-2001);
- Image Landsat ETM+ (juin 2001);
- Image ASTER (avril 2003);
- Images Quick Bird (août 2005) pour deux sous-zones carrées (5x5Km) d’intéresse ;
- Données climatiques des stations de Feriana et Kasserine.
4.3. Connaissance préliminaire du territoire
Une première expédition en Tunisie, menée en Mars 2006, a prévu une campagne de relèvement au cours de laquelle on a approfondi en parallèle les aspects pédologiques et géomorphologiques du territoire en examen.
La campagne pédologique a amené à la description, à l’ouverture et à l’échantillonnage de 40 profils, au but de caractériser du point de vue pédologique les différentes unités de paysage et d’interpréter l’évolution des sols qui se sont développés dans les différents paysages.
On a dès l’abord observé une forte incidence des processus géomorphologiques passés et actuels sur le modelage et la différenciation du paysage et une corrélation importante entre les formes morphologiques et le degré d’évolution des sols. Dans les environnements des régions arides et semi-arides, cette corrélation est renforcée par le rôle de l’érosion, qui par exemple, en agissant de manière différentielle selon la morphologie, contribue à la formation de sols ayant des épaisseurs limitées sur les versants de montagne ou de colline, et de sols plus profonds et développés, circonscrits aux surfaces morphologiquement stables, comme les dépôts alluviaux et les glacis. Étant donné ces considérations, on a
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
40
estimé opportun d’adopter un schéma d’échantillonnage basé sur les chaînes de sols, c'est-à-dire des transepts expérimentaux coupant les formes et les unités différentes. Chaque chaîne est constituée de trois profils au minimum, huit au maximum, pour un total de neuf chaînes relevées.
Pour chaque profil pédologique a été remplie une fiche de relevé, qui relate les informations relatives à la station où le creusage a été effectué, avec une référence particulière à l’unité géomorphologique d’appartenance, et toutes les informations relatives à la description du sol et à la compréhension du processus pédogénétique. Au cours de la campagne de relèvement, une première interprétation géomorphologique du paysage a été donnée, en déterminant les dynamiques principales et leur expression dans le paysage.
4.4. Première rédaction de la Carte des Unités de Paysage
L’acquisition des cartes thématiques disponibles a permis d’effectuer un travail de superposition des couches (layers) dans le but de produire une première rédaction de la Carte des Unités de Paysage.
Tout d’abord, on a effectué une nouvelle élaboration de la Carte Géomorphologique (N.Gasmi, carte à l’échelle 1:50.000, inédite) au format digital. Cette Carte comprend des éléments linéaires et ponctuels; s’est donc rendue nécessaire une phase de transformation de ces derniers en unités polygonales par digitalisation, à l’aide de photos aériennes et imagines satellitaires. Ces opérations ont été réalisées par les logiciels MapInfo 6.0 et ArcGIS 9.0. Le fichier shape contenant les Unités Géomorphologiques élaborées de nouveau a été ensuite superposé au fichier contenant les Unités d’Utilisation du Sol (échelle 1:50.000), afin d’obtenir un nouveau fichier shape contenant des informations combinés des deux précédentes cartes.
Tab. 42 Principales unités géomorphologiques et d’utilisation du sol
Unités géomorphologiques Unités d’utilisation du sol
Surface structurale Terres cultivées
G5 et G4 Corps hydriques et zones humides
G5 et G4 avec érosion hydrique Zones urbanisées
CT3 Pâturage
CT3 avec érosion hydrique Terres incultes
T2
CT3 nebkhas
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
41
À partir de 7 Unités Géomorphologiques et de 5 Unité d’Utilisation du Sol rapportées dans le tableau ci-dessus, l’opération a produit 22 nouvelles Unités, après l’élimination des unités dont la surface était inférieure à la plus petite unité cartographiable, qui, à l’échelle 1:50.000, corresponde à 62.555 m2. On a puis calculé un nombre théorique de profils pédologiques et d’observations expéditives à effectuer en chaque unité de paysage sur la base de la surface occupée par la même et sur la base de l’hétérogénéité évaluée au cours des observations de terrain, afin d’avoir une bonne représentativité des types pédologiques à l’échelle 1:50.000.
4.5. Vérification de terrain de la Carte des Unités de Paysage et implémentation des données Dans la période Janvier – Février 2007, une deuxième campagne de relèvement a été effectuée, au but de valider la Carte des Unités de Paysage par deux phases essentielles. La première a concerné une vérification à terre des délimitations territoriales envisagées, un approfondissement ultérieur sur les principaux domaines géomorphologiques et leurs interconnexions avec les processus de formation des sols, par des observations expéditives visées, conduites dans la plupart de la zone d’étude. La deuxième phase du travail a abouti à l’ouverture, à la description et à l’échantillonnage de 20 ultérieurs profils pédologiques, accompagnés souvent d’observations expéditives effectuées par sonde ou grâce à des talus ou creusages artificiels, pour vérifier la variabilité spatiale des sols selon les caractères morphologiques. On a obtenu en parallèle un travail d’affinement de la Carte Géomorphologique.
Sur la base du tableau complet des caractères pédologiques et géomorphologiques de la zone d’étude, intégrés par les résultats analytiques obtenus et sur la base des informations tirées de la Carte d’Occupation du Sol à l’échelle 1:50. 000, on a procédé à la rédaction finale de la Carte des Unités Pédomorphologiques. A ce but on a utilisé les images satellitaires ASTER, Quick Bird et les orthophotos qui, avec la carte topographique de base (1:50.000), on servi de support au tracé des limites des Unités, digitalisés par ArcGIS 9.0).
5. LA CARTE DES UNITÉS PÉDOMORPHOLOGIQUES
La structure hiérarchique de la légende de la Carte comprend 9 unité de premier niveau, 13 de deuxième niveau et des différenciations ultérieurs de troisième niveau, qui toutefois ne sont pas représentées graphiquement, mais seulement décrites. Appartiennes à la première catégorie:
1 Affleurements rocheux 2 Pédiments 3 Surfaces de transition entre les pédiments et les terrasses alluviales 4 Zone sujette à salinisation et idromorphie 5 Zone de sédimentation éolienne 6 Zone d’endoréisme ancien avec des dunes fossiles 7 Lit et berges fluviales de l’Oued Saboun 8 Lit et berges fluviales de l’Oued Safsaf
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
42
Les critères pour la détermination des unités de premier niveau se sont basés essentiellement sur le repérage des formes produites par des processus géomorphologiques anciens et actuels dans la zone étudiée, aboutissant à la différentiation du paysage et se répercutant sur la diversification des sols. Souvent les processus géomorphologiques strictement corrélés à la pédogénèse jouent un rôle essentiel en ce sens et, par conséquent, les unités coïncident souvent avec les différents niveaux géomorphologiques (voir le paragraphe 1.2.1.2) des formes présentes dans la région : c’est le cas des unités n. 1, 2, 3, 7, 8 et 9. Dans les autres cas, au contraire, le niveau géomorphologique est d’une importance secondaire. L’influence la plus grande sur l’évolution du paysage et des sols est due aux dynamiques à caractère locale ou stationnelle: le transport/déposition ou érosion éolique, les processus d’hydromorphie et de salinisation.
L’utilisation du sol est souvent liée aux différentes formes du paysage et présente une certaine homogénéité en correspondance de niveaux géomorphologiques déterminés (voir le paragraphe 1.2.1.2.). Elle a donc renforcé, en ces cas, le tracé des unités (1, 2 et 7). En d’autres unités au contraire (par exemple, 3, 5 et 6), le caractère fragmentaire de l’utilisation du sol est le reflet de la particulière complexité et hétérogénéité du paysage; elle s’est donc montrée un facteur important pour faire des distinctions du deuxième et aussi du troisième niveau.
Pour la détermination des unités du deuxième niveau, on n’a pas suivi des critères communs, mais plutôt spécifiques pour chaque cas, au but de repérer des zones les plus homogènes possible, surtout du point de vue des dynamiques pédogéniques, en repérant les différences possibles entre les facteurs qui peuvent conditionner la pédogénèse et, par conséquent, le climat, l’érosion, la végétation, la morphologie, le temps et enfin les dynamiques érosives.
L’unité 1, par exemple, a été divisée sur la base de la lithologie, la 3 sur la base de la différente morphologie et donc de la différente action de l’érosion hydrique/éolienne, l’unité 5 sur la base des processus d’accumulation (passés ou encore en cours) et enfin la 7 sur la base de la dynamique de déposition dominante.
Comme déjà dit, on a fait des subdivisions ultérieures de troisième niveau dans les unités caractérisées par une hétérogénéité élevée et qui montrent une variabilité élevée du paysage et des différences de sols à leur intérieur. Ces différences, souvent liées à la morphologie, seront décrites au-dedans de chaque unité.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
43
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
44
5.1. Les unités pédomorphologiques Dans les paragraphes suivants on décrira les 9 Unités principales et les éventuelles subdivisions en sous-unités et en différenciations de troisième niveau. Le fichier de description de chaque unité prévoit: - Représentation photographique du paysage caractéristique; - Description générale de l’unité; - Indication des profils pédologiques type; - Subdivision en sous-unités; - Fichier descriptif du Profil pédologique type et des autres profils caractérisant l’unité; - Tableau rapportant quelques paramètres analytiques des sols; - Classification taxonomique (WRBSR 2006); - Considérations pédologiques. On a attribué à chaque unité un ou plus profils pédologiques type, une ou plus chaînes de sols, choisis parmi ceux qui sont décrits dans l’unité, en tant qu’estimés les plus représentatifs des processus pédogénétiques en cours et des typologies présentes. Les unités et les sous-unités estimées les plus homogènes du point de vue pédologique ont un seul profil de référence; les plus hétérogènes et complexes à leur intérieur ont plusieurs profils ou chaînes de référence, mieux exprimant leur variabilité spatiale. La localisation de tous les profils relevés dans la zone d’étude est rapportée dans l’image ci-dessous.
Fig. 18-1 Carte topographique à échelle réelle 1 :50.000 avec localisation des profils pédologiques et observations expéditives
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
45
5.1.1. Unité 1: Affleurements rocheux
Fig. 18-2 Paysage typique de la sous-unité 1 (Reliefs sur le fond).
Localisation de l’unité: la sous-unité 1 (faciès calcaire) est la plus représentée dans la zone d’étude et peut être observée dans la figure ci-dessus. Elle s’étend en direction sud-ouest nord-est, dans le secteur septentrional de la carte et corresponde au relief Goubel. La sous-unité 2 (faciès gréseuse) se trouve au contraire en position centre-orientale (aux alentours de la localité As-Skhirat as-Souda). Son paysage typique est visible dans l’image ci-dessous.
Fig. 18-3 Paysage typique de la sous-unité 2
Extension de l’unité: environ 3.490 ha. Altitude: 800-1170 m au-dessus du niveau de la mer.
Pente: d’élevée à modérée. Utilisation du sol: dans le secteur le plus occidental de la sous-unité 1, la couverture végétale est encore très sporadique, avec dominance de roche nue. En se déplaçant vers ouest, augmentent les surfaces occupées par le pâturage plus ou moins rare, où domine Stipa tenacissima; dans les endroits où le pâturage est en état de plus grande détérioration, Stipa t. laisse place à Artemisia herba alba. La sous-unité 2 est caractérisée par un végétation naturelle rare à dominance de Astragalus armatus.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
46
Substrat: la sous-unité 1 est constituée de matériau du Crétacé (Campanien-Maastrichtien); affleurements calcaires et présence de nodules de silex (comme on peut observer à la Fig. 18-4). La deuxième sous-unité, au contraire, est caractérisée par matériau sédimentaire déposé en milieu continental deltaïque-fluvial, donc plus récente (Miocène moyen): en particulier, grès à stratification croisée (Fig. 18-5).
Fig. 18-4 Faciès calcaire Fig. 18-5 Faciès gréseuse
Géomorphologie: la sous-unité 1 correspond à la forme structurale anticlinale (par. 1.2.1.2), tandis que la sous-unité 2 est une forme résiduelle d’érosion sélective.
Description générale: l’unité comprend des zones où dominent les affleurements rocheux, comme spécifié plus haut. Les sols sont toujours minces et riches en carbonate de calcium (en général Leptosols) et la couverture végétale est faible, type pâturage naturel, dominée par Stipa tenacissima dans le premier cas et par Astragalus armatus dans le deuxième. Dans la sous-unité 2, se trouvent en surface nombreux restes de bois fossile (Tamarix et Retamas), témoignant de conditions climatiques différentes des actuelles.
Sous-unités:
- 1 Faciès calcaire
- 2 Faciès gréseuse
Profil type: P 23
Autres profils: –
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
47
Profil type P 23
Localité As Sawwặ
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage)) 32S445626-3855868
Altitude 825 m s.n.m.
Pente 10- 30 %
Exposition 20° N
Pierrosité environ 5%
Rochosité 2-5% (affleurements éloignés de moins de 10 m)
Utilisation du sol pâturage naturel ; présence d’individus isolés de Stipa tenacissima
Substrat dépôts colluviaux sur calcaires cristallins crétacés
Morphologie partie basse du versant (monoclinal à sud de la zone d’étude)
Drainage extérieure bon
Érosion hydrique diffuse et modérée,
hydrique canalisée faible
Notes et observations
Dans la zone est présente une carrière de calcaire. Pente > 30% en plusieurs endroits du versant. Processus de décarbonatation et apport de matériau colluvial d’en haut.
Couverture de graviers et de cailloux en surface jusqu’à 80%.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
48
Description du Profil
Horizon A1: 0 à 24 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 5/3, brun. Texture limono-argileuse. Squelette: environ 30-40% en volume, avec des éléments fins et quelques éléments de dimension moyenne, faiblement arrondis. Agrégation polyédrique subangulaire, moyenne, modérée, peu forte. Porosité commune avec des pores très petits et quelques éléments petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses ou même absentes, petites, à trajectoire oblique ou verticale. Activité biologique limitée. Limite avec l’horizon sous-jacent, abrupte et linéaire.
Horizon R: de 24 à 100 cm et plus. Calcaires cristallins du Crétacé.
Analyse de laboratoire
Horizon prof (cm) pH H2O pH KCl CaCO3 (g/kg) C.O. (g/Kg) S.O. (g/Kg)
A 24 7,9 7,7 399 24,60 42,40
Horizon SG (g/kg) SF (g/kg) LG (g/kg) LF (g/kg) A (g/kg) Classe USDA
A 195 210 115 300 180 F
Classification : Rendzic Leptosol (WRB, 2006)
Considérations pédologiques :
Les sols caractérisant l’unité sont en générale très minces, d’une épaisseur souvent inférieure à 25 cm; ils rentrent ainsi dans le groupe des Leptosols selon WRBSR 2006. Cette unité, en fait, est dominée par des affleurements rocheux, pentes élevées et phénomènes d’érosion de type hydrique diffus sur le relief Goubel. La sous-unité 2, au contraire, est plus exposée à l’érosion éolienne. Dans les endroits les plus basses des versants, se trouvent des sols d’une épaisseur un peu plus grande, à cause des processus de transport hydrique et d’accumulation de matériau colluvial provenant des parties les plus hautes du versant.
Le profil décrit ci-dessus appartient à la chaîne 5, située à sud de la zone d’étude, à peine sous la limite, sur le versant moyen-haut d’une structure monoclinale constituée de calcaire du Crétacé. On peut comparer cette unité à la sous-unité 1.
Le matériau fin qui constitue ce sol a été affecté par des processus de décarbonatation et a incorporé du matériau colluvial venant des parties plus hautes du versant.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
49
Il s’agit d’un sol peu profond, avec une teneur plus élevée de carbonate de calcium (environ 40%), pH faiblement alcalin, riche en squelette et avec une teneur en substance organique particulièrement élevée (4% environ) par rapport aux valeurs rencontrés dans les autres sols dans la zone d’étude.
La sous-unité 2 présente elle aussi des sols minces et peu développés, quoique les pentes soient faibles, à cause probablement des processus d’érosion éolienne ne favorisant pas la pédogénèse.
Les Leptosols, qui semblent représenter cette unité du point de vue pédologique, pourraient constituer une ressource potentielle pour le pâturage et pour des utilisations forestières pendant la saison pluvieuse. L’érosion constitue la menace la plus importante pour ces sols, surtout dans le cas où ils soient soumis à des fortes pressions, par exemple à surpâturage. Leur utilisation pour des buts agricoles pourrait donner quelques résultats positifs où les pentes sont réduites, même si le risque d’érosion reste élevé. Sur les versants à plus forte pente, au contraire, des œuvres d’étagement et d’épierrage (avec une utilisation éventuelle des pierres pour la construction des terrasses) sont nécessaires avant la mise en culture. L’excessif drainage intérieur et la minceur de la plupart de ces sols peuvent exacerber l’aridité, aussi en environnements relativement humides.
5.1.2. Unité 2: Glacis (Pédiments)
Localisation de l’unité: l’unité est distribuée surtout dans le secteur septentrional de la zone d’étude. Les langues de glacis du 4° et 5° niveau qui appartiennent à cette unité s’étendent à partir de l’alignement des reliefs compris entre Jbal As Saf Saf et Jbal Goubel, selon une direction prévalente NO-SE. Elles occupent parfois des positions isolées aussi dans la partie centrale de la zone d’étude et en correspondance de la structure monoclinale à sud.
Extension de l’unité: 2110 ha environ.
Altitude: 850-920 m s.n.m. Pente: les sommets des glacis sont plats, avec une pente inférieure au 2%; les versants, au contraire, ont des pentes modérées.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
50
Utilisation du sol: l’unité est dominée par le pâturage naturel à base de Stipa tenacissima et Astragalus armatus; dans la plupart des cas, il s’agit d’une couverture rare mélangée à une couverture de cailloux calcaires, avec des évidences de thermo et crio-clastisme, à un différent niveau d’arrondissement et d’altération.
Substrat: à la base est présent du matériau du Néogéne (formation Beglia, avec des stratifications d’argiles vertes et sables, et formation Segui, avec argiles rouges) sur lequel reposent des dépôts d’épaisseur variable de matériau plus récent (Quaternaire) d’origine alluviale et colluviale (de nature calcaire) provenant des structures montagneuses.
Géomorfologie: l’unité est caractérisée par les Glacis du 4° et 5° niveau (G5 et G4) dont la formation est liée à l’action hydrique dans les phases pluviales du Quaternaire. G5 est plus ancien (Pléistocène inférieur) et plus élevé en hauteur; G4 moins élevé en hauteur et plus récent (Pléistocène moyen). Ces formes sont caractérisées par la présence de croûte calcaire sous l’épaisseur de couverture.
Description générale: l’unité est caractérisée par la forme G5, plus érodée et moins diffuse dans la zone d’étude, et la forme G4, plus conservée par rapport à l’érosion et par conséquent plus facilement observable dans la zone d’étude sous forme de langues allongées sur des centaines de mètres vers SE. L’unité comprend soit les sommets plats des glacis, caractérisés par la couverture de cailloux calcaires et silexifères en surface, avec des évidences de thermo et crio-clastisme, que les versants raides transversaux et longitudinaux. Les formes décrites représentent les niveaux les plus élevés dans la zone d’étude, après l’anticlinale; elles sont donc intéressées par intenses phénomènes d’érosion éolienne. Ces surfaces sont généralement occupés par une végétation naturelle utilisée pour le pâturage. Il faut noter que la portion plus orientale de l’unité, c’est-à-dire la partie du relief Goubel comprise entre le lit de l’Oued Dourivya et le lit de l’Oued Saboun, présente fortes évidences d’érosion hydrique, sous forme d’érosion canalisée.
Sous-unités: –
Profil type: P27 Autres profils: P16, P2
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
51
Profil type: P.27
Localité Argout al Fakka
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S439761-3850054
Altitude 715 m sur le niveau de la mer
Pente < 1%
Exposition 235° N
Pierrosité 0.01%
Rochosité absente
Utilisation du sol pâturage avec des individus isolés de Stipa tenacissima
Substrat dépôts d’argiles et sables sur dépôts du Néogène
Morphologie sommet plat d’une surface du niveau 5
Drainage extérieure Bon
Érosion éolienne, diffusée et modérée
Notes et observations La couverture de graviers et de cailloux en surface varie entre 15-20 %. Dans Ck(m) la cimentation des sables est discontinue
Description du profil: Horizon A1: 0 à 18 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 6/6, jaune brunâtre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette: environ 50% en volume avec des éléments fins et arrondis. Structure: de lamellaire moyenne et faible dans les premiers 2 cm à polyédrique subangulaire, moyenne, modérée, friable dans les cm suivants. Porosité faible avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines: d’abondantes à
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
52
communes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon Ckm: 18 à 38 cm. Couleur à l’état sec, blanc. Structure massive, forte. Cimentation pour hydrates de carbone, litoïde. Il n’est pas pénétré par les apparats radicales. Limite avec l’horizon sous-jacent, abrupte et linéaire.
Horizon C2: 38 à 65 cm. Sables. Couleur à l’état sec 10 YR 7/3 brun très clair. Texture au toucher sableuse. Squelette: < 1% en volume avec des éléments fins et arrondis. Structure friable. Concrétions carbonatiques: environ 10% en volume, sous forme de fin pseudomycélium associé à quelques nodules au diamètre inférieure à 0,5 cm. Effervescence considérable. Racines et activité biologique absentes. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon C3: 65 à 73 cm. Squelette: environ 80 % en volume avec des éléments fins arrondis et quelques éléments de dimensions moyennes (graviers grossiers). Structure: friable. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire. Observations: horizon graveleux.
Horizon C4: 73 à 106 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 7/5, entre le brun très clair et le jaune. Squelette <1 % en volume avec des éléments fins et arrondis. Structure : friable. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire. Observations: horizon sableux.
Horizon Ck(m): 106 à 116 cm. Sables avec cimentation par carbonate de calcium discontinue. Couleur à l’état sec, blanc. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon C6: 116 à 200 cm et plus. Sables grossières. Couleur à l’état sec 7,5 YR 7/6 jaune rougeâtre. Structure friable.
Analyse de laboratoire:
Horizon Prof. (cm)CEes
(dS/m) C.O.
(g/Kg)S.O.
(g/Kg)pH
H2OpH
KClCaCO3
(g/kg)CSC
(méq/100g)
A 0-18 0,5 7,30 12,60 8,2 7,7 142 6,98
C2 38-65 5,2 2,60 4,50 8,2 8,2 143 2,73
C4 73-106 x x 8 8,2 117 2,18
C6 116-200 x x 8,7 8,4 64 0,66
Horizon SK (g/kg) SG (g/Kg) SM (g/Kg) SF (g/Kg) SMF (g/Kg) L(g/Kg) A (g/Kg) Tex USDA
A 292 20 22 57 729 122 50 SF
C2 312 157 172 161 387 73 50 S/SF
C4 168 174 292 195 266 25 48 S
C6 60 150 307 287 199 20 37 S
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
53
Classification : Epipetric hypocalcic Calcisol (Aridic) (WRB, 2006)
Autres profils: P16, P2
P16 P2
Localité: Awlad Sidi Rabish Garit Kribish
Référence cartographique: Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage): 32S439583- 3859230 32S441717-3866682
Altitude : 837 m s.l.m. 905 m sur le niveau de la mer
Pente: < 1 % < 1 %
Exposition: 270° N totale
Pierrosité: < 0.1% < 0,01%
Rochosité: absente absente
Utilisation du sol: quelques individus isolés de Stipa tenacissima et d’Astragalus armatus
pâturage naturel, quelques individus isolés de Stipa tenacissima et d’Astragalus armatus
Substrat: dépôts éoliens sur dépôts d’argiles du Néogène
paquet de cailloux et graviers en prévalence calcaires, cémentés par sables, limon et argiles
Morphologie: partie sommitale du G4 partie sommitale du G5
Drainage extérieur: bon Bon
Érosion: éolienne, diffuse et modérée éolienne, diffusée, forte
Horizontation: A-Bk(m)-Bk2-C A-C
Classification: Petric Hypercalcic Calcisol (WRB, 2006) Hyperskeletic Leptosol (WRB, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
54
Analyses de laboratoire :
Horizon Prof.
(cm)
pH
H2OpH
KCl CaCO3
(g/kg) SK
(g/kg)SG
(g/Kg)
SM
(g/Kg)
SF
(g/Kg)
SMF
(g/Kg)
L
(g/Kg)
A
(g/Kg)
Classe
USDA
C.O.
(g/Kg)
S.O.
(g/Kg)
A 18 8,3 8 135 167 39 113 266 400 80 102 SF 6,50 11,20
Bk(m) 38 8,1 8,2 733 602 39 43 104 661 120 33 SF
Bk2 170 7,6 7,8 507
A 15 8 7,7 455 18,50 31,90
Horiz. CEes
(dS/m)
SP (%) Sali (%) Na+ sol
(méq/100g)
Ca2+ sol
(méq/100g)
Mg2+ sol
(méq/100g)
K+ sol
(méq/100g)
A 5,2 55,92 1,86 1,22 0,42 0,15 0,01
Considérations pédologiques :
Les profils localisés sur le sommet du G5 montrent des sols relativement minces, sous une couverture de cailloux de calcaire constituant souvent le 100% de la couverture superficielle. Cette couverture sert de protection à l’égard de l’érosion éolienne, particulièrement forte en ces zones. Sous peu de cm de sol, on rencontre souvent un horizon pétrocalcique; c’est le cas du profil P16.
Sur le sommet du G4, les cailloux sont plus arrondis par rapport à ceux du sommet du G5, parce que, provenant souvent de ce dernier niveau, ils ont subi un double arrondissement. Les sols observés présentent des épaisseurs de 150 cm environ, des horizons calciques, des élevées teneures en concrétions secondaires de CaCO3 (souvent 60 % environ) et une considérable effervescence à HCl. Le front de calcification est très superficiel à cause de l’aridité climatique ; fréquente est la présence d’horizons durcis par l’action de cimentation exercée par le carbonate de calcium, qui agit en cimentant aussi la squelette à l’intérieur du profil. Ce dernier est constitué de calcaire et de nodules de silex dans une quantité variable entre 10 et 30 % en volume. La couleur des sols est brun en surface, mais elle s’éclaircit et devient rose clair en descendant en profondeur, à cause de l’augmentation de la teneur en carbonate de calcium. Les résultats analytiques mêmes mettent en évidence une augmentation du carbonate de calcium grâce à la profondeur. Son contenu atteint des valeurs jusqu’à 70% environ dans les horizons calciques.
En particulier, on a ouvert la chaîne de sols n. 7 pour décrire éventuelles corrélations entre les niveaux géomorphologiques d’âges différents et les sols qui se sont développés au-dessus d’eux. Cette chaîne est constituée de sept profils pédologiques (P27-P33) avec orientation NE-SO, localisés sur différents niveaux morphologiques. Parmi les profils observés, appartiennent à cette unité: le P27, qui se trouve sur le sommet du G5 en position de relief en rapport aux autres profils (à l’hauteur de 808 m s.n.m); le P28, ouvert en correspondance du passage entre G5 et G4 (hauteur 802 m s.n.m) et le P29 sur G4 (hauteur 795 m s.n.m).
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
55
De l’observation du P27, une alternance apparaît de matériau de déposition fluvial et de matériau éolien dans les horizons plus profonds, tandis qu’on trouve a en surface un horizon calcique tendant au pétrocalcique (dont l’origine remonte aux périodes de plus grande aridité). L’horizontation est du type: A-Ckm-C2-C3-C4-Ck(m).
Le profil 28 reflète les caractéristiques intermédiaires entre les deux niveaux géomorphologiques G5 et G4 et par conséquent entre le P27 et le P29. Le G5 est caractérisé par du matériau plus grossier. On peut envisager qu’il se soit formé par déposition fluviale dans une phase à haute turbulence, suivie d’un long processus d’érosion. Le G4, au contraire, provient probablement d’une phase de déposition fluviale à basse énergie; à la base du profil, en effet, on peut voir du matériau alluvial plus fin, sur lequel repose une couche de matériau éolien fin, déposé par la suite. Dans le cas examiné, sur le sommet du G4 est présent du matériau plus grossier provenant du G5 par gravité. Le raccordement entre le deux niveaux, en effet, est très troublé par la gravité.
Le sol montre une horizontation du type: A-A/Bk-Ckm, développé sur un autre sol 2Btk. En ce dernier horizon, sont visibles des revêtements d’argiles sur les faces des agrégats et dans les pores, témoignant d’un certain degré évolutif de l’horizon.
Le P29 présente au contraire l’horizontation suivante: A-Btk-Btkx-Btk2-C. À la profondeur de 280 cm, le substrat rocheux n’a pas été atteint. Il s’agit donc d’un sol profond et bien développé, avec présence de pellicules d’argile, indice de processus d’illuviation, et avec présence de nombreuses concrétions de carbonate de calcium le long de tout le profil. En particulier, à la profondeur 50 à 160 cm on a relevé un horizon fortement cimenté nommé duripan. Cet horizon, pour se former, a besoin de pressions très élevées et de temps très longs. On envisage donc d’être en présence d’un paléosol formé probablement sous conditions climatiques différentes des actuelles, avec une plus grande disponibilité hydrique pour permettre l’illuviation de l’argile dans les horizons de profondeur.
Fig. 518-6 Couverture de cailloux calcaires des glacis.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
56
Les sols caractérisant principalement cette unité sont les Calcisols et les Leptosols, distribués en général sur les surfaces du 5° niveau, et les Calcic Luvisols, qu’on rencontre souvent sur les glacis du 4° niveau.
Les Calcisols sont souvent utilisés pour le pâturage extensif; leur utilisation à buts agricoles, en effet, est fréquemment limitée par la difficulté de labour à cause de l’élevée pierrosité superficielle, souvent associée à ces sols, ou bien par la présence d’un horizon pétrocalcique sous-superficiel. Les cultures en effet, afin d’obtenir un bon rendement, ont besoin de pratiques irriguées, à moins qu’on ne veuille utiliser des cultures supportant l’aridité, comme les tournesols.
Les Luvisols, au contraire, sont en général des sols fertiles et convenables à une vaste gamme d’utilisations agricoles. Au cas où ils aient une élevée teneur en limon, toutefois, ils sont sujets à la détérioration de la structure s’ils sont travaillés humides ou avec des moyens lourds. Quant aux versants en pente, ils nécessitent d’interventions de contrôle de l’érosion. Les Luvisols avec préfixe chromic, calcic ou vertic sont communs sur dépôts colluviaux, formés souvent à la suite de l’altération du calcaire.
5.1.3. Unité 3: Surface de transition entre pédiments et terrasses alluviales
Localisation des unités: l’unité comprend surtout vastes surfaces du secteur centre-septentrional de la zone d’étude, mais aussi quelques portions de territoire à sud, en correspondance du glacis.
Extension de l’unité: environ 8.250 ha.
Altitude: 720-850 m s.n.m
Pente: modérée à faible.
Utilisation du sol: L’unité, très étendue, présente une grande hétérogénéité à son intérieur, se reflétant dans une certaine fragmentation de l’utilisation du sol. Les cultures à céréales sont les plus répandues en correspondance aux endroits déprimés. Les versants et les dos
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
57
sont occupés par la végétation naturelle utilisée pour le pâturage ou, plus souvent, sont par des plantations d’Opuntia ficus indica ou d’autres espèces d’arbres.
Substrat: Matériaux du Néogène (formation Beglia, avec des stratifications d’argiles vertes et sables) avec des couvertures de matériaux plus récents (Quaternaire) d’une épaisseur variable, hétérométrique, dominé par les sables et les argiles.
Géomorphologie: dans cette unité les formes du niveau 3 sont dominantes (âge probable, Pléistocène supérieur) ou bien des formes de transition glacis-cône ou glacis-terrasse. Elles sont recouvertes de dépôts alluviaux, relativement mobiles; par conséquent, la croûte calcaire affleure seulement en certains endroits limités et en manière généralement très discontinue. Cependant, les formes du 4° et du 2° niveau sont aussi bien présentes.
Description générale: cette unité est l’une des plus représentatives et étendues dans la zone d’étude et, sous l’aspect morphologique, présente une grande variabilité pédologique et d’utilisation du sol. Elle est caractérisée par des environnements de colline, avec des surfaces ondulées et une alternance de dos et dépressions. Les surfaces de l’unité raccordant les reliefs les plus élevés avec les plateaux voisins présentent des pentes modérées et sont utilisées surtout pour le pâturage, avec des utilisations agricoles sporadiques. Les surfaces étendues occupant les positions plus déprimés et plates sont intéressées par la céréaliculture et profitent souvent de situations de talweg qui viennent se créer, et de la présence de sols plus profonds.
Des phénomènes intenses d’érosion hydrique qui portent à la formation de ravins (gullies) actifs, d’amples dimensions, intéressent le secteur méridional de la zone d’étude, correspondant à la sous-unité 2.
Sous-unité:
• 1 Morphologie ondulée • 2 Pentes régulières, allongées, avec érosion en ravins (gully) • 3 Zone avec prévalence de croûte calcaire continue ou subaffleurante • 4 Zone sujette à intense érosion éolienne
Profil type: P18 et P15 (sous-unité 1) P30 (sous-unité 2) P43 (sous-unité 3)
Autres profils P19, 21, 4, 5, 7, 8 (sous-unité 1) P29 (sous-unité 2)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
58
5.1.3.1. Sous-unité 1. Morphologie ondulée
Description générale: il s’agit de la sous-unité la plus étendue en surface. Sous l’aspect morphologique, elle se développe sur les formes de transition du 3e niveau cône-terrasse et glacis-terrasse, qui s’intercalent à celles du 4° et du 2° niveau. La morphologie est ondulée, avec alternances de dos et de dépressions qui correspondent à une différente utilisation du sol. En général, sur le dos la végétation est naturelle, constituée de pâturage continu, mais on a souvent effectué des interventions de plantations de Opuntia f. i., au but de fixer le terrain pour en réduire la perte à la suite de l’érosion et stabiliser ainsi les versants. Des expériences précédentes ont en effet montré une bonne réussite de ces plantations sur les versants en pente en milieux semblables. En correspondance aux dépressions, généralement, les sols, plus profonds et développés, on été mis en culture avec des céréales, orge surtout. En général on prépare des tabias, c’est-à-dire des terre-pleins en terre, qui servent de barrière contre l’érosion et retiennent l’eau pour favoriser les cultures, qui en effet sont effectuées en amont de ces terre-pleins.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
59
Profil type : P18, représentatif du milieu de dos
Localité Awlad Sidi Rabish
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S439412-3859278
Altitude 835 m s.n.m.
Pente 2 - 6 %
Exposition 260° N
Pierrosité < 0,1%
Rochosité Absente
Utilisation du sol pâturage sur Stipa tenacissima et Astragalus armatus
Substrat dépôts éoliens sur dépôts du Néogène
Morphologie partie moyenne-haute du versant, sur surface du 3e niveau
Drainage extérieur Bon
Erosion hydrique et éolienne, diffuse et faible
Notes et observations
le profil a été décrit sur la surface de raccordement entre deux terrasses. La couverture de graviers et cailloux polygéniques intéresse jusqu’à 40-50% de la surface. Dans l’horizon C sont été observées des microstructures morphologiques héritées. Petites incisions et discontinuités dans la succession entre différents niveaux de graviers de petites dimensions.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
60
Description du profil: Horizon A : 0 à 8 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre humide et sec 10 YR 6/3, brun clair. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette : <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure : de lamellaire, moyenne, faible, friable (humide). Porosité faible avec des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines rares, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec le sous-jacent horizon abrupte et linéaire.
Horizon Cy : 8 à 110 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre humide et sec 10 YR 6/4 brun jaunâtre clair. Texture au toucher sableuse. Squelette < 1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique et subangulaire, de moyenne à grossière, modérée, friable. Concrétions carbonatiques: environ 5% en volume, tant comme pseudomycelium que comme nodules au diamètre inférieure à 1-1,5 %, durs, au contour net. Porosité absente. Effervescence considérable. Drainage normal. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon C2 : 110 à 140 cm. Couleur à l’état humide 10 YR 3/1,5 intermédiaire entre gris très foncé et brun grisâtre très foncé. Texture au toucher sableuse. Squelette < 5% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique subangulaire tendant à l’angulaire, grossière, forte, résistante. Concrétions carbonatiques environ 5% en volume, sous forme des nodules au diamètre inférieur à 1 cm, tendres et dures, au contour net. Porosité absente. Effervescence considérable. Drainage de normal à rapide. Racines et activité biologique absentes. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon C3 : au-delà de 140 cm, argiles vertes du Néogène.
Analyses de laboratoire :
Horiz. prof. (cm) pH H2O pH KCl CaCO3 (g/kg) C.O. (g/Kg) S.O. (g/Kg)
A 8 8,5 8,1 129 5,20 9,00
Cy 110 8,8 8,5 117 1,20 2,10
C2 140 8,9 8,8 84 2,80 4,80
Horiz. SG (g/kg) SF (g/kg) LG (g/kg) LF (g/kg) A (g/kg) Classe USDA
A 783 92 25 50 50 S
Cy 847 43 15 50 45 S
C2 881 39 10 35 35 S
Classification :
Haplic Arenosol (Gypsiric, Eutric) (WRB, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
61
Profil type: P15 représentatif des environnements de dépression
Localité Sidi al Borji
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S440097- 3863200
Altitude 865 m s.n.m
Pente < 0,1 %
Exposition Totale
Pierrosité absente
Rochosité absente
Utilisation du sol cultures en orge
Substrat dépôts alluviaux et éoliens
Morphologie plateau au pied du relief
Drainage extérieur bon
Érosion hydrique et éolienne, diffuse et faible
Notes et observations
Notes et observations : Le profil a été ouvert au bord du champ. Le plateau, qui a une faible pente en direction est, est interrompu par une succession de tabias hautes environ 150-180 cm. L’horizon A1 pourrait être un précédent Ap couvert de dépôts alluviaux et/ou éoliens actuels.
Description du profil Horizon Ap : 0 à 15 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 5/5, brun jaunâtre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette < 5% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure de lamellaire fine et faible à polyédrique subangulaire, grossière, forte, dure. Porosité de commune à faible avec des petits pores. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
62
Horizon A1 : 15 à 30 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre sec et humide 10 YR 5/6, brun jaunâtre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique subangulaire, grossière, modérée, friable à dure. Porosité de commune à faible avec des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon Bt1 : 30 à 75 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre sec et humide 7,5 YR 4/6, brun fort. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette < 1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements en argiles abondantes, sur les agrégats, dans les pores et sur les grains de sable. Structure polyédrique angulaire, grossière, forte, résistante. Porosité faible avec des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines et activité biologique absentes. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Horizon Bt2 : 75 à 125 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre sec et humide 7,5 YR 4/4, entre brun et brun sombre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette < 1 % en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements d’argiles abondants, sur les agrégats, dans les pores et sur les grains de sable. Structure polyédrique angulaire, grossière, forte, très résistante. Porosité faible pour des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines et activité biologique absentes. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 2Btk : 125 à 170 cm et plus. Couleur à l’état sec 10 YR 6/6 jaune brunâtre. Squelette : < 1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements d’argiles abondantes, sur les agrégats, dans les pores. Structure polyédrique angulaire, grossière, forte, résistante. Concrétions carbonatiques environ 15-20% en volume, sous forme de nodules, durs, au contour net, d’environ 3-4 mm de diamètre. Porosité faible avec des pores très petits. Effervescence considérable. Drainage normal. Racines et activité biologique absentes.
Analyses de laboratoire :
Horiz. Prof. (cm) pH H2O pH KCl CaCO3 (g/kg) C.O. (g/kg) S.O. (g/kg)
Ap 0-15 8,4 7,5 162 7,40 12,80
A2 16-30 8,3 7,5 175 6,40 11,00
Bt 31-75 8,3 7,5 168 3,40 5,90
Bt2 76-125 8,1 7,7 71 1,60 2,80
2Btk 76-170 8,3 7,8 214 2,20 3,80
Horiz. SK (g/kg) SG (g/Kg) SM (g/Kg) SF (g/Kg) SMF (g/Kg) L(g/Kg) A (g/Kg) Classe USDA
Ap 9 26 85 183 176 290 240 F
A2 7 31 88 179 219 248 235 FSA
Bt 254 128x 44 39x 275 260 FSA
Bt2 285 142x 50 38x 185 300 FSA
2Btk 431 215 60 49x 70 175 FS
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
63
Classification définitive : Cutanic Luvisols (Hypereutric) (WRB, 2006)
Autres profils de la sous-unité : P19, P20, P21, P22 (Chaîne 4) représentatifs des environnements des dépressions
P19 P21
Localité: Awlad Sidi Rabish Awlad Sidi Rabish
Référence cartographique :Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage): 32S439323- 3859304 32S439163- 3859396
Altitude : 828 m s.n.m. 822 m s.n.m.
Pente : 6 - 10% < 1%
Exposition : 285°N 285°N
Utilisation du sol : pâturage naturel, quelques individus isolés de Stipa t. et de Astragalus a.
pâturage, quelques individus isolés de Stipa t. et de Astragalus a.
Substrat : dépôts éoliens et dépôts alluviaux quaternaires sur dépôts du Néogène
succession de dépôts éoliens et dépôts alluviaux sur dépôts du Néogène
Morphologie : bord de terrasse, surface de transition entre les niveaux 3 et 4 plate, surface du 2e niveau
Drainage extérieur : bon bon
Pierrosité : < 0.1% < 0.1%
Rochosité : absente absente
Érosion: hydrique et éolienne, diffuse et modérée hydrique et éolienne, diffuse et modérée; hydrique et canalisée, très faible
Horizontation : A-Btk-2Btky-2C A1-A2-2Btk1-2Btk2-3Ck
Classication: Hypocalcic Luvic Calcisols (Aridic) (WRB, 2006) Cutanic Calcic Luvisols (WRB, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
64
P4 et P5 (Chaîne 1), correspondant respectivement à des environnements de dos et de dépression
P4 P5
Localité: Garit Kribish Garit Kribish
Référence cartographique : Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage): 32S441596-3866466 32S441510-3866330
Altitude: 881 m s.n.m. 870 m s.n.m.
Pente : 2 - 6% < 1 %
Exposition : 240°N -
Utilisation du sol : pâturage, quelques individus isolés de Stipa t. et de Astragalus A.
Plantation de Opuntia f.i. (2004) et pâturage entre les rangées; surface travaillée de temps en temps par charrue à disques.
Substrat: sables jaunes du Néogène dépôts éoliens récents sur dépôts alluviaux d’une terrasse intermédiaire entre les niveaux 1 et 2
Morphologie : moyen versant sur surface du 4e niveau terrasse intermédiaire entre les niveaux 1 et 2
Drainage extérieur : bon bon
Pierrosité : 0,01 à blocs < 0,01% à blocs
Rochosité : absente absente.
Érosion : hydrique et éolienne, diffuse, faible ; hydrique, canalisée, faible hydrique et éolienne, diffuse, faible
Horizontation: A-Bt-2Bk-C A-AB-Bt1-Bt2
Classification: Calcic Cutanic Luvisols (Arenic) (WRB, 2006) Cutanic Luvisols (Arenic) (WRB, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
65
Autres profiles représentatifs respectivement d’environnements de dos P7 (chaîne 2) et de dépression P8
P7 P8
Localité : Sidi al Borji Ghdir al Bhim
Référence cartographique : Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage): 32S440260-3863272 32S442658-3862429
Altitude: 872 m s.n.m. 838 m s.n.m.
Pente: 6 - 12 % 2 - 6 %
Exposition: 230°N 230°N
Utilisation du sol : pâturage naturel de Stipa tenacissima et Astragalus armatus
olivaie et Opuntia ficus indica avec pâturage naturel sur Stipa tenacissima
Substrat : dépôts d’argiles du niveau 3 dépôt alluvial de cône terrasse de 3e niveau intéressé en partie par des dépôts éoliens récents
Morphologie : partie haute du versant sur surface du 3e niveau Surface plate du 3e niveau
Drainage extérieur : bon bon
Pierrosité superficiel : 5% 0,01%, couverture de graviers et cailloux polygéniques 15% environ
Rochosité : 1% à blocs 50 cm
Érosion : éolienne et hydrique, diffuse, modérée ; hydrique canalisée, faible éolienne et hydrique, diffuse, modérée
Horizontation : A-Bt-Bk-C-2C-3C-4Cy A-Bk
Classification : Haplic Calcisol (WRB, 2006) Petric Calcisols (WRB, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
66
Considérations pédologiques :
Les sols de cette unité sont généralement caractérisés par la présence d’horizons argiques avec abondantes pellicules d’argile sur la face des agrégats, indiquant un processus d’illuviation.
Ces sols présentent, en outre, des enrichissements en carbonates secondaires, sous forme de concrétions de CaCO3 ou pseudomycéliums, et une considérable effervescence à l’HCl le long de tout le profil (donnée confirmée par les résultats analytiques, qui montrent des teneurs en carbonates toujours supérieures a 5%, parfois jusqu’à 40%). On avance l’hypothèse que le processus d’illuviation ait été précédé par une phase de décarbonatation plus ancienne et que pendant des phases successives un nouvel apport éolien ait eu lieu, enrichi en carbonates.
Ces sols sont dans l’ensemble peu squelettiques et présentent des profondeurs variables entre 1 et presque 2 mètres, comme dans le cas du P15. Ce dernier, en effet, caractéristique des milieux les plus déprimés de la sous-unité, présente un haut degré de développement et un bonne structure grossière polyédrique subangulaire. À partir de la profondeur de 30 jusqu’à 170 cm et plus, des abondantes pellicules d’argile sont visibles sur les pores et sur le faces des agrégats, alors que l’enrichissement en carbonates secondaires commence à 120 cm environ de profondeur. Les sols développés en ces environnements légèrement concaves sont en général plus profonds et moins structurés par rapport à ceux qui se trouvent sur les dos, et des évidences d’illuviation plus forte et de recarbonatation moins forte peuvent être généralement observées. Étant donné la position du profil dans le talweg, on envisage qu’il peut y avoir lieu une illuviation actuelle par transport hydrique latéral. L’horizontation de ces profils est en générale du type : A-Btl-Bt2 et parfois Btk, ou, plus rarement, Bk (c’est le cas du P8).
Ces sols sont utilisés à des buts agricoles. Le P15 en effet est situé dans l’emplacement d’un champ d’orge, le P8 a été ouvert en profitant d’un défoncement visé à une future plantation d’oliviers, qui a effacé in situ l’horizon petrocalcique, visible à 25 cm environ de la surface en autres endroits de la station. Le P5 se trouve aux alentours d’une parcelle de Opuntia ficus indica et présente dans les parties les plus superficielles des évidences de matériau d’apport fluvial et des évidences de processus d’illuviation des argiles.
Les profils développés sur les dos sont un peu moins profonds et structurés, parce qu’ils se sont développés sur des pentes plus fortes, généralement occupés par des pâturages.
Le P18 est un témoignage de processus pédogénétiques développés à partir de matériau parental constitué de sables éoliens. Le sol a une épaisseur mince et on rencontre tout de suite l’horizon C.
Le P4 et le P7 présentent une horizontation du type Bt-Bk-C1-C2-C3 avec horizon B avec abondantes pellicules d’argile, mais d’une épaisseur très limitée. L’horizon Bk est beaucoup plus développé, les concrétions de CaCO3 sont abondantes et le contenu de carbonates mesuré en laboratoire atteint le 50%.
La chaîne 4 est positionnée le long du versant d’un dos en localité Awlad Sidi Rabish, dans une zone presque dépourvue de couverture végétale et sujette à érosion hydrique diffuse par ruissellement (des canaux d’érosion sont visibles en surface). Les sols observés sont
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
67
localisés sur des pentes modérées à faibles et plus l’on descend vers le pied du versant, plus augmente leur degré de développement et leur profondeur.
5.1.3.2. Sous-unité 2. Pentes régulières avec érosion en ravins ( « gully »)
Description générale : cette sous-unité est caractérisée d’un point de vue géomorphologique par les formes du 3e et 4e niveau. Les versants des glacis se raccordent aux terrasses situées au-dessous en manière douce et graduelle et donnent ainsi au paysage un aspect régulier, allongé en direction est-ouest. En général les sols rencontrés sont relativement argileux, ce qui probablement contribue à la formation et au recul des ravins (gullies). L’utilisation du sol sur les parties hautes des versants et le long des pentes est constituée le plus souvent de végétation naturelle, caractérisée par pâturage rare avec des individus isolés de Stipa tenacissima, Astragalus armatus et Genista spp., tandis que sur les parties basses du versant il y a des zones cultivées à céréales et arbres fruitiers.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
68
Profil type: P30
Localité Argout al Fakka
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S439392-3949792
Altitude 775 m s.n.m
Pente 6 - 10%
Exposition 285° N
Pierrosité < 0.01%
Rochosité absente
Utilisation du sol pâturage avec des individus isolés de Stipa t., Astragalus A. et Genista spp.
Substrat succession de dépôts éoliens sur dépôts du Néogène
Morphologie partie haute du versant sur surface du niveau 3
Drainage extérieur bon
Érosion hydrique et éolienne, diffuse et faible
Notes et observations petite et irrégulière nappe de gravier au passage Bt-Btk
Description du profil : Horizon A: 0 à 20 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 6/6, jaune brunâtre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette : environ 10% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure : de lamellaire moyenne et modérée dans les premiers cm à polyédrique subangulaire, moyenne, modérée, friable dans les cm suivants. Porosité faible avec des
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
69
pores très petits. Drainage régulier. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon Bt : 20 à 55 cm. Couleur è l’état intermédiaire entre sec et humide 7,5 YR 6/7 jaune rougeâtre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette : <5% en volume pour éléments petits et arrondis. Revêtements d’argiles abondants, le long des faces des agrégats et dans les pores. Structure polyédrique subangulaire tendant à l’angulaire, grossière, forte, dure. Porosité faible avec des pores très petits. Effervescence considérable. Drainage régulier. Racines et activité biologique absentes. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon Btk : 55 à 180 cm et plus. Couleur à l’état sec 7,5 YR 6/7 jaune rougeâtre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette : < 5% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements d’argiles abondants, le long des faces des agrégats et dans les pores. Structure polyédrique subangulaire tendant à l’angulaire, de grossière à très grossière, forte, très résistant. Concrétions de carbonate de calcium : environ 40% en volume, sous forme de nodules, durs et au contour net. Porosité absente. Effervescence considérable. Drainage lent. Racines et activité biologique absentes.
Analyses de laboratoire :
Horiz. Prof. (cm) CEes
(dS/m)
C.O.
(g/Kg)
S.O.
(g/Kg)pH
H2OpH
KClCaCO3
(g/kg)
CSC
(méq/100g)
A 0-20 0,4 3,50 6,00 8,6 7,7 64 4,69
Bt 21-55 0,4 3,10 5,30 8,6 7,7 229 4,92
Btk 56-100 3,6 1,90 3,30 8,4 8,4 252 5,23
Btk 101-180 1,50 2,60 7,9 7,5 129 5,14
Horiz. SK
(g/kg)
SG
(g/Kg)
SM
(g/Kg)
SF
(g/Kg)
SMF
(g/Kg)
L
(g/Kg)
A
(g/Kg)
Classe
USDA
A 15 28 96 234 505 32 105 SF
Bt 9 27 95 285 375 88 130 FS
Btk x x x x x x x x
Btk 11 13 71 207 454 150 105 FS
Classification: Luvic Calcisol (Aridic); (WRB, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
70
Autres profils: 29
Localité Argout al Fakka
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S439691-3850042
Altitude 795 m s.n.m
Pente 10 - 15%
Exposition 240° N
Pierrosité < 0.01%
Rochosité absente
Utilisation du sol pâturage avec des individus isolés de Stipa t.
Substrat dépôts de sables sur dépôts d’argiles et sables du Néogène
Morphologie partie haute de la pente, petit col. Surface du niveau 4
Drainage extérieur bon
Érosion hydrique et éolienne, diffuse et modérée, hydrique canalisée modérée
Horizontation A-Btk-Btkx-Btk2-C
Classification Cutanic Calcic Luvisols (Fragic) (WRB, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
71
Considérations pédologiques: Les sols observés sont caractérisés par le fait d’être très profonds – dans le cas du P29, par exemple, à 280 cm en profondeur on ne rencontre pas le substrat rocheux – et très développés, avec présence de pellicules d’argile, indice de processus d’illuviation, et beaucoup de concrétions de carbonate de calcium le long de tout le profil. En particulier, à une profondeur entre 50 et 160 cm on a relevé un horizon fortement cimenté : un duripan, c’est-à-dire un horizon endurci qui se réalise par le dessèchement à l’air et à la suite de processus périodiques de concentration d’ions en solution (Si, Ca et Mg) par évapotranspiration pendant la saison sèche ; les oxides (SiO2) et les sels (carbonates de Ca et Mg) précipitent et cristallisent en cimentant le matériau. Cet horizon pour se former nécessite de pressions très élevées et de temps très longs. On envisage donc d’être en présence d’un paléosol formé sous des conditions climatiques différents des actuelles, avec une disponibilité hydrique plus grande, pour permettre l’illuviation de l’argile dans les horizons de profondeur.
Le P30 aussi présente des pellicules d’argile à partir de 20 cm de la surface et une accumulation de carbonates de calcium secondaires entre 55 et 180 cm sous forme de concrétions en quantité égale à environ 40% du volume.
5.1.3.3. Sous-unité 3. Zone avec prévalence de croûte calcaire continue et subaffleurante
Description générale : cette sous-unité est caractéristique de la portion sud-ouest de la zone d’étude, aux limites avec le territoire algérien, et donc près de l’Oued Saf-saf. L’utilisation prédominante du sol est basée sur les cultures agricoles, céréales surtout ; sont cependant répandues des amples surfaces occupées par la végétation naturelle, très clairsemée et parfois dégradée. Le niveau géomorphologique dominant c’est le 3e, qui raccorde les surfaces plates des glacis du 4e niveau aux sous-jacentes terrasses alluviales. Une croûte calcaire continue est souvent visible à peu de cm de la surface et parfois est même affleurante, soit sur le sommet des glacis que sur les formes de transition, étant donné l’épaisseur limitée du matériau de couverture. Les versants occidentales des sous-
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
72
unités sont caractérisés par une plus grande épaisseur de la croûte calcaire, avec des sols minces, souvent du type Haplic ou Petric Calcisol, tandis que les versants exposés à ouest présentent une couverture éolienne sur matériau du Néogène, par endroits affleurant avec une alternance de sables et argiles vertes.
Profil type: P43
Localité Ganzou
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S435989-3851709
Altitude 754 m s.n.m.
Pente 10%
Exposition 50°N
Pierrosité 70%
Rochosité absente
Utilisation du sol inculte, avec des individus isolés de Stipa tenacissima
Substrat matériau du Néogène, argiles vertes couvertes de matériau calcaire alluvial
Morphologie surface de transition entre G4 et CT3, partie moyenne-haute du versant
Drainage extérieur bon
Érosion éolienne diffuse forte
Notes horizon A très mince et squelettique avec élevées porosité et friabilité
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
73
Description du profil Horizon A : 0 à 6 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 5/3, brun. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette : environ 70% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Structure granulaire fine et faiblement développée avec consistance friable. Porosité abondante avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines abondantes, petites, à trajectoire oblique. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et ondulée.
Horizon Ck1 : 6 à 20 cm. Squelette : environ 70% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Concrétions de carbonate de calcium (10-15%). Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon Ck2 : 20 à 40 cm. Squelette : environ 70% en volume avec des éléments moyens et subarrondis. Concrétions de carbonate de calcium (10-15%). Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et ondulée.
Horizon Ck3 : 40 à 50 cm. Squelette : environ 70% en volume avec des éléments moyens et subarrondis revêtus de patines de carbonate de calcium. Concrétions de carbonate de calcium (10-15%). Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et ondulée.
Horizon CR : au-delà de 50 cm. Argiles vertes du Néogène.
Classification : Petric Calcisol (Aridic) (WRBSR, 2006)
Considérations pédologiques : le P43 est représentatif de la situation d’un versant moyen-haut exposé à est. Il s’agit d’un sol peu développé, avec horizon organo-minéral mince reposant directement sur des horizons C. La structure est faible et la consistance friable, l’effervescence est considérable le long de tout le profil et sont fréquemment présentes des concrétions de carbonate de calcium, à témoignage d’un processus de calcification. Sur le versant occidental, qui donne sur l’Algérie, les sols présentent des horizons pétrocalciques continus et d’épaisseur considérable, peu de cm au-dessous de la surface.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
74
5.1.3.4. Sous-unité 4. Zone sujette à forte érosion éolienne
Description générale : cette sous-unité est localisée dans le secteur nord-occidental de la zone d’étude et son paysage est fortement affecté et modelé par des phénomènes d’érosion éolienne auxquels il est exposé. Les vents dominants de la région soufflent en effet de NO vers SE, intéressant surtout les terrasses et les reliefs les plus hauts, presque totalement dépourvus de couverture végétale, et donc plus exposés à l’action corrosive du vent. La végétation présente est dominée par des espèces pionnières, tandis que les plantations de Opuntia f. i. réalisées sur ces surfaces ont montré des problèmes de croissance, dérivées justement de la forte action du vent.
Malheureusement il n’a pas été possible ouvrir des profils pédologiques pour caractériser le sol de cette sous-unité; on a jugé toutefois opportun la délimiter sur la carte, en se basant sur les images satellitaires et les photos aériennes, étant donné le caractère particulier des processus érosifs en cette zone, et par conséquent l’attention que l’on doit y prêter lors d’une planification d’interventions agricoles.
5.1.4. Unité 4 : zone sujette à salinisation et hydromorphie
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
75
Localisation de l’unité : elle est circonscrite au secteur centre-occidental de la zone d’étude, près de la frontière avec l’Algérie, en particulier dans la localité Oglit al Marra.
Extension de l’unité : environ 540 ha.
Altitude : 750-780 m s.n.m.
Pente : nulle, morphologie légèrement déprimée.
Utilisation du sol : l’unité se caractérise par des vastes extensions de pâturage naturel, avec individus isolés de Stipa tenacissima. Les parties les plus déprimées sont intéressées par des interventions d’implantation avec des espèces arbustives, principalement Atriplex nummularia et en second lieu Atriplex halimus, tandis que sur les surfaces à plus forte pente se trouvent des cultures d’arbres fruitiers, en particulier oliviers. Des surfaces limitées sont intéressées par des cultures céréalières.
Substrat : dépôts constitués d’une alternance de sables et d’argiles du Néogène, recouvertes par dépôts plus récents (Quaternaire) constitués de sables, limons et argiles.
Géomorphologie : l’unité se développe surtout sur terrasses du 2e niveau (Capsien-Holocène) délimitées par les formes du 3e et 4e niveau (Pléistocène Moyen-Supérieur).
Description générale : La morphologie plate, et parfois déprimée, de l’unité, et la présence de nappes sous-superficielles, donnent lieu aux conditions stationnelles convenables aux processus de salinisation et d’hydromorphie ; en sont des témoins évidents les efflorescences salines en surface et les taches d’oxido-réduction observées pendant l’ouverture des profils. Les élevées concentrations salines dans les sols ne favorisent pas le développement d’une couverture végétale spontanée et la mise en culture de ces surfaces, sinon par des espèces halophytes.
L’érosion, hydrique et éolienne, soit diffuse que canalisée, est faible et observable seulement au-dehors de la dépression centrale. Elle est mise en évidence par la présence de sillons d’érosion et d’accumulations de matériau éolien sous forme de petites nebkha, en particulier dans la partie plus orientale de l’unité. L’observation à partir d’une basse colline adjacente a suggérée l’hypothèse que cette zone était jadis une dépression dont la genèse était liée à la existence de phénomènes karstiques.
Profile type : P10 (chaîne 3)
Autres profils : P9, P11, P12, P13, P14 (Chaîne 3), P50
Sous-unités : –
Profils type : P10 et P9, P11, P12, P13, P14 (Chaîne 3)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
76
Profili tipo: P10 e P9, P11, P12, P13, P14 (Catena 3)
Località Oglit al Marra
Riferimento Cartografico Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubicazione UTM (Carthage) 32S434710-3857127
Esposizione assente
Pietrosità assente
Rocciosità assente
Substrato depositi alluvionali quaternari di cône-terrasse su depositi di sabbie e argille del Neogene
Morfologia pianeggiante debolmente inclinata verso ovest su terrazzo del 2° livello
Drenaggio esterno buono
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
77
Profil P9 P10 P11 P12 P13 P14
Photo
Altitude
770m s.n.m.
770 m s.n.m. 770 m s.n.m. 771 m s.n.m. 772 m s.n.m. 774 m s.n.m.
Utilisation du sol
Implanta-tion
Atriplex n.
2003
Quelques individus
isolés de Stipa t.
Pâturage naturel
Très dégradé avec quelques individus de Stipa t.
Quelques individus isolés de Stipa t.
Pâturage naturel
Implanta-
tion
Atriplex n. 2003/2005
Horizons A1-A2-Bk-Bkg-Cgy
A-Bk-Btg-Btk A-Bk-2Btk-2Cy A-Bt-Ck-2C-3C-W A-Btk1-Btk2-2C-2Cy A-Bk-Ck-2C
Classif. Hypersalic Solonchak (WRBSR, 2006)
Hypersalic Calcic Solonchak
(WRBSR, 2006)
Hyper-salic Calcic Solon- chak (Aridic) (WRBSR 2006)
Hyper-salic Calcic Solon-chak (Aridic) (WRBSR 2006)
Hypersalic Calcic Solonchak (Aridic) (WRBSR, 2006)
Hypocalcic Luviv Calcisol (Aridic) (WRBSR, 2006)
Analyse de laboratoire:
P Horiz.
Prof.
(cm)
CEes
(dS/m)
Sels
(%)
Na+ es
(méq/100g)
Ca2+ ex
(méq/100g)
Mg2+ es
(méq/100g)
K+ es
(méq/100g) SAR
9 A1 15 39,65 3,70 x x x x x
A2 35 32,50 3,32 x x x x x
Bk 80 18,73 1,16 x x x x x
Bkg 120 18,00 0,69 x x x x x
Cgy 180 12,38 0,51 x x x x x
10 A 18 38,55 2,44 9,85 1,26 1,55 0,11 8,31
Bk 60 82,03 10,14 28,59 2,33 4,99 0,11 14,95
Btg 95 69,45 9,35 30,96 2,39 4,07 0,12 17,23
Btk 160 36,10 3,09 x x x x x
11 A 15 38,07 3,04 18,44 1,12 1,16 0,14 17,29
Bk 50 19,20 0,93 x x x x x
2Btk 80 18,21 1,07 8,57 1,27 1,45 0,06 7,34
2Cy 120 10,63 0,32 4,57 0,91 0,57 0,04 5,30
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
78
12 A 10 21,54 1,43 9,55 1,32 0,93 0,36 9,01
Bt 65 12,37 0,21 2,42 0,63 0,55 0,06 3,15
C 85 3,83 0,02 0,71 0,17 0,12 0,18 1,87
2Cb 98 2,23 0,01 x x x x x
3Cb 120 3,43 0,02 x x x x x
13 A 15 30,33 1,13 x x x x x
Btk 70 22,20 1,00 x x x x x
Btk2 87 17,07 0,31 x x x x x
C 145 5,96 0,06 1,78 0,31 0,40 0,05 2,98
2Cb >145 10,01 0,11 1,73 0,32 0,45 0,03 2,78
14 A 20 3,50 0,01 x x x x x
Bk 45 3,28 0,02 0,84 0,51 0,40 0,02 1,25
Ck 90 5,43 0,06 2,08 0,75 0,41 0,03 2,73
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
79
P Horiz. pH H2O pH KCl CaCO3 (g/kg) CSC (méq/100g) C.O. (g/Kg) S.O. (g/Kg)
9 A1 7,8 7,5 220 15,30 6,80 11,70
A2 8,1 7,7 235 x 5,50 9,50
Bk 7,9 7,5 240 x 1,90 3,30
Bkg 8,3 7,6 245 x 2,10 3,60
Cgy 8,1 7,6 130 8,73 1,10 1,90
10 A 7,9 7,7 207 11,58 3,00 5,20
Bk 7,9 7,9 227 14,02 2,30 4,00
Btg 8,1 7,7 226 15,91 4,10 7,10
Btk 8,4 7,7 184 20,65 1,30 2,20
11 A 8,1 8,0 206 15,38 7,80 13,40
Bk 8,5 8,1 207 14,35 0,40 0,70
2Btk 8,0 8,4 217 10,25 1,20 2,10
2Cy 7,6 7,9 109 7,01 1,40 2,40
12 A 7,9 8,1 215 5,35 2,20 3,80
Bt 7,8 7,6 233 5,46 1,40 2,40
C 9,1 8,0 398 x 1,00 1,70
2Cb 9,2 7,8 124 x 1,50 2,60
3Cb 8,6 7,8 30 6,01 0,70 1,20
13 A 7,7 7,8 154 5,79 4,60 7,90
Btk 7,9 8,1 168 8,61 1,40 2,40
Btk2 8,6 8,2 143 5,14 0,80 1,40
C 8,3 7,9 156 5,01 x x
2Cb 8,4 7,9 253 6,01 x x
14 A 8,2 8,4 207 5,14 3,50 6,00
Bk 8,3 8,4 152 5,46 0,80 1,40
Ck 8,4 8,4 117 x x
P Horiz. SK (g/kg) SG (g/Kg) SM (g/Kg) SF (g/Kg) SMF (g/Kg) L (g/Kg) A (g/Kg) Classe USDA
9 A1 9 3 15 48 488 260 195 FS
A2 2 2 4 22 137 820 17 L
Bk 5 9 26 71 x x x x
Bkg x x x x x x x x
Cgy 66 65 90 127 327 363 28 FS
10 A 125 18 30 80 550 222 100 FS
Bk 17 11 27 57 560 298 47 FS
Btg 22 13 27 59 311 188 402 A
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
80
Btk x x x x x x x x
11 A 13 14 31 60 435 328 132 FS
Bk 5 15 57 169 296 158 305 FSA
2Btk 33 36 45 69 688 130 32 SF
2Cy 23 24 27 54 750 123 22 SF/S
12 A 13 17 71 187 532 158 35 SF
Bt 17 9 31 96 616 218 30 SF
13 A 170 43 91 470 191 165 40 FS
Btk 5 18 55 125 559 218 25 SF
Btk2 51 55 150 209 421 140 25 SF
C 83 92 105 130 488 160 25 SF
2Cb 75 83 47 30 578 245 17 SF
14 A 63 30 101 273 331 120 145 FS
Bk 9 11 35 82 507 318 47 FS
Ck 31 16 385 265 174 135 25 SF
Description du profil (P10 ) : Horizon A : 0 à 18 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre humide et sec 10 YR 5/4, brun jaunâtre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette inférieure à 1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Agrégation de lamellaire, moyenne, modérée, friable, à polyédrique, subangulaire, moyenne, modérée, friable (humide). Porosité pauvre avec des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon Bk : 18 è 60 cm. Couleur à l’état humide 10 YR 4/5 brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette inférieure à 1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Agrégation polyédrique subangulaire, grossière, forte, résistante. Concrétions de carbonate de calcium, soit comme nodules au diamètre inférieure à 1 cm, que comme psudomycélium, 20% environ en volume, au diamètre de 0,5 cmq, tendres et dures, au contour net. Porosité pauvre avec des pores petits. Effervescence considérable. Drainage normal. Racines de peu nombreuses à absentes, petites, avec trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon Btg : 60 à 95 cm. Couleur à l’état humide 10 YR 3/1,5 intermédiaire entre gris très sombre et brun jaunâtre très sombre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette inférieure au 5% en volume avec des éléments petits et arrondis. Agrégation polyédrique subangulaire tendant à l’angulaire, grossière, forte, résistante. Concrétions de carbonate de calcium, environ 5% en volume, sous forme de nodules au diamètre inférieure à 1 cm, tendres et dures, au contour net. Porosité absente. Effervescence considérable. Drainage lent. Racines et activité biologique absentes.
Classification : Hyper salic Calcic Solonchak (Sodic, Aridic) (WRBSR, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
81
P50. Autres profils de l’unité qui n’appartient pas à la chaîne 3
Localité Oglit al Marra (più ad est)
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S436804-3857567
Altitude 761 m s.n.m.
Pente < 1%
Exposition 310° N
Pierrosité < 5%
Rochosité -
Utilisation du sol plantation de Atriplex nummularia et Atriplex halimus peu loin. Présence de nebkha et taches herbeuses en position entre rangée
Substrat dépôts constitués par une alternance de sables et d’argiles néogènes recouverts par des dépôts plus récents (Quaternaire) constitués de des sables, limons et argiles
Morphologie terrasses du 2e niveau
Drainage extérieur bon
Érosion des parties avec érosion éolienne modérée et diffuse et d’autres parties avec accumulation éolienne sous forme de voile mince.
Horizontation A1-A2-A3-BC-Cky
Classification (WRBSR, 2006) Gleyic Solonchak
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
82
Considérations pédologiques :
Pour caractériser les sols de l’unité a été étudiée la Chaîne 3, comprenant 6 profils en succession à une distance d’environ 40 m l’un de l’autre, le long de la direction Ovest-Ouest, sur une terrasse du 2e niveau. Le dénivellement entre P9 et P10, localisés dans le point le plus bas de la zone, et P14, dans la position la plus relevée, est de 4 m seulement.
Du point de vue de l’utilisation du sol, les profils sont sélectionnés selon la manière suivante : P9 à l’intérieur de la parcelle de Atriplex n. (âge de l’implantation : 2003), P10, P11, P12 au-dehors de la parcelle, avec couverture végétale pratiquement absente, et P13 et P14 à l’intérieur d’une autre parcelle d’Atriplex n. (âge de l’implantation : 2003/2005). Voilà ci-dessous une synthétique description morphologique des sols :
P9
A1-A2-Bk-Bkg-Cgy ; profondeur : 120 cm. Humide sauf que A, qui est entre humide et sec. Squelette : <1% en volume pour tous les profils. Texture estimée sur le terrain : FLA en tous les horizons.
Structure : lamellaire dans les cm les plus superficiels de l’horizon A, polyédrique subangulaire dans le reste du profil. Effervescence à l’HCl : considérable en tout le profil. Accumulations de carbonates secondaires : à partir de A2 (5% en volume). Dans Bk et Bkg nodules et pseudomycéliums (40% en volume).
Taches par hydromorphie : in Bkg (épaisseur 1 cm environ). Le drainage en cet horizon est très lent. Dans Cgy taches abondantes d’une couleur jaunâtre, très visibles, irrégulières, 1 cm environ d’épaisseur, associées à nodules et cristaux de gypse. Ces derniers intéressent le 20-25% du volume de l’horizon.
P10 A-Bk-Btg-Btk ; profondeur : > 160 cm. Humide. Squelette <1% en tout le profil. Structure : elle varie de lamellaire, moyenne, modérée des premiers cm, à polyédyque, subangulaire, grossière, à polyédrique angulaire du Btk. Texture : estimée FLA en tout le profil. Pellicules d’argile abondantes in Btk. Effervescence à l’HCl : considérable en tout le profil. Accumulations de carbonates secondaires en Bk et Btk sous forme de nodules (diamètre inférieur a 1 cm) et de pseudomycéliums en Bk. Nodules de Fe-Mn en Btk sous forme de patines noires, amples 1 cmq environ, tendres, au contour net (5-10% en volume).
P11 A-Bk-2Btk-2Cy ; profondeur : 80 cm. Humide. Squelette : 1 à 5% en volume en tout le profil. Texture estimée sur le terrain : FLS en A et FLA en Bk et 2Btk. Structure : agrégation de lamellaire, faible, fine à polyédryque subangulaire, de moyenne à grossière, modérée en A; polyédrique, de subangulaire à angulaire, grossière, forte dans les autre horizons. Effervescence à l’HCl : considérable, sauf qu’en 2Cy, où elle est très faible. Pellicules d’argile abondantes en 2Btk. Accumulations de carbonates secondaires sous forme de concrétions (5-10% en volume) en Bk et 2Btk. Minuscules cristaux de gypse en 2Cy (environ 2-3% en volume).
P12 A-Bt-Ck-2C-3Cg-W; profondeur : 65 cm. Humide. Squelette <1% en A et Bt ; environ 25-30% en volume en Ck et 2C. Texture estimée sur le terrain : FLA dans les premiers deux horizons et FA en Ck. Structure : lamellaire dans les premiers cm de l’horizon A ; après, elle devient polyédrique subangulaire dans ce même horizon, intermédiaire entre la polyédrique subangulaire et angulaire en Bt et Ck. Effervescence à l’HCl : considérable. Pellicules d’argile abondantes en Bt. Nodules de carbonates secondaires en Ck (15-25% en volume), au diamètre inférieur à 5 mm, durs et au contour net. Dans l’horizon 2Cg, de 85 à 89 cm, l’effervescence est présente, mais pas les nodules, et des taches grises vertes apparaissent affectant le 30% environ du volume du sol.
En 3Cg les taches intéressent jusqu’à 80% du volume du sol. À partir de 120 cm est présente une nappe aquifère libre, horizon W.
P13 A-Btk1-Btk2-2C-2Cy. Profondeur : 87 cm. Humide, sauf A. Squelette <5%. Texture estimée sur le
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
83
terrain : FLA en A et BTK, FA en 2C. Structure : de lamellaire des premiers cm, à polyédrique subangulaire en A et intermédiaire entre polyédrique subangulaire et angulaire en Btk, en 2C polyédrique angulaire, grossière. Effervescence à l’HCl : considérable en tout le profil, sauf qu’en 2C, où elle est absente. Pellicules d’argile abondantes en Btk. Accumulations de carbonates secondaires sous forme de pseudomycéliums (15-20% en volume) en Btk. Minuscules cristaux de gypse en 2Cy au-delà des 145 cm.
P14 A-Bk-Ck. Profondeur : 45 cm. Texture estimée sur le terrain : FLA en tout le profil. Squelette <10% en volume. Accumulations de carbonate secondaire sous forme de nodules (associés à un filet serré de pseudomycéliums) qui intéressent le 30% du volume du Bk et le 70 % du Ck. Structure : lamellaire dans le premiers cm, polyédrique angulaire en Bk, massive en Ck de 45 à 90 cm. Pellicules d’argile, de communes à peu nombreuses en A et à partir de 10 cm de profondeur.
Les profils P9, P10, P11 et P12 montrent un horizon superficiel très foncé et profond, tellement que, selon les premières hypothèses sur le terrain, ils avaient été estimés comme des sols iso-humiques, en particulier Kastanozems ; c’est-à-dire, des sols qui, sous conditions climatiques légèrement plus humides, ont subi des processus de mélanisation, en s’enrichissant aussi, dans les parties les plus profondes, en substance organique. Les résultats analytiques ont confirmé seulement en partie cette hypothèse ; en effet, seuls le P9 et le P11 présentent des teneurs en carbone organique telles qu’ils peuvent appartenir à ce groupe. Actuellement, le processus de salinisation se révèle prédominant en cette zone ; par conséquent, même si le P9 et le P11 montrent des caractères iso-humiques, ils présentent toutefois des valeurs de salinité extrêmement élevées, et donc ils ont été classifiés comme Solonchaks, pour souligner l’évidence d’un processus actuel qui s’est superposé au passé.
Les valeurs de conductivité électrique de tous les profils analysés (sauf le P14), mesurées sur l’extrait de pâte saturée, sont très élevées, toujours supérieures à 15 dS/m, comme requis par le WRBSR 2006 pour un horizon salique et par conséquent pour classifier les sols comme Solonchaks. Ces valeurs de salinité tellement élevées semblent corrélées à la présence de nappes sous-superficielles (à 140 cm environ de la surface, dans le cas du P12) qui, à la suite de phénomènes de remontée capillaire, concentrent les sels dans les horizons les plus superficiels, en général entre 1-50 cm, comme on peut observer dans le graphique ci-dessous.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
84
ECes - profondità
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
0 50 100 150 200
P9P10P11P12P13P14
Dans les horizons profonds de presque tous les profils de la chaîne sont visibles des cristaux de gypse, influant sur le bas degré d’effervescence à l’HCl dans les horizons Cy. Leur présence est probablement due au fait que les argiles vertes du Néogène, affleurant relativement à la surface en cette unité, sont gypseuses et chargent les eaux circulantes de sels qui, par évapotranspiration, se concentrent, précipitent et recristalisent.
Un rôle significatif dans l’évolution de cette chaîne est joué par les nappes aquifères sub-superficielles, dont le niveau oscille selon les saisons. Elles favorisent le mouvement des carbonates et du gypse, et aussi du sodium, à l’intérieur des pédons et enrichissent ainsi les zones déprimées. La présence de nappes est liée à la présence localisée de lentilles de matériaux plus imperméables (argiles du Néogène subaffleurantes).
Le fait même que l’unité ait cette forme particulière légèrement déprimée favorise le ruissellement vers le centre de la dépression et une plus haute concentration de sels en cette zone.
5.1.5. Unité 5: Zone de sédimentation éolienne
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
85
Localisation de l’unité : elle est située en position sud-ouest par rapport à la zone d’étude, à ouest par rapport au centre habité de Skhirat et aux limites sud-orientales de la zone.
Extension de l’unité : environ 2.800 ha.
Altitude : 720-840 m s.n.m.
Pente : modérée à faible
Utilisation du sol : l’occupation des sols est hétérogène. La plupart de la surface est occupée par la végétation naturelle, tandis qu’une autre bonne partie est dominée par des cultures de céréales et, dans une plus petite mesure, d’arbres ; parmi ces dernières, vastes extensions sont intéressées par des implantations d’Opuntia ficus indica.
Substrat : matériau du Néogène (formation Beglia avec des couches d’argiles vertes et sables) avec une couverture éolienne, d’épaisseur variable et différente consolidation.
Géomorphologie : en prévalence terrasses alluviales du 2e niveau (Capsien - Holocène) avec des couvertures d’épaisseur variable de sables de transport éolien. Nombre de dunes de dimension différentes sont présentes, qui occupent des surfaces de différente extension : les nebkha et les rebdou.
Description générale : l’unité est caractérisée par une action intense de transport éolien et par l’accumulation de matériau sableux. Tandis qu’en toute la zone d’étude il y a un saupudrage éolien de peu de cm de couverture, en cette zone l’épaisseur augmente et atteint des dimensions métriques. L’unité est située dans le secteur centre-occidental de la zone d’étude, et en particulier à nord-ouest à l’égard des reliefs montagneux et collinaires qui intéressent le secteur méridional à la limite inférieure de la zone d’étude. Cette position est particulièrement exposée au « placage éolien », parce que les vents dominants dans la région provenant de nord-ouest soufflent vers sud-ouest. Ils exercent une forte action érosive dans le secteur le plus septentrional du territoire, où ils ont une force plus grande, en se chargeant de particules fines qu’après ils relâchent plus à sud, au pied et sur le flanc des reliefs collinaires. L’unité comprend soit des paysages modelés par des phénomènes d’accumulation actuels et dominés par des dunes de différentes dimensions, que des paysages exprimant des processus éoliens passés, qui ont mené à la formation de dunes fossiles et de dépôts nommés éolianites, au caractéristique aspect.
Profile type : P48 (sous-unité 1), P 55 (sous-unité 2)
Autres profiles : P47, P49 (sous-unité 1)
Sous-unités : - 1 Sédimentation actuelle
- 2 Sédimentation passée
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
86
5.1.5.1. Sous-unité 1. Sédimentation actuelle
Descrizione generale: Le dinamiche connesse all’azione eolica risalgono almeno agli inizi dell’Olocene nell’area in esame, ma quelle riguardanti questa sotto unità sono tuttora in atto. La maggior parte del materiale sabbioso accumulato sulle superfici nella forma di copertura eolica di cospicuo spessore e di dune, dalla dimensione sempre maggiore spostandosi verso ovest, deriva prevalentemente dal settore nord-occidentale del territorio, in particolare dagli affioramenti sabbiosi e molto friabili del Neogene, ossia è di origine locale. I processi di deposizione e di accumulo agenti in queste zone, modellano il territorio e ne modificano la morfologia, tanto che le forme geomorfologiche, che in questa unità sono costituite da terrazzi alluvionali, prevalentemente del 2° livello, hanno un ruolo secondario nella caratterizzazione del paesaggio e dei suoli.
Le nebkhas sono diffuse su tutta l’area, sia come forme isolate, che raggruppate in quelli che vengono definiti “campi di nebkhas”, mentre i Rebdou sono presenti in misura minore e sviluppati prevalentemente lungo una direttrice Nord-Sud. Tali forme sono spesso associate ai reticoli idrografici, vie preferenziali per l’incanalamento del vento ed importanti fonti di sabbia.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
87
Profil type: P47
Localité Awlad Ibrahim
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S436221-3854295
Altitude 750 m .s.n.m.
Pente < 0,1 %
Exposition Totale
Pierrosité Absente
Rochosité Absente
Utilisation du sol nouvelle implantation d’oliviers
Substrat sables du Néogène recouvertes d’accumulations éoliennes d’origine récente
Morphologie terrasse du 2e niveau
Drainage extérieur bon
Érosion accumulation de matériau éolien
Notes zone intéressée à la présence de rebdou
Description du profil : Horizon A1 : 0 à 10 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 6/6, jaune rougeâtre, à l’état humide 7,5YR 4/6 brun foncé. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette < 5% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Structure lamellaire, moyenne, faiblement développée. Porosité commune avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
88
considérable. Racines abondantes petites, moyennes et grandes, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon A2 : 10 à 29 cm. Couleur à l’état humide 7,5YR 3,5/ entre brun et brun foncé. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette < 5% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Structure polyédrique subangulaire, moyenne, faiblement développée. Porosité commune avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes, petites et moyennes à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon A3 : 29 à 52 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 5/6 brun foncé, à l’état humide 7,5 YR 4/6 brun foncé. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette < 5% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Structure polyédrique subangulaire, moyenne, faiblement développée. Porosité commune avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites, moyennes et grandes à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon AC : 52 à 95 cm. Texture au toucher franche-sableuse. Squelette < 5% en volume pour éléments petits et subarrondis de silex. Structure polyédrique subangulaire, moyenne, faiblement développée. Effervescence considérable. Drainage normal. Racines peu nombreuses, petites. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon C1 : 95 à 120 cm. Squelette entre 35 et 70% en volume avec des éléments petits et subarrondis dans la partie plus basse de l’horizon (110 à 120 cm). Sable du Néogène avec grains de quartz et pellicules de manganèse. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon C2 : 120 à 138 cm. Sable du Néogène avec grains de quartz et pellicules de manganèse. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon C3 : 138 à 160 cm. Sable du Néogène avec grains de quartz et pellicules de manganèse. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon C4 : 160 à 190 cm. Sable du Néogène avec sesquioxydes et grains de quartz revêtus de pellicules de manganèse.
Analyse de laboratoire : Horiz. prof. (cm) pH H2O CaCO3
(g/kg)
SG
(g/Kg)
SF
(g/Kg)
LG
(g/Kg)
LF
(g/Kg)
A
(g/Kg)
Classe
USDA
C.O.
(g/Kg)
S.O.
(g/Kg)
A1 10 8,2 64 736 84 25 50 105 SF 2,30 4,00
A2 29 8,4 62 747 58 25 40 130 FS 1,80 3,10
A3 52 8,6 74 779 61 15 10 135 SF 0,90 1,60
Classification : Haplic Arenosol (Aridic) (WRBSR, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
89
Autres profils: P48
Localité Awlad Ibrahim
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S436851-3854487
Altitude 760 m s.n.m.
Pente < 0,1 %
Exposition totale
Pierrosité absente
Rochosité absente
Utilisation du sol végétation naturelle à Opuntia f. i., Acacia, Zysiphus L.
Substrat sables du Néogène couverts d’accumulations éoliennes d’âge récente
Morphologie terrasse du 2e niveau, surface plate
Drainage extérieur bon
Érosion accumulation de matériau éolien
Notes dans la zone présence de rebdou. Dans le sol au-delà de 80 cm est présente une glosse de carbonate de calcium.
Description du profil : Horizon A1 : 0 à 7 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 4/6, brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette inférieur à l’1% en volume avec des éléments petits et
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
90
subarrondis. Structure polyédrique subangulaire, fine, modérément développée, à la consistance peu forte. Porosité abondante avec des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines petites et communes, quelques racines grandes, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon A2 : 7 à 17 cm. Couleur à l’état humide 7,5 YR 4,5/6 brun sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette inférieur à l’1% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Structure polyédrique subangulaire, fine, modérément développée, à la consistance peu forte. Porosité abondante avec des pores petits. Drainage régulier. Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon BC : 17 à 47 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 4,5/6 brun sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette inférieur à 5% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Structure prismatique moyenne, faiblement développée, à la consistance forte. Porosité abondante avec des pores petits. Drainage régulier. Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon Ck : 47 à 80 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 6/4 brun clair. Texture au toucher sableuse. Squelette inférieur à 5% en volume, avec des éléments petits et arrondis, revêtu de patines de carbonate de calcium. Structure prismatique moyenne, faiblement développée. Concrétions de carbonate de calcium extrêmement grossières, fréquemment au 5-20% environ en volume. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines et activité biologique absente. Notes : grumeaux de sable fin cimentés par carbonate de calcium.
Horizon C2 : au-delà de 80 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 6/4 brun clair. Sable du Néogène avec grains de quartz et pellicules de manganèse. Concrétions de carbonate de calcium extrêmement grossières, fréquemment au 5-20% environ en volume, avec glosse de carbonate de calcium.
Classification : Haplic Arenosol (Aridic) (WRBSR, 2006)
Considérations pédologiques: les sols développés en cette sous-unité, exposés au continu apport de matériau éolien (qui peut atteindre une déposition de 1 cm chaque année) montrent un bas degré d’évolution et une subdivision en horizons peu marquée. Sur la base aussi de nombreuses observations expéditives effectuées en cette zone, en profitant souvent de nouvelles plantations d’oliviers, on observe que ces sols présentent en général: a) un premier horizon superficiel A1 , dont l’épaisseur varie de peu de cm dans la plupart des cas aux 10-15 cm, avec structure lamellaire à cause de la pluie battante et du piétinement animal ; b) un horizon sous-jacent A2 plus sombre, avec une épaisseur plus grande, une plus haute teneur en substance organique (0,3% environ) et une structure subangulaire de dimensions moyennes, de faiblement a modérément développée. Il n’y a pas d’horizon B, mais des formes de transition avec les sous-jacents C, constitués de matériau sableux du Néogène à différents degrés de cimentation ; les grains de sable sont souvent groupés en structures grumeleuses, cimentées par carbonate de calcium.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
91
L’accumulation de carbonate de calcium est répandue en tout le profil. Seulement dans les horizons plus profonds elle se présente sous forme de concrétions grossières et dans le P48 est concentrée en glosses et poches, probablement occupées auparavant par des racines ou terriers d’animaux. La caractéristique particulière de ce type de sols est la texture grossière (de sableuse fine à limono-sableuse) qui les rend très poreux, extrêmement perméables et tendres.
5.1.5.2. Sous-unité 2. Sédimentation passée
Description générale : cette sous-unité est dominée par la présence de matériau éolien consolidé, d’épaisseur variable, jusqu’à 3 m, caractéristique des plaines du secteur orientale de la zone d’étude et nommé « éolianite ». Ces dépôts sont le résultat de mécanismes de transport et d’accumulation passés, déterminés par la disposition latitudinale du système des reliefs montagneux de la zone d’étude, qui on fait obstacle aux vents qui soufflent du secteur nord-ouest, causant ainsi la relâche des sables sur les versants septentrionales.
Ces dépôts sont souvent couverts de matériau éolien plus récent et inconsolidé, duquel diffèrent aussi par la couleur. Les éolianites, en effet, qui dérivent de la cimentation de sables calcaires, présentent des colorations sombres à leur intérieur, qui font envisager des processus pédogénétiques produits grâce à milieux climatiques plus favorables, avec une couverture végétale différente et pendant des phases d’atténuation des phénomènes éoliens. Cette sous-unité est développée sur des terrasses alluviales du 2e niveau et l’utilisation du sol est pour la plupart caractérisée par des zones à utilisation agricole (cultures céréalières), interrompues par des vastes surfaces avec végétation naturelle plus ou moins continue affectées au pâturage.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
92
Profil type : P55
Localité Wad Lahial
Référence Cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S448729-3862681
Altitude 761 m s.n.m.
Pente 1%
Exposition totale
Pierrosité 70%
Rochosité absente
Utilisation du sol végétation naturelle avec des individus de Stipa tenacissima, Astragalus armatus et Artemisia campestris
Substrat argiles vertes du Néogène
Morphologie terrasse du 2e niveau, dans une paléodépression ; actuellement, correspondant à un dos creusé par un ravin d’érosion
Drainage extérieur bon
Érosion croûte superficielle de quelques cm, à la suite d’érosion éolienne
Notes le sol, à ce qu’il paraît, s’est formé sur matériau sableux de provenance soit éolienne que fluviale ; il y a des évidences d’iso-humisme
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
93
Description du profil :
Horizon A1 : 0 à 5 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 6/6, brun jaunâtre, à l’état humide 10 YR 4/6, brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette absent. Structure lamellaire, fine, modérée, friable. Porosité commune avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence violente. Racines rares, très petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Horizon A2 : 5 à 12 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 6/6, brun jaunâtre, à l’état humide 10 YR 4/6, brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette : entre 35 et 70% en volume avec des éléments quartzeux très petits, petits et moyens. Structure polyédrique subangulaire, de fine à moyenne, modérément développée. Porosité commune avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence violente. Racines abondantes, très petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Notes : entre 10 et 12 cm est présente une stone line avec des éléments quartzeux, qui provient d’alluvion récente.
Horizon 2Bt1 : 12 à 35 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 3/4, brun grisâtre sombre, 10 YR 3/2, brun jaunâtre très sombre. Texture limono-sableuse. Squelette inférieur au 5% du volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique angulaire grossière, modérément développée. Concentrations tendres de carbonate de calcium inférieures au 2% en volume. Porosité abondante avec des pores très petits et petits. Effervescence violente. Drainage régulier. Racines abondantes, très petites. Quelques rares pellicules d’argile sur les faces des agrégats. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Notes : présence de coprolithes de lombrics et accumulations de substance organique.
Horizon 2Bt2 : 35 à 110 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 3/4, brun jaunâtre très sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette absent. Structure polyédrique angulaire grossière, modérément développée. Concentrations tendres de carbonate de calcium et pseudomycéliums inférieurs au 2% en volume. Porosité abondante avec des pores très petits. Effervescence violente. Drainage normal. Racines et activité biologique absentes. Quelques rares pellicules d’argile sur la face des agrégats. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Notes : entre 50 et 52 cm est présente une stone line avec des éléments quartzeux et fragments de croûte calcaire.
Horizon 2C : 110 à 160 cm. Sable plus grossier dans la partie supérieur, provenant probablement d’un épisode alluvial à basse énergie. À 140 cm environ est présente une stone line avec des éléments quartzeux et fragments de croûte calcaire ; au dessous sable plus fin de probable origine éolienne.
Horizon 3C : au-delà de 160 cm. Argiles cimentées du Néogène.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
94
Analyses de laboratoire :
Horiz. prof. (cm) SG
(g/kg)
SF
(g/kg)
LG
(g/kg)
LF
(g/kg)
A
(g/kg)
Classe
USDA
C.O.
(g/kg)
S.O.
(g/kg)
pH H2O
CaCO3
(g/kg)
A2 5-12 703 137 15 50 95 SF 2,30 4,00 8,6 107
2Bt1 13-35 619 116 25 60 180 FS 1,00 1,70 8,5 59
2Bt2 36-110 728 82 30 40 120 FS 1,10 1,90 8,4 72
Classification : Haplic Luvisol (WRB, 2006)
Considérations pédologiques : Les sols développés en cette sous-unité ont, comme caractère commun, un horizon très sombre sous-superficiel. Celui-ci, en effet, commence à une profondeur d’environ 10 cm et se termine à 100 cm environ de la surface, avec colorations bruno-jaunâtres ou bien brunes très sombres et chroma 3. Cet horizon sous-superficiel sombre est visible en manière relativement continue en toute la sous-unité : dans les sols développés sur éolianites, en ceux développés sur matériau alluvial, en ceux développés directement sur affleurements du Néogène ; ce qui laisse envisager des anciens processus pédogénétiques de mélanisation corrélés à facteurs favorables par rapport au climat et à la végétation.
Les premières observations, en effet, étant donné la coloration particulièrement sombre de ces horizons et quelques évidences d’activité biologique passée, parmi lesquelles des restes de coprolithes et des accumulations de substance organique, avaient fait envisager des sols iso-humiques, enrichis en substance organique jusqu’à des profondeurs élevées. Les résultats analytiques, toutefois, ne mettent pas en évidence une élevée teneur de carbone organique, toujours <0,6%, valeur limite pas atteint pour considérer l’horizon comme mollique. Probablement, à cause de l’âge élevée, ces sols ont subi des pertes progressives en carbone organique le long du temps et aussi, ensuite, des processus de lessivage, avec la formation d’horizons illuviaux enrichis en argile en rapport aux horizons surjacents.
Le P55 a été décrit en correspondance à un affleurement d’argiles du Néogène, sur le côté ouest du Oued Labjal ; en outre, il présente à son propre intérieur des stone lines à profondeurs diverses, correspondantes probablement à différents événements de crue à énergie de déposition plus ou moins élevée. Une stone line se trouve entre 10 et 12 cm, indiquant des phénomènes relativement récents.
Dans l’image ci-dessous (Fig. 518-7) on peut observer un agrandissement sur la paroi orientale du Oued Labjal ; en ce cas le matériau pariétal du sol est constitué d’éolianites.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
95
Fig. 518-7 Horizon sombre dans un dépôt d’éolianites
En ce cas l’horizon noirci se trouve entre 45 et 95 cm de profondeur. Il a été nommé 2Ab, pour indiquer un sol enfoui, développé à partir de matériau parental divers et formé par un processus pédogénétique plus ancien par rapport à celui qui a porté à la formation du sol situé au-dessus, avec des évidences d’action éolienne plus récent. La coloration particulièrement sombre en cette partie du talus avait amené à penser au début qu’il pouvait s’agir d’un ancien Chernozem ; mais on ne peut toutefois le classer comme tel, étant donné la teneur élevée en carbonates de calcium.
Sous l’horizon 2Ab est présente une stone line constituée de cailloux de petites dimensions et de gastéropodes terrestres, de peu de cm d’épaisseur, indice de déposition fluviale. Sur le même talus, un peu plus à sud, au dessous de l’horizon 2Ab l’on observe une épaisseur de 3 m environ déolianite, qui repose sur une terrasse de 2e niveau géomorphologique.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
96
5.1.6. Unité 6 : Zone d’endoreisme ancien avec des dunes fossiles
Localisation de l’unité : l’unité occupe un secteur circonscrit de la zone d’étude, situé près de la limite sud-ouest de la zone d’étude.
Extension de l’unité : environ 625 ha
Altitude : 780-810 m s.n.m.
Pente : de basse à modérée.
Utilisation du sol : des surfaces de dimensions réduites à nord-ouest de l’unité, limitées aux plaines légèrement déprimées, sont intéressées par des cultures céréalières (orge surtout), tandis que les versants à faible pente du secteur occidental sont intéressés par l’arboriculture (en particulier oliviers, arbres fruitiers et Opuntia ficus indica) ; enfin, lorsque la pente des versants et l’altitude augmentent, les pâturages caractérisés par végétation naturel deviennent dominants.
Substrat : matériaux du Néogène (alternance de sables et d’argiles, formation Segui et Beglia).
Géomorphologie : l’unité repose pour la plupart sur une terrasse du 2e niveau (Capsien-Holocène) ; dans les parties plus basses, toutefois, on rencontre le 1e niveau.
Description générale : le paysage de l’unité est caractérisé par l’alternance de formes en relief et déprimées : dunes fossiles de grandes dimensions, de la forme typique “en croissant”, entourent des zones plus déprimées de terrasses alluviales du 2e niveau
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
97
géomorphologique. Ces formes sont considérées héritées et proviennent de dynamiques passées d’action combinée hydrique et éolienne.
Les facteurs qui on produit le paysage actuel ont été dominés du fait que l’unité se trouve dans un bassin endoréique, c’et-à-dire « avec des cours d’eau sans embouchures à la mer » (Castiglioni, 1991), qui n’ont pas donc d’issues à sud.
Précédemment l’Oued Saboun coulait vers le sud, mais des mouvements tectoniques et des systèmes de failles orientés NO-SE ont dévié son cours et par conséquent ont créé l’endoréisme actuel. Le réseau hydrographique, qui prenait sa source de l’anticlinal, à nord de la zone d’étude, convergeait vers le sud, dans la partie la plus déprimée ; c’est pourquoi que l’on a eu ici la formation de stagnations d’eau douce ou d’élargissements temporaires, plus ou moins fréquents et durables.
Les phases les plus arides, alternées à celles plus froides et humides correspondantes approximativement aux phases glaciaires du Quaternaire, ont provoqué l’assèchement et le dessèchement de ces dépressions et le remaniement des sédiments sableux locaux par l’action éolienne dominante combinée, qui a érodé les particules de poussière plus fines au centre des dépressions et les a accumulés aux bords, avec la formation des structures typiques “en croissant” .
Actuellement l’apport de matériau par les vents est moins important dans cette zone par rapport à d’autres, quoique il y ait une couverture éolienne diffuse en surface.
Cette alternance de formes se reflète dans l’utilisation différente du sol, qui en général voit les dépressions, caractérisées par une humidité plus forte et par des sols plus profonds, occupées par des champs de céréales et par l’arboriculture, tandis que les dunes fossiles sont stabilisées par des plantions de Opuntia f. i. ou par la végétation naturelle.
Sous-unités : –
Profil type : P37 et P40.
Autres profils : P36, P38, P39.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
98
Profil type : P37
Localité Garit ar Nzabadir
Référence Cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S446889-3859790
Altitude 785 m s.n.m.
Pente < 2%
Exposition 250° N
Pierrosité absente
Rochosité absente
Utilisation du sol pâturage naturel, riche de cruciféracées aux bord d’un champ semé en orge
Substrat dépôts éoliens sur des argiles du Néogène
Morphologie partie basse d’une dune éolienne stabilisée sur terrasse du 2e niveau
Drainage extérieur bon
Érosion éolienne, diffuse et faible
Notes observations profil ouvert au pied d’une dune, près du contact entre les sables et des dépôts alluviaux récents. Cimentation des horizons Btkx par compactage (fragipan) ou par des carbonates diffus.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
99
Description du profil : Horizon A : 0 à 10 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 5/4, brun jaunâtre. Texture au toucher sablo-franche. Squelette : environ 1% en volume pour des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique subangulaire, de fine à moyenne, modérée, de friable à souple. Porosité de commune à faible avec des pores très petits. Drainage rapide. Effervescence considérable. Peu de racines, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon Bt1 : 10 à 30 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre sec et humide 7,5 YR 5/6, brun fort. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette : <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements en argiles, communs, sur les faces des agrégats et dans les pores. Structure polyédrique subangulaire, grossière, forte, friable. Porosité faible avec des pores très petits. Drainage régulier. Racines absentes. Activité biologique absente. Effervescence considérable. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon Bt2 : 30 à 60 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 5/7, brun fort. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements en argiles, communs, sur les faces des agrégats et dans les pores. Structure polyédrique de subangulaire à angulaire, grossière, forte, peu dure. Porosité absente. Drainage de régulier à lent. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Horizon Btkx1: 60 à 190 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 6/4, brun jaunâtre clair. Texture au toucher limono-sableuse-argileuse. Squelette : <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements en argiles, abondants, sur les faces des agrégats et dans les pores. Structure polyédrique de subangulaire à angulaire, grossière, forte, peu dure. Cimentation par compactage et par les carbonates. Concrétions de carbonates, environ 10% en volume avec des nodules durs, au contour net et au diamètre inférieur à 0,5 cm. Porosité absente. Drainage lent. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon Btkx2 : 190 à 230 cm. Couleur è l’état sec 10 YR 5/6, jaune brunâtre. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette : <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique angulaire, grossière, forte, très dure. Cimentation par compactage et les carbonates diffus. Concrétions de carbonates, environ 15% en volume avec des nodules durs, au contour net et au diamètre inférieur à 0,5 cm. Porosité absente. Drainage lent. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 2Btb : 230 cm et plus. Couleur à l’état sec 7,5 YR 7/6, brun fort. Texture au toucher limono-argileuse. Squelette : <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements en argiles, abondants, sur les faces des agrégats et dans les pores. Structure polyédrique angulaire, grossière, forte, très dure. Concrétions de carbonates : 5% en volume avec des nodules durs, au contour net et au diamètre inférieur à 0,5 cm, associés à pseudomycélium aux éléments très fins. Porosité absente. Drainage lent. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
100
Analyses de laboratoire :
Horiz. prof. (cm) CEes (dS/m) Sali (%) pH Es Na+ es Ca2+ es Mg2+ es K+ es
A 10 0,5 0,06 x 0,02 0,04 0,01 0,01
Bt 30 0,5 0,06 8,2 0,05 0,04 0,02 0,02
Btk 60 0,4 0,07 8,1 0,04 0,02 0,01 0,01
Btkx1 190 0,4 0,07 8,1 0,03 0,00 0,01 0,01
Btkx2 230 1,8 0,60 7,9 0,07 0,06 0,03 0,28
2Btb >230 2,8 1,05 1,02 0,15 0,10 0,03
Horiz. SK (g/kg) SG (g/Kg) SM (g/Kg) SF (g/Kg) SMF (g/Kg) L(g/Kg) A (g/Kg) Classe USDA
A 30 26 168 283 411 45 67 S
Bt 13 39 166 401 269 35 90 S
Btk 7 34 138 338 263 67 160 FS
Btkx1 2 10 42 271 564 48 65 S
Btkx2 4 4 17 253 611 38 77 S
2Btb
Classification : Luvic Calcisol (Aridic) (WRBSR, 2006)
Horiz. pH H2O pH KCl CaCO3 (g/kg) C.O. (g/Kg) S.O. (g/Kg)
A 8,5 7,8 96 4,30 7,40
Bt 8,5 7,7 89 3,50 6,00
Btk 8,6 7,7 142 1,30 2,20
Btkx1 8,3 7,9 149 1,30 2,20
Btkx2 9 8 193 1,00 1,70
2Btb 8,4 7,8 174 2,80 4,80
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
101
P40
Localité Garit ar Nzabadir
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S446755-3860552
Altitude 778 m s.n.m.
Pente absente
Exposition totale
Pierrosité absente
Rochosité absente
Utilisation du sol champs semés en orge
Substrat succession de dépôts éoliens et alluviaux sur calcaires du Crétacé
Morphologie plate sur terrasse alluviale du 1e niveau
Drainage extérieur bon
Érosion éolienne, diffuse et faible
Notes et observations profil ouvert entre deux parcelles en orge. Revêtements dans le 2Bt1 peu évidents
Description du profil :
Horizon A : 0 à 10 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 5/3,5, entre le brun sombre et le brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Agrégation de lamellaire, de fine à moyenne, modérée dans les premiers 2 cm à polyédrique subangulaire, fine, de faible à modérée, friable dans les cm
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
102
restants. Porosité faible avec des pores très petits. Drainage rapide. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 2Btk1 : 10 à 40 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre sec et humide 10 YR 4/3, intermédiaire entre brun et brun sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements en argiles, entre communs et abondants, sur les faces des agrégats et dans les pores. Agrégation entre la polyédrique subangulaire et l’angulaire, de moyenne à grossière, forte, friable. Porosité faible avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines de peu nombreuses à absentes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon 2Btk2 : 40 à 80 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre sec et humide 10 YR 4/4, brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette <1% en volume avec des éléments petits et arrondis. Revêtements en argiles, abondants, sur le faces des agrégats et dans les pores. Agrégation entre polyédrique subangulaire à angulaire, grossière, forte, friable. Concrétions de carbonates inférieures à 5% en volume avec des nodules peu nombreux, isolés, au diamètre inférieur à 1 cm. Porosité absente. Drainage régulier. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon C : 80 à 120 cm et plus. Succession de dépôts éoliens et alluviaux, ces derniers constitués par une alternance de graviers de petite taille et sables. Couleur à l’état sec 10 YR 5/4, brun jaunâtre. Squelette environ 20-30% en volume avec des éléments petits et arrondis. Agrégation plyédrique subangulaire, moyenne, forte, dure. Porosité absente. Drainage lent. Effervescence considérable. Racines et activité biologique absents.
Analyses de laboratoire :
Horiz. SK (g/kg) SG (g/Kg) SM (g/Kg) SF (g/Kg) SMF (g/Kg) L(g/Kg) A (g/Kg) Classe USDA
A 14 97 168 256 299 105 75 SF
2Btk1 7 18 93 176 513 25 175 FS
2Btk2 9 22 100 196 357 85 240 FSA
2Cb x x x x x x x x
Horiz. prof. (cm)
CEes
(dS/m) SP
(%) Sels (%)
Na+ es
(méq/100g)
Ca2+es
(méq/100g)
Mg2+ es
(méq/100g)
K+ es
(méq/100g)
A 10 0,4 22,4 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02
2Btk1 40 0,4 35,1 0,09 0,03 0,01 0,02 0,01
2Btk2 80 0,6 32,0 0,12 0,09 0,04 0,25 0,01
2Cb 120 3,7 29,2 0,68 0,04 0,04 0,02 0,02
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
103
Horiz. C.O. (g/kg) S.O. (g/kg) pH Es pH H2O pH KCl CaCO3 (g/kg) CSC (méq/100g)
A 5,90 10,20 8,2 8,3 7,6 97 6,65
2Btk1 3,80 6,60 7,8 8,4 7,5 210 7,95
2Btk2 2,30 4,00 7,9 8,5 7,6 194 8,21
2Cb 2,50 4,30 7,8 8,1 8,1 129 x
Classification : Luvic Calcisol (WRBSR, 2006)
Considérations pédologiques : Pour caractériser les environnements divers de l’unité ont été ouvertes et décrites 2 chaînes de sols : la première se compose des deux profils P36 et P37 et a été réalisée le long du versant d’une dune fossile, tandis que l’autre a été réalisée pour décrire le niveau plus bas et déprimé de la zone et comprend les P38, P39 et P40, localisés respectivement sur CT3, T2 et T1.
Le P36 se trouve sur la partie médio-haute du versant sur matériau argileux du Néogène et il est couvert par un mince voile éolien ; le P37, au contraire, a été ouvert dans la partie plus basse à plus faible pente, où l’accumulation de sables éoliens est plus ancienne en rapport au précédent. Les profils présentent des caractéristiques très semblables, soit d’un point de vue morphologique qu’au regard des paramètres chimiques ; on observe seulement une plus grande profondeur du P37, avec un horizon enfoui 2Btb qui commence à la profondeur de 230 cm.
Dans les deux profils on a observé la présence de fragipan au-delà de 60 cm, c’est-à-dire un horizon très dur et compact à l’état sec, et extrêmement fragile à l’état humide. Il s’est formé par compactage à la suite de l’alternance de saturation hydrique et d’assèchement et par cimentation par le carbonate de calcium diffus en tout le profil.
On y trouve en outre des évidences d’illuviation de l’argile, avec abondantes pellicules sur les faces des agrégats et une élevée augmentation de sa teneur en Btk au regard de l’horizon surjacent. Le sol a un pH particulièrement élevé (toujours >8,3) et la teneur en carbonate équivalent croît vers le bas. Aussi la valeur de ECes, et par conséquent le taux de sels présents, augmente avec la profondeur, même si elle reste en tous cas inférieure aux 4 dS/m. La CEC est basse en tout le profil, toujours inférieure à 10 méq/100g de sol.
Quant aux sols de l’autre chaîne, au contraire, le P38 se trouve en correspondance à un site archéologique, où l’on a retrouvé en surface des restes de la période Romaine.
Des horizons noircis et nombreuses taches d’oxido-réduction y sont présentes, indice de conditions de stagnation hydrique faisant envisager la présence d’eau par le passé.
L’horizontation est du type : A-Bw-C1-2Ab-2C1b-2C2b avec l’horizon enfoui 2Ab anthropique, très sombre, avec des fragments céramiques Romains à son intérieur et contenu en substance organique égale à l’1%, valeur plus élevée en rapport au reste du profil.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
104
Le P39, situé à la limite du bassin endoreïque, au bord extérieur de la zone déprimée, c’est un sol peu évolué avec horizontation A-Bw-C1-C2.
Le P40, enfin, situé au centre de la dépression entre deux parcelles d’orge, présente des horizons très sombres, une plus grande humidité par rapport aux autres sols de la zone, des abondants revêtements d’argile sur la surface des agrégats en Bt et carbonate de calcium diffus le long de tout le profil, témoignant d’une forte humidité dans la phase de formation, suivie par une recarbonatation en des phases ou saisons plus contrastées. Dans ce cas aussi, la teneur en substance organique d’environ 1% est relativement élevée par rapport aux autres valeurs retrouvées dans la région.
5.1.7. Unité 7 : Terrasses alluviales
Localisation de l’unité : elle s’étend dans tout le secteur centro-oriental de la zone d’étude, dont occupe vastes extensions, et dans la partie sud-occidentale.
Extension de l’unité : environ 9000 ha.
Altitude : 800 m s.n.m. (altitude prédominante, avec des secteurs, limités à nord-ouest, qui atteignent 880 m s.n.m., et des parties très surbaissées à sud-ouest, avec des altitudes de 700 m s.n.m.).
Pente : de nulle à basse.
Utilisation du sol : tout le secteur oriental de l’unité est assez homogène et occupé par des cultures céréalières ; dans la partie centrale, aux cultures céréalières s’unissent l’arboriculture et des espaces couverts de végétation naturelle utilisée pour le pâturage.
Substrat : il est caractérisé par matériau du Néogène (alternance de sables et d’argiles, formation Beglia et Segui) recouvert de dépôts peu hétérométriques dominés par des matériaux sableux.
Géomorphologie : terrasses alluviales du 2e niveau (Capsien-Holocène).
Description générale : l’unité est très étendue ; par conséquent elle offre un paysage hétérogène à son intérieur, même si la nature alluviale des dépôts et la forte empreinte laissée sur la formation des sols par les processus hydriques sont les caractéristiques plus communes en toute la zone. Le secteur oriental est fortement lié aux dynamiques de l’Oued Saboun, dont les épandages alluviaux, en particulier, ont fortement affecté le paysage. En ce secteur du paysage on observe en outre des langues allongées de forme irrégulière,
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
105
formées par le transport en masse, pendant des périodes de crue particulièrement turbulentes, de matériau grossier, érodé par les versants plus à nord et déposé plus à sud, à la suite de la diminution de l’énergie du transport.
Le secteur le plus central de l’unité, au contraire, est caractérisé par des dépôts constitués de matériau plus fin et les dynamiques dominantes sont dues au caractère endoreïque de cette zone.
En se déplaçant vers sud-ouest dans la zone d’étude, les processus éoliens prennent une plus grande importance relative et les sols développés en cette sous-unité reflètent les deux caractères, alluvial et éolien, de l’environnement dans lequel ils se sont formés.
L’unité en générale est caractérisée par des sols profonds, ayant un bon degré de développement ; c’est pour cela qu’ils sont utilisés à buts agricoles, surtout pour la céréaliculture, et secondairement pour l’arboriculture. Cette-ci, toutefois, dans les dernières années est en train de s’imposer dans la région et particulièrement sur ces surfaces.
Profil type : P59, P60, P41 (sous-unité des épandages alluviaux)
Sous-unités : 1 Épandages alluviaux
2 Zone endoreïque
3 Zone avec voiles éoliens répandus
5.1.7.1. Sous-unité 1. Épandages alluviaux
Description générale : cette sous-unité se présente homogène du point de vue de l’utilisation du sol, parce qu’elle est caractérisée presque entièrement par des vastes cultures de céréales et, seulement en plus petite mesure, par l’arboriculture (oliviers surtout). La surface est en générale plate et développée sur matériau alluvial soit fin que grossier, selon l’énergie de déposition. On peut distinguer une partie plus septentrionale de
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
106
la sous-unité, avec des accumulations de matériau caillouteux à la base et des couvertures sableuses éoliennes discontinues et d’épaisseur variable en surface (qui peuvent porter à la formation de dunes) engendrées à cause d’une circulation locale des vents, qui en ce secteur soufflent en direction nord-ouest. Ces vents se chargent de matériau fin plus à sud (et le lit du Oued Saboun constitue une bonne source de sable) et le relâchent au pied du relief Goubel, qui fait obstacle au transport.
La partie plus méridionale, au contraire, n’est pas sujette à une accumulation éolienne importante et les dynamiques dominantes sont strictement liées aux épandages alluviaux de l’Oued Saboun et de son réseau hydrographique secondaire, avec dépôts caractérisés par des éléments plus fins au regard du cas précédent. Dans cette zone sont présents nombreux ravins actifs qui, au cours des périodes de plus grande concentration d’événements pluvieux servent de collecteurs au rapide découlement des eaux, et par conséquent subissent des ultérieurs processus d’incision et de recul.
Une autre différentiation du paysage, enfin, est donnée de la présence de langues allongées en direction prédominante NO-SE, dont la formation, comme déjà dit, peut être ramenée à des épisodes de crue particulièrement turbulents, développant des énergies capables d’éroder et transporter aussi des cailloux de grands dimensions. Ces langues, en effet, sont constituées de matériau grossier calcaire diffus aussi en surface.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
107
Profil type de la partie septentrionale des épandages alluviaux : P59
Localité Garit al Arar
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S443579-3868789
Altitude 856 m s.n.m.
Pente 2%
Exposition 300°N
Pierrosité 25%
Rochosité absente
Utilisation du sol pâturage naturel généralement à Stipa tenacissima, près des cultures de céréales
Substrat matériau du Néogène avec accumulation de matériau alluvial sableux et grossier du Quaternaire
Morphologie surface plate sur terrasse du 2e niveau
Drainage extérieur bon
Érosion voile éolien très mince
Notes -
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
108
Description du profil : Horizon A1 : 0 à 10 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 5/6, brun sombre, à l’état humide 7,5 YR 4/6 brun sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : absente. Structure polyédrique subangulaire, fine, modérément développée. Porosité commune et pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes et petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Notes : matériau éolien.
Horizon A2 : 10 à 25-40 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 4/6, brun jaunâtre sombre, à l’état humide 10 YR 3/6 brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : <5% en volume avec des éléments petits et angulaires. Structure polyédrique subangulaire, moyenne, modérément développée. Porosité commune avec des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et ondulée.
Horizon 2Bt : 25-40 à 95 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 3,5/3,5, brun sombre, à l’état humide 7,5 YR 2,5/3 brun très sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : <5% en volume avec des éléments petits et angulaires. Concrétions de carbonate de calcium <2% en volume moyennes. Structure polyédrique angulaire, grossière, fortement développée. Porosité commune avec des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et ondulée.
Horizon 2Ck : 95 à 118 cm. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : entre 35 et 70% en volume avec des éléments grossiers et angulaires. Porosité absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon 3Bkx : 118 à 150 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 4/6, brun jaunâtre sombre, à l’état humide 10 YR 4/4 brun. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : 5<% en volume avec des éléments petits et angulaires. Structure polyédrique angulaire, grossière, fortement développée. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes. Porosité faible avec des pores petits et moyens. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Notes : on observe endurcissement de type fragipan.
Horizon 3Ck1 : 150 à 158 cm. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette : >70% en volume avec des éléments grossiers et angulaires. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes. Porosité absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon 3Ck2 : 158 à 164 cm. Squelette : >70% en volume avec des éléments grossiers et angulaires. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
109
Horizon 3Ck3 : 164 à 190 cm. Squelette : >70% en volume avec des éléments grossier et angulaires. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Notes : présence de silex.
Horizon 3Ck4 : 190 à 210 et plus. Squelette : >70% en volume avec des éléments grossiers et angulaires. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes.
Analyses de laboratoire :
Horiz. prof. (cm) pH H2O CaCO3
(g/kg)
SG
(g/kg)
SF
(g/kg)
LG
(g/kg)
LF
(g/kg)
A
(g/kg)
Classe
USDA
C.O.
(g/kg)
S.O.
(g/kg)
A2 0-25/40 8,4 114 227 468 55 45 205 FSA 4,00 6,90
2Bt 26/41-95 8,3 114 502 98 65 65 270 FSA 3,70 6,40
3Bkx 118-150 8,5 153 590 105 70 90 145 FS 3,90 6,70
Classification : Calcic Luvisol (Fragic) (WRBSR, 2006
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
110
Profil type de la partie méridionale de l’épandage alluvial : P60
Localité Hannashi
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S448246-3867824
Altitude 778 m s.n.m.
Pente 1%
Exposition Totale
Pierrosité 2%
Rochosité absente
Utilisation du sol champ labouré en vue d’une culture céréalicole
Substrat matériau du Néogène avec accumulation de matériau alluvial sableux fin du Quaternaire
Morphologie terrasse du 2e niveau
Drainage extérieur bon
Érosion hydrique canalisée forte avec ravins d’érosion et diffuse modérée (croûte superficielle sous le cm par l’action battante de la pluie)
Notes profil creusé près d’un ravin ; présence de tabias orientées perpendiculairement à l’écoulement superficiel
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
111
Description du profil : Horizon A(h)k : 0 à 8 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 5/4, brun jaunâtre, à l’état humide 10 YR 4/4 Texture au toucher limono-sableuse. Squelette : <5% en volume avec des éléments petits subarrondis. Concrétions de carbonate de calcium <2% en volume de petites dimensions. Structure lamellaire, moyenne, modérément développée et consistance friable. Porosité commune, pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes et petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Notes : matériau éolien.
Horizon 2Btk : 8 à 103. Couleur à l’état sec 7,5 YR 3,5/3, intermédiaire entre brun et brun sombre, à l’état humide 7,5 YR 3/3 brun sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : <5% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Concrétions de carbonate de calcium <2% en volume de petites dimensions. Structure prismatique, grossière, fortement développée et consistance forte. Porosité commune avec des pores moyens. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, moyennes, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et ondulée.
Notes : présence de résidus de coquilles.
Horizon 2Btkx : 103 à 180 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 5/4, brun jaunâtre et brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : <5% en volume avec des éléments petits et subarrondis. Concrétions de carbonate de calcium entre 5 et 20% en volume de dimensions moyennes. Structure prismatique, grossière, fortement développée et consistance très forte. Présence de pellicules d’argile communes entre 25 et 50% dans les pores et sur les faces des agrégats. Porosité commune avec des pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et ondulée.
Horizon 3Cm : 180 à 214 cm. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette : >70% en volume, avec des éléments moyens et angulaires. Consistance extrêmement forte. Porosité absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et ondulée.
Horizon 3Ck : 214 à 234 cm. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette : entre 35 et 70% en volume avec des éléments petits et angulaires. Consistance extrêmement forte. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes. Porosité faible avec des pores petits et moyens. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et discontinue.
Horizon 3Ck2 : 234 à 264. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette : entre 35 et 70% avec des éléments petits et angulaires. Consistance extrêmement forte. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes. Porosité absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et irrégulière.
Horizon 4CRkm : 264 cm et plus. Squelette : entre 35 et 70% en volume avec des éléments petits et irréguliers. Consistance extrêmement forte. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
112
Analyses de laboratoire : Horiz. prof. (cm) pH H2O CaCO3
(g/kg)
SG
(g/kg)
SF
(g/kg)
LG
(g/kg)
LF
(g/kg)
A
(g/kg)
Classe
USDA
C.O.
(g/kg)
S.O.
(g/Kg)
A(h)k1 8 8,3 190 415 170 49 196 170 FS 5,70 9,80
Btk2 103 8,3 149 442 153 20 100 285 FSA 2,60 4,50
2Btkx 180 8,5 271 377 203 45 130 245 FSA 2,20 3,80
Classification : Calcic Luvisol (Fragic) (WRBSR, 2006)
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
113
Profil type de l’épandage alluvial à haute énergie : P41
Localité Farsh al Hannashi
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S44835-3865576
Altitude 813 m s.n.m.
Pente 3%
Exposition totale
Pierrosité 70%
Rochosité absente
Utilisation du sol oliveraie et implantation de Opuntia ficus indica
Substrat matériau argileux du Néogène sous une accumulation de matériau alluvial grossier et arrondi de nature calcaire du Quaternaire
Morphologie partie basse du versant sur une terrasse du 2e niveau
Drainage extérieur bon
Érosion éolienne diffuse faible
Notes les horizons C sont constitués des alternances de matériau sableux et caillouteux avec des concrétions de carbonate de calcium
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
114
Description du profil : Horizon A : 0 à 30 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 4/4, brun, à l’état humide 7,5 YR
3/3 brun sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette commun : entre 5 et 15% en volume avec des éléments moyens. Structure polyédrique angulaire, grossière, fortement développée. Porosité commune, pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines abondantes et petites, à trajectoire oblique et verticale. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et ondulée.
Horizon CA : 30 à 40 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 4/4, brun, à l’état humide 7,5 YR 3/3 brun sombre. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette abondant : entre 35 et 70% en volume avec des éléments moyens et arrondis. Structure polyédrique subangulaire, moyenne, faiblement développée. Porosité commune, pores moyens. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Horizon C1 : 40 à 60 cm. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette très abondant : >70% avec des éléments moyens et arrondis. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Notes : les cailloux constituant le squelette sont aplatis et anguleux.
Horizon C2 : 60 à 80 cm. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette très abondant : >70% pur des éléments moyens et arrondis. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Notes : matrice ferrugineuse.
Horizon C3 : 80 à 105 cm. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette très abondant : >70% pur des éléments moyens et arrondis. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon C4 : 105 à 122 cm. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette : absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Notes : horizon sableux.
Horizon C5 : 122 à 200 cm et plus. Texture au toucher argileuse. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente.
Notes : argiles rouges et vertes du Néogène, avec couleur respectivement 7,5 YR 5/6 et 5Y 5/4.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
115
Analyse de laboratoire :
Horiz. prof. (cm) pH H2O CaCO3
(g/kg)
SG
(g/kg)
SF
(g/kg)
LG
(g/kg)
LF
(g/kg)
A
(g/kg)
Classe
USDA
C.O.
(g/kg)
S.O.
(g/kg)
A 0-25 8,4 91 600 190 6 4 200 FS 4,10 7,10
Classification : Hyperskeletic Leptosol (Aridic) (WRBSR, 2006)
Considérations pédologiques : Les sols observés en cette sous-unité présentent la caractéristique commune d’avoir un horizon très sombre, avec des épaisseurs, en général, d’environ 30 cm, des valeurs de chroma sèches généralement inférieures au 3, une structure souvent grossière de modérément à fortement développée et le contenu équivalent en carbonate de calcium toujours abondant ; la réaction à l’HCl est, en effet, toujours considérable et souvent sont présentes des concrétions de petite taille de CaCO3. Le contenu en carbone organique (généralement <0,6%), toutefois, ne permet pas d’insérer ces sols dans le group des Kastanozems, selon les hypothèses avancées d’abord sur le terrain.
En particulier, dans la partie plus septentrionale (P59) de cette sous-unité, ces sols peuvent se trouver sous une couverture de matériau éolien de plus récente déposition et faiblement pédogénisée.
Dans la partie plus méridionale (P60), les sols observés présentent une succession d’horizons foncés jusqu’à 100 cm de profondeur, tandis qu’au dessous on rencontre des horizons enrichis en argile sous la forme d’abondantes pellicules sur les faces des agrégats et sur les parois des pores particulièrement durcis, en formant ainsi le fragipan.
Enfin, en correspondances des langues allongées constituées de matériau calcaire grossier (P41), les sols présentent un degré de développement inférieur par rapport aux autres plus haut décrits, avec épaisseurs limitées et absence d’un horizon B. L’horizon superficiel A ou Ah (souvent 25 cm environ), selon la teneur en substance organique, repose directement sur matériau alluvial grossier, avec des cailloux arrondis et calcaires plongés dans une matrice sableuse plus fine. Au dessous (à la profondeur de 150 cm environ) affleure le Néogéne sous forme de couches de sables ou argile, selon la position dans laquelle on effectue le creusage.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
116
5.1.7.2. Sous-unité 2. Zone endoréique
Description générale : cette sous-unité est située au centre de l’unité et se caractérise parce qu’elle se trouve dans une légère dépression par rapport aux zones adjacentes. Elle est donc sujette à des phénomènes locaux d’endoréisme. La surface est pour la plupart plate, même si la pente localement suit un gradient NO-SE avec un pendage de peu de degrés vers NO. Les eaux de ruissellement superficielles sont canalisées par conséquent vers les parties plus basses, où s’infiltrent jusqu’à ce qu’elles rencontrent les couches argileuses du Néogéne, qui dans ces zones sont dominantes, et qui permettent ainsi le maintien d’un certain degré d’humidité dans le sol.
Ces surfaces sont occupées par des champs arables, en général, et secondairement par des cultures arboricoles. Seulement des extensions réduites, dans les parties marginales, sont utilisés pour le pâturage.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
117
Profil type: P51
Localité Ghdir om al Khrakhir
Référence cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S440526-3858109
Altitude 805 m s.n.m.
Pente absente
Exposition totale
Pierrosité 5%
Rochosité absente
Utilisation du sol terrain inculte entre deux champs d’orge
Substrat matériau du Néogène
Morphologie terrasse du 2e niveau
Drainage extérieur bon
Érosion mince voile éolien
Notes
zone de convergence des eaux de ruissellement. À la profondeur de 2 m environ sont visibles les argiles rouges du Néogène. On observe une augmentation d’argile en allant de haut en bas.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
118
Description du profil :
Horizon Ap1 : 0 à 2 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 5/4, brun jaunâtre, à l’état humide 10 YR 4/4 brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette absent. Structure lamellaire, fine et consistance friable. Porosité abondante, pores petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines abondantes très petites, petites, moyennes et grandes, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon Ap2 : 2 à 22 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 3/4, brun jaunâtre sombre. Texture au toucher argileuse. Squelette : <5% en volume avec des éléments très petits et arrondis quartzeux. Concrétions de carbonate de calcium <2% en volume de dimensions moyennes. Structure polyédrique subangulaire, moyenne et grande, modérément développée et consistance dure. Porosité abondante avec des pores petits. Drainage régulier. Effervescence considérable. Racines abondantes très petites, petites, moyennes et grandes à trajectoire oblique et verticale. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon Bt1 : 22 à 60 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 3/6, brun jaunâtre sombre. Texture au toucher argileuse. Squelette : <5% en volume avec des éléments très petits et arrondis. Concrétions de carbonate de calcium <2% en volume, moyennes. Structure polyédrique subangulaire, moyenne, modérément développée et consistance forte. Pellicules d’argiles et ferromanganesifères communes entre 25 et 50% dans les pores et sur les faces des agrégats. Porosité commune avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes petites et moyennes. Activité biologique absent. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Horizon Bt2 : 60 à 135 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 4/3, brun. Texture au toucher argileuse. Squelette : <5% en volume, avec des éléments très petits, arrondis, de nature quartzeuse. Concrétions de carbonate de calcium <2% moyennes. Structure polyédrique angulaire, très grande, fortement développée et consistance forte. Pellicules d’argile et ferromanganesifères abondantes >50% dans les pores et sur les faces des agrégats. Porosité commune avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines communes moyennes à trajectoire oblique et verticales. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent graduelle et linéaire.
Horizon Bt3 : au-dessous de 135 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 4/6, brun sombre, couleur taches 10 YR 4/3 brunes. Texture au toucher argileuse. Squelette absent. Structure polyédrique angulaire, très grande, fortement développée et consistance forte. Drainage normal. Effervescence considérable. Pellicules d’argile et ferromanganesifères abondantes >50% dans les pores et sur les faces des agrégats. Porosité faible avec des pores très petits. Racines absentes. Activité biologique absente.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
119
Analyses de laboratoire :
Horiz. prof. (cm) pH H2O CaCO3
(g/kg)
SG
(g/kg)
SF
(g/kg)
LG
(g/kg)
LF
(g/kg)
A
(g/kg)
Classe
USDA
C.O.
(g/kg)
S.O.
(g/kg)
Ap 2-22 8,3 162 259 121 -5 175 450 A 4,70 8,10
Bt1 22-60 8,4 161 229 91 40 165 475 A 3,20 5,50
Bt2 60-135 8,7 173 199 116 0 185 500 A 2,50 4,30
Classification définitive : Cutanic Calcic Luvisol (Clayic) (WRBSR, 2006)
Considérations pédologiques : le P51 est le profil le plus caractéristique de tous ceux observés dans cette zone. Le caractère plus évident de ce sol est son élevée teneur en argile, qui augmente avec la profondeur. Il semble que le processus dominante qui a porté à la formation de ce sol ait été le lessivage de l’argile, mis en évidence par la présence de pellicules sur la faces des agrégats et sur les parois des pores, en quantité d’autant plus grande que la profondeur augmente, à partir de Bt1. Les résultats analytiques aussi révèlent une texture argileuse le long du profil, avec une progressive augmentation de haut en bas. La présence même d’élevées teneurs en argile dans l’horizon superficiel Ap peut être causée par les labours avec la charrue, qui pourraient avoir remué le sol, porté à la surface une partie d’horizons sous-superficiels et provoqué un ultérieur enrichissement en argile de ces derniers.
En dépit de l’aridité climatique, le caractère endoréique de la zone et la situation de talweg qui vient se créer favorisent le processus de translocation des argiles en solution. Les élevées valeurs en carbonates de calcium le long de tout le profil (environ 15%), suggèrent l’alternance de processus de décarbonatation, lessivage et recarbonatation secondaire.
5.1.7.3. Sous-unité 3. Zone avec diffus voiles éoliens
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
120
Description générale : cette sous-unité occupe le secteur sud-ouest de la zone d’étude et se développe dans la zone d’influence de l’Oued Saf-saf. Dans ce cas aussi on a observé des zones avec des accumulations d’une dimension plus grande, qu’on peut ramener à des épisodes turbulents de crue, et d’autres avec du matériau plus fin. La zone est exposée à l’action des vents dominants provenant de nord-ouest, qui relâchent en ce secteur même les particules transportées et recouvrent les surfaces avec des couvertures d’une épaisseur inférieure par rapport à celles qui caractérisent la sous-unité “Sédimentation récente”. Dans l’image rapportée ci-dessous, sont visibles une panoramique de la zone d’intérêt et au loin un groupement de rebdou, indicateurs d’accumulation éolienne. Les vastes surface alluviales sont intéressées par l’arboriculture, surtout plus à nord, et par des champs arables, interrompus sporadiquement par des zones utilisées pour le pâturage, avec une végétation plutôt rare et dégradée.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
121
Profil type: P45
Localité Ganzou
Référence Cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S436535-3852149
Altitude 740 m s.n.m.
Pente absente
Exposition totale
Pierrosité 15%
Rochosité absente
Utilisation du sol champs à semer en légumineuses
Substrat matériau du Néogène
Morphologie terrasse du 2e niveau, partie basse d’un versant
Drainage extérieure bon
Érosion voile éolien
Notes forte empreinte éolienne dans les horizons superficiels et présence de pellicules d’argile sur la face des agrégats entre 40 cm et 2 m.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
122
Description du profil : Horizon A1 : 0 à 10 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 4,5/6, brun fort, à l’état humide 7,5 YR ¾ brun sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette <5% en volume avec des éléments petits et moyens, angulaires. Structure polyédrique angulaire, fine et moyenne modérément développée. Porosité commune avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites et moyennes, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon A2 : 10 à 40 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 4,5/6, brun fort, à l’état humide 7,5 YR 3/4 brun sombre. Texture au toucher limono-sableuse. Squelette <5% en volume avec des éléments petits et moyens, angulaires. Structure polyédrique angulaire, fine et moyenne modérément développée. Porosité commune pour des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites et moyennes, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 2Btk1 : 40 à 90 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 5/4, brun jaunâtre, à l’état humide 10 YR 4,5/6 entre brun jaunâtre et brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette <5% en volume pour des éléments petits et moyens, angulaires. Abondantes pellicules d’argile sur les pores et sur les faces des agrégats. Concrétions de carbonate de calcium entre 20 et 40% en volume moyennes. Structure prismatique moyenne et grande, fortement développée. Porosité absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon 2Btk2 : 90 à 210 cm. Couleur à l’état sec 10 YR 5/6, brun jaunâtre, à l’état humide 10 YR 4/6 brun jaunâtre sombre. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Squelette <5% en volume avec des éléments petits angulaires. Abondantes pellicules d’argile sur les pores et sur les faces des agrégats. Concrétions de carbonate de calcium entre 5 et 20% en volume moyennes. Structure prismatique moyenne et grande, fortement développée. Porosité absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Note : stone line entre 90 et 100 cm.
Horizon 2Btk3 : 210à 300 cm. Couleur à l’état sec 7,5 YR 5/4, brun jaunâtre, à l’état humide 10 YR 4 /4 brun jaunâtre sombre. Squelette absente. Texture au toucher limono-sablo-argileuse. Structure prismatique moyenne et grande, fortement développée. Concrétions de carbonate de calcium entre 5 et 20% en volume moyennes. Abondantes pellicules d’argile dans les pores et sur les faces des agrégats et quelques pellicules de sesquioxydes. Porosité absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent claire et linéaire.
Horizon CR : au-delà de 300 cm.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
123
Analyses de laboratoire :
Horiz. prof. (cm) pH H2O CaCO3
(g/kg)
SG
(g/kg)
SF
(g/kg)
LG
(g/kg)
LF
(g/kg)
A
(g/kg)
Classe
USDA
C.O.
(g/kg)
S.O.
(g/kg)
A1 0-10 8,5 92 696 124 20 35 125 FS 0,70 1,20
A2 10-40 8,5 154 603 112 35 65 185 FS 1,90 3,30
2Btk 40-90 8,4 275 454 126 55 100 265 FSA 0,90 1,60
Classification : Haplic Arenosol (thapto luvisolic) (WRBSR, 2006)
Considérations pédologiques : les sols observés (faisant partie de la chaîne 10) sont distribués le long d’une ligne directrice NE-SE, qui coupe transversalement la sous-unité, et sont positionnés à différentes altitudes sur la pente d’un versant faiblement incliné d’une terrasse alluviale du 2e niveau.
En tous les cas l’on observe une accumulation de matériau récent, ayant subi une pédogénèse peu accentuée. La teneur en substance organique est particulièrement faible (<0,4%) et la texture est limono-sableuse. En descendant en profondeur, au contraire, apparaissent des horizons plus structurés, avec une agrégation prismatique fortement développée et de grandes dimensions et aussi des abondantes pellicules d’argiles se montrent sur les faces des agrégats, indice d’illuviation. La teneur même en argile mesurée en laboratoire confirme l’augmentation de cette dernière en profondeur. Au dessous de 2 m apparaissent aussi des pellicules de sesquioxydes de Fe dans les parties les plus profondes du profil.
À une profondeur variable selon le profil, on rencontre diverses stone line constituées de matériau arrondi de dimension et composition variable selon l’événement qui les a déposées (cailloux calcaires surtout, et silexifères en second lieu). Dans le P46, localisé dans la partie plus basse de la chaîne, à la profondeur de 2 m environ, on relève un horizon constitué par des cailloux calcaires très gros, de transport fluvial, cimentés entre eux par du carbonate de calcium, témoignant d’un ancien événement de crue à haute énergie, probablement de l’Oued Saf Saf.
En descendant encore en profondeur, on rencontre les argiles et les sables du Néogène.
On avance donc l’hypothèse d’être en présence de sols polycycliques superposés et développés à partir de matériau parental différent : en particulier, Arenosols à bas degré de développement sur des Luvisols enfouis.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
124
5.1.8. Unité 8-9. Lit et bords fluviaux des Oueds Saboun et Saf Saf
Localisation : l’unité comprend les lits des deux Oueds principaux Saboun et Saf Saf, marquant respectivement la limite orientale et occidentale de la zone d’étude. Les Oueds découlent du système de reliefs à nord et poursuivent leur cours vers sud. À la limite méridionale de la zone, l’Oued Saboun présente un détournement vers ouest, dû probablement à des mouvements tectoniques passés.
Extension : 430 ha environ.
Altitude : 700-790 m s.n.m. (l’altitude augmente vers le nord).
Pente : nulle.
Utilisation du sol : absente.
Substrat : matériau du Néogène enseveli par du matériau alluvial récent et par des couvertures de sables éoliens en surface.
Géomorphologie : terrasse alluviale du 1e niveau.
Description générale : le régime hydrique des deux Oueds est de type saisonnier et les eaux découlent surtout de bassins d’alimentation situés à nord du segment montagneux Goubel ou bien de l’ensemble d’affluents drainant le bassin de Skhirat et le territoire algérien limitrophe.
L’Oued Saf Saf, en particulier, est le plus grande chenal de drainage de la zone d’étude.
L’étendue du lit de ces fleuves est de l’ordre de centaines de mètres et le pavage de ces lits est constitué d’une couverture décimétrique de sable quartzeux. Sur les parois on observe des stratifications mélangées de matériau fluvial déposé en phases diverses et matériaux éolien qui l’a enseveli en phases postérieures. Des abondants cristaux de gypse sont visibles à différentes profondeurs.
Dans le voisinage immédiat sont souvent présents des champs arables et des implantations d’oliviers, d’acacias et d’arbres fruitiers.
Profil type : P1
Sous-unité : –
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
125
Profil type : P1
Localité Wadi as Saboun
Référence Cartographique Jbal As-Sarragiyya – NI-32-XV-3d
Ubication UTM (Carthage) 32S448858-3868287
Altitude 790 m s.n.m.
Pente < 2 %
Exposition totale
Pierrosité absente
Rochosité absente
Utilisation du sol pâturage naturel, présence de quelques individus isolés de Stipa tenacissima et d’Astragalus armatus
Substrat dépôt éolien récent sur des successions d’alluvions récentes (niveau 1) superposées aux argiles du Néogène
Morphologie plaine alluviale
Drainage extérieur bon
Érosion éolienne, diffuse, modérée
Notes et observations profil sur le berge gauche de l’Oued ; dans l’horizon 5Agb présence de nombreuses coquilles d’Elix sp.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
126
Description du profil : Horizon A : 0 à 50 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre faiblement humide et sec 10 YR 6/4, brun jaunâtre clair. Texture au toucher sableuse. Squelette absent. Structure polyédrique subangulaire ; à l’état humide, fine, faible, très friable ; à l’état sec de friable à souple. Porosité faible avec des pores petits et très petits. Drainage rapide. Effervescence considérable. Racines peu nombreuses, petites, fines, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique faible. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 2Cb : 50 à 80 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre faiblement humide et sec 10 YR 5/3, brun. Texture au toucher sablo-franche. Squelette : environ 60-70% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique subangulaire à l’état humide ; moyenne, modérée, friable, à l’état sec, peu forte. Porosité faible avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines de peu nombreuses à absentes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 3Ab : 80 à 120 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre faiblement humide et sec 7,5 YR 5/4, brun. Texture au toucher sablo-franche. Squelette : environ 5-10% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique subangulaire, à l’état humide ; moyenne, modérée, friable, à l’état sec, peu forte. Porosité faible avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines de peu nombreuses à absentes, petites, à trajectoire oblique et verticale. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 3Cb : 120 à 130 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre faiblement humide et sec 7,5 YR 5/3,5, brun. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette : environ 60-70% en volume pour des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique subangulaire, à l’état humide ; moyenne, modérée, friable, à l’état sec, peu forte. Porosité faible avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 4Ab : 130 à 170. Couleur à l’état intermédiaire entre faiblement humide et sec 2,5 YR 4/2, brun grisâtre sombre. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette : environ 5% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique subangulaire, grossière, modérée, de friable à résistante à l’état humide, de peu forte à forte à l’état sec. Porosité faible avec des pores très petits. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 4Cb : 170 à 190 cm. Couleur à l’état intermédiaire entre faiblement humide et sec 2,5 YR 5/2, brun grisâtre. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette : environ 70-80% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure polyédrique subangulaire, fine modérée, peu forte à l’état sec. Porosité absente. Drainage normal. Effervescence considérable. Racines absentes. Activité biologique absente. Limite avec l’horizon sous-jacent abrupte et linéaire.
Horizon 5 Agb : 190 à 250 cm et plus. Couleur à l’état intermédiaire entre faiblement humide et sec 2,5 YR 5/2, brun grisâtre. Texture au toucher sablo-limoneuse. Squelette : environ 5% en volume avec des éléments petits et arrondis. Structure colonnaire, très grossière, modérée, friable soit à l’état humide qu’à l’état sec. Porosité absente. Drainage
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
127
de normal à lent. Taches couleur 10 YR 5/8, brun jaunâtre, d’environ 1 cm d’épaisseur, environ 5-10% en volume. Effervescence considérable. Racines et activité biologique absentes.
Notes : présence de nombreuses coquilles.
Analyses de laboratoire :
Horiz. prof. (cm) C.O. (g/Kg) S.O. (g/Kg) SG (g/kg) SF (g/kg) LG (g/kg) LF (g/kg) A (g/kg) Classe USDA
A 50 1,50 2,60 833 77 35 30 25 S
2Cb 80 1,40 2,40 731 89 20 80 80 SF
3Ab 120 1,80 3,10 430 70 140 145 215 F
3Cb 130 2,90 5,00 373 197 60 150 220 FSA
4Ab 170 10,60 18,30 171 229 85 200 315 FA
4Cb 190 1,40 2,40 481 149 55 125 190 FS
5Agb 250 1,30 2,20 396 264 75 105 160 FS
Classification:
Haplic Fluvisol (Aridic) (WRBSR, 2006)
Considérations pédologiques : Le P1 ci-dessus décrit est représentatif de la berge ouest de l’Oued Saboun. Il montre une succession de sols superposés, développés à partir du matériau déposé en cycles divers, fluviaux et éoliens.
Les horizons aux matériaux moins fins, qui proviennent de déposition éolienne, alternent avec les horizons constitués de matériau très fin, de déposition en eaux plus tranquilles. Le matériau fin, souvent, est aussi d’origine éolienne ; en toute la zone, en effet, on observe toujours une combinaison entre action éolienne et fluviale.
L’horizon 5Agb montre une coloration brun grisâtre (2,5YR 5/2), indice d’une longue permanence d’eau dans le sol et de conditions réductrices. Nombreuses taches d’hydromorphie, en effet, sont aussi évidentes.
Des observations effectuées sur le bord est de l’Oued Saboun montrent une différente stratification. Les couches sont inclinées et on peut voir l’affleurement des argiles vertes dans la partie plus basse de la coupe verticale. On retrouve en outre un horizon avec des cristaux de gypse, tandis que la couche plus superficielle est constituée de matériau éolien.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
128
6. CONCLUSIONS
La Carte des Unités Pédomorphologiques pour la zone d’étude de Skhirat en Tunisie se propose un double but : décrire, d’un côté, les dynamiques géomorphologiques, en permettant ainsi de mettre en évidence les zones les plus vulnérables par rapport aux processus d’érosion hydrique et éolienne et d’ensablement ; de l’autre, d’associer aux sols ou chaînes de sols représentatifs des Unités, des informations fonctionnelles à l’évaluation d’une vocation/sensibilité agronomique. Cette Carte se présente donc comme outil de support pour la planification agro-pastorale, avec une référence particulière à l’évaluation des principales “options” culturales de la région : oléiculture, céréaliculture, plantations pastorales.
Le relèvement pédologique, en effet, a mis en lumière les différentes typologies de sols dans la zone d’étude, avec différentes propriétés morphologiques et physico-chimiques, à considérer et valoriser pour une gestion appropriée du territoire.
Selon le système taxonomique de référence utilisé (WRBSR, 2006), il résulte que dans la zone d’étude sont présents Leptosols, Calcisols, Luvisols, Arenosols, Solonchaks, Fluvisols et parfois Kastanozems : il en ressort donc une considérable pédodiversité, qui rend entre autres la zone très intéressante sur le plan scientifique.
Les Leptosols ont été généralement relevés dans l’unité “Affleurements rocheux” et “Pédiments” et parfois le long des versants à plus forte pente des “Zones de transition entre pédiments et terrasses alluviales”.
Ces sols, d’une épaisseur limitée (inférieure à 25 cm), pourraient constituer une potentielle ressource pour des utilisations forestières et pour le pâturage au cours de la saison pluvieuse, même si l’érosion c’est une forte menace, au cas, par exemple, où ils soient sujets à surpâturage. Leur utilisation à buts agricoles pourrait donner quelques résultats positifs là où le pentes sont faibles, quoique le risque d’érosion reste élevé. Dans le cas des versants à plus forte pente (de toute façon, toujours inférieure à 20-25%), se rendent en revanche nécessaires des œuvres d’étagement et d’épierrage avant la mise en culture. Le drainage intérieure excessif et la faible puissance de la plupart de ces sols peuvent exaspérer leur aridité même en milieux relativement humides. Les zones disposant de cette typologie de sol sont parmi les plus indiquées pour des plantations de cactus, qui ont démontré une bonne capacité d’adaptation aux sols minces, une appréciable productivité et un bon control de l’érosion, grâce â leur système radicale développé en horizontal.
Les Calcisols sont distribués dans la plupart des Unités. Seulement les sols exposés à la salinisation et aux processus de sédimentation éolienne actuelle ne présentent cette typologie de sol.
Ces sols sont fréquemment utilisés pour le pâturage extensif. Leur utilisation à buts agricoles, en effet, est souvent limitée â cause de l’élevée pierrosité superficielle ou par la présence d’un horizon pétrocalcique sous-superficiel. Pour obtenir un bon rendement cultural, ils ont besoin de pratiques d’irrigation, à moins que l’on n’utilise des cultures supportant l’aridité. Ces sols peuvent être indiqués pour des plantations d’Atriplex nummularia, possiblement alternées avec des rangées de cactus pour les protéger du vent. Le processus de carbonatation ou de calcification avec l’accumulation conséquente de carbonate de calcium secondaire, la cimentation et l’endurcissement d’horizons entiers, est
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
129
souvent superposé à des processus de lessivage plus anciens, avec la formation d’horizons profonds illuviaux riches en pellicules d’argile. Ces processus sont souvent connexes entre eux et les sols qui en dérivent ont des caractéristiques intergrades entre Calcisols et Luvisols. La séquence des processus de décarbonatation (partielle ou totale), lessivage et recarbonatation sur la longue période et en phases climatiques différentes semblerait la plus commune dans l’Unité “Zone de transition entre pédiments et terrasses alluviales”, ou bien, plus en général, dans l’entière zone d’étude.
Les Luvisols aussi sont très fréquents dans l’Unité “Zone de transition entre pédiments et terrasses alluviales” et en particulier dans les parties les plus basses et plates et dans les talweg, où ils atteignent des épaisseurs considérables. Sur les sommets peu inclinés des glacis du 4e niveau ils présentent souvent des horizons profonds endurcis (fragipan et duripan), ensevelis par d’autres sols d’origine plus récente. De toute façon, l’Unité représentée au mieux par cette typologie de sols est celle des “terrasses alluviales”, surtout dans la sous-unité “Zone endoréique”, dans laquelle on atteint les puissances les plus grandes, les teneurs les plus hautes en argile et la plus grande évidence d’illuviation.
Ces sols sont généralement fertiles et convenables à une vaste gamme d’utilisations agricoles. Lorsqu’ils ont une élevée teneur en limon, ils sont sujets à la détérioration de la structure, surtout s’ils sont travaillés humides ou avec des moyens lourds. Dans le cas de versants en pente, qui en cette Unité n’atteint jamais des valeurs élevées, ils exigent des interventions de contrôle de l’érosion.
Dans la zone d’étude, ces sols sont généralement utilisés pour des champs arables, tandis que sur les versants à plus forte tendance ils accueillent le pâturage naturel.
Les Solonchaks sont circonscrits à l’Unité “Zone sujette à salinisation et hydromorphie” et présentent des valeurs de salinité particulièrement élevées, avec une potentiel limité pour les cultures, à moins qu’ils ne soient traités avec des techniques opportunes pour délaver les sels. Dans un seul cas on a relevé des valeurs élevées de sodicité (avec ESP >15%) accompagnées par une conductivité électrique extrêmement élevée, au point de faire envisager des sols intergrades entre salins et sodiques. En ce cas les hautes concentrations de sodium pourraient influer négativement sur les cultures arables, soit en manière directe (par la toxicité du sodium) qu’indirecte (à cause de la détérioration de la structure). Dans le reste de la zone d’étude la conductivité électrique présente toujours des valeurs inférieures à 4 dS/m. Ces sols sont indiqués pour accueillir Atriplex n., qui utilise les élevées quantités de sels contenues dans le sol pour son propre métabolisme.
Les Arenosols constituent la typologie dominante de la Sous-unité “Zone de sédimentation éolienne récente”, où les apports de sables par le vent comportent un continuel “rajeunissement” du profil. La pédogénèse, à partir de ce matériau, forme des sols peu développés, extrêmement tendres et perméables, avec une faible capacité d’emmagasiner l’eau et les nourrissants. Les activités agricoles sont possibles si les précipitations dépassent les 300 mm annuels, sinon des interventions d’irrigation sont nécessaires, encore que ça comporte des pertes élevées de nourrissants par percolation. Ces sols, en outre, sont très sujets à l’érosion et le pâturage incontrôlé et les cultures sans mesures de conservation les rendent instables, pouvant même les faire régresser à dunes mobiles. Sont donc souhaitables des mesures de stabilisation des dunes de cette Sous-unité, par le développement de cactus ou d’autres espèces d’arbres ayant un apparat radical capable de descendre en profondeur et puiser des nourrissants sous les couvertures de sable.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
130
Ont été classifiés comme Fluvisols les sols qu’on rencontre le long des terrasses et des berges actuels et récents des oueds. Ils présentent des évidences de stratification, communes taches rédoximorphes dans les parties basses du profil et du matériau éolien dans les parties plus hautes. On observe souvent une coexistence de matériau éolien et de matériau alluvial. On suggère de les utiliser à but conservatoire pour freiner l’érosion des berges et l’érosion régressive (bank gullies).
Enfin, dans la Sous-unité “Épandages alluviaux ” et “Sédimentation éolienne passée” a été observée la présence continue d’un horizon sous-superficiel (souvent enseveli par épaisseurs élevés de matériau plus récent) très sombre (avec colorations Munsell bruno-jaunâtre ou brun très sombre et chroma égal à 3), dont la formation semblerait indépendant du matériau parental (éolianites, matériau alluvial, affleurements argilo-sableux du Néogène). Il semble qu’on puisse envisager un rôle joué par des anciens processus pédogénétiques de mélanisation liés à des facteurs du climat et de la végétation.
Cet horizon, qui présente un intéresse spécifique, peut influencer le fonctionnement agronomique et l’aptitude du sol par rapport à sa profondeur et aux caractères physiques de l’horizon même.
Les premières observations, en effet, sur la base de la couleur particulièrement foncée de ces horizons et d’un certain nombre d’évidences d’activité biologique passée, entre lesquelles des restes de coprolithes et d’accumulations de substance organique, avaient fait envisager des sols iso-humiques, enrichis en substance organique jusqu’à une élevée profondeur. Les résultats analytiques toutefois, bien qu’ils confirment une relative homogénéité de la distribution verticale de la substance organique, ne mettent pas en lumière une haute teneur de carbone organique, qui souvent est même inférieur à 0,6%. Cet horizon, par conséquent, ne peut être considéré mollique, probablement à cause de l’âge élevé de ces sols, qui ont subi la minéralisation progressive du carbone organique au cours du temps. Dans les cas où cette valeur-seuil a été atteint, les sols ont été classés comme Kastanozems. Ils témoignent ainsi d’une pédogénèse réalisée en conditions climatiques passées légèrement plus humides que celles d’aujourd’hui, étant donné que leur climax est différent par rapport à celui qui caractérise la zone d’étude. Dans ces cas, la fertilité est élevée, mais il s’agit de sols particulièrement vulnérables à l’érosion.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
131
BIBLIOGRAPHIE
AA.VV. 2006., World Reference Base for Soil Resources. FAO
Assallay A.M., Rogers C.D.F., Smalley I.J., Jefferson I.F. 1998., Silt: 2–62 mm, 9–4Φ. Earth-Science Reviews 45_1998.61–88
Billaux P. 1978., Estimation du régime hydrique des sols au moyen des données climatiques. La méthode graphique: son utilisation dans le cadre de la Taxonomie américaine des sols. ORSTOM série Pédologie, Vol. XVI, n.3.
FAO – 1976., A Framework for Land evaluation. Soil Bulletin n. 32, Roma.
FAO – 1977., Unesco Soil map of the world 1:5.000.000 Volume VI Africa.
Floret C. Pontanier R. 1982., L’ariditè en Tunisie présaharienne, Climat, sol, végétation et aménagement
Jurinak, J.J. Suarez, D.L. 1990., The chemistry of salt-affected soils and waters. In: Tanji, K.K. (ed.) Agricultural salinity assessment and management. New York: ASCE, cap3, p.42-63. Manuals and Reports on Engineering Practice, p.71.
Kovda V. A. et al. 1973., Irrigation, drainage and salinity. FAO-UNESCO
MEAT – 2000., Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification. République Tunisienne, Ministère de l’environnement et de l’Aménagement du Territoire. (www. unccd.int)
Ministère de l’Agriculture – 1973., Sols de Tunisienne. Bulletin de la Direction des Sols N°5
Ministère de l’Agriculture – 1998., Sols de Tunisienne. Bulletin de la Direction des Sols N°18
Mtimet A. – 1999- Atlas des sols tunisiens
Ongaro L., Sarfatti P. – 2006 – Valutazione delle terre per i Paesi in Via di Sviluppo. In metodi di valutazione dei suoli e delle terre. Coordinatore Costantini E.A.C. Edizione Cantagalli.
Richards L.A. – 1954., Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. USDA Agriculture handbook. Washington, D.C.
Salinity Laboratory Staff, U.S. – 1954., Diagnosis and Improvement of saline and alkali soils.
Soil Survey Staff, Bureau of Plant Industry – 1951., Soils, and Agricultural Engineering.
Soil Survey Staff, Soil Conservation Service, U. S. Dept. of Agricolture, 1975., Soil Taxonomy. Agricolture Handbook n. 436, 1st ed., Washington D.C.
Spark L. D. – 1995., Environmental soil chemistry.
Szalbolcs I. – 1989., Salt affected soils.
Projet: SMAP “PLAN DÉMONSTRATIF SUR LES STRATÉGIES POUR COMBATTRE LA DÉSERTIFICATION DES ZONES ARIDES AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS RURALES DU NORD DE L'AFRIQUE”
Contrat : ME-8/B7-4100/2001/0132/SMAP-5 Titre du Document : Rapport sur les activités effectuées dans les régions du Maroc et de la Tunisie
132
Thornthwaite C.W., Mather J.R. – 1957., Instructions and tables for computing potential evapotraspiration and water balance. Centerton.
Urgeghe A. – 2006., Caratterizzazione pedologica e studio di valutazione dell’attitudine del territorio dell’utilizzo agricolo di un area a rischio di desertificazione in Tunisia: l’Imada di Skhirat. Tesi di laurea, Università degli Studi di Sassari
US Salinity Laboratory – 1954., Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils.