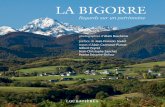Patrimoine vécu et choc des mémoires urbaines dans le Redlight de Montréal
Paysages culturels de l'Agropastoralisme du Haut-Atlas, un patrimoine à valoriser
Transcript of Paysages culturels de l'Agropastoralisme du Haut-Atlas, un patrimoine à valoriser
1
Paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-Atlas, un patrimoine à valoriser !
Mohamed Mahdi
Professeur de sociologie rurale
Ecole Nationale d’Agriculture – Meknès.
Tél : 06 65 65 93 09 et fax : 05 35 30 02 38
Résumé
Le patrimoine sous ses diverses manifestations matérielles et immatérielles est actuellement considéré
comme une ressource territoriale mobilisable par les acteurs pour construire le territoire (Gumuchian
et Pecqueur, 2007) et explique l’intérêt croissant qui, de par le monde, est accordé à sa valorisation.
L’articulation entre patrimoine et développement territorial est par ailleurs démontré par de
nombreuses expériences réussies au Maroc et ailleurs. (Campagne et Pecqueur, 2012)
L’article explore le potentiel de développement territorial des ‘’paysages culturels agropastoraux du
Haut-Atlas’’ en apportant des éléments en faveur de sa patrimonialisation (Mahdi, 2010). Pour ce
faire, il fait appel à la notion de ‘’ paysage culturel’’ reconnu comme composante du patrimoine de
l’humanité par la convention de 1992 de l’UNESCO et dont le paysage culturel agropastoral des
Causses et Cévennes (France) fournit un exemple récemment reconnu par l’UNESCO (juin 2011). Il
valorisera ensuite les acquis de la recherche sur la question (S/D Auclair et Al Ifriqui. 2012). Il
s’appuie aussi sur une expérience personnelle en tant que membre du groupe d’experts chargés de la
préparation du dossier d’inscription des paysages culturels de l’agropastoralisme des Causses et
Cévennes au patrimoine mondial, puis du suivi du « Bien » inscrit (UNESCO). Le constat de départ
est que cette notion est encore peu présente dans la communication publique et territoriale de
valorisation des patrimoines et des stratégies de développement les concernant. En s’appuyant sur
l’exemple du « paysage culturel agropastoral du Haut-Atlas», l’artcile insiste de façon particulière
sur le concept de l’Agdal qui est une composante singulière et centrale de ce patrimoine mais sans
toutefois s’y réduire.
L’exemple de l’Agdal de l’Oukaïmeden a servi pour démontrer et justifier sa place parmi les éléments
matériels et immatériels du patrimoine marocain et faire ressortir les attributs pour sa reconnaissance
et les possibilités de son inscription dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO d’une part, et
de l’autre, montrer que le paysage culturel agropastoral est une ressource territoriale authentique qui
s’inscrit dans le cadre des problématiques de développement durable des territoires du Haut-Atlas.
L’article attire à la fin l’attention sur les menaces qui pèsent sur ce patrimoine. (Mahdi et Dominguez,
2009, Lebaudy, 2014)
Mots clés : Patrimoine, patrimonialisation, Agdal, ressource territoriale, développement territorial
2
Introduction
Le titre est un condensé de notions complexes : le paysage, le paysage culturel, l’agropastoralisme et
le patrimoine. La notion de ‘’patrimoine’’ tient une place centrale dans ce complexe notionnel, étant
donné l’intérêt grandissant accordé à sa valorisation dans une perspective de développement par la
communauté internationale, les états, la société civile, les chercheurs et les experts… Au Maroc
l’importance du potentiel patrimonial du pays et son apport original et précieux à la civilisation et à la
culture mondiales ont été mis en évidence par le rapport du cinquantenaire, qui a aussi tiré un signal
d’alarme : ‘’le patrimoine anthropologique et architectural du pays commence à montrer des signes
d’érosion, en raison de l’insuffisance de l’effort de préservation et de valorisation1’’ (Rapport, 2006 :
54).
Depuis lors, la promotion du patrimoine marocain commence à être inscrite dans les stratégies de
développement territorial : ainsi les agences étatiques de développement des provinces du Nord, de
l’Oriental et du Sud ont orienté leurs actions de communication en direction de divers aspects du
patrimoine de leurs provinces qu’ils tentent de faire connaitre à travers l’organisation de rencontres
scientifiques, l’appui aux projets touristiques, l’édition de beaux livres, le soutien à des projets de
musées… Aussi, l’idée de ‘’patrimoine paysager’’ commence-t-elle à figurer, sous une forme ou une
autre, dans la communication publique et territoriale et dans les stratégies de développement et de
valorisation les concernant. Quand à la notion de ‘’paysage culturel’’, elle est relativement récente et
l’un des objectifs de cet article est justement de contribuer à la mieux faire connaître.
Mais, avant d’aller plus loin, revenons sur ces notions condensées dans le titre pour les définir et
préciser la posture théorique qui guidera cette présentation. Une littérature abondante, provenant de
diverses disciplines scientifiques (géographie, anthropologie, ethnographie…) et des conventions
internationales, est consacrée à ces diverses notions rattachées à la problématique du patrimoine et à sa
valorisation.
Et d’abord le paysage. Le mot exprime un concept qui réfère à deux niveaux de réalité objective et
subjective (G. Lenclud, 1995). En tant que réalité objective, le paysage ‘’renvoie à (…) un site ou un
pays, des « éléments constitutifs » dont on peut faire l’analyse.’’ Dans sa réalité subjective : ‘’Un
paysage (…) n’est constitué comme paysage que par le regard qui s’attache à lui. Pas de paysage sans
observateur ; il faut qu’un site soit vu pour être dit paysage.’’ (Lenclud, ibid : 2). Le paysage existe
donc du moment où il est perçu comme tel. Il est construit par un regard déterminé par une culture et
un système de référence. Mais la notion de paysage n’a pas le même sens pour les habitants du lieu.
C’est même une étrangeté pour ces habitants: ‘’S’il est une notion étrangère aux habitants d’un lieu,
c’est bien la notion du paysage’’ (Cuisenier, 1989 : 245). Ce que nous considérons comme paysage
1 Rapport du Cinquantenaire, 2006. « Le Maroc Possible, Une offre de débat pour une ambition collective. », Casablanca.
3
n’est pour l’autochtone que l’espace où il vit, où se déroulent ses travaux et ses jours2. G. Lenclud
donne l’exemple des Tharu du Népal : ‘’Là où un trekkeur, s’il vient à passer, voit des paysages le
Tharu voit des sites investis de surnaturel’’.
Une difficulté supplémentaire concerne la signification et la manière de nommer le paysage. Au
Maroc, dans les langues officielles du pays, l’arabe et l’amazigh, existe-t-il des équivalents au mot
paysage ? Il semble que la catégorie paysage soit absente du glossaire de ces deux langues et de celle
des populations locales. La notion de paysage et à fortiori celle de ‘’paysage culturel de
l’agropastoralisme’’3 a-t-elle un sens pour les montagnards du Haut-Atlas ? Que signifie le paysage
pour la population qui y vit et l’occupe et qui, paradoxalement comme nous le verrons, en est le
créateur mais aussi l’agent de sa perpétuation et de son évolution ?
Ph. Descola (2007) appréhende le paysage comme un produit anthropisé de la population qui y est
présente, la physionomie qu’il prend étant le résultat de plusieurs millénaires d’occupation humaine.
La population, par la pratique agricole et pastorale, est usagère de cet espace et des ressources qui s’y
trouvent. L’espace a pour elle une utilité productive, mais est-elle consciente de sa fonction
paysagère ? Descola en vient à se demander si cette catégorie ‘’paysage’’ n’est pas en définitive une
création des politiques, des gestionnaires, des chercheurs, des conventions internationales… c’est à
dire de ‘’tous ceux qui agissent dans les coulisses de la nature’’ (Descola, 2007: 124).
La définition du paysage proposée de Descola est proche de celle de ‘’paysage culturel’’ proposée par
l’UNESCO. En effet, l’article 1 de la Convention 1992 de l’UNESCO sur le patrimoine définit les
paysages culturels comme des "ouvrages combinés de la nature et de l'homme". ‘’Le paysage
culturel’’ est reconnu comme composante du patrimoine de l’humanité par l’UNESCO qui s’engage à
le protéger et donne des orientations devant conduire à son inscription sur la Liste du patrimoine
mondial.
Le terme "paysage culturel" recouvre une grande variété de manifestations interactives entre l'homme
et son environnement naturel. L’approche des ‘’paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-
Atlas’’ adoptée ici procède de la posture théorique qui : i) tient compte de cette opposition entre notre
vision externe du paysage et celle des locaux, habitants des lieux ; et reconnait que ce que nous
pensons bon ne l’est pas forcément du point de vue des autochtones. C’est une posture qui, par
ailleurs, pose la question de la place et du rôle des acteurs locaux dans toute entreprise qui vise la
patrimonialisation et la valorisation de ces paysages ; ii) considère le patrimoine paysager comme un
produit anthropisé qui fait partie de ces ‘’écosystèmes de la planète qui sont le produit d'interactions
poursuivies pendant des millénaires entre humains et non-humains’’ (Descola, 2007 : 127)
2 ‘’Les travaux et les jours’’ titre du poème d’Hésiode écrit au VIIIe siècle av. J.C.
3 L’expression « paysage culturel de l’agropastoralisme » sera définie par la suite.
4
Dans ce qui suit, nous essayons d’introduire à cette notion de ‘’paysage culturel de l’agropastoralisme
méditerranéen du Haut-Atlas’’, pour la faire connaître et identifier son potentiel pour le
développement territorial, tout en exposant les éléments en faveur de sa patrimonialisation et de son
inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Nous présenterons, dans un premier temps, le contenu
que couvre la notion du paysage culturel de l’agropastoralisme du Haut-Atlas (1). Puis nous
analyserons les atouts et les possibilités qu’il offre pour son inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO (2). Nous envisagerons ensuite son rôle en tant que ressource pour le développement
territorial (3). Et nous discuterons enfin le dilemme de la patrimonialisation des paysages (4).
1. Le paysage culturel de l’agropastoralisme du Haut-Atlas4
Les paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-Atlas sont d’abord des paysages de montagne.
Mais en quoi un paysage de montagne est–il culturel ? Nous essayerons de présenter les qualités
culturelles des paysages de montagne en distinguant entre les éléments qui leur sont communs et les
éléments spécifiques à certains d’entre eux. Nous montrerons par là même que les territoires du Haut-
Atlas sont marqués depuis des millénaires par une activité agropastorale liée à une antique
transhumance vers les alpages des hautes terres, appelés Agdal, celui de l’Oukaïmeden, de Yagour et
de Tichka. C’est cette activité, résultat d’une interaction entre l’homme et son milieu, qui a façonné
ces paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-Atlas. Ces paysages culturels constituent un
patrimoine original qui mérite d’être connu et valorisé.
1.1. Eléments communs aux paysages culturels de montagne
La montagne est belle et fascinante mais très difficile à vivre ! Pourtant les montagnards, Iboudrarn,
(sing. Aboudrar, littéralement ‘’homme de montagne’’), y vivaient et continuent d’y vivre. Les
gravures rupestres du Haut-Atlas datent de 2000 ans avant JC. Elles attestent d’une activité pastorale
dont les alpages de l’Oukaïmeden, du Yagour, de Tichka, situés à plus de 3000 m d’altitude,
constituaient le théâtre. Mais pour pouvoir exister dans les conditions difficiles de montagne, il fallait
l’aménager pour rendre la vie possible en son sein. Et c’est au moyen de la technique5, et de
techniques très ingénieuses, que les montagnards ont pu apprivoiser la montagne. Ainsi en est-il des
terrasses de culture qui permettent de dompter la pente et créer des champs fertiles, des systèmes
d’irrigation qui cassent la déclivité des pentes et assurent la circulation des eaux, de la transhumance
qui varie l’usage saisonnier des différents étages bioclimatiques de la montagne, de l’architecture des
4 Il s’agit tout particulièrement du Haut-Atlas de Marrakech et plus précisément du territoire de l’ancienne tribu Rheraya
(Mahdi, 1999), aujourd’hui largement couvert par la Commune Rurale d’Asni. Mais même en focalisant sur le territoire de
Rheraya, la démonstration vaudra aussi pour les territoires de l’Ourika, qui partagent avec les Rheraya l’Agdal
d’Oukaïmeden, des Messioua utilisateurs de l’Agdal de Yagour et des Seksawa qui fréquentent l’Agdal de Tichka. Ces
groupes tribaux partagent le même genre de vie et occupent des territoires autour du massif du Toubkal. 5 Le mot grec techné désigne le savoir par lequel l’homme s’assure une place dans la nature (physis) en mettant au jour, soit
sous les espèces des ustensiles (artisanaux), soit sous celle d’une œuvre (d’art), quelque chose de déjà présent au sein de la
nature elle-même. (Encyclopaedia Universalis, Corpus 7, page 287).
5
douars et de leurs habitations construites en pisé, matériau bien adapté aux fluctuations des
températures. Ces techniques, qui expriment le génie hydraulique, pastoral et architectural des
montagnards, font partie de la culture de la montagne et témoignent de leurs savoirs et savoir-faire et
de leurs capacités managerielles et d’aménagement du territoire.
Ces techniques témoignent surtout d’une interaction millénaire de l’homme et la montagne qui est à
l’origine de leur système agraire6. Et c’est justement cette interaction qui est au fondement des
paysages culturels montagneux, c’est-à-dire des paysages culturellement façonnés par l’activité
humaine au moyen de la technique. Celle-ci est une composante de la ‘’culture’’ d’un peuple ; une
composante essentielle de l’ensemble qui le caractérise et le distingue des autres peuples et/ou l’en
rapproche. C’est aussi par l’intermédiation de ce volet technique de la culture que le montagnard
s’assure une adéquation à sa montagne en la façonnant à son usage. Si la montagne est un paysage
culturel, c’est parce qu’elle porte les marques, la signature dirait Descola, du montagnard.
Vivre, survivre, et s’adapter à un territoire demande à s’assurer une cohabitation avec ses semblables,
d’une part et la bienveillance des divinités, de l’autre. Deux ordres de faits supplémentaires qui
complètent la dimension culturelle des paysages de montagne : les relations que les hommes
entretiennent entre eux et celles qu’ils entretiennent avec les divinités constituent en fait le fondement
de leur vie sociale et religieuse. D’un côté, l’organisation sociale, c'est-à-dire les formes que prennent
la vie sociale et les normes qui gouvernent les relations sociales et la vie communautaire et celles qui
régissent la gestion des ressources naturelles (terre, eau, parcours, forêt…). De l’autre, les croyances,
les pratiques religieuses ainsi que les normes qui régissent la gestion et l’entretien des biens
symboliques, comme les lieux de culte (mosquée, mausolées, Zaouia...), la célébration des rites
agraires et non agraires ou enfin la vie festive (danse, chants, moussem7…). Ce dernier aspect figurera
dans le domaine de l’esthétique8 et de la production artistique.
C’est l’ensemble de ces dimensions technique, sociale, religieuse et esthétique de la vie d’un groupe
qui, en définitif, constitue l’essentiel des aspects communs des ‘’paysages culturels de
l’agropastoralisme des montagnes du Haut-Atlas’’. Ces dimensions s’imbriquent, s’enchevêtrent et
forment ‘’système’’. Ce système agropastoral de montagne peut être défini comme un système de
production qui associe : i) des cultures céréalières, essentiellement l’orge et le maïs, et l’arboriculture
fruitière représentée, selon l’altitude, par l’amandier, l’olivier ou le noyer, ii) un élevage mixte de
ruminants, composé de caprins, d’ovins et de bovins de races locales. Cet élevage est conduit en semi-
extensif, rythmé par la transhumance. Cette dernière s’effectue dans les alpages d’altitude, sus
mentionnés, connus sous le nom d’Agdal. L’Agdal9 occupe une place centrale dans ce système
6 Un système agraire est une interaction entre un système agricole et un système social. 7 Fête annuelle organisée autour d’un lieu saint et célébrée par des activités religieuses et commerciales
8 Esthétique : ‘’Tout ce qui est beau et sublime dans la nature et dans l’art’’ (Kant, repris dans (Encyclopaedia Universalis, Corpus 7, page 287) 9 L’Agdal se situe tout juste dans le Parc national du Toubkal, créé par arrêté visiriel du 19-11-1942.
6
agropastoral et participe vigoureusement à la ‘’fabrication’’ des paysages culturels de
l’agropastoralisme du Haut-Atlas et leur donne leur spécificité.
1.2. Eléments spécifiques aux paysages culturels de montagne
L’Agdal est une œuvre conjuguée de l’homme et de la nature, le réceptacle d’un riche patrimoine
matériel et immatériel. Le patrimoine Agdal, là où il existe, confère aux paysages culturels du Haut-
Atlas toute leur spécificité. L’attention sera focalisée sur l’«Agdal d’Oukaïmeden». Il est situé à 75
km au Sud de Marrakech, à une altitude variant entre 2.600 et 3.600 m. Il se présente sous forme
d’un plateau et des versants qui l’encerclent dont la superficie est estimée à 800 ha. Parsemé d’Azibs,
campements, où sont construits les enclos des familles de transhumants originaires des deux tribus
Rheraya et Ourika, l’Agdal d’Oukaïmeden est soumis à un régime de mise en défens du 15 mars au
10 août, date de la montée des transhumants. La mise en défens permet un repos de la végétation,
l’établissement de jeunes semis et la pérennité de l’écosystème.
L’Agdal, (pluriel, Igoudlane), désigne des prairies verdoyantes situées sur les hautes terres, servant
de parcours au bétail et accueillant chaque année des éleveurs transhumants qui habitent les vallées
voisines. L’Agdal est donc une institution de gestion communautaire de la ressource pastorale et un
mode de régulation sociale de l’accès à ces prairies par leur mise en défens saisonnière10
, et aussi un
modèle de conservation et de protection des ressources naturelles.
La montée des transhumants sur l’Agdal est l’occasion d’un moussem, (Anmougar en Amazigh,
littéralement ‘‘rencontre’’) qui donne lieu à une activité festive faite de danses et de chants, de
réjouissances collectives, de célébration de rituels, dédiés au saint protecteur de l’Agdal et aux esprits
des lieux. L’Agdal est donc un espace de rencontre et de sociabilité.
L’Agdal est considéré par les écologues comme un réservoir et un conservatoire de la biodiversité
végétale et animale. La pratique de la mise en défens printanière favorise la floraison et l’arrivée à
maturité des semis, la reconstitution des espèces végétales, le maintien de nombreuses espèces
endémiques et la perpétuation de l’écosystème (Alaoui-Haroni, 2009). Par ailleurs, sur l’Agdal vit une
faune sauvage où trônent, tout particulièrement, l’aigle royal et l’aigle de Bonelli, bien que cette
biodiversité animale reste mal connue.
L’Agdal abrite des sites de grande valeur archéologique qui en font un musée en plein air. Des
gravures rupestres11
(Simoneau, 1967) attestent de l’ancienneté de la vie et des mobilités pastorales.
‘’Les symboles et représentations gravés sur les grès rouges représentent des armes, des animaux
d’élevage, les bovidés notamment, et font remonter le pastoralisme à l’âge du bronze entre 2.000 et
500 avant JC. ’’ (Auclair & Al Ifriqui, 2012). On y trouve aussi des ouvrages architecturaux, des
10 Dans un sens juridique, l’Agdal renferme l’idée de clôture et d’exclusion, de réserve, de protection, de mise en réserve (Auclair et al.,
2012), voir de horm, sacré et de haram, illicite (Chelhoud, 1964). 11 Le Centre National du Patrimoine Rupestre (CNPR) tente de protéger ces gravures (Houarau., 2006) après leur reconnaissance par le
ministère de la culture marocain en tant que patrimoine culturel national.
7
enclos et des grottes qui servent d’habitats aux transhumants et forment des campements, appelés
Azibs, de véritables ‘‘villages de transhumance’’. Des objets lithiques ont été découverts sur le site :
outils, éclats, lames brutes représentant un riche patrimoine peu exploité.
2. Atouts pour la reconnaissance des paysages culturels du Haut-Atlas
Les montagnes du Haut-Atlas connaissent des dynamiques de changement significatives qui ont
touché leur système agraire et transformé les ‘’paysages culturels de l’agropastoralisme’’.
L’agriculture de subsistance basée sur la culture de l’orge et du maïs cède le pas à une arboriculture
fruitière tournée vers le marché. L’activité touristique se développe et prend une place assez
importante dans l’économie des ménages et de la montagne. Les infrastructures de base comme
l’électrification, l’eau potable, les routes et les pistes ainsi que les moyens de communication de masse
(TV, parabole, portable, internet, etc.), se développent bien qu’à un rythme lent.
En matière d’organisation sociale, la Jmaa’a, institution emblématique, n’est plus l’unique instance de
gestion des affaires de la ‘’cité’’. Des associations de développement de douar émergent et prennent en
charge des secteurs d’activités où la Jmaa’a manque de compétence. Ces associations donnent un sens
nouveau aux notions de solidarité et de cohésion sociale, qui font partie de la culture participative des
montagnards, et se positionnent en tant qu’acteurs aptes à mobiliser l’action collective en vue du
développement du territoire.
Les populations de montagne changent leur attitude et comportement à l’égard des activités rituelles
qui accompagnent l’activité agraire. Ces croyances et pratiques antéislamiques (d’avant l’islam)
tendent à être abandonnées au profit d’un islam plus rigoriste. La même attitude est observée envers la
danse, Ahwach, actuellement regardée comme une forme d’exhibition de la femme, ‘’tabarroj’’, ou
envers le rituel de Bilmawn, l’homme aux peaux, Boujloud. Le caractère licite, ‘’halal’’ ou illicite,
‘’haram’’ de ces pratiques fait polémique dans la société, une polémique animée par différents
protagonistes (Mahdi et Pablo, 2009b : 62 et suiv).
Mais ces changements sont le signe d’une société vivante et dynamique. Les montagnards inventent et
expérimentent de nouvelles formes d’adaptation et d’adéquation avec leur montagne, preuve
supplémentaire que l’interaction de l’homme avec son milieu est inscrite dans la durée. Loin d’une
vision qui essentialise les paysages culturels de l’agropastoralisme, ces évolutions sont à regarder
plutôt comme un atout en faveur de leur valorisation. Car la pérennité des paysages culturels de
l’agropastoralisme du Haut-Atlas est tributaire de la perpétuation du genre de vie qui leur sert de
support.
Mais ces paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-Atlas disposent-ils de tous les attributs qui
les qualifieraient pour leur reconnaissance et leur inscription dans la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO ?
8
L'un des objectifs de cet article est d’esquisser les premiers éléments qui pourraient amorcer le
processus d’élaboration d’un dossier de demande d’inscription des paysages culturels de l'agro-
pastoralisme du Haut-Atlas sur la liste du patrimoine de l'humanité et obtenir une déclaration
consacrant la valeur universelle exceptionnelle de l’Agdal en tant qu’élément spécifique de la culture
agropastorale méditerranéenne. Sachant, bien entendu, que la préparation d’un tel dossier demande la
mobilisation, sur la durée, de compétences institutionnelles nombreuses et variées et de moyens
intellectuels et financiers conséquents.
Le Comité du Patrimoine Mondial de l'Unesco, lors de sa 35ème
session du 28 juin 2011, a adopté la
déclaration de valeur universelle exceptionnelle des Causses et des Cévennes (France), paysages
culturels de l'agro-pastoralisme méditerranéen, sur la liste du patrimoine de l'humanité. C’est un
modèle qui a inspiré cette réflexion sur les paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-Atlas.
L’agropastoralisme de cette partie du Haut-Atlas, objet de cet article, fait partie de l’agropastoralisme
méditerranéen12
. Le dossier présenté au comité du Patrimoine mondial de l'Unesco pour l’inscription
des Causses et des Cévennes a satisfait à deux des dix critères de sélection13
: Le critère iii, qui
demande d’‘’ Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou
une civilisation vivante ou disparue.’’ Et le critère v, exigeant que le paysage culturel doit ‘’Être un
exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de
la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec
l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation
irréversible.’’
Les paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-Atlas, tels qu’ils sont introduits par ces pages,
semblent pouvoir satisfaire au moins aux deux critères exigés par le comité du Patrimoine mondial de
l'Unesco et sur la base desquels les Causses et Cévennes ont été inscrits.
Pour le critère iii, les aspects généraux et spécifiques des paysages culturels du Haut-Atlas prouvent
bien que l’on est face à un exemple assez singulier d’agropastoralisme méditerranéen. Les paysages
des vallées encaissées que la vue peut embrasser à partir des cols situés à de très hauts niveaux
d’altitude, leur chapelet de villages perchés et l’architecture des habitations construites en pisé ou en
pierre sèche, les terrasses de cultures céréalières et d’arboriculture fruitière qui tombent en cascade
jusqu’au torrent, les prairies permanentes où paisse tranquillement le bétail quand les mises en défens
ne leur en interdisent pas l’accès, les ouvrages hydrauliques avec leur bassin de retenue et les canaux
de drainage, le mode d’organisation sociale, cultuelle ou de gestion des ressources naturelles
communes, une activité cultuelle et festive qui rythme les saisons, etc., l’ensemble témoigne d’une
12 Je fus associé au groupe d’experts pour la préparation de la candidature des Causses et Cévennes et j’ai contribué par deux
articles montrant la réalité vivante de ces paysages de l’agropastoralisme méditerranéen et de leur possibilité de
patrimonialisation à partir du cas marocain (Mahdi, 2008 et 2010). 13 http://www.cevennes-parcnational.fr/Un-territoire-vivant/Les-classements-Unesco/L-inscription-au-patrimoine-mondial
(Consulté le 06/12/2014)
9
civilisation et de pratiques bien ancrées dans une tradition certes millénaire, mais ouverte sur la
modernité. Cependant l’originalité patrimoniale des paysages dans cette partie du Haut-Atlas demeure
l’institution de l’Agdal.
S’agissant du critère v, les montagnes du Haut-Atlas abritent une population nombreuse bien ancrée
dans son territoire mais assez mobile (Iraki et Tamim, 2013). Cette population perpétue l’une des
civilisations de montagne les plus typiques et les plus anciennes ; une civilisation vivante et évolutive,
grâce à sa capacité de résilience et à l’ingéniosité des réponses que les populations apportent aux défis
qu’elles affrontent. Cette civilisation ne demande qu’à être soutenue et revitalisée.
L’inscription, si elle vient à être obtenue, sera un honneur pour les populations qui habitent ces lieux,
particulièrement si elles y sont associées dès le début du processus. Elle engagera surtout l’Etat à
préserver et faire connaître les composantes des paysages culturels de l’agropastoralisme de montagne
et à les soutenir, en donnant les moyens aux habitants de ces lieux de continuer à vivre de leur activité.
En effet, les paysages culturels de l’agropastoralisme constituent un formidable atout pour le
développement territorial.
3. Paysage culturel et développement territorial
La spécification des paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-Atlas précédemment esquissée a
fourni quelques arguments qui justifieraient leur place parmi les éléments matériels et immatériels du
patrimoine marocain et fait ressortir certains de leurs attributs pour leur reconnaissance et, si possible,
leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La spécificité de ces paysages
culturels proviendrait de leur ancrage historico-spatial et de leur caractère difficilement reproductible
et transposable d’un territoire à l’autre (Gumuchian et Pecqueur, 2007), comme la transhumance et
l’Agdal, ce qui pourrait convaincre de la pertinence de leur patrimonialisation (Mahdi, 2010b).
Nous essayons dès à présent de démontrer que, par-delà leur valeur patrimoniale, ces paysages
culturels de l’agropastoralisme pourraient constituer une ‘’ressource territoriale authentique’’
(Gumuchian et Pecqueur, Ibid) mobilisable par les acteurs pour construire le territoire et initier des
processus de développement territorial dans les montagnes du Haut-Atlas. Dans ce processus, les
paysages seront appréhendés en tant support et objet de mise en valeur et de développement.
Cependant, la constitution des paysages culturels comme ressource territoriale ‘’suppose l’existence
d’une représentation partagée de ce qui « fait paysage » ou d’une démarche projective raisonnée à
partir de laquelle une société locale identifie des potentialités identitaires’’ (Peyrache-Gadeau et
Perron, 2010). Ces deux auteurs appréhendent le paysage en tant que construction collective formée de
représentations sociales parfois divergentes provenant d’acteurs divers et révélatrices des enjeux qui
les animent sur l’usage des ressources du territoire.
Ma démarche individuelle et aventureuse est celle du chercheur en sciences sociales qui tente une
construction individuelle des paysages culturels du Haut-Atlas dans une perspective de
10
développement, et est conscient que cette construction n’aura, somme toute, qu’une vertu
pédagogique. Toutefois, il faut reconnaître que cette tentative est animée par l’ambition et l’espoir de
pouvoir, dans le futur, fédérer divers acteurs (chercheurs et experts, politiques et administratifs locaux
et régionaux… organisme international, ONG locale et internationales) et les sociétés locales dans une
démarche projective de construction et valorisation des paysages culturels de l’agropastoralisme du
Haut-Atlas. L’optimisme est permis. La zone a connu ces deux dernières décennies une accumulation
de faits empiriques, d’expériences de développement, de productions scientifiques dans diverses
disciplines, l’organisation de colloques internationaux, en particulier celui sur ‘’l’AGDAL Patrimoine
socio-écologique de l’Atlas Marocain’’ (Auclair et Alifriqui, 2012) et pourrait compter sur la
disponibilité d’acteurs provenant d’horizons divers et partageant le même intérêt pour la
problématique de développement territorial du Haut-Atlas.
Par ailleurs, la pertinence de l’articulation entre patrimoine et développement territorial a été
démontrée dans le cadre d’un travail collectif et comparatif (Campagne et Pecqueur, 2012). Sur la base
d’études de cas conduites dans plusieurs pays de la Méditerranée le collectif de chercheurs a montré
que, depuis ces deux dernières décennies, et dans de nombreux territoires méditerranéens, sont
apparues de nouvelles activités qui valorisent les ‘’ressources spécifiques’’ de chaque territoire ; celles
qui, justement, sont constitutives des paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen ; de
même, et parallèlement, a émergé un début de conscience partagée chez les acteurs locaux de la
société civile notamment, autour de l’identité des produits et des services territoriaux pouvant
constituer la base d’une économie durable et donner une meilleure visibilité aux territoires.
Dans la localité d’Imlil située au cœur du Haut-Atlas de Marrakech, présentée comme étude de cas
dans le cadre de ce travail comparatif (Mahdi, 2012) les ressources territoriales spécifiques et
identitaires mobilisées par les acteurs pour construire le territoire sont les produits de terroir de
l’arboriculture fruitière et les gisements touristiques. Ce sont des éléments des paysages culturels du
Haut-Atlas façonnés par l’activité agropastorale. Ces ressources territoriales vont structurer les
principales activités économiques de cette localité et forger sa nouvelle identité.
Ce qui ressort de façon forte de ce travail comparatif est la ‘’place encore prépondérante14
de
l’agriculture dans l’économie de ces territoires méditerranéens et son rôle dans le façonnement du
paysage et de la culture (…) du fait de l’appartenance de ces territoires‘’ à une vieille civilisation
agraire et à son agriculture de type méditerranéen’’ (Mahdi, 2010a : 12). C’est ‘’l’héritage que ces
pays méditerranéens partagent encore et qui, actuellement, constitue le fond de commerce de leurs
14 Ces pays, ‘’ représentaient en 1995 une population de près de 360 Millions d’habitants ; 37% d’entre eux sont considérés
comme ruraux, soit 131 millions, qui se répartissent de manière à peu près équivalente : 68 millions pour le Nord et 63
millions pour le Sud. Par contre, ces derniers représentent sensiblement la moitié de la population des cinq pays du Sud alors
que, au Nord, les 68 millions n’en représentent que 30%’’ (RAFAC, 2000 : 9-10). Le Sud est plus rural que le Nord.
11
territoires ruraux. Les paysages naturels de type méditerranéen sont les héritiers de cette antique
civilisation agraire. Ou du moins, ils en rappellent les traits.’’ (ibid : 13)
4. L’ambigüité de la patrimonialisation des paysages
Comme partout ailleurs, les paysages culturels de l’agropastoralisme du Haut-Atlas sont le résultat
des activités économiques et sociales des populations et constituent leur cadre de vie. L’atout majeur
de ces paysages culturels est, en effet, la persistance d’une population nombreuse dépendante de
l’activité agropastorale à laquelle elle est encore attachée. La finalité de la patrimonialisation de ces
paysages culturels serait de : i) les préserver pour protéger le cadre de vie et des activités économiques
des populations qui y vivent, ii) les valoriser en faisant connaitre les pratiques typiques comme la
transhumance, et promouvoir les produits issus des activités agropastorales (viande, fruits…) en tant
que produits de terroir qui génèrent un revenu décent aux producteurs.
Mais tout cela ne va pas sans difficultés. Dans le contexte du pastoralisme des Alpes-Provence, G.
Lebaudy a soulevé ‘’toute l’ambiguïté de la patrimonialisation de l’activité pastorale, de la
transhumance et des bergers.’’ (2014 : 114) À la base de cette ambigüité, le dilemme que pose
l’opposition entre la beauté des paysages, des sites, des pratiques exotiques comme la transhumance,
etc., d’un côté et, de l’autre, les conditions humaines et les moyens d’existence des populations qui
vivent dans ces sites. La valorisation des paysages ne peut s’accommoder de la misère sociale
comme il est hors propos de ‘’faire l’apologie d’une vie de misère.’’ Car, les paysages ne valent que
par les populations qui les entretiennent et les façonnent et refaçonnent. Pour les paysages culturels
de l’agropastoralisme du Haut-Atlas, la question serait de savoir comment les patrimonialiser sans
leur faire perdre leur vocation de production agropastorale et de cadre de vie des populations
montagnardes. Comme nous l’avons dit, l’activité agropastorale est la base de l’économie locale et
des ménages, à laquelle s’est intégrée récemment l’activité touristique.
C’est ici que le rôle de la communication et de la médiation culturelle devient crucial. Mais quel type
de communication et de médiation faire valoir ? L’exemple d’un pays comme la France, qui a
accumulé une longue expérience de valorisation du patrimoine, est instructif et pourrait constituer
une source d’inspiration. Dans la zone Alpes-Provence ‘’l’activité pastorale et le savoir-faire
traditionnel sont valorisés par leur dimension patrimoniale et peuvent servir d’argument commercial
pour attirer une clientèle dans des gîtes ou chambres d’hôtes et leur servir des produits de l’élevage.’’
(Lebaudy, 2014 : 329) Dans le Haut-Atlas, en l’absence d’un modèle de communication sur les
paysages culturels de l’agropastoralisme, les professionnels locaux et externes du tourisme
commercialisent des images bricolées des paysages culturels où reviennent invariablement les
gravures rupestres et la transhumance, voir le nomadisme !
Le risque de ce type de communication est qu’elle fige ou dénature l’image d’une société, sa culture
et ses paysages en produisant des images-clichés et des stéréotypes figés sur des cultures vivantes,
12
contribuant ainsi à leur muséification. La patrimonialisation des paysages culturels ne procèdera pas
d’une démarche ‘’conservatoire’’ ou de ‘’muséification’’, mais d’un projet qui en ferait une
ressource territoriale pour amorcer des processus de développement raisonnés.
Il ne faudrait pas finir sans rappeler les menaces qui affectent ou qui pourraient affecter ces paysages
culturels et sur lesquels nous avions attiré l’attention dans d’autres écrits (Mahdi et Dominguez,
2009a). Les plus dangereuses de ces menaces sont celles qui touchent l’intégrité physique des Agdals
et qui, à la longue, peuvent mettre en péril l’ensemble du système agropastoral. Deux phénomènes
principaux sont à citer.
L’appropriation privative des terres de parcours de statut collectif et leur mise en culture est l’une de
ces menaces de type endogène perpétrée par les populations locales mais qui interpelle sur l’identité
des auteurs. Dans le Yagour, les éleveurs ont développé une agriculture irriguée sur le parcours. A
l’Oukaïmeden, c’est la sédentarisation embryonnaire dans les Azibs où des enclos sont en passe d’être
transformés en maisons solides pouvant accueillir leurs « propriétaires » en hiver quand la station de
ski est mise en service.
Le phénomène d’accaparement de l’Agdal pour des projets touristiques d’envergure est une menace
exogène. C’est le cas du groupe émirati « Emaar » qui projette la création sur l’emplacement de
l’Agdal d’Oukaïmeden d’un méga complexe touristique fonctionnant toute l’année, avec un golf de 18
trous, des pistes d’athlétisme pour l’entrainement de sportifs d’élite, de nouvelles pistes de ski avec
des canons à neige (alors qu’il n’y a pas assez d’eau pour tous), 11 hôtels, des résidences (Mitrate,
2009) avec un investissement de 1,4 milliard de dollars. Ce projet avait été inscrit dans la stratégie
nationale de développement du tourisme à l’horizon 2010 !
Conclusion
Les paysages du Haut-Atlas de Marrakech rentrent dans la catégorie des ‘’paysages culturels’’ tels
qu’ils ont été définis par la Convention de 1992 de l’UNESCO sur le patrimoine et les ‘’paysages
culturels de l’agropastoralisme méditerranéen’’, dont le modèle est fourni par les Causses et Cévennes
déclarés de valeur universelle exceptionnelle et inscrits sur la liste du patrimoine mondial en juin
2011. Une démarche projective pour l’inscription des paysages culturels du Haut-Atlas sur la liste du
patrimoine mondial de l'humanité est donc justifiée.
Ils sont, en effet, le résultat d’une interaction millénaire entre l’homme et son milieu. Mais ces
paysages culturels évoluent, c’est là leur atout majeur. Objet dynamique, ils se transforment,
s’enrichissent par de nouveaux apports, sont constamment réinterprétés et prennent des sens nouveaux.
En un mot, ils sont vivants. Cette vitalité leur provient de celle du système agropastoral dont
dépendent encore les populations habitant ces lieux et façonneuses de ces mêmes paysages. Ce qui
prouve la force de sa résilience, ses capacités d’adaptation pour faire face aux défis de la modernité.
13
Le développement territorial pourrait être fondé sur la valorisation des composantes des paysages
culturels de la montagne, ses produits agropastoraux et touristiques. Les populations de la montagne
ont déjà entamé des processus de développement territorial. Il est nécessaire qu’ils soient soutenus par
des politiques publiques qui promeuvent les genres de vie de montagne tout en neutralisant les
menaces qui pèsent sur ces sites de valeur patrimoniale, notamment la privatisation et/ou
d’accaparement des terres.
14
Bibliographie
Alaoui-Haroni, S. (2009): “Les pelouses humides dans le haut Atlas: biodiversité végétale, dynamique
spatiale et pratiques de gestion coutumière”. Thèse de Doctorat, Université Cadi Ayyad (Marrakech).
Auclair. L et Al Ifriqui. M (S/Dir). 2012. ‘’AGDAL Patrimoine socio-écologique de l’Atlas
Marocain.’’ - IRD – IRCAM
Campagne P et Pecqueur B, 2012. « Processus d’émergence des territoires ruraux dans les pays
méditerranéens – Analyse comparée de 10 pays Méditerranéens du Sud, du Nord et de l’Est». Options
Méditerranéennes.
Chelhoud, J. (1964): La structure du sacré chez les arabes. Maisonneuve, Geuthner. (Voir la page de
l’article où il apparait)
Cuisenier J, 1989
A l’ombre des Carpates
Ethnologie Française, XIX, 3 pages 244-252
Descola Ph
Postface ‘’Les coulisses de la nature’’ (123 – 127), in ‘’Gouverner la nature’’ 2007. Cahiers
d’Anthropologie Sociale, numéro 3. L’Herne Edition
Gumuchian H et Pecqueur B, 2007. ‘’La ressource territoriale’’ Economia – Anthropos.
LEBAUDY G, 2014
‘’Le bon berger et les gens de moutons - Une culture pastorale en mutation - Alpes-Provence (XIXe-
XXIesiècle)’’. Thèse de doctorat d’anthropologie sociale et ethnologie. Ecole des hautes Etudes en
Sciences Sociales – Paris.
Houarau, B. (2006): “Recherche sur les gravures rupestres du plateau du Yagour”. Mémoire Master,
Université de Nice – Sophia Antipolis.
Iraki A et Tamim M, 2013
‘’La dimension territoriale du développement rural au Maroc’’. Etude géographique. Ed Kalimate
Lenclud G, 1995
L’ethnologie et le paysage. Questions sans réponses. (2 – 17), in Claudie Voisenat, 1995
Paysage au pluriel. Pour une approche ethnologique du paysage, 1995
Paris. Ed le MSH.
Mahdi, M. (1999): Pasteurs de l’Atlas. Production pastorale, droit et rituel. Casablanca, Fondation
Adenauer.Encyclopaedia Universalis, Corpus 7
Mahdi M, 2008
« L'agropastoralisme du versant nord du Haut Atlas », pp 69-74, In, JP Chassany (Ed), « Les paysages
culturels de l'agro pastoralisme méditerranéen ». Edition: AVECC Association de Valortisation des
Espaces des Causses et des Cévennes et le Ministère de MEDDAT.
Mahdi M et Dominguez P, 2009a
Les Agdal de l’Atlas marocain : un patrimoine culturel en danger !
Bulletin Economique et Social du Maroc, 327-347. Ed. OKAD – Rabat.
15
Mahdi M et Dominguez P, 2009b
« Regard anthropologique sur transhumance et modernité au Maroc »
Ager • no 8 • 2009. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural. Espagne.
Journal of Depopulation and Rural Development Studies
Mahdi M, 2012.
‘’Le Maroc’’, in Processus d’émergence des territoires ruraux dans les pays méditerranéens». Analyse
comparée de 10 pays du Nord, du Sud et de l’Est Méditerranéens. pp. 47-51. Ed. P. Campagne et B.
Pecqueur. Options méditerranéennes. Série B : Etudes et recherches. N° 69
Mahdi M, 2010a
‘’Nos territoires ruraux sont-ils méditerranéens ?’’
Conférence présentée à : Primeras JORNADAS Antropología del Mediterráneo. Un mar como lugar
de encuentro, organizadas por el Instituto Universitario de Etnología de la UCV con ocasión del Año
Internacional del Acercamiento de las Culturas - 4 y 5 de noviembre de 2010 – Valencia (Espagne)
Mahdi M, 2010b. « Patrimonialisation de la transhumance à l’Oukaïmeden » Cahiers Options
Méditerranéennes, Série A: Séminaires méditerranéens, Numéro 93.
Mitrarte, C. (2007): “Oukaïmeden: 2007, l’été de la dernière transhumance?”, communication
au Congrès International AGDAL (Marrakech). 11, pp. 67-76.
Peyrache-Gadeau V et Perron L
Le Paysage comme ressource dans les projets de développement territorial
Dossier : Paysage et développement territorial. Vol. 1, n° 2 | Septembre 2010 : Paysage et
développement durable
Simoneau, A. (1967): “Les gravures du Haut-Atlas de Marrakech”, Revue de Géographie du Maroc,
Rapport du Cinquantenaire, 2006. « Le Maroc Possible, Une offre de débat pour une ambition
collective. » p. 54, Casablanca.
Rapport Final, 2009 –
‘’Processus d’émergence des territoires ruraux dans les pays Méditerranéens : Analyse comparée
entre les trois pays du Maghreb, la France et 6 pays méditerranéens du Nord, du Sud et de l’Est.’’
MSH / fsp Maghreb. CIHEAM-RAFAC-Université Joseph-Fournier.
http://www.cevennes-parcnational.fr/Un-territoire-vivant/Les-classements-Unesco/L-inscription-au-
patrimoine-mondial (Consulté le 06/12/2014)