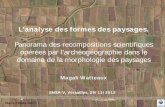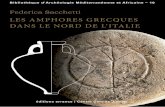Paysages enchantés et merveilles architecturales. Le pittoresque et la photographie dans l’Italie...
Transcript of Paysages enchantés et merveilles architecturales. Le pittoresque et la photographie dans l’Italie...
VOYAGE EN ITALIE À TRAVERS LES PHOTOGRAPHIES DES ARCHIVES ALINARI ET LES COLLECTIONS D’ART DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE
IL VIAGGIO IN ITALIA NELLE FOTOGRAFIE DEGLI ARCHIVI ALINARI E NELLE COLLEZIONI D’ARTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Mémoires duMemorie del GRAND TOUR
a cura disous la direction de
Angelo Maggi
Testi diTextes de
Angelo Maggi Daria Jorioz
Patrizia Framarin
VOYAGE EN ITALIE À TRAVERS LES PHOTOGRAPHIES DES ARCHIVES ALINARI ET LES COLLECTIONS D’ART DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE
IL VIAGGIO IN ITALIA NELLE FOTOGRAFIE DEGLI ARCHIVI ALINARI E NELLE COLLEZIONI D’ARTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Mémoires duMemorie del GRAND TOUR Aosta, Museo Archeologico Regionale Aoste, Musée Archéologique Régional20 dicembre 2008 - 3 maggio 200920 décembre 2008 - 3 mai 2009
CuratoreCommissaireAngelo Maggi
Direttore editorialeDirecteur éditorialGiovanna Naldi
Progetto grafi coProjet graphiqueSansai Zappini
Ricerca iconografi caRecherche iconographiqueAngela Barbetti, Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografi aValentina Tofani
Riproduzioni fotografi cheReproductions photographiquesPierpaolo PaganoStefano Venturini
RedazioneRédactionMaria Possenti, Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografi a
OrganizzazioneOrganisationPaola de Polo
©Copyright 2008Alinari 24Ore spa, [email protected]
ISBN 9788863020212
Regione Autonoma Valle d'AostaRégion Autonome Vallée d'Aoste
Presidente della RegionePrésident de la RégionAugusto Rollandin
Assessore all'Istruzione e CulturaAssesseur à l'éducation et à la cultureLaurent Viérin
Soprintendente per i beni e le attività culturali Surintendant des activités et des biens culturelsRoberto Domaine
Capo del Servizio attività espositiveChef du Service des expositionsDaria Jorioz
TestiTextesAngelo MaggiDaria JoriozPatrizia Framarin
Organizzazione della mostraOrganisation de l'expositionAssessorato Istruzione e CulturaDirezione promozione beni e attività culturaliServizio attività espositiveAssessorat de l'éducation et de la cultureDirection de la promotion des activités et des biens culturels Service des expositions
Coordinamento tecnicoCoordination techniqueGianna Gilli
AllestimentoMise en scèneFortunato Sergi
Segreteria organizzativaSecrétariat pour l’organisationDaniela FazariRiccarda Lettry
ComunicazioneCommunicationChristine Valeton
Albo dei prestatoriRegistre des prêteursArchivi Alinari, FirenzeRegione Autonoma Valle d’Aosta
CatalogoCatalogueAlinari 24 Ore
Traduzioni Traductions Christel Lambot
Uffi cio StampaBureau de presseSpaini & Partners, PisaSabina Vagneur
LuciEclairageFratelli Vicentini, Aosta
Consulenza e assistenza sullo stato di conservazione delle opere Conseil et assistance sur l'état de conservation des oeuvres Restauratori della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta Restaurateurs de la Surintendance des activités et des biens culturels de la Vallée d'Aoste
RingraziamentiRemerciementsLiliana ArmandOmar BorettazPiero CadoniCristina Costa LaiaLoredana DalleGaetano De GattisRosanna Maggio SerraDaniela Vicquéry
Internet: www.regione.vda.it
Le immagini provengono dai seguenti archiviLes images sont tirées des archives suivantesArchivi Alinari, FirenzeRaccolte Museali Fratelli Alinari (RMFA), FirenzeCollezioni Regione Autonoma Valle d’Aosta
In copertinaEn couvertureFotografo non identifi catoAosta. Porta Praetoria, 1900 ca.Raccolte Museali Fratelli Alinari (RMFA), FirenzePhotographe non identifi éAoste. Porta Praetoria, 1900 environCollections Musée Fratelli Alinari, Florence
SommarioSommaire
Laurent ViérinPresentazione
Laurent Viérin Preséntation
Angelo Maggi Paesaggi incantati e meraviglie architettonichePittoresco e fotografi a nell’Italia del Grand Tour
Angelo Maggi Paysages enchantés et merveilles architecturalesLe pittoresque et la photographie dans l’Italie du Grand Tour
Daria Jorioz Souvenirs d’ItalieIconografi a del Grand Tour nelle collezioni d’arte della Regione Valle d’Aosta
Daria Jorioz Souvenirs d’ItalieIconographie du Grand Tour dans les collections d’art de la Région Vallée d’Aoste
Patrizia Framarin Monumenti di Aosta romanaStudiosi e artisti tra '700 e '800
Patrizia Framarin Monuments romains d’AosteChercheurs et artistes du XVIII e et du XIX e siécle
Il viaggio in Valle d'Aosta - Le fotografi eLe voyage en Vallée d'Aoste - Les photographies
Il viaggio in Valle d'Aosta - Disegni, dipinti, stampeLe voyage en Vallée d'Aoste - Dessins, peintures, gravures
Il viaggio in Italia - Da Verona alla SiciliaLe voyage en Italie - De Vérone à la Sicile
Elenco delle opereListe des œuveres
Bibliografi a essenzialeBibliographie essentielle
4
5
6
10
14
18
22
25
29
67
101
135
140
�10
Le XVIIIe représente le siècle d’or des voyages en Italie. L’idée du Grand Tour se répand parmi
l’aristocratie européenne d’au-delà des Alpes principalement dans la dernière partie du siècle,
transformant l’Italie en carrefour de lieux de pérégrinations de gentilshommes, d’architectes et
d’artistes français, anglais ou allemands. En parcourant les routes du bel paese, le voyageur étranger
- fût-il superfi ciel - ou le globe-trotter poussé par sa curiosité intellectuelle et spécialement attiré par
les trésors de l’art et de l’Antiquité sont facilement poussés à établir quelques comparaisons entre
les paysages qui se déploient devant leurs yeux. À ce propos, dans un essai moderne et illuminé sur
les caractères du paysage italien, Aldo Sestini explique comment le voyageur « en avertit la variété
admirable et est heureux de rappeler à son esprit le spectacle de beauté et d’harmonie qui lui est
offert par certaines visions panoramiques ou par la succession rapide de petites scènes »1.
La photographie, avec sa représentation conventionnelle des lieux, n’arrive qu’après 1839 pour
combler la matrice narrative du voyage. Il suffit de penser aux Excursions daguerriennes de
Noël-Marie Paymal Lerebours, le premier exemple de guide iconographique des lieux du Grand
Tour d’après daguerréotype transposés en estampe à l’aquatinte, ou bien au projet singulier
d’Alexander John Ellis intitulé Italy Daguerreotyped, une entreprise photographique et éditoriale
qui n’a jamais été achevée. Jusqu’alors, le voyageur qui a besoin de fixer un contact imaginatif
avec la réalité et avec la scène qui se déroule devant ses yeux s’appuie à la représentation
graphique. Les contextes naturels et architecturaux qu’il traverse sont représentés dans des
peintures à l’huile, des aquarelles, des gravures ou des croquis personnels réalisés en cours
de route. Dans l’imaginaire visuel du traveller du XVIIIe siècle, l’Italie est encore le pays où
domine la catégorie esthétique du « pittoresque »: un langage, formulé par le révérend William
Gilpin dans plusieurs publications de 1768 à 1808, qui influence beaucoup la structuration du
regard du voyageur en préfigurant ce qui sera interprété plus tard comme style ou cadrage
photographique. Pour Gilpin, le décor idéal doit inclure un contraste de lumière et d’ombre,
une structure rigide, de l’irrégularité, de la variété et le pouvoir de stimuler l’imagination.
Ces caractéristiques ne sont pas pittoresques en elles-mêmes, mais doivent se combiner entre
elles pour obtenir l’effet désiré. L’homme n’est plus un voyageur passif : il doit devenir un
observateur sensible de la nature et rechercher de nouveaux horizons. La recherche et la curiosité
font intégralement partie de l’idéal pittoresque ; voyager en quête du pittoresque devient le
présupposé du flux copieux de visiteurs qui arrivent en Italie au siècle suivant aussi.
Paysages enchantés et merveilles architecturalesLe pittoresque et la photographie dans l’Italie du Grand Tour
1 Aldo Sestini, Caratteri del Paesaggio Italiano in "Le vie d’Italia", n. 11, novembre 1962, p. 1315.
11�
En 1789, dans son Picturesque Travel, Gilpin écrit :
La première source d’amusement pour un voyageur en quête du pittoresque est la recherche de
toutes sortes de beauté, quand la nouveauté le surprend à chaque pas et quand chaque horizon
distant promet une fraîche gratifi cation. Après cette recherche, nous arrivons à l’objectif esthétique,
puis nous analysons les scènes que nous avons découvertes, nous les examinons comme un tout : la
composition de couleurs et de lumière sous une vision complète… mais notre plus grand plaisir naît
là où la scène s’ouvre devant nos yeux et bloque toute faculté de l’esprit : c’est alors que l’émotion
l’emporte sur l’observation 2.
Gilpin introduit ici l’émotion à l’intérieur du compte-rendu de voyage, comme le feront les écrivains
anglais de l’époque victorienne dans leurs descriptions de l’Italie « dans la transformation de la
littérature de voyage en essais et en récits »3. La recherche visuelle de Gilpin annonce ce que l’on fera
d’abord avec la chambre noire, puis avec le moyen mécanique de la photographie.
Le terme « pittoresque » établit une série d’images idéales et caractéristiques à travers lesquelles une
scène de paysage et d’architecture est jugée et considérée appropriée pour être incluse dans une peinture
ou dans une photographie. En ce sens, le paysage italien n’est pas tellement vu pour ses caractéristiques
naturelles, mais plutôt pour la façon où il offre des images d’une idylle rurale contrastant avec la réalité.
Comme une conséquence culturelle, le pittoresque tire une image visuelle d’une Arcadie hors du temps,
une image homogène de la vie sociale italienne4. D’après une conception pittoresque bien connue, l’un
des thèmes les plus importants à expérimenter en Italie est celui de la fenêtre comme cadre de lumières
changeantes au fi l des saisons ou bien une grande ouverture à travers laquelle le regard pénètre dans
une ruine antique. Saisir les contrastes fondamentaux de lumières et d’ombres dans la vue dépend aussi
des distributions des intérieurs des demeures italiennes et de l’aspect de ruine des grands monuments
du passé. Les peintres aiment reproduire ces conditions dans leurs paysages, car ils apprécient aussi
beaucoup de voir ces caractéristiques dans la réalité. Évidemment, cette curiosité est largement satisfaite
par la photographie, qui offre tout de suite ses qualités de document pour mieux garantir le « vrai », tout
en maintenant toujours un lien avec le changement progressif des principes de l’art de la peinture. Cela
apparaît de façon évidente dans les sélections effectuées par les voyageurs qui réalisent les premières
photographies du Grand Tour, quand l’Italie on the spot est encore fortement interprétée comme
expression fi dèle de la pensée et de l’état d’âme de l’artiste peintre en plein air.
L’aspect de la ruine dans laquelle sont photographiés les édifi ces des Forums impériaux à Rome, les
vestiges des temples de Paestum ou, de manière clairement visible, dans la photo prise de l’éruption
du Vésuve par Giovanni Crupi à travers les restes de Pompéi met en lumière une attitude différente
envers ce qui est antique. En effet, avec la technique du collodion humide, s’exprime la tendance à
saisir non pas tant la perfection formelle de l’architecture du passé, mais plutôt une série de qualités
émotionnelles suscitées par l’association de certaines formes architecturales à l’histoire et aux
2 William Gilpin, Three Essays: On Picturesque Beauty; on Picturesque Travel: and on Sketching Landscape: to which is added a poem, on Landscape Painting, London 1794, p.41.3 Attilio Brilli, Quando viaggiare era un’arte. Il romanzo del Grand Tour, Bologna 1995, p. 53.4 La relation complexe entre le paysage et l’esthétique du pittoresque est largement traitée par Malcolm Andrew dans The Search for the Picturesque, London 1989 ; à ce sujet, consulter aussi l’étude fondamentale de Christopher Hussey, The Picturesque: Studies in a Point of View, London & New York 1927. La relation entre la photographie et le pittoresque est encore brièvement traitée par Graham Clarke dans The Photograph, Oxford 1997, p. 55.
William GilpinThree Essays: On Picturesque Beauty; on Picturesque Travel: and on Sketching Landscape: to which is added a poem, on Landscape Painting, London 1794
�12
événements dont ils sont un témoignage. Et en ce sens, en Italie, surtout vers la moitié du XIXe siècle,
la poétique exprimées par les ruines des monuments ne concerne pas que le répertoire classique, mais
aussi celui de l’architecture du Moyen-Âge.
Une fois franchie la barrière des Alpes, où - d’après la défi nition de John Ruskin - c’est l’espace de la
montagne avec ses « Cathédrales de la terre » qui s’offre au regard, l’Italie se manifeste aussi bien au
photographe qu’au voyageur romantique avec une série extraordinaire de sujets à représenter5. Avec son
envie de vérité, Ruskin est l’un des premiers à se libérer des freins du langage académique en achetant des
daguerréotypes de paysage et d’architecture, et en en peignant, presque simultanément, des impressions
rapides et inédites qui soulignent la perception des variations des lumières et de l’atmosphère6. Après
Ruskin, l’Italie cesse d’être un lieu de beauté arcadienne à la Claude Lorrain ou à la Nicolas Poussin, pour
assumer une série d’identités distinctes : celles des lieux vers lesquels les visiteurs étaient attirés.
L’impulsion donnée au tourisme par les liaisons ferroviaires a lieu à une période où la photographie
progresse beaucoup grâce à l’invention de la technique au collodion humide en 1851. Ce n’est qu’avec ce
procédé que l’on peut tenir compte de la reproduction en série et du facteur coût qui répond à l’opportunité
commerciale représentée par la séduction croissante exercée par les images-souvenirs proposées par de
nombreux ateliers. Les photographes nationaux et étrangers sont de plus en plus nombreux à parcourir
l’itinéraire italien. Bien que les procédés photographiques les plus vieux aient du succès dans leur secteur
spécifi que, ils possèdent des limites sévères qui rendent leur application commerciale diffi cile.
La technique au collodion humide surmonte plusieurs des conditions défavorables des premiers
procédés et combine de nombreux avantages de la daguerréotypie et de la calotypie. Le nouveau
procédé photographique est accueilli avec enthousiasme par les photographes et, vers 1852, quand il
s’est désormais perfectionné, il permet de développer une nouvelle activité prometteuse, entre autres
sur le plan commercial. Ainsi que nous le raconte Lucia Moholy, une « vaste gamme de possibilités »
s’ouvre : la massifi cation et le nombre illimité de copies positives représente « un autre pas décisif vers
la démocratisation de la photographie au sens économique et idéologique du terme »7. Parmi tous ces
photographes commerciaux émergent Naya à Venise, Sommer à Naples, Alinari à Florence, MacPherson
et Anderson à Rome, ainsi que beaucoup d’autres qui répandent leurs images partout, avec celles qui
ont été achetées par d’autres photographes, concernant aussi différentes étapes du Grand Tour, sous les
formats les plus variés et, en particulier, dans les vues stéréoscopiques peu coûteuses8.
Tous les touristes désirent un témoignage visuel de leur voyage. L’image souvenir associe en quelque
sorte le voyageur à la dimension historique de l’endroit et en refl ète nostalgiquement l’expérience
perceptive. Aucun souvenir n’est plus effi cace que la vue stéréoscopique qui conduit le regard dans
une tridimensionnalité « virtuelle », en comptant sur la perception simultanée de l’espace et de la
profondeur de deux images légèrement séparées.
Au début, l’effet stéréoscopique est obtenu avec des images dessinées à la main grâce à un appareil
inventé en 1832 par Charles Wheatstone. Ce dispositif plutôt encombrant est également utilisé pour
observer des daguerréotypes et différentes versions du passage positif-négatif. En 1849, David Brewster
5 Voir à ce sujet Giuseppe Garimoldi, « L’immagine contesa. L’iconografi a alpina fra belle arti e fotografi a », dans Le Cattedrali della Terra. La rappresentazione delle Alpi in Italia e in Europa 1848-1918, Electa, Milano 2000, pp. 118-124 ; à propos de la représentation photogra-phique des Alpes avec une section consacrée aux transformations territoriales des glaciers de l’Arctique, voir la publication récente de Monika Faber (sous la direction de), Infi nite Ice. The Artic and the Alps from 1860 to Present, Hatje Cantz - Albertina, Vienne 2008.6 Voir à ce sujet Paolo Costantini et Italo Zannier (sous la direction de), I Dagherrotipi della Collezione Ruskin, Alinari - Arsenale, Venezia, 1986.7 Lucia Moholy, Cento Anni di Fotografi a 1839-1939, Alinari, Firenze 2008, p. 114.8 Pour un regard d’ensemble sur la photographie des voyageurs du XIXe siècle, consulte : Italo Zannier, Le Grand Tour, Venezia 1997 ; Vincent Jolivet, Memorie del Grand Tour nelle fotografi e delle collezioni Alinari, Firenze 2006.
13�
projette un appareil beaucoup plus précis et compact, facile à manipuler. Avec peu de modifi cations, de
perfectionnements et de variations, ce dispositif pour la vision des stéréogrammes demeure le principe
de base des stéréoscopes pendant de nombreuses années. À la fi n des années cinquante du XIXe siècle,
la popularité de la vision stéréoscopique est telle qu’aucune maison bourgeoise n’est privée d’un viseur
pour stéréogrammes ; l’enthousiasme avec lequel la stéréoscopie est accueillie engendre une véritable
manie, défi nie moqueusement « stereoscopic epidemic »9. Le rôle du stéréoscope comme instrument
de connaissance et de persuasion est précieux. De nombreux voyageurs apprennent à apprécier les
merveilles d’Italie sans se déplacer de leurs maisons ; d’autres sont sans aucun doute inspirés par les
scènes qu’ils ont achetées et désirent voyager pour les voir en vrai.
Bien que, vers 1860, le succès de la photographie soit soutenu par le développement constant du marché,
vers la fi n du XIXe siècle un nouveau type d’image commence à faire son apparition dans les albums
de voyage : la photographie instantanée. Jusqu’à ce moment, le fait de posséder et d’utiliser du matériel
photographique est un privilège réservé à quelques amateurs. En 1880, avec d’autres progrès techniques,
l’invention de l’appareil photo portable change de façon importante le rôle du photographe professionnel,
qui n’est plus considéré comme le seul créateur d’images. Toujours plus de passionnés de photo s’équipent
pour produire leurs propres images du monde. « En dix minutes - promet un mode d’emploi Kodak de 1888
- tout être humain peut apprendre sans effort à prendre de bonnes photographies, indépendamment de ses
capacités intellectuelles. » La facilité avec laquelle chacun peut prendre une photo est la réponse technique
aux exigences de la nouvelle génération de photographes incapables et peu enclins à s’occuper de procédés
plus compliqués. Le fait que ce changement profond dans le cours de production de la photographie a lieu
en même temps que l’avènement du tourisme moderne est signifi catif. À ce moment, la conformation
sociale et le style de voyage du touriste en Italie commencent à se transformer. Les photos d’amateur
prises à cette période semblent libérées de l’esthétique pittoresque de l’ancien voyage photographique et
de l’intention de conserver l’héritage culturel du monde. Les scènes photographiées sont subordonnées à
des « signifi cations sociales » qui transforment les lieux culturels importants en fond en fonction d’un seul
objectif : garantir aux personnes impliquées une espèce de roman fabuleux de leur expérience personnelle.
À la place de l’homme, qui - dans de nombreuses photographies d’architecture - sert à comprendre quelles
sont les dimensions de l’édifi ce ou du monument ou qui représente simplement un élément de folklore, ces
nouvelles photographies offrent un attrait matériel aux futurs destinataires de l’image. Les photographies
deviennent soudain plus étroites et cela ne dépend pas que de leur petit format. Les instantanés sont destinés
à fi xer le but stéréotypé des terres lointaines comme démonstration de la présence sur place de celui qui
prend la photo. Tous ces fragments photographiques avec un riche album d’excellentes photographies du
XIXe siècle ne suffi sent pas à faire connaître pleinement nos nombreux paysages, à faire apprécier leur
intérêt et à profi ter de leur beauté. Aujourd’hui comme hier, dans son devenir historique, la photographie
révèle « une invitation à voyager à travers l’Italie, non seulement pour visiter ses cent villes, mais pour
observer les yeux bien ouverts ses cent paysages, à les comprendre au-delà des pures apparences, à aimer
en même temps l’œuvre de la nature et celle des hommes, unies pour façonner un visage si multiforme et
si admirabile à notre pays »10.
Angelo Maggi
9 Moholy, op. cit., p. 178. À ce sujet, voir également le quatrième chapitre du livre de Jonathan Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernità in the Nineteenth Century, Massachusetts Institute of Technology, 1990.10 Sestini, op.cit., p. 1324.
31�
Fratelli AlinariAosta. L’Arco di Augusto, 1895 ca.
Frères AlinariAoste. L’Arc d’Auguste, 1895 environ
�48
Fotografo non identifi catoAosta. Torre di Bramafan, 1900 ca.
Photographe non identifi éAoste. Tour de Bramafan, 1900 environ
�74
AnonimoVeduta del Castello di Ussel, 1875 circaacquarello su cartoncino
Artiste anonymeVue du Château d’Ussel, 1875 environaquarelle sur carton léger
�96
Anonimo“Arco trionfale d’Augusto presso la città di Aosta”, 1845litografi a
Artiste anonyme« Arco trionfale d’Augusto presso la città di Aosta », 1845lithographie
�98
Federico Ashton“L’Arco di Augusto in Aosta”, 1860olio su tela
Federico Ashton« L’Arco di Augusto in Aosta », 1860huile sur toile
105�
Fratelli AlinariPerugia. Arco di Augusto, 1875 ca.
Frères AlinariPérouse. Arc d’Auguste, 1875 environ
�106
Robert MacphersonAssisi. Tempio di Minerva, 1860 ca.
Robert MacphersonAssise. Temple de Minerve, 1860 environ
111�
Fratelli AlinariRoma. Il Tempio di Saturno nel Foro Romano, 1875 ca.
Frères AlinariRome. Le Temple de Saturne sur le Forum romain, 1875 environ
�112
Gioacchino Altobelli e Pompeo MolinsForo Romano e Colonna di Foca, 1860 ca.
Gioacchino Altobelli et Pompeo MolinsForum romain e Colonne de Phokas, 1860 environ
�118
Edmondo BehlesRoma. L’Anfi teatro Flavio, 1865 ca.
Edmondo BehlesRome. L’Amphithéâtre Flavius, 1865 environ
�126
Giorgio SommerPaestum. Il Tempio di Nettuno, 1880 ca.
Giorgio SommerPaestum. Le Temple de Neptune, 1880 environ
129�
Giovanni CrupiSiracusa. Ingresso dell’Anfi teatro, 1880 ca.
Giovanni CrupiSyracuse. Entrée de l’Amphithéâtre, 1880 environ