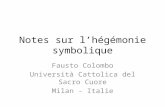In-Plane Retardation of Collective Expansion in Au + Au Collisions
Les problématiques ecclésiologiques françaises au prisme des lectures italiennes. Gallicanisme et...
Transcript of Les problématiques ecclésiologiques françaises au prisme des lectures italiennes. Gallicanisme et...
Laboratoire
Langages
Littératures
Sociétés
Les
éch
ange
s re
ligi
eux
entr
e l’
Ital
ie e
t la
Fra
nce
Université de SavoieISBN: 978-2-915797-61-9ISSN : 1771-6195
Les échanges religieux franco-italiens de 1750 à 1850 ? L’objet ne s’impose pas à l’évidence. Pourtant sa cohérence se justifie par la période choisie : enjamber la période révolutionnaire permet de restituer des mouvements de fond de la vie de l’Église aux prises avec des débats totalement inédits dans le cadre d’une Europe en bouleversement. De l’Aufklarung au tournant intransigeant, il y a bien ici un temps crucial de l’évolution de la catholicité caractérisé, notamment, par son recentrage autour de Rome, comme le rappelle la couverture de cet ouvrage. Il ne s’agissait pas de revenir sur les événements eux-mêmes ; les aspects diplomatiques et politiques, mieux connus, ont été écartés. Les organisateurs ont voulu privilégier une approche dynamique selon le principe des flux : mouvement des hommes et des femmes, des doctrines, des dévotions, des pratiques, des institutions, etc. avec une attention marquée à la notion de réseaux qui les canalisent. La période envisagée, du milieu du xviiie siècle au milieu du xixe siècle, se révèle alors dans son unité, en dépit de – ou grâce à – la rupture révolutionnaire. Elle fut, notamment, un temps de maturation des positions de l’Église catholique et de réorientation de la vie religieuse face aux profondes transformations contemporaines, de la réaction aux Lumières jusqu’aux événements décisifs de 1848-1850. En somme, il s’agissait de saisir les évolutions en termes de diffusion et de réception de modèles et de traditions, profondément enracinées ou réinventées. Les échanges de toutes natures, dont il n’était pas question ici de dresser l’inventaire, participèrent bien à nourrir la réponse catholique aux défis multiples d’un siècle de mutations accélérées.
Frédéric Meyer et Sylvain Milbach sont maîtres de conférences à l’Université de Savoie.
20 €
SociétésReligionspolitiques
Les échanges religieux entre l’Italie et la France,
1760-1850Regards croisés
-
Scambi religiosi tra Francia e Italia,
1760-1850Sguardi incrociati
Textes réunis par
Frédéric Meyer et Sylvain Milbach
15
Illustration de couverture : « Le pape Pie VII ». Frontispice à François-Marie Bigex, Étrennes religieuses aux fidèles du diocèse de Genève pour l’an de grâce mil huit cent un, an Ier du dix-neuvième siècle, an 2 du pontificat de Pie VII, s.l., 1801, un volume in 12°. Collections Bibliothèque municipale de Chambéry (SEM P 814) ; cliché Éric Beccaro.
Laboratoire Langages, Littératures, sociétés coLLection sociétés, reLigions, poLitiques
n° 15
© Université de Savoie UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés BP 1104 F – 73011 CHAMBERY CEDEX Tél. 04 79 75 85 14 Fax 04 79 75 91 23 http ://www.lls.univ-savoie.fr
Réalisation : Catherine Brun Illustration de couverture : « Le pape Pie VII ». Frontispice à François-Marie Bigex, Étrennes religieuses aux fidèles du diocèse de Genève pour l’an de grâce mil huit cent un, an Ier du dix-neuvième siècle, an 2 du pontificat de Pie VII, s.l., 1801, un volume in 12°. Collections Bibliothèque municipale de Chambéry (SEM P 814) ; cliché Éric Beccaro. ISBN : 978-2-915797-61-9 ISSN : 1771-6195 Dépôt légal : mars 2010
Université de Savoie
directeur du Laboratoire
Christian Guilleré
Cet ouvrage a été réalisé avec le concours de l’Assemblée des Pays de Savoie,
la Région Rhône-Alpes
Université de Savoie
sommaire
Présentation ...........................................................................................7Spazi sacri a Roma : presenze e modelli della chiesa franceseStefania Nanni ......................................................................................9Vicaires généraux et administrations diocésaines en France et en Italie à la fin du xviiie siècleFrédéric Meyer .....................................................................................27L’ influence de la France, du Synode de Pistoia à Auctorem FideiPaola Vismara ......................................................................................43Les problématiques ecclésiologiques françaises au prisme des lectures italiennesGallicanisme et antiromanisme janséniste au temps de la papauté intransigeante (de la mi-xviiie siècle à la mi-xixe siècle)Sylvio De Franceschi ............................................................................59Le «Amicizie » – Reti di sociabilità sui due versanti delle AlpiEdoardo Bressan ..................................................................................79Les voyageurs français face aux dimensions religieuses de l’Italie entre l’ âge des Lumières et l’ époque romantique : les ambiguïtés du « moment révolutionnaire »Gilles Bertrand .....................................................................................93La diffusion de la dévotion au chemin de croix entre Italie et France au début du xixe siècleJean-Marc Ticchi ............................................................................... 117Una chiesa, due Stati, tre «nazioni »: la chiesa del Santo Sudario dei Piemontesi a Roma fra Restaurazione e RisorgimentoPaolo Cozzo ....................................................................................... 131Religiosi francesi a Roma tra rivoluzioni e restaurazione.Il caso dei fratelli delle scuole cristiane Maria Lupi ......................................................................................... 145
Université de Savoie
Maria Cosway : témoin cosmopolite de son temps, pédagogue novatrice à Lodi (avec quelques documents inédits)A. Zambarbieri ................................................................................... 175Pauvre Italie ! Tout le monde a l’air bâillonné. Quel beau pays à affranchir !Regards de catholiques libéraux français sur l’Italie – 1830-1848Sylvain Milbach ................................................................................. 191Giovanni Maria Mastai Ferretti e la prima diffusione in Italia dell’Opera della Propagazione della Fede Carlo Pioppi .......................................................................................213Une Europe des dévots au xixe siècle ? L’ exportation d’un modèle charitable français en ItalieMatthieu Brejon de Lavergnée............................................................243Un cas d’ italianisation réussie de la piété française au xixe siècle : la dévotion aux âmes du purgatoireGuillaume Cuchet ..............................................................................257ConclusionsChristian Sorrel ..................................................................................267
Université de Savoie
59
Les probLématiques eccLésioLogiques françaises au prisme des Lectures itaLiennes
gaLLicanisme et antiromanisme janséniste au temps de La papauté intransigeante
(de La mi-xviiie siècLe à La mi-xixe siècLe)
syLvio de franceschi
École pratique des hautes études, IVe section LARHRA, UMR-CNRS 5190
Dans l’histoire de l’ecclésiologie catholique, l’existence et la précise délimitation sont désormais acquises d’un moment intransigeant qui, selon les mots de Philippe Boutry, « constitue à l’aube de l’ère contemporaine une étape majeure dans les rapports qu’entretiennent histoire générale du chris-tianisme et théologie »1. Un temps désarçonnée par la diffusion des idéaux propres aux Lumières2, divulgation qu’elle tente d’encadrer par la produc-tion contrôlée d’une Aufklärung catholique dont les travaux de Mario Rosa ont dressé la généalogie3, la papauté doit faire face au douloureux trauma-tisme engendré par la Révolution française et consolidé par la naissance et la mise en place de l’État libéral.
Organisé et tenu à Strasbourg du 26 au 28 novembre 1959, un col-loque consacré à l’ecclésiologie du xixe siècle avait en son temps permis d’éclairer nombre de points – près d’un demi-siècle plus tard, la plupart de ses conclusions paraissent encore valides, même si elles demandent à être
1 Ph. Boutry, « Tradition et autorité dans la théologie catholique au tournant des xviiie et xixe siècles. La Bulle Auctorem fidei (28 août 1794) », Histoire et théologie, (dir.) J.-D. Durand, Paris, 1994, p. 59.2 Voir S. De Franceschi, « L’ autorité pontificale face au legs de l’antiromanisme catholique et régaliste des Lumières : réminiscences doctrinales de Bellarmin et de Suárez dans la théologie politique et l’ecclésiologie catholiques de la mi-xviiie siècle à la mi-xixe siècle », Archivum Historiæ Pontificiæ, 38, 2000, p. 119-163.3 Voir M. Rosa, Settecento religioso. Politica della Ragione e religione del cuore, Venise, 1999, en particulier « L’ Aufklärung cattolica », p. 149-184.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
60
précisées et nuancées. Dans une contribution intitulée La Géographie ecclé-siologique au xixe siècle, Roger Aubert rappelait très justement qu’en matières d’ecclésiologie, la France pouvait se fonder sur sa solide tradition gallicane, soit le gallicanisme modéré de Bossuet, nuancé ensuite par le théologien Honoré Tournély (1658-1729)4, auteurs dont Austin Gough a pu souligner la cruciale importance au long de l’âge romantique5. Au début du xixe siècle paraissent des apologies de la Déclaration des quatre Articles de 1682, dont l’enseignement a par ailleurs été rendu obligatoire dans les séminaires en vertu de l’article 24 de la section III du titre II des Articles organiques du concordat de 1801 : « Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le Clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue. » L’ année même du concordat du 11 juin 1817, qui n’a finalement jamais eu force de loi dans le royaume, Louis-Mathias de Barral publiait une Défense des libertés gallicanes et de l’assemblée du Clergé de France6 ; de son côté, Denis-Antoine-Luc Frayssinous faisait paraître en 1818 ses Vrais principes de l’Église gallicane sur le gouvernement ecclésiastique7 ; en 1821, enfin, le cardinal de La Luzerne produit sa Dissertation sur la Déclara-tion de l’assemblée du clergé de France de 1682. Par réaction à une indéniable réaffirmation du modèle gallican se développe en France un impétueux cou-rant ultramontain dont les prodromes doivent être situés aux alentours de 1815. À en croire Roger Aubert, le mouvement commence avec la diffusion – par les soins des jésuites récemment rétablis – de traductions d’ouvrages italiens dévoués à la cause du Saint-Siège. Dès 1815 est éditée la version française d’un livre fondamental du jésuite Alfonso Muzzarelli (†1813) inti-tulé De l’autorité du pontife romain d’après les conciles généraux8. En ce qui concerne l’ecclésiologie défendue par les auteurs acquis au souverain ponti-ficat, Roger Aubert note l’importance qu’a eue la confrontation directe et in
4 R. Aubert, « La géographie ecclésiologique au xixe siècle », L’ Ecclésiologie au xixe siècle (Strasbourg, 26-28 novembre 1959), Revue des sciences religieuses, xxxIV/2-4, 1960, p. 11-55.5 A. Gough, Paris and Rome, The Gallican Church and the Ultramontane Campaign, 1848-1853, Oxford, 1986, Paris et Rome. Les catholiques français et le pape au xixe siècle, trad. française, Paris, 1996.6 L.-M. de Barral, Défense des libertés gallicanes et de l’assemblée du Clergé de France tenue en 1682, ou Réfutation de plusieurs ouvrages publiés récemment en Angleterre sur l’ infaillibilité du pape, Paris, 1817.7 D.-A.-L. Frayssinous, Les vrais principes de l’Église gallicane sur le gouvernement ecclésiastique, la papauté, les libertés gallicanes, la promotion des évêques, les trois concordats et les appels comme d’abus, Paris, 1818.8 Sur Muzzarelli, voir G. Mellinato, « Alfonso Muzzarelli, teologo tra fine Settecento e Restaurazione », Ricerche di storia sociale e religiosa, 42, 1992, p. 25-35.
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
61
situ entre les théologiens italiens et l’application de la doctrine gallicane lors de l’exil de la curie en France au temps de Napoléon : « Plusieurs théologiens romains, dont Muzzarelli et le cardinal Litta, y composèrent de nouvelles réfutations du gallicanisme, lesquelles, sans grande influence dans l’immé-diat, devaient contribuer à alimenter la polémique ultramontaine au cours des décades ultérieures9. » De prime abord, le besoin, pour les uns comme pour les autres, de revenir sur la Déclaration des quatre Articles de 1682 s’affirme irrésistible, comme s’il s’agissait d’un événement fondateur à l’aune duquel se dût relire l’évolution contemporaine des rapports entre sphères ecclésiale et politique.
Au demeurant, le souverain pontificat avait lui-même ouvert la voie à la résurrection d’un discours pourtant apparemment désuet en accordant une attention particulière à la Déclaration de 1682 au sein du dispositif même de la Bulle Auctorem fidei du 28 août 1794 portant condamnation des actes du synode de Pistoia, réuni du 18 au 28 septembre 1786, sous l’autorité du grand-duc Léopold de Toscane, par l’évêque réformateur et jansénisant Scipione De’ Ricci, avec la participation notamment des deux grands théo-logiens jansénistes italiens Pietro Tamburini (†1827) et Vincenzo Palmieri (†1820)10. Avec pieuse indignation, la Bulle Auctorem fidei reproche aux Tos-cans de revivifier le gallicanisme de Bossuet : « Neque silentio prætereunda insignis et fraudis plena synodis temeritas, quæ pridem improbatam ab Aposto-lica Sede conuentus gallicani declarationem anni 1682 ausa sit non amplissimis modo laudibus exornare, sed, quo maiorem illi auctoritatem conciliaret, arti-culos in illa contentos palam adoptare, et quæ sparsim per hoc ipsum decretum tradita sunt, horum articulorum publica et sollemni professione obsignare11. » Il faut toutefois signaler que l’ecclésiologie romaine n’avait pas attendu la Bulle Auctorem fidei pour reprendre ses attaques, un temps assoupies, contre les quatre Articles de 1682. Parmi les noms les plus réputés, deux sont à retenir,
9 R. Aubert, art. cité, p. 33.10 Sur le synode de Pistoia, voir la synthèse de C. A. Bolton, Church Reform in 18th Century Italy. The Synod of Pistoia, 1786, La Haye, 1969. L’ ecclésiologie janséniste de Pistoie a été étudiée par P. Stella, « L’ oscuramento della verità nella Chiesa dal Sinodo di Pistoia alla Bolla Auctorem fidei », Salesianum, xLIII/4, 1981, p. 731-756, et « La Duplex delectatio : Agostinismo e giansenismo dal sinodo di Pistoia alla Bolla Auctorem fidei », Salesianum, xLV/1, 1983, p. 25-48. Pour une mise en perspective de l’ecclésiologie défendue par la Bulle Auctorem fidei, voir B. Neveu, « Juge suprême et docteur infaillible : le pontificat romain de la Bulle In eminenti (1643) à la Bulle Auctorem fidei (1794) », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge-Temps modernes, xCIII/1, 1981, p. 215-275, repris dans id., Érudition et religion aux xviie et xviiie siècles, préf. M. Fumaroli, Paris, 1994, p. 385-450.11 Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 36e éd., Fribourg-en-Brisgau-Rome, 1976, n. 2699, p. 544.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
62
celui de Giuseppe Agostino Orsi (1692-1761), d’abord, auteur en 1739 d’un traité De irreformabili Romani Pontificis in definiendis fidei controuersiis iudi-cio qui s’en prend violemment à Bossuet, celui, ensuite, de Giovanni Anto-nio Bianchi (1686-1758), qui fait paraître de 1745 à 1751 un virulent traité Della potestá e della politica della Chiesa dirigé contre la défense de la Décla-ration de 1682 faite par Bossuet et contre le régaliste napolitain Pietro Gian-none. Deux théologiens, Orsi et Bianchi, qui appartiennent sans contredit au groupe des « Italiens défenseurs de la papauté » qu’Yves Congar plaçait au début du moment intransigeant de l’ecclésiologie catholique au tournant des xviiie et xixe siècles dans sa contribution au colloque de Strasbourg12 – Yves Congar avançait l’idée selon quoi « les traités publiés en Italie et sou-vent en italien, dans la seconde moitié du xviiie siècle, contre les Articles gallicans, contre le richérisme et Fébronius, sont, sans préjudice de modèles plus anciens, les sources immédiates et décisives des ultramontains du xixe siècle »13. Yves Congar citait, pêle-mêle, les noms d’Orsi, de Bianchi, de Pie-tro Ballerini, du cardinal Gerdil et de Gianvincenzo Bolgeni, sans oublier Alfonso Muzzarelli et Mauro Cappellari, auteur d’Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa, publié à Rome en 1799 – tous auteurs dont Richard Costigan vient très récemment de souligner le rôle dans la constitution de la doctrine moderne sur les rapports entre consensus Ecclesiæ et infaillibilité pontificale14. À en croire Yves Congar, « avec Pietro Ballerini, c’est Zaccaria, Muzzarelli et Mauro Cappellari qui ont le plus servi la cause papale contre les thèses galli-canes et fébroniennes » : « Ils les ont en effet affrontées sur le terrain où elles trouvaient toute leur force, celui de l’histoire. Ils ont alimenté de textes et d’arguments les infaillibilistes d’Allemagne et de France15. » Apologistes dont les textes, particulièrement engagés, sont animés par une thèse fondatrice de l’ultramontanisme contemporain, « celle de l’autorité de l’Église ayant pour forme la monarchie pontificale et pour propriété, en son chef suprême, l’infaillibilité »16. L’ idée, certes, est congénitale à l’ecclésiologie catholique ; ancienne, elle connaît pourtant une nette reviviscence au tournant des xviiie et xixe siècles, incontestable regain qui s’explique par la nécessité de lutter contre le régalisme gallican ou joséphiste et contre l’antiromanisme janséni-sant. À focaliser l’attention surabondante des théologiens italiens défenseurs
12 Y. Congar, « L’ ecclésiologie de la Révolution française au concile du Vatican, sous le signe de l’affirmation de l’autorité », L’ Ecclésiologie au xixe siècle…, op. cit., p. 77-114.13 Ibid., p. 91. 14 R. F. Costigan, The Consensus of the Church and Papal Infallibility. A Study in the Background of Vatican I, Washington, 2005.15 Y. Congar, art. cité, p. 93.16 Ibid., p. 93.
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
63
de la papauté et fondateurs du moderne intransigeantisme catholique, donc, deux questions principales, celles du gallicanisme et du jansénisme, qui sont au cœur des échanges et de la confrontation entre ecclésiologies pontifi-cale, antiromaine et française. D’emblée, un fait massif, le retour obsession-nel, maladif et indubitablement symptomatique de la référence aux quatre Articles de 1682. La Déclaration du Clergé de France s’énonçait comme profession de foi régaliste, conciliaire et anti-infaillibiliste à travers quatre thèses fondamentales : les rois ne reconnaissent aucun supérieur au tempo-rel ; le concile est au-dessus des papes ; la primauté romaine ne doit s’exercer qu’en respectant les canons conciliaires et les usages de l’Église gallicane ; les jugements du souverain pontife ratione fidei et morum ne sont irréformables qu’une fois sanctionnés par le consentement de l’Église.
Le gallicanisme bossuétien et ses affidés étaient depuis longtemps cible privilégiée de l’intransigeance romaine, notamment dans les multiples attaques subies par l’Histoire ecclésiastique publiée en vingt volumes de 1691 à 1723 par Claude Fleury, un disciple de l’impétueux évêque de Meaux. De 1747 à 1761 paraissent à Rome les vingt volumes de la Istoria ecclesiastica de Giuseppe Agostino Orsi, à l’effort polémique desquels viennent s’ajouter en 1782 et en 1783 les deux tomes publiés à Bologne de la Critica della Storia ecclesiastica e de’ discorsi del Signor Abate Claudio Fleury de l’archevêque d’An-cyre Giovanni Marchetti. Deux répliques qui ne sont pas passées inaperçues des ultramontains en France. Dans une lettre célèbre à Mme Swetchine rédi-gée durant l’été 1815, Joseph de Maistre délivrait d’acerbes conseils de lec-ture à son amie : « Vous lisez maintenant Fleury, condamné par le souverain pontife, pour savoir exactement à quoi vous en tenir sur le souverain pontife ; c’est fort bien fait, Madame, mais, quand vous aurez achevé, je vous conseille de lire la réfutation de Fleury par le docteur Marchetti. Le célèbre cardinal Orsi, ayant entrepris une réfutation de Fleury, y trouva tant d’erreurs qu’il se détermina à écrire une nouvelle histoire ecclésiastique, croyant que l’unique réfutation d’une mauvaise histoire était une bonne histoire. Il entreprit une nouvelle histoire, et il mourut au vingtième volume in-4°, qui n’achève pas le vie siècle17. » Le traditionalisme mennaisien s’ancre originellement dans un rejet du gallicanisme, incarné par Bossuet et par Fleury, qui pousse Lamen-nais, à l’instar de Joseph de Maistre, vers les théologiens italiens intransi-geants. Écrivant en novembre 1809 à Mgr Bruté de Remur, Lamennais avoue franchement ses sentiments : « Plus j’étudie Fleury, plus je m’en dégoûte. On n’imagine pas combien il y a de faussetés, d’exagérations, de réticences et
17 Joseph de Maistre à Mme Swetchine, s. l., 31 juillet-12 août 1815, J. de Maistre, Œuvres complètes, t. xIII, Genève, 1979 (1886), p. 122.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
64
de préjugés dans cet homme à qui l’on a fait, je ne sais sur quoi fondée, une réputation de raison qui en impose en France presque universellement. J’ai Marchetti, nous attendons Orsi, et peut-être pourra-t-on par la suite essayer de détromper le seruum pecus français »18. Il semble que l’ultramontanisme se nourrisse opportunément en France de la production de l’intransigeantisme romain. Dans une lettre à son frère Jean du 10 juillet 1814, Lamennais vante « les brochures de Muzarelli, Marchetti sur Fleuri, et les œuvres de Gerdil »19. Dans ses travaux fondamentaux sur la propagande catholique à Rome de Pie VI à Léon xII, Giuseppe Pignatelli a souligné l’importance qu’a eue pour les ultramontains la critique de Fleury par Marchetti : en 1802 paraît un résumé français de l’ouvrage sous le titre de Réflexions sur l’ histoire ecclésias-tique de M. l’abbé Fleury ; une traduction complète est publiée à Besançon en 1818 et s’intitule Critique de l’ histoire ecclésiastique de Claude Fleury20. Réciproquement, dans son grand livre sur le Settecento religioso21, Mario Rosa a rappelé que l’Histoire ecclésiastique de Fleury avait connu un grand succès en Italie : une traduction italienne en est éditée à Gênes entre 1769 et 1783 ; pour sa part, Vittorio Alfieri (1749-1803) dévore l’édition originale française, qui le confirme dans ses sentiments anticléricaux.
De l’incroyable floraison de traités qui reviennent, au cours du moment intransigeant au tournant des xviiie et xixe siècles, sur le contenu des quatre Articles de 1682, un exemple indique clairement dans quelle mesure l’opposition au gallicanisme classique a été le point névralgique de l’élaboration d’une nouvelle ecclésiologie romaine intransigeante dont le foyer se situe en Italie, mais dont les préoccupations sont évidemment et lucidement françaises. Publiées à Lyon en 1818, les Lettres diverses et très intéressantes sur les quatre Articles dits du Clergé de France du cardinal Lorenzo Litta (1756-1820) sont représentatives du sentiment éprouvé par la curie intransigeante à l’égard des principes gallicans. L’ auteur est né à Milan, de famille noble22. Après des études au collège Clémentin à Rome, il est nommé par Pie VI archevêque de Thèbes le 23 février 1793. Nonce apostolique en Pologne entre 1794 et 1795, au moment du partage décisif, Lorenzo Litta est légat pontifical aux fêtes organisées pour le couronnement
18 Lamennais à Mgr Bruté de Remur, s. l., novembre 1809, F. de Lamennais, Correspondance générale, t. I, 1805-1819, éd. L. Le Guillou, Paris, 1971, p. 66.19 Lamennais à Jean de Lamennais, s. l., 10 juillet 1814, ibid., p. 167.20 Voir G. Pignatelli, Aspetti della propaganda cattolica a Roma da Pio VI a Leone XII, Rome, 1974, p. 272-273.21 Voir M. Rosa, op. cit., p. 287.22 Sur Litta, voir É. Amann, art. « Litta (Laurent de) », Dictionnaire de théologie catholique, t. Ix/1, Paris, 1926, coll. 785-787.
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
65
du tzar Paul Ier en janvier 1797. Élevé au cardinalat par Pie VII en 1801, il devient préfet de la Propagande en 1814 – soit une carrière brillante de haut prélat curialiste. Son ouvrage est rédigé dans le contexte concordataire de l’après-1801, et plus précisément au moment de l’exil français de Pie VII en 1809. Les Lettres diverses du cardinal Litta ont très rapidement attiré l’at-tention des ultramontains, qui y ont trouvé une exemplaire réfutation des principes gallicans. Dans une lettre à Joseph de Maistre du 18 mai 1820, Lamennais écrivait : « Vous connaissez sûrement les lettres du cardinal Litta sur les quatre Articles. Il serait très bon de les faire réimprimer avec des notes dans ce pays-ci »23. Lamennais proposait d’ailleurs au célèbre Savoyard la charge de rédiger les notes désirées ; lui-même se faisait fort de prendre soin de l’impression. Lamennais ajoutait : « L’ ouvrage du cardinal Litta a fait un bien réel. J’ai vu, depuis deux ans, beaucoup de prêtres en chercher des exemplaires ; mais il n’y en a plus. Il serait aisé de le répandre dans les séminaires, où on le lirait avec fruit »24. Le projet d’une réédition des Lettres diverses du cardinal Litta a longtemps hanté Lamennais ; dans une lettre du 30 juillet 1825, il affirme son intention de s’occuper de l’urgente réimpres-sion « de quelques bons livres »25 ; le premier qu’il évoque est celui de Litta – l’ouvrage paraît d’ailleurs en 1826 avec les notes de Lamennais. Farou-chement antigallicane, la doctrine du cardinal Litta l’était assurément, et à plus d’un titre. La 2e des Lettres diverses affirmait impavidement qu’il était impossible de deviner les intentions des prélats de 1682 si l’on ignorait les circonstances dans lesquelles avait été souscrite la Déclaration du Clergé de France : « En lisant cette déclaration, on y reconnoît tout de suite trois objets qu’on a eus principalement en vue. 1° De garantir la souveraineté temporelle contre les prétendues entreprises des Papes. 2° De rabaisser l’autorité spiri-tuelle du Pape dans tout ce qui concerne le gouvernement de l’Église. 3° De détruire la croyance à peu près générale dans la Chrétienté et en France, même la plus commune jusqu’à cette époque, par rapport à l’infaillibilité du Pape lorsqu’il prononce son jugement dans les causes de la foi »26. Quant au premier point, qui vise clairement les tenants de la doctrine bellarminienne
23 Lamennais à Joseph de Maistre, Paris, 18 mai 1820, F. de Lamennais, Correspondance générale, op. cit., t. II, 1820-1824, Paris, 1971, p. 59.24 Ibid., p. 59.25 Lamennais au comte de Senfft, La Chenaie, 30 juillet 1825, F. de Lamennais, Correspondance générale, op. cit., t. III, 1825-juin 1828, Paris, 1971, p. 77.26 L. Litta, Lettres diverses et très intéressantes sur les quatre Articles dits du Clergé de France par un professeur en théologie ex-jésuite, accompagnées d’une dissertation très importante sur cette question : le souverain pontife a-t-il le droit de priver un évêque de son siège dans un cas de nécessité pour l’Église ou de grande utilité ?, Paris, 1809 [Lyon, 1818], 2e lettre, p. 5.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
66
du pouvoir indirect du souverain pontife in rebus temporalibus27, le cardinal Litta avoue son profond étonnement – en 1682, rien ne menaçait, selon lui, l’intégrité de la souveraineté royale dans son domaine propre de préroga-tives civiles : « Lorsque ces querelles étoient parfaitement éteintes, lorsqu’elles étoient oubliées, lorsqu’il n’y avoit rien à craindre de la part des Papes, voilà des prélats français qui, dans l’année 1682, sous le pontificat d’Innocent xI, sous le règne de Louis xIV, s’avisent de sonner la trompette d’alarme »28. D’aucune utilité, donc, le retour anachronique à un questionnement qui avait hanté l’Occident chrétien depuis les temps reculés de la Querelle du Sacerdoce et de l’Empire jusqu’à la conclusion exténuée, aux alentours de l’affaire Santarelli en 1626 et en 1627, de la controverse autour de la potestas indirecta du pontife romain au temporel. Au contraire, le revif d’un discours périmé valait acte d’antiromanisme : « La doctrine que ces prélats ont procla-mée sur cet objet n’est pas assez édifiante pour la prêcher sur les toits comme ils ont fait. Bien loin d’y trouver rien d’utile ou d’édifiant pour les fidèles, il me paroît au contraire que ces prélats ont semé dans le cœur des princes un germe funeste de défiance contre les Papes, qui ne pouvoit qu’être fatal à l’Église »29. À suivre le cardinal Litta, la revendication de l’autonomie abso-lue des princes au temporel par rapport au Saint-Siège n’a fait qu’entamer le respect des fidèles catholiques à l’égard de la hiérarchie ecclésiastique.
Non que l’intransigeant prélat fût indéracinable partisan du pouvoir indirect tel que l’avait défini en son temps le cardinal Bellarmin. La 7e de ses Lettres diverses est étrangement modérée : « Vous savez que sur cette matière, il y a deux opinions. L’ une qui soutient que les deux puissances spirituelle et temporelle sont parfaitement, et dans tous les cas, indépendantes l’une de l’autre ; et la seconde, qui, admettant la distinction des deux puissances et leur indépendance dans les objets qui sont purement de leur ressort, admet néanmoins, dans certaines circonstances où la puissance temporelle abuse-roit de ses moyens au préjudice de la religion, le pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des princes, et jusqu’à leur déposition dans le cas où cela seroit expédient »30. Litta observe aussiôt que la première position n’a jamais été prohibée, ni condamnée – ce qui est faux, même si depuis deux siècles,
27 Sur le retour obsessionnel de la référence à la doctrine bellarminienne au xixe siècle, voir S. De Franceschi, « Le pouvoir indirect du pape au temporel et l’antiromanisme catholique des âges pré-infaillibiliste et infaillibiliste : références doctrinales à Bellarmin et à Suárez dans la théologie politique et l’ecclésiologie catholiques du début du xixe siècle à la mi-xxe siècle », Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 88, 2002, p. 103-149.28 L. Litta, op. cit., 2e lettre, p. 6.29 Ibid., 2e lettre, p. 6.30 Ibid., 7e lettre, p. 19.
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
67
la papauté a renoncé à défendre sa doctrine avec autant de fermeté que jadis. Quant à la seconde, elle réunit les suffrages de nombre de respectables autorités. Au demeurant, Litta invoque le témoignage de François de Sales, l’une des rares voix à s’être élevée pour appeler les esprits au calme après la condamnation en 1610 du De potestate Summi Pontificis de Bellarmin par le Parlement de Paris. Délaissant les ambages, Litta affirme hautement : « Je voudrois bien sincèrement qu’on abandonnât ces questions qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont d’aucune utilité ni édification »31. Sans choisir entre les deux partis, Litta se contente de frapper d’ineptie un débat qu’il juge marqué du sceau de la péremption et nuisible, en outre, pour la réputation de la catholicité : « Ce n’étoit pas sur une question où l’Église a laissé la liberté de suivre l’une ou l’autre de ces deux opinions que les prélats de l’as-semblée de 1682 devoient s’occuper sans nécessité et sans pouvoir en espérer la moindre utilité. Au contraire, ils ont fait du mal à l’Église »32. Ici, l’indice le plus sûr de la déshérance du discours ecclésiologique de potestate indirecta au tournant des xviiie et xixe siècles, quand le nouveau moment d’intransi-geance s’édifie plutôt autour de la question infaillibiliste.
Car de l’autorité spirituelle du pape dans la communauté ecclésiale, il s’agit désormais, et presque exclusivement. La 2e des Lettres diverses s’empor-tait derechef contre la Déclaration de 1682 : « Je ne crois pas que ces prélats pouvoient alléguer de tels abus dans l’exercice de l’autorité spirituelle du Pape qu’il fût nécessaire de la restreindre et de la rabaisser, quand même le droit auroit pu leur appartenir de quelque manière »33. À plus forte raison, dès lors que l’on soulevait la question du caractère irréformable des oracles rendus par le Saint-Siège, convenait-il de s’avancer prudemment : « Il faudroit prouver que des erreurs dans la foi se sont introduites ou soutenues dans l’Église par le moyen d’une décision du Pape, ce que je suis sûr qu’aucun catholique n’aura le courage de dire »34. Ici, Litta se laisse dominer par sa passion intransigeante de la papauté, mais le point a été crucial dans le débat janséniste. Acharné à défendre l’intégrité des prérogatives pontificales in rebus spiritualibus, le cardi-nal devait fatalement rencontrer le conciliarisme sur son chemin – les quatre Articles de 1682 l’y invitaient expressément. Pour Litta, le pape conserve inté-gralement son autorité spirituelle sur les évêques assemblés en concile. La 12e des Lettres diverses l’exprime sans ambiguïté : « Si le pape est le chef de toute l’Église, le père de tous les chrétiens, et s’il tient de Jésus-Christ la pleine puis-sance d’être pasteur de toute l’Église, de la conduire et de la gouverner, on ne
31 Ibid., 7e lettre, p. 19.32 Ibid., 7e lettre, p. 20.33 Ibid., 2e lettre, p. 7.34 Ibid., 2e lettre, p. 7.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
68
pourra pas douter qu’il n’ait cette même autorité sur les évêques assemblés en concile ; autrement, cette puissance ne seroit ni pleine, ni sur toute l’Église »35. Le tropisme romain, consolidé dans l’Église par les pères tridentins, atteint son apogée lors du moment d’intransigeance du tournant des xviiie et xixe siècles. La romanité de l’Église, même si elle ne s’est jamais imposée comme note36, ne fait aucun doute pour les théologiens italiens qui persistent à pourfendre l’antiromanisme gallican. Il y a, chez les défenseurs de la papauté, une véritable mystique pétrine dont, à la suite de Giuseppe Alberigo37, Gérard Pelletier a montré qu’elle procédait directement du combat antijanséniste38. Insistance sur la primauté de Pierre qui trouve à s’exprimer dans la confrontation de l’intransigeantisme italien au gallicanisme. Pour Litta, seul le successeur de Pierre est garant du non-obscurcissement des vérités dans l’Église et de l’in-tégrité du depositum fidei : « Il s’élève des questions sur la foi ; je cherche une autorité enseignante pour m’éclairer. Voilà que j’entends la voix de Pierre, qui prononce son jugement. Ici, je demande : puis-je craindre quelqu’erreur dans ce jugement ? Pour former un tel doute, il faudroit oublier que c’est en vain que Satan a demandé de cribler les Apôtres ; car Jésus-Christ a prié pour Pierre afin que sa foi ne manquât pas »39. Premier des Apôtres, Pierre est le principal béné-ficiaire des promesses du Rédempteur ; il est la voix par quoi le Christ guide désormais ses fidèles : « Je ne peux pas craindre non plus que Jésus-Christ ait manqué son but lorsqu’il a choisi Pierre pour affermir ses frères, lorsqu’il l’a choisi pour la pierre sur laquelle il a bâti son Église ; il a promis que les portes de l’enfer ne prévaudroient pas contr’elle, ce qui affermit également la pierre et l’édifice, puisque si la pierre venoit à chanceler, l’édifice ne seroit pas solide non plus ; enfin, Jésus-Christ n’a pas manqué son but en le choisissant pour pasteur des agneaux et des brebis. Si le pasteur s’égaroit, irois-je demander aux brebis quel est le chemin du salut ? »40. La 15e des Lettres diverses est une
35 Ibid., 12e lettre, p. 39.36 Voir S. De Franceschi, « Approches de la romanité ecclésiale du concile de Trente au Syllabus. L’ idée romaine dans la définition de l’Église : parcours d’une interrogation critique », L’ idée de Rome : pouvoirs, représentations, conflits. Actes de la XIIe Université d’ été d’ histoire religieuse, Rome, 10-15 juillet 2003, éd. H. Multon et C. Sorrel, Chambéry, 2006, p. 47-65.37 Voir G. Alberigo, Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il xvi e il xix secolo, Rome, 1964, particulièrement « Ecclesiologia e teologia dell’episcopato nel xviii secolo », p. 221-348, et « Sviluppi e polemiche nella dottrina precedente il Vaticano I », p. 349-413.38 G. Pelletier, Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799), Rome, 2004, « Une théologie de l’Église : l’école romaine », p. 235-272.39 L. Litta, op. cit., 15e lettre, p. 4840 Ibid., 15e lettre, p. 48-49.
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
69
profession de foi explicitement infaillibiliste ; elle révèle avec insistance le pivot autour de quoi s’article la nouvelle ecclésiologie intransigeante, et elle le révèle en s’opposant une fois de plus radicalement au gallicanisme : « L’ enseignement de Pierre par rapport à la foi n’est jamais sujet à l’erreur, n’est jamais différent ni séparé de l’enseignement du collège des Apôtres, et ces deux enseignements n’en font qu’un »41. La 16e des Lettres diverses va plus loin encore ; elle accuse les gallicans d’avoir emmêlé une discussion au cours de laquelle leur opinion devait céder : « Ce qui a fait penser à quelques-uns que l’infaillibilité du pape n’étoit pas certaine, ce sont les ténèbres qu’on a répandues sur cette question ; et, certes, tant qu’on l’embrouillera, on pourra disputer. Si ceux qui soutien-nent l’infaillibilité du pape parlent de la supposition que son jugement soit en opposition avec celui de l’Église pour décider lequel des deux doit prévaloir, ils bâtissent sur une hypothèse qui se détruit d’elle-même, et qui d’ailleurs est contraire à toutes les promesses de Jésus-Christ. Mais cela n’empêche pas que l’infaillibilité du Pape ne soit très certaine »42. Il n’y a pas deux enseignements, celui du pontife romain et celui de l’Église – le vicaire du Christ, quand il rend excathédralement ses oracles, est certainement uox Ecclesiæ. Litta reprend à son compte l’adage de saint Ambroise, pour qui Vbi Petrus, ibi Ecclesia : « Où est Pierre, là est l’Église ; et sans doute aussi : où est le successeur de Pierre, là est l’Église. Vous voyez qu’on ne peut pas séparer le jugement du Pape de celui de l’Église, qu’il ne peut jamais y avoir deux jugements, l’un du pape, l’autre de l’Église, et que le jugement du Pape et celui de l’Église ne sont qu’un seul et même jugement43. » À dire vrai, l’argumentaire du cardinal Litta est tauto-logique ; il procède par rigoureuses identités pour promouvoir une doctrine qui est d’intransigeante dévotion au Saint-Siège et qui a marqué les ultra-montains : « Je n’ai plus besoin de vous apporter les preuves de l’infaillibilité du Pape, il me suffit que vous m’accordiez l’infaillibilité de l’Église, et voici mon argument : le jugement du Pape et celui de l’Église ne sont qu’un seul et même jugement ; or le jugement de l’Église est infaillible ; donc le jugement du Pape l’est aussi. Cela posé, vous ne pouvez pas croire à l’infaillibilité de l’Église sans croire en même temps à l’infaillibilité du Pape »44. En son temps, Bossuet, auquel Litta se réfère nommément, avait cru pouvoir contourner l’obstacle en distinguant la Sedes du sedens ; à l’une, certes, infaillibilité incontestable, mais pas à l’autre. Pour Litta, le raisonnement est captieux : « L’ indéfectibilité dans la foi du siège apostolique ne peut pas se concevoir sans l’indéfectibilité du Pape. Le siège n’agit et ne parle que par la personne du pontife qui le remplit,
41 Ibid., 15e lettre, p. 51.42 Ibid., 16e lettre, p. 53.43 Ibid., 16e lettre, p. 57.44 Ibid., 16e lettre, p. 57.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
70
et si la foi du Pape manque, celle du siège manque aussi45. » Ici, assurément, l’effet du progrès en direction d’une doctrine favorable à la détention gratia muneris d’une infaillibilité personnelle du souverain pontife en matières de foi et de mœurs.
Alors que s’amenuise inexorablement le discours ecclésiologique sur le pouvoir indirect, s’enfle irrésistiblement, comme par un phénomène com-pensatoire, l’expression d’un courant infaillibiliste destiné à triompher en 1870 au concile premier du Vatican. Encore une fois, la lutte en faveur de l’infallibilitas Summi Pontificis passe par le rejet justifié de l’ecclésiologie gal-licane. D’une crise française de la théologie romaine, avivée par la Révolu-tion française et ses conséquences, témoigne d’évidence l’œuvre ecclésiolo-gique d’Alfonso Muzzarelli. Né en 1749, Muzzarelli entre au noviciat des jésuites en 1768, puis enseigne la grammaire à Bologne et à Imola. Après la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773, il se voit conférer un bénéfice à Ferrare ; il devient ensuite directeur du Collegio dei Nobili à Parme, avant d’être appelé à Rome par Pie VI, qui le fait théologien de la Pénitencerie. En 1809, il suit le pape dans son exil français et finit ses jours dans un couvent parisien en 1813. Muzzarelli a une réflexion ecclésiologique compa-rable à celle de Litta – du reste, les Lettres diverses sont accompagnées, dans leur édition de 1818, d’une dissertation du jésuite sur la question du droit détenu par le pontife romain « de priver un évêque de son siège dans un cas de nécessité pour l’Église ou de grande utilité ». Comme Litta, Muzzarelli est le représentant typique d’une curie romaine marquée par son entrée en intransigeance ; comme Litta, également, il est obsédé par le gallicanisme ; comme Litta, encore, il défend l’infaillibilité pontificale. Dans le cadre de la confrontation ecclésiologique franco-italienne du premier xixe siècle, Muz-zarelli est un cas particulier : une partie notable de son œuvre est rédigée en français et publiée en France ; il est par ailleurs obnubilé par le gallicanisme et le jansénisme. Imprimée sans lieu ni date, sa brochure – l’usage était alors courant, parmi les théologiens polémistes, de recourir à des écrits de dix ou vingt pages – intitulée Les gallicans ne peuvent s’accorder avec eux-mêmes dans leur système sur l’ infaillibilité du Pape affirme contre le catholicisme antiromain l’indéfectibilité plénière du pontife romain. Muzzarelli revient d’abord sur le contenu de la doctrine gallicane de infallibilitate. Jésus-Christ a promis à son Église aide et assistance, mais il a prédit aussi la venue d’hérésies, fléau contre quoi il a pris soin de prémunir les chrétiens d’un remède : « Ce remède ne pouvait être que l’autorité, il fallait une autorité infaillible, divine, toujours vivante, toujours parlante. Tel est le remède que
45 Ibid., 23e lettre, p. 79.
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
71
Jésus-Christ a établi, l’autorité qui réside dans le corps des évêques unis au Pape, leur chef et successeur de saint Pierre. Pierre est du nombre de ceux auxquels Jésus-Christ donne cette autorité, mais il a la première part. Ces maximes sont admises des gallicans, ils conviennent que l’infaillibilité se trouve dans le corps des pasteurs unis à leur chef »46. Pour les tenants du gallicanisme classique, ajoute Muzzarelli, les promesses du Christ ont été faites à un corps complet, celui des évêques en union avec le pontife romain. Le consentement de l’épiscopat est donc condition nécessaire à l’exercice de l’infaillibilité ratione fidei et morum du siège apostolique. Infaillibilité, assurément, il y a pour les gallicans, mais scrupuleusement encadrée : « De la nécessité admise par les gallicans de l’union des évêques avec leur chef pour que le jugement soit infaillible résulte l’infaillibilité du Pape quand il parle ex cathedra »47. Première contradiction du gallicanisme, donc : en limi-tant l’exercice de l’infallibilitas, il en reconnaît paradoxalement l’existence. Muzzarelli en appelle au témoignage de Bossuet lui-même pour mettre en relief la singularité du ministère pétrin : « Bossuet dit que le Pape exerce un ministère principal et fondamental dans toute l’Église ; il dit que par la pro-messe de Jésus-Christ, nous sommes guidés dans l’inviolable attachement à la chaire de saint Pierre. Il y a donc dans cette promesse quelque chose de singulier qui ne nous permet pas de nous détacher jamais de la chaire de ce premier des Apôtres, et quel peut être ce motif particulier contenu dans la promesse, sinon l’assistance perpétuelle promise à lui en particulier et à ses successeurs dans la chaire ? »48. De rien ne sert, selon Muzzarelli, d’invoquer une spécieuse distinction entre la Sedes et le sedens – la centralité romaine est charisme propre au ministère pontifical, soit un magistère personnel : « Par siège apostolique jugeant avec autorité judiciaire en ce qui regarde la foi, on ne peut entendre que le Pape. »49. Pour Alfonso Muzzarelli, Rome n’est centre de l’unité catholique qu’en vertu de Pierre et de ses successeurs. Non sans malice, l’ancien jésuite cite abondamment le Sermon sur l’unité de l’Église rédigé en 1681 par Bossuet pour l’ouverture de l’Assemblée générale du Clergé de France. Bossuet affirmait notamment : « Quand Jésus-Christ veut mettre la dernière main au mystère de l’unité, il ne parle plus à plu-sieurs, il désigne Pierre personnellement, et par le nouveau nom qu’il lui a
46 A. Muzzarelli, Les gallicans ne peuvent s’accorder avec eux-mêmes dans leur système sur l’ infaillibilité du pape, s. l. n. d., p. 3.47 Ibid., p. 5.48 Ibid., p. 6-7.49 Ibid., p. 7.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
72
donné. C’est un seul qui parle à un seul »50. Curieusement, le texte d’un gal-lican des plus ardents apporte une eau savoureuse et désaltérante au moulin de l’intransigeantisme du début du xixe siècle. Muzzarelli cite avec bonheur l’une des conclusions du Sermon sur l’unité de l’Église : « Qu’on ne dise point, qu’on ne pense point que ce ministère de saint Pierre finisse avec lui : ce qui doit servir de soutien à une Église éternelle ne peut jamais avoir de fin. Pierre vivra dans ses successeurs ; Pierre parlera toujours dans sa chaire : c’est ce que disent les Pères, c’est ce que confirment six cens trente évêques au concile de Calcédoine »51. Pour Bossuet, Rome est la chaire éternelle ; de son avis, pour une fois, les ecclésiologues transalpins qui construisent, à l’aube de l’âge libéral, une nouvelle intransigeance romaine.
Réaction orthodoxe qui récuse la distinction antiromaine entre le siège et son détenteur pour en poser, face aux gallicans, la confusion, l’intime et irréfragable identité. À en croire Muzzarelli, « si vous séparez le successeur de saint Pierre de la chaire, du siège, de l’Église, il n’y a plus dans ce siège le centre de l’unité catholique, parce que vous retranchez celui que Jésus-Christ a désigné pour conserver l’unité »52 – le théologien ajoute : « L’ Église de Rome n’a l’indéfectibilité que par son union à son chef, successeur de saint Pierre, auquel la promesse a été faite directement. Après cette séparation, il n’y a plus de centre d’unité, car Jésus-Christ n’est pas avec une chaire sans doc-teur, avec un siège sans siégeant ; c’est alors une chaire muette, un siège vide, un corps sans chef. Ainsi c’est le Pape qui est éminemment, principalement, souverainement le centre de l’unité catholique »53. Devant les principes du gallicanisme, Muzzarelli souligne à l’envi le fait qu’ils empêchent les fidèles de détenir un signe certain et facile pour s’assurer de la vérité ; ils créent une vacance du dogme dès lors qu’ils réclament le consentement des évêques aux décisions romaines en matières de foi. Sarcastique, Muzzarelli s’interroge : « Quel nombre d’années faut-il attendre pour présumer le consentement par le silence des Églises dispersées ? Dites-moi, savez-vous d’une certitude de fait si la Bulle Auctorem fidei de Pie VI a été acceptée du plus grand nombre d’évêques ? Les pasteurs eux-mêmes le supposent, mais ils ne peuvent le prou-ver d’une certitude de fait, et cependant, selon le système gallican, si elle n’a pas été acceptée, elle est réformable ; en conséquence le jugement de l’Église est encore incertain, et depuis longtemps le remède promis par Jésus-Christ,
50 J.-B. Bossuet, Sermon sur l’unité de l’Église presché à l’ouverture de l’Assemblée générale du Clergé de France en 1681, Paris, 1726, p. 11-12.51 Ibid., p. 12-13.52 A. Muzzarelli, op. cit., p. 8.53 Ibid., p. 8.
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
73
pour tous les jours, manque sur les articles qu’elle décide »54. Au demeu-rant, les gallicans sont à nouveau en contradiction avec eux-mêmes lorsqu’ils refusent d’admettre une infallibilitas personnelle du pontife romain ratione fidei, « puisque la doctrine de l’infaillibilité du Pape est celle de la très grande majorité des évêques unis à leur chef »55. Le gallicanisme doit être tenu pour opposé à la doctrine du reste de la communauté ecclésiale ; singularité qui, en soi, est indice d’hétérodoxie.
Contre le catholicisme antiromain, l’intransigeantisme contemporain bâtit une mystique pontificale qui dessine les contours d’une note de romani-tas dans la définition de la véritable Église. Pour Muzzarelli, « le Saint-Siège, la chaire de saint Pierre est le chef de l’Église universelle, le centre de l’unité catholique dans la foi »56 – il ajoute : « Ce chef, ce centre est unique, néces-saire, immobile, de tous les jours, de tous les tems, jusqu’à la consommation des siècles, et il ne sera jamais dans un état où il ne puisse être reconnu comme tel, ce qui est essentiel pour l’unité et la visibilité de l’Église »57. Ici, clairement exprimée, le basculement, typique de l’ecclésiologie intransi-geante, du régime de visibilité ecclésiale à l’évidence romaine, car, précise Muzzarelli, « par le Saint-Siège, la chaire de saint Pierre, l’Église de Rome, il faut entendre principalement, fondamentalement, nécessairement le suc-cesseur de saint Pierre, qui a été désigné immédiatement et directement par Jésus-Christ pour le chef et le centre de son Église, et sans lequel il n’y a ni siège, ni chaire, ni Église de Rome jugeante et décidante »58. Du reste, souligne Muzzarelli, quatre papes ont déclaré qu’ils cassaient, annulaient et improuvaient les Articles de 1682, et l’on ne connaît aucune réclamation des gallicans ; à suivre leur propre enseignement, qui répute irréformable une décision romaine lorsque le consentement des évêques y est joint, « ces bulles sont irréformables au dire des Français mêmes et les Articles sont d’aveu commun cassés et annulés »59. Antigallicane, la brochure de Muzzarelli se livrait à un virulent réquisitoire que l’auteur ne craignait pas de réitérer dans un ouvrage plus copieux et dont le titre était très provocateur : L’ infaillibilité du Pape prouvée par les principes mêmes et le sentiment universel de l’Église gal-licane. À stimuler la réflexion ecclésiologique d’Alfonso Muzzarelli, comme celle de Lorenzo Litta, le gallicanisme avait été primordial, posant les condi-tions de possibilité d’une crise française de l’ecclésiologie italienne.
54 Ibid., p. 9.55 Ibid., p. 15.56 Ibid., p. 17.57 Ibid., p. 17.58 Ibid., p. 17.59 Ibid., p. 27.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
74
La tradition gallicane n’était pas la seule française à retenir l’attention des défenseurs de la papauté en Italie. Curieusement, le premier xixe siècle a été aussi le lieu d’un débat houleux autour du jansénisme et d’un retour polémique aux sources mêmes d’une dispute commencée à la mi-xviie siècle. Il est vrai que durant l’ensemble du xviiie siècle, ainsi que les travaux de Pie-tro Stella récemment réunis dans le monumental Giansenismo in Italia l’ont éloquemment montré60, la péninsule italienne a suivi avec anxiété les déve-loppements de la crise provoquée par la fulmination de la Bulle Vnigenitus – les publications françaises ont circulé en Italie, elles ont même souvent été traduites ; inversement, les ouvrages italiens, jusqu’aux minutieuses mises au point augustinianistes des PP. Berti et Bellelli, ont été rapidement diffusés en France. Dans la mesure où elle portait non plus tant sur la grâce dans ses rapports au libre arbitre que sur la validité des jugements romains, la discussion a fini par entrer de plain-pied dans le champ disciplinaire de l’ec-clésiologie. Ainsi Muzzarelli rédige-t-il une brochure très bien informée sur le sujet intitulée Un fait dogmatique décidé par l’Église est-il objet de foi catho-lique ? – d’emblée, la controverse est rattachée au problème de l’infallibilitas du souverain pontife : « Il paraît impossible que les jansénistes aient prétendu ne point attaquer la foi en refusant à l’Église l’infaillibilité dans les décisions des faits dogmatiques. Si l’Église n’est pas infaillible dans les définitions des faits qui tiennent au dogme, il faut dire que la promesse d’infaillibilité que lui a faite Jésus-Christ se réduit à rien dans la pratique »61. Or on sait que pour Muzzarelli, le jugement de l’Église est celui du pape, et inversement. Revenant sur les péripéties de la crise janséniste et sur la célèbre question du Fait et du Droit, Muzzarelli résume les arguments des jansénistes :
Le Pape a déclaré et défini que les cinq Propositions condamnées sont conte-nues dans le livre de Jansénius, dans le sens obvie et naturel que présentent les paroles de l’auteur. L’ Église, par son consentement, approuve la décision du Pape. C’est bien. Mais ceci est un fait, ce n’est pas un point de doctrine ou de morale. Que l’Église soit infaillible dans ses décisions sur un point de doctrine ou de morale, nous le croyons aussi, et nous l’enseignons. Mais ici c’est un fait ; c’est un fait de notre siècle ; c’est un fait qui n’est pas révélé. Comment donc prétend-on en faire un article de foi ? Il n’y a que ce qui est révélé qui appartienne à la foi ; et tout ce qui est révélé est contenu dans l’Écriture ou dans la tradition ; mais le fait du livre de Jansénius ne se trouve
60 P. Stella, Il giansenismo in Italia, t. I, I preludi tra Seicento e primo Settecento, Rome, 2006, t. II, Il movimento giansenista e la produzione libraria, Rome, 2006, et t. III, Crisi finale e transizioni, Rome, 2007.61 A. Muzzarelli, Un fait dogmatique décidé par l’Église est-il objet de foi catholique ?, Avignon, 1838, p. 3.
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
75
ni dans l’Écriture ni dans la tradition ; donc il n’est pas révélé ; donc il n’ap-partient pas à la foi. Pourquoi donc veut-on nous forcer à croire, d’une foi ferme, ce qui n’est ni ne peut être de foi ? Voilà sur cette question l’unique difficulté des jansénistes qui mérite quelque réponse.62
L’ interrogation est inévitable : il s’agit de savoir si la décision des faits dog-matiques appartient à la foi théologique ou à la foi ecclésiastique. De fide ecclesiastica, le doute n’est pas permis, à en croire Muzzarelli : « Quand le Pape, ainsi que l’Église, ont déclaré que les cinq Propositions condamnées sont contenues dans le livre de Jansénius, je dois croire à ce jugement de l’Église, et je dois y croire sans aucun doute, parce que ce jugement prononcé par l’Église est d’une autorité infaillible, et que l’Église n’a pu errer sur ce point ; autrement, l’assistance promise du Saint-Esprit lui aurait manqué, et le dire serait une hérésie manifeste »63. Ratione fidei theologicæ, en revanche, la justification est plus délicate, même si Muzzarelli est par ailleurs partisan d’une solution qui, évidemment, possède une indéniable capacité de légi-timation. Il rappelle que pour constituer une foi théologique, deux condi-tions sont nécessaires : d’abord, l’objet matériel de la foi doit être une vérité révélée ; ensuite, l’objet formel, ou le motif de croire, doit être la Révélation divine. Système critériologique qui a poussé nombre de théologiens à refuser de tenir de fide theologica credendæ les décisions de l’Église sur les faits dog-matiques : « Car il est certain, disent-ils, que Dieu ne révèle à présent rien de nouveau à son Église. Il est certain que le fait dogmatique sur le sens du livre de Jansénius est un fait nouveau du temps présent. Donc ce n’est pas un fait révélé de Dieu. S’il n’est pas révélé de Dieu, il ne peut être objet de foi théologique »64. Les tenants de la position contraire admettent volontiers que le fait dogmatique n’est pas révélé formellement et immédiatement de Dieu, mais ils estiment qu’il l’est médiatement et virtuellement « dans la décision de l’Église, à laquelle Dieu prête son assistance »65 ; de plus, « quand l’Église définit que les cinq Propositions condamnées sont contenues dans le livre de Jansénius, alors l’Église propose vraiment un nouvel article de foi, mais qui se trouve contenu implicitement dans un article révélé, c’est-à-dire dans l’infaillibilité de l’Église, et de là vient que cet article peut s’appeler nouveau secundum quid, mais non simpliciter nouveau »66. La décision du fait dogmatique peut donc faire l’objet d’une foi théologique dans la mesure où
62 Ibid., p. 6-7.63 Ibid., p. 8.64 Ibid., p. 10.65 Ibid., p. 10.66 Ibid., p. 10-11.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
76
elle s’est nécessairement faite avec l’assistance du Saint-Esprit – l’argument est omniprésent dans le raisonnement de Muzzarelli. À l’appui de ses dires, il donne l’exemple du nombre des sacrements institués par le Christ, nombre resté longtemps indécis : « Sur ces entrefaits, l’Église déclare, dans le concile de Trente comme article de notre foi, que les sacremens de la nouvelle Loi institués par Jésus-Christ sont au nombre de sept, ni plus, ni moins. Mais comment l’Église a-t-elle pu parvenir à une décision hors de toute atteinte sur ce point, si le Saint-Esprit, au milieu de l’agitation de tant de contro-verses, ne lui a révélé, découvert et fait connaître la vérité ? »67. Le jansénisme, ainsi qu’Yves Congar l’a fortement mis en valeur68, avait permis l’émergence de la nouvelle catégorie des faits dogmatiques ; il autorise finalement, et mal-gré lui, au xixe siècle une évolution fondamentale des doctrines infaillibi-listes qui font de l’infaillibilité du pape une véritable machine à fabriquer des propositions de fide theologica credendæ – l’infaillibilité est devenue un dogme à faire les dogmes, et il est profondément significatif que la sourde élaboration des thèses retenues par le concile premier du Vatican se situe chez des théologiens italiens qui se servent de la tradition ecclésiologique française, gallicane et janséniste, comme d’un repoussoir.
L’ incessante confrontation qui avait opposé à l’âge classique les ecclé-siologies française et italienne s’est poursuivie avec urgence accrue au cours du moment intransigeant au tournant des xviiie et xixe siècles. Les auteurs français ont consulté la production de leurs homologues italiens – les ultra-montains, tels Joseph de Maistre ou le premier Lamennais, s’inspiraient de Muzzarelli, Marchetti ou Litta ; les gallicans, au contraire, les réfutaient. À la fin de la préface de son Histoire critique de l’Assemblée générale du Clergé de France en 1682 publiée à Paris en 1826, l’oratorien jansénisant et galli-can Mathieu-Mathurin Tabaraud évoquait rageusement la récente publica-tion de l’Ultimatum per il dominio indiretto della Santa Sede Apostolica sul temporale de’ sovrani du juriste Carlo Fea – l’ouvrage était paru à Rome en 1825 avec l’approbation de l’intransigeant Filippo Anfossi, maître du Sacré Palais. Tabaraud précise : « Il est fait mention dans cet écrit de plusieurs autres ouvrages récemment publiés à Rome pour soutenir la même doctrine par des auteurs qui jouissent d’une grande considération, tels que le P. Anfossi, le pré-lat Marchetti, et autres »69. Assurément, les catholiques français antiromains
67 Ibid., p. 28.68 Y. Congar, « Fait dogmatique et foi ecclésiastique », Catholicisme. Hier, aujourd’ hui, demain, t. IV, Paris, 1954, coll. 1059-1067, repris dans id., Sainte Église, Paris, 1963, p. 357-373.69 M.-M. Tabaraud, Histoire critique de l’Assemblée générale du Clergé de France en 1682 et de la déclaration des quatre Articles qui y furent adoptés, suivie du discours de M. l’abbé Fleury
Université de Savoie
Les probLématiques eccLésioLogiques Françaises
77
ont suivi avec malveillante attention le travail de rénovation ecclésiologique qui s’effectuait en péninsule italienne. À parcourir les grands textes produits par l’ecclésiologie transalpine du tournant des xviiie et xixe siècles, qu’elle soit jansénisante ou non, un fait, incontestable, s’impose dans sa massivité : l’ob-session française d’auteurs acharnés à redéfinir la place du souverain pontifi-cat dans une Église catholique bouleversée par les effets de la sécularisation induite par l’entrée dans l’âge libéral. L’ inflation du discours ecclésiologique de infallibilitate devait se payer d’une inévitable confrontation au gallica-nisme et au jansénisme qui a pénétré très profondément la théologie italienne du moment intransigeant à l’aube de l’ère contemporaine. Le problème, au reste, n’était pas uniquement d’antiromanisme ; il touchait à une modifica-tion de très large ampleur dans la nature du magistère romain, mutation qu’Yves Congar avait signalée dans sa contribution au colloque de Strasbourg de 1959. Jusqu’à la fin du xviiie siècle, l’enseignement théologique en France était demeuré profondément historique, attaché au contact direct avec les sources conciliaires et patristiques, trouvant ses normes dans les monuments de la Tradition. Or l’intransigeantisme romain n’a eu de cesse dès la mi-xviiie siècle de resserrer l’acception de la Traditio autour du seul magistère ecclé-sial, monopole du Saint-Siège, tendant à exclure désormais l’enseignement doctoral de la sphère de décision des faits dogmatiques. À l’inverse, ainsi que le rappelait Yves Congar, « le gallicanisme et le jansénisme trouvaient évi-demment leur compte dans le rôle joué, presque jusqu’à la Révolution, par la Faculté de théologie de Paris, les docteurs de la Sorbonne, vivant du maintien de traditions à l’encontre des empiétements ou des nouveautés d’un pouvoir discrétionnaire »70. Conclusion que retrouvait en 1993 Bruno Neveu dans son grand livre intitulé L’ erreur et son juge, lorsqu’il retraçait l’évolution de la pratique théologique à l’âge moderne : « Avec les auteurs de la fin du xviiie siècle se clôt un âge de la théologie : sous l’effet des bouleversements politiques et de l’affaiblissement du savoir ecclésiastique, la théologie positive, la sco-lastique moderne, la science juridique in utroque, entrent en obsolescence et font place à une affirmation de plus en plus autoritaire de la puissance ponti-ficale qui répond au tropisme catholique en direction de Rome »71. Qu’il y ait donc eu une crise française de l’ecclésiologie italienne, rien d’étonnant – gal-licanisme et jansénisme constituaient deux puissants courants catholiques antiromains ; leur nature, mieux, leur ancrage historique, les rattachaient à
sur les libertés de l’Église gallicane, Paris, 1826, p. xVI.70 Y. Congar, « L’ ecclésiologie de la Révolution française au concile du Vatican », art. cité, p. 105.71 B. Neveu, L’ erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l’ époque moderne, Naples, 1993, p. 29.
Université de Savoie
Les échanges reLigieux entre L’itaLie et La France, 1760-1850
78
un âge du magistère en voie de péremption ; ils restaient néanmoins des obs-tacles doctrinaux à liquider. D’où la référence constante aux auteurs français dans les ouvrages italiens d’ecclésiologie. Dans son étude fondamentale sur L’ infaillibilité et son objet, Jean-François Chiron notait à propos de la brochure de Muzzarelli consacrée au problème des rapports entre fait dogmatique et foi catholique : « C’est bien la problématique, toute française à l’origine, qui continue à s’acclimater en Italie »72. Se disputant tour à tour les suffrages de l’Aigle de Meaux ou du Cygne de Cambrai, les auteurs italiens ont nourri leur réflexion assidue d’une fréquentation parfois hostile, parfois admirative, toujours constante des grands monuments français des traditions gallicane et janséniste. Titre à quoi l’ecclésiologie italienne du moment intransigeant apparaît comme puissamment déterminée par son affrontement au legs ambigu de l’antiromanisme de France avant d’imprégner en retour, par une profitable revanche, l’arsenal doctrinal d’ultramontains avides de s’appuyer sur des textes qui bénéficiaient de la légitimante caution du souverain ponti-ficat et de la curie romaine.
72 J.-Fr. Chiron, L’ infaillibilité et son objet. L’ autorité du magistère infaillible de l’Église s’ étend-elle aux vérités non révélées ?, Paris, 1999, p. 137.
Université de Savoie
Laboratoire
Langages
Littératures
Sociétés
Les
éch
ange
s re
ligi
eux
entr
e l’
Ital
ie e
t la
Fra
nce
Université de SavoieISBN: 978-2-915797-61-9ISSN : 1771-6195
Les échanges religieux franco-italiens de 1750 à 1850 ? L’objet ne s’impose pas à l’évidence. Pourtant sa cohérence se justifie par la période choisie : enjamber la période révolutionnaire permet de restituer des mouvements de fond de la vie de l’Église aux prises avec des débats totalement inédits dans le cadre d’une Europe en bouleversement. De l’Aufklarung au tournant intransigeant, il y a bien ici un temps crucial de l’évolution de la catholicité caractérisé, notamment, par son recentrage autour de Rome, comme le rappelle la couverture de cet ouvrage. Il ne s’agissait pas de revenir sur les événements eux-mêmes ; les aspects diplomatiques et politiques, mieux connus, ont été écartés. Les organisateurs ont voulu privilégier une approche dynamique selon le principe des flux : mouvement des hommes et des femmes, des doctrines, des dévotions, des pratiques, des institutions, etc. avec une attention marquée à la notion de réseaux qui les canalisent. La période envisagée, du milieu du xviiie siècle au milieu du xixe siècle, se révèle alors dans son unité, en dépit de – ou grâce à – la rupture révolutionnaire. Elle fut, notamment, un temps de maturation des positions de l’Église catholique et de réorientation de la vie religieuse face aux profondes transformations contemporaines, de la réaction aux Lumières jusqu’aux événements décisifs de 1848-1850. En somme, il s’agissait de saisir les évolutions en termes de diffusion et de réception de modèles et de traditions, profondément enracinées ou réinventées. Les échanges de toutes natures, dont il n’était pas question ici de dresser l’inventaire, participèrent bien à nourrir la réponse catholique aux défis multiples d’un siècle de mutations accélérées.
Frédéric Meyer et Sylvain Milbach sont maîtres de conférences à l’Université de Savoie.
20 €
SociétésReligionspolitiques
Les échanges religieux entre l’Italie et la France,
1760-1850Regards croisés
-
Scambi religiosi tra Francia e Italia,
1760-1850Sguardi incrociati
Textes réunis par
Frédéric Meyer et Sylvain Milbach
15
Illustration de couverture : « Le pape Pie VII ». Frontispice à François-Marie Bigex, Étrennes religieuses aux fidèles du diocèse de Genève pour l’an de grâce mil huit cent un, an Ier du dix-neuvième siècle, an 2 du pontificat de Pie VII, s.l., 1801, un volume in 12°. Collections Bibliothèque municipale de Chambéry (SEM P 814) ; cliché Éric Beccaro.