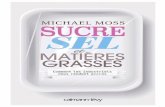Formes et matières d'un dieu incarné. Les images du Christ à Rome, IIIe-IXe siècles
-
Upload
univ-montp3 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Formes et matières d'un dieu incarné. Les images du Christ à Rome, IIIe-IXe siècles
Formes et matièresd’un dieu incarné
1 Religions & Histoire no 51
DOSSIER Figurer le Christ
Les images du Christ à Rome IIIe-IXe sièclesL’Ancien Testament, livre commun aux trois religions monothéistes,
contient un précepte clair sur les images : « Tu ne te feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, oudans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux ni ne les serviras. »(Deutéronome 5, 8-9). Pourtant, à la différence du judaïsme et de l’islam, le christianisme a vite admisla figuration de la divinité. L’Incarnation est la clé de ce choix : Dieu lui-même a en effet accepté la matière en décidant de revêtir un corps humain en la personne du Fils. Ainsi, au cours des premierssiècles de notre ère, tandis que des auteurs chrétiens s’interrogeaient encore sur la légitimité desimages, de nombreuses figurations du Christ occupaient les espaces funéraires romains, puis lesédifices de culte, devenant parfois même l’objet de pratiques de vénération.
Alessia TRIVELLONE, maître de conférences à l’université Paul-Valéry Montpellier 3
Hélas perdues, les deux statues du Sauveurpesaient respectivement 120 et 140 livresromaines, ce qui laisse imaginer qu’ellesétaient de grande dimension.Dans les églises romaines du Ve siècle, la figuration du Christ en vient à dominercomplètement l’espace ecclésial. La plusancienne abside décorée conservée est celle de l’église Santa Pudenziana (début du Ve siècle), avec sa mosaïqueprésentant le Christ au milieu des apôtres(toute la partie droite est cependant unajout Renaissance). Sur d’autres, commecelle de la basilique Santi Cosma eDamiano (526-530), copiée ensuite dansd’autres absides romaines (comme à SantaPrassede, 817-824, ou à San Marco, 827-844), le Christ descend du ciel surune échelle de nuages et semble s’avancervers la nef. Or, il ne faut pas oublier quedans la basilique chrétienne, l’abside repré -sente le point focal de l’espace : c’est làque le regard du fidèle se dirige naturel-lement lorsqu’il entre dans l’édifice etavance le long de la nef encadrée par deuxfiles de colonnes. L’espace ecclésial envient ainsi à être complètement construitautour des mosaïques absidiales, où ontrouve le plus souvent l’image triomphantedu Christ, associée à celles des apôtresou des intercesseurs.À partir du VIIIe siècle, le Christ est éga -lement figuré selon une autre formule ico-nographique au centre de l’espace deséglises romaines : en effet, selon le Liberpontificalis, plusieurs papes auraient commandité des crucifix monumentauxen or et en argent, pour les placer prèsdes autels majeurs ou au centre de l’église.L’inven tion de la formule iconographiquedu Christ en croix était survenue quelques
2Religions & Histoire no 51
« L’espace ecclésial en vient ainsi à être complètement construit autour des mosaïques absidiales, où on trouve le plus souvent l’image triomphante du Christ, associée à celle des apôtres
ou des intercesseurs. »
Le Liber pontificalis est un recueil debiographies des papes, de saint Pierrejusqu’au XVe siècle, compilé à diversesépoques (le premier recueil datevraisemblablement du début du VIe siècle).
Le Christ au milieu des apôtres, mosaïque, début du Ve siècle, Rome, église Santa Pudenziana,abside. La partie droite de la mosaïque date du XVIe siècle ; elle représente le pape Paul III Farnèseet des membres de sa famille. © Andrea Jemolo / Scala, Florence
Les images du ChristDe l’art funéraire…Une lettre qu’Eusèbe, évêque de Césaréemort en 339-340, écrit à Constantia, sœur de l’empereur Constantin, laisseentendre que cette dernière lui a demandéune image de Jésus. Même si, dans saréponse, Eusèbe montre tout son scepti-cisme quant à la possibilité de représenterla divinité du Fils de Dieu, la demande de Constantia indique que des portraitsmobiles du Christ, destinés sans doute àune vénération domestique, circulaientalors parmi les fidèles. Nous n’en conser-vons toutefois aucune trace matérielle.C’est dans l’art funéraire que l’on trouveles plus anciennes images christologiquesqui soient encore conservées. Dans lespein tures des catacombes, le Christ appa-raît surtout dans des scènes narratives leprésentant de l’enfance à l’âge adulte.Les sarcophages sculptés constituentaussi, à partir du IVe siècle, un importantlieu d’élaboration de formules icono -graphiques du Christ. Le plus souventimberbe, selon la tradition ancienne, ilest figuré tantôt dans des scènes évangé-liques, souvent en train d’accomplir desmiracles, tantôt au milieu des apôtres.
… au décor des basiliques et églisesQuant au décor originel des basiliquesconstantiniennes, malheureusement dis-paru, on ne peut qu’avancer de prudentessuppositions. On sait, par exemple, queles absides des basiliques Saint-Jean-du-Latran et Saint-Pierre ne présentaient qu’unrevêtement en tissu doré (camera fulgens).L’image du Christ ne devait toutefois pasen être complètement absente. Selon leLiber pontificalis, Constantin avait offert àl’église Saint-Jean-du-Latran deux statuesen argent du Christ pour un fastigiumargenteum (probablement un élément deséparation entre le chœur et la nef) : ducôté des fidèles, le Christ apparaissaitparmi les douze apôtres, alors que du côtédu chevet, il était flanqué par des anges.
siècles auparavant, à Rome toujours, oùla scène de la Crucifixion avait été sculptéesur la porte en bois de cyprès de SantaSabina all’Aventino (422-432). Au coursdes VIIIe et IXe siècles, c’est dans desmatières précieuses que le Christ en croixest figuré, pour être placé à l’intérieur del’église. Léon III (795-816) fait réaliserdeux crucifix en argent pour l’église Saint-Pierre, l’un de 52 livres, placé à proximitéde l’autel, et l’autre, de 72 livres, in medioecclesiae (au milieu de l’église). Après lesdéprédations sarrasines de 846, Léon IV(847-855) fait réaliser un autre crucifixpour la même basilique, en argent doréorné de pierres précieuses, pesant quelque77 livres. L’usage de crucifix monumen-taux en métal est attesté ailleurs à partirdu VIIe siècle : par exemple, dans la cathé-drale de Metz, en 636, et à Saint-Étienned’Auxerre, entre 813 et 829.
Le pape et la vénération des imagesCes crucifix commandités par les papespermettent de mieux reconstruire l’attitudedes pontifes vis-à-vis des images du divin.On sait en effet qu’en dépit des positionscritiques de l’empereur Charlemagne, lepape Adrien Ier (772-795) avait accueilliavec ferveur les décisions du concile deNicée II (787), qui mettaient un terme àla première période iconoclaste dansl’Empire byzantin et introduisaient l’ado-ration des images. Nicolas Ier (858-867)avait, lui aussi, défendu la légitimité desimages contre les positions iconoclastesde Photius, patriarche de Constantinople ;sur les figurations du divin, les positionsde l’évêque de Rome étaient proche descanons du concile de Nicée. Or, selon lesNicéens, l’hommage à l’icône du Christ,de la Vierge Theotokos ou des saints devaitêtre rendu à travers une proskynèse, soit
le geste de prosternation utilisé à l’égardde l’empereur. L’adoration des figurations de la divinitéest peut-être représentée, au IXe siècle,dans deux images de la péninsule italique.Dans la mosaïque de Santa Maria inDomnica, le pape Pascal Ier (817-824) estagenouillé devant une Vierge à l’Enfantdont il touche le pied. Le contraste entrele pontife, de trois-quarts et au premierplan, et l’image de la Vierge Theotokos,rigidement frontale, est saisissant : toutlaisse croire que Pascal Ier, vivant commeson nimbe carré l’indique, se prosterneici devant une icône. La mosaïque deSanta Maria in Domnica constitue ainsi
3 Religions & Histoire no 51
DOSSIER Figurer le Christ
Le pape Pascal Ier vénérant la Vierge à l’Enfant,mosaïque, 817-824, Rome, église Santa Maria in Domnica, abside. © Akg / De Agostini Picture Library
« Selon les Nicéens, l’hommage à l’icône du Christ, de la ViergeTheotokos ou des saints devait être rendu à travers une proskynèse,c’est-à-dire le geste de prosternation utilisé à l’égard de l’empereur. »
une véritable prise de position du pape,qui se fait représenter en train d’adorerune image à l’époque même où l’Orientest secoué par une deuxième crise icono-claste (813-843). L’image de l’évêqueÉpiphane, dans les fresques de la cryptede l’abbaye San Vincenzo al Volturno (824-842), est construite selon le mêmeschéma : doté du nimbe carré des vivantset au premier plan, jusqu’à empiéter surle cadre, le prélat s’agenouille devant leChrist en croix. Ce dernier pourrait renvoyerà l’un des crucifix de grande taille placésprès des autels des églises romaines etque l’on retrouve cités dans les diversexemplaires du Liber pontificalis.Les sources écrites et les documents ico-nographiques convergent donc pour indi-quer que les papes des VIIIe et IXe sièclesont défendu la légitimité des images demanière presque ininterrompue, allantjusqu’à rendre hommage aux figurationsdu Christ et de la Vierge comme le pres-crivait le concile de Nicée II. Dans la pra-tique, l’image était donc revêtue d’unesacralité particulière. Dans ces conditions,nul doute que sa forme et sa matièredevaient être soigneusement choisies.
La matière d’un dieu incarnéDes images bidimensionnelles ou tridimensionnelles?Ce rapide panorama permet d’invaliderune idée courante et tenace, selon laquellele premier art chrétien aurait rejeté lesimages tridimensionnelles de la divinité ;bannies car associées aux idoles païennes,elles ne seraient réapparues qu’au coursdu Xe siècle. Or, il suffit de penser auxfigures christologiques sur les sarcophagesdu IVe siècle, aux statues commanditéespar l’empereur Constantin pour la basilique
Saint-Jean-du-Latran, au Christ en croixsculpté sur la porte en bois de SantaSabina all’Aventino au Ve siècle ou encoreaux crucifix d’or et d’argent commanditéspar les papes au cours des VIIIe et IXe
siècles, pour se rendre compte du carac-tère erroné de cette hypothèse. Ces figu-rations tridimensionnelles sont d’ailleursloin d’être une exception romaine. Nous
avons vu qu’un crucifix, probablement enargent repoussé, était présent à Metz auVIIe siècle ; dans les îles britanniques, lescroix monumentales en pierre ornéesd’images du Christ marquent les espacesextérieurs dès le VIIIe siècle – la croix deRuthwell en est probablement l’exemplele plus célèbre. À Cividale del Friuli, dansle royaume lombard, des statues de saintesen stuc sont réalisées presque en ronde-bosse avant 774, date de la conquêtecarolingienne. Il semble par conséquentjudicieux d’abandonner la distinction entrebidimensionnalité et tridimensionnalité,pour focaliser la réflexion sur la matièredes images du Christ.
4Religions & Histoire no 51
L’abbé Épiphane devant la Crucifixion (détail),fresque, 824-842, abbaye de San Vincenzo al Volturno, crypte. © Valentino Pace
Déisis : la Vierge, saint Jean-Baptiste et le Christ-lumière, mosaïque,817-824, Rome,église Santa Prassede, chapelle de Saint-Zénon. © Kunsthistorie.com / D.R.
De l’or, de l’argent, des pierres précieuses…La richesse des matériaux semble une des caractéristiques les plus recherchéespour les figurations chrétiennes. C’estcette attention au raffinement de lamatière, ainsi qu’une nouvelle réflexionsur la lumière, qui pourraient avoir menéles chrétiens à revisiter la technique de la mosaïque, autrefois utilisée surtout dans les thermes ou comme revêtementdes sols. Dans les absides, les tessellesde marbre et de pierre propres auxmosaïques de l’Antiquité sont remplacéespar la pâte de verre, parfois posée sur des feuilles d’or, et par des pierres auxcouleurs brillantes. En ce qui concerneles sculptures en pierre et en bois, ainsique les réalisations en stuc, il convientde rappeler que, durant le haut MoyenÂge, elles étaient normalement peintes et pouvaient être enrichies de gemmes.Ce procédé courant fut particulièrementexploité dans les royaumes barbares.Maîtri sant les techniques de l’orfèvrerie,les artisans de ces territoires les appli-quaient à des objets de grandes dimen-sions. Le célèbre autel de Ratchis, qui Jean-le-Baptiste s’avancent bras tendus
vers une fenêtre. Dans l’art byzantin, cesdeux personnages sont habituellementplacés à côté du Christ dans la formuleiconographique de la déisis. Or, tout laisseentendre que c’est également le cas dansla chapelle dédiée à saint Zénon : enaccord avec le verset de l’Évangile selonJean 8, 12 (« Jésus, à nouveau, leuradressa la parole : “Je suis la lumière dumonde” »), le Christ est ici la lumière quipénètre par l’ouverture. Aucune convictioniconoclaste n’inspire cette étonnante solu-tion figurative : le Sauveur est, en effet,représenté dans la mosaïque de la mêmechapelle, au sommet de la voûte.Cette évocation du Christ-lumière n’estpas une invention romaine du IXe siècle.Elle avait en effet déjà été adoptée dansle prétendu tempietto annexe au palaisdu gastald lombard, à Cividale de Friuli,avant 774. Sur la contre-façade de cetédifice, deux cortèges de saintes en stucse répartissent de part et d’autre d’unefenêtre (aujourd’hui condamnée), et lesfigures centrales tendent les bras verscette ouverture.
5 Religions & Histoire no 51
DOSSIER Figurer le Christ
apparaît aujourd’hui comme un bas-relief,était à l’origine une œuvre polychromedont les alvéoles en champlevé étaientremplies de pâte de verre.
… et de la lumièreDes réflexions théologiques semblent par ailleurs inspirer quelques évocations originales du Christ. Au IXe siècle, à Rome,dans la chapelle funéraire que le papePascal Ier (817-824) fait ériger dansl’église Santa Prassede pour sa mère etqu’il dédie à saint Zénon, la Vierge et saint
Christ en gloire, face principale de l’autel de Ratchis, vers 737-744, Cividale del Friuli,Museo cristiano. À l’origine, ce bas-relief étaitpolychrome et orné de pâte de verre. © Photo Scala, Florence
Dans ce cas également, il s’agit d’unereprésentation du Christ vera lux (lumièrevéritable). Ce choix est encore plus frap-pant ici, la divinité immatérielle contras-tant fortement avec les corps des femmesqui émergent de la paroi. Tout comme àRome, il ne s’agit pas de l’expression d’unrefus de la représentation du divin : desfresques de la même époque figurent leChrist, juste en dessous de la fenêtre,dans un « portrait » identique à celui deConstantin-Apollon-Soleil…
Un art inventifAinsi, au cours des premiers siècles duchristianisme, alors que des doutes sur la légitimité des images se font encoreentendre en Occident, les images du Christinterviennent dans différents domaines
Saintes avançant vers le Christ-lumière, avant 774, Cividale del Friuli, tempietto. © Akg-images / Cameraphoto
(domestique, funéraire, liturgique) de lavie du chrétien. Rome s’affirme rapidementcomme un centre d’expériences iconogra-phiques en la matière. Par leurs prises depositions et par leurs commandes, lespapes défendent la légitimité des images,allant probablement jusqu’à des pratiquesde vénération, y compris dans les périodesoù les icônes font l’objet de violents débatsen Orient. La volonté de représenter ladivinité incarnée constitue un défi que lesartistes chrétiens parviennent à relever enélaborant un foisonnement de formes eten utilisant les matériaux les plus précieux,ou bien en mettant en place des solutionsfiguratives originales où la lumière est pro-tagoniste. Sont ainsi posées de solidesbases à l’inventivité qui caractérise l’artmédiéval occidental ultérieur.
BIBLIOGRAPHIE
ANDALORO Maria et ROMANO Serena, Arte e iconografiaa Roma dal tardoantico alla fine del Medioevo, Milan,Jaca Book, 2002.MENOZZI Daniele, Les images. L’Église et les arts visuels,Paris, Cerf, 1991.PACE Valentino (dir.), L’VIII secolo : un secolo inquieto.Atti del convegno internazionale (Cividale del Friuli,4-7 dicembre 2008), Cividale del Friuli, Comune diCividale del Friuli, 2010.SCHMITT Jean-Claude, Le corps des images. Essais surla culture visuelle au Moyen Âge, Paris, Gallimard,2002.SCHÜPPEL Katharina Christa, Silberne und goldeneMonumentalkruzifixe. Ein Beitrag zur mittelalterlichenLiturgie- und Kulturgeschichte, Weimar, VDG, 2005.
6Religions & Histoire no 51
Dans les royaumes lombards, le gastaldest le fonctionnaire chargé de la gestionéconomique d’une partie du domaineroyal. Il pouvait également représenter le roi sur les plans militaire et judiciaire.